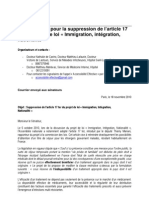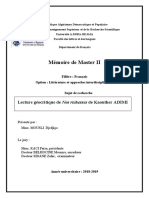Professional Documents
Culture Documents
Langage Et Violence Dans La Littérature Africaine Écrite en Français
Uploaded by
Gabrielle VerdierOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Langage Et Violence Dans La Littérature Africaine Écrite en Français
Uploaded by
Gabrielle VerdierCopyright:
Available Formats
NGALASSO Mwatha Musanji : Langage et violence dans la littérature africaine écrite en français
LANGAGE ET VIOLENCE
DANS LA LITTERATURE AFRICAINE
ECRITE EN FRANÇAIS*
NGALASSO Mwatha Musanji
Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3
La violence est un concept difficile à cerner par le discours, en raison de l'ambiguïté de
notre attitude à son égard : elle nous répugne (nous nous déclarons volontiers "contre" la violence)
autant qu'elle nous fascine (nous cachons mal notre penchant naturel "pour" le spectacle de la
violence que ce soit dans la rue, au cinéma ou dans les livres). Notre moi rationnel abhorre ce
qu'adore notre moi animal. De sorte que le discours sur la violence, généralement anti-violence,
même s'il n'est pas toujours lui-même dépourvu de violence, est souvent simple affichage de cette
rationalité fréquemment contrarié et contredite par l’animalité. Une animalité qui pousse les
détenteurs du pouvoir à l’usage de la force physique ou idéologique comme moyen de
gouvernement. Dans ces conditions la violence discursive ou scripturaire, qui, seule, nous
intéresse ici, apparaît comme une forme de contre-pouvoir, une arme redoutable entre les mains
des sans-pouvoir.
Etudier la relation entre la violence et le langage1 dans la littérature africaine d'expression
française c'est s'interroger sur les usages qui sont faits de l'écriture comme moyen d'influence et
sur la manière dont la langue d'écriture, en l'occurrence le français, se trouve (mal?)traitée comme
outil de création par des écrivains dont elle n'est pas la langue native. Il ne s'agit surtout pas de
revenir sur le vieux (et bien inutile) débat concernant la relation personnelle de l'écrivain à la langue
d'écriture (la liberté de celui-ci doit être totale en la matière) ; il s'agit plutôt de tenter d'apprécier
l'efficacité d'une langue seconde apprise formellement et de comprendre son évolution dans un
environnement où elle coexiste, de façon dynamique, avec les langues maternelles acquises
naturellement.
*Une version abrégée de cet article est parue dans Notre Librairie, numéro 148 (2002)
1
Robert Gauthier (1999 : 45) note, avec justesse, que “ violence et langage ont la même origine : le désir d’exister,
de maîtriser, de se protéger, de se reproduire, de se survivre. Le désir est violence puisqu’il implique de s’intégrer
l’autre, de s’approprier l’objet convoité, de se rendre pareil à un modèle, donc de se faire violence ”.
Centre d'Etudes Linguistiques et Littéraires Francophones et Africaines
Article en ligne
-1-
NGALASSO Mwatha Musanji : Langage et violence dans la littérature africaine écrite en français
La violence est omniprésente dans la littérature à travers les thèmes éternels de la vie, de
l'amour et de la mort. Les mots et les images qu’ils portent, par le biais de l'écriture, sont sa
meilleure expression. Mais l'écriture, en tant que travail sur les mots et sur la syntaxe, élaboration
et "refaçonnage" des formes du langage, n'est-elle pas aussi une forme de violence sur la langue ?
Ecritures de la violence
Cette expression2 réfère, ici, non seulement à la littérature qui fait de la violence son thème
privilégié mais aussi et surtout aux formes d'écriture qui marquent, d'une manière plus ou moins
brutale, une solution de continuité avec l’état des choses précédent. Georges Ngal (1994) parle de
"rupture" comme moteur de la création littéraire. Cette notion de rupture qui, depuis quelques
années, occupe une place de choix dans la réflexion sur les littératures africaines3, renvoie
explicitement à toute (r)évolution chronologique (changement d’époques qui autorise de nouvelles
périodisations), thématique (surgissement de nouveaux thèmes), structurelle (renouvellement des
structures du récit ou de la poésie) ou stylistique (contravention aux normes linguistiques et
esthétiques établies), observable dans le mouvement de la création littéraire et sentie comme
coupure, discontinuité, modification, saut qualitatif. La violence, dans ce cas, réside dans le refus
du conformisme, l'ébranlement des habitudes acquises, le “ refus de respecter la loi du silence, en
écrivant aussi sur ce qu'il ne faut pas dire ” (Borgomano, 1995 : 74), dans la transgression des
tabous scripturaires au nom du principe que toute vérité, même celle qui n'est pas bonne à dire,
est bonne à écrire. C’est un acte de libération de l'écriture de toutes les formes d'enchaînement ou
d'enfermement, que ce soit par la tradition, par la religion ou par l'idéologie. Elle est fondée sur la
contestation et la dénonciation d'une situation initiale jugée inacceptable et sur le désir de fonder
un ordre nouveau considéré comme nécessairement meilleur.
Il s’agit donc, pour le critique, de rompre, lui aussi, avec une historiographie littéraire dont
l'ambition serait de retracer des étapes invariables d'une littérature africaine une et uniforme. La
littérature africaine est, en réalité, plurielle du fait de la pluralité des itinéraires personnels des
auteurs, de la diversité des thèmes exploités, de la variété des médiums linguistiques utilisés.
L'écrivain africain des années 2000 n'est plus le Négro-africain apatride luttant, dès les années
2
Elle fut utilisée dans le titre d’un livre récent par Ngandu (1997). Voir notre compte-rendu de cet ouvrage dans
Notre Librairie, 135 (1998) : 87.
3
Sewanou Dabla (1986) a été parmi les premiers à analyser rigoureusement le phénomène des “ nouvelles écritures
africainres ”. De son côté, s’agissant de la littérature du Maghreb, M’hamed Alaoui Abdallaoui (1989) utilise le
terme “ ruptures ” pour caractériser à la fois le mouvement d’abandon et de retour des auteurs maghrébins à la langue
arabe (ou, si l’on préfère, d’adoption puis de rejet de la langue française). Un point de vue critique sur la notion de
“ rupture ” est donné par Mateso (1990).
Centre d'Etudes Linguistiques et Littéraires Francophones et Africaines
Article en ligne
-2-
NGALASSO Mwatha Musanji : Langage et violence dans la littérature africaine écrite en français
1930, à partir de Paris, pour la reconnaissance d'une identité niée ; il n'est plus un homme
politique déguisé en poète ni, d'ailleurs, seulement un homme (car les femmes aussi écrivent4) ni
même un thuriféraire de la langue classique (puisqu'on écrit de plus en plus en "français local"5).
Avec la fin de l’époque coloniale la négritude a cessé d'être le thème-phare de la littérature et le
français n'est plus (l’a-t-il jamais été ?)6, l'unique langue de la création littéraire. Rupture dans la
chaîne de production et dans l’instrument de travail. Rupture aussi du côté du consommateur, du
lecteur-destinataire qui n'est plus potentiellement euroccidental ni exclusivement francophone.
Rupture enfin par l'intrusion de l'oralité dans la scripturalité. La notion de “ génération littéraire ”
elle-même bouge : les Ahmadou Kourouma, Jean-Marie Adiaffi, Henri Lopès, Sony Labou Tansi,
Aminata Sow Fall, Vumbi Yoka Mudimbe, Tierno Monenembo, considérés naguère (dans les
années 1980) comme représentant le “ nouveau courant ” sont déjà bousculés par les jeunes nés
autour des années 1960 (les Calixthe Beyala, Marie Ndiaye, Véronique Tadjo, Bolya Baenga,
Kangni Alemjrodo, Alain Mabanckou, Abdourahaman Waberi, etc.).
Pour exprimer les conflits (des traditions, des classes ou des générations), exacerber le
sentiment de crise et justifier la rupture l’écriture opère sur un mode essentiellement agonique qui
souligne les oppositions et les antagonismes plutôt que sur le mode irénique qui recherche
l'entente et le consensus. Ce contre quoi elle s'élève avec virulence ce sont toutes les violences
vécues, individuellement ou collectivement, dans l'histoire passée ou immédiate du continent
africain : l’esclavage, le racisme, le colonialisme, la dictature, le népotisme, la marginalisation.
Une étude attentive des thèmes de la littérature africaine écrite en français révèle,
notamment à travers les titres des oeuvres romanesques, poétiques ou théâtrales7, un imaginaire
particulièrement débridé : il s'agit, le plus souvent, de caractériser ou de stigmatiser, d'un mot ou
d'une phrase, la dégradation permanente des sociétés africaines (celle que dépeint Sony Labou
Tansi dans ses romans comme dans ses pièces de théâtre), de dénoncer un univers social violent,
hostile et inhospitalier (celui que décrit, par exemple, Ahmadou Kourouma dans Allah n'est pas
obligé) qui appelle, à son tour, la violence physique (crimes et délits), psychologique (magie et
sorcellerie), politique (violence idéologique ou régalienne) ou verbale (parole injurieuse ou
maldisante) qui habite l'espace du quotidien africain : en famille, dans la rue, au marché, au lieu de
travail ou de loisir. Il s’agit aussi de formuler, de manière lapidaire et percutante, les nouvelles
4
L’entrée des femmes en littérature dans les années 1970-80 est l’un des événements les plus importants de
l’histoire africaine. Citons quelques pionnières : Clémentine Nzuji-Madiya avec Kasala et autres poèmes (1969),
Aminata Sow Fall avec Le revenant (1976) et La grève des Battù (1979), Nafissatou Diallo avac De Tylène au
Plateau (1976), Mariama Bâ avec Une si longue lettre (1979), Marie-Léontine Tshibinda avec Poèmes de la terre
(1980) . La relève est, aujourd’hui, largement assurée avec des “ écrivaines ” au talent incontestable comme Ken
Bugul (Sénégal), Véronique Tadjo et Tanella Boni (Côte-d’Ivoire), Angèle Ntyugwetondo Rawiri (Gabon), Werewere
Liking, Calixthe Beyala et Evelyne Mpoudi-Ngolle (Cameroun) et bien d’autres.
5
Un bon exemple en est fourni par Les Matitis : mes pauvres univers en contre-plaqué, en planche et en toile du
Gabonais Hubert Freddy Ndong Mbeng (1992).
6
Sur cet aspect lire notamment Gérard (1971 et 1981), Ngandu (1992) et Ricard (1995).
7
Voir les différentes et très riches livraisons du LITAF : Notre Librairie, numéros 94, 129 et 147.
Centre d'Etudes Linguistiques et Littéraires Francophones et Africaines
Article en ligne
-3-
NGALASSO Mwatha Musanji : Langage et violence dans la littérature africaine écrite en français
problématiques de la vie en ville ou à l’étranger, dans ce perpétuel mouvement de migration et
d’exil à l’intérieur ou à l’extérieur de son pays.
Une part importante de la littérature africaine d'aujourd'hui procède de la dénonciation des
maux dont souffre la société, de la contestation des remèdes proposés par les responsables et de la
révolte contre l'impuissance à changer le monde dans lequel vivent les Africains. L'écriture de la
violence apparaît alors comme une façon de lutter, avec les mots, contre la décrépitude de la
pensée, le cynisme des idéologies et l'absurdité des actions de ceux qui ont en charge le destin de
leurs concitoyens ; comme une thérapeutique collective par la conscientisation des citoyens-
lecteurs. Encore faut-il que ceux-ci soient formés au difficile exercice de la lecture, qu'ils entendent
le message en un langage qui leur soit accessible et qu'ils soient en nombre suffisant pour
prétendre changer réellement le cours des événements.
Violence du verbe
C’est à la violence brute par la contrainte physique et idéologique que s’ oppose la
violence douce de la persuasion par la parole orale ou écrite, comme antidote au dogmatisme et au
fanatisme. La littérature, quand elle est engagée, ce qu'elle est presque toujours, use des mots dont
l’entrechoc peut produire des effets catastrophiques (combien d'écrivains ont connu la mort8 ou
l'exil9 ? combien d'autres croupissent encore dans des prisons sordides pour "délit d'écriture" ?) ou
salutaires (par exemple on a cru voir dans les indépendances africaines, au début des années 1960,
la conséquence directe de l’engagement politique des écrivains et artistes du monde noir). Les
mots ont donc un pouvoir ; les mots sont un pouvoir10. En particulier ceux qui relèvent de la
cacophémie, univers nébuleux de la maldisance dont le rapport à la violence est patente. Je m’en
tiendrai, ici et pour l’instant, à cette seule catégorie de violence verbale dont je voudrais relever
quelques manifestations fortes et indiquer la fonctionnalité essentielle dans l’énonciation littéraire
africaine.
Jurons, insultes, injures et autres gros mots
8
On pense avec émotion au Nigérian Ken Saro-Wiwa sauvagement exécuté en 1995, mais aussi aux tribulations du
Guinéen William Sassine et du Congolais Sony Labou Tansi morts de solitude et "de chagrin", ce qui est un
euphémisme.
9
Ce fut le sort notamment du Kenyan Ngugi Wa Thiong'o, du Nigérian Wole Soyinka, premier Prix Nobel de
littérature africain, des Algériens Noureddine Aba et Rachid Mimouni, et bien d’autres.
10
Lire, à ce sujet, Ngalasso (1996).
Centre d'Etudes Linguistiques et Littéraires Francophones et Africaines
Article en ligne
-4-
NGALASSO Mwatha Musanji : Langage et violence dans la littérature africaine écrite en français
Parmi les procédés langagiers, mots, expressions ou énoncés, qui entrent dans la violence
verbale ordinaire il y a les insultes et les injures11, ces paroles offensantes dirigées contre autrui ou
contre soi-même ; il y a les gros mots (jurons, blasphèmes et autres imprécations) définissable
essentiellement par leur caractère de transgressions gratuites. Ces catégories, qui ne sont pas à
confondre, malgré leur forte proximité sémantique et fonctionnelle, s'inscrivent directement dans le
registre de la grossièreté, de la malséance et de l'obscénité, en raison de leur rapport au sexe, à
l’infirmité, à la mort et à la matière fécale. Les “ gros mots ” ne sont pas seulement des mots
grossiers (mal dégrossis, dépourvus de finition et de finesse) qui impliquent une forte dépréciation
de soi et de l’autre ; ils se définissent aussi comme des “ bas mots ” en raison de leur usage
essentiellement oral et de leur fréquence particulièrement élevé dans les classes sociales dites
populaires qui en sont, du reste, les principaux producteurs. De là leur désignation ordinaire
comme “ mots vulgaires ” .
Or ces formes “ crues ” et vulgaires abondent dans les textes d’un grand nombre
d’écrivains africains contemporains qui les utilisent comme marques de style écrit. Parmi les
écrivains passés maîtres en la matière on cite souvent Sony Labou Tansi, Ahmadou Kourouma, et
Calixthe Beyala. On a parlé de "sexualisation" et de "fécalisation" chez Sony Labou Tansi
(Chevrier, 1998 : 118), d’ “ érotisme du style ” et d'écriture "scatologique" chez Ahmadou
Kourouma (Gassama, 1995 : 17), d'écriture "érotique" voire "pornographique" chez Beyala (Kom,
1996 : 67). La grossièreté du langage va souvent de paire avec la laideur des personnages, au
physique comme au moral.
Les héros de Sony Labou Tansi, dont la langue (celle des héros, bien sûr) opère à partir du
bas-ventre, ne sont pas seulement des êtres bêtes et méchants, cruels et grotesques, dotés, de
surcroît, d’un appétit (y compris sexuel) pantagruélique, ils sont aussi fréquemment des monstres
accablés des pires infirmités physiques et psychologiques comme dans L’état honteux (1981) où
la hernie de Martillimi Lopez est à la fois la malformation d’un organe mâle et “ le symbole d'un
phallus hors de proportion qui semble avoir définitivement remplacé le siège de la pensée chez la
plupart des tyrans ” (Chevrier 1998 : 112). Sony accorde visiblement une place de choix à tout ce
qui concerne le “ bas-corporel ” ; dans La vie et demie (1979) c’est une véritable célébration qu’il
voue au "cul essentiel et envoûtant" de Chaïdana-à-la-grosse-viande, l'opposante farouche au
"Guide providentiel", capable de subir sans faiblir les assauts de ... 363 miliciens. Sony demeure le
maître incontesté de la dérision dont les victimes désignées sont les maîtres de ce monde, les
dinosaures de la politique, tyrans de leur état, décrits sous les traits les plus dégradants qui les
rabaissent au niveau de la pure bestialité. Tout cela est porté par un vocabulaire dont l’audace ne
connaît aucune limite, aucune censure.
11
La différence entre ces deux termes réside dans le fait que l’un (l’insulte) est un jugement asserté comme vrai et
vérifiable alors que l’autre (l’injure) est un jugement au delà de la vérité voire de la vraisemblance : l’insulte
s’apparente à la médisance alors que l’injure est une forme péremptoire de calomnie
Centre d'Etudes Linguistiques et Littéraires Francophones et Africaines
Article en ligne
-5-
NGALASSO Mwatha Musanji : Langage et violence dans la littérature africaine écrite en français
Ahmadou Kourouma est de ceux qui manient avec le plus d’aisance le gros mot, le juron,
l’injure et l’insulte qui se répandent par quantité dans tous ses textes. Le héros de son dernier
roman, allah n’est pas obligé (2000), Birahima, un “ sale gosse ” de 10-12 ans, devenu enfant-
soldat dans “ un pays foutu et barbare ” où “ tout le monde s’égorge ” et où il mène “ une vie de
merde ”, n’a que cela à la bouche : faforo, gnamokodé, walahé12. Ces mots grossiers proférés en
malinké, la langue maternelle de l’auteur, ne sont pas seulement la manifestation de la colère qui
sourd en lui ; ils servent aussi de ponctuation au récit sur toute sa longueur et fonctionnent comme
marques phatiques de maintien de la relation avec le lecteur et comme mots de clôture des
différents chapitres du livre. La langue malinkée n'apparaît pas ici dans la fonction communicative,
toute entière dévolue au français, mais uniquement dans les fonctions expressive et phatique à
travers les jurons, insultes et autres gros mots de Birahima. L'écrivain en langue seconde n'est donc
pas sujet à une amnésie totale face à sa langue maternelle : c'est l'histoire du palimpseste où la
langue oubliée n'est pas effacée de la mémoire et resurgit de sa trace, subrepticement, dans le texte
en langue d'écriture.
Un auteur beaucoup plus jeune qui se situe, sans complexe, dans la même veine du langage
scatologique, c’est le Congolais Bolya Baenga. La parution de son premier roman, Cannibale
(1986) avait déjà fait l’effet d’une bombe sur la scène littéraire africaine. Ses derniers titres ne sont
pas moins ragoûtants : La polyandre (1998), Les cocus posthumes (2001).
Parmi les femmes c’est assurément Calixthe Beyala qui va le plus loin dans l’audace
langagière. Cette “ amazone des lettres africaines ”, selon l’heureuse expression de Jacques
Chevrier, part résolument en guerre contre "la dictature des couilles" (entendez la “ phallocratie")
et parle, avec mépris, des "fesses coutumières", ces matrones africaines conservatrices des
coutumes rétrogrades de soumission et d’allégeance excessives aux pères géniteurs et aux maris
jaloux. La plupart de ses textes tournent autour du sexe. Le titre de son dernier roman n’est pas, à
cet égard, le moins évocateur : Comment cuisiner son mari à l’africaine (2000). Voilà qui fait dire
à la critique que “ sur ce plan l'oeuvre de Beyala constitue un point de rupture avec ses
devancières. Chez elle, la libération du corps féminin va de pair avec l'affranchissement du texte,
ce qui signifie à la fois subversion des codes littéraires habituels et élaboration d'un nouveau
discours romanesque ”, qu’on trouve chez elle “ une violence à la fois politique, idéologique et
rhétorique [...] qui entend faire émerger dans le corps du récit la réalité du corps féminin enfin
affranchi des fantasmes et des tabous qui en ont longtemps brouillé l'image ” (Chevrier, 1998 : 64).
Mais, bien entendu, la violence qui s’exprime par les mots du registre cacophémique a, dans la
communication, des fonctions énonciatives qu’il convient d’identifier très précisément.
12
Ces mots sont expliqués dès le début du roman (p. 10) : "Je dis pas comme les nègres noirs africains bien cravatés
: merde! putain! salaud! J'emploie les mots malinkés comme faforo ! (Faforo ! signifie sexe de mon père ou du père
ou de ton père). Comme gnamokodé ! (Gnamokodé ! signifie bâtard ou bâtardise). Comme walahé ! (Waladé !
signifie Au nom d'Allah)".
Centre d'Etudes Linguistiques et Littéraires Francophones et Africaines
Article en ligne
-6-
NGALASSO Mwatha Musanji : Langage et violence dans la littérature africaine écrite en français
Référentialité, expressivité et impressivité
En s’inspirant des polarités du langage mises en évidence par Roman Jacobson (1963),
Huston, dans Dire et interdire (1980), dégage une analyse des mots trangressifs qui me paraît tout
à fait pertinente à l’objet de la présente réflexion. Selon cette approche on peut identifier trois
fonctions majeures dans les usages de cette catégorie de mots en discours : les fonctions
référentielle, expressive et conative ou impressive.
Les procédés cacophémiques ont tous pour but, et c’est ce qui les unit, de déto(n)ner
bruyamment, donc de créer un électrochoc chez la victime-cible mais aussi chez le lecteur-
destinataire du message en transgressant, sans façons, les règles de bienséance, en violant, sans
vergogne, les tabous sociaux les plus stricts. Leurs armes favorites : la dérision, la raillerie, le
sarcasme, le ricanement. Leurs genres de prédilection : la satire, le pamphlet et, parfois, la
réécriture parodique des discours officiels. Leurs mots-clés : le dégoût, la nausée, le vomissement,
pouah ! Ces usages se retrouvent, évidemment, chez nombre d’auteurs africains actuels dont la
volonté de plus en plus affichée d'appeler un chat un chat contraste avec le style pudibond et
excessivement alambiqué des écrivains de la négritude.
L’écriture de la violence et de la transgression a donc pour fonction majeure de briser les
mythes, d’ébranler les certitudes, de démystifier les vérités uniques, de régler leur compte aux
contre-vérités, de rompre l'opacité et la non-transparence dans la communication, de briser la loi
du silence, de combattre la langue de bois. Le dernier roman de Kourouma nous en fournit un
excellent échantillon.
Certains des procédés transgressifs (les gros mots) ont une fonction référentielle évidente :
nommer l'innommable, dire l’indicible. Ainsi : Merde, Faforo (sexe de mon père) ou L’école ça
vaut pas le pet de la grand-mère, Un pet sorti des fesses ne se rattrape jamais. D’autres ont une
valeur expressive remarquable : extérioriser les sentiments intérieurs du sujet parlant ou écrivant ;
ce sont les jurons : Merde !, Gnamokodé (bâtard) !, Walahé (au nom d'Allah) !. D'autres encore
ont clairement une fonction impressive : blesser la victime ou choquer le lecteur, en tous cas
l’influencer de quelque manière ; ce sont les insultes et les injures qui ne se distinguent des autres
catégories que par leur tonalité et leur intentionnalité, puisque les formes utilisées peuvent être
rigoureusement les mêmes, comme on peut le voir avec Merde, selon le ton qu’on y met. Il se
situe sur le pôle du référent en tant que mot désignant une notion réputée obscène : la merde. Il
est expressif en tant que juron : Merde ! Il est impressif en tant qu’injure, c’est-à-dire un énoncé
dégradant à l’encontre du destinataire : Je te dis “ Merde ”, que “ tu es la merde ”. Ces trois
fonctions se trouvent d’ailleurs souvent imbriquées : par exemple les jurons, qui sont une marque
Centre d'Etudes Linguistiques et Littéraires Francophones et Africaines
Article en ligne
-7-
NGALASSO Mwatha Musanji : Langage et violence dans la littérature africaine écrite en français
d'expressivité du sujet parlant ou écrivant, implique, en même temps, un agressivité virtuelle
dirigée vers le destinataire, auditeur ou lecteur ; l’injure et l’insulte sont une manière de manifester
son animosité contre autrui (fonction expressive) en même temps qu’elles visent à le blesser, à le
provoquer ou à le faire agir (fonction impressive). Enfin l’usage que le narrateur (Birahima), ou
l’auteur qui se cache derrière lui (Kourouma), fait de faforo dans différents passages du roman,
notamment par les traductions très variables qu’il en donne, montre bien que ce mot n’a pas un
référent unique ; celui-ci peut être, en réalité, n’importe quel actant dans l’échange : le narrateur, le
lecteur voire l’auteur ; faforo peut donc signifier tantôt “ sexe du père ”, tantôt “ sexe de
mon/ton/son père ”.
Caliban et la langue de Prospéro
Une langue volée...
Les auteurs africains qui écrivent en français, utilisent une langue qui leur est, au départ,
étrangère. Bien souvent ils se sont appropriés cette "langue de l'autre" avec une assurance qui les
autorise à l'employer non seulement comme moyen de communication mais aussi comme outil de
création. Ce qui justifie, pour le français, le statut de "langue seconde" (Ngalasso, 1992). En cela
les auteurs africains, comme d'autres francophones non natifs, sont des "voleurs de langue". Sauf
que cet acte, qui se situe hors de la sphère morale, n'a rien d'ignominieux puisqu'il n'implique ni
l'idée de "spoliation" honteuse par le voleur ni celle de "privation" douloureuse pour le volé. Il n'y
a, par conséquent, ni culpabilité ni amertume d'aucune sorte.
La seule question pertinente qui se pose est de savoir si l'écrivain francophone, en
l'occurrence africain, dont le français n'est pas la langue naturelle, peut "écrire sans douleur" dans
cette langue d'emprunt, une langue dont un écrivain marocain francophone, Abdellatif Laâbi13, dit
qu'elle est "prêtée à un taux exorbitant". La réponse est évidemment non puisqu'on ne cesse jamais
d'être, au moins partiellement, étranger à une langue d'adoption dont on ne maîtrise jamais
totalement ni les subtilités et les nuances de l'expression ni l'étendue et la finesse de la culture
véhiculée. Le comble, sinon le drame, c'est quand l'adoption d'une langue seconde vous rend
étranger à votre langue originelle. Cette situation extrême de "double extranéité" est, fort
heureusement, chez la grande majorité des écrivains africains, qui sont généralement bien enracinés
dans leur langue et souvent parfaits polyglottes, une pure hypothèse d'école. Aux écrivains issus
de la nouvelle génération née dans l'immigration, pour qui le français est parfois l'unique langue de
13
Abdellatif Laâbi (1981), Traversée d'écriture, dans Visions du Maghreb, Paris, Edisud; cité par Alaoui Abdallaoui
(1989 : 15).
Centre d'Etudes Linguistiques et Littéraires Francophones et Africaines
Article en ligne
-8-
NGALASSO Mwatha Musanji : Langage et violence dans la littérature africaine écrite en français
communication et de création, l'interrogation ne se pose évidemment pas†: c'est l'idiome de leurs
parents qui est, pour eux, langue seconde voire langue étrangère.
... Une langue violée ?
L'écrivain africain francophone se trouve, actuellement, devant un impossible choix :
abandonner l'usage du français pour celui des langues locales identitaires, comme l'ont fait certains
écrivains maghrébins (Rachid Boudjedra ou Kateb Yacine) en faveur de l'arabe (sans, d'ailleurs,
pour autant, cesser définitivement d'écrire en français) ou des auteurs anglophones (le plus illustre
étant le kényan Ngugi wa Thiong'o14) en faveur de leurs langues maternelles. En Afrique noire
francophone on trouve peu d'exemples similaires : le cas du Rwandais Alexis Kagame, qui a
traduit lui-même une partie de ses textes en kinyarwanda, et du Camerounais Elolongue Epanya
Yondo, qui a livré, dès 1960, un recueil de poèmes (Kamerun, Kamerun!) contenant des textes en
douala, paraît très exceptionnel. Le Congolais Ngandu Nkashama, qui insère fréquemment dans
ses textes en français des passages en ciluba, sa langue maternelle, annonçait, en 1994, que
Yakouta était son dernier roman en langue étrangère (voir en quatrième de couverture). La bonne
nouvelle ! Une affaire à suivre... Quant au Sénégalais Ousmane Sembene, sa démarche concerne
essentiellement le cinéma qu'il ne réalise plus, depuis longtemps, qu'en wolof. Sortir de l'exil
linguistique pour recourir à l'expression littéraire en langue vernaculaire est un projet légitime mais
difficile. Suffit-il de le vouloir pour le pouvoir ? Beaucoup ne peuvent, dans l'état actuel des
choses, y parvenir en raison de plusieurs obstacles réels (absence d'alphabétisation et de
formation des populations à l'écriture et à la lecture dans leur langue maternelle, non intégration
des langues à l’école) ou imaginaires (absence de lectorat désireux de lire dans les langues locales,
impossibilité technique d'effectuer le passage des langues africaines à l'écriture, etc.).
Il reste alors l'autre (non)choix, celui que font la majorité de nos écrivains : adopter la
langue française, même quand sa maîtrise est mal assurée, quitte à la plier aux exigences de ses
propres besoins d'expression, éventuellement au prix d'importantes manipulations, quitte à la
"subvertir", donc à lui faire violence. Certains ont parlé de "viol", ce qui me semble bien excessif
car viol suppose "zone interdite" ou de "non-droit", ce qui n'est, évidemment, pas le cas pour une
langue devenue, depuis longtemps, en raison de son statut juridique et social, la copropriété de
tous ceux qui le parlent dans les pays dits "francophones".
La violence sur la langue, dans le sens de participation active à son élaboration, à son
évolution et à son enrichissement, commence par le refus de la langue classique, excessivement
normée, diffusée par l'école au détriment de la langue vivante propre à notre temps et à notre lieu.
14
Auteur de plusieurs best-sellers (dont A Grain of Wheat, 1967 et Petals of Blood, 1977) traduits dans plusieurs
langues, dont le français. Il explique sa démarche dans un livre intitulé Decolonising the mind (1988).
Centre d'Etudes Linguistiques et Littéraires Francophones et Africaines
Article en ligne
-9-
NGALASSO Mwatha Musanji : Langage et violence dans la littérature africaine écrite en français
Ce refus est exprimé par plusieurs auteurs africains dont Ahmadou Kourouma et Sony Labou
Tansi sont les porte-étendard. Ils parlent de "dompter" la langue française, de "l'acclimater", de "la
domestiquer", de la "cocufier", de lui "tordre le cou", bref de "l'adapter" à leur vécu d'Africains en
vue de lui apporter le renouvellement nécessaire au sein même de la communauté francophone
mondiale. D'où leur volonté clairement affichée de recourir à la langue courante en usage dans les
villes et les campagnes africaines, une langue authentique, qui ne craint ni l'emprunt ni le calque ni
le particularisme ni même la faute.
La violence se manifeste alors, concrètement, comme une véritable intrusion dans la
"langue de l'autre", une forme de pénétration, par effraction, dans le corps des mots et des sens.
Cela se fait par le recours aux termes "indigènes"15, par les emprunts et les interférences de toutes
sortes, y compris au niveau de l'onomastique (anthroponymie, toponymie, ethnonymie, etc.)16.
Cela se fait aussi par d'audacieuses créations lexicales17, au départ individuelles, qui se répandent
ensuite dans la langue générale18, par des re-créations sémantiques (processus de resémantisation
des mots français par monosémisation ou par polysémisation)19, par des reconstructions
syntaxiques20, par la pulvérisation des lois énonciatives, discursives et narratives classiques21. Le
15
Termes désignant des réalités locales spécifiques. Mais la Congolaise Mambou Aimée Gnali vient de publier, chez
Gallimard, un récit portant un titre en kikongo : Beto na beto. Le poids de la tribu.
16
La plupart des auteurs recourent aux emprunts de mots et aux noms propres locaux dans leurs titres comme dans
la désignation des personnages, des lieux ou des peuples.
17
Certains auteurs comme Sony Labou Tansi ou Ahmadou Kourouma, sont passés maîtres dans l'art de l'inventivité
lexicale par dérivation ou par composition. Ainsi chez le premier : merder, merdeur ; gester, téléparler, mocherie,
excellentiel, anté-peuple, les pas-tout-à-fait-vivants, les près-de-mourir, etc.; chez le second : déhonté, déshonnête,
griotter, nuiter, viander, menterie, griotterie, vilainerie, tutubement, répondeur, travailleur forcé, , etc. De
nombreuses expressions sont des africanismes traduits des langues locales : frère même père même mère "frangin",
asseoir un palabre "tenir un palabre", refroidir le coeur "apaiser", courber les prières "réciter les prières", tuer des
sacrifices "offrir des sacrifices vivants".
18
Voir, à ce sujet, l'Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire dont une part non
négligeable du vocabulaire recensé provient des écrits d'auteurs africains. Ce qui n'empêche pas un écrivain comme
Kourouma d'en faire, en retour, un usage explicite dans Allah n'est pas obligé.
19
On trouve chez Kourouma : les mendiants ...miaulaient d'une façon impie, le croassement des boubous
amidonnés, etc.
20
La locution nominale invariable bon pied la route employée au Cameroun pour dire "bon voyage !" permet à
Kourouma de créer de nombreuses expressions à base verbale, comme faire pied la route, partir pied la route ou
prendre son pied la route, exploitant ainsi à fond une structure particulièrement productive : Après ça, nous n'avons
pas encore longtemps fait beaucoup pied la route. Cet auteur n'hésite pas à recourir à la dislocation de la forme du
gérondif par un adverbe (en bien mouillant les barbes des douaniers) ni à celle d'un nom composé incorporant un
adjectif épithète (un éclat ébourifant de rire) ni à des structures syntaxiques lourdement redondantes comme le
fameux syntagme nègre noir africain indigène, dont la forme la plus cumulative est un vrai enfant nègre noir
africain broussard (p. 13), et la structure parallèle le commandant blanc toubab colon colonialiste (p. 221), à
l'extrême limite de la saturation des possibilités combinatoires de la langue française. Une phrase comme Saydou
était jaloux : il ne voulait pas que sa mère s'occupe du petit Mamadou avec la tendresse qu'elle le faisait (221) est à
la limite de la correction.
21
Des expressions comme s'éffondrer dans les larmes ou tout le long et large de l'Afrique paraissent bien curieuses
; mais Kourouma nous a habitués, depuis longtemps, à ce type de formulations analogiques dont le caractère
poétique ou "poiétique" (au sens fort du terme, c'est-à-dire "inventif") est indéniable, produisant, chez le lecteur, un
effet de surprise garanti. En voici quelques autres qui ne manquent pas de croustillant : Sarah était unique et belle
Centre d'Etudes Linguistiques et Littéraires Francophones et Africaines
Article en ligne
- 10 -
NGALASSO Mwatha Musanji : Langage et violence dans la littérature africaine écrite en français
résultat le plus perceptible est que la langue étrangère employée par l'étranger devient étrangère à
ses usagers naturels22. L'indigénisation est une forme de cannibalisation, si, au lieu d'être un
facteur d'enrichissement de la langue étrangère apprise, elle devient un élément de brouillage de
l'intercompréhension entre ceux qui partagent la même langue. On retrouve là le fameux mythe de
Caliban voleur de langue (Jahn, 1965 : 230) :
Caliban force la prison qu'est la langue de Prospéro [...] Caliban continuera à comprendre
la langue de Prospéro. Mais la langue qui sera désormais propre à Caliban, Prospéro ne la
comprendra plus que partiellement.
Que dire de la génération des "blacks et beurs", ces Afro-français nés de parents
entièrement ou partiellement africains, hors d'Afrique, dans la banlieue parisienne, lyonnaise,
marseillaise, bordelaise où ils ont leur résidence ordinaire ? Il est clair , comme le relève Françoise
Gadet (2001), que leur problème de langage est tout différent de celui de la génération de leurs
parents immigrés. Leurs pratiques discursives et scripturaires aussi.
Conclusion
La violence est une forme de langage. Elle peut investir l'espace littéraire en devenant une
forme d'écriture. Il est important de comprendre que l'écriture de la violence comme tentative de
conscientisation, comme forme de subversion, à travers la dérision et les divers procédés de
transgression qu'elle cultive, n'est pas un exercice dérisoire : elle exerce un véritable pouvoir
d'influence sur les citoyens-lecteurs et recèle une dimension thérapeutique indéniable. Il s’agit, à
défaut de guérir par le cri de douleur, d'exorciser la peur par un éclat de rire, le fameux "rire de
sauvetage" de Sony Labou Tansi, le "pleurer-rire" de Henri Lopès.
L'histoire de la littérature africaine écrite est faite de multiples soubresauts thématiques,
structurelles ou stylistiques dont on a parlé en termes de "ruptures". Celles-ci sont la marque
d'une vitalité évidente de cette littérature, d'une créativité manifeste des auteurs africains écrivant
en une langue non maternelle, d'une nécessaire recréation de cette même langue.
comme quatre (92), Il avança dans la mitraille avec tellement d'aplomb, tellement de couilles entre les jambes que
les mitrailleurs d'en face décrochèrent. Pour se tailler (128).
22
Pour une meilleure compréhension du phénomène je renvoie à Ngalasso (2001).
Centre d'Etudes Linguistiques et Littéraires Francophones et Africaines
Article en ligne
- 11 -
NGALASSO Mwatha Musanji : Langage et violence dans la littérature africaine écrite en français
Une seule rupture n'a pas encore eu lieu : la rupture linguistique, par une prise de liberté
par rapport au médium d'écriture. Ce fait est d'autant plus étonnant que la majorité des écrivains
africains évoluent dans des contextes d'énonciation dominés par le plurilinguisme et que beaucoup
d'entre eux sont polyglottes. Certains, comme Ahmadou Kourouma, affirment penser dans leur
langue maternelle et écrire en français n'offrant ainsi au lecteur qu'une sorte de traduction dont ils
se refusent à livrer l'original. D'autres, comme Sony Labou Tansi (Devésa, 1996 : 51), n'ont, en
réalité, jamais cessé d'écrire dans leurs langues mais ils ne se sont jamais résolus à publier dans ces
langues parce que, disons-le, cela n'est pas actuellement rentable, ni financièrement ni
commercialement ni politiquement. Cette rupture souhaitable ne doit pas être entendue de façon
négative en termes d'abandon-rejet du français mais positivement comme une possibilité
supplémentaire offerte à l'écrivain plurilingue, qui en a la compétence, de faire un usage alterné de
la pluralité des langues dont il a la maîtrise.
La violence verbale en littérature, faite de plusieurs types de ruptures, peut alors
fonctionner comme une mécanique de plaisir, la fonction poétique du langage s'investissant tout
naturellement dans l'écriture comme jeu et récréation et pas seulement comme re-création du
monde.
Un problème se pose, qui concerne l'avenir : sommes-nous en train de nous acheminer, par
toutes ces formes de violence qui s'exercent sur le français, que d'aucuns n'hésitent pas à nommer,
bien improprement, "viol", vers la pidginisation ou la créolisation de cette langue et, ce qui serait
plus inquiétant encore, vers la substitution, à terme, de cette forme linguistique abâtardie aux
langues africaines, un peu comme cela s'est passé en Gaulle où un latin colonial dégénéré a
remplacé la langue original indigène, le gaulois ? J'ai expliqué ailleurs (Ngalasso, 1990) les raisons
pour lesquelles je pense qu'il n'en sera pas ainsi.
Bibliographie
ALAOUI ABDALLAOUI M’hamed (1989), La langue, la rupture et la mémoire, Notre Librairie, 96 :
14-20.
BLACHERE Jean-Claude (1993), Négritures. Les écrivains d'Afrique noire et la langue française,
Paris, L'Harmattan.
BORGOMANO Madeleine (1996), Calixthe Beyala, une écriture déplacée, Notre librairie, 125 : 72-
74.
CHEVRIER Jacques (1998), Littératures d'Afrique noire de langue française, Paris, Nathan-
Université.
DABLA Sewanou (1986), Nouvelles écritures africaines, romanciers de la nouvelle génération, Paris,
L'Harmattan.
Centre d'Etudes Linguistiques et Littéraires Francophones et Africaines
Article en ligne
- 12 -
NGALASSO Mwatha Musanji : Langage et violence dans la littérature africaine écrite en français
DEVESA Jean-Michel (1996), Sony Labou Tansi, écrivain de la honte et des rêves magiques du
Kongo, Paris, L'Harmattan.
GADET Françoise (2001), Le français en France : une langue en crise ?, In Présence francophone, 56
"Le français dans le monde" (coordonné par Ngalasso Mwatha Musanji) : 1-26.
GASSAMA Makhily (1995), La langue d'Ahmadou Kourouma ou le français sous le soleil d'Afrique,
Paris Karthala.
GAUTHIER ROBERT (1999), La violence du langage et le langage de la violence, Violence et
langage. Actes du 19e Colloque d'Albi 1998 "Langages et signification", Université de Toulouse-le-
Mirail : 41-48.
GERARD Albert (1971), Four African Literatures : Xhosa, Sotho, Zulu, Amharic, Berkeley, The
University of California Press.
GERARD Albert (1981), African Language Literatures : an Introduction to the Literary History of
Sub-Saharan Africa, Washington DC-Londres, Three Continents Press-Longman.
HUSTON Nancy (1980), Dire et interdire. Eléments de jurologie, Paris, Payot.
JACOBSON Roman (1963), Essais de linguistique générale. Les fondations du langage, Paris, Les
Editions de Minuit.
JAHN Janheinz (1965), Manuel de littérature néo-africaine, Paris, Resma.
KOM Ambroise (1996), L'univers zombifié de Calixthe Beyala, Notre Librairie, 125 : 64-71.
MATESO Locha (1990), Critique de la critique, Notre Librairie, 103 : 79-83.
NGAL Georges (1994), Création et ruptures en littérature africaine, Paris, L'Harmattan.
NGALASSO Mwatha Musanji (1984), Langues, littératures et écritures africaines, Recherches et
travaux (Université de Grenoble), 27 "Littératures africaines d'écriture française" : 21-40.
NGALASSO Mwatha Musanji (1989), Le dilemme des langues africaines, Notre librairie, 98 : 15-21.
NGALASSO Mwatha Musanji (1990), Latinité gauloise, francophonie africaine : destin parallèle ?, In
RIESZ Janos et Alain RICARD, éd., Semper aliquid novi. Littérature comparée et littérature
d'Afrique. Mélanges offerts à Albert Gérard, Tübingen, Gunter Narr Verlag : 21-29.
NGALASSO Mwatha Musanji (1992), Le concept de français langue seconde, Etudes de linguistique
appliquée, 88 (coordonné par Henri Besse, Mwatha Musanji Ngalasso et Gérard Vigner) : 27-38.
NGALASSO Mwatha Musanji (1996), Démocratie : le pouvoir des mots, Politique africaine, 64
(coordonné par Ngalasso Mwatha Musanji) : 6-17.
NGALASSO Mwatha Musanji (2001), De Les soleils des indépendances à En atttendant le vote des
bêtes sauvages. Quelles évolutions de la langue chez Ahmadou Kourouma ?, In Littératures
francophones : langues et styles (Actes du colloque international organisé à l'Université Paris 12, le
26 mars 1999), Paris, L'Harmattan : 13-47.
NGANDU NKASHAMA Pius (1992), Littératures et écritures en langues africaine, Paris,
L'Harmattan.
NGANDU NKASHAMA Pius (1997), Ruptures et écritures de violence, Paris, L'Harmattan.
NGUGI WA THIONG'O (1988), Decolonising the Mind. The Politics of Language in African
Literature, Londres, James Currey (Extrait en français sous le titre "J'écris en kikuyu" dans Le
Courrier. Afrique-Caraïbes-Pacifique - Communauté européenne, 119 (janvier-février 1990) : 72-
76).
Centre d'Etudes Linguistiques et Littéraires Francophones et Africaines
Article en ligne
- 13 -
You might also like
- Les littératures africaines de langue francaise à l'époque de la postmodernité: Etat des lieux et perspectives de la rechercheFrom EverandLes littératures africaines de langue francaise à l'époque de la postmodernité: Etat des lieux et perspectives de la rechercheHans-Jürgen LüsebrinkNo ratings yet
- A la recherche du temps perdu: Analyse complète de l'oeuvreFrom EverandA la recherche du temps perdu: Analyse complète de l'oeuvreNo ratings yet
- La Littérature Africaine Dans Son EssenceDocument226 pagesLa Littérature Africaine Dans Son EssencerwatzaNo ratings yet
- LittératureDocument21 pagesLittératureAliceHope100% (1)
- Le Personnage de RomanDocument12 pagesLe Personnage de RomanGhita RafaïNo ratings yet
- La Bataille D'hernaniDocument1 pageLa Bataille D'hernaniookkkNo ratings yet
- Litterature MarocaineDocument1 pageLitterature MarocaineBrahim OmariNo ratings yet
- Memoires AlphaDocument92 pagesMemoires AlphaGeorgoulas IakovosNo ratings yet
- Femme, Identité, Écriture Dans Les Textes Francophones Du MaghrebDocument14 pagesFemme, Identité, Écriture Dans Les Textes Francophones Du MaghrebTiti SuruNo ratings yet
- Document 2 La Litterature Marocaine Expression Francaise Ses Etapes Et Ses PrincipauDocument24 pagesDocument 2 La Litterature Marocaine Expression Francaise Ses Etapes Et Ses Principauamal100% (1)
- Lecture Ethnocritique Du Roman de Kaouther Adimi Des Pierres Dans Ma PocheDocument82 pagesLecture Ethnocritique Du Roman de Kaouther Adimi Des Pierres Dans Ma PocheENTAMENE Nour-Eddine100% (1)
- Madame Bovary RealismeDocument32 pagesMadame Bovary RealismeMihai AmarieiNo ratings yet
- Dossier Pedago Les BonnesDocument36 pagesDossier Pedago Les BonnesMaxime AyacheNo ratings yet
- Fiche Introduction Aux Grandes Theories Du RomanDocument16 pagesFiche Introduction Aux Grandes Theories Du RomanGwen Miel100% (3)
- Roland Barthes. L'Ecriture de L'evenementDocument6 pagesRoland Barthes. L'Ecriture de L'evenementMiguel Ángel Maydana Ochoa100% (1)
- Lecture Analytique Victor Hugo Réponse À Un Acte D'accusationDocument3 pagesLecture Analytique Victor Hugo Réponse À Un Acte D'accusation83squadNo ratings yet
- Albert Camus La Peste Le SeminaireDocument13 pagesAlbert Camus La Peste Le SeminaireAna Zvrko100% (1)
- Sociocritique 76155414Document13 pagesSociocritique 76155414Ïɱã ŊéNo ratings yet
- Les Genres LittérairesDocument8 pagesLes Genres LittérairesOmar chhaima100% (1)
- Assia DjebarDocument391 pagesAssia DjebarsamyNo ratings yet
- La Littérature Maghrébine D'expression FrançaiseDocument7 pagesLa Littérature Maghrébine D'expression Françaiseboualem mohamed100% (1)
- Marc Gontard Roman MarocanDocument18 pagesMarc Gontard Roman Marocandaria popescuNo ratings yet
- Le Dialogue Des Arts : Femmes D'alger Dans Leur Appartement D'assia DjebarDocument7 pagesLe Dialogue Des Arts : Femmes D'alger Dans Leur Appartement D'assia DjebarcristiyanNo ratings yet
- L IntertextualiteDocument2 pagesL IntertextualiteSilvia Corolenco100% (2)
- Curs L IntertextualiteDocument5 pagesCurs L IntertextualiteMoraruElenaNo ratings yet
- Le Comique, La Théâtralité Et L'absurde en Cantatrice ChauveDocument5 pagesLe Comique, La Théâtralité Et L'absurde en Cantatrice ChauveNah SafoNo ratings yet
- Esthétique Baroque Dans La Littérature Maghrébine D'expression FrançaiseDocument368 pagesEsthétique Baroque Dans La Littérature Maghrébine D'expression FrançaiseLycophron100% (2)
- Le Dadaïsme Et Le SurréalismeDocument8 pagesLe Dadaïsme Et Le Surréalismehicham hassouniNo ratings yet
- CRITIQUE Résumé GengembreDocument5 pagesCRITIQUE Résumé GengembreVanessa CavallariNo ratings yet
- Mythe Et LitteratureDocument6 pagesMythe Et LitteratureDonQuichotteNo ratings yet
- Analyse de La Structure Et Des Procédés de Narration Et de Contage - Approche Comparative Des Contes de Perrault Et Des Contes Chaouis - BOUDJELLAL MEGHARI AminaDocument558 pagesAnalyse de La Structure Et Des Procédés de Narration Et de Contage - Approche Comparative Des Contes de Perrault Et Des Contes Chaouis - BOUDJELLAL MEGHARI Aminaidlisen100% (2)
- A. La Critique PsycanalytiqueDocument2 pagesA. La Critique PsycanalytiqueCorina BingaNo ratings yet
- Conditions Postmodernes de La Litt AfriDocument19 pagesConditions Postmodernes de La Litt Afriealainfl100% (1)
- Vaste Est La Prison Est Le Troisième Volet DuDocument12 pagesVaste Est La Prison Est Le Troisième Volet Ducecyrose100% (1)
- Tahar Ben Jelloun CZW STDocument31 pagesTahar Ben Jelloun CZW STiamraja1692No ratings yet
- Article - Les Procédés de La Critique Beuvienne Et Leurs ImplicationsDocument11 pagesArticle - Les Procédés de La Critique Beuvienne Et Leurs ImplicationsDaniela Callipo100% (1)
- Differences Corneille Et Racine PDFDocument5 pagesDifferences Corneille Et Racine PDFSofia GandiniNo ratings yet
- Littérature Féminine Au MarocDocument12 pagesLittérature Féminine Au Marockamal achikeNo ratings yet
- Cours Sur Le Roman 2Document7 pagesCours Sur Le Roman 2Abdourahmane ThiawNo ratings yet
- Littérature Maghrébine Francophone - WikipédiaDocument20 pagesLittérature Maghrébine Francophone - WikipédiaStan's ManNo ratings yet
- Commentaire Stylistique S4Document3 pagesCommentaire Stylistique S4ichrak elkebiri100% (1)
- PROUSTDocument25 pagesPROUSTAndreea CodițăNo ratings yet
- (Francopolyphonies) Oana Panaite-Des Litteratures-Mondes en Francais - Ecritures Singulieres, Poetiques Transfrontalieres Dans La Prose Contemporaine-Rodopi (2012)Document307 pages(Francopolyphonies) Oana Panaite-Des Litteratures-Mondes en Francais - Ecritures Singulieres, Poetiques Transfrontalieres Dans La Prose Contemporaine-Rodopi (2012)Akagami Shanks100% (1)
- A - Le Texte LittéraireDocument3 pagesA - Le Texte LittéraireRachida Barmi100% (1)
- Analyse - Les Contemplations (Analyse Linéaire Livre 5)Document42 pagesAnalyse - Les Contemplations (Analyse Linéaire Livre 5)Oussama Bah0% (1)
- Tweede Versie - Passe SimpleDocument62 pagesTweede Versie - Passe Simpleprabakaran0908100% (1)
- CM Littérature Francophone WORDDocument22 pagesCM Littérature Francophone WORDTinna55No ratings yet
- Methode Analyse TheatreDocument1 pageMethode Analyse TheatreFouzia BadiNo ratings yet
- L'etrangerDocument16 pagesL'etrangerFiorina Jaso100% (1)
- Le Romancier Et Son Personnage - DossierDocument10 pagesLe Romancier Et Son Personnage - DossierpattybellaNo ratings yet
- Histoire Des Idées Et Des ArtsDocument23 pagesHistoire Des Idées Et Des ArtsSandra Elma100% (1)
- Pour Une Analyse de L'effet-Personnage Vincent JouveDocument10 pagesPour Une Analyse de L'effet-Personnage Vincent JouveEli SaNo ratings yet
- L'Œuvre Romanesque D'Ahmadou Kourouma - Et Sa CritiqueDocument115 pagesL'Œuvre Romanesque D'Ahmadou Kourouma - Et Sa CritiqueMbenid0% (1)
- 486 Racine AndromaqueDocument94 pages486 Racine AndromaquelizzaniaNo ratings yet
- La FableDocument4 pagesLa FableARiitha CLsyNo ratings yet
- LQ Sémiotique Du Conte Comme TexteDocument29 pagesLQ Sémiotique Du Conte Comme TexteNatalia Popusoi100% (1)
- Sequence NarrativeDocument7 pagesSequence NarrativeBojanaNo ratings yet
- Naratologie FRDocument6 pagesNaratologie FRAldea Monica-GabrielaNo ratings yet
- Le Realisme (I)Document6 pagesLe Realisme (I)Petrica RarincaNo ratings yet
- Les Précieuses ridicules de Molière (Analyse de l'oeuvre): Comprendre la littérature avec lePetitLittéraire.frFrom EverandLes Précieuses ridicules de Molière (Analyse de l'oeuvre): Comprendre la littérature avec lePetitLittéraire.frNo ratings yet
- Urgent - Violences Policieres A Tel-Aviv Et A Roissy #Flytilla #PalestineDocument1 pageUrgent - Violences Policieres A Tel-Aviv Et A Roissy #Flytilla #PalestineGabrielle VerdierNo ratings yet
- France Le Guide Des Gens Du VoyageDocument6 pagesFrance Le Guide Des Gens Du VoyageGabrielle VerdierNo ratings yet
- Viol - Ne Plus Se TaireDocument13 pagesViol - Ne Plus Se TaireGabrielle VerdierNo ratings yet
- #France #Sionisme #LDJ Deux Appels Importants - Two Important Calls (English Translation Below)Document6 pages#France #Sionisme #LDJ Deux Appels Importants - Two Important Calls (English Translation Below)Gabrielle VerdierNo ratings yet
- Sionistes Contre Le PIR Et Le NPA À Propos Du FPLPDocument2 pagesSionistes Contre Le PIR Et Le NPA À Propos Du FPLPGabrielle VerdierNo ratings yet
- #Tunisie #SidiBouzid Meeting Bourse Gue Travail Jeudi 13 Janvier 2011 #ParisDocument1 page#Tunisie #SidiBouzid Meeting Bourse Gue Travail Jeudi 13 Janvier 2011 #ParisGabrielle VerdierNo ratings yet
- #Feb17 #Sidibouzid Urgent Soutien Aux Réfugiés Qui Fuient La Barbarie Du Sinistre Clown GaddafiDocument1 page#Feb17 #Sidibouzid Urgent Soutien Aux Réfugiés Qui Fuient La Barbarie Du Sinistre Clown GaddafiGabrielle VerdierNo ratings yet
- Déclaration Alliance Noire Citoyenne ANC & Collectif - Brigade Anti Negrophobie - Commémoration de L'abolition de L'esclavage Du 10 Mai 2011Document1 pageDéclaration Alliance Noire Citoyenne ANC & Collectif - Brigade Anti Negrophobie - Commémoration de L'abolition de L'esclavage Du 10 Mai 2011Gabrielle VerdierNo ratings yet
- #SIDIBOUZID Conférence Débat #Tunisie Révolution Et Contre-RévolutionDocument1 page#SIDIBOUZID Conférence Débat #Tunisie Révolution Et Contre-RévolutionGabrielle VerdierNo ratings yet
- Initiative PIR Paris Et Autres Assos Appel Contre Les Assises Sur L'islamisation de Nos PaysDocument1 pageInitiative PIR Paris Et Autres Assos Appel Contre Les Assises Sur L'islamisation de Nos PaysGabrielle VerdierNo ratings yet
- #JAN25 Soutien Revolution Du Peuple Egyptien Devant L'ambassade Egypte Rassemblement Paris 3 Février 2011 14hDocument1 page#JAN25 Soutien Revolution Du Peuple Egyptien Devant L'ambassade Egypte Rassemblement Paris 3 Février 2011 14hGabrielle VerdierNo ratings yet
- #France #Racisme La Mémoire Des Luttes - Moghniss AbdallahDocument5 pages#France #Racisme La Mémoire Des Luttes - Moghniss AbdallahGabrielle VerdierNo ratings yet
- #France #Discrimination Appel Des Médecins Pour La Suppression de L'article 17ter Du Projet de Loi Immigration, Intégration, NationalitéDocument10 pages#France #Discrimination Appel Des Médecins Pour La Suppression de L'article 17ter Du Projet de Loi Immigration, Intégration, NationalitéGabrielle VerdierNo ratings yet
- #JAN25 Soutien Revolution Du Peuple Egyptien Demo Paris 4 Février 2011 15H Parvis Des Droits de L'homme Metro Trocadero ParisDocument1 page#JAN25 Soutien Revolution Du Peuple Egyptien Demo Paris 4 Février 2011 15H Parvis Des Droits de L'homme Metro Trocadero ParisGabrielle VerdierNo ratings yet
- Bas Les Masques Qui Est Ghozlan ? Un Fanatique Raciste SionisteDocument1 pageBas Les Masques Qui Est Ghozlan ? Un Fanatique Raciste SionisteGabrielle VerdierNo ratings yet
- #HumanRights Rapport Consacré À L'afrique Du Nord Et Au Moyen OrientDocument68 pages#HumanRights Rapport Consacré À L'afrique Du Nord Et Au Moyen OrientGabrielle VerdierNo ratings yet
- Charles de Gaulle 18 Juin 1940Document1 pageCharles de Gaulle 18 Juin 1940Gabrielle VerdierNo ratings yet
- Le Neuf-Quinze - Exclusif @si Le Bouclier Fiscal Expliqué À Liliane BettencourtDocument2 pagesLe Neuf-Quinze - Exclusif @si Le Bouclier Fiscal Expliqué À Liliane BettencourtGabrielle VerdierNo ratings yet
- Appel Charles de Gaule Du 18 Juin 1940 Emprunté, Avec Modifs Dernière Minute Le 18 Juin 2010Document1 pageAppel Charles de Gaule Du 18 Juin 1940 Emprunté, Avec Modifs Dernière Minute Le 18 Juin 2010Gabrielle VerdierNo ratings yet
- Urgent Appel A L'aide Du Bateau Rachel Corrie Jeudi 3 Juin 2010Document2 pagesUrgent Appel A L'aide Du Bateau Rachel Corrie Jeudi 3 Juin 2010Gabrielle VerdierNo ratings yet
- Action Urgente - Des Familles Palestiniennes Risquent L'expulsion ForcéeDocument2 pagesAction Urgente - Des Familles Palestiniennes Risquent L'expulsion ForcéeGabrielle VerdierNo ratings yet
- Première Fois Depuis Son Investiture, en Février 2009, Que Le Gouvernement NetanyahouLieberman-Barak ReculeDocument1 pagePremière Fois Depuis Son Investiture, en Février 2009, Que Le Gouvernement NetanyahouLieberman-Barak ReculeGabrielle VerdierNo ratings yet
- La Face Cachée Des GI's or US ARMY OF RAPISTSDocument6 pagesLa Face Cachée Des GI's or US ARMY OF RAPISTSGabrielle VerdierNo ratings yet
- Forum Citoyen France-AfriqueDocument4 pagesForum Citoyen France-AfriqueGabrielle VerdierNo ratings yet
- BDS TOUR - Venez Avec Nous !Document2 pagesBDS TOUR - Venez Avec Nous !Gabrielle VerdierNo ratings yet
- Gmail - Tous Au Rassembleme... Pdftous Au Rassemblement Ce Jeudi À 10 H Pour Dire NON À Une France Complice Des Crimes Israéliens !Document2 pagesGmail - Tous Au Rassembleme... Pdftous Au Rassemblement Ce Jeudi À 10 H Pour Dire NON À Une France Complice Des Crimes Israéliens !Gabrielle VerdierNo ratings yet
- Mobilisation Jeudi 15 Avril A 10 H 00 Contre L'inauguration Par Delanoe de La Promenade Ben GourionDocument2 pagesMobilisation Jeudi 15 Avril A 10 H 00 Contre L'inauguration Par Delanoe de La Promenade Ben GourionGabrielle VerdierNo ratings yet
- Les Français, Israël Et La PalestineDocument15 pagesLes Français, Israël Et La PalestineGabrielle VerdierNo ratings yet
- Remarques de JC Lefort Sur Le Sondage PalestineDocument2 pagesRemarques de JC Lefort Sur Le Sondage PalestineGabrielle VerdierNo ratings yet
- Ouvrir Bourgeois Gentilhomme 2023 2Document47 pagesOuvrir Bourgeois Gentilhomme 2023 2SibonyNo ratings yet
- Coran 2013Document290 pagesCoran 2013Said Boutoucha100% (1)
- QUESTIONNAIRES 9 Et 10 - La Potion Magique de Georges BouillonDocument2 pagesQUESTIONNAIRES 9 Et 10 - La Potion Magique de Georges Bouillonsego.auzrivNo ratings yet
- Lecture Linéaire - La Rencontre À Amiens, Manon Lescaut, L'abbé PrévostDocument5 pagesLecture Linéaire - La Rencontre À Amiens, Manon Lescaut, L'abbé PrévostAce151100% (2)
- Lecture Géocritique de Nos Richesses de Kaouther ADIMIDocument116 pagesLecture Géocritique de Nos Richesses de Kaouther ADIMIMoïse IdirNo ratings yet
- Ttema Pentru Acasa Franceză IIDocument2 pagesTtema Pentru Acasa Franceză IIL MoonNo ratings yet
- Descartes Publiées Les Principes de La PhilosophieDocument567 pagesDescartes Publiées Les Principes de La Philosophiehicham mouhibNo ratings yet
- Cahier de Bord - Semaine 4Document26 pagesCahier de Bord - Semaine 4Stéphanie GuenotNo ratings yet
- 5 e SecondaireDocument60 pages5 e Secondairedela14123No ratings yet
- The Lord's PrayerDocument2 pagesThe Lord's PrayerDean MontolaluNo ratings yet
- A Heart Full of LoveDocument8 pagesA Heart Full of Lovejuliet perelNo ratings yet
- Corrigé Questionnaire de Lecture Matin BrunDocument7 pagesCorrigé Questionnaire de Lecture Matin BrunRayane EL ARJI100% (1)
- C.R Gabrielle Capet Wildenstein InstituteDocument72 pagesC.R Gabrielle Capet Wildenstein InstituteA. AlbertNo ratings yet
- LA NAISSANCE DE LA TRAGÉDIE, Friedrich Nietzsche Fiche de LectureDocument4 pagesLA NAISSANCE DE LA TRAGÉDIE, Friedrich Nietzsche Fiche de LectureFRED HIRSCHMANNNo ratings yet
- Retour D'afrique: Claude RoussinDocument8 pagesRetour D'afrique: Claude RoussingorguyNo ratings yet
- Lecture Analytique Le Père Goriot (18 35)Document7 pagesLecture Analytique Le Père Goriot (18 35)Oumaima RM0% (1)
- 625-Poésie Et Musique - NOV - 2011Document66 pages625-Poésie Et Musique - NOV - 2011JFNo ratings yet
- Sequence 4 Seances 4 Et 5xDocument3 pagesSequence 4 Seances 4 Et 5xSamaNo ratings yet
- Grammaire Italienne (IA Grammaireitalien00anay)Document206 pagesGrammaire Italienne (IA Grammaireitalien00anay)Sabri El Matri100% (1)
- Rapport de Stage - Le Plan D'un Rapport de Stage PDFDocument16 pagesRapport de Stage - Le Plan D'un Rapport de Stage PDFSani mohamedNo ratings yet
- Livre-Prof-Hg4-Chap12 2Document8 pagesLivre-Prof-Hg4-Chap12 2mohamed zakaria el alaouiNo ratings yet
- Entrainement A La Dissertation La Fontaine PDFDocument34 pagesEntrainement A La Dissertation La Fontaine PDFrepajNo ratings yet
- Le Coran Des Historiens - Tome 3Document345 pagesLe Coran Des Historiens - Tome 3RahmanNo ratings yet
- Script VICKY CRISTINA BARCELONADocument6 pagesScript VICKY CRISTINA BARCELONALinda TazibetNo ratings yet
- Arabe. Manuel de Traduction - 3e Édition Revue Et Augmentée... Wawacity - BetDocument235 pagesArabe. Manuel de Traduction - 3e Édition Revue Et Augmentée... Wawacity - BetGildas EyiNo ratings yet
- Nouveau Document TexteDocument2 pagesNouveau Document TexteMartin LopezNo ratings yet
- Le Travail Au Miroir de L'artDocument16 pagesLe Travail Au Miroir de L'artElodie BailliatNo ratings yet
- Nouvelles Realistes Et Naturalistes LP-1Document27 pagesNouvelles Realistes Et Naturalistes LP-1Fbyes SNo ratings yet
- Derecho C28Document1 pageDerecho C28Jhon lcdNo ratings yet
- Acclamation 2 D P BDocument3 pagesAcclamation 2 D P BOdi Enyegue Timothee ThierryNo ratings yet