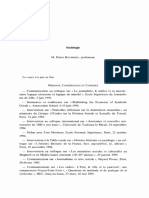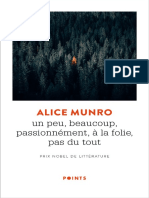Professional Documents
Culture Documents
MSH-M - Rusca - Sociologie de La Mort ? de Quelques Enjeux Épistémologiques.
Uploaded by
louise antheaumeOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
MSH-M - Rusca - Sociologie de La Mort ? de Quelques Enjeux Épistémologiques.
Uploaded by
louise antheaumeCopyright:
Available Formats
MSH-M — Rusca — Sociologie de la Mort ? De quelques enjeux ... http://www.msh-m.fr/le-numerique/edition-en-ligne/rusca/rusca-ter...
RUSCA
Rusca LLCC Rusca TTSD
Sociologie de la Mort ? De quelques enjeux
épistémologiques.
DEA Séminaire de Jean-Marie Brohm
En poursuivant la réflexion critique – que j’avais commencée dans un numéro de
Prétentaine [1] sur la possibilité même de la thanatologie, je me suis rendu compte que
toute énonciation concernant la sociologie de la mort, (l’anthropologie, la psychologie, la
philosophie, la sémiologie, etc., de la mort) tendait vers la mort d’une certaine sociologie
académique, ou du moins vers son autolyse plus ou moins acceptée. La mort est en effet
l’analyseur impitoyable de toutes les prétentions positivistes qui se font jour dans les
sciences sociales contemporaines gangrénées à la fois par l’illusion de la tout- puissance
des « enquêtes de terrain », le mythe de l’objectivisme, la manie de la quantophrénie et le
fétichisme du « recueil des données ». Les enjeux de ce constat sont considérables puisque
d’innombrables jeunes chercheurs ont été confrontés à ce terrorisme scientiste qui entend
ériger en dogme la production industrielle, et proprement insensée, de recherches
« empiriques » spécialisées (partielles et partiales) dont l’intérêt de connaissance est Dans la même rubrique :
dérisoire, parce que sectoriel, cloisonné, réducteur, et dont le seul objectif est d’alimenter
les publications dites canoniques du champ, c’est-à-dire de conforter le conformisme de la Entretien avec Pierre
conformité aux normes instituées par les instances bureaucratiques qui contrôlent la Messmer
recherche [2]. La compétition en
questions.
La fiction empiriste
Réflexions naïves et
La première démarche critique à laquelle invite toute étude sur la mort est de remettre moins naïves sur
immédiatement en cause la fiction empiriste généralement bardée de résultats chiffrés, de une évidence jamais
sondages, d’une batterie de protocoles d’enquêtes, de tests et de tableaux statistiques. La discutée en
critique féroce de cette idéologie professionnelle propre aux experts de la sociologie Education Physique
appliquée (conseils d’entreprise, cabinet de recrutement, directeurs des ressources et Sportive
humaines), aux stakhanovistes de l’intervention sociale (travailleurs sociaux, acteurs de Les Formes sociales
terrain, agents institutionnels) et aux gestionnaires du management social (consultants, et symboliques
formateurs de formateurs, médiateurs, écoutants) a été faite il y a bien longtemps avec un
d’une parentalité
humour décapant par Pitirim Sorokin. Elle n’en revêt aujourd’hui que plus de pertinence
dans le contexte français littéralement envoûté par les platitudes que distillent à haute dose
singulière
les sciences sociales américaines ou canadiennes, y compris, bien sûr, dans le domaine Lieu de vie, lieu de
des études sur la mort. Dénonçant le pseudo-objectivisme de la sociologie contemporaine culte et altérité.
aux Etats Unis, Pitirim Sorokin analyse comment les procédures standards d’une certaine Feedback et
sociologie appliquée (d’Etat, d’entreprise ou d’Institut de recherche) fabriquent à la chaîne Autodafé
des prêts-à-penser administratifs, des marchandises technocratiques prêtes-à-être-stockées anthropologiques
dans les archives des portes ouvertes enfoncées. « Les usines où sont fabriqués de tels Pour une
produits constituent la branche d’industrie la plus importante dans la recherche sociologique phénoménologie
et psychologique. Leurs articles sont manufacturés en grande série, et sortent en chaîne sociale du regard
aussi automatiquement que les automobiles. Il s’ensuit que les revues, les ouvrages et les Sociologie de la
monographies dites scientifiques sont pleins de ce genre de résultats. Il en a paru tellement
Mort ? De quelques
que nul, sauf peut-être le « robot électronique qui enregistre, classe et ordonne toutes les
enjeux
choses », ne peut se souvenir de cette masse innombrable de faits et les utiliser […].
Beaucoup d’hommes de science véritables refusent de gaspiller leur temps et leur énergie, épistémologiques.
à emmagasiner ces tonnes de recherches de plus en plus monotones. De quelle valeur
scientifique peut-il être de savoir que 87,68% des soldats de la section A du régiment B de Rechercher
l’armée C interrogés le 7 février 1942, à 14 heures, répondirent qu’au front ils ne dormaient
pas suffisamment et qu’ils étaient mal lavés ; ou que les prostituées de l’établissement X ont
en moyenne 11,6 clients par vingt-quatre heures pendant l’été et 9,4 pendant l’hiver ; ou
96,78% des épouses qui appartiennent à la promotion de 1928 de telle Université
répondirent qu’elles étaient satisfaites de leurs époux en tant qu’amants, encore que
47,23% de ces épouses voulussent être des « femmes fatales et perdues ». Ces
prétendues découvertes ne font qu’encombrer nos esprits de bric-à-brac. Et la classification
selon des méthodes d’indexation compliquées n’y ajoute rien […]. Comment s’étonnerait-on
alors que toute cette phalange d’enquêteurs n’ait pas enrichi les connaissances humaines
en découvrant de nouvelles vérités » [3] . On comprend bien que la mort ne puisse pas faire
l’objet d’un tel traitement ou alors de manière purement anecdotique, dans l’anonymat et
l’abstraction statistique de la mort en « troisième personne » [4]. Il existe sans doute des
données chiffrées que les démographes, urbanistes, policiers, assureurs, économistes,
travailleurs sociaux, médecins, etc., peuvent utiliser : taux de mortalité selon les âges, les
sexes, les professions, les régions ; courbes saisonnières des suicides et tentatives de
suicide ; chiffre des accidents mortels de la route ; décompte annuel des victimes des
1 sur 7 10/04/2018 à 17:45
MSH-M — Rusca — Sociologie de la Mort ? De quelques enjeux ... http://www.msh-m.fr/le-numerique/edition-en-ligne/rusca/rusca-ter...
crimes, catastrophes naturelles, guerres, épurations ethniques ; statistiques des causes de
décès, des espérances de vie et des inégalités devant la mort [5]. Ces chiffres restent
cependant à la surface de l’épaisseur ontologique de la mort et bien souvent même
empêchent de la penser, si tant est qu’on puisse penser la mort [6]. On n’a encore jamais vu
en effet des données chiffrées permettre de comprendre l’angoisse de la mort, ni bien sûr
« le sens ontologique qu’a le trépas pour le mourant en tant qu’il est une possibilité d’être de
son être » [7]. De même, aucune distribution statistique des rites funéraires (pourcentages
de personnes favorables à l’incinération, ou qui observent les signes extérieurs du deuil, qui
commandent les messes pour les défunts, qui entretiennent les tombes) ne donnera jamais
le sens intersubjectif profond du culte des morts, du cérémonial des funérailles, de
l’expression symbolique obligatoire de la douleur et du travail du deuil. Seule une
phénoménologie des rites funéraires et une herméneutique anthropologique – à la fois
historique et ethnopsychanalytique – des conduites funèbres [8] permet de comprendre le
rapport ontologique qui s’instaure entre les (sur)vivants et les morts, l’ici-bas et l’au-delà, le
passé et l’avenir, l’être et le néant, le travail du rêve et le travail du deuil.
Il est assez affligeant d’avoir à rappeler ces évidences, mais les orientations actuelles de la
thanatologie sont de plus en plus infiltrées par les préoccupations pratiques des
professionnels de la mort (accompagnateurs, infirmières, thanatopracteurs, agence de
pompes funèbres, agents des funérariums) et de plus en plus dépendantes 8 à la fois dans
les thématiques et les problématiques – des demandes sociales liées aux « questions de la
fin de vie » (euthanasie, mort douce, mort digne) et aux questions de l’accueil des
personnes confrontées à la mort (SOS suicide, soutien aux endeuillés, stage de formation
pour unité de soins palliatifs). Cette orientation praxéologique ne peut pas ne pas entraîner
une inquiétante dérive de l’anthropologie de la mort, dont Louis-Vincent Thomas fut l’un des
principaux représentants [9], vers une sorte d’activité de grande surface (par exemple La
Samaritaine où l’on trouverait tous les articles sur la mort…), qui deviendrait prestataire de
services pour les divers décideurs dans les institutions où se gère la mort et les morts, ou
une sorte d’assistance généralisée à l’expertise pour les experts spécialisés que sont les
anesthésistes, experts de la réanimation, les psychanalystes, experts du deuil, les
gérontologues, experts du bien vieillir, les accompagnateurs, experts du bien mourir, les
prêtres, experts du monopole du salut de l’âme, les « expérienceurs », experts des
expériences de mort imminente (NDE) ou des expériences de sortie du corps (OBE), sans
compter l’immense cohorte des experts du bavardage idéologique sur la mort qui fleurit
aujourd’hui sur le terreau des « nouvelles spiritualités ».
Dans ce contexte la sociologie de la mort est elle-même travaillée par l’idéologie du terrain,
de l’objectivité, de la division du travail, du chiffre, de la « validation des résultats » et tout ce
qui fait la doxa de la sociologie académique, laquelle s’imagine qu’il existe une méthode
standard pour aborder tous les « objets sociologiques », quels qu’ils soient. La sociologie de
la mort, oubliant de plus en plus son héritage philosophique et anthropologique, oscille ainsi
sans cesse entre la banalisation et la scotomisation, le tout évidemment sur fond de
parcellisation infinie des tâches. La mort est alors une mort en miettes, objet d’un
morcellement disciplinaire désastreux, ce contre quoi Louis-Vincent Thomas s’est battu
toute sa vie [10]. Banalisation, puisque les « objets d’étude » que les sociologues
consentent encore à étudier sont soit à la périphérie de la mort (les testaments, les
successions, les faire-part de décès, les inscriptions mortuaires, les mots de la mort), soit
d’une trivialité à toute épreuve (le coût économique des morts, le marché des obsèques, les
représentations de la mort [11], les lieux de mort). Scotomisation massive, d’autre part,
puisque dans leur immense majorité les différentes sociologies générales ou sectorielles
ignorent purement et simplement cette réalité anthropologique universelle qu’est la mort. On
le sait bien, les sociologues ne meurent point, mais leurs œuvres sont immortelles ! Qu’on
veuille bien consulter les traités de sociologie, que l’on s’amuse à parcourir les tables des
matières et les index thématiques des ouvrages princeps des sociologues canoniques [12],
on n’y trouvera jamais mentionnés, ou alors à dose infinitésimale, les items mort ou mourir.
Diverses rubriques étudient la ville, le travail, l’entreprise, la famille, les partis politiques, les
associations, le racisme, la culture, le corps, la connaissance, la science, l’art, et même le
sport, mais la mort, elle, est massivement absente. Etrange cécité pour l’école française de
sociologie qui se réclame du Suicide de Durkheim. Etrange lacune pour les théoriciens qui
prétendent expliquer l’ordre social, les champs sociaux, les interactions sociales, les
institutions sociales, etc, d’autant que les multiples ouvrages de vulgarisation ne dérogent
pas à la règle [13] . Même un théoricien aussi remarquable que Cornélius Castoriadis,
pourtant familier de la psychanalyse, scotomise complètement la transversalité
institutionnelle de la mort. « L’institution de la société, écrit-il, est chaque fois institution d’un
magma de significations imaginaires sociales, que nous pouvons et devons appeler un
monde de significations. Car c’est la même chose de dire que la société institue chaque fois
le monde comme son monde ou son monde comme le monde, et de dire qu’elle institue un
monde de significations, qu’elle s’institue en instituant le monde de significations qui est le
sien […]. Ce qui permet de la [la société] penser dans son eccéité, comme cette société-ci
et pas une autre, c’est la particularité ou la spécificité de son monde de significations en tant
qu’institution de ce magma de significations imaginaires sociales, organisé ainsi et non
autrement » [14]. Or, s’il est bien un magma de significations – scientifiques, politiques,
religieuses, mythologiques, eschatologiques, esthétiques, etc., qui fait monde et qui donne
sens à tous les mondes possibles, c’est bien la mort. Dans toutes les sociétés humaines la
mort articule en effet de manière très complexe les divers mondes des vivants (qui sont
2 sur 7 10/04/2018 à 17:45
MSH-M — Rusca — Sociologie de la Mort ? De quelques enjeux ... http://www.msh-m.fr/le-numerique/edition-en-ligne/rusca/rusca-ter...
aussi des héritiers ou des descendants), les divers mondes des futurs vivants (des êtres à
naître) avec les divers mondes des morts (des ancêtres) et les divers mondes des futurs
morts (des êtres à mourir), et ceci à travers toute une série de mondes intermédiaires
(morts-vivants, fantômes, esprits, âmes errantes, etc.) [15] . Il n’en est donc que plus
troublant de constater l’abyssale absence de la mort dans la quasi-totalité des théories de la
société. S’il est bien en effet un « ait social total » c’est la mort, aussi est-il toujours étonnant
de remarquer que les grands systèmes explicatifs de la sociologie l’ont à peu près
complètement évacuée, ce qui ne manque pas d’interroger leurs capacités effectives de
compréhension du fait social. Seules les sociologies critiques, comme le remarque Patrick
Baudry [16], ont su accueillir la dimension existentielle, c’est-à-dire réellement humaine, de
la mort, soit en contestant les diverses formes de la thanatocratie, soit en critiquant
l’économie politique de la mort et les idéologies mortifères du capitalisme, soit enfin en
soulignant la nécessité de pacifier notre rapport à la mort pour humaniser la société [17]. Si
la sociologie de la mort n’est admise qu’à la marge – on pourrait d’ailleurs en dire autant,
avec des nuances, de la sociologie de la sexualité qui elle aussi ne semble pas concerner
les sociologues établis, véritables anges de la pensée – c’est sans doute parce que la mort
fait voler en éclat la fiction de l’objectivisme sociologique qui tient lieu aujourd’hui
d’épistémologie minimale pour les différentes variables du positivisme.
La transversalité ontologique de la mort
Une des premières évidences à rappeler est que la sociologie de la mort n’a pas de
« terrain » privilégié (champ ou territoire), comme par exemple la sociologie des entreprises,
l’ethnologie des banlieues ou l’ergonomie du sport, puisqu’elle explore des horizons de sens
qui jamais ne se laissent assigner à des lieux réels ou symboliques, mais qui débordent
sans cesse toute forme de lieux, la mort étant le hors-lieu par excellence. La mort n’est ni
dans les cimetières, ni dans les églises, ni dans les hôpitaux, ni dans les morgues, ni dans
les charniers, ni dans les tranchées, ni dans les mouroirs, ni sur les autoroutes. Elle est
partout et nulle part, comme le rappelait Louis-Vincent Thomas dans un texte magnifique
qui mériterait d’être réédité. « Nulle part en tant qu’essence, puisqu’elle n’est que coupure,
béance, transition entre le vivant et la cadavre. Jamais isolée sur un territoire spécifique,
elle est incernable au niveau du temps : il n’y a pas un instant du décès. Et l’on meurt
toujours par degrés, car la mort est un processus, et par morceaux ou par organes,
progressivement. Justement, en tant que processus, la mort réside partout dans le flux vital
[…]. En tant qu’elle se retrouve partout au cours de l’existence, elle est au cœur du discours
dans l’art, la philosophie, la religion, la biologie et la médecine […]. En tant qu’elle est nulle
part elle cesse d’être un objet empirique : ce n’est qu’un point insaisissable dont on ne peut
rien dire sinon qu’il y a un avant (vieillesse, agonie, coma) et un après (rites funéraires,
cultes des morts et des ancêtres, deuil). La mort, à la limite, n’est pas. Seuls existent ceux
qui tuent, ceux qui vont mourir, meurent et sont déjà morts » [18]. La sociologie de la mort
n’a pas non plus d’ « objets » répertoriés comme tels – comme on parle de l’ « objet » de la
sociologie et de ses « objets d’étude » puisque la mort transcende toute forme d’objet et
d’objectivation et finit par détruire tous les objets possibles. En tant que réalité inscrite dans
le temps et même forme visible de l’altération dans et par le temps, la mort ne peut pas non
plus être conçue comme une collection d’ « objets de recherche » stables, repérés et
catégorisés, puis que la mort est hors catégorie, ce qui bouleverse évidemment les
catégories traditionnelles de la sociologie (champs, systèmes, habitus, paliers en
profondeur, interactions, rapports, acteurs, etc.). « Dans le Non absolu de cet indicible, écrit
Vladimir Jankélévitch, toutes les déterminations positives se trouvent nihilisées. Les
catégories servent à classer ou à ordonner abstraitement certaines déterminations suivant
les questions qu’on peut poser à leur sujet ; mais la mort de quelqu’un est un événement
dépareillé et unique en son genre, une monstruosité solitaire ; cette inclassable, cette
incomparable négation de l’être-propre est sur un tout autre plan que le reste et sans
commune mesure avec le reste. En nous obligeant sur chaque point à passer à la limite, la
nihilisation absolue fait éclater toutes les formes catégorielles […]. La mort n’entre pas dans
une catégorie abstraite préexistante comme une espèce entre dans un genre à côté des
autres espèces du même genre, ou comme une expérience singulière entre dans une
espèce à côté des autres expériences de la même espèce ; la mort est sans commune
mesure avec les autres événements de la continuation, puisqu’elle étrangle cette
continuation elle-même : la mort est d’un autre ordre, d’un autre monde, sur un tout autre
plan, à une toute autre échelle ». [19] Cette impossibilité d’assigner la mort à une
quelconque forme de catégorisation met à mal, on s’en doute, toutes les taxinomies et
classifications, tous les schémas d’intelligibilité et repères logiques, toutes les labellisations
et désignations, tous les codes et signifiants, puisque la mort est disparition de toute
délimitation des signifiés, dispersion des traces, néantisation radicale des formes,
nihilisation de toute construction (fût-elle sociale) et même de toute déconstruction (fût-elle
postmoderne). La mort est la force absolue de décloisonnement (des disciplines, des
terrains, des spécialités), la puissance infinie de destruction des limites, de transgression
des frontières, de dissolution de toute forme d’ordre, surtout lorsque celui-ci se présente
sous l’aspect méthodologique d’une grille de lecture. La mort est par excellence la négation
de tout contenu et de tout contenant. « La mort, écrit encore Vladimir Jankélévitch, n’est
plus transformation, c’est-à-dire passage d’une forme à une autre forme et modification des
modes, mais abolition de tous les modes et passage de la forme à l’absence de toute
forme ; avènement de l’informe sinon du difforme […]. Le passage de tout à rien ou (ce qui
revient au même) le changement de tout au tout n’est plus l’avènement d’un autre ordre : ce
3 sur 7 10/04/2018 à 17:45
MSH-M — Rusca — Sociologie de la Mort ? De quelques enjeux ... http://www.msh-m.fr/le-numerique/edition-en-ligne/rusca/rusca-ter...
passage est littéralement une accession au tout-autre, au radicalement-autre […]. Ce qui
vient d’être dit des formes et des modes pourrait se redire des places ou lieux dans l’espace
et des moments du temps. La mort n’est pas déplacement ni remplacement, c’est-à-dire
simple changement de place : car un déplacement n’est rien qu’un autre placement, au lieu
que la mort est passage de quelque-part à nulle-part » [20]. Cette épistémologie paradoxale
d’une sociologie de la mort qui peine à légitimer son champ, ses objets et ses méthodes
renvoie, bien évidemment, au refoulement majeur qui frappe toutes les sciences sociales
contemporaines fascinées par la « scientificité » : la refoulement du socle métaphysique
desdites sciences qui oublient que l’être humain est tout autant un être métaphysique qu’un
être politique. Or, comme l’a rappelé Maurice Merleau-Ponty, la métaphysique est toujours à
l’horizon des sciences humaines, qu’elles le sachent ou non. Métaphysique de l’être
d’abord, parce que toutes les sciences humaines supposent explicitement ou implicitement
une ontologie, c’est-à-dire une conception a priori ou transcendantale de la nature ontique
ou de l’essence des objets étudiés : la société, le psychisme, l’inconscient, l’histoire, le
langage, la connaissance, etc. [21] . Il n’y a pas de neutralité ou de point zéro ontologique
possibles puisque les sciences sociales construisent leurs objets selon les lignes de force
de l’ontologie spontanée des chercheurs, jamais critiquée comme telle, ou alors font advenir
des objets qui impliquent à leur tour une ontologie et même une métaphysique [22]. Ce n’est
donc pas ce soubassement métaphysique qui doit être critiqué dans les sciences humaines,
comme se l’imaginent encore les intégristes du scientisme, mais plutôt le refus de
clarification des présupposés métaphysiques qui guident tous les chercheurs, quels qu’ils
soient, et surtout le refus désastreux de tenir compte des implications métaphysiques
profondes, immédiates, irrécusables, de certaines réalités abordées par les sciences
humaines, parmi elles au premier chef la mort. « Il y a métaphysique, écrit Maurice Merleau-
Ponty, à partir du moment où, cessant de vivre dans l’évidence de l’objet – qu’il s’agisse de
l’objet sensoriel ou de l’objet de science , nous apercevons indissolublement la subjectivité
radicale de toute notre expérience et sa valeur de vérité » [23]. Or, la mort est bien ce qui
interroge, avant même tout questionnement scientifique, la subjectivité radicale de toute
notre expérience. La mort est même ce qui renvoie nécessairement au Temps, à Autrui, à
Dieu, à l’Éthique [24] qui sont autant de questions essentielles qui fondent la socialité
humaine, bien avant la construction sociale des champs et des interactions et bien en
amont des postulations empiriques sur les conflits sociaux, l’intégration sociale ou l’anomie.
La mort est en dernière instance l’incitation métaphysique par excellence, parce qu’elle
nous contraint à envisager l’au-delà de l’être, le totalement-autre, l’invisible absolu, l’inconnu
radical. Métaphysique de la vie ensuite, parce que comme l’a souligné Georg Simmel « la
vie est jusque dans ses aspects les plus intimes, à chaque époque de la civilisation, en
étroite interaction avec le sens que l’époque impartit à la mort. Notre conception de la vie,
notre conception de la mort, ne sont que deux aspects d’un seul et même comportement
fondamental » [25]. Cette dialectique circulaire de la vie et de la mort a été et est encore
modulée selon deux perspectives opposées : soit on indexe la mort sur la vie, soit on indexe
la vie sur la mort. Dans une perspective panvitaliste, telle qu’elle a pu exister dans
l’hylozoïsme, l’animisme ou diverses philosophies de la vie, la vie est première et innerve
tout le réel, l’énigme à laquelle est alors confronté l’être humain est la mort. « Dans la
mesure où on accepte la vie comme l’état primitif des choses, la mort se dresse comme le
mystère inquiétant […]. Que la mort, et non la vie, exige en premier lieu une explication
reflète une situation théorique qui perdura longtemps dans l’histoire de l’espèce. Avant qu’il
y eût étonnement devant le miracle de la vie, il y eut étonnement à propos de la mort et de
ce qu’elle pouvait signifier. Si la vie est la chose naturelle et compréhensible, la mort – sa
négation manifeste – est chose contre nature et ne peut être vraiment réelle. L’explication
qu’elle appelle doit être fonction de la vie en tant qu’elle est la seule chose compréhensible :
la mort doit en quelque manière être assimilée à la vie » [26]. Inversement, dans une
perspective « matérialiste », telle qu’elle prévaut aujourd’hui dans les sciences
fondamentales, « le sans vie est la règle, la vie l’exception énigmatique dans l’existence
physique. En conséquence, c’est l’existence de la vie au sein d’un univers mécanique qui à
présent appelle une explication, et cette explication doit être fonction du sans vie […]. Qu’il y
ait tout simplement de la vie et de quelle manière une telle chose est possible dans un
monde de simple matière est à présent le problème qui se pose à la pensée […].
Considérer la vie comme un problème, c’est ici reconnaître son étrangeté dans le monde
mécanique qui est le monde ; l’expliquer, c’est – dans ce climat d’ontologie universelle de la
mort – la nier en en faisant l’une des variantes possibles du sans vie. La théorie mécaniste
de l’organisme est une telle négation […]. Le monisme vitaliste est remplacé par le monisme
mécaniste, dans les règles d’évidence duquel se substitue à la norme de la vie celle de la
mort » [27]. Il n’est donc pas indifférent que la pensée soit sous la domination ontologique
de la mort ou sous celle de la vie. On n’en voit que trop les implications éthiques, politiques
ou pédagogiques [28]. Il n’est pas indifférent non plus de penser l’être humain comme un
être-vers-la-mort avec les heideggeriens ou un être pour la vie, un être vivant dans la vie
avec la phénoménologie de la vie de Michel Henry pour qui « la donation du vivant dans la
Vie est le fait de la Vie seule » [29]
Ces questions proprement métaphysiques et quelques autres liées à la question de la
survie [30] ne peuvent être balayées par la simple référence au savoir scientifique. La mort
oblige en effet le chercheur à la modestie, à la patience, à la précaution. Précisément parce
qu’elle est la certitude ontologique absolue elle entraîne avec elle d’innombrables
incertitudes épistémologiques. Ridicules sont donc les poses scientistes qui censurent
l’étude des réalités anthropologiques liées à la mort – qu’elles soient ordinaires ou
4 sur 7 10/04/2018 à 17:45
MSH-M — Rusca — Sociologie de la Mort ? De quelques enjeux ... http://www.msh-m.fr/le-numerique/edition-en-ligne/rusca/rusca-ter...
extraordinaires, surtout celles qui sont aux frontières de la « normalité » : cannibalisme,
vampirisme, satanisme, sorcellerie, etc. – sous le prétexte qu’elles seraient
« irrationnelles », « non rigoureuses », « non fondées », « non vérifiées » ou « non
vérifiables ». La mort, c’est peut-être regrettable, mais c’est un fait têtu, ne se laisse pas
enfermer dans des annuaires statistiques (sauf pour les obsédés du calcul des taux de
mortalité), ni dans les annales savantes (sauf pour les collectionneurs des oraisons
funèbres), ni dans des années sociologiques (sauf pour les forçats des publications
thanatologiques). Elle ne saurait non plus être mesurée, quantifiée, mise en fiches, triturée
sur les logiciels de traitement des données. La mort est décidément réfractaire à la
sociologie classique. Les savoirs essentiels sur la mort, ou plus exactement autour de la
mort ou à propos de la mort, ne proviennent pas de la sociologie, mais de l’anthropologie,
de la biologie, de la théologie, des croyances religieuses, des sagesses spirituelles, de la
littérature, de l’art, de la métaphysique, des gnoses, initiations et autres doctrines
ésotériques. Ici aussi c’est peut-être regrettable, mais c’est un fait. Et un fait tout aussi
« vrai » que l’indice des prix des cercueils. Il faut donc, à propos de la mort particulièrement,
rabaisser la morgue des sociologues qui ont imposé le monopole de la définition légitime de
la scientificité. « Aucune bouche, écrit Edgar Morin, n’est dépositaire de la vérité de la
science. C’est l’ensemble du jeu qui fait qu’il y a une production de scientificité. Le
sociologue qui énonce : « La sociologie me dit que… » est un sociologue imprudent ou
impudent. La prétention à monopoliser la scientificité qui anime certains sociologues n’est
pas simplement du terrorisme, c’est aussi une impudence antiscientifique, un
obscurantisme, car il est antiscientifique de se prévaloir du monopole de la scientificité dans
sa théorie ou dans sa pensée. La vraie scientificité, la vraie tâche scientifique du sociologue
est de s’auto-relativiser en considérant les caractères relatifs de sa propre
scientificité » [31]. La mort comme absolu se charge d’ailleurs de rappeler périodiquement la
relativité du sociologue…
Jean-Marie Brohm Professeur Émérite de Sociologie à l’Université Paul Valéry-Montpellier
III
[1] Jean-Marie Brohm, « Ontologie de la mort. Esquisses épistémologiques pour une
thanatologie qui se voudrait scientifique », in Prétentaines, n° 7/8, Anthropologie de
l’ailleurs. Présence de Louis-Vincent Thomas. J’ai poursuivi cette réflexion épistémologique
dans ma préface, « Louis-Vincent Thomas et l’anthropologie de la vie », à l’ouvrage
posthume de Louis-Vincent Thomas, Les Chairs de la mort. Corps, mort, Afrique, Paris,
Institut Sanofi-Synthélabo, « Les empêcheurs de tourner en rond », 2000. Dans le même
sens voir Patrick Baudry, « La thanatologie ou l’exigence de transversalité », in
Prétentaines, n° 7/8, op. cit.
[2] Voir Pierre Bourdieu, Les Usages sociaux de la science. Pour une sociologie clinique du
champ scientifique, Paris, Ed. INRA, 1997, p. 49 : « Le premier acte d’une science sociale
réellement scientifique consistera à prendre pour objet d’analyse la construction sociale des
objets d’étude proposés par les instances étatiques à la sociologie – par exemple,
aujourd’hui, la délinquance, les « banlieues », la drogue, etc. – et les catégories d’analyse
qui vont avec et qui sont mises en œuvre sans problème par les grandes institutions de
recherche étatique ».
[3] Pitirim Sorokin, Tendances et déboires de la sociologie américaine, Paris, Aubier, 1959,
pp. 378 et 379. La préface de Georges Gurvitch montre bien que la « platitude
sociologique » n’a pas épargné la sociologie française (ibid., p. 5). Georges Devereux, De
l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement, Paris, Flammarion, 1980, a lui
aussi disséqué la fiction du « rat statistique » qui prévaut dans une certaine psychologie
expérimentale. Pour une critique de l’empirisme sociologique on se reportera aussi au texte
classique de Theodor W. Adorno, « Sociologie et recherche empirique », in De Vienne à
Francfort, la querelle allemande des sciences sociales (textes de T. W. Adorno, K. Popper,
R. Dahrendorf, J. Habermas, H. Albert, H. Pilot), Bruxelles, Complexe, 1979 ; voir
également Lucien Goldmann, Sciences humaines et philosophie, Paris, Denoël-Gonthier,
1978.
[4] Sur cette notion, voir Vladimir Jankélévitch, La Mort, Paris, Flammarion, 1977.
[5] Voir Louis-Vincent Thomas, La Mort, P.U.F., 1988, qui fournit de nombreuses données
chiffrées. Celles-ci ne prennent sens toutefois que dans le cadre d’une herméneutique
générale de la mort, du mourir et de l’après-mort.
[6] Voir Vladimir Jankélévitch, Penser la mort ?, Paris, Liana Lévi, 1994.
[7] Martin Heidegger, Être et Temps, Paris, Gallimard, Paris, 1986, p. 292.
[8] Voir Philippe Ariès, L’Homme devant la mort, Paris, Seuil, 1977 ; Michel Vovelle, La Mort
et l’Occident de 1300 à nos jours, Paris, Gallimard, 1983 ; Rites de la Mort (sous la direction
de Jean Guiart), Paris, Musée de l’Homme, 1978 ; Les hommes et la mort. Rituels
funéraires à travers le monde (textes rassemblés et présentés par Jean Guiart), Paris, Le
Sycomore, 1979 ; Eliane Gorges, Voyages de la mort, Paris, Berger-Levrault, 1982 ; Louis-
Vincent Thomas, Rites de mort. Pour la paix des vivants, Paris, Fayard, 1985 ; Rituels de
deuil, travail de deuil, Grenoble, La Pensée Sauvage, 1995, avec notamment les articles de
5 sur 7 10/04/2018 à 17:45
MSH-M — Rusca — Sociologie de la Mort ? De quelques enjeux ... http://www.msh-m.fr/le-numerique/edition-en-ligne/rusca/rusca-ter...
Louis-Vincent Thomas, « Leçons pour l’Occident : ritualité du chagrin et du deuil en Afrique
noire » et de Tobie Nathan, « Rituels de deuil, travail du deuil. Prolégomènes à une
ethnopsychanalyse du traitement du mort et de l’endeuillé ».
[9] Louis-Vincent Thomas, Anthropologie de la mort, Paris, Payot, 1975.
[10] Louis-Vincent Thomas, La Mort en question. Traces de mort, mort des traces, Paris,
L’Harmattan, 1991, en particulier le chapitre 2 : « Vers une thanatologie ».
[11] Les représentations de la mort étudiées par les sociologues contemporains touchent
essentiellement aux représentations et figurations iconographiques ou photographiques
publicitaires, religieuses, médiatiques, etc. – de la mort, alors que Robert Hertz,
« Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort », in Sociologie
religieuse et folklore, Paris, P.U.F., 1970, étudie « l’ensemble des croyances relatives à la
mort et des pratiques funéraires » (p. 2). Petite nuance…
[12] Je ne citerai ici que quelques auteurs consacrés : Georges Gurvitch, La vocation
actuelle de la sociologie, deux tomes, Paris, P.U.F., 1968 et 1969 ; Traité de sociologie
(sous la direction de Georges Gurvitch), deux tomes, Paris, 1968 ; Alain Touraine,
Production de la société, Paris, Seuil, 1973 ; Pierre Bourdieu, La distinction. Critique sociale
du jugement, Paris, Minuit, 1979 ; Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Minuit, 1980 ;
Raymond Boudon et François Bourricaud, Dictionnaire critique de la sociologie, Paris,
P.U.F., 1982 ; Traité de sociologie (sous la direction de Raymond Boudon), Paris, P.U.F.,
1992 ; Peter Berger et Thomas Luckmann, La Construction sociale de la réalité, Paris,
Méridiens Klinksieck, 1992.
[13] Voir par exemple Jean-Pierre Durand et Robert Weil, Sociologie contemporaine, Vigot,
Paris, 1989 ; Danilo Martucelli, Sociologie de la modernité, Gallimard, Paris, 1999.
[14] Cornélius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975, pp. 480
et 481.
[15] Voir par exemple Lucien Lévy-Bruhl, L’Âme primitive, Paris, P.U.F., 1996, notamment
toute la deuxième partie : « La vie et la mort de l’individu », « La survie des morts »,
« Dualité et bi-présence des morts », « La condition des morts et leur fin », « La
réincarnation ». Voir aussi Louis-Vincent Thomas, Cinq essais sur la mort africaine, Dakar,
Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 1968.
[16] Patrick Baudry, La place des morts. Enjeux et rites, Paris, Armand Colin, 1999.
[17] Voir notamment Edgar Morin, L’homme et la mort, Paris, Seuil, 1970 ; Jean Ziegler, Les
Vivants et la mort, Paris, Gallimard, 1976 ; Jean Baudrillard, L’Echange symbolique et la
mort, Paris, Gallimard, 1976 ; Louis-Vincent Thomas, Mort et pouvoir, Paris, Payot, 1978.
[18] Louis-Vincent Thomas, La mort aujourd’hui, Paris, Editions du Titre, 1988, pp. 13 et 14.
[19] Vladimir Jankélévitch, La Mort, Op. cit., pp. 90 et 91.
[20] Vladimir Jankélévitch, Philosophie première. Introduction à une philosophie du
« presque », Paris, P.U.F., 1986, p. 55.
[21] Voir la brillante thèse de Magali Uhl, Á l’épreuve du sujet. Éléments de métasociologie
de la recherche, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, décembre 2000. Edmund Husserl,
La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, Paris,
Gallimard, 1976, a souligné l’importance constituante du Lebenswelt dans la connaissance
scientifique qui procède toujours de la subjectivité transcendantale : « Seule une question-
en-retour radicale sur la subjectivité, j’entends sur la subjectivité qui rend possible de façon
ultime toute validité-du-monde avec son contenu, et ce dans toutes les modalités pré-
scientifiques et scientifiques, question qui porte également sur le quoi et sur le comment des
performances rationnelles, peut rendre compréhensible la vérité objective et atteindre
l’ultime sens d’être du monde. Ce n’est donc pas l’être du monde dans son évidence sans
question qui est en soi ce qu’il y a de premier, et il ne suffit pas de poser simplement la
question de ce qui lui appartient objectivement ; ce qui est premier en soi est au contraire la
subjectivité et ce en tant qu’elle pré-donne naïvement l’être du monde, puisqu’elle
rationalise, ou, ce qui revient au même, qu’elle l’objective » (p. 80).
[22] Pour ne prendre que les constructions métapsychologiques de la psychanalyse
(pulsion, inconscient, libido, etc.), on a pu montrer qu’elles reposaient sur toute une
ontologie implicite. Voir par exemple Jean-Marie Vaysse, L’inconscient des modernes. Essai
sur l’origine métaphysique de la psychanalyse, Paris, Gallimard, 1999 et surtout Michel
Henry, Généalogie de la psychanalyse. Le commencement perdu, Paris, P.U.F., 1985.
[23] Maurice Merleau-Ponty, « La métaphysique dans l’homme », in Sens et non-sens,
Paris, Gallimard, 1996, p. 114.
[24] Voir Emmanuel Lévinas, Dieu, la Mort et le Temps, Paris, Grasset, 1993.
[25] Georg Simmel, « Métaphysique de la mort », in Tragédie de la culture, Paris, Rivages,
6 sur 7 10/04/2018 à 17:45
MSH-M — Rusca — Sociologie de la Mort ? De quelques enjeux ... http://www.msh-m.fr/le-numerique/edition-en-ligne/rusca/rusca-ter...
1988, p. 16.
[26] Hans Jonas, Le Phénomène de la vie. Vers une biologie philosophique, Bruxelles, De
Boeck, 2001, p. 20.
[27] Ibid, p. 22.
[28] Par exemple dans le sport contemporain qui justifie les prises de risques mortels
(toxicomanie sportive, sports extrêmes, violences mortifères) au nom du « dépassement
infini des limites ». Dans cette course à la performance la mise en jeu de sa vie est l’enjeu
du jeu avec la mort. Voir Patrick Baudry, Le corps extrême. Approche sociologiques des
conduites à risques, Paris, L’Harmattan, 1991 et Jean-Marie Brohm, Les meutes sportives.
Critique de la domination, Paris, L’Harmattan, 1993, notamment le chapitre 12 : « Figures
sportives de la mort ».
[29] Michel Henry, Incarnation. Une philosophie de la chair, Paris, Seuil, 2000, p. 177. Voir
aussi Georg Simmel, « Die Transzendenz des Lebens », in Lebensanschauung. Vier
metaphysische Kapitel, Berlin, Duncker et Humblot, 1994.
[30] Voir par exemple Platon, Phédon, in Apologie de Socrate, Criton, Phédon, Paris, GF-
Flammarion, 1965 ; Ludwig Feuerbach, Pensées sur la mort et sur l’immortalité, Paris,
Pocket 1997 ; Arthur Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation,
Paris, P.U.F., 1996, notamment le chapitre intitulé : « De la mort et de ses rapports avec
l’indestructibilité de notre être en soi » ; Max Scheler, Mort et survie, Paris, Aubier, 1952 ;
Hans-Georg Gadamer, Langage et vérité, Paris, Gallimard, 1995, le chapitre intitulé « La
mort comme question » ; Ernst Bloch, Le Principe Espérance, Paris, Gallimard, Tome III :
Les images-souhaits de l’Instant exaucé, 1991, notamment le chapitre 52 : « Le soi et la
lampe funéraire ou les images qu’oppose l’espérance à la puissance de l’anti-utopie par
excellence : la mort ».
[31] Edgar Morin, Sociologie, Paris, Fayard, 1984, p. 22. Pour une critique philosophique
radicale du scientisme, voir Michel Henry, La Barbarie, Paris, Grasset, 1987.
Dernier ajout : mardi 6 octobre 2009. — © RUSCA 2007-2010
Réalisation des étudiants de l'ED60 soutenue par la Maison des Sciences de l'Homme de Montpellier
17 rue Abbé-de-l'Épée — 34090 Montpellier — France
msh-m.fr - contact@msh-m.org
7 sur 7 10/04/2018 à 17:45
You might also like
- RESUME DU COURS DE TERMINALE DFDocument42 pagesRESUME DU COURS DE TERMINALE DFwk4pnnk7dw0% (1)
- Verbes Et Leurs PrépositionsDocument5 pagesVerbes Et Leurs PrépositionsFlaquitaEndeje100% (1)
- GeopolitiqueDocument3 pagesGeopolitiqueSoukaina TadlaouiNo ratings yet
- La Bonne Gouvernance Au Maroc - Partie 1 PDFDocument0 pagesLa Bonne Gouvernance Au Maroc - Partie 1 PDFAmine MJ BouyzemNo ratings yet
- 25 Most Important MistakesDocument32 pages25 Most Important Mistakeshmid100% (1)
- Dislog GroupDocument10 pagesDislog GroupSara ElouazaniNo ratings yet
- Henri Bergson ExtraitDocument10 pagesHenri Bergson Extraitlouise antheaumeNo ratings yet
- Extrait Extrait 0Document58 pagesExtrait Extrait 0louise antheaumeNo ratings yet
- Respire ExtraitDocument6 pagesRespire Extraitlouise antheaumeNo ratings yet
- Andrea de Dos ExtraitDocument12 pagesAndrea de Dos Extraitlouise antheaumeNo ratings yet
- Extrait Extrait 0Document40 pagesExtrait Extrait 0louise antheaumeNo ratings yet
- 7 Cazals-2Document29 pages7 Cazals-2louise antheaumeNo ratings yet
- OjoDocument20 pagesOjolouise antheaumeNo ratings yet
- Gorge Des Tambours ExtraitDocument9 pagesGorge Des Tambours Extraitlouise antheaumeNo ratings yet
- Partout Le Feu ExtraitDocument7 pagesPartout Le Feu Extraitlouise antheaumeNo ratings yet
- UPL1682068803623161678 AN 95 BourdieuDocument3 pagesUPL1682068803623161678 AN 95 Bourdieulouise antheaumeNo ratings yet
- Extrait Extrait 0Document23 pagesExtrait Extrait 0louise antheaumeNo ratings yet
- Extrait Extrait 0Document43 pagesExtrait Extrait 0louise antheaumeNo ratings yet
- F'FDocument16 pagesF'Flouise antheaumeNo ratings yet
- DerDocument35 pagesDerlouise antheaumeNo ratings yet
- Extrait Extrait 0Document32 pagesExtrait Extrait 0louise antheaumeNo ratings yet
- Extrait Extrait 0Document34 pagesExtrait Extrait 0louise antheaumeNo ratings yet
- Extrait Extrait 0Document28 pagesExtrait Extrait 0louise antheaumeNo ratings yet
- Extrait Extrait 0Document35 pagesExtrait Extrait 0louise antheaume100% (1)
- Extrait Extrait 0Document21 pagesExtrait Extrait 0louise antheaumeNo ratings yet
- Extrait Extrait 0Document27 pagesExtrait Extrait 0louise antheaumeNo ratings yet
- Extrait Extrait 0Document10 pagesExtrait Extrait 0louise antheaumeNo ratings yet
- Extrait Extrait 0Document37 pagesExtrait Extrait 0louise antheaumeNo ratings yet
- Extrait Extrait 0Document21 pagesExtrait Extrait 0louise antheaumeNo ratings yet
- Extrait Extrait 0Document28 pagesExtrait Extrait 0louise antheaumeNo ratings yet
- Extrait Extrait 0Document23 pagesExtrait Extrait 0louise antheaumeNo ratings yet
- Extrait Extrait 0Document32 pagesExtrait Extrait 0louise antheaumeNo ratings yet
- Extrait Extrait 0Document7 pagesExtrait Extrait 0louise antheaumeNo ratings yet
- Extrait Extrait 0Document21 pagesExtrait Extrait 0louise antheaume100% (1)
- Extrait Extrait 0Document18 pagesExtrait Extrait 0louise antheaumeNo ratings yet
- Extrait Extrait 0Document9 pagesExtrait Extrait 0louise antheaumeNo ratings yet
- Cv-Wihtol de Wenden-Catherine PDFDocument5 pagesCv-Wihtol de Wenden-Catherine PDFstumpfrenchNo ratings yet
- Rapport Itie Tchad 2016Document182 pagesRapport Itie Tchad 2016Hassan MhtNo ratings yet
- Omd Rapport Unesco 2015 EngDocument28 pagesOmd Rapport Unesco 2015 EngGiser TakoustNo ratings yet
- HOUDRET These FR Conflits Eau MarocDocument74 pagesHOUDRET These FR Conflits Eau MarocMohamed RaouNo ratings yet
- CATALOGUE A4 Numismatique MDC 04-10-2017 NumeriqueDocument484 pagesCATALOGUE A4 Numismatique MDC 04-10-2017 NumeriqueAlessandro AzzolaNo ratings yet
- KPM Tarifs Maritimes Chine-CongoDocument1 pageKPM Tarifs Maritimes Chine-CongoRachisNo ratings yet
- Genette, Gérard Mimologiques. Voyages en Cratylie, Paris, Éditions Du Seuil, 1976 (Collection Poétique, 427 P.)Document5 pagesGenette, Gérard Mimologiques. Voyages en Cratylie, Paris, Éditions Du Seuil, 1976 (Collection Poétique, 427 P.)Kichou MouradNo ratings yet
- Le Kaïzen Exemplaire WordDocument3 pagesLe Kaïzen Exemplaire WordOukassou MohamedNo ratings yet
- JMP 2017 Wash in The 2030 Agenda FRDocument8 pagesJMP 2017 Wash in The 2030 Agenda FRbassemonlineNo ratings yet
- Le PouvourDocument12 pagesLe PouvourHamza El MakhloufiNo ratings yet
- Compreehension Orale-B2-ADocument2 pagesCompreehension Orale-B2-ARANJANA MUNJALNo ratings yet
- 2nde - H0-La PériodisationDocument3 pages2nde - H0-La PériodisationSamuel Duval (RAESRSE7EN)No ratings yet
- Entraînez VousDocument4 pagesEntraînez VousAlina AlinaNo ratings yet
- DELF B2 Production Orale Sujet 3Document1 pageDELF B2 Production Orale Sujet 3Tanvi NaikNo ratings yet
- Compréhension Écrite C1 - La Génération D....Document4 pagesCompréhension Écrite C1 - La Génération D....Carmen PănuțăNo ratings yet
- Exposé de FrançaisDocument4 pagesExposé de Françaisworld.center.tech225No ratings yet