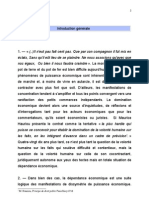Professional Documents
Culture Documents
Principes de Metaphysique t1
Uploaded by
domi347347Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Principes de Metaphysique t1
Uploaded by
domi347347Copyright:
Available Formats
Paul JANET
[1823-1899]
PHILOSOPHE, MEMBRE DE LINSTITUT
(1897)
Principes de mtaphysique
et de psychologie.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris
1888-1894
TOME PREMIER
Un document produit en version numrique par Jean Alphonse, retrait, bnvole,
fondateur du site Mtascience.
Page web de lauteur dans Les Classiques des sciences sociales.
Dans le cadre de: "Les classiques des sciences sociales"
Une bibliothque numrique fonde et dirige par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi
Site web: http://classiques.uqac.ca/
Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.ca/
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
Politique d'utilisation
de la bibliothque des Classiques
Toute reproduction et rediffusion de nos fichiers est interdite,
mme avec la mention de leur provenance, sans lautorisation formelle, crite, du fondateur des Classiques des sciences sociales,
Jean-Marie Tremblay, sociologue.
Les fichiers des Classiques des sciences sociales ne peuvent
sans autorisation formelle:
- tre hbergs (en fichier ou page web, en totalit ou en partie)
sur un serveur autre que celui des Classiques.
- servir de base de travail un autre fichier modifi ensuite par
tout autre moyen (couleur, police, mise en page, extraits, support,
etc...),
Les fichiers (.html, .doc, .pdf, .rtf, .jpg, .gif) disponibles sur le site
Les Classiques des sciences sociales sont la proprit des Classiques des sciences sociales, un organisme but non lucratif
compos exclusivement de bnvoles.
Ils sont disponibles pour une utilisation intellectuelle et personnelle et, en aucun cas, commerciale. Toute utilisation des fins
commerciales des fichiers sur ce site est strictement interdite et
toute rediffusion est galement strictement interdite.
L'accs notre travail est libre et gratuit tous les utilisateurs. C'est notre mission.
Jean-Marie Tremblay, sociologue
Fondateur et Prsident-directeur gnral,
LES CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
Cette dition lectronique a t ralise par Jean ALPHONSE, retrait,
bnvole, responsable du site web Mtascience.
Paul JANET
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
. TOME PREMIER.
Paris : Librairie Ch. Delagrave, 1897, 650 pp.
Une dition numrique ralise partir dun facsimile de la Bibliothque nationale de France.
Polices de caractres utilise :
Pour le texte: Times New Roman, 14 points.
Pour les notes de bas de page : Times New Roman, 12 points.
dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft Word
2008 pour Macintosh.
Mise en page sur papier format : LETTRE US, 8.5 x 11.
dition numrique ralise le 9 juin 2015 Chicoutimi, Ville
de Saguenay, Qubec.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
Paul JANET
PHILOSOPHE, MEMBRE DE LINSTITUT
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET
DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894 .
TOME PREMIER.
Paris : Librairie Ch. Delagrave, 1897, 650 pp.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
Note pour la version numrique : la pagination correspondant
l'dition d'origine est indique entre crochets dans le texte.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
[649]
Table des matires
Prface [v]
INTRODUCTION LA SCIENCE PHILOSOPHIQUE [1]
Leon I.
La philosophie est-elle une science ? [3]
Leon II.
De quelques dfinitions rcentes de la philosophie [24]
Leon III.
Du criterium en philosophie [41]
Leon IV.
Explication sur la leon prcdente [59]
Leon V.
La science et la croyance en philosophie [68]
Leon VI.
Classification des sciences [96]
I. Classification d'Aristote [96]
II. Classification de Bacon [99]
III. Classification d'Ampre [102]
IV. Classification d'Auguste Comte [106]
V. Classification d'Herbert Spencer [113]
Leon VII.
Classification des sciences (suite) [118]
Leon VIII.
Objet de la philosophie : 1 La science des faits de conscience, la
psychologie [130]
Leon IX.
Suite de la discussion sur l'objet de la psychologie [153]
Leon X.
Objet de la philosophie (suite) : 2 Les sciences mtaphysiques
[169]
Leon XI.
Unit de la philosophie [179]
Leon XII et XIII.
Leon XIV.
Des rapports de la philosophie et de la thologie [193]
Rapports de la philosophie et des sciences. Examen du positivisme [225]
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
Leon XV.
Rapports de la philosophie et des sciences (suite). [236]
Leon XVI.
Rapports de la philosophie et de l'histoire [245]
Leon XVII. Les rapports de la philosophie et de la gographie [253]
Leon XVIII. Suite des rapports de la philosophie et de la gographie [265]
Leon XIX.
Rapports de la philosophie avec la littrature [279]
Leon XX.
Rapports de la philosophie et de la politique [290]
LIVRE PREMIER. - L'ESPRIT [303]
Leon I. De la responsabilit philosophique, propos du Disciple, de M. Paul
Bourget [305]
I.
Le roman [306]
II.
Le problme [307]
Leon II. L'homme pense [328]
Leon III.
Le matrialisme et la dignit de la pense [341]
Leon IV.
La conscience [350]
Leon V.
Conscience et raison pure [360]
Leon VI.
Le cerveau et la pense [371]
Leon VII. L'attention [385]
Leon VIII. L'imagination cratrice [406]
Leon IX.
L'union de l'me et du corps. Le sens du corps. La localisation
des sensations [421]
LIVRE DEUXIME. LES PASSIONS [447]
Leon I.
Le fond commun des phnomnes psychologiques. La sensibilit
physique [449]
Leon II.
I. La question des penchants. II. Y a-t-il quelque chose d'actif
dans la sensibilit [472]
Leon III.
Innit des penchants [485]
Leon IV.
Classification des motions [499]
Leon V.
Des passions en gnral [510]
Leon VI.
Analyse des passions [252]
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
Leon VII. Analyse des passions (suite) [536]
Leon VIII. La mcanique des passions. Spinoza [547]
Leon IX.
La mcanique des passions. Ch. Fourier [559]
Leon X.
Lois de relativit et de continuit [574]
Leon XI.
Lois d'association et de coalescence [586]
I. Loi d'association [586]
II. Loi de coalescence [592]
Leon XII. Loi de contagion et loi du rythme [599]
I. Loi de contagion [599]
II. Loi du rythme [605]
III. Loi de diffusion [610]
Leon XIII. La loi d'volution [613]
Leon XIV. La loi d'hrdit [624]
Leon XV. Loi d'hrdit (suite) [636]
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
[V]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
PRFACE
Retour la table des matires
Lorsque nous avons publi, en 1880, notre Trait lmentaire de
philosophie, nous avions cru pouvoir promettre un cours complet et
dvelopp en quatre volumes, qui aurait embrass toutes les parties de
la science. Nous avions trop prsum de nos forces : ce plan, l'excution, a dpass nos efforts. Nous avons d y renoncer. Nous n'avons
pas voulu cependant laisser cette promesse entirement caduque, et,
de ce tout que nous avions promis, nous donnons aujourd'hui au
moins une partie importante, savoir un essai de Mtaphysique ml
de Psychologie et prcd d'une Introduction la science. C'est ce qui
fait aujourd'hui le plus dfaut dans les traits de ce genre.
Nous ne nous sommes point plac au point de vue du criticisme,
qui rgne presque exclusivement en philosophie depuis quelques annes ; nous ne l'avons pas ddaign cependant, et l'on en trouvera la
discussion dans la dernire partie de notre livre ; mais on s'est renferm trop exclusivement dans ce point de vue. Nous avons voulu faire
une mtaphysique concrte, objective, relle, [VI] ayant pour objet des
tres et non des ides. L'me, Dieu, le monde extrieur, la libert, tels
sont les objets que Descartes a dfendus dans ses Mditations, que
Kant a combattus dans la Dialectique transcendantale, et dont nous
persistons soutenir l'existence et la vrit. Nous avons donc expos
les principes d'une philosophie dogmatique, mais dans un esprit assez
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
10
large pour contenir ce qu'il y a de vrai dans ce qu'on appelle assez vaguement l'idalisme.
Ce livre est en quelque sorte, si j'ose dire, mon testament philosophique. ce titre, je le livre la sympathie bienveillante de mes collgues, de mes lves et de mes amis, et celle du public qui a bien
voulu suivre avec quelque intrt mes autres travaux.
Il y a aujourd'hui cinquante-six ans que j'ai commenc penser.
C'tait en 1840. J'entrais en philosophie. Ce fut pour moi une anne
dcisive. Je ne suis pas Malebranche, disait M. Cousin ; mais en entendant les leons de M, de La Romiguire, j'ai prouv quelque chose
de semblable ce qu'prouva Malebranche en lisant pour la premire
fois le Trait de l'homme. Et moi, je dirai mon tour : Je ne suis ni
Malebranche ni M. Cousin ; et cependant j'ai prouv aussi quelque
chose de semblable en entendant les premires leons de mon matre
en philosophie, le vnr M. Gibon, qui n'tait pas loquent, car il lisait ses leons ; mais il tait grave, convaincu, d'un esprit libre et indpendant : je lui dois un amour de la philosophie qui n'a jamais tari
depuis tant d'annes. Encore aujourd'hui, affaibli et refroidi par l'ge,
j'ai conserv pour cette belle science le mme amour, la mme ferveur, la mme foi. Quelques crises philosophiques que j'aie traverses,
rien [VII] ne m'a dcourag. Je n'ai pas eu l'oreille ferme aux nouveauts ; elles m'ont toujours intress et souvent sduit. Je ne me suis
pas montr leur gard un adversaire hargneux et effray ; j'en ai pris
ce que j'ai pu ; mais, malgr ces concessions lgitimes, je suis rest
fidle aux grandes penses de la philosophie ternelle dont parle
Leibniz ; et ces penses n'ont jamais cess de me paratre immortellement vraies.
Je n'ai pas seulement aim la philosophie dans son fond, mais dans
toutes ses parties, dans tous ses aspects et dans toutes ses applications.
Philosophie populaire, philosophie didactique, philosophie transcendante, morale, politique, application la littrature et aux sciences,
histoire de la philosophie, j'ai touch tout, je me suis intress tout,
nihil philosophicum a me alienum putavi. Cet amour de la philosophie
dans son ensemble et dans son tout pourra faire pardonner ce qu'il y a
d'incomplet et d'insuffisant dans chacun de mes travaux.
Cela dit, je n'ai plus qu' abandonner son sort le livre que j'offre
au public. Je dois seulement faire remarquer qu'il est sorti de mes
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
11
cours de la Sorbonne, dans la chaire de philosophie o j'ai eu l'honneur de succder mon ami, le si regrett M. Caro. J'ai cru devoir
conserver ces leons leur forme primitive, avec les imperfections
qu'elle entrane, le nglig, les lacunes, les rptitions ; la refonte sous
forme de livre et exig un travail dont je n'tais plus capable ; peuttre mme ces leons intresseront-elles plus sous la forme libre et
varie de l'enseignement ; enfin j'ai voulu rester professeur devant le
public qui lit, comme je l'avais t si longtemps devant le [VIII] public
qui coute. Et maintenant, il faut que je me spare de ces pages o j'ai
mis le meilleur de ma pense. Puissent-elles, dans le monde troubl o
nous vivons, procurer ceux qui les liront le mme calme et la mme
satisfaction d'esprit que j'ai toujours trouvs dans la doctrine dont elles
sont la trop imparfaite expression !
Octobre 1896.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
[1]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
INTRODUCTION
LA SCIENCE
PHILOSOPHIQUE
Retour la table des matires
[2]
12
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
13
[3]
Introduction la science philosophique
Leon I
LA PHILOSOPHIE EST-ELLE
UNE SCIENCE ?
Retour la table des matires
Messieurs,
Ce n'est pas sans intention que nous avons donn pour litre ces
tudes : Introduction la science philosophique. Notre objet en effet
est d'tablir, s'il est possible, que la philosophie est une science, et de
la traiter comme elle. C'est donc l la premire question qui se prsente nous. Rien de plus contest la philosophie que le droit de
s'appeler science. On n'en nie pas l'existence ; qu'elle s'appelle comme
elle voudra ; mais science, non pas. Que devons-nous penser de ce
dbat ?
Cette question, de la manire dont elle est pose d'ordinaire, ne
prsente pas un grand intrt ; car elle n'est gure autre chose qu'une
question de mots. On prend pour type tel ou tel ordre de sciences, et
en particulier les plus rigoureuses de toutes ; on en tire une dfinition
de la science, et tout ce qui ne correspond pas ce type est exclu de
cette dnomination. Par exemple, l'on convient que le caractre essentiel de la science est l'emploi de l'exprimentation et du calcul ; par l,
toutes les sciences morales, qui n'ont pas, ou qui n'ont que trs imparfaitement ces deux mthodes leur disposition, ne sont pas des
sciences. Ainsi, la jurisprudence, l'conomie [4] politique, l'histoire,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
14
ne s'ont pas des sciences. En ce sens, il est trop vident que la philosophie n'en est pas une. Mais, prendre ce type la rigueur, ce ne seraient pas seulement les sciences morales, ce seraient en grande partie
les sciences naturelles, et mme la physiologie, qui devraient tre limines du rang des sciences : car si cette dernire a commenc, dans
notre sicle, employer sur une vaste chelle la mthode exprimentale, elle est encore plus loin de pouvoir faire usage du calcul. plus
forte raison, la mdecine ne sera-t-elle pas une science, tant elle comporte encore d'empirisme et d'alatoire. Si, au contraire, on largit le
sens du mot science pour y faire rentrer les sciences naturelles et mdicales, pourquoi ne pas l'largir plus encore pour y faire rentrer les
sciences morales et avec elles la philosophie ? Et, aprs tout, qu'importe que l'on tende ou que l'on rtrcisse le sens d'un mot ! Les
choses ne restent-elles pas ce qu'elles sont, de quelque manire qu'on
les appelle ? Que l'on nomme la philosophie de tel nom qu'on voudra,
qu'on l'appelle une tude, une recherche, un exercice, une application
de l'esprit, elle est ce qu'elle est ; et on ne lui donnera pas plus de certitude en l'appelant du nom de science, qu'on ne diminuera ce qu'elle
peut avoir de solidit, en lui refusant ce nom.
Abandonnons donc cette premire manire de poser la question.
Laissons les mots pour passer aux choses.
Dans un sens vraiment philosophique, il n'y a qu'un cas o l'on
peut dire d'une prtendue science qu'elle n'est pas une science. C'est
lorsqu'elle s'occupe d'un objet qui n'existe pas. Par exemple, il y a une
science qui a dur pendant une srie innombrable de sicles, et que la
raison moderne a dfinitivement limine : c'est l'astrologie judiciaire.
Pourquoi ? C'est que l'astrologie judiciaire s'occupait d'un objet qui
n'avait aucun fondement dans la ralit. Quel tait cet objet ? C'tait le
rapport du mouvement des astres avec les destines humaines. Or il
n'y a aucune espce de rapport de ce genre. Ces rapports taient fictifs,
fortuits, imagins par les astrologues, plus ou moins dupes de leur
propre science. Mais l [5] o il n'y a rien de rel, il n'y a rien tudier, rien savoir, par consquent pas de science. Ce n'est plus ici une
question de mots : c'est une question de choses. En est-il de mme de
la philosophie ?
On peut dire tout ce qu'on voudra de la philosophie : qu'elle est une
science obscure, arbitraire, conjecturale, dvore par des divisions intestines, immobile et rditant sans cesse les mmes systmes (tout
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
15
cela est examiner) ; mais ce qu'on ne peut pas dire, c'est que son objet n'existe pas, qu'elle ne porte pas sur des problmes rels. On peut
trouver telle ou telle solution chimrique ; on ne peut pas dire que la
question soit chimrique. C'est une question chimrique de se demander quelle est l'influence d'une comte sur les vnements de notre
plante ; mais on ne peut pas dire que ce soit une question chimrique
de se demander si le monde a commenc ou n'a pas commenc ; car il
faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Peut-tre est-ce une question insoluble, mais, insoluble ou non, c'est une question. Il faut ou que le
monde ait commenc ou qu'il n'ait pas commenc, que l'homme soit
libre ou qu'il ne le soit pas, que l'univers soit l'uvre d'une cause intelligente ou qu'il subsiste par lui-mme ; et lors mme que l'on croirait
pouvoir chapper ces antinomies par la solution critique de Kant,
encore faut-il que ces questions soient poses pour rendre possible
cette solution. En un mot, il y a l des questions relles, et tant qu'il y
aura une raison humaine, ces questions seront poses ; et il y aura une
science qui les posera et qui, avec plus ou moins de succs, essayera
de les rsoudre.
Ainsi, quand mme toute solution serait douteuse, quand mme
toute solution serait dmontre impossible, la philosophie existerait
encore et devrait exister ce titre, qu'elle est au moins ceci, savoir
une science de problmes. Il ne faut pas croire que cela ne soit rien.
C'est en effet un des caractres distinctifs de l'esprit humain d'tre capable de poser des questions. Les animaux ne le font pas. On a dfini
l'homme de bien des manires : un animal raisonnable, un [6] animal
qui rit, animal risibile. On peut le dfinir aussi un animal qui fait des
questions, animal qustionale. Rflchir sur les origines, tendre ses
vues au del du temps et du lieu prsent jusqu'au temps et l'espace
sans bornes, remonter de cause en cause, chercher le secret de la vie et
de la mort, c'est ce dont l'homme est seul capable. Le jour o de tels
problmes naissent dans la vie d'un homme ou d'un peuple est le jour
de l'avnement de l'un ou de l'autre la maturit. Admettez que ces
questions sont insolubles, encore faut-il savoir quelles sont les questions insolubles ; car, parmi celles qu'on dclare telles, il pourrait y en
avoir qui seraient susceptibles de solution. Il faut donc faire au moins
la table de ces problmes insolubles ; et par l mme on les poserait
encore.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
16
Je me reprsente donc une science qui ne serait par un pur rien, et
qui aurait pour objet la dtermination et la division des problmes.
Circonscrire et diviser ce champ indtermin, tel serait son travail
propre. Elle dresserait la carte du vide ; elle serait la gographie de
l'inconnu. Dans une telle science, les problmes seraient poss, numrs, diviss, coordonns, et subordonns suivant un plan mthodique. Ce ne seraient que des questions, mais des questions enchanes d'une manire systmatique et scientifique ; une telle science serait toujours faire, lors mme que la science dite positive s'emparerait elle seule de toute la matire connaissable.
Mais maintenant devons-nous nous contenter de cette premire dfinition ? La philosophie n'est-elle qu'une science de problmes, un
catalogue mthodique de questions ? Qu'est-ce qu'une question ? C'est
une proposition interrogative o un certain rapport est pos d'une manire problmatique entre le sujet et l'attribut. Retranchez l'interrogation, il reste une solution positive dans l'interrogation elle-mme ; car
la question est une solution suppose, en d'autres termes une hypothse. Problme et hypothse sont donc une seule et mme chose. En
posant un problme, on ne pose pas seulement une question vide,
mais, sinon toujours au moins trs souvent, [7] on pose conjecturalement une solution possible. Lorsque l'on parle de problmes insolubles, on n'entend donc pas des problmes auxquels ne rpondrait
aucune solution, ni certaine, ni douteuse, ni intelligible, enfin rien ;
mais des problmes dont la solution possible n'est pas dmontre, ou
encore qui sont susceptibles de plusieurs solutions entre lesquelles on
est embarrass de choisir. Sans doute l'hypothse est accompagne
d'incertitude comme les problmes, mais d'une incertitude limite,
renferme dans les termes d'une ou de plusieurs solutions possibles, et
non pas d'une incertitude indtermine qui serait celle d'un vide absolu, dans lequel il n'y aurait pas mme lieu de distinguer les problmes
les uns des autres ; car, dans le vide, rien n'est distinct.
Montrons par des exemples que les problmes de philosophie ne
sont autre chose que des hypothses. Demander par exemple si le
monde a commenc ou n'a pas commenc, n'est-ce pas concevoir deux
solutions possibles du problme, deux hypothses, celle du commencement, celle du non-commencement ? Demander si l'homme est
libre, n'est-ce pas concevoir d'une part l'hypothse de la libert, de
l'autre celle du dterminisme ? Demander si l'me est immortelle,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
17
n'est-ce pas concevoir l'hypothse de la vie future, ou celle de l'anantissement ? Tout au plus pourrait-on dire qu'il y a des questions qui
n'impliquent aucune solution, par exemple lorsque l'on s'interroge sur
la nature d'une chose, comme lorsqu'on dit : Qu'est-ce que la volont ? Il semble que l'on ne suppose rien par une telle question ; et cependant, en ralit, demander ce que c'est que la volont, c'est demander si elle est ou non rductible au dsir, si elle est ou n'est pas une
action rflexe, si elle n'est pas une affirmation de l'intelligence, etc. ;
or ce sont l autant d'hypothses sur la nature de la volont. Mme les
problmes originaux invents par les philosophes et qui ne correspondent pas des questions naturellement poses par tous les hommes, ne
sont autre chose encore que des hypothses. Lorsque Kant se demande
comment les jugements synthtiques a priori sont possibles, il [8]
suppose l'existence d'une synthse a priori, conception qui a videmment le caractre d'une hypothse. Lorsque Hume demande d'o vient
l'ide de connexion ncessaire, cette question ne s'est pose pour lui
que parce qu'il avait dj conu dans son esprit la possibilit de rduire l'ide de cause ou de pouvoir une succession constante. Le
problme de la communication des substances au XVIIe sicle est n
lorsque les philosophes ont commenc souponner que l'action et la
raction des substances pouvaient bien n'tre autre chose que de
simples concomitances d'actions simultanes.
Il en est de mme dans l'ordre pratique. Colomb ne s'est aventur
la recherche d'une terre inconnue que parce qu'il avait conu l'hypothse qu'il devait rencontrer l'Inde en marchant toujours vers l'ouest.
Si l'on cherche le passage du ple nord, c'est parce qu'on croit la
possibilit d'une mer libre dans les environs du ple.
Ainsi la philosophie n'est pas seulement une science de problmes,
elle est quelque chose de plus ; elle est une science d'hypothses. Ce
n'est pas la science d'un inconnu indtermin ; c'est la science d'un
inconnu dtermin. Ce qui fait l'incertitude, ce n'est pas l'absence de
solution ; c'est l'absence d'un critrium entre plusieurs solutions. Nous
avons donc fait un pas, notre science a un contenu : ce contenu est, si
l'on veut, mobile, flottant, inconsistant ; mais ce n'est pas un pur rien.
N'est-ce rien, en effet, qu'une hypothse ? N'est-ce rien, devant un
problme embarrassant et accablant, d'en entrevoir une solution possible ? N'y a-t-il pas l une satisfaction vraiment scientifique ? Rappelez-vous l'tat de votre esprit lorsque vous sortez de la sance d'un ha-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
18
bile prestidigitateur. Vous avez assist un tour d'adresse merveilleux. Il vous est impossible de le comprendre. Tout ce que vous imaginez pour l'expliquer est inadmissible : c'est une irritation pour l'esprit. Et cependant, dites-vous, il n'est pas sorcier. Il ne l'est pas ; mais
c'est comme s'il l'tait, puisque son secret vous chappe absolument.
Imaginez maintenant que vous [9] trouviez ou que l'on vous propose
une explication plausible, vraie ou fausse, mais seulement possible, et
qui rentre dans les conditions ordinaires de l'exprience. Cela suffit
pour vous satisfaire et calmer l'impatience de votre curiosit. Il vous
suffit d'avoir une issue vos doutes, un dnouement intelligible celle
intrigue ; vous tes sur que ce n'est pas de la magie. Que cette solution
ou une autre soit la vraie, toujours est-il qu'il y en a une. Sans doute,
vous le saviez auparavant ; mais vous le voyez bien plus clairement
l'aide d'une hypothse. Si ce n'est pas la ralit, c'est au moins un
symbole qui fixe les ides, et qui par l mme tranquillise l'esprit.
Il y a plus. Dans un certain nombre de cas, il semble que l'on soit
parvenu circonscrire le nombre des hypothses possibles. Par
exemple, pour ce qui concerne l'origine du monde, les anciens disaient
dj : Le monde est ou l'uvre du hasard, ou l'uvre d'une ncessit
aveugle, ou l'uvre d'une providence ; or ce raisonnement est encore le mme aujourd'hui. M. Herbert Spencer, numrant de son ct
toutes les hypothses possibles sur l'origine du monde, dit galement
qu'il n'y en a que trois : le thisme, le panthisme et l'athisme. Voici
comme il rsume ces trois hypothses : Nous pouvons, dit-il, faire
trois suppositions intelligibles sur l'origine de l'univers : ou bien qu'il
existe par lui-mme, ou qu'il se cre lui-mme, ou qu'il est cr par
une puissance extrieure. Il ne serait pas difficile de faire cadrer ces
trois explications avec les trois explications de l'antiquit. Admettons
donc qu'il n'y ait que ces trois suppositions. N'est-ce pas savoir
quelque chose que de savoir que, sur l'origine des choses, il n'y a que
trois explications possibles ? Et si l'on dit qu'il y en a une quatrime,
savoir que nous n'en savons rien du tout, cette quatrime hypothse
rpond un autre problme : celui des limites du connaissable et de
l'inconnaissable. Toujours est-il que, si l'on se renferme dans les
bornes de l'esprit humain et de ses facults, on sait n'en pas douter
qu'il n'y a que trois thses possibles ; et savoir cela, c'est faire acte de
science.
[10]
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
19
Cependant, si la philosophie se bornait soit des problmes, soit
des hypothses, elle ne sortirait pas de l'incertitude. Dans le premier
cas, c'est l'incertitude illimite ; dans le second cas, c'est l'incertitude
limite ; mais dans les deux cas, n'aurait-on pas le droit de dire : Une
science qui ne porte que sur l'incertain est-elle une science ? N'y a-t-il
donc rien de vrai, rien de fond, rien de dmontr en philosophie ?
Si vraiment, et, pour l'tablir, il n'est pas besoin de sortir des dfinitions prcdentes. Toute hypothse, en effet, repose sur un fait ; l'hypothse est douteuse, mais le fait est certain. L'hypothse de l'harmonie prtablie repose sur ce fait que souvent l'action et la raction apparentes des choses se ramnent un simple accord, c'est--dire une
correspondance de mouvements. C'est ainsi que, dans un orchestre,
deux instruments ont l'air de se rpondre l'un l'autre, qui ne s'coulent mme pas, et pourraient ne pas s'entendre, mais dont chacun, attentif la mesure, suivant sa propre partie, se trouve, grce la prcision du compositeur, tomber juste au point o il devrait tre s'il avait
entendu l'autre et s'il voulait lui rpondre. L'hypothse de la sympathie
repose sur ce fait que nous approuvons les choses auxquelles nous
sympathisons. Par exemple, si quelqu'un aime la campagne et que
nous l'aimions nous-mme, nous disons qu'il a raison, quoique en
principe on ne puisse pas dire que quelqu'un ait raison parce qu'il partage nos gots. L'hypothse de l'utilitarisme repose sur ce fait que
souvent notre intrt concide avec notre devoir. L'hypothse des ides
platoniciennes repose sur ce fait que, dans les espces vivantes,
chaque individu est conforme au type de l'espce, et semble avoir t
tir d'un moule commun. L'hypothse des causes finales a pour origine ce fait que les organes ressemblent des instruments prpars par
l'art pour accomplir un certain effet. L'hypothse de la vie future a
pour base la distribution ingale du bonheur et du malheur, sans aucune proportion avec le mrite. Ce que l'on appelle les controverses en
philosophie ne sont autre chose que des faits opposs des faits. Les
arguments, les objections, [11] les rponses, les instances, les rpliques, toute cette artillerie de la dialectique scolastique ne sont jamais qu'une srie de faits exprims sous forme abstraite, et dont il
s'agit d'apprcier le nombre et la signification. Inutile d'ajouter
qu'indpendamment des faits qui servent aux hypothses, il y a encore
en philosophie un grand nombre de faits qui existent pour eux-mmes.
Ainsi, lors mme qu'elle renoncerait ces problmes et hypothses
que Jouffroy appelait les questions ultrieures, la philosophie demeu-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
20
rerait encore titre de science de faits ; et ne ft-elle, comme on dit,
qu'une science descriptive, une science descriptive est encore une
science. Tout le monde sait, en effet, qu'en psychologie, en esthtique,
en morale, il y a un grand nombre de faits qui ont t observs, dcrits, classs ; cela au moins est du domaine du certain ; et lors mme
qu'elle ne s'lverait pas plus haut, elle se prsenterait au moins avec
ce caractre positif d'tre l'analyse des phnomnes de l'esprit humain.
Maintenant ces faits leur tour ne sont-ils rien autre chose que des
faits ? N'y faut-il voir qu'une simple matire brute, sans signification,
semblable ces catalogues de faits dont parle Bacon et dont il nous a
donn l'exemple dans son Sylva sylvarum ? Ces faits sont-ils fortuits,
isols, incohrents, sans consistance, sans gnralit, sans conditions
rgulires, en un mot sans lois ? De mme que la nature, l'esprit n'a-til pas aussi ses lois ? De mme que c'est une loi que les corps tendent
vers le centre de la terre, n'est-ce pas aussi une loi que les hommes
sont attirs par le plaisir et repousss par la douleur ? Sans doute la
philosophie ne peut prtendre, comme la physique et l'astronomie,
des lois mathmatiques ; mais c'est prcisment une question de savoir, et mme c'est la question par excellence, si les lois mathmatiques sont des lois absolues, s'appliquant toute espce d'tres, ou
seulement la matire, de telle sorte qu'imposer de telles lois toute
science c'est rsoudre a priori et sans discussion le problme fondamental de la philosophie. Un tel procd ne pourrait tre facilement
disculp de l'imputation de ptition de principe.
[12]
Mais ce qu'on ne peut contester la philosophie, c'est de pouvoir
prsenter au moins des lois empiriques, ou, si vous voulez, des faits
gnraliss, qu'Aristote exige de la science pour tre science. Est-il
ncessaire de rappeler tout ce que la psychologie nous apprend des
lois de nos facults : par exemple, les lois de la mmoire, savoir que
la rptition et la prolongation fixent le souvenir ; les lois de l'association des ides, savoir que deux ides qui se sont succd dans le
temps tendent se reproduire l'une aprs l'autre ; les lois de l'habitude,
savoir que l'habitude mousse la sensibilit et perfectionne l'activit ; les lois des passions, telles que celle-ci : toutes les passions ne
sont que le dsir transform ; les lois du langage, par exemple celle-ci
de Condillac : les langues sont des mthodes analytiques ? Nous ne
citons que des faits simples et bien connus, pour fixer les ides par des
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
21
exemples. Indpendamment de ces lois empiriques, la philosophie
peut encore faire valoir des lois rationnelles, telles que les lois du syllogisme, celle de la proposition, de la dfinition, en un mot les lois
logiques, et aussi les lois morales, qui, lors mme qu'elles pourraient
avoir une origine dans l'exprience et dans la coutume, se prsentent
aujourd'hui avec un caractre d'autorit qu'on ne peut mconnatre et
qu'il faut expliquer. On discute sans doute en philosophie sur la porte
et les limites de ces lois psychologiques, logiques ou morales, comme
on discute aussi dans les sciences sur les limites et la porte des lois
les plus certaines. Quelques-uns aussi essayent d'y ramener toutes les
lois une seule ; mais, en attendant que ces rductions soient dmontres, on distingue les lois mcaniques, les lois chimiques, les lois
physiques et, dans chaque ordre, les diffrentes lois les unes des
autres. Pourquoi n'en serait-il pas de mme en philosophie ? Ainsi, en
ajoutant ce nouveau caractre au prcdent, nous aurons une dfinition complte, qui est celle-ci : la philosophie est une science de faits
et de lois ; et comme les faits et les lois sont des vrits, c'est donc une
science de vrits ; et quand mme on ferait abstraction des solutions
hypothtiques par lesquelles [13] on essaye d'enchaner ces vrits
sous forme de systme, ces vrits ne subsisteraient pas moins litre
de fragments briss, spars, existant chacun pour soi-mme, en un
mot de vrits particulires, et l'on pourrait dire que la philosophie est
une science de vrits partielles, coordonnes, d'une manire plus ou
moins artificielle, par ces hypothses que l'on appelle des systmes.
Est-ce l donc si peu de chose ? La vrit a-t-elle donc si peu de
prix qu'on la ddaigne, quelque degr qu'elle se prsente, parce
qu'elle ne serait pas toute la vrit ? Toute science ne commence-t-elle
pas par tre une science de vrits partielles ? La physique, avant
d'tre arrive l'tat synthtique o elle est aujourd'hui, n'a-t-elle pas
t longtemps une science de faits et de lois, de faits incohrents et de
lois isoles ? Ce sont l, la vrit, des tats provisoires et transitoires ; mais c'est par l qu'il faut passer pour s'lever plus haut. Supposez maintenant une science qui, par la difficult et la complexit de
ses problmes, par la hauteur de son objet, ne soit encore arrive (au
moins dans sa partie positive et certaine) qu' saisir des parcelles de
vrit, des points de vue isols, tantt des faits, tantt des lois, et des
lois tantt empiriques, tantt rationnelles : cet ensemble de vrits
mme incohrentes, mais dont chacune serait solide sparment, ne
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
22
serait-ce pas quelque chose ? Et ainsi, ce titre au moins, savoir
comme science de vrits partielles, la philosophie devrait subsister.
Regardons-y cependant de plus prs. Les vrits que nous appelons
partielles le sont-elles vritablement ? Les vrits philosophiques ne
sont-elles pas enveloppes, entrelaces les unes dans les autres ? Ne se
contiennent-elles pas les unes les autres ? L'tude de la plus humble
sensation n'implique-t-elle pas la question de la conscience, celle de
l'objectivit, celle de l'espace, du temps, celle de l'activit intellectuelle, celle du moi, on un mot la mtaphysique tout entire ? La question de l'instinct n'implique-t-elle pas celle des limites de la conscience et de l'inconscience, du mcanisme et du dynamisme, [14] de la
volont et de la libert, de l'innit et de l'hrdit ? En philosophie,
rien de plus difficile que la sparation des questions. Aussi rien de
plus superficiel que ces thories de morale indpendante, de psychologie indpendante que l'on croit trs scientifiques, et qui ne sont que
des limitations conventionnelles commodes pour l'tude des questions. Ainsi, dans tous les problmes philosophiques, la pluralit suppose l'unit ; et, tout en reconnaissant que nous ne connaissons gure
que des parties, c'est cependant le tout que nous apercevons dans chacune des parties. D'o cette nouvelle dfinition : la philosophie est la
science partielle du tout, la science fragmentaire de l'unit.
Maintenant ces parties de vrit peuvent leur tour tre considres un autre point de vue ; puisqu'elles sont dans le tout et par le
tout, elles ne sont pas seulement partielles, elles sont relatives au tout.
Ce ne sont pas seulement des fragments, ce sont des degrs de vrit,
et ce titre des acheminements vers la vrit idale. (fragments en
regard de la totalit des parties spares, degrs en regard de l'unit du
tout) Que l'on considre, en effet, les choses diffrents degrs de
profondeur, cette doctrine peut tre vraie un certain degr, qui ne le
sera plus un degr suprieur. C'est ainsi que les hypothses qui nous
paraissaient tout l'heure devoir tre exclues du rang de vrits, peuvent y rentrer titre de vrits provisoires et relatives, reprsentant un
certain tage des conceptions de l'esprit humain. Par exemple, la doctrine des atomes, qui peut tre fausse comme explication finale de
l'univers, peut tre vraie comme exprimant la premire approximation
que nous puissions avoir de l'essence de la matire. C'est dans ce sens
que Leibniz rpte partout que tout dans l'univers doit s'expliquer mcaniquement, mais que le mcanisme suppose la mtaphysique. On
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
23
peut donner beaucoup d'exemples de cette loi des tages de vrit.
Ainsi, on est trs port aujourd'hui tout expliquer par l'hrdit,
mme ce que nous appelions autrefois la raison pure. L'empirisme,
vaincu par Kant, croit avoir pris sa revanche, et il a retrouv toutes ses
prtentions grce cette merveilleuse ressource de l'hrdit, qui rpond [15] tout. Supposons, si l'on veut, qu'il en soit ainsi. Toujours
est-il que, si les principes sont hrditaires, c'est--dire acquis dans
l'espce, ils sont inns dans l'individu : car l'individu n'acquiert point
par sa propre exprience ce qu'il tient de l'hrdit. S'il en est ainsi, on
peut dire que la vieille doctrine des ides innes est en dfinitive celle
qui a triomph, et que la table rase a t dfinitivement vaincue ; car,
mme par l'hrdit, on n'arrivera jamais un moment o rien n'aurait
prcd, et o l'on rencontrerait une prtendue table rase, c'est--dire
le pur indtermin, le vide, le rien. En tout cas, si on restreint le problme l'individu, comme c'tait le cas par exemple entre Leibniz et
Locke, on peut dire qu'il y a une vrit certaine : c'est qu'il y a des
ides innes. Maintenant, que ces ides viennent d'une vie antrieure,
comme le pensait Platon ; qu'elles soient la marque que Dieu a mise
sur son ouvrage, selon l'expression de Descartes ; qu'elles soient la
vision de Dieu lui-mme, comme dans Malebranche ; enfin qu'on les
explique thoriquement par la transmission hrditaire, ce sont l des
questions ultrieures. Toujours est-il qu' l'tage o nous sommes placs, l'innit est la vrit.
C'est-l une vrit du mme ordre, sauf le degr de prcision, que
celles qui existent dans les sciences. Serait-on admis, par exemple,
soutenir que les lois de l'affinit chimique ne sont pas des vrits, sous
ce prtexte que, si l'on pouvait pousser la recherche plus loin, ces lois
se rduiraient peut-tre un cas particulier d'une loi plus gnrale et
plus simple ? N'est-il pas vident que cette rduction ultrieure ne
changerait en rien la vrit des lois actuelles ? C'est ainsi encore que
les lois de la chute des corps dcouvertes par Galile n'en taient pas
moins des lois parfaitement certaines avant qu'on sut qu'elles sont les
consquences de la loi newtonienne de la gravitation universelle ; et
elles n'ont pas cess d'tre des lois aujourd'hui qu'on le sait. On continue les enseigner pour elles-mmes, et l'on peut les possder parfaitement sans avoir fait et sans faire jamais aucune astronomie. C'est
une vrit d'un certain tage, qui se rattache une autre vrit place
[16] plus haut. Enseignons donc qu'en tant qu'il s'agit de l'individu, la
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
24
loi est l'innit, sauf chercher ensuite si c'est une loi primordiale ou
drive. Il en est de mme des instincts, dont l'innit ne peut pas tre
conteste plus que celle des ides.
Cette doctrine des degrs et des tages de la vrit explique que
l'on puisse soutenir la fois le pour et le contre en philosophie sans
sophistique et sans contradiction. C'est ce qu'a montr Pascal ; et c'est
ce qu'il appelle la mthode de renversement du pour au contre , ou
encore la mthode de gradation . Il en donne un exemple des plus
ingnieux. Le peuple, dit-il, honore les personnes de grande naissance. Les demi-habiles les mprisent, disant que la naissance n'est
pas un avantage de la personne, mais du hasard. Les habiles les honorent, non par la pense du peuple, mais par la pense de derrire. Les
dvots, qui ont plus de zle que de savoir, les mprisent malgr cette
considration qui les fait honorer par les habiles, parce qu'ils en jugent
par une nouvelle lumire que la pit leur donne. Mais les chrtiens
les honorent par une autre lumire suprieure. Ainsi vont les opinions
succdant du pour au contre, selon qu'on a de la lumire. (Penses,
dit. Havet, art. V, 2.)
Appliquez cette mthode en philosophie, et beaucoup de difficults
s'clairciront. L'on verra que ce qu'on appelle des controverses striles , suivant l'expression banale consacre, ne sont que les diffrents points de vue superposs les uns aux autres, et dont chacun est
vrai son tage et sa place. (vrits circonstancielles et non vrits
absolues, dans la relativit des relations et non son universalit) Par
exemple, on peut dire, dans un ordre de gradation analogue celui de
Pascal : L'instinct et le sens commun nous forcent croire l'existence des corps : donc il y a un monde extrieur. Oui, mais nous ne
connaissons les corps que par nos sensations, qui sont subjectives :
donc il n'y a pas de monde extrieur. Oui, mais ces sensations subjectives ont une cause objective : donc il y a un monde extrieur.
Oui, mais cette cause objective n'est peut-tre que notre moi objectivant des imaginations ; donc il n'y a pas de monde extrieur. [17]
Oui, mais ce moi qui s'oppose lui-mme sans en avoir conscience
n'est pas un moi, c'est un non-moi : donc il y a un monde extrieur.
Jusqu'o se continuera ce dialogue ? Jusqu' ce qu'on ne puisse plus
aller plus loin. La dernire proposition laquelle on arrive est la vrit
limite, jusqu' ce qu'un degr de profondeur de plus ait rvl un nouveau point de vue, ou jusqu' ce que le problme pos aille se perdre
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
25
dans un autre problme : c'est ce qui arrive ici, o le problme de l'extriorit va se perdre dans le problme de l'unit de substance. De ces
considrations sortira une nouvelle dfinition de la philosophie. La
philosophie est la science des vrits relatives, des approximations
successives de la vrit finale.
Cette dfinition paratra sans doute bien modeste. La voil donc,
dira-t-on, celle science hautaine qui s'appelle la reine des sciences, la
science des premiers principes et des premires causes, la science de
l'absolu, de l'tre en tant qu'tre, la voil rduite n'tre plus que la
science du relatif. Ceux qui nous feraient cette objection ne comprendraient pas bien la recherche laquelle nous nous livrons en ce moment. Nous ne renions, en ce qui nous concerne, et nous revendiquerons hautement plus lard, dans la suite de ces tudes, les prtentions,
les ambitions, les droits de la philosophie premire. Mais nous ne parlons pas ici au nom d'une cole et d'une doctrine particulire ; nous
recherchons seulement quel est le minimum que l'on ne peut refuser
la philosophie, quelle que soit d'ailleurs l'cole philosophique laquelle on appartient. Or ce minimum tel que nous l'avons dfini jusqu' prsent, suffit pour faire passer la philosophie tout entire. C'est
dans l'intrieur de la science elle-mme qu'aura lieu le dbat sur la
porte de la science ; nous ne combattons ici que pour son existence.
Qu'elle soit seulement, et tout y passera.
Mme cette notion d'absolu que la dfinition prcdente paraissait
sacrifier n'est pas si compltement exile que l'on croit d'une science
du relatif. Car le relatif sans absolu devient lui-mme l'absolu. Si, en
effet, il n'existe rien autre chose qu'une srie phnomnale sans commencement ni fin, [18] cette srie tant tout, et ne dpendant de rien
autre chose que d'elle-mme, est par l mme quelque chose d'absolu.
Car l'absolu est ce qui ne dpend que de soi, ce qui n'a aucune condition d'existence autre que son existence mme : c'est le ,
de Platon. Dans l'hypothse du relatif, l'absolu subsisterait
encore titre de totalit phnomnale ; car Kant a admirablement dmontr que l'absolu s'impose nous sous deux formes, soit comme
terme premier, indpendant de toute srie, soit comme totalit. On
n'chappe l'un de ces termes qu'en se rfugiant dans l'autre ; et si l'on
veut les carter tous deux titre d'antinomies insolubles, encore faut-il
les comparer l'un l'autre ; et par l mme encore on pose la question
de l'absolu.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
26
L'absolu peut encore rentrer dans la philosophie du relatif titre de
l'unit idale de la srie. Imaginons l'hypothse de l'volution o
chaque phnomne sort du prcdent par un dveloppement intrieur,
o le prsent, selon l'expression de Leibniz, est gros de l'avenir et issu
du pass, o la srie se dveloppe sans cesse du moins au plus : ne
conoit-on pas que le point de dpart idal de cette srie croissante et
dcroissante doit tre zro, et que le point d'arrive doit tre l'infini,
tel que l'entendent les mtaphysiciens ? Que ce soient l des notions
idales, cela se peut ; mais ce sont des notions insparables de notre
esprit, et qui seules rendent intelligible l'ide de srie.
Disons encore que l'absolu peut avoir sa place dans la philosophie
du relatif ou ct, titre d'inconnaissable. C'est ce nom que lui
donne le plus grand philosophe du relatif de notre temps, savoir
Herbert Spencer. Pour lui, ce qu'il appelle inconnaissable, c'est l'absolu. C'est lui, et non pas nous, qui crit : Tous les raisonnements par
lesquels on dmontre la relativit de la connaissance supposent distinctement quelque chose au del du relatif. Dire que nous ne pouvons
connatre l'absolu, c'est affirmer implicitement qu'il y a un absolu.
C'est le mme philosophe qui soutient contre le philosophe Hamilton
que la notion d'absolu n'est [19] pas ngative, mais positive : Si le
non relatif ou l'absolu, dit-il, n'est prsent la pense qu' titre de ngation pure, la relation entre lui et le relatif devient inintelligible,
parce que l'un des deux termes manquerait dans la conscience. Et il
dmontre en outre que cette notion n'est pas ngative : Notre notion
des limites, dit-il, se compose premirement d'une certaine espce
d'tre et secondement d'une conception de limites. Dans son antithse
(l'illimit), la conception des limites est abolie, mais non pas celle de
l'tre. (c'est toute l'insparabilit entre le continuum des discontinuits indfiniment variables et plurales d'tre, d'avoir et de faire, et le
continuum complmentaire d'immanence existentielle unicitaire)
Cette notion est indestructible ; elle est la substance mme de la pense ; et par consquent, puisque la seule mesure de la validit de nos
croyances est la rsistance que nous faisons aux efforts faits pour les
changer, il en rsulte que celle qui persiste dans tous les temps parmi
toutes les circonstances est par l mme celle qui a le plus de valeur.
Le mme philosophe, tout en professant que l'absolu est inconnaissable en lui-mme, reconnat cependant que nous le connaissons au
moins par ses manifestations, et il dit que la seule chose permanente
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
27
est la ralit inconnaissable cache sous toutes ses apparences changeantes . Enfin, mme dans le positivisme proprement dit, nous
voyons encore l'absolu rentrer sous le nom d'immensit : L'immensit tant matrielle qu'intellectuelle, dit Littr, tient par un lien troit
nos connaissances et devient par cette alliance une ide positive du
mme ordre ; je veux dire qu'en les touchant et en les bordant, cette
immensit apparat sous son double caractre, la ralit et l'inaccessibilit. C'est un ocan qui vient battre notre rive et pour lequel nous
n'avons ni barques ni voiles, mais dont la claire vision nous est aussi
salutaire que formidable.
On le voit, la notion d'absolu est loin d'tre carte par les philosophes du relatif, ni par Kant qui l'admet sous le litre de noumne, ni
par Spencer qui en fait l'inconnaissable, ni par Littr qui l'appelle
l'immensit, ni mme par Hamilton, le plus critique de tous, qui reproche Kant de n'avoir pas exorcis la notion d'absolu et qui luimme la reprend [20] titre de croyance et de rvlation merveilleuse.
Dans toutes ces philosophies du relatif, l'absolu demeure titre de
substance indfinissable et incomprhensible, mais non pas titre de
rien et de zro. Nous ne le connaissons pas en lui-mme ; nous ne le
connaissons que dans et par le relatif ; et ainsi encore, pour ces coles,
la philosophie pourrait tre dfinie non pas seulement la science du
relatif pur et simple, mais la science relative de l'absolu.
Tournons-nous maintenant du ct de ceux qui, comme nous, admettent l'existence d'un absolu comme base fondamentale de leur philosophie, qui rattachent le relatif l'absolu, non pour liminer celui-ci,
mais pour clairer celui-l, qui admettent donc un point fixe antrieur
et suprieur toute srie phnomnale, qui de plus croient que cet absolu n'est pas compltement inconnaissable, qui mme vont encore
plus loin et ne craignent point de le dfinir par le mot d'esprit, selon le
mot de Hegel : L'absolu, c'est l'esprit. Demandons ces philosophes, demandons-nous nous-mmes si nous avons le droit d'exiger
une autre dfinition de notre science que celle que nous venons de
donner, savoir : la philosophie est la science relative de l'absolu. Je
ne le crois pas. En effet, si cette science n'est pas relative, il faut donc
qu'elle soit absolue. Or, quel est le philosophe, si dogmatique qu'il
soit, qui oserait dire de bonne foi qu'il possde la science absolue de
l'absolu ? L'absolu seul peut avoir la science absolue de lui-mme.
L'infini seul peut avoir la science infinie de l'infini. Dieu seul peut
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
28
possder la science divine. Cela rsulte des termes mmes. Mme
ceux qui pensent que l'absolu est notre fond, notre substance, notre
tre vritable, que Dieu, pour parler comme un philosophe contemporain, nous est plus intrieur que notre intrieur, mme alors ces
philosophes doivent reconnatre que cette intriorit fondamentale ne
nous apparat qu' travers nos phnomnes, qu' travers le temps et
l'espace, et que nous ne pouvons nous connatre qu'en nous ignorant.
Mme dans ce cas, il serait vrai de dire que Dieu ne devient visible,
[21] selon l'expression de Bacon, que par un rayon rfract ; mme
alors il serait encore vrai de dire que la philosophie est la science relative de l'absolu.
Un illustre crivain qui a pass les dernires annes de sa vie
mditer sur la religion et sur la philosophie, M. Guizot, avait crit qu'il
n'y a pas et qu'il ne peut pas y avoir de science de l'infini, parce que le
fini est infiniment disproportionn avec l'infini. J'avais pris la libert
de lui rpondre que nous n'avons pas, la vrit, de science complte
de l'infini, mais que nous pouvons en avoir une connaissance incomplte et relative qui n'est pas un pur rien, et qui vaut mieux que rien :
J'avoue, lui disais-je, que je ne crois pas ma pense adquate l'essence des choses. Il me fit l'honneur de me rpondre que j'entrais par
l mme dans sa doctrine. Il n'y a de science, disait-il, que l o la
pense est adquate l'objet qu'elle tudie, quand il y a connaissance
effectivement et possiblement complte et claire des faits et de leurs
lois, de l'enchanement des causes et des effets ; ces conditions
seules la science existe, et l'esprit scientifique est satisfait. ce
compte, rpondrons nous, la science n'existe jamais que quand elle est
finie ; avant que la science ne soit faite, elle n'est pas une science ;
mais comment pourra-t-elle tre faite si elle ne commence pas par se
faire ? et, pendant qu'elle se fait, elle ne peut tre encore compltement adquate son objet ; elle ne l'est mme jamais compltement,
au moins pour les questions nouvelles et non rsolues. La dfinition
de Guizot ne s'applique donc qu' la science immobile et idale, et non
la science relle et en mouvement. Les diverses sciences sont ingalement loignes de ce but idal, ce qui ne les empche pas d'tre
sciences. La philosophie l'est peut-tre plus que toutes les autres : cela
est possible ; mais que ce soit une raison de renoncer nos recherches
parce qu'elle ne donne pas tout ce qu'on dsire, c'est tre bien modeste
pour l'esprit humain. Il n'est pas rationnel de prtendre, moins d'em-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
29
brasser hautement le scepticisme (ce qui est encore une philosophie),
que, [22] parce que l'on ne sait pas tout, on ne sait rien, et qu'il n'y a
pas de milieu entre rien et tout. Pascal disait que, tout ayant rapport
tout, toutes choses tant causes et causantes, celui qui ne sait pas tout
ne sait rien. Ne peut-on pas dire, au contraire, en retournant la proposition, que tout ayant rapport tout, toutes choses tant causes et
causantes, celui qui sait quelque chose, si peu que ce soit, sait par l
mme quelque chose du tout ?
Les plus grands philosophes et les plus dogmatiques n'ont jamais
prtendu que l'on pt avoir de l'absolu une science absolue. Descartes
disait que nous pouvions concevoir Dieu, mais non le comprendre. Il
le comparait une montagne que l'on peut toucher, mais non embrasser. Malebranche disait que nous ne connaissions pas Dieu par son
ide, c'est--dire de faon pouvoir dduire ses proprits de son essence, comme on fait en gomtrie. Nous sommes plongs en Dieu
comme dans la lumire, par laquelle nous voyons toutes choses sans
savoir en elle-mme ce qu'elle est. Spinoza disait que nous ne connaissons que deux attributs de Dieu, quand il en possde un nombre
infini. La thologie elle-mme affirme que Dieu est un Dieu cach ; et
saint Thomas enseigne qu'il y a deux degrs d'intelligibles en Dieu, un
degr par lequel il est accessible la raison et un autre plus lev que
l'on n'atteint que par la foi. N'est-ce pas dire que ce que nous connaissons de Dieu par la raison n'est qu'une rvlation incomplte et tout
humaine ? Chez les anciens, Platon disait galement que nous n'apercevons que difficilement l'ide de Dieu, c'est--dire l'essence de Dieu,
, et les Alexandrins plaaient cette essence au-dessus de
l'intelligence et de l'tre. Pour tous ces philosophes, il n'est pas inexact
de dire que la philosophie est la science relative de l'absolu, en
d'autres termes qu'elle est la science humaine du divin.
Maintenant, de ce que les plus grands philosophes ont reconnu que
la mtaphysique elle-mme, que la philosophie premire ne peut atteindre qu' des lumires incompltes, [23] des clarts obscures,
faut-il conclure avec les nouveaux philosophes qu'une telle science
n'est qu'une chimre et un leurre et qu'il faut nous renfermer dans les
bornes du fini ? C'est un conseil que l'on donnait dj aux hommes du
temps d'Aristote, et qu'il repoussait par ces mles paroles : Il ne faut
pas croire ceux qui conseillent l'homme de ne songer qu'aux choses
humaines, et l'tre mortel qu' des choses mortelles comme lui. Loin
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
30
de l, il faut que l'homme cherche s'immortaliser autant qu'il lui est
possible, .
Ainsi, malgr les assauts qui s'lvent aujourd'hui de divers cts
contre les parties les plus hautes de la philosophie et contre la philosophie elle-mme, nous ne sommes pas encore parmi les dcourags.
Nous sommes fermement convaincu que l'esprit humain ne se laissera
pas dcouronner, ni dpouiller de sa plus noble prrogative, celle de
penser l'absolu et l'infini. Nous ne sommes pas non plus effray
des efforts de l'esprit nouveau qui veut porter en philosophie une mthode plus scientifique et plus exacte. On peut chercher voir plus
clair, sans renoncer porter les regards en haut : car c'est d'en haut
que vient la lumire. Nous ne renonons donc rien de ce qui constitue la philosophie. Nous croyons la raison humaine et la raison
divine, la libert philosophique et la possibilit d'tablir des principes par la libert. Pour nous, la cause de la libert de penser est la
cause mme du spiritualisme. Si la pense doit tre libre, c'est qu'elle
est sacre. Si elle tait un accident fortuit de la matire, en quoi vaudrait-elle mieux que tout autre accident, tels que l'or ou la volupt ?
De quel droit traitez-vous votre esprit en esclave, lorsque vous faites
de la pense une souveraine sans contrainte et sans matre ? Libert de
penser et dignit de l'esprit sont deux termes insparables, et, pour
finir par une dernire dfinition, la philosophie est pour nous la
science de l'esprit libre, et la science libre de l'esprit.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
31
[24]
Introduction la science philosophique
Leon II
DE QUELQUES DFINITIONS
RCENTES DE LA PHILOSOPHIE
Retour la table des matires
Messieurs,
Pendant de longs sicles, la philosophie a t considre comme
une science semblable toutes les autres, ayant son objet propre, sa
mthode, ses rsultats acquis. De nos jours, ce caractre de science lui
a t refus. On n'a pas voulu cependant pour cela se priver compltement de philosophie. On a essay de la conserver diffrents titres,
sous diffrents points de vue ; et on a donn plusieurs dfinitions nouvelles, que nous voudrions examiner.
La premire de ces dfinitions qui retranchent le fond de la philosophie, tout en lui laissant le droit l'existence, est celle-ci : la philosophie est la science de l'inconnu. Nous y avons dj fait allusion dans
notre premier travail ; nous devons ici l'examiner en elle-mme.
D'aprs cette conception, toutes les choses de l'univers se divisent
en deux classes : les choses connues et les choses inconnues. Les
premires seules sont l'objet de la science ; les secondes sont l'objet de
la philosophie. Encore faut-il ici tablir une distinction : parmi les
choses inconnues, il en est qui sont du mme ordre que les choses
connues ; ce ne sont pas de pures inconnues ; ce sont des lacunes par-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
32
mi les connues ; elles tombent ou peuvent tomber sous les prises des
mmes mthodes, et se classer leur tour dans la catgorie du connu.
Ainsi, dans l'tude des fonctions physiologiques, il y a des parties
obscures, des points inexplors, mais c'est toujours le mme domaine ;
ainsi en est-il des combinaisons nouvelles que l'on peut trouver en
chimie, des astres que l'on [25] peut dcouvrir dans le ciel, etc. Toute
cette portion de l'inconnu n'en est pas moins du domaine de la science,
parce que c'est le mme genre de recherches que celui o l'on a trouv
jusqu'ici les choses connues.
Ce qui reste donc titre d'inconnu pour constituer l'objet propre de
la philosophie, c'est cette portion des choses qui chappe ou qui a
chapp jusqu'ici aux prises de la mthode scientifique proprement
dite, ce qui ne nous est donn que dans sa complexit concrte, que
nous ne pouvons ni diviser ni analyser, et dont nous ne pouvons deviner l'essence ou la cause que par le pur raisonnement abstrait ; en un
mot, c'est l'indtermin. Aussitt que cet indtermin devient dterminable, c'est--dire aussitt que ses conditions d'existence tombent sous
la mthode exprimentale, cet objet se spare de la philosophie pour
entrer dans le domaine des sciences positives. La philosophie ne comprend donc que les objets qui, soit actuellement, soit absolument,
chappent aux prises du dterminisme scientifique : une fois que la
science s'empare de ces objets, par l'exprience et le calcul, la philosophie les abandonne ; par l, on voit que le champ philosophique
tend devenir toujours de plus en plus restreint, mesure que le
champ de la science augmente. On pourrait mme entrevoir un terme
idal o ce champ de la philosophie serait rduit rien, si ce n'est ce
qui, tant non seulement inconnu, mais inconnaissable, chapperait
par l mme aux prises de la science.
Le point de vue que nous venons de rsumer a t expos clairement et fortement, par Claude Bernard, dans son Introduction la
mdecine exprimentale, et c'est lui principalement qu'il a d de se
rpandre parmi les philosophes, qui ont paru souvent l'adopter, ou plutt s'y rsigner. Voici comment s'exprime le grand physiologiste
Claude Bernard :
Au point de vue scientifique, la philosophie reprsente l'aspiration
ternelle de la raison humaine vers la connaissance de l'inconnu. Les phi-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
33
losophes se tiennent toujours sur les questions en controverse et dans les
rgions leves, [26] limites suprieures des sciences. Par l, ils communiquent la pense scientifique un mouvement qui la vivifie. Dans le sens
restreint o j'entends la philosophie, l'indtermin seul lui appartient, le
dtermin tombant incessamment dans le domaine scientifique.
Ce passage de Claude Bernard est significatif ; mais, avant lui, un
philosophe avait dj aperu et nonc la mme doctrine. Il est mme
remarquer que, dans l'nonc de cette opinion, le philosophe avait
apport encore plus de prcision que le savant.
mesure que les sciences particulires se sont formes et multiplies, dit Th. Jouffroy, certains objets qui faisaient d'abord partie de l'objet total de la science primitive en ont t retranchs ; et, comme ils n'ont
pu en tre retranchs qu' la condition d'tre mieux connus, il s'ensuit que
ceux qui ont continu en faire partie ont continu de rester obscurs, en
sorte qu' toutes les poques la philosophie a eu pour objet la partie reste
obscure de l'objet total de la connaissance humaine.
Qu'est-ce donc que la philosophie ? C'est la science de ce qui n'a pas
encore pu devenir l'objet d'une science ; c'est la science de toutes ces
choses que l'intelligence n'a pas encore pu dcouvrir les moyens de connatre entirement : c'est le reste de la science primitive totale ; c'est la
science de l'obscur, de l'indtermin, de l'inconnu.
O est donc l'unit de la philosophie ? C'est une unit de couleur et
de situation, et non point une unit relle. Entre tous les objets de la philosophie, il y a cela de commun qu'ils sont encore obscurs et inconnus.
Que faut-il donc faire en philosophie ? Il faut continuer de faire avec
connaissance de cause ce que l'esprit a fait jusqu' prsent sans s'en rendre
compte. Il faut renoncer la chimre d'une science dont la philosophie serait le nom, dont l'unit et l'objet seraient dterminables, et, s'efforant de
dgager des concepts obscurs et indfinis qu'elle prsente, quelques nouveaux objets de connaissance, dterminer des [27] mthodes spciales par
lesquelles on peut arriver les tudier avec sret et certitude, mettre ainsi
au monde de nouvelles sciences particulires.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
34
On voit avec quelle nettet de vue et quelle fermet d'esprit Jouffroy avait saisi le premier ce point de vue qu'ont adopt les savants
modernes, lorsqu'il donnait pour objet la science le dtermin et le
connaissable, et pour objet la philosophie l'indtermin, l'inconnu,
l'inconnaissable. Il avait rencontr ce point de vue ; il s'y tait ralli un
instant ; mais il s'en tait vite dsabus. Voici ses raisons : 1 cette
dfinition toute ngative de la philosophie venait se heurter contre une
rsistance naturelle de son esprit, qui croyait instinctivement un caractre commun, positif et non ngatif, non seulement entre les
sciences qui composent la philosophie, mais entre les objets de ces
sciences ; 2 elle se heurtait aussi contre les habitudes du langage et
du sens commun, qui supposent certains objets dtermins comme
appartenant en propre la philosophie ; 3 dans l'hypothse o l'unit
de la philosophie serait une unit purement ngative et toute formelle,
les sciences philosophiques devraient tre autant de membres indpendants et sparables, rapprochs par hasard ; mais, en fait et au contraire, la psychologie, la logique, la morale et mme la mtaphysique
sont tellement insparables qu'elles se soudent les unes dans les autres
d'une manire insensible, et que ce qu'il y a de plus difficile, c'est de
les isoler.
Mais laissons de ct les tmoignages des savants, des philosophes, et considrons en elle-mme la doctrine prcdente. Cette
doctrine a certainement une part de vrit. Il est incontestable, en effet, au point de vue de l'histoire, que toutes les sciences ont t primitivement englobes dans une seule et mme science appele philosophie, et qu'elles se sont dtaches peu peu : d'abord les mathmatiques, qui, ds l'antiquit mme, se distinguaient dj de la philosophie ; puis l'astronomie, puis la physique, la chimie, la physiologie,
etc. Le fait est donc vrai ; c'est l'interprtation du fait qui est sujette
discussion. En effet, de ce qu' l'origine les sciences [28] particulires
n'avaient pas encore d'objet propre et bien dfini, en sorte que cet objet se confondait avec celui de la philosophie, il ne s'ensuit pas que la
philosophie, au contraire, devra confondre son objet avec le leur. On
peut dire au contraire qu'en se sparant elles dgageaient cet objet
propre jusqu'alors confondu et ml ; il faut dire qu'elles dlivraient la
philosophie plutt qu'elles ne l'appauvrissaient. Les deux explications
sont videmment lgitimes a priori ; et par consquent le fait par luimme ne prouve rien.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
35
Cherchons maintenant, en considrant la philosophie en elle-mme
et non plus dans son histoire, si son unit est toute factice et toute collective, et si les diffrentes sciences qui la composent n'ont d'autre lien
qu'un lien ngatif, celui de l'indtermin et de l'inconnu, et d'autre caractre distinctif que de n'tre pas des sciences constitues. Ce qui les
unissait, c'tait un lien positif, une unit effective, savoir l'unit de
l'univers. C'tait l'unit de l'univers qui faisait l'unit de la science.
Sans doute, mesure que les sciences spciales faisaient ces progrs,
elles devenaient trop considrables pour rester lies leur centre,
c'est--dire la philosophie ; elles ont du se dtacher en vertu de la
division du travail ; et, en se dtachant, elles s'opposaient la science
totale, mais non pas comme le clair s'oppose l'obscur, le dtermin
l'indtermin, mais comme le spcial s'oppose l'universel. Les
sciences spciales se sparant de la philosophie, rciproquement la
philosophie se dgageait des recherches spciales ; mais elle ne renonait pas son caractre primitif, qui est l'universalit. En effet, en
quoi la philosophie de Schelling et de Hegel, ou encore, si l'on aime
mieux, la philosophie d'Herbert Spencer est-elle moins encyclopdique, moins vaste, moins riche en contenus que la philosophie de
Thals ou mme de Platon et d'Aristote ? N'avons-nous pas dans H.
Spencer une cosmologie, une biologie, une psychologie, une sociologie, exactement comme dans Aristote, ce qui ne devrait pas tre, si la
philosophie allait toujours s'appauvrissant par le fait de l'mancipation
des sciences spciales ? Le caractre commun qui unit les [29]
sciences philosophiques peut tre sans doute obscur et difficile dterminer ; mais il n'est pas pour cela l'inconnu et l'indtermin, au
moins dans le sens tout ngatif que l'on tait tent d'abord de donner
ce mot. Mais la philosophie ne s'appauvrit pas pour cela. On peut
presque dire au contraire que la philosophie est loin de s'appauvrir par
l'mancipation successive de ses colonies ; car, comme une mre patrie, tout en conservant son unit, elle a bnfici de leurs richesses, et
s'est assimil les plus importants de leurs rsultats.
Ajoutons encore une autre considration. En disant que la philosophie est la science de l'indtermin, entend-on par l qu'elle a pour
objet des phnomnes et des tres actuellement indtermins, qui peuvent devenir plus tard dtermins, c'est--dire ramens leurs conditions d'existence phnomnales, exprimentalement dterminables, ou
bien faut-il entendre indtermins dans le sens de quelque chose qui
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
36
exclut le dterminisme et toute condition phnomnale, comme par
hypothse : la libert, l'me ou Dieu. Dans le premier cas, il est vrai
que ces choses, actuellement non dtermines, mais qui peuvent le
devenir, en d'autres termes qui peuvent tre objet d'exprimentation
physique, chapperont au domaine de la philosophie pour donner
naissance une science spciale. Dans le second cas, ces objets ne
rentreront jamais dans la science positive ; mais il ne s'ensuit pas
qu'ils ne seront l'objet d'aucune science. Dans le premier cas, l'unit
philosophique ne serait que provisoire ; dans le second cas, elle serait
relle ; la philosophie aurait son objet propre, savoir l'indtermin,
c'est--dire ce qui ne peut tre ramen aux conditions de l'existence
physique ; et l'on ne serait pas autoris soutenir qu'un tel objet n'est
rien, moins d'affirmer a priori ce qui est en question, savoir qu'il
n'y a qu'un seul genre d'existence, l'existence physique et phnomnale ; et dire que ces objets sont inconnus, c'est ne rien dire ; ils ne le
sont pas absolument, puisqu'on en parle ; et s'ils peuvent tre connus
dans une certaine mesure, ils seront objet de science dans la mesure
o ils seront connus, mesure [30] qui ne peut pas tre pose d'avance,
et qui ne peut tre fixe que par la science elle-mme.
Par consquent, la dfinition prcdente laisserait subsister la possibilit d'objets suprasensibles ou mtaphysiques, comme on les appelle, objets qui ne peuvent pas tre tudis par les procds ordinaires des sciences positives, mais qui peuvent l'tre autrement. C'est
ce que reconnaissait d'ailleurs le savant dont la dfinition a t le point
de dpart de cette discussion :
Je n'admets donc pas, disait Cl. Bernard, la philosophie qui voudrait
assigner des bornes la science, pas plus que la science qui voudrait supprimer les vrits philosophiques qui sont hors de son propre domaine. La
vraie science ne supprime rien. Elle regarde en face, sans se troubler, les
choses qu'elle ne comprend pas encore Nier ces choses ne serait pas les
supprimer : ce serait fermer les yeux et croire que la lumire n'existe pas ;
ce serait l'illusion de l'autruche qui croit supprimer le danger en se cachant
la tte dans le sable.
la dfinition prcdente s'oppose en quelque sorte une dfinition
nouvelle qui en serait la contrepartie. La philosophie ne serait pas seu-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
37
lement une science ngative, place sur les confins des sciences proprement dites et reprsentant ce qui est au del, l'indtermin et
l'inconnu. Par l'autre ct, c'est--dire de ce ct-ci de la ralit, la
philosophie reprsenterait la plus haute gnralit scientifique. Par l,
elle conserverait encore son unit primordiale ; elle serait bien la
science de l'univers ; mais elle emprunterait tout son contenu aux
sciences particulires dont elle serait la synthse. Cette conception,
qui est celle du positivisme, a t exprime dans les termes suivants,
d'une manire potique, par M. E. Renan : La philosophie offre cette
singularit qu'on peut dire avec presque autant de raison qu'elle est et
qu'elle n'est pas. La nier, c'est dcouronner l'esprit humain. L'admettre
comme science distincte, c'est contredire la tendance gnrale des
tudes de notre temps. Elle est moins une science qu'un ct de toutes
les sciences La philosophie est l'assaisonnement sans lequel tous les
mets sont insipides, mais qui lui seul [31] ne constitue pas un aliment ; ce n'est pas nier la philosophie, c'est l'ennoblir que de dclarer qu'elle n'est pas une science, mais le rsultat gnral de toutes les
sciences ; le son, la lumire, la vibration qui sort de l'ther divin que
tout porte en soi. 1
Si l'on comprend bien cette dfinition, il semble qu'elle consiste
substituer la philosophie proprement dite ce qu'on appelle l'esprit
philosophique. Ce qui aurait de la valeur, ce ne serait pas la philosophie elle-mme, mais l'esprit de la philosophie, le philosopher,
; c'est une tendance rechercher en toutes choses l'ide
gnrale qu'elle contient, la pense qui anime tout, l'lment cach qui
est li tous les phnomnes de l'univers ; on un mot, c'est l'esprit
de rflexion qui ne se borne pas au fait, mais qui recherche la signification idale du fait. La philosophie, c'est la pense. Le philosophe,
c'est le penseur, le mditatif, le critique.
Cette manire de voir a, comme la prcdente, sa valeur et sa vrit. C'est l sans doute un des grands cts de la philosophie. En dehors
de son domaine propre, sans avoir pour ainsi dire aucun objet dtermin et saisissable, elle subsiste encore titre d'esprit philosophique.
ce point de vue, elle est partout ; elle est dans la science, elle est
dans la littrature, elle est dans l'art. Il n'y a pas de grand savant ni de
grand crivain qui ne soit philosophe ; elle est la pense mme ; et,
1
Renan, Dialogues. (Fragment, p. 286.)
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
38
ce titre, elle est prsente tous les modes de la pense. Ce n'est donc
pas la diminuer, c'est au contraire en faire voir la haute valeur que de
la reprsenter comme l'assaisonnement universel, comme la vibration
de cet ther que tout porte en soi.
Mais, considrer les choses avec moins de posie et un peu plus
de prcision, deux questions se prsentent l'esprit : 1 s'il n'y avait
pas de philosophie, y aurait-il encore un esprit philosophique ? 2
tant donn l'esprit philosophique, serait-il possible de ne pas voir
natre la philosophie ?
[32]
1 Supposons qu'il n'y ait jamais eu dans le monde de Socrate, de
Platon, d'Aristote, d'picure, de Carnade, de Plotin, ou encore de
Descartes, de Leibniz, de Malebranche, de Spinoza et de Kant ;
croyez-vous que la philosophie existerait titre d'esprit gnralisateur,
de mditation rflchie ? Il ne faut pas oublier que les sciences sont
nes de la philosophie, et que ce n'est pas la philosophie qui est ne
des sciences. La philosophie est ne d'abord pour elle-mme ; et,
ayant ensuite divis son objet primitif, qui tait l'univers entier, elle a
engendr les sciences particulires. Mais elle prexistait titre de
science universelle. C'est ce titre qu'elle a cr, conserv, aliment
cet esprit de gnralisation, de rflexion, cette rvlation du cach
sous l'apparent qui est l'esprit philosophique. Sans doute, cet esprit
peut ensuite se dtacher de sa source et subsister en son propre nom,
en dehors du domaine philosophique proprement dit, et s'appliquant
tantt l'histoire, tantt aux sciences, tantt la vie ; mais cet esprit
philosophique existerait-il s'il n'y avait pas eu de philosophes, et subsisterait-il s'il n'y en avait plus ? C'est ce qui est en question.
Considrons maintenant l'intrt de la science elle-mme. Elle croit
souvent, ou plutt certains savants croient de l'intrt de la science de
supprimer les problmes philosophiques, comme vagues, obscurs, indtermins, chappant aux prises de la recherche scientifique proprement dite. Mais la science ne s'aperoit pas qu'elle a soutenir de son
ct une lutte absolument semblable celle de la philosophie, savoir
la lutte contre l'esprit pratique, industriel, positif de notre temps, qui
est aussi oppos l'esprit scientifique que l'esprit scientifique peut
l'tre l'esprit philosophique. En un mot, le mme conflit qui s'lve
entre la science du dtermin ou science positive, et la science de
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
39
l'indtermin ou philosophie, le mme conflit existe entre la science
pure et la science applique, entre la thorie et la pratique. Le mme
got du rel et du concret, qui porte souvent les savants s'lever
contre les philosophes, porte aussi les praticiens s'lever [33] contre
les savants. quoi sert la thorie pure ? Voil le cri des hommes positifs, des hommes d'affaires, des industriels, des agriculteurs, etc. Sans
doute, la science peut se dfendre encore dans une certaine mesure en
invoquant les services qu'elle rend la pratique, comme la philosophie
se dfend aussi par les services rendus par elle en logique et en morale ; et c'est par l en effet que la science russit se rendre populaire. Mais que de recherches scientifiques qui n'ont aucune application pratique ! Et d'ailleurs ce n'est que pour le dehors et pour sa dfense matrielle que la science invoque l'utilit pratique. Au fond, le
savant ne reconnat d'autre intrt que celui de la science elle-mme,
savoir l'intrt de la vrit pure, de la vrit idale. Mais au nom de
quoi, dirai-je aux savants, pourriez-vous faire valoir cet intrt spculatif et idal, si ce n'est au nom de la dignit de la pense considre
en elle-mme ? L'ide mme de la science en tant que science a besoin
d'tre dfendue par des principes suprieurs la science elle-mme.
En un mot, c'est l'esprit philosophique qui anime et soutient l'esprit
scientifique, de mme que c'est l'esprit scientifique qui soutient et alimente l'esprit d'invention pratique. En minant la philosophie, la
science se minerait elle-mme.
Le mme mouvement critique qui de la science s'lve contre la
philosophie, se manifeste dans la science elle-mme. C'est ainsi que
les mathmatiques, qui sont la partie idale de la science et qui autrefois passaient pour exercer lgitimement une haute suprmatie sur les
autres sciences, sont menaces, dans cette surintendance gnrale, par
les sciences purement exprimentales. Dans les sciences exprimentales, les conceptions thoriques, qui reprsentaient la part de la philosophie dans les sciences, sont menaces par l'exprimentation pure.
Dans les sciences naturelles, les grandes thories philosophiques sont
galement presses de trs prs par l'esprit empirique, qui ne cherche
que l'accumulation des faits. Ainsi en toutes choses le gnral est
combattu et refoul par l'esprit de spcialit. Les sciences ont donc de
la peine se [34] dfendre elles-mmes contre l'envahissement d'un
certain positivisme pratique ; fortiori elles seraient impuissantes
dfendre elles seules l'esprit philosophique, si la philosophie pro-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
40
prement dite disparaissait. La chute de la philosophie entranerait avec
elle la chute de l'esprit philosophique, qui entranerait son tour la
chute de l'esprit spculatif, l'abandon des mathmatiques transcendantes, des hautes spculations physiques et biologiques, et enfin de
l'esprit scientifique lui-mme, de plus en plus envahi par la pratique.
Le maintien de la philosophie est donc de l'intrt commun de toutes
les sciences. Elles ont assez se dfendre elles-mmes, et n'ont pas
besoin de prendre en main les affaires de la philosophie.
2 Notre seconde question tait celle-ci : si la philosophie, en tant
que science distincte, venait disparatre, et que cependant l'esprit
philosophique continut subsister, ne ramnerait-il pas infailliblement avec lui, au bout d'un temps quelconque, la philosophie ellemme, la philosophie proprement dite, telle qu'elle a toujours exist ?
Par exemple, supposons que, par suite de l'esprit critique et positif de
notre temps, on supprime absolument toutes les spculations philosophiques ; pour rendre sensible l'argument, mettons sur un bcher,
comme l'a fait Omar Alexandrie, tous les crits philosophiques depuis Platon jusqu' nos jours, et supposons toutefois qu'il reste encore
l'esprit philosophique : je dis que cet esprit philosophique recommencera ce qu'il a fait l'origine, et ne se bornera pas aux problmes spciaux des diffrentes sciences. Il remontera plus haut ; il s'lvera jusqu' la nature de la pense, jusqu' l'origine de l'univers, jusqu'aux lois
de la socit humaine en gnral ; il refera une philosophie premire,
une psychologie, une logique, une morale, en un mot toute une philosophie. Il recommencera toutes les grandes hypothses de l'histoire.
En un mot, il reproduira tout ce qui a t dtruit. Serait-ce bien la
peine d'avoir tout dtruit pour tout recommencer ?
Ainsi la philosophie est lie l'esprit philosophique. Elle [35] en
est la consquence ou le principe. Elle l'engendre ou elle en est engendre. C'est comme si l'on disait que ce qu'il y a d'intressant dans
une telle personne, c'est la beaut, mais que les muscles, les os, la
chair, ne sont rien : comme s'il pouvait y avoir beaut sans un corps
rel. La dfinition prcdente place trs haut la philosophie ; mais elle
lui refuse un corps rel ; elle lui te toute substance, et ne conserve
d'elle que l'empreinte et le reflet. La doctrine d'une philosophie qui ne
serait qu'un assaisonnement sans tre un aliment est donc une vue incomplte et superficielle, et lorsqu'on la presse, elle nous ramne en
dfinitive la doctrine reue.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
41
On pourrait sans doute donner plus de corps la dfinition prcdente, en disant que la philosophie, considre comme synthse des
sciences, n'est pas seulement un assaisonnement et ne se rduit pas au
pur esprit philosophique. Elle aurait une vraie substance, qui serait la
runion de toutes les plus hautes gnralits scientifiques. Ce serait
alors la pure doctrine du positivisme ; mais nous nous rservons plus
tard de faire de cette doctrine un examen spar. (Leon XII.) Disons
seulement, quant prsent, que cette manire d'entendre la philosophie comme une synthse des sciences n'a jamais t absente de la
philosophie, et qu'elle reprsente, sinon le tout, du moins une partie de
la philosophie traditionnelle.
Une nouvelle dfinition de la philosophie sur laquelle nous nous
arrterons moins, parce qu'elle est dj plus ou moins engage dans
les dfinitions prcdentes, est celle-ci : La philosophie n'est pas une
science ; c'est un art ; c'est quelque chose d'intermdiaire entre la posie et la religion ; c'est, dit-on, l'uvre de l'initiative individuelle.
Chacun se fait sa philosophie. Ce qui prouve la mme vrit, c'est que
la philosophie a t parfaite ds le premier jour. Comme on n'a pas
surpass Homre, on n'a pas surpass Platon. C'est encore M. Renan
que nous emprunterons l'expression la plus nette de ce point de vue :
Ce n'est point des sciences particulires que l'on peut assimiler la
philosophie ; on sera mieux dans le vrai en rangeant le mot de philosophie dans la mme [36] catgorie que les mots d'art et de posie. La
plus humble comme la plus sublime intelligence a sa faon de concevoir le monde. Chaque tte pensante a t sa guise le miroir de l'univers. Chaque tre vivant a eu son rve ; grandiose ou mesquin, plat ou
sublime, ce rve a t sa philosophie. La philosophie, c'est l'homme
mme. Chacun nat avec sa philosophie, comme son style. Cela est si
vrai que l'originalit, en philosophie, est la qualit la plus requise, tandis que, dans les sciences positives, la vrit des rsultats est la seule
chose considrer. 2
Si l'on veut dire que, dans toute philosophie, il y a une uvre d'art,
une uvre d'imagination, cela est vrai. Certes, il ne faut pas une petite
imagination pour inventer la thorie des ides, la thorie des hypostases, l'infinit des mondes, l'harmonie prtablie, l'idalisme transcendantal ; or toute cration est uvre d'imagination. Mais de l con2
Renan, Dialogues, p. 287.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
42
clure que la philosophie n'est qu'une uvre d'art, une uvre d'imagination, c'est tout autre chose. En effet, la science elle-mme, en un
sens, est aussi une uvre d'imagination ; il ne faut pas non plus une
petite imagination pour qu' propos d'une pomme qui tombe on devine
le systme de la gravitation universelle, pour qu' propos d'un os ou
d'une dent on reconstitue un animal entier, pour qu' propos d'une
tude spciale sur les pigeons on entrevoie tout le systme de la transformation des espces. Mme dans les mathmatiques, il y a une part
d'imagination, et d'Alembert disait qu'il faut autant d'imagination pour
tre gomtre que pour tre pote. De plus, c'est une erreur de reprsenter le savant comme un tre impersonnel, entirement confondu
avec la vrit objective. Au contraire, chaque savant a son gnie
propre, chaque gomtre a son style. Donc l'art n'exclut pas la science.
Que la part de l'imagination soit plus grande, parce que la part de l'hypothse est plus grande, cela se comprend ; mais l'hypothse, c'est encore la science, elle est assujettie des conditions scientifiques. Au
fond, il y a parit entre la philosophie et les [37] sciences ; et elle peut
tre une uvre d'art sans cesser d'tre une uvre de science.
La vraie question est de savoir si les hypothses philosophiques
sont des fictions libres : ce qui est le propre de l'art. Ne sont-elles
faites que pour charmer l'esprit, comme les pomes et les romans, on
les appellera alors belles, jolies, ingnieuses : il sera indiffrent
qu'elles soient vraies ou fausses. Au contraire, sont-ce des conceptions
rationnelles, ayant pour objet l'explication des choses : ce titre, on
les appellera vraies, probables, douteuses, errones. Elles pourront
tre belles aussi ; mais ce sera alors une qualit accessoire, qui d'ailleurs ne manque mme pas aux vrits scientifiques les mieux dmontres. N'entendez-vous pas les gomtres parler du beau thorme de
celui-ci et de l'lgante dmonstration de celui-l ? La science n'exclut
donc pas l'art ; et la beaut n'exclut pas la vrit. Or, ce qui prouve que
les hypothses ont rapport la vrit, et non pas seulement la beaut, c'est qu'on les discute, c'est qu'elles donnent leurs raisons, c'est
qu'elles se contredisent et se combattent les unes les autres. Sans
doute, l'hypothse n'est pas une vrit certaine ; autrement, ce ne serait
pas une hypothse ; mais c'est une vrit cherche, anticipe, suppose, qui devra tre ultrieurement dmontre, ou tout au moins qui
devra servir satisfaire l'esprit en tablissant un certain ordre entre les
phnomnes, et en expliquant au moins quelques-uns. S'il ne s'agissait
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
43
que de fictions libres, que servirait-il de chercher dmontrer ou
rfuter une hypothse ? Qu'elle soit belle et agrable, serait tout ce
qu'il faudrait. Il y a sans doute des degrs dans l'hypothse. Les hypothses de la mtempsycose ou de l'me des plantes ne sont pas loin
d'tre de pures crations de l'imagination. Mais en quoi les hypothses
du mcanisme ou du dynamisme, du vitalisme ou de l'animisme, de la
sensation transforme, de l'idalisme transcendantal, en quoi, dis-je,
de telles hypothses diffrent-elles, sauf pour le degr de prcision,
des hypothses purement scientifiques, telles que celles de l'atomisme
ou de l'ther ?
[38]
Si nous consultons les grands philosophes, nous verrons qu'ils
n'ont jamais considr leurs systmes comme de simples fictions. On
a pu le dire de Platon, parce qu'en effet il a ml beaucoup d'imagination et de fantaisie sa philosophie. De l cette hypothse de quelques
critiques que Platon n'est qu'un pote, mme en philosophie, et qu'il
n'a jamais pris la philosophie au srieux. Mais rien n'est plus douteux
que cette supposition ; et le tmoignage d'Aristote, qui ne cesse de
combattre Platon dans tous ses crits, et de lui attribuer un systme
trs li, suffit, je crois, pour l'infirmer. Car lui, qui tait un vrai savant,
aurait-il tant de reprises poursuivi une polmique si profonde et si
persistante contre un pur jeu d'esprit ? Mais enfin, Platon cart, de
quel autre philosophe pourrait-on soutenir qu'il n'a cherch dans la
philosophie qu'un simple amusement de l'imagination ? Dites donc
Spinoza que son systme n'est qu'un pome, qu'une fiction. Pour lui,
au contraire, son systme est la vrit vraie, aussi bien que pour Newton l'attraction universelle. On peut dire sans doute que les philosophes sont des artistes inconscients, dupes de leurs propres fictions,
comme Don Quichotte des romans de chevalerie. Mais, en supposant
qu'il en ait t ainsi jusqu'ici, une fois le secret vent, on aurait coup
court toute philosophie. Car quel philosophe consentirait chercher
des hypothses uniquement pour l'amusement et pour la rjouissance
de son esprit ? On a dit souvent, et c'est une autre forme de la mme
opinion, que l'intrt de la philosophie est dans la recherche et non
dans la possession de la vrit ; et l'on attribue Lessing ou tel autre
cette parole que, si on lui offrait la vrit toute faite, il n'en voudrait
pas. Pascal a dit galement dans le mme sens : Donnez au chasseur
le livre pour lequel il a couru toute la journe, il le refusera. Soit ;
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
44
cela est vrai ; mais dites aussi un chasseur de chasser dans un bois
o il sait qu'il n'y a pas de gibier, il s'y refusera galement. L'exercice
de nos facults est un plaisir, mais la condition qu'elles aient un objet rel. Autrement nous serions semblables aux solitaires de la Thbade qui plantaient un [39] morceau de bois mort dans le dsert, et se
donnaient la peine de l'arroser, pour pouvoir dire qu'ils se livraient au
travail.
Sans doute il y a en philosophie quelque chose de personnel. Chacun se fait sa philosophie ; et chaque philosophe, mme le plus
humble, est le miroir de l'univers. Sous ce rapport, la philosophie a de
l'affinit avec la religion. Mais autre chose est l'art, autre chose est la
religion. Il faut choisir. La philosophie est-elle l'un ou l'autre ? La religion n'est pas l'uvre de l'initiative individuelle purement libre. C'est
une uvre ou d'inspiration ou de choix, mais de choix motiv. La religion, comme la philosophie, a pour objet la vrit, non la fiction. On
peut dire sans doute que l'art aussi a pour objet la vrit, qu'il cre luimme un monde plus vrai que le monde rel : cela est possible ; mais
ce que la philosophie veut expliquer, c'est le monde rel ; mme
quand la philosophie conoit l'idal, elle ne le donne que comme
idal ; et en cela mme, comme la gomtrie, elle est encore scientifique.
Quant l'objection que la philosophie a t parfaite du premier
coup, elle est fort sujette contestation. Il n'y a rien de plus parfait que
Platon comme artiste ; mais il est difficile de soutenir qu'en philosophie il n'y a eu de Platon Kant aucun progrs. Si la philosophie a
trouv du premier coup. toutes les grandes hypothses, cela tient ce
que ces hypothses sont trs simples, et qu' mesure qu'on s'lve
des questions de plus en plus gnrales, le nombre des hypothses diminue. Mais c'est le dveloppement mme de ces hypothses qui
constitue la science.
Pour en finir avec ces diverses conceptions rcentes sur l'objet de
la philosophie, on pourrait en ajouter une quatrime, que je n'ai pas
vue la vrit exprime encore d'une manire formelle et systmatique ; mais elle se mle souvent d'autres ides, et je l'ai souvent entendu exprimer dans la conversation. C'est que la philosophie doit se
borner l'histoire de la philosophie. La philosophie a reprsent un
certain tat de l'esprit humain ; cet tat a produit les plus belles
uvres, qu'il faut reconnatre. Mais c'est une science finie, une science
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
45
[40] morte. Ce qui le prouve, c'est l'importance mme attache l'histoire de la philosophie. Les sciences vivantes ne s'occupent pas de leur
histoire. Les vieillards seuls rassemblent leurs souvenirs. Cependant la
philosophie ne doit pas prir ; mais elle survivra sous forme d'histoire
de la philosophie.
Cette conception provoque encore plusieurs objections : 1 L'histoire de la philosophie est incomprhensible sans la philosophie ellemme. Il faudra donc toujours faire la science avant de passer l'histoire de cette science. D'ailleurs une science finie n'en est pas moins
une science. Telle est, par exemple, l'arithmtique lmentaire, la logique formelle. 2 Quand on a conduit l'histoire de la philosophie
jusqu'au temps prsent, on est forc d'aller plus loin, on se demande ce
que deviendront les problmes aprs nous. 3 Rien qu'en se bornant aux donnes fournies par l'histoire de la philosophie, on ferait
encore une philosophie.
En rsum, toutes les dfinitions prcdentes ont un dfaut visible :
c'est que toutes impliquent le scepticisme, c'est--dire un certain systme de philosophie. C'est un moyen subreptice de faire passer le
scepticisme sous le couvert d'une dfinition. Supposons en effet qu'il y
ait des vrits en philosophie : il ne sera plus vrai de dire qu'elle est la
science de l'inconnu, qu'elle est un art, une posie, un assaisonnement,
en un mot une forme vide. On ne peut donc admettre ces dfinitions
sans admettre par l mme une certaine solution, savoir la solution
sceptique. Mais, moins de faire une ptition de principe trop manifeste, on ne peut nier que cette solution ne soit elle-mme en question
comme les autres ; on ne peut donc lui constituer un privilge et lui
assurer d'avance la prminence par une dfinition prjudicielle.
Toutes ces dfinitions ont un caractre commun : elles sont d'accord pour retrancher la philosophie tout contenu positif, et la rduire
soit une forme vide, soit une activit pure de l'esprit. Nous croyons
au contraire que la forme est insparable du fond, et qu'une activit
pure qui s'exercerait vide se dvorerait elle-mme.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
46
[41]
Introduction la science philosophique
Leon III
DU CRITERIUM
EN PHILOSOPHIE
Retour la table des matires
Messieurs,
Nous continuerons nous demander si la philosophie est une
science, et quelles conditions elle peut en tre une.
Est-ce en l'assujettissant aux mmes conditions que les sciences
dites positives, c'est--dire en s'efforant d'appliquer aux problmes
philosophiques la mthode exprimentale et le calcul ?
Non ; car ce serait prcisment accorder que, tant qu'on n'a pas appliqu ces mthodes, la philosophie n'a pas t une science ; et ce serait abdiquer devant la science positive.
Nous ne voulons pas dire que dans telle question philosophique
spciale, par exemple dans telle partie de la psychologie touchant la
physiologie, on ne puisse avec fruit appliquer la mthode exprimentale ; que dans telle partie de la logique on ne puisse faire usage de la
mthode mathmatique ; mais en principe, dans la gnralit de la
science philosophique, la mthode n'est ni la mthode exprimentale
ni le calcul, et ce serait prcisment renoncer l'originalit de la philosophie que de lui imposer ces deux mthodes.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
47
En effet, la mthode exprimentale et le calcul ne peuvent s'appliquer qu' des phnomnes, et des phnomnes plus ou moins rductibles l'tendue. S'imposer ces deux mthodes comme les seules mthodes scientifiques, ce serait accorder qu'il n'y a que des phnomnes, et des phnomnes matriels, puisque ceux-l seuls sont mesurables et rductibles l'tendue. Ce serait donc nier l'objet propre de la
[42] philosophie, savoir ce qui, par hypothse, est au del des phnomnes et ce qui est irrductible l'tendue.
C'est de la philosophie en tant que telle qu'il faut chercher si elle
est une science, et non pas en tant qu'elle s'abandonnerait elle-mme
et se rangerait sous la bannire des sciences positives. Comment donc
la philosophie peut-elle tre une science ? Si nous comparons la philosophie aux sciences proprement dites, nous verrons que dans toutes on
fait une distinction entre les vrits acquises et les opinions contestes. Les vrits acquises constituent le corps de la science. Les opinions en hypothses constituent le ferment de la science, le principe
actif qui la pousse en avant, et qui sert accrotre sans cesse le
nombre des vrits acquises.
Pourquoi cette distinction n'a-t-elle pas t applique la philosophie ?
D'abord il est vrai de dire qu'en philosophie le champ de l'opinion
est beaucoup plus tendu que dans les autres sciences. C'est l ce qui
frappe le plus. Il faut donc reconnatre que le nombre des vrits acquises que l'on peut invoquer en philosophie est beaucoup moins considrable que partout ailleurs.
Une seconde difficult, plus grave que la prcdente, c'est qu'en
philosophie la part de ce qui est acquis est toujours tellement mle au
point de vue systmatique et hypothtique qui constitue les diverses
coles, qu'il est bien difficile de dmler l'un de l'autre ces deux lments. Toutes les propositions d'un systme sont lies ce systme ;
et, quoiqu'il puisse y avoir une part de vrit dans ces propositions, il
semble que l'on ne puisse admettre cette part de vrit sans admettre
par l mme le systme qui la suggre. Comment admettre ce qu'il y a
de vrai dans le systme de la sensation transforme, sans admettre par
l mme ce systme ? De mme comment admettre ce qu'il y a de vrai
dans l'innit, sans admettre par l mme le systme de l'innit ? Car
de deux choses l'une : ou il y a des ides innes, ou il n'y en a pas ; s'il
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
48
n'y en a pas, il n'y a rien de vrai dans le systme. Il [43] en est de
mme de l'volutionnisme, du panthisme. Vouloir tirer quelque chose
de vrai de tous ces systmes, n'est-ce pas s'exposer de perptuelles
contradictions ?
Mais une dernire raison qui rend trs difficile le dpart du certain
et de l'incertain dans toutes les doctrines philosophiques, et la plus
importante de toutes, c'est que dans les autres sciences l'opinion n'est
rien qu'une opinion, tandis qu'en philosophie l'opinion est tout autre
chose qu'opinion ; elle devient croyance. Dans les sciences, le savant
est indiffrent, au fond, sur la ralit objective de son hypothse (abstraction faite, bien entendu, de l'amour-propre et du point d'honneur
qui le fait tenir ses opinions). Mais, en ralit, qu'il y ait un seul
fluide ou deux, ou mme point du tout, que la lumire soit une substance ou un mouvement, qu'elle se propage par mission ou par ondulation, que la matire soit ou non compose d'atomes, que la maladie
soit produite ou non par des microbes, tout cela lui est absolument
gal. Il est habitu depuis longtemps sparer le domaine du certain
de celui de l'incertain ; il reconnat volontiers que son opinion n'est
qu'une opinion.
Il n'en est pas de mme en philosophie. La philosophie, partout o
elle s'est dveloppe, est sortie de la religion ; et les doctrines philosophiques, avant de se produire sous la forme d'opinions et systmes,
existaient en grande partie sous forme de croyances religieuses. En
passant de la religion la philosophie, soit que la philosophie ne soit
que l'auxiliaire de la religion, soit qu'elle en soit le succdan, la remplaante, ces croyances sont restes croyances, c'est--dire tenant au
fond de l'me, aux intrts de l'me, lies au sentiment et toute la vie
morale. Obtenir donc de ces mes de reconnatre ces sortes de
croyances titre d'opinions hypothtiques qui ne peuvent tre acceptes ou admises provisoirement qu'en raison de leur probabilit plus
ou moins grande, c'est ce qui parat impossible. De l, on le voit, une
bien plus grande difficult que dans les autres sciences de dtacher la
partie solide et acquise de la partie controverse. [44] Comment admettre que ces croyances qui sont la vie de l'me ne sont que des hypothses comme les autres ? On citera comme un manque de respect
envers la Divinit le mot clbre de Laplace Napolon qui s'tonnait
de ne pas voir le mot Dieu dans la Mcanique cleste : Sire, je n'ai
pas eu besoin de cette hypothse. On citera, dis-je, cette parole
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
49
comme irrespectueuse et impie, tandis qu'au fond quoi de plus rationnel, quoi de plus philosophique que de ne pas invoquer une hypothse
quand on peut s'en passer ? Non sunt entia multiplicanda prster
necessitatem. Sans doute, Laplace a eu peut-tre tort de croire que l'on
peut expliquer la mcanique du monde sans Dieu ; mais, l'ayant cru, il
avait raison de n'en pas parler, et il n'tait pas plus coupable pour cela
que celui qui croit pouvoir se passer d'atomes en chimie, quoique de
grands savants prtendent que c'est la seule explication rationnelle des
phnomnes chimiques.
On remarquera d'ailleurs que cet intrt pratique et moral qui fait
que les philosophes sont attachs plus que par l'esprit telles ou telles
opinions n'est pas seulement le propre de ceux qui ont conserv en
philosophie le fond des doctrines religieuses, tout en leur tant leur
appareil thologique. Cela est tout aussi vrai de ceux qui repoussent
ces croyances ; et l'on a souvent remarqu, nous avons encore l'occasion de remarquer tous les jours que les matrialistes, athes, sceptiques de toute nature, sont, pour la dfense de leurs opinions, aussi
passionns, aussi intolrants que leurs adversaires. Pour les uns
comme pour les autres, l'hypothse est une croyance. On a dit avec
raison que Lucrce est un Pascal athe ; il traite l'picurisme comme
une religion ; il y trouve la paix, la consolation que les autres trouvent
dans la doctrine contraire. Bien plus, ceux-l mmes qui prtendent
constituer la philosophie scientifiquement, lui donner une forme
scientifique, tiennent bien moins aux faits vrais qu'ils introduisent
dans la science qu'aux conclusions finales qui pourraient rsulter de
ces faits. Par exemple, ils traitent des maladies de la volont et de la
personnalit, non [45] pas tant pour introduire ce fait, si important cependant par lui-mme, savoir qu'il y a des maladies de la volont et
des maladies de la personnalit, que pour faire conclure que la volont
et la personnalit sont des accidents du systme nerveux, de telle sorte
qu'il est trs difficile de faire la part de ce qui est scientifique et de ce
qui ne l'est pas. Ce qui est scientifique, c'est que la volont et la personnalit sont lies des conditions physiques dont l'altration se manifeste dans le domaine psychologique ; ce qui ne l'est pas, et ce qui
reste en question, c'est que la volont et la personnalit ne sont que
des phnomnes physiologiques ; et cependant c'est cette conclusion
non scientifique laquelle tiennent le plus ceux qui prtendent instituer la philosophie scientifiquement. Chez eux aussi, l'opinion prend
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
50
la forme de la croyance, et ils la dfendent avec la mme intolrance
que ceux qui soutiennent l'opinion contraire.
Il y a encore une raison pour laquelle les philosophes ne se sont
pas suffisamment appliqus faire la part dans leur science de ce qui
est acquis et de ce qui ne l'est pas. L'esprit philosophique consiste surtout penser par soi-mme. Il en rsulte que ce quoi un philosophe
tient le plus, ce sont ses propres ides ; or les vrits acquises, ce ne
sont pas ses ides lui, ce sont les ides de tous. De l une tendance
naturelle carter, passer sous silence, lgrement ddaigner tout
ce qui est connu. Aussi y a-t-il une objection qui revient souvent dans
les dbats philosophiques : c'est que telle proposition, telle gnralit,
est un lieu commun, une banalit. C'est une vrit, si l'on veut, mais
une vrit inutile dire, tant elle est rebattue ; peu peu on applique
la mme qualification toutes les propositions qui ont un certain caractre d'vidence et de solidit ; de sorte que la philosophie finit par
ne plus se composer que de propositions excentriques et exclusivement individuelles. Si on allait jusqu'au bout de cette mthode, la philosophie ressemblerait une maison de fous, o chacun suit son ide,
sans s'occuper de son voisin. Dans un clbre article que [46] nous
avons plusieurs fois cit, M. Renan, pour tablir que la philosophie
n'est pas une science comme les autres, dit qu'en philosophie l'originalit est la qualit la plus requise, tandis que dans les autres sciences,
c'est la vrit des rsultats qui importe . Mais pourquoi, en philosophie, la vrit des rsultats n'importerait-elle pas aussi ? Est-ce que,
dans les sciences, la vrit des rsultats empche l'originalit ? Voiton le savant, par une recherche maladive de l'originalit, traiter de lieu
commun et de banalit la thorie de l'addition et de la soustraction,
parce qu'elle est trs simple, trs connue et la porte des enfants ? Ce
haut ddain l'gard des vrits simples, loin de servir faire avancer
la science, comme on le prtend, ne peut, au contraire, que l'arrter en
l'encombrant d'une masse d'opinions individuelles sans porte et sans
solidit. Pour faire avancer la science, il faut partir de ce qui est acquis, et ce progrs n'est vraiment dfinitif que lorsqu'on voit clairement comment le nouveau se rattache au pass, et comment il enrichit
la science sans la renverser.
Pour nous rsumer, on voit qu'il y a un grand nombre de causes diverses qui ont empch d'appliquer en philosophie la mthode de dis-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
51
crimination qui distingue partout ailleurs le certain du probable, du
douteux et du faux.
Cette mthode est-elle donc absolument inapplicable la philosophie ? Nous ne le croyons pas. Lors mme qu'il faudrait se rsigner
ne pas l'appliquer la rigueur, tout au moins devrait-on s'en servir
comme d'une direction, d'une tendance que l'on doit toujours avoir
prsente devant les yeux, comme d'une rgle qui nous mettrait sur la
voie.
Essayons d'indiquer comment on pourrait se servir de cette rgle,
en s'approchant autant que possible de l'idal que nous avons dcrit.
Voici quelle serait cette rgle : doit tre considre comme scientifique en philosophie toute proposition, toute exprience, toute distinction relle ou formelle, en un mot toute vrit accorde par toutes les
coles de philosophie sans exception. [47] Cette rgle est susceptible
de soulever quelques difficults. On pourrait faire observer que c'est
en revenir purement et simplement au critrium du consentement universel ; et l'on sait quelles objections s'lvent contre ce critrium. Je
rponds qu'il n'est nullement question ici de rsoudre thoriquement la
question du critrium de certitude. Cette question est une question de
mtaphysique qui ne peut tre traite que par la philosophie et ne peut
tre rsolue avant toute philosophie. Cette question, d'ailleurs, pse
sur toutes les sciences aussi bien que sur la philosophie elle-mme :
les mathmatiques y sont tout aussi intresses que la mtaphysique.
Il ne s'agit donc pas ici d'un critrium thorique du vrai et du faux
d'une manire absolue. Il s'agit d'un critrium pratique purement externe, lequel dans toutes les sciences sert faire la part de ce qui est
acquis et de ce qui ne l'est pas.
En dfinitive, quel signe reconnatre dans les sciences que telle
ou telle vrit est acquise, fait partie de la science faite, et non de la
science en voie de se faire ? ce signe que cette vrit est en dehors
de la controverse, qu'elle n'est plus objet de dispute. Sans doute la
croyance cette vrit ne repose pas sur cet accord des opinions : c'est
l'vidence qui nous la donne. Nous croyons au carr de l'hypotnuse
parce qu'il est dmontr, et non parce que tous les gomtres nous affirment que cela est vrai. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est dmontr ? C'est que personne ne le conteste ; en d'autres termes, c'est que
quiconque refait ou refera le raisonnement des gomtres est frapp
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
52
ou sera frapp de la mme vidence. C'est pourquoi personne ne conteste. Cela finit tout. La mme chose est vraie dans les sciences de
fait, o quiconque peut refaire une exprience en constate lui-mme la
vrit. De l vient que l'on ne dispute plus. Au contraire, que reproche-t-on prcisment la philosophie ? C'est qu'elle n'est qu'une
science de dispute et de controverse, et qu'il n'y a aucune question que
l'on puisse dire rsolue. Mais cela vient peut-tre de ce qu'on ne
cherche pas cet accord, ou que l'on demande trop la science, et que
l'on exige d'elle des solutions [48] absolues, au lieu de se contenter,
comme dans toutes les sciences, de solutions partielles ou relatives. Si
donc, en y regardant de plus prs, on pouvait tablir qu'en philosophie
il y a des vrits acquises, en dehors de toute controverse, on aura tabli ce qu'il y a de scientifique en philosophie.
On dira que le nombre des propositions non controverses est bien
petit, qu'il y a bien peu de choses dont on ne dispute pas, que mme le
cogito ergo sum de Descartes a pu tre l'objet de longues disputes, que
les vrits que l'on obtiendrait ainsi, par exemple, A = A, sont de si
peu d'utilit et de fertilit qu'il n'est jamais ncessaire de les recueillir.
Mais il ne s'agit tout d'abord ni du nombre de ces vrits, ni de leur
utilit, ni de leur intrt esthtique. Il s'agit avant tout de vrit ; si peu
que ce soit que l'on pourrait sauver par cette mthode (et en ralit on
en sauverait bien plus qu'on n'est tent de le croire), toujours est-il
que, dans cette mesure, la philosophie contiendrait un lment solide
comparable ceux qui procdent des autres sciences. On partirait de
quelque chose de fixe, et l'on aurait une base d'opration non conteste.
Mais ce que vous proposez, dira-t-on, savoir sparer, comme
dans les autres sciences, le certain de l'incertain, les vrits acquises
des vrits disputes, une telle mthode est-elle autre chose que le
doute mthodique de Descartes, qui consistait mettre part tout ce
qui peut tre objet de cloute, et de ne conserver que ce qui est absolument vident ? Il y a videmment de l'analogie entre ces deux mthodes ; mais il y a aussi d'importantes diffrences. Le doute mthodique est une mthode spculative, qui a pour but d'atteindre l'vidence absolue. Tant qu'il reste un atome de doute possible, si hyperbolique que puisse tre ce doute, ft-ce l'hypothse bizarre d'un malin
gnie qui se moque de nous, ft-ce la chance minime de nous tromper
dans nos raisonnements parce que nous pouvons avoir oubli les pr-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
53
misses quand nous arrivons aux conclusions, fussent mme les vieilles
objections banales des sceptiques, Descartes passera outre ; il ne saura
s'il veille ou s'il dort, s'il a un corps ou s'il n'en [49] a pas. Il ne s'agit
de rien de semblable dans notre proposition. Il ne s'agit que d'un critrium tout empirique et pratique, semblable celui dont on fait usage
dans toutes les autres sciences. Le savant, lorsqu'il fait de bons raisonnements ou de belles expriences, ne se trouble pas l'esprit en se demandant s'il dort ou s'il veille, si ses sens le trompent, et il se contente
de se demander si ses raisonnements sont accepts par les savants, ou
si ses expriences sont confirmes par les expriences des autres. Si
ces conditions sont remplies, il affirme que l'on a trouv la vrit sur
ce point, et il passe une autre recherche. Pourquoi n'en serait-il pas
de mme en philosophie ? Il sera toujours temps de chercher la mthode absolue ; et cela mme, si on le trouve, sera une de ces vrits
qu'il s'agit de mettre part. Il est clair que le doute mthodique est la
mthode idale de celui qui voudrait se placer en quelque sorte,
comme Dieu lui-mme, au centre de la vrit. Mais en ce moment
nous ne visons pas si haut. Il suffit qu'il y ait un accord assez grand
entre les philosophes pour donner une scurit relative, scurit qui
deviendra de plus en plus grande mesure que le nombre de ces vrits augmentera.
Cependant c'est peut-tre placer trop haut notre idal que de vouloir tout d'abord demander un accord possible entre toutes les coles
philosophiques sans exception. Il sera plus sage de se contenter tout
d'abord d'un accord relatif et limit et, au lieu de s'adresser tous les
systmes de philosophie, considrer seulement diffrents groupes et
systmes qui, sur des questions spciales, forment antithse et sont le
plus loigns possible l'un de l'autre. En se renfermant dans ces limites, on dira :
Est scientifique (au moins relativement) par rapport deux systmes opposs, tout ce qui est reconnu ou doit tre reconnu d'un
commun accord par l'un et l'autre de ces deux systmes.
Prenez, par exemple, les deux plus vieilles hypothses que nous
prsente l'histoire de la philosophie, celle du spiritualisme [50] et celle
du matrialisme. Qu'y a-t-il ou que doit-il y avoir d'accord entre ces
deux coles ? Il y a ceci, savoir : 1 l'action du physique sur le moral ; 2 l'existence des faits de conscience.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
54
D'une part le spiritualiste, s'il est loyal et sincre, accorde ou doit
accorder que le corps agit sur l'me, et que la facult de penser est
plus ou moins sous l'influence des conditions physiques et organiques : que, par exemple, un coup de bton appliqu sur la tte vous
te la facult de penser.
Rciproquement, le matrialiste le plus intrpide accorde ou doit
accorder qu'il y a des faits de conscience, savoir des faits immdiatement aperus par celui qui les prouve, et qui ne sont aperus par
aucun autre que par lui ; en un mot des faits subjectifs tout fait distincts de ceux qui frappent les sens externes.
Jusqu' quel point le premier de ces deux faits (l'action du physique
sur le moral) autorise-t-il la conclusion des matrialistes, savoir que
la pense est le rsultat de la matire ?
Jusqu' quel point du second de ces deux faits, la subjectivit des
faits de conscience, peut-on conclure que la pense est un fait sui generis indpendant de la matire ?
Ces deux questions sont le point de dbat entre les deux coles ;
mais, en faisant abstraction de ces questions et de ces conclusions, il
reste toujours ceci d'tabli, savoir l'influence du physique sur le moral, et l'existence des faits subjectifs.
ces deux premires vrits j'en pourrais joindre une troisime,
savoir l'influence rciproque du moral sur le physique ; mais comme
les matrialistes pourraient ici quivoquer, je passe sur ce troisime
point, et je m'en tiens aux deux premiers.
On dira que c'est l bien peu de chose, que ce sont l des vrits de
sens commun et non des vrits scientifiques. Mais ce ne sont point
des vrits si mdiocres, car chacune de ces vrits peut devenir le
point de dpart d'une science [51] spciale : l'analyse de tous les faits
physiologiques qui ont leur consquence dans le moral, en d'autres
termes, des rapports du physique et du moral, est une science tout entire. De mme, les phnomnes de conscience sont l'objet d'une
science distincte, savoir la psychologie subjective ou introspective.
On peut donc, en laissant de ct la question de principe, constituer
sur les donnes accordes de part et d'autre deux sciences trs vraies et
trs solides. Ce sont donc des vrits trs fcondes, et en tout cas ce
sont deux vrits.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
55
On dira peut-tre que, par cette mthode d'abstraction spculative,
on retrancherait de la science tout ce qui en fait prcisment l'intrt,
pour ne conserver que l'tude de ce qui nous est indiffrent.
Mais nous ne retranchons rien du tout. La science comprend non
seulement les questions rsolues, mais encore les questions rsoudre. Le partage que nous avons fait n'te rien l'intrt des problmes et n'empche nullement d'en poursuivre l'tude. Les choses
restent exactement dans le mme tat qu'auparavant. Nous avons seulement constat un fait : c'est que, dans le dbat en question, il y a des
choses accordes de part et d'autre, et d'autres qui ne le sont pas. Les
premires constituent le corps de la science ; les secondes, la science
militante, la science en voie de formation. Nul doute que, pour la valeur intrinsque, les secondes propositions ne l'emportent de beaucoup
sur les premires. C'est ce qui n'est pas contest. Mais ce qui ne l'est
pas non plus, c'est que sur ces choses si importantes et si prcieuses
l'accord n'est pas fait. Pourquoi donc ne consentirait-on pas d'abord
constater ce qui est accord, sauf continuer pour le reste disputer
comme auparavant ?
On remarquera ici, en outre, que ce qui est accord par les deux
coles en question le sera probablement aussi par toutes les autres :
car ces deux coles sont les plus intresses dans la question. Chacune
d'elles est intresse accorder le moins possible l'cole adverse. Ce
qui est accord, [52] c'est ce qui ne peut tre refus, mme en se plaant au point de vue le plus rigoureux. plus forte raison, les autres
coles ne peuvent refuser ce que matrialistes et spiritualistes ont accord. Par exemple, le panthisme, qui a la prtention de se placer audessus de l'un et de l'autre, n'a nul intrt nier l'action du physique
sur le moral, ni l'existence des faits de conscience. Aussi Spinoza ne
nie-t-il ni l'une ni l'autre. Le sensualisme peut videmment accorder
les deux propositions. L'idalisme seul pourrait faire quelques difficults, parce que, n'admettant pas l'existence de la matire et rduisant
tout aux faits de conscience, il pourrait la rigueur contester l'action
du physique sur le moral. Mais ce n'est que spculativement que
l'idalisme nie l'existence de la matire. Il admet bien ce fait qu'il
existe un monde objectif, apparent ou rel ; or il est certain que ce
monde apparent se prsente nous comme conditionnant d'une certaine manire les manifestations de l'esprit. L'explication au fond
pourrait tre diffrente ; mais le fait gnral d'une action du corporel
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
56
sur le spirituel peut tre accept par l'idalisme aussi bien que par les
autres coles de philosophie.
Appliquons la mme mthode aux diverses controverses philosophiques, on verra toujours un fond accept d'un commun accord et une
partie controverse.
Sur le dbat du sensualisme et du rationalisme, ou, pour tre plus
clair, de l'apriorisme, d'une part il faut accorder au sensualisme, au
moins provisoirement, que les ides abstraites et gnrales peuvent
tre tires de la sensation : je dis provisoirement, parce que mme la
facult d'abstraire et de gnraliser suppose peut-tre encore, comme
le veut Malebranche, l'ide de l'infini ; mais nous pouvons faire tout
d'abord abstraction de ce point de vue. D'autre part, il faut accorder
l'apriorisme que, parmi ces ides gnrales, il en est de fondamentales,
qui sont mles tous nos jugements et qui paraissent marques d'un
double caractre d'universalit et de ncessit ; et mme, comme nous
l'avons dit [53] dans notre premire leon, si l'on admet la thorie hrditariste de M. Herbert Spencer, il faut encore accorder l'innit
dans l'individu des ides et des vrits premires.
D'aprs la mme mthode, entre l'idalisme et le ralisme il est accord : 1 que le fait de conscience est suprieur tous les faits objectifs ; 2 que toutes nos sensations sont subjectives ; 3 que la cause de
nos sensations chappe la conscience. Entre le panthisme et le
thisme, il est accord : 1 qu'il y a de l'infini et que l'infini est la
cause du fini ; 2 que le fini existe dans et par l'infini. Enfin entre le
dogmatisme et le scepticisme, il est accord : 1 qu'il y a de la relativit dans la connaissance, reste savoir jusqu'o ; 2 que la connaissance des faits de conscience en tant que subjectible est d'une certitude absolue.
Ce ne sont l que des exemples que l'on pourrait multiplier, mais
qui suffiront pour donner une ide de la mthode. En les rsumant on
trouve une srie de propositions, plus ou moins admises par toutes les
coles, et ayant, au moins relativement, un caractre scientifique. Voici ces propositions :
1 La certitude des faits subjectibles ;
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
57
2 La distinction du subjectif et de l'objectif, au moins apparente ;
3 Le subjectif li l'objectif par l'action du physique sur le
moral ;
4 Une certaine mesure ( fixer) de relativit dans la connaissance ;
5 L'origine exprimentale de nos ides abstraites et gnrales ;
6 La nature spciale de certaines notions qui se prsentent
avec un caractre de ncessit et d'universalit ;
7 Le fini donn dans l'exprience, sans qu'on puisse jamais en
trouver la limite, et, par consquent,
8 L'enveloppement du fini par l'infini ou tout au moins par
l'indfini.
Sans doute, ces propositions peuvent tre encore elles-mmes objet
de dbat, soit quant la limitation, soit quant [54] la signification
dfinitive ; car, comme nous l'avons dit, toutes les questions sont engages les unes dans les autres, et une proposition commune peut tre
accepte, chacun lui donnant des sens diffrents ; mais c'est chacun
de faire des efforts sincres, dans l'intrt de la science, de dgager ces
propositions de toute interprtation individuelle et systmatique, de
s'en tenir au sens le plus apparent ; et, ce titre, ces propositions et
beaucoup d'autres pourraient tre consenties par toutes les coles. Il y
a donc, en philosophie, un fond de vrits solides, acquises et reconnues, aussi bien que dans les autres sciences.
Mme dans la mtaphysique, qui est le domaine classique de la
controverse, on peut trouver sinon des doctrines positives admises par
tous, au moins des distinctions abstraites, des points de vue logiques,
qui sont d'un usage commun et qui reprsenteraient un nombre considrable de faits : par exemple, la distinction aristotlique de l'acte et
de la puissance est d'un usage tellement facile et applicable que les
savants eux-mmes ont d y avoir recours pour distinguer ce qu'ils
appellent l'nergie potentielle et l'nergie actuelle. L'ide de Platon, si
loin qu'elle soit de la ralit, n'en est pas moins un point de vue riche
et fcond sous lequel il est trs frquent de considrer les choses ; et
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
58
un grand physiologiste n'a pas trouv de meilleur moyen de dfinir la
vie que de l'appeler une ide directrice. Pour Descartes, la distinction
de la pense et de l'tendue, mme quand on croit devoir supposer un
troisime terme ; dans Hume la dmonstration d'une impossibilit de
l'origine exprimentale externe de l'ide de causalit ; dans Kant, au
moins titre d'hypothse, la thorie des jugements synthtiques a
priori, et, d'une manire plus gnrale, comme nous l'avons montr
dans notre premire leon, toutes les hypothses mtaphysiques, au
moins titre de conceptions commodes pour se reprsenter les
choses : voil une somme considrable de notions relles, solides, instructives, qui peuvent tre appeles des notions scientifiques.
[55]
On dira que cet amas de propositions, plus ou moins vraies sparment, mais qui ne sont pas lies par un systme, puisque c'est prcisment des systmes que l'on fait abstraction, qu'un tel amas, dis-je,
ne constitue pas une science ; car ce qui fait la science, c'est le lien,
l'unit systmatique, l'enchanement des parties. Oui sans doute s'il
s'agit de la science faite, mais non pas de la science faire. Pour
qu'une science se fasse, il faut qu'elle ramasse des matriaux, dont elle
fera d'abord l'usage qu'elle pourra. Pendant ce temps de prparation,
elle est l'tat d'incohrence et d'empirisme ; mais elle n'en est pas
moins une science pour cela ; si elle n'avait pas commenc comme
cela, elle n'irait jamais plus loin et ne sortirait jamais de ses langes.
Toutes les sciences ont commenc de cette manire. Prenons, par
exemple, la physique telle qu'elle est aujourd'hui, et la physique telle
qu'elle tait au commencement du sicle, et plus forte raison telle
qu'elle tait au XVIIe sicle. Aujourd'hui elle forme un tout cohrent
et systmatique ; mais il n'en tait pas ainsi il y a un ou deux sicles.
La science alors se composait dj de quelques vrits, mais de vrits
incohrentes et sans lien. Aujourd'hui on n'admet plus gure qu'un
seul agent, une seule force qui se manifeste par toutes sortes de phnomnes diffrents ; au commencement du sicle, dans la Physique de
Biot par exemple, nous voyons numres une vingtaine de forces diffrentes. Au temps de Descartes, c'tait le contraire, et une synthse
prmature confondait tous les phnomnes dans des explications arbitraires. Tels sont les ttonnements invitables des sciences. Il faut
qu'elles passent par ces expriences pour arriver l'tat de maturit ;
dira-t-on qu'il valait mieux ne rien savoir du tout en physique que de
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
59
savoir la physique de Descartes ou celle de Biot ? Mais, sans ces chelons, on ne serait pas arriv la physique actuelle. De mme l'astronomie de Ptolme a rendu possible celle de Copernic et de Galile.
Supposons maintenant une science qui, vu l'imperfection des mthodes et les difficults des problmes, soit condamne pour un temps
ne pas sortir de [56] cet tat chaotique qui ne peut nous offrir que
des vrits sans lien, mais enfin un certain nombre de vrits, cela ne
vaudrait-il pas mieux que rien ? On lierait le tout comme on pourrait,
par des hypothses diverses ; mais il n'y en aurait pas moins l un fond
scientifique, et il y aurait beaucoup plus de chances d'accrotre ce
fond, quand on l'aurait dgag nettement de ce qui le dpasse et le recouvre dans les divers systmes de philosophie.
La distinction que nous avons essay d'tablir en philosophie entre
ce qui est acquis et ce qui est dcouvrir ne doit pas se confondre
avec une autre distinction trs connue et trs familire tous les philosophes, et que Thodore Jouffroy notamment a mise en lumire avec
une clart magistrale, dans sa prface de Reid, savoir la distinction
entre les questions de fait et ce qu'il appelle les questions ultrieures,
les premires tombant sous la lumire de l'exprience, les secondes
rsolues par le raisonnement l'aide des faits. Cette distinction a sa
vrit ; elle est une de ces vrits relatives et provisoires que l'on doit
conserver, sauf l'interprter. Mais si on la pressait la rigueur, il ne
serait pas difficile d'en faire sortir le positivisme. Sans doute les faits
sont au nombre de ces vrits que tout le monde peut accepter ; mais
toutes les vrits de ce genre ne sont pas des faits. Le cogito ergo sum,
le principe d'identit et de contradiction, la distinction de l'acte et de la
puissance, la distinction de la pense et de l'tendue, du sujet et de
l'objet, toutes ces vrits ne sont pas des faits, mais des vrits rationnelles. Il ne faut pas ajourner les problmes de crainte de les supprimer : ce fut le danger de la distinction de Jouffroy. Pour nous, au contraire, la mtaphysique, aussi bien que les autres parties de la philosophie, peut nous prsenter des vrits solides et certaines. Elle n'est ni
exclue ni supprime. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle a sa part et
son rle dans la connaissance philosophique.
Du principe prcdent il semble qu'il puisse rsulter une manire
nouvelle d'entendre et de pratiquer les controverses [57] philosophiques. C'est ce que nous appellerons la mthode des concessions
rciproques, mthode ayant pour objet de dlimiter le champ del dis-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
60
pute. Cette mthode d'acheminement respectif des uns vers les autres
n'est gure de mise en philosophie. On considre les concessions
comme de petites lchets, et on se cantonne dans des affirmations
outrance, qui d'ordinaire ne se rpondent pas et qui, triomphant chacune de leur ct de la partie adverse, amnent en gnral la galerie
conclure en faveur du scepticisme. Si, au contraire, on commenait
par dire avec prcision jusqu'o l'on peut aller de chaque ct, le
champ de la contradiction serait d'autant plus rduit, et il y aurait au
moins un gain certain, savoir les choses acceptes d'un commun accord. M. Herbert Spencer a dit admirablement : La controverse mtaphysique n'est qu'une dlimitation de frontires. Par exemple, pour
ce qui concerne le problme de Dieu, la question entre les panthistes
et les thistes est une fixation de limites entre l'lment mtaphysique
et l'lment moral qui composent cette conception. Le panthisme fait
ressortir l'lment mtaphysique, le thisme fait ressortir l'lment
moral. Jusqu'o peut-on aller dans un sens ou dans l'autre ? Voil la
question.
M. Herbert Spencer a exprim les mmes ides dans l'introduction
de son livre des Premiers Principes : Il faut, dit-il, que chaque parti
reconnaisse dans les prtentions de l'autre des vrits qu'il n'est pas
permis de ddaigner. C'est le devoir de chaque parti de s'efforcer de
comprendre l'autre, de se persuader qu'il y a dans l'autre un lment
commun, qui mrite d'tre compris et qui, une fois reconnu, sera la
base d'une rconciliation. 3
Enfin, ce qui rend le critrium que nous proposons titre de critrium externe tout fait lgitime, c'est qu'en dfinitive rien n'empche
qu'en mme temps on ne continue philosopher par la mme mthode
qu'auparavant. Il n'est [58] pas douteux qu'en philosophie ce qui intresse le plus, ce sont les questions controverses ; ce que nous aimons
le plus dans toutes les philosophies, c'est la critique des autres philosophes, et aussi c'est l'lment personnel que chaque philosophe y apporte. Cela tient, comme on l'a souvent remarqu, ce que la philosophie porte sur les choses morales ; il semble que le subjectif doit y
jouer un grand rle, et le rle le plus intressant. Loin de nous donc la
pense de vouloir desscher et appauvrir la philosophie en lui demandant de se traner pas pas dans les sentiers connus et de rpter tou3
Premiers Principes, introd. ch. Ier.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
61
jours la mme chose pour tre sre de ne pas se tromper, de reconnatre seulement pour vrai, non pas ce qui parait vident, mais ce qui
est cru par les autres. Une telle mthode, littralement entendue, dsenchanterait de toute philosophie et en ferait la plus pauvre des
sciences. Ce sont prcisment ces grandes controverses qui attirent
tous les esprits. Aussitt que tout le monde serait d'accord, personne
n'y viendrait plus voir, et la philosophie perdrait toutes ses plus
grandes sductions. Je suis donc d'avis que la philosophie doit continuer comme auparavant disputer, employer la mthode personnelle, chercher, ses risques et prils, des penses nouvelles, critiquer et essayer des synthses hasardeuses, en un mot philosopher
librement. Mais qui empche que, pendant que la philosophie continue marcher de l'avant, elle essaye en mme temps de se constituer
un capital, un fond de rserve que l'on cultiverait en commun et qui
serait le domaine, non pas de telle ou telle cole, mais de la philosophie tout entire dans son unit et dans son universalit. Le grand effort pour chaque philosophe sera d'augmenter ce fond commun et
d'ajouter des vrits nouvelles aux vrits acquises ; c'est ainsi qu'elle
se rapprochera de plus en plus des sciences proprement dites, sans
cesser d'tre pour cela ce qu'elle est actuellement, la science libre de
l'universel et de l'absolu.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
62
[59]
Introduction la science philosophique
Leon IV
EXPLICATIONS SUR
LA LEON PRCDENTE
Retour la table des matires
Messieurs,
Nous avons cherch dans notre dernire leon un critrium pour
distinguer en philosophie ce qui pourrait tre appel rigoureusement
scientifique et ce qui ne l'est pas. Nous avons emprunt ce critrium
aux autres sciences, et nous avons dit que toujours on appelle la
science faite la partie de la science sur laquelle on ne dispute pas ; le
reste est la science en mouvement, la science en voie de formation,
qui se fait par le moyen de la contradiction et qui son tour dpose un
certain fond qui va s'ajouter la science faite.
Nous nous sommes demand si ce critrium ne pourrait pas s'appliquer aussi la philosophie ; nous en avons montr les difficults, et
en particulier celle-ci : c'est que dans les autres sciences la partie dont
on dispute est purement et simplement, de l'aveu de tout le monde,
matire d'opinion et d'hypothse, tandis qu'en philosophie ce qu'on
appellerait ailleurs opinion et hypothse prend en outre le caractre de
croyance et ne se laisse pas facilement considrer comme matire controversable, tandis qu'on ne laisserait au compte de la science proprement dite que la partie la moins intressante de la philosophie.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
63
En faisant allusion aux rsistances que cette sparation pourrait
provoquer, je ne croyais pas si bien dire ; car, prcisment depuis
notre dernire leon, j'ai reu des lettres et des articles de journaux o
cette mthode tait svrement blme et o l'on me reprochait de
tomber dans le scepticisme, de mettre en pril toutes les vrits morales et religieuses, [60] en les prsentant comme de simples hypothses sur lesquelles on peut diffrer d'avis, comme sur l'existence
d'un fluide ou deux fluides en lectricit.
Vous voyez, Messieurs, combien la philosophie est une science
difficile ; car on ne peut pas y avancer un mot sans rencontrer immdiatement des scrupules et des impatiences qui, si on les coutait, rendraient impossible toute application srieuse de la mthode vraiment
scientifique. Les circonspections, les lenteurs, les abstractions, les divisions des difficults, comme l'entendait Descartes, l'obligation d'aller du simple au compos, du plus facile au plus difficile, toutes les
rgles si prudentes et si utiles de la vraie mthode philosophique, tout
cela disparatrait devant l'obligation d'affirmer d'avance jour dit, a
priori en quelque sorte et sans examen, toutes les solutions de la philosophie. On nous demande de rsoudre d'avance et sans examen le
problme du critrium de la certitude, le problme de l'existence de
Dieu, et aussi le problme du mal qui y est li, le problme de l'me,
car on a aussi reproch comme un scandale Jouffroy d'avoir dit que
la question de l'me est une question prmature. Il est vident aussi
que le problme de la libert, celui de la loi morale, celui de la morale
indpendante, celui de l'immortalit de l'me, que toutes ces questions
ne sont pas moins importantes que l'existence de Dieu. Il ne serait
donc pas permis de traiter ces solutions d'hypothses, c'est--dire de
problmes rsoudre. Il faudra donc tout d'abord les donner comme
des problmes rsolus. quoi servira donc la science, si elle sait
d'avance tout ce qu'elle cherche ? Puisqu'elle le cherche, c'est qu'elle
ne le sait pas encore ; et jusqu' dmonstration qui pourront venir en
leur temps et auxquelles nous ne renonons pas, jusque-l, dis-je, nous
croyons pratiquer une mthode svre et parfaitement lgitime, en appelant hypothse ce qui est dmontrer. Lorsque saint Thomas commence sa Somme thologique par cette question : Au Deus sit, et qu'il
rpond hardiment : Dico quod non, je dis qu'il n'y en a pas, il est vident qu'il met en [61] question l'existence de Dieu, et que cette exis-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
64
tence, tant que la dmonstration n'est pas complte, n'est qu'une hypothse.
Au fait, dans ce qu'on nous reproche, qu'y a-t-il autre chose que la
constatation d'un fait ? Or que pouvons-nous contre les faits ?
Ce fait est celui-ci. Dans les sciences positives, physiques ou mathmatiques, on ne dispute pas (au moins dans la partie de la science
qui est faite). En thologie et en philosophie, on dispute. Je ne dis pas
que l'on ne puisse expliquer le fait ; peut-tre l'essayerons-nous un
jour. Je ne dis point que ce fait prouve le moins du monde qu'il n'y a
pas de vrit, et qu'il n'y ait rien de dmontr. Je ne dis pas que, pour
ce qui me concerne, je n'aie pas pris parti, comme dit Descartes, sur
les matires qui s'agitent parmi les doctes . Le fait de constater l'existence des disputes et des contradictions ne nous prive en aucune faon
du droit de nous prononcer nous-mmes sur le fond des choses. Ce
droit existe tout entier, et il existe pour nous comme pour notre contradicteur. Nous reprocher le scepticisme parce que nous avons constat que tout le monde n'est pas d'accord en philosophie, c'est comme
si on reprochait le scepticisme un catholique pour avoir constat
qu'il y a des protestants.
Sans doute, nous aurions pu prendre immdiatement partie les
problmes dont nous avons parl, les discuter et les rsoudre dans
notre sens, et, une fois ces problmes rsolus, au lieu de dire que telle
solution est une hypothse, nous aurions dit : Elle est une vrit ; et
bien certainement je considre comme vrits tous les principes de
l'ordre moral et religieux que nous avons indiqus tout l'heure ;
mais, mme alors et aprs dmonstration, il faudrait encore reconnatre que ces vrits sont des vrits disputes et qu'elles se distinguent (c'est un fait) des vrits non disputes. Or, avant de nous engager dans cette voie, nous nous sommes demand si ce ne serait pas
une mthode meilleure et plus sre de laisser provisoirement en suspens tout ce qui divise en philosophie et de mettre l'abri tout ce qui
pourrait [62] tre accord par tous, en supposant qu'il y ait quelque
chose de tel. N'est-il pas plus sage de se mettre d'abord en dehors et
au-dessus de sa propre doctrine, pour chercher un terrain commun sur
lequel les philosophes puissent s'entendre ? Il semble mme que la
meilleure manire de rsoudre les problmes controverss, c'est de
partir d'ides communes. Peut-tre verrait-on alors que l'on est moins
divis qu'on ne se le figure, que plus de choses sont accordes implici-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
65
tement qu'on ne le croit ; qu'en se plaant soi-mme sur les points aigus d'une certaine doctrine, on provoque les autres taler les mmes
prtentions. Les coles mises en prsence les unes des autres par le
ct o elles se choquent, sont d'autant plus portes se nier rciproquement. En tout cas, avec notre mthode, il y aurait au moins cet
avantage de marcher ensemble le plus longtemps possible, et ce serait
un bien pour la raison humaine en gnral, quand mme on ne gagnerait rien sur les points controverss.
Ce qui parat avoir le plus proccup les personnes qui se sont fait
des scrupules propos de la mthode que je viens d'indiquer, c'est le
mot d'hypothse appliqu des ides d'un caractre sacr et qui touchent au plus profond des intrts de l'me humaine. Il me semblait
cependant m'tre expliqu bien clairement. Il me semblait avoir dit
expressment que ces ides, qui, au point de vue spculatif pur, pourraient tre appeles hypothses, sont, un autre point de vue, des
croyances, des convictions, c'est--dire tout autre chose que des hypothses. J'avais fait remarquer que ce caractre de croyance tient
l'me plus qu' la raison pure, et, bien loin d'avoir cherch les discrditer, il me semble avoir dit, et en tout cas je dis maintenant que
l'homme n'est pas seulement une raison pure, qu'il est un tre vivant,
sentant, social, historique, compos de toutes sortes d'lments, qu'il
ne peut pas guider sa vie uniquement par la raison pure, qu'une ataraxie absolue est impossible et illgitime, que tout le monde reconnat,
mme les incroyants, qu'il faut croire quelque chose ; personne ne
voudrait tre considr comme un homme sans [63] conviction. Par
toutes ces raisons et par beaucoup d'autres encore, je suis parfaitement
d'avis que les opinions philosophiques ne ressemblent pas du tout aux
opinions dans les sciences, et que croire Dieu n'est pas la mme
chose que croire la quatrime dimension de l'espace. Mais, en mme
temps, je persiste dire que les vrits morales et religieuses, en tant
qu'elles sont l'objet de la controverse, et en tant qu'on ne les considre
qu'au point de vue de la raison pure spculative, sont analogues ce
qu'on appelle dans les autres sciences des opinions ou des hypothses.
Je ne vois pas ce qu'on pourrait reprendre dans cette doctrine, qui n'est
que l'expression d'un fait.
En ralit, nous n'avons fait autre chose qu'une sorte d'application
extensive du doute mthodique de Descartes. Est-ce que Descartes n'a
pas commenc par tout mettre en doute, et est-ce que ces choses mises
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
66
en doute, en attendant qu'elles soient, comme il le dit, ajustes au
niveau de la raison , ne sont pas des hypothses ? Lorsqu'il va jusqu'
ce qu'il appelle la supposition d'un dieu trompeur, d'un malin gnie,
cela n'implique-t-il pas que l'ide d'un dieu non trompeur, c'est--dire
du vrai Dieu, est galement une hypothse ? Il met en doute bien plus
de choses que nous, puisqu'il y met tout, except qu'il existe. Et ce
doute, qu'il appelle hyperbolique, est cependant un doute rel ; car
lorsque ses adversaires lui opposent que ce n'est pas pour de bon qu'il
veut ainsi mettre toutes choses en doute, il rpond nergiquement que
c'est pour tout de bon, et non pas par fiction, qu'il procde ainsi. Et
croyez-vous que ce procd ait scandalis les contemporains de Descartes ? En aucune faon ; car ce qu'on lui reproche, ce n'est pas que la
mthode soit tmraire, mais au contraire qu'elle n'a rien de nouveau.
Car, lui dit le P. Bourdin, jsuite, ce doute universel n'est autre chose
que ce qu'on appelle dans les coles le doute mtaphysique, dubitatio
metaphysica. Donc, dans les coles de la scolastique, on connaissait
bien ce procd de l'esprit qui, pour arriver la vrit, commence par
carter tout ce qui prte le moins [64] du monde au doute. Nous ne
voyons donc pas ce qui nous empcherait d'user notre tour du doute
mtaphysique, en faisant remarquer que nous mettons part tout ce
qui est sujet contestations en tant qu'hypothse, et que nous nous
tenons tout d'abord ce qui est universellement admis.
On pourrait dire que le procd de Descartes est un procd rigoureux qui a pour but de mettre en lumire le critrium absolu de la vrit, savoir l'vidence, tandis que nous nous sommes borns un critrium extrieur qui n'est en quelque sorte qu'un fait matriel, savoir
l'accord des esprits. Mais ce critrium lui-mme n'est pas absent chez
Descartes. Il n'est pas pour lui un principe de logique abstrait ; mais il
s'en sert d'une manire concrte pour faire le partage du certain et de
l'incertain dans les sciences, et c'est l'exemple que nous avons suivi.
Je ne dis rien de la philosophie, dit-il dans le Discours de la Mthode, sinon que voyant qu'elle a t cultive par les plus excellents esprits, et que nanmoins il ne s'y trouve encore aucune chose dont on ne
dispute, et qui par consquent ne soit douteuse, je rejetai presque pour
faux ce qui n'tait que vraisemblable.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
67
Et ailleurs, dans les Rgles pour la direction de l'esprit :
Il existe peine dans les sciences une seule question sur laquelle des
hommes d'esprit n'aient t d'avis diffrent ; or, toutes les fois que deux
hommes portent sur la mme chose un jugement contraire, il est certain
que l'un des deux se trompe. Il y a plus : aucun des deux ne possde la vrit ; s'il en avait une vue claire et nette, il pourrait l'exposer son adversaire, de telle sorte qu'il finirait par forcer sa conviction. Il n'y a donc parmi les sciences exactes que l'arithmtique et la gomtrie. 4
Il rsulte videmment de ces passages que le critrium d'une
science faite, selon Descartes, est l'accord des esprits ; et en ce genre il
n'en trouve que deux qui soient arrives [65] ce point : c'est l'arithmtique et la gomtrie. Nous avons t beaucoup moins loin que lui
dans le doute, car nous reconnaissons beaucoup d'autres sciences
comme sciences faites ; et mme en philosophie nous nous sommes
demand si, malgr l'assertion de Descartes, il est vrai de dire qu'il n'y
a aucune chose dont on ne dispute. Il nous a sembl au contraire qu'il
y a beaucoup de choses ncessairement admises de part et d'autre et
que l'on passe sous silence dans les controverses, parce que chacun de
son ct, moins proccup de la vrit que de la victoire, vite tout ce
qui pourrait ressembler une concession ses adversaires ; et cependant c'est cela mme, savoir ce qu'on sous-entend, qui constitue la
vrit acquise.
Et d'ailleurs il nous semble que, dans les objections qui nous sont
parvenues, ce qui a le plus bless notre contradicteur, ce n'est pas tant
d'avoir dit qu'il y a des choses dont on dispute en philosophie, car c'est
un fait trop vident ; c'est plutt d'avoir dit qu'il y a peut-tre des
choses dont on ne dispute pas. Si nous avions dit, comme Descartes,
que tout est objet de dispute, aussi bien les matires les plus simples
que les plus leves, on aurait dit que c'est l le caractre des sciences
morales aussi bien que de la thologie ; que cela ne veut pas dire qu'il
n'y a pas de vrit, mais qu'il y en a une ; que ceux qui n'admettent pas
cette vrit sont des esprits mal faits ou malfaisants. Au contraire, dire
qu'en philosophie il y a des choses certaines, mais que parmi ces
4
Tome XI, p. 204, rgie 11.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
68
choses certaines on ne rencontrera pas celles auxquelles on tient le
plus, il semble que ce soit donner a celles-ci un caractre de plus d'instabilit. Compare aux autres sciences, dira-t-on, la philosophie a tel
caractre qui tend la diffrencier des sciences, dont les unes s'occupent d'objets matriels, et les autres d'objets moraux. Ainsi, si dans la
philosophie elle-mme on pouvait trouver quelque base vraiment solide, sur laquelle les esprits pussent s'entendre, ne serait-ce pas alors,
au nom mme de la philosophie, relguer dans le domaine du doute
tout ce qu'il y [66] a de plus vrai, et mme ce qui est le fondement de
toute vrit ?
Mais en supposant mme qu'il en ft ainsi, si nous raisonnons
comme philosophes, n'aurons-nous pas vritablement un avantage
gagner quelque chose de positif et de certain, mme au risque de reconnatre que, thoriquement au moins, le reste peut tre considr
comme douteux ? Cela ne vaudrait-il pas encore mieux que d'envelopper la philosophie tout entire dans la mme apparence d'incertitude, en comparaison de toutes les autres sciences ?
Et d'ailleurs qui nous empche, mme avec notre mthode, d'employer en mme temps la mthode de tout le monde ? Qui nous empchera, parce que nous aurons commenc par mettre part certaines
vrits incontestes, de dire aussi bien que les thologiens que, mme
dans le domaine du contest, il y a une vrit ; que si cette vrit est
conteste, ce n'est pas prcisment parce que les hommes ont de mauvaises passions, comme l'ont dit les thologiens, mais parce que cette
vrit est trop leve, trop dlicate, pour tre bien comprise et sentie
par tous les hommes ? C'est pourquoi pendant tant de sicles il a fallu
les protger par la religion. Les hommes, livrs eux-mmes et leur
libre pense, ne se seraient rellement mancips qu'en retranchant de
leur esprit tout ce qui rappelle de vieilles croyances, semblables,
comme dit Platon, des esclaves affranchis ou des criminels chapps de prison, qui, une fois libres, passent leur temps s'enivrer. Quoi
d'tonnant ce que des esprits mancips pour la premire fois, peuttre trop vite, je n'en sais rien, s'enivrent leur tour de dsordres et de
ngations ? Voil les raisons que nous donnerions, si nous avions
expliquer pourquoi les doctrines les plus leves et les plus nobles
sont aussi les plus combattues.
Ainsi la situation reste la mme, soit qu'on prenne la philosophie
comme un grand champ de bataille o il n'y a pas autre chose faire
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
69
qu' combattre, soit qu'on en fasse un grand champ d'tudes o, par
des mthodes pacifiques, on [67] essaye, en partant des choses acquises, de s'avancer pas pas vers celles qui ne le sont pas. C'est une
mthode analogue celle que pratiquait Socrate. Il partait, nous dit
Xnophon, de ce qui est universellement admis. Je ne conteste pas les
avantages de la mthode de combat, mais il est bon que chacun suive
sa vocation : non omnia possumus omnes. En tout cas, autre chose est
l'enseignement, autre chose est la prdication. La direction de nos
tudes est de donner autant que possible cet enseignement la forme
scientifique. De l des lenteurs et des circonspections ncessaires. Il
faut s'habituer la sparation de ces deux points de vue. Ici la sparation consiste distinguer en philosophie la part de la science et la part
de la croyance, c'est ce que nous avons essay de faire ; mais il faut
reconnatre qu'il y a l de graves difficults. Aussi, aprs ces explications prliminaires, nous comptions aborder aujourd'hui cette question
mme, savoir le conflit de la croyance et de la science en philosophie. Mais c'est l une question trop importante et trop dlicate pour
l'aborder la fin d'une leon. Nous la traiterons la prochaine fois.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
70
[68]
Introduction la science philosophique
Leon V
LA SCIENCE ET LA CROYANCE
EN PHILOSOPHIE
Retour la table des matires
Messieurs,
Le conflit de la science, et de la croyance est de tous les temps.
Partout o il y a eu des savants et des prtres, il y a eu lutte entre les
uns et les autres. Les savants veulent faire penser, les prtres veulent
faire croire ; les uns font appel la libert de l'esprit, les autres exigent
la soumission de l'esprit. Le conflit est devenu surtout remarquable
depuis l'avnement du christianisme. Dans l'antiquit paenne, il y
avait si peu de dogmes, et des dogmes si indtermins et si mls
d'imagination, que le conflit de la philosophie et de la thologie
n'avait gure de prtexte. Si l'on excepte quelques vers de Xnophane,
quelques passages de Platon, on voit que la philosophie a rarement
pris partie la mythologie. Les proscriptions des philosophes, telles
que celles de Diagoras, d'Anaxagore et de Socrate, taient plus politiques que religieuses, et avaient lieu au nom des lois de l'tat plutt
qu'au nom d'une orthodoxie dominatrice. Plus tard, vers la lin du paganisme, les philosophes essayrent plutt de venir au secours de la
religion chancelante par des interprtations rationalistes et philosophiques, que de la combattre par la critique : c'est ce que firent par
exemple les Stociens et les Alexandrins. L'picurisme seul rompit
avec la religion, qu'il appelait superstition, et vit dans la ngation des
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
71
Dieux et de la Providence le suprme affranchissement et la vraie batitude.
Dans le christianisme, les dogmes sont devenus quelque chose de
si concret, de si prcis, de si savant, qu'il fallait [69] une tude approfondie pour en fixer le sens, en dterminer les limites, en dvelopper
les consquences. Ce fut l'objet d'une vritable science, connue sous le
nom de thologie. Les bases en taient la rvlation, l'autorit de
l'criture et des saints Pres. La raison n'tait employe qu' expliquer
et dfendre le dogme sacr. Nanmoins, par le paralllisme des matires et par l'analogie au moins partielle des mthodes, puisque la raison tait employe de part et d'autre, la thologie et la philosophie se
trouvrent bientt en prsence, et bientt aussi en conflit. Le dbat se
concentra sur ce point : les mystres, imposs par l'autorit et accepts
par la foi, sont-ils contraires ou suprieurs la raison ? Si contraires, il
y a rupture absolue entre les deux puissances ; s'ils sont seulement audessus de la raison, l'accord est possible, et la philosophie peut rclamer son indpendance sans tre entrane la rvolte contre l'autorit.
Telle fut jusqu'au XVIIe sicle l'attitude respective des deux sciences, et
Leibniz faisait encore prcder la Thodice d'un Discours sur la conformit de la foi et de la raison, discours dans lequel il dveloppait la
fameuse thse que la foi est suprieure la raison, mais ne lui est pas
contraire.
Cette explication est trs plausible, mais elle n'allait pas au point
vrai de la difficult. Ce point tait celui-ci : faut-il partir de la raison
pour aller la foi, ou partir de la foi pour aller la raison ? Si vous
partez de la raison, vous partez d'un tat d'esprit naturel, pour arriver
la foi, qui est un tat d'esprit surnaturel. Or, pouvez-vous passer, par la
pure logique, du naturel au surnaturel ? Une croyance fonde par la
raison sera-t-elle jamais autre chose qu'une croyance rationnelle, c'est-dire soumise l'examen, la rvision, aux doutes qui peuvent natre
de difficults nouvelles, comme dans toute recherche scientifique ?
Peut-on arriver par l ce caractre d'adhsion entire et absolue qui
appartient en propre la foi ? D'un autre ct, s'il faut partir de la
foi comme d'un postulat antrieur la dmonstration, on peut demander de quelle foi il s'agit. Il est vident qu'en fait, [70] chacun en particulier part de la foi dans laquelle il est n et dans laquelle il a t instruit en son enfance. Mais les croyances sont bien diffrentes suivant
les pays et suivant les temps. Le fait d'tre n ici ou l ne peut consti-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
72
tuer aucun avantage en faveur de telle ou telle croyance, puisque le
mme fait vaut pour toutes :
J'eusse t prs du Gange esclave des faux dieux,
dit Zare dans la tragdie de Voltaire. Il faut donc choisir entre les diverses religions, par consquent leur appliquer l'examen, par consquent soumettre la foi la raison ; et nous retombons dans la premire
mthode, c'est--dire la foi cherche par la raison, avec l'inconvnient
grave que nous avons signal : savoir la disproportion des moyens
avec la fin.
Mais laissons de ct ce premier dbat, qui n'est pas notre objet.
Nous ne voulons pas insister sur le conflit de la foi et de la raison par
rapport la religion positive et aux dogmes rvls ; nous voulons
suivre ce conflit jusque dans la philosophie elle-mme, dans la science
elle-mme. Ne voult-on conduire sa pense et sa vie que par la raison
seule, chapperait-on par l la difficult, et le combat de la science
et de la croyance ne subsisterait-il pas encore comme auparavant ?
Lorsque la philosophie, par la mthode de Descartes. se fut dfinitivement spare de la thologie, on put croire que le conflit de la
science et de la croyance avait cess. Quoi de plus simple en effet ? Je
me sers de ma raison pour trouver les principes dont j'ai besoin pour
satisfaire mon esprit et pour gouverner ma vie. La mthode et les conclusions sont du mme ordre, et mes opinions sont absolument proportionnes aux lumires de ma raison. Et cependant, quelque vraisemblable que fut cette apparence, c'tait encore une illusion. Mme
au point de vue naturel, et toute religion positive mise part, il reste
toujours deux besoins : savoir et croire ; le besoin spculatif et le besoin pratique. Comme savant, j'ai du temps devant moi pour ajuster
mes opinions au niveau de la raison , comme dit Descartes. [71]
Comme homme, j'ai besoin immdiatement de rgles et de principes
pour agir et pour donner un sens et un but ma vie. Ici encore il y a
lieu de se demander si l'on partira de la raison pour parvenir la
croyance, ou si l'on partira de la croyance, pour la confirmer par la
science et par la raison. Dans le premier cas, il s'agit de dcouvrir la
vrit ; dans le second cas, on la possde dj, et il suffit de la dmontrer en la dveloppant.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
73
Si vous suivez le premier chemin, vous n'avez rien craindre du
cte de la raison ; car vous avez toujours le droit de suspendre votre
jugement plutt que de vous tromper ; et Bossuet lui-mme nous apprend que nous pouvons toujours viter l'erreur : Il demeure pour
certain, dit-il, que l'entendement ne se trompera jamais : parce qu'alors
ou il verra clair, et ce qu'il verra sera certain ; ou il ne verra pas clair,
et il tiendra pour certain qu'il doit douter jusqu' ce que la lumire apparaisse. Soit ; voil la raison satisfaite ; mais que devient le besoin
pratique ? que devient la croyance ? que devient l'action ? Dans tous
les cas, sans mme trop pousser au doute, les dmarches de la raison
sont lentes, et la vie pratique ne saurait attendre. Puis-je attendre que
la thorie ait prononc sur la nature et les droits du pouvoir paternel,
pour croire que je dois du respect mes parents ? Dois-je attendre que
la science ait prononc sur le meilleur des gouvernements, pour prendre un parti sur le gouvernement de mon pays ? D'ailleurs, au point de
vue naturel aussi bien qu'au point de vue surnaturel, il y a inadquation, disproportion entre la science et la croyance, entre la fin et les
moyens. Jamais on n'arrivera par la raison seule cet tat de confiance
absolue que l'on doit la nature. Sans aller jusqu' dire avec Pascal
que la raison confond le dogmatisme, et que la nature confond le pyrrhonisme, il est certain qu'on n'arrivera pas par la raison ce degr de
dogmatisme que la foi nous impose.
Essayera-t-on donc, au contraire, de partir de la croyance ? Mais de
laquelle ? Ici, il ne s'agit plus de foi positive, par [72] consquent de
tel ordre de croyances propre tel ou tel pays. Personne non plus ne
prtera une autorit absolue, l'autorit de principes, tel systme de
loi ou telles conventions sociales, diffrentes suivant les temps ou
suivant les lieux, comme l'usage d'ter ou de garder son chapeau dans
un lieu saint. Il ne peut donc tre question que de croyances communes tous les hommes : il s'agira de ce que l'on a appel la foi instinctive du genre humain. Mais y a-t-il une foi instinctive du genre
humain ? y a-t-il des croyances universelles ? quoi de commun entre
le ftichisme du sauvage et le monothisme chrtien ? Et, de plus, que
de croyances universelles ont t dmontres fausses, telles que les
sacrifices humains, l'esclavage, la lgitimit de la torture, et, dans
l'ordre physique, la croyance l'immobilit de la terre et l'impossibilit des antipodes ! Il faut donc soumettre ces croyances la critique
de la science, et par consquent retomber dans la premire mthode.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
74
On voit que les deux procds sont insuffisants. Et cependant il est
certain que l'homme a besoin de savoir et qu'il a besoin de croire ; et,
pour viter toute quivoque, je n'entends pas seulement, par croire,
admettre des ides morales et religieuses plus ou moins semblables
celles que nous ont enseignes les religions positives ; j'entends par l
toute forme de conviction qui ne dpend pas exclusivement de la raison et de l'examen, et qui est l'uvre commune de la raison, du sentiment et de la volont. Par exemple, les convictions politiques ne sont
certainement pas, chez la plupart des hommes, le rsultat d'un examen
scientifique. Bien peu d'hommes ont le temps et les moyens de se faire
des doctrines politiques par l'tude approfondie de l'histoire et l'analyse des avantages ou des inconvnients attachs telle ou telle forme
de gouvernement ; bien peu aussi peuvent se rendre compltement
compte de ce qu'il y a de bien ou de mal fond dans les grandes mesures proposes par tel ou tel parti, par exemple la sparation de
l'glise et de l'tat. L'opinion politique de chacun n'est donc pas exclusivement [73] une uvre rationnelle et scientifique ; mais chacun,
suivant sa situation, son ducation, les donnes de son exprience
propre, choisit librement, entre les doctrines rgnantes, celle qui lui
agre le plus. Il en est de mme des doctrines sociales ou antisociales,
religieuses ou antireligieuses, des diverses conceptions qu'on se fait de
la moralit, enfin et mme des doctrines littraires et esthtiques. Dans
tous ces cas, l'adhsion telle ou telle doctrine n'est pas un acte de
science ; c'est encore, et la plupart du temps c'est surtout un acte de
foi, parce qu'elle ne dpend pas exclusivement de l'examen, mais
qu'elle est un rsultat complexe dans lequel entrent l'instinct, l'ducation, le milieu, la rflexion, la sensibilit, l'imagination, en un mot
l'homme tout entier.
Mais, si d'un ct l'homme a besoin de croyances, parce que,
comme dit Voltaire, il faut prendre un parti , d'un autre, en tant que
raison pure, raison abstraite, l'homme veut savoir, se rendre compte,
comprendre pourquoi il croit : or, c'est l prcisment ce qu'on appelle
philosophie. Ainsi l'antinomie de la science et de la croyance subsiste
au point de vue de la philosophie aussi bien qu'au point de vue de la
thologie.
Cette antinomie de la science et de la croyance est le fond de la
philosophie moderne depuis Kant. Kant a saisi cette antinomie de la
manire la plus profonde, et il en a fait le centre de sa philosophie.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
75
Dans la Raison pure, il a essay de dterminer l'ide de la science de
la manire la plus svre. Dans la Raison pratique, il a essay de dterminer le domaine de la croyance en s'appuyant sur le fait moral. Le
philosophe cossais Hamilton, en cosse, a expos la mme doctrine
avec plus de svrit encore, en retranchant de la science toute ide
absolue, mme titre d'ide rgulatrice, comme l'avait fait Kant, et en
renvoyant l'ide d'absolu elle-mme an domaine de la croyance.
L'cole clectique, qui avait cru d'abord pouvoir fonder scientifiquement sa philosophie laide de la psychologie, a fini par renoncer
cette mthode trop lente, et elle a fait appel, pour rsoudre [74] les
questions ultrieures et finales, ce qu'elle appelait le sens commun,
c'est--dire cet ensemble de croyances naturelles ou acquises qui
appartiennent tous les hommes civiliss dans le temps o nous
sommes.
Nous voudrions, notre tour, examiner fond cette antinomie de
la science et de la croyance. Partons d'abord de l'ide de la science
dans ce qu'elle a de plus clair et de plus prcis. La science a pour objet
la vrit, et non seulement la vrit en elle-mme, mais la vrit aperue et reconnue comme telle, la vrit en tant que notre intelligence
lui est adquate. ce point de vue, Descartes a pos la rgle suprme,
que l'on peut appeler la loi et les prophtes en philosophie : c'est la
rgle, le critrium de l'vidence. La science doit recueillir tous les faits
qui se prsentent elle, quels qu'ils soient, sans se demander si ces
faits sont ou non contraires telle vrit prsuppose que l'on a
d'avance dans l'esprit.
Que serait-il arriv si, lorsque Copernic et Galile se sont mis la
recherche du vrai systme du monde, on leur avait dit : Prenez garde
la voie dans laquelle vous vous engagez. Si vous persistez jusqu'au
bout dans cette voie, vous allez vous trouver en face d'une croyance
thologique, et vous blesserez la conscience. Une fois la thologie
branle sur un point, elle le sera sur tous les autres. Il n'y aura plus de
critrium de vrit. Nous tomberons dans le scepticisme. Si Galile,
au lieu d'tre un savant, n'et t qu'un croyant, il et ferm les yeux
l'vidence ; il et cart les faits les plus certains, et il et interprt
les autres faits comme le systme reu l'et exig. L'astronomie moderne ne se serait pas fonde, et un nombre incalculable de vrits capitales serait rest enfoui pour l'homme. Heureusement Galile tait
un savant qui ne pensait qu' la science. Il s'est dit que la vrit ne
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
76
peut pas contrarier la vrit, et que, si le systme de Copernic tait
vrai, il faudrait bien que la thologie s'en accommodt ; et c'est ce qui
est arriv. Aujourd'hui, le systme de Copernic s'enseigne partout,
mme [75] Rome ; il fut convenu que lorsque Josu a arrt le soleil,
cela voulait dire qu'il arrtait la terre et les autres plantes : explication
plausible dont on aurait d s'aviser plus tt. Depuis ce grand et mmorable vnement, la science fut mancipe. La thologie, avertie des
dangers qu'elle courait dans de tels conflits, reconnut que l'astronomie,
la physique et les autres sciences ne relvent pas de la thologie,
qu'elles n'ont pas se proccuper ni de la thologie ni des dogmes rvls. Le seul critrium, c'est l'vidence, soit l'vidence de fait, prouve par l'exprience, soit l'vidence de dmonstration.
En serait-il autrement de la philosophie ? D'o viendrait cette diffrence ? La philosophie ne fait que continuer les autres sciences.
Celles-ci ont pour objet les tres particuliers ; celle-l, l'tre universel.
Celles-ci se bornent l'homme physique ; celle-l pntre jusqu'
l'homme intellectuel et moral. Mais il s'agit toujours de la mme
chose, savoir et comprendre. Or, on ne peut comprendre que par
l'usage libre de la raison, par l'observation, par l'exprience quand cela
est possible, par l'analyse des ides, par l'induction et la dduction ; et
quoiqu'il soit difficile, peut-tre mme impossible d'arriver au mme
niveau de certitude affirmative que dans les autres sciences, bien loin
que ce soit l une raison d'tre moins svre en matire d'vidence, au
contraire c'est une raison de l'tre plus. Plus la chose est dlicate, plus
il faut y regarder de prs.
Il est donc vident que, pour la philosophie comme pour les autres
sciences, la seule rgle c'est de n'affirmer qu'aprs l'examen et au nom
de l'vidence. La seule mthode vraiment philosophique est la libert
d'examen.
La philosophie ne peut donc pas accepter, plus que les autres
sciences, d'tre engage souscrire d'avance un certain credo thologique. Elle ne peut admettre comme critrium la soumission aux
vrits de la foi. Elle ira devant elle ses risques et prils, ne consultant que la raison seule, et, comme le dit Pascal, affirmant o il faut,
doutant o il [76] faut , sans se tenir cependant pour oblige de
croire o il faut . Bien loin de considrer le doute comme une
mauvaise note, elle y verra au contraire la vraie garantie de la libert
de l'esprit et de l'indpendance de la science. Si les rsultats auxquels
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
77
elle arrive sont insuffisants, eh bien ! la thologie prendra sa place si
elle le peut ; c'est elle que cela regarde. La philosophie, envisage
comme science, n'a donc rien voir avec la religion positive. Elle ne
sait pas si elle est vraie, si elle est fausse. Elle ne s'en occupe pas.
En sera-t-il de mme l'gard de la religion naturelle, du disme,
dont les dogmes sont, comme on sait, l'existence de Dieu, la vie future, la loi morale, le devoir, la libert ? Ici la question est diffrente.
En effet, entre la philosophie et la thologie positive, il y a une diffrence de base. L'une repose sur la raison, l'autre sur la rvlation. Il est
donc facile de sparer l'une de l'autre. La raison n'est pas ncessairement engage affirmer ou nier la vrit de la rvlation. C'est un
autre ordre d'ides, dont il est permis de faire abstraction en philosophie. Au contraire, la religion naturelle est une uvre de la raison humaine, et en grande partie de la philosophie elle-mme. La philosophie ne peut donc se soustraire l'examen de la religion naturelle.
Mais la question est de savoir si la religion naturelle doit tre un postulat admis d'avance et dont il ne faut pas s'carter, ou si c'est une conclusion laquelle on peut arriver ou ne pas arriver, suivant le succs
qu'aura la dmonstration.
Mais quel titre telle ou telle doctrine pourrait-elle s'imposer
d'avance la raison sans lui permettre l'examen et sans attendre la
dmonstration ? Ces doctrines, dont nous parlons, sont en partie le
produit de la raison philosophique. Elles ne peuvent donc tre considres comme antrieures elle, et par consquent prises comme
principe. Elles ont pris d'ailleurs, en tant que croyances, toutes sortes
de formes dans tous les temps et dans tous les pays. Laquelle de ces
formes est la vraie et doit s'imposer comme postulat indiscutable ?
Lorsque l'on parle, par exemple, de l'existence de [77] Dieu, parle-t-on
du ftiche des sauvages ou du Dieu unique et immatriel, du Dieu
crateur ou du Dieu architecte ? Et si l'on prend la moyenne des
croyances, il reste quelque chose de si vague, qu'on se demande quoi
servirait de prendre l un point de dpart de dmonstration. Ce n'est
pas dire que l'existence de ces croyances dans l'espce humaine ne
soit un fait de la plus haute importance dont il faudra tenir compte
dans la discussion des questions ; et c'est mme ce qu'on appelle l'argument du consentement universel. Mais ce n'est qu'un fait qui entrera
pour sa part dans l'argumentation ; ce n'est point un axiome a priori
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
78
servant de rgle la science, et en dehors duquel il ne sera pas permis
de se mouvoir.
La philosophie ne doit donc pas plus partir d'un credo naturel que
d'un credo surnaturel. En supposant qu'il y ait certaines croyances
primitives et instinctives qui doivent rsister toutes critiques, c'est
encore la philosophie qu'il appartient de les constater, de les caractriser, de les distinguer et de les sparer des superstitions. Autrement,
pourquoi ne partirait-il pas aussi de la croyance l'apparition des esprits ? Il faut donc soumettre ces croyances l'analyse et l'examen.
Or c'est prcisment l'uvre de la philosophie, et dans cette uvre
elle doit tre libre ; car, comment distinguerait-elle autrement la
croyance lgitime du prjug ?
Voici cependant une question dlicate et souvent dbattue. Le droit
d'examiner librement va-t-il jusqu'au droit de se tromper ? Devonsnous reconnatre le droit l'erreur aussi bien que le droit la vrit ?
Je dis qu'on a le droit l'erreur, en ce sens que c'est le seul moyen
d'arriver la vrit. Sans doute, par l'examen on peut arriver l'erreur ; mais sans examen on est sr de manquer absolument la vrit :
car, si j'admets une vrit sans examen, comment puis-je savoir que
c'est la vrit ? En quoi se distingue-t-elle de telle autre affirmation
que d'autres admettent galement sans examen et qui est cependant
une erreur ? Sans doute j'ai en ma possession un moyen infaillible de
ne pas me tromper ; c'est de suspendre mon jugement, c'est .de ne rien
affirmer [78] du tout. Mais c'est ce qui est impossible. Pour la plupart
des questions philosophiques, il faut que j'affirme. J'ai besoin d'affirmation pour conduire ma vie. D'ailleurs le scepticisme lui-mme est
encore une affirmation. Il ne faudrait pas mme affirmer cela. Du
droit d'examen combin avec la ncessit d'affirmer rsulte le droit
l'erreur. Car si je n'ai pas ma disposition toutes les donnes ncessaires pour rsoudre le problme pos ; si, par suite du milieu intellectuel o je vis, je ne vois qu'un ct des choses ; si je n'ai pas l'esprit
assez puissant pour rsoudre toutes les difficults qui peuvent se prsenter ; si je ne connais pas telle solution qu'un autre connat, qui, une
fois connue, satisferait aux lacunes de ma dmonstration ; si, en un
mot, je suis un homme, et comme tel limit dans mon exprience,
dans mes moyens d'information et dans ma puissance de raisonnement, je puis trs bien raisonner juste et cependant me tromper ; et
cela est mon droit. Bien plus, en affirmant ce qui est la vrit en soi,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
79
mais sans raisons dmonstratives et sans proportionner la conclusion
aux prmisses, je manquerai mon devoir philosophique, puisque
j'irai au del de ce que je conois clairement et distinctement.
Il ne faut pas oublier d'ailleurs que la philosophie fait autant de
progrs par l'erreur que par la vrit, et que l'erreur est le seul moyen
que la raison humaine ait eu jusqu'ici de pntrer jusqu' la vrit.
Admettons par exemple, si l'on veut, la doctrine des ides innes ;
supposons que ce soit la vrit. C'est Descartes qui a trouv cette vrit. 5 Mais il l'a peine expose, et sous la forme la plus vague ; puis il
l'a tellement rduite qu' la fin il n'a plus considr comme inne que
la facult d'acqurir les ides, ce qui est rduire l'innit presque
rien. Enfin ses disciples avaient, de leur ct, abus de l'hypothse en
multipliant les principes inns sans ncessit. La svre critique de
Locke, qui accumule [79] les objections contre la doctrine de Descartes et qui essaye d'expliquer toutes les ides par la sensation et la
rflexion, tait donc autorise par le vague de la doctrine de Descartes. Or c'est prcisment cette doctrine de Locke qui a suscit celle
de Leibniz, c'est--dire qui a forc la philosophie un examen nouveau de la question, et une doctrine beaucoup plus profonde de
l'innit. On peut dire galement que c'est la doctrine utilitaire qui a
amen Kant dgager la notion du devoir, qui dans toutes les doctrines prcdentes tait plus ou moins mle la notion d'intrt personnel.
Admettra-t-on que le libre examen soit bon pour dcouvrir la vrit, mais, qu'une fois la vrit dcouverte, il faut s'y tenir, et se contenter de la dfendre sans la compromettre en voulant la changer, ni la
perfectionner en la mettant de nouveau en question ? Ici encore nous
sommes oblig de maintenir le droit d'examen dans toute son extension. Ce droit entrane le droit de rvision, soit parce que l'on peut
s'tre tromp, soit enfin parce que des faits nouveaux exigent un examen nouveau.
Ainsi, dans la philosophie considre comme science, la porte doit
toujours rester ouverte pour les rectifications et complments de la
vrit dj dcouverte, aussi bien que pour l'invention des vrits ca5
Bien entendu que nous ne parlons qu'en gros. En ralit, ce que Descartes a
trouv, c'est la forme moderne de la question ; mais la thorie prexistait dans
la philosophie de Platon.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
80
ches et encore mconnues. Les opinions philosophiques ne peuvent
donc jamais arriver l'tat de dogmes absolus, soustraits dfinitivement tout examen et toute recherche ultrieure.
J'abrge ces considrations sur la libert de penser en philosophie.
Tout a t dit sur ce sujet. Il est inutile d'y insister davantage. J'ai hte
d'arriver au point o la thorie vient se heurter contre une sorte d'impossibilit morale qui la forcera ou de s'arrter ou de reculer.
L'appel l'vidence, qui n'est autre que la libert d'examen, peut-il
s'appliquer aux matires morales aussi bien qu'aux matires religieuses ? Pourquoi pas ? Par la mme raison que les vrits religieuses, les vrits morales ont le droit .d'tre ajustes au niveau de
la raison , selon l'expression [80] de Descartes. Celui-ci les comprenait sans doute parmi les vrits qu'il mettait en doute, puisqu'il se
croyait oblig de se faire une morale provisoire ; c'est donc que la
vraie morale tait encore pour lui un problme. De quelle morale d'ailleurs pourrait-on partir comme tant au-dessus de l'examen ? La morale vulgaire est tout ce qu'il y a de plus mlang, de plus confus. C'est
un compos hybride de devoir, d'intrt, de plaisir, de sentiment, d'habitude, d'ducation, le qu'en dira-t-on, de respect humain, etc. Dans
ce mlange confus, comment trouver une doctrine s'imposant d'avance
et a priori toute analyse, toute discussion. Donc, ncessit d'examiner en morale comme en toute autre partie de la philosophie ; mme
droit d'affirmer ce qui parait vident, de nier ce qui ne le parait pas.
Par consquent, mme libert pour la diversit des sentiments et des
systmes. Systme utilitaire, systme hdoniste, systme sentimental,
systme de la volont divine, etc., tous ces systmes peuvent se prsenter ct du systme du devoir et au mme titre, philosophiquement parlant. Tant que nous restons dans le spculatif, dans la rgion
des principes et de la thorie pure, la morale ne se distingue pas des
autres parties de la philosophie. Elle est matire examen, recherches, et par consquent dispute et controverse ; et aucune doctrine n'a le droit de s'arroger a priori un privilge qui la soustrairait au
libre examen.
En sera-t-il de mme de la morale pratique ? Aura-t-on le droit de
mettre en doute et de soumettre l'examen les principes sur lesquels
repose l'ordre social, par exemple la proprit, la famille, l'tat ? Ici
encore la logique nous contraint soutenir l'affirmation. De ce que
telle institution, tel systme d'organisation, existe en fait dans la soci-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
81
t actuelle, est-ce une raison d'affirmer qu'il existe aussi en droit, c'est-dire qu'il soit vrai et lgitime ? Ne faut-il pas encore procder par
voie d'examen ? Qui me prouve avant examen que la proprit soit
une institution juste et bienfaisante ? Pendant des sicles la socit a
repos sur l'esclavage ; et [81] cependant on a fini par dcouvrir que
l'esclavage tait inutile et illgitime. Pourquoi n'en serait-il pas de
mme de la proprit ? Si donc je viens trouver, aprs examen, que
la proprit s'est tablie par usurpation, comme le disait Pascal ; si je
trouve que la proprit est un vol, comme Je disait Proudhon, pourquoi ne le dirais-je pas ? De mme pour la famille. Si je trouve que le
mariage est mal organis, si je crois la lgitimit du divorce, pourquoi ne le dirais-je pas ? Et mme, si je vais jusqu' penser que le mariage est une pure affaire de libert individuelle dans laquelle l'tal n'a
pas intervenir, pourquoi ne le dirais-je pas ? Rciproquement, si je
dcouvre que le divorce est une institution immorale, et, comme le
disait rcemment un prdicateur, un systme de prostitution lgale,
pourquoi n'aurais-je pas le droit de le dire ? Il en est de mme du fondement de la socit et de l'tat. Si je pars du principe de l'vidence,
je ne dois rien prendre pour accord, je dois tout examiner et tout
prouver, except les axiomes premiers, s'il y en a de tels. Et il ne s'agit
pas ici du droit extrieur d'mettre et d'exprimer ses opinions par la
voie de la presse. La libert de la presse est une question sociale et
politique que nous n'avons pas examiner ici. Il s'agit du droit intrieur que j'ai de penser tout ce qui me semble vident et de ne penser
que ce qui me semble vident.
Ici commence paratre d'une manire visible l'antinomie que nous
cherchons mettre en lumire entre la science et la croyance. Car une
socit, pour vivre et pour subsister, a besoin de principes fixes, de
doctrines communes, de fondements accepts par tous ; et la libert de
penser, seul rsultat lgitime cependant de la science, a pour consquence de tout mettre en doute, de provoquer toutes les opinions,
toutes les manires de voir, sans qu'aucune ait le droit de se mettre audessus des autres ; car toutes relvent d'une mme autorit : l'vidence. Si votre doctrine ne force pas les convictions des autres
hommes, c'est qu'elle n'est pas plus vidente que les autres doctrines.
[82]
N'oublions pas, en effet, le mot de Descartes : Il n'y a aucune
chose dont on ne dispute et qui, par consquent, ne soit douteuse ; et
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
82
cette autre proposition que, partout o deux esprits se contredisent,
il est certain que l'un d'eux a tort, et mme il est probable qu'ils ont
tort tous les deux, parce qu'on ne voit pas pourquoi l'un ne forcerait
pas l'adhsion de l'autre ; et si l'on dit que ce sont les passions qui
s'opposent la vrit, cela peut tre dit des deux cts. Quoique j'aie
d faire un choix par la ncessit o je suis dans la pratique d'affirmer
quelque chose, je n'en dois pas moins considrer que les autres
hommes ont le mme droit. Je devrai donc admettre que toutes les
opinions sont aussi lgitimes que la mienne. Toutes les opinions possibles sur les fondements de la socit, mme celle qui nie toute socit, devront donc coexister au mme titre. Que devient donc alors l'unit sociale, le consensus sans lequel il n'y a pas de vie, aussi bien pour
les organismes individuels que pour les organismes sociaux ? Remarquons que la mme antinomie subsisterait encore lors mme qu'on
interdirait extrieurement telle ou telle opinion ; car le conflit existerait toujours intrieurement, et c'est par l'esprit, et non pas seulement
par les paroles extrieures, que l'unit sociale se maintient et se fonde.
Mais le conflit prcdent devient encore bien plus grand lorsque
l'on passe de la pense l'action, du droit purement thorique de soutenir telle opinion au droit d'agir conformment cette opinion. C'est
ici que la science, il n'y a pas a le dissimuler, entre en conflit avec la
morale.
Sur ce terrain, il faut reconnatre que les partisans de la libre pense montrent en gnral peu de consquence et peu d'audace. Ils sparent radicalement le domaine de la pense et celui de l'action. Ils admettent dans le premier domaine la libert illimite, et continuent
comme tout le monde soumettre le second la morale et la loi sociale. Cependant c'est l une sparation arbitraire et artificielle. Dj la
psychologie la plus moderne nous montre que toute ide [83] tend se
raliser au dehors, que l'ide d'un acte consiste prcisment en ce que
les premiers mouvements organiques dont l'acte est la suite extrieure
tendent se reproduire en nous. Quand nous pensons l'ide de manger, il se produit dans les muscles de la mchoire un commencement
de mouvement qui, en se continuant, arriverait produire l'acte de la
mastication. On sait que chez les hypnotiques l'ide d'un acte produit
fatalement et infailliblement l'excution de cet acte. D'un autre ct, si
nous passons la question de droit, on peut se demander si le droit de
penser que tel acte est lgitime n'entrane pas le droit d'accomplir cet
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
83
acte. Autrement, que signifierait alors mon opinion ? Dire que j'ai le
droit de croire au droit d'insurrection, n'est-ce pas dire que j'ai en fait
le droit de m'insurger. Car mon opinion consiste prcisment en ce
que je soutiens la lgitimit de l'acte. Contester la libert de l'action,
c'est contester la vrit de l'opinion. Il en est de mme de l'opinion du
tyrannicide, et ce droit de tuer le tyran ne doit pas seulement tre entendu du rgicide ; car les rois ne sont pas les seuls tyrans ; et j'ai de
plus le droit, en tant qu'individu, de dsigner le tyran ; aucune autorit
lgale ne peut le faire, car c'est prcisment elle-mme qui est suspecte de tyrannie, de sorte que le tyrannicide conduit l'homicide indtermin. Sans doute, au point de vue matriel et politique, la socit
peut convenir qu'elle n'admettra que la libert intrieure et non la libert extrieure : chacun ayant le droit de penser ce qui lui plat, la
socit jouira du mme droit ; et elle pourra fixer les limites o elle
voudra. Ce n'est plus qu'une question de force. Mais, encore une fois,
il ne s'agit point ici de la question sociale et extrieure ; il s'agit de la
question philosophique ; il s'agit du jugement port par un philosophe
sur mon action : or, je dis que vous, philosophe, vous ne pouvez pas
reconnatre le droit de penser et ne pas reconnatre en mme temps le
droit d'agir ; car, encore une fois, ma pense ici consiste prcisment
affirmer le droit d'agir.
[84]
Encore l'insurrection, le tyrannicide, sont des doctrines politiques ; et de nos jours ces doctrines, par l'habitude des rvolutions et
les prjugs des partis, ont t couvertes d'une sorte d'indulgence gnreuse et mme quelquefois d'une admiration superstitieuse ; mais il
faut avoir le courage d'aller plus loin, et de la morale politique passer la morale prive. Ici encore, je dfie que l'on fixe une limite entre
la thorie et la pratique. Si je juge thoriquement, par exemple, que la
proprit est ne de l'usurpation et que, selon l'expression consacre,
les propritaires sont des voleurs, pourquoi ne penserais-je pas qu'il
est permis toute personne de rparer l'injustice primitive en tant
ceux qui ont, pour donner ceux qui n'ont pas assez ; et comme je
puis tre moi-mme parmi ceux-l, pourquoi ne m'attribuerais-je pas
moi-mme quelque chose de cette portion revendique sur le tout ? De
plus, pourquoi tous ceux qui sont dans le mme tat que moi ne formeraient-ils pas une ligue o les uns seraient chargs de prendre, les
autres de cacher, les autres de vendre, et en un mot une socit en par-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
84
ticipation, grce laquelle chacun finirait par avoir sa quote-part de la
richesse reconquise ? En un mot, pourquoi ne soutiendrait-on pas la
lgitimit du vol ? et, s'il est vrai que voler un voleur, ce n'est pas voler, ne peut-on pas dire que voler un propritaire ce n'est pas voler ?
Enfin, au nom de quoi pouvez-vous m'interdire de passer de la thorie
l'acte, puisque ma pense consiste prcisment ici soutenir la libert de l'acte ? Encore une fois, il ne s'agit pas de savoir si la socit, en
fait, devra laisser faire. La socit a ses lois qu'elle maintient, et je
puis tre frapp par elles ; je m'y soumets d'avance. Mais il s'agit du
jugement philosophique porter sur l'acte ; or ce jugement ne peut
tre ngatif, sans quoi on reconnatrait par l mme que la libert de
penser n'est pas illimite.
J'ai une certaine honte et j'prouve une sorte de rvolte intrieure
pousser plus loin l'argumentation, et cependant il est facile de voir
qu'il serait tout aussi lgitime d'appliquer [85] le mme raisonnement
l'assassinat qu'au vol. Il serait rpugnant, dis-je, mme fictivement,
de pousser la doctrine jusque-l. Rappelons seulement que le pote
Schiller, couvert sans doute par la libert de la muse tragique, n'a pas
craint de nous reprsenter, dans une de ses pices, un de ses personnages ( la vrit le tratre de la pice, mais qui n'en est pas moins un
subtil raisonneur) lequel, dans un monologue pouvantable, se demande s'il n'a pas le droit d'empoisonner son pre, et qui se donne
lui-mme des raisons pour cela. Eh bien ! ne sommes-nous pas tenus,
par la suite du raisonnement prcdent, d'accorder que la libert intellectuelle doit aller jusque-l ? et aussi, en vertu du mme raisonnement, que l'action a le droit d'aller jusqu'o va la pense ? Et remarquez d'ailleurs qu'il ne s'agit pas ici d'un de ces cas que les thologiens
appellent la conscience errone et la conscience ignorante, o le sujet
est amnisti par l'tat de sa conscience (comme l'anthropophagie des
sauvages ou les crimes du fanatisme). Non, il s'agit au contraire d'un
cas o, la conscience parlant trs haut, au point d'inquiter et troubler
le coupable, il se sert de sa libre pense pour combattre sa conscience,
celle-ci tant prcisment un acte de croyance, et l'examen auquel il se
livre un acte de science. Si, en effet, nous considrons les croyances
morales des hommes comme pouvant tre des prjugs et par consquent comme justiciables du libre examen, pourquoi ne considreraisje pas ma propre conscience comme un prjug possible et par consquent comme susceptible d'tre combattue par l'examen et, cons-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
85
quemment, d'tre limine dans la conduite pratique ? On ne dira pas
non plus qu'il ne s'agit pas ici de science ; car il y a deux sortes de
sciences : la science pure et la science applique ; et un ingnieur qui
a rsoudre un problme pratique, un canal creuser, un pont jeter,
etc., fait de la science aussi bien que le pur gomtre. De mme la
question de savoir si on commettra tel ou tel acte est une question de
morale applique, et par consquent une question de science. Si j'ai le
droit de tout penser, j'ai le droit de penser cela ; et [86] comme ma
pense ici c'est la lgitimit de tel ou tel acte, j'ai le droit de le faire,
sinon au point de vue de la socit, qui m'en empche si elle est la
plus forte, du moins au point de vue du philosophe qui mjuge et qui
doit reconnatre que je suis un philosophe comme lui.
Ainsi la libert de penser, pousse jusqu' ses dernires consquences, aboutit la libert du crime : voil, sous sa forme la plus aigu, le conflit de la science et de la croyance.
Ici la conscience morale se rvolte ; elle crie. La nature, comme dit
Pascal, confond la raison imbcile et l'empche d'extravaguer jusqu'
ce point. Cette conscience nous crie qu'un acte de vertu vaut mieux
que tous les systmes de philosophie. Prisse la philosophie plutt que
la probit, l'humanit et l'honneur !
Il est donc vident que, si loin que l'on pousse le principe du doute
mthodique et de la libert intellectuelle, il vient un point cependant
o il faut reconnatre que cette libert entre en conflit avec la conscience, c'est--dire avec la croyance inne du bien et du mal, et o celui que vous avez devant vous n'est plus un libre raisonneur, mais un
malhonnte homme, un sclrat. Nous aurions pu, par prudence et par
respect pour nous-mme, faire commencer le conflit plus haut ; mais
on nous et accus peut-tre de sacrifier la libert philosophique,
comme on croyait pouvoir nous accuser de scepticisme lorsque nous
traitions d'hypothses et de problmes les vrits morales et religieuses. Nous avons donc d employer un procd violent pour mettre
en pleine lumire le conflit qui existe au fond de toute libre philosophie.
Pour le dire en passant, la solution que l'cole clectique avait
donne du problme prcdent et que nous avons tous enseigne dans
notre jeunesse, n'tait pas si peu philosophique qu'on a pu le croire.
Cette solution tait que la philosophie doit respecter le sens commun ;
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
86
qu'elle en relve au lieu de le dominer ; que l'instinct de l'humanit a
rsolu spontanment et rsout encore chaque jour, sans attendre les
lentes dmarches de la raison pure, les questions relatives sa doctrine [87] et son bonheur ; qu'il faut mettre part et hors de cause les
grandes croyances de l'humanit ; que la vox populi, malgr ses erreurs, est aussi la vox Dei. L'humanit est inspire, disait Cousin.
Le philosophe recueille ces enseignements qui viennent de la spontanit nave de ses semblables. Il les recueille pour les lui renvoyer
clairs, dvelopps et complts par l'analyse et la rflexion. La
science a le droit d'clairer ces notions, mais elle n'a pas le droit de les
dtruire.
On a trouv celle solution trop peu philosophique, trop peu scientifique. On a voulu qu'il ft permis d'employer en philosophie la libert
absolument absolue que l'on a dans les autres sciences. Mais o fixera-t-on la limite ? Car nous avons vu qu'il faut finir par en fixer une :
sans quoi, il pourrait se faire que, sous couleur de libre pense, on se
rveillt un jour malhonnte homme.
En suivant le principe de la libert philosophique, nous n'avons
trouv aucune solution de continuit, aucun point o pourrait intervenir une autorit, je ne dis pas extrieure et matrielle, mais morale et
spirituelle, qui put arrter l'enchanement des ides ; et nous avons d
aller jusqu' la dernire limite, c'est--dire jusqu' l'action mme, et
jusqu'aux actions les plus rvoltantes ; car pour d'autres actions, telles
que celles qui concernent les murs, la conscience morale est beaucoup plus large et plus complaisante ; et le libertinage de l'esprit s'unit
bientt, comme au XVIIe sicle, au libertinage des murs. Il n'en est
plus de mme lorsqu'il est question du crime et du vol. Eh bien ! je le
demande, est-ce suffisamment garantir la part lgitime de la croyance
dans l'me humaine que d'attendre les derniers scandales et les dernires rvoltes de la conscience en face du crime ? De l cette pense
naturelle que, pour garantir la pratique, il faut faire commencer beaucoup plus haut le droit de la conscience morale. Ce ne sera pas seulement dans cette action particulire que la conscience fera entendre son
autorit ; ce sera au principe mme de la loi morale. La loi morale ne
s'imposera pas seulement [88] par son vidence logique, qui peut tre
conteste, mais par son vidence morale. Ce sera un devoir de croire
au devoir. Mais la morale ainsi sauve se suffira-t-elle elle-mme ?
Sera-t-elle suspendue sans principe entre une mtaphysique absente et
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
87
une physique indiffrente ? Ne faut-il pas la morale un principe religieux ? La religion naturelle reviendra donc titre de credo ncessaire : car n'est-ce pas un devoir aussi de croire ce qui est le fondement du devoir, c'est--dire Dieu ? Il semble que l'on ne soit pas forc philosophiquement d'aller plus loin. Cependant, ne peut-on pas dire
encore que la religion naturelle, n'ayant d'autre fondement que les assertions obscures et contradictoires du sens commun, n'offre pas non
plus, son tour, une garantie bien solide, si elle ne s'appuie pas sur la
religion rvle ? Le devoir de croire la religion naturelle nous conduit donc un autre devoir, qui est de croire la religion rvle, le
seul fondement solide de la religion naturelle. On sait enfin que, dans
la religion rvle elle-mme, la certitude et l'autorit paraissent insuffisamment tablies dans une glise qui prendrait pour principe le libre
examen. D'o cette consquence, que la certitude morale n'est garantie
que par l'adhsion au dogme catholique et l'autorit suprme et infaillible du chef de la catholicit.
Voil les droits de la croyance bien garantis. Soit ; mais que deviendraient les droits de la science ? La philosophie serait alors rduite n'tre plus que l'exgse, le commentaire de la vrit chrtienne et mme catholique. Ce ne serait plus qu'une scolastique. Les
plus grands penseurs n'auraient plus qu' se taire. Un Spinoza, un
Hume, un Kant, ne seront plus que des sophistes qui n'auront plus le
droit de cit en philosophie. Bien plus, les penseurs chrtiens ne seront pas eux-mmes l'abri de toute suspicion. Un Malebranche sera
suspect, parce qu'il pousse au dterminisme ; un Pascal, parce qu'il ne
craint pas de se faire une arme du scepticisme ; un Descartes luimme, parce que, par son automatisme, il a ouvert la voie la doctrine
des actions rflexes, si dangereuse pour la libert humaine.
[89]
Ainsi, si l'on part de la science, on menace les organes et la vie
morale ; si l'on part de la croyance, on menace la science et on renie la
philosophie. Qui dmlera cet embrouillement ? Essayons une solution.
Je ne crois pas que l'on puisse esprer de rconcilier la foi et la
science si l'on commence par les sparer. La foi sans la science est
aveugle ; la science sans la foi est vide. C'est donc l'origine mme et
dans le premier acte de science que l'on doit rencontrer les deux prin-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
88
cipes runis l'un l'autre dans une unit invisible. Autrement l'on sera
toujours en prsence de ce dilemme : ou sacrifier la science la
croyance, ou la croyance la science. Je me demande aussi si l'on
peut admettre deux certitudes htrognes d'origine diffrente, la certitude logique et la certitude morale, et s'il ne faut pas essayer de rtablir l'unit de certitude, principe mme de la recherche.
Or, nous sommes parti de l'ide de la science. C'est donc en analysant cette ide que nous devons trouver en mme temps le principe de
la croyance.
La science a pour objet de savoir, et l'objet du savoir est la vrit ;
enfin la vrit n'a d'autre signe que l'vidence ; et le seul moyen de
dcouvrir l'vidence, c'est de la chercher ; et le seul moyen de la chercher, c'est l'examen. De la ce principe que la libert d'examen est la
condition sine qua non de la science.
La libert d'examen n'est considre en gnral que du ct ngatif.
On n'y voit autre chose qu'un instrument de division et d'anarchie, un
principe d'individualit et de rvolte. La libert d'examen ne parat
autre chose que la libert de ne pas penser comme les autres, de ne pas
se soumettre l'autorit, de ne pas accepter les opinions reues. C'est
l, en effet, un des caractres de la libert de penser : N'admettre
comme vrai que ce qui parat vident , selon le mot de Descartes,
c'est bien en effet s'affranchir de l'autorit. Mais ce n'est l qu'une partie du principe cartsien : c'en est le ct ngatif. Mais il y a une autre
partie du mme [90] principe qui en est la partie positive. En effet,
ct du droit d'examen, il y a le devoir d'examen ; or ce devoir est absolu comme le droit. Lorsque Descartes fait appel l'vidence pure, il
n'entend pas par l que nous devons nous affranchir des opinions d'autrui pour ne plus penser que ce qu'il nous plaira. Il enseigne en mme
temps que nous devons nous affranchir des sens, de l'imagination et
des passions, dont l'office n'est pas de nous faire connatre la vrit, et
qui au contraire sont des obstacles toute vrit. S'affranchir du joug
intrieur de la passion, en mme temps que du joug extrieur de
l'autorit, voil ce que comporte la rgle de l'vidence. Dans la rgle
mme donne par Descartes, le devoir est exprim aussi bien que le
droit, lorsqu'il dit : viter la prcipitation et la prvention. La Recherche de la vrit, de Malebranche, o l'auteur tudie toutes les
causes d'erreur, et notamment les sens, l'imagination et les passions,
est le complment ncessaire du Discours de la Mthode.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
89
Il est remarquer que ceux qui sont les moins disposs pour la libert d'examen sont les premiers rclamer le devoir d'examiner.
Sans cesse ils reprochent aux autres leur lgret, leur ignorance, leurs
prventions, leurs affirmations superficielles. Ils se plaignent qu'on
juge leurs croyances sans les connatre ; ils protestent sans cesse
contre les prjugs. Qu'ils apprennent donc au moins quelle est cette
religion, avant que de la combattre, dit Pascal. C'est bien l un appel
l'examen. Mais en appelant l'examen, on en reconnat par l mme le
droit. Vous ne pouvez en effet imposer le devoir d'examiner sans admettre en mme temps le droit d'examiner.
Ainsi le droit d'examen suppose le devoir ; et le devoir d'examen
suppose le droit. C'est un seul et mme fait ; ce sont les deux faces
d'un acte indivisible ; et si je me demande ce qui est contenu dans cet
acte, j'y trouve un principe absolu, savoir : l'inviolabilit de la pense. Qu'est-ce dire ? C'est que je ne puis pas faire de ma pense ce
que [91] je veux. Je ne puis pas, mme le voulant, la soumettre
l'autorit d'autrui (sauf par des raisons que je crois bonnes et que j'ai
acceptes comme miennes). Je ne puis pas davantage la subordonner
mes caprices, mes dsirs, mes passions. Enfin, je ne puis pas voir
la vrit comme il me plat ; je ne puis la voir que comme elle est. Ma
pense est donc inviolable. Je ne puis pas la traiter comme une chose,
en faire un instrument de bonheur, de fortune, de pouvoir, etc. Voil
ce qui est compris dans l'ide de science.
Imaginez un savant, auteur d'une grande dcouverte introduite par
lui dans la science et qui y rgne sans conteste. Elle porte son nom.
Voil trente ans qu'elle est tablie, et pas un fait n'est venu l'branler.
Supposons maintenant que ce mme savant vienne rencontrer par
hasard, dans son laboratoire, un fait qui, s'il tait vrai, renverserait sa
thorie. Ce fait est un accident ; il s'est rencontr par le plus grand des
hasards ; il est prsumer qu'il ne se prsentera pas d'ici longtemps
aucun observateur. On peut donc le supprimer sans danger. Si notre
savant le fait connatre, sa gloire est perdue, son uvre est dtruite ;
peut-tre encore ce fait n'est pas un fait, mais seulement un soupon.
Vaut-il la peine que l'on s'en occupe ? Laissons d'autres le soin de
l'claircir s'ils le rencontrent. Eh bien ! non. Le devoir du savant est
tout trac. Il faut que lui-mme aille au-devant de ce fait pour le discuter, le fixer et, s'il le faut, le faire connatre aux autres. Laissons de
ct ici les devoirs de l'homme d'honneur, qui rentrent dans la donne
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
90
de la conscience universelle ; bornons-nous au devoir de la recherche
scientifique. Je dis que le savant, en tant que savant, se sent tenu, au
nom mme de la science, de porter la lumire sur ce fait, dt-il dtruire le travail de toute sa vie. S'il ne le fait pas, il n'est pas un savant ; il fait de la science un instrument d'orgueil, au lieu d'en faire un
but. La pense est donc quelque chose d'inviolable.
Maintenant, dans ce principe de l'inviolabilit de la pense, je vois
deux choses :
[92]
La premire, c'est l'excellence de la pense, la supriorit de la
pense sur la matire. En effet, je puis faire de la matire ce que je
veux, je ne puis faire de ma pense ce que je veux. Je puis casser une
pierre en deux, la briser en mille morceaux, la rduire en poussire, en
disperser les lments dans l'espace. Mais je ne puis sparer un attribut d'un sujet, lorsque je vois clairement et distinctement qu'ils appartiennent l'un l'autre. Quand je dis que je ne le puis pas, je veux dire
que je ne le dois pas : car je le puis extrieurement, en exprimant le
contraire de ce que je pense. Je le puis mme intrieurement, en dtournant mon esprit de la vrit qui me dplat et en me tournant du
ct qui me plat. Mais c'est cela mme qui m'est interdit. Sans doute,
dans l'impossibilit o je suis de trouver heure fixe l'vidence absolue, et dans la ncessit d'affirmer pour le besoin de la vie pratique, il
m'arrive souvent, et c'est mme un devoir pour moi, d'affirmer prventivement, c'est--dire de faire prvaloir ma volont dans le conflit des
raisons ; mais il faut toujours que ce soit du ct des raisons prvalentes que ma volont fasse sentir son poids. Mais, dans la pure
science, o je ne suis pas forc d'affirmer, je sens qu'il m'est interdit
de penser une chose par cette seule raison qu'elle me plat. Ma pense
est donc quelque chose d'inviolable. Elle a une dignit en soi qui n'est
pas dans la matire, une excellence qui en fait quelque chose de suprieur aux choses sensibles et phnomnales. Elle appartient donc un
ordre hyperphysique. L'esprit peut donc pntrer au del du pur physique dans un monde d'ordre suprieur. Qu'est-ce autre chose que le
principe mme de la mtaphysique ?
En outre, nous venons de le voir, la seconde chose que contient le
principe de l'inviolabilit de la pense, c'est l'ide du devoir et du
droit. Ds le principe mme, nous avons rencontr l'ide du droit, et
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
91
nous avons vu que le droit est insparable du devoir ; le devoir et le
droit, c'est--dire la morale, sont donc impliqus dans la premire
rgle de la logique, dans l'ide mme de la recherche scientifique.
[93]
Aussi le scientifique nous donne le mtaphysique, et le mtaphysique nous donne le moral sans postulat.
O donc est le conflit entre la science, la mtaphysique et la morale ? Ces trois choses coexistent d'une manire indivisible dans le
premier acte de la science. Libert de la pense, inviolabilit de la
pense, devoir de la pense envers elle-mme, ce sont l trois termes
insparables et identiques.
Si l'on n'admet pas ces principes rgulateurs de la pense coexistant avec la libert mme, on verra que la libert de penser non seulement peut engendrer les paradoxes les plus pouvantables et entrer en
conflit avec la conscience morale, mais qu'elle peut tre logiquement
conduite se nier elle-mme, et qu'elle contient en soi le principe de
sa destruction.
Si, en effet, une certaine dose de libert de penser nous conduit
affirmer que les hommes ne sont que des animaux, et des animaux
malfaisants, pourquoi un degr suprieur de libre pense ne nous conduirait-il pas dire que les hommes devraient, en consquence, tre
gouverns, comme les autres animaux, par la force et par la ruse. Un
Machiavel, un Hobbes, sont de plus libres penseurs qu'un d'Holbach et
qu'un Helvtius. Un ami de ceux-ci, l'abb Galiani, disait franchement
qu'il tait pour le despotisme tout cru. Ainsi la libert aboutirait la
servitude. la vrit, ceux qui parlent ainsi ne parlent pas pour le
peuple, et ils ont en gnral bien soin de s'exempter eux-mmes de la
rgle commune. Servitude pour la foule, libre pense pour euxmmes, voil la formule. Mais l'exprience en a bien vite montr la
vanit. Les libres penseurs s'apercevront bientt qu'ils ne peuvent pas
penser tout seuls, sans que personne s'en aperoive et sans que leurs
penses se rpandent au dehors et envahissent la foule. La socit est
alors atteinte en ses fondements, et la scurit de tous est en pril. Le
vrai penseur ira donc au del ; et il aura le droit d'affirmer que, la pense n'tant qu'un accident sans valeur, il est inutile de lui sacrifier le
repos et le bien-tre de tous les jours. Il pensera donc que la socit a
besoin d'illusions pour continuer vivre, et que ces illusions [94] ne
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
92
peuvent durer lorsque les habiles s'en moquent et s'en dtachent. Il ne
suffit pas de soutenir le trne ; il faut relever l'autel. Celui qui ne va
pas jusque-l est un niais. Il ne pense pas comme il faut. Conclusion :
non seulement interdire la libre pense aux autres, mais se l'interdire
soi-mme. Si l'on veut que la foule croie, il faut faire comme si l'on
croyait soi-mme, et le plus haut degr de la libre pense sera l'hypocrisie. Quelqu'un a dit : Si j'tais athe, je me ferais jsuite. Bien
entendu, je prends le mot de jsuite dans le sens que lui donnent la
tradition et la lgende ; et je ne voudrais infliger personne une injure
immrite. Mais si on prend le mot de jsuite dans le sens vulgaire,
savoir comme une socit d'ambitieux hypocrites chargs d'imposer la
superstition aux masses pour les faire vivre en paix, ce serait l le
comble de la libre pense chez des esprits hardis, qui ne seraient
dupes de rien, et qui, par surcrot, seraient les bienfaiteurs de l'humanit, en lui assurant la scurit sur la terre, et par del l'illusion d'un
bonheur ternel. Si le philosophe a horreur de telles consquences, s'il
est toujours prt a dire hautement : Fiat veritas, pereat mundus, c'est
que pour lui la vrit a une valeur suprieure au monde ; c'est que la
pense, qui nous fait participer la vrit, nous fait participer aussi
l'exprience de cette existence suprieure ; c'est que, comme nous
l'avons dit dj, libert de penser et dignit de l'esprit sont deux
termes insparables ; c'est que la science contient un principe de
croyance.
Ainsi, tandis que la critique de Kant travaille la dissolution de la
mtaphysique, et ne la rtablit ensuite que par un chemin dtourn en
faisant appel la morale, nous croyons au contraire que la critique en
elle-mme implique une mtaphysique et une morale. Elle suppose
que la pense est une fin en soi qui nous commande sans condition. Se
critiquer soi-mme, c'est s'lever au-dessus de soi-mme ; c'est comparer sa propre raison une raison suprieure que nous pouvons ne
pas possder, mais dont il faut que nous ayons l'instinct et le pressentiment pour juger que la ntre non [95] seulement lui est infrieure,
mais encore lui est trangre et htrogne. Kant revient souvent sur
ce que devrait tre ce qu'il appelle un entendement intuitif qui verrait
les choses en soi. Un tel entendement n'aurait pas besoin qu'une matire lui ft donne ; il produirait immdiatement ses propres objets ;
pour lui le savoir et le croire, le vouloir et le devoir, le mcanisme et
la finalit se confondraient. N'est-ce pas l en dfinitive avoir une cer-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
93
taine ide de cette raison absolue ? Une critique qui sait si bien ce qui
nous manque n'est-elle donc pas rattache par quelque lien ce principe suprasensible dont elle sent si nergiquement le besoin ? C'est par
l, c'est par cet lment divin qui est en elle que la pense se sent inviolable et sacre. C'est pourquoi elle n'a rien craindre de la libert,
qui ne peut que la ramener sa source quand elle s'en sert comme il
faut.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
94
[96]
Introduction la science philosophique
Leon VI
CLASSIFICATION
DES SCIENCES
Retour la table des matires
Messieurs,
Aprs les considrations gnrales qui prcdent, et qui sont en
quelque sorte l'entour de la philosophie, il nous faut maintenant serrer la question de plus prs, et nous demander avec plus de prcision
ce que c'est que la philosophie, et quel est son objet. Voici la mthode
que nous emploierons pour le dterminer.
Cette mthode sera de passer en revue les divers objets de nos connaissances, ainsi que les sciences universellement reconnues qui s'occupent de ces objets. Que si, aprs avoir puis l'numration de
toutes ces sciences, il reste encore un objet qui n'a pas t nomm, cet
objet pourra tre considr comme un bonum vacans qui appartiendra
qui voudra s'en emparer. La ncessit d'une science de plus sera dmontre, et il ne s'agira plus que de savoir si cette science nouvelle
n'est pas prcisment ce qu'on appelle la philosophie elle-mme. 6
Nous croyons avoir t le premier a indiquer d'employer cette mthode, soit
dans notre Trait lmentaire de philosophie, soit, longtemps auparavant, en
1864, dans notre cours de la Sorbonne. (Voir la Revue littraire.)
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
95
La dtermination de l'objet de la philosophie supposera donc une
classification, ou du moins une numration de diverses sciences.
Nous exposerons d'abord les classifications les plus importantes et les
plus connues.
I. Classification d'Aristote.
Retour la table des matires
Aristote fonde sa classification des sciences sur une distinction
[97] psychologique. Il distingue trois oprations de l'esprit : savoir,
agir et faire. Savoir consiste connatre purement et simplement, sans
aucune opration de la part du sujet. Agir consiste dans une opration
interne qui ne sort pas du sujet ; faire, dans une opration interne qui
produit quelque chose en dehors du sujet. De l trois ordres de
sciences : les sciences thortiques, les sciences pratiques et les
sciences potiques. Ces deux dernires s'appliquent des objets qui
peuvent tre ou ne pas tre, ou encore tre autrement qu'ils ne sont,
par consquent des objets contingents. Les sciences thortiques ont
pour objet les choses qui ne peuvent tre autrement qu'elles ne sont,
par consquent s'appliquent des objets ncessaires.
Considrons d'abord les sciences potiques. Elles ont pour objet la
production de quelque chose qui est, ou peut subsister en dehors du
sujet : par exemple, une maison, un tableau, ou mme un discours et
un raisonnement. Elles sont au nombre de trois : la Potique, la Rhtorique, la Dialectique. La potique a pour objet les pomes ; la rhtorique, les discours ; la dialectique, les arguments.
Les sciences pratiques, qui ont pour objet l'action, sont galement
au nombre de trois, suivant qu'elles considrent l'individu, la famille
et l'tat. Ce sont l'thique, l'conomique et la Politique.
Enfin les sciences thortiques sont encore au nombre de trois : les
Mathmatiques, la Physique, la Philosophie premire ou Thologie.
La physique est la science de la nature ou du mouvement ; les mathmatiques ont pour objet les tres immobiles, et la nature en tant qu'elle
est indpendante du mouvement. La philosophie premire ou mtaphysique a pour objet la cause du mouvement.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
96
Tel est le tableau des sciences. Quel est maintenant l'ordre dans lequel elles doivent tre places, c'est--dire leur hirarchie ? Cette hirarchie peut tre considre un double point de vue. Il faut distinguer l'ordre au point de vue [98] de la connaissance et l'ordre au point
de vue de l'existence.
Au point de vue de la connaissance, il faut aller de la potique la
pratique, et de la pratique la connaissance thorique. Au point de
vue de l'tre, c'est--dire du rapport interne des choses, il faut aller au
contraire de la thortique la pratique et de la pratique la potique ;
de mme pour les sous-divisions : au premier point de vue, on ira de
la potique la rhtorique, et de la rhtorique la dialectique ; de la
morale l'conomique, et de l'conomique la politique ; enfin de la
physique aux mathmatiques, et des mathmatiques la philosophie
premire.
Au point de vue de l'tre, au contraire, il faut suivre la marche inverse, et redescendre de la philosophie premire aux mathmatiques,
des mathmatiques la physique ; de la politique l'conomique, de
l'conomique la morale ; enfin de la dialectique la rhtorique, et de
la rhtorique la potique.
C'est l sans doute un plan de classification trs savant et trs ingnieux. Il rpondait aux faits, l'poque d'Aristote ; aujourd'hui, il n'est
plus en rapport avec l'tat des sciences. En effet, on peut dire que la
potique, depuis Aristote, n'a pris aucune extension. Elle aurait perdu
plutt en intrt et en tendue. La potique proprement dite n'est
presque plus rien ; la rhtorique, pas grand'chose. La dialectique seule
a conserv sa valeur ; mais c'est en se fondant avec la logique, qui appartient plutt au groupe des sciences thortiques.
Au contraire, les sciences thortiques ont pris un accroissement
considrable. Ce n'est pas trop s'avancer que de dire que leur domaine
a centupl. Les mathmatiques ont vu se produire dans leur sein un
grand nombre de sciences nouvelles : l'algbre, la mcanique, la gomtrie analytique, le calcul intgral, le calcul des probabilits, etc. La
physique, y compris la biologie, est devenue un champ immense et
sans fin. On a le droit de se demander si la potique, la rhtorique [99]
et la dialectique runies peuvent faire contrepoids cet norme amas
de sciences nouvelles, qui sont venues enrichir la connaissance thorique. Il y a l une disproportion choquante. Quand mme on conser-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
97
verait les divisions d'Aristote, la difficult reviendrait tout entire, rien
que pour le classement des sciences thortiques.
D'ailleurs, que faut-il entendre par sciences potiques et sciences
pratiques ? Sont-ce des sciences qui donnent des rgles pour agir ?
Mais alors ce sont des arts, et chaque science a son art. La mcanique
et l'industrie correspondent la physique, l'agriculture l'histoire naturelle, la mdecine la physiologie. Ces diffrents arts ne devraientils pas rentrer dans la science de la production et de l'action ? Les
animaux eux-mmes produisent et agissent. La vie mme, suivant
Aristote, est une sorte de . Il faudrait donc largir le cadre, sparer les arts des sciences, et classer les uns comme les autres. Mais
ce serait alors un rtrcissement singulier de la classification.
II. Classification de Bacon.
Retour la table des matires
Bacon, comme Aristote, part d'une distinction psychologique, mais
un autre point de vue. Aristote avait considr les oprations de l'esprit ; Bacon considre les facults. Il en constate trois principales : la
mmoire, l'imagination, la raison. D'o il tire trois classes de sciences
ou d'arts ; l'histoire, la posie, l'imagination.
La mmoire a pour objet les individus ; l'imagination aussi, mais
les individus composs fictivement. La raison a pour objet les notions
abstraites et gnrales.
L'histoire est divise en deux genres : l'histoire naturelle, qui a
pour objet les actes de la nature ; et l'histoire civile, qui a pour objet
les actes de l'homme.
L'histoire naturelle fournit des matriaux la philosophie ; elle est
une sorte de ppinire pour l'induction. Telles sont, par exemple, les
histoires des corps clestes, des mtores, [100] de la terre et de la
mer, des lments et des espces, plantes, minraux, animaux.
L'histoire civile se divise en histoire de Dieu ou histoire sacre, et
histoire de l'homme ou histoire civile proprement dite.
La posie est narrative, dramatique ou parabolique, ou fiction visible et symbolique : pope, drame et apologue.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
98
La philosophie constitue la science proprement dite : elle a trois
objets : Dieu, la nature et l'homme. Voil trois sciences : la philosophie divine, la philosophie naturelle et la philosophie humaine.
Bacon s'tend peu sur la philosophie divine ou thologie naturelle.
Il insiste sur la philosophie naturelle, qu'il divise en deux parties :
thorique et pratique. La philosophie thorique se divise en deux : la
physique, qui a pour objet la matire et la cause efficiente ; et la mtaphysique, qui a pour objet la cause formelle et la cause finale.
La philosophie naturelle se divise aussi en deux parties : la mcanique et la magie.
la physique, Bacon adjoint comme appendice et dpendance les
mathmatiques ; c'est l'un des vices de son systme de n'avoir pas
compris l'importance de cette science.
Quant la philosophie humaine, elle se divise en deux : doctrine
de l'me et doctrine du corps. La premire se divise son tour en logique et en morale.
Bacon couronne le tout par la thologie rvle.
D'Alembert, au XVIIIe sicle, dans sa belle prface de l'Encyclopdie, a modifi sur quelques points la classification de Bacon : 1 quant
l'ordre, il passe de la mmoire la raison et de la raison l'imagination, par consquent de l'histoire la philosophie et de la philosophie
la posie. Dans la philosophie il passe de Dieu l'homme, et de
l'homme la nature ; 2 quant la nature des sciences, le point capital ! c'est qu'au lieu de faire des mathmatiques un simple appendice
de la physique, il en fait au contraire la premire partie.
La classification de Bacon est artificielle et assez peu originale.
[101] Elle est surtout intressante par le dveloppement. Ce vaste tableau dans lequel nous passons en revue toutes les sciences, y compris
celles qui n'existent pas encore, est une construction trs riche et trs
fconde en aperus. Elle a suffi longtemps pour mettre en un certain
ordre les connaissances humaines ; mais elle ne rsiste pas l'examen
et la critique.
D'abord il est vident que la posie n'est pas une science et qu'elle
ne doit pas avoir sa place dans le tableau des sciences ; ou alors il faudrait aussi classer les autres arts, peinture, sculpture, architecture, dont
Bacon ne parle pas. Les subdivisions de la posie sont arbitraires, et il
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
99
n'est pas admissible que l'apologie ou la parabole fassent contrepoids
au drame ou l'pope.
La mmoire joue un rle dans toutes les sciences, mais elle n'est le
principe spcial d'aucune d'elles. Ce n'est point par la mmoire que
l'on fait l'histoire civile, c'est par le tmoignage. Ce n'est point par la
mmoire que l'on traite l'histoire naturelle, c'est par l'observation. Enfin il est artificiel de ranger dans le mme groupe l'histoire naturelle et
l'histoire civile.
La collection des faits (Sylva sylvarum) n'est pas une science spare : c'est le vestibule de toutes les sciences ; aussi voit-on dans Bacon
le premier groupe, savoir l'histoire, se perdre et se fondre dans le
second, c'est--dire la philosophie.
Ce dernier groupe, la rigueur, devrait tre le seul. La division est
simple : Dieu, la nature et l'homme ; et cette division devra se retrouver dans une classification ; mais elle est bien gnrale, et dans le dtail de cette division il y a bien des mprises. La thologie naturelle ne
doit pas tre spare de la mtaphysique, dont elle n'est qu'une partie ;
et rciproquement la mtaphysique n'est pas une partie de la philosophie naturelle. Une autre erreur grave que nous avons dj signale,
c'est le trop peu d'importance donne aux racines mathmatiques.
[102]
III. Classification d'Ampre.
Retour la table des matires
La plus savante de toutes les classifications des sciences, mais aussi la plus artificielle, est celle d'Ampre. Elle a demand un travail
prodigieux ; mais, except quelques grandes lignes, on ne voit pas
trop ce qui peut en rester, tant elle est complique et difficile suivre.
Le principe fondamental est qu'il y a deux sortes d'objets : 1 le
monde de la matire ; 2 le monde de la pense. De l deux groupes
de sciences : les sciences cosmologiques et les sciences noologiques.
Ampre ne justifie pas cette division. Il se contente de dire qu'elle repose sur des ides gnralement reues, qu'il n'est pas besoin de discuter ou de dmontrer. S'il et su qu'en mme temps que lui un autre
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
100
philosophe, Auguste Comte, proposait une classification des sciences
fonde sur un principe absolument contraire, il n'et pas pass aussi
rapidement sur ces notions prliminaires.
Ampre calque sa classification sur celle des sciences naturelles. Il
procde par rgnes, embranchements, ordres, sous-ordres, classes, etc.
Les deux domaines indiqus plus haut, savoir la matire et la
pense, forment des rgnes, qui se subdivisent d'abord en sous-rgnes.
Sciences cosmologiques. Premier sous-rgne : sciences cosmologiques proprement dites, ayant pour objet la matire inorganique.
Deuxime sous-rgne : sciences physiologiques ayant pour objet la
matire vivante.
Sciences noologiques. Premier sous-rgne : sciences noologiques
proprement dites. Deuxime sous-rgne : sciences sociales.
Chaque sous-rgne se divise en deux embranchements, chaque
embranchement en deux sous-embranchements ; puis en sciences du
premier ordre, sciences du deuxime ordre, sciences du troisime
ordre.
Pour plus de clart, suivons l'un des termes de la division ; [103]
par exemple le sous-rgne des sciences cosmologiques comprend
deux embranchements : 1 la mathmatique ; 2 la physique.
L'embranchement des mathmatiques donne naissance deux
sous-embranchements : 1 les mathmatiques proprement dites ; 2 la
physico-mathmatique.
Chacun des sous-embranchements se subdivise en deux sciences
du premier ordre : 1 arithmtique ; 2 gomtrie. Chaque science du
premier ordre se divise en deux sciences du second ordre : 1 arithmtique lmentaire ; 2 mgathologie. Chaque science du second ordre
se divise en deux sciences du troisime ordre : par exemple, l'arithmtique lmentaire en arithmographie et analyse mathmatique ; de
mme la mgathologie en thorie des fonctions et calcul des probabilits.
Si nous passons aux sciences noologiques, qui nous intressent davantage, nous trouvons deux embranchements : 1 sciences philosophiques ; 2 sciences nootechniques. Les sciences philosophiques se
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
101
divisent en deux sous-embranchements : 1 philosophiques proprement dites ; 2 sciences morales.
Les premires (philosophiques) comprennent deux sciences du
premier ordre : 1 psychologie ; 2 ontologie.
Les secondes (morales), galement en deux sciences du premier
ordre : 1 l'thique ou science des murs ; 2 la tlologie ou morale
thorique.
Les sciences du premier ordre en engendrent deux du second ordre.
Par exemple la psychologie se divise en : 1 psychologie lmentaire ;
2 psychogonie ; et de ces deux sciences de deuxime ordre, la premire, la psychologie lmentaire, en engendre deux du troisime : 1
la psychographie ; 2 la logique. La seconde, ou psychogonie, engendre : 1 la mthodologie ; 2l'idognie.
Nous ne pouvons donner ici que quelques exemples, car la classification dans son ensemble, comprenant deux volumes, ne peut tre reproduite en entier. Examinons seulement le fil [104] conducteur
qu'Ampre nous propose comme l'ayant guid lui-mme dans cette
recherche, et qui est celui-ci : les sciences ne doivent pas tre classes
seulement quant la matire, mais encore quant au point de vue. Principe du reste assez arbitraire, et qui tend morceler les diverses parties d'une mme science, pour les faire obir aux distinctions abstraites qui n'existent que dans notre esprit.
Quoi qu'il en soit de cette rserve, on distinguera d'abord deux
points de vue : 1 les phnomnes ou les objets en eux-mmes ; 2 les
lois et les causes. Par exemple, deux espces de physique : 1 la physique lmentaire ; 2 la physique mathmatique.
De plus, chacun de ces deux premiers points de vue sera divis en
deux : 1 le point de vue apparent ; 2 le point de vue cach ; et l'un et
l'autre dans les deux catgories prcdentes. D'o ce tableau :
1er groupe :
1 Autoptiques, les phnomnes au point de vue apparent.
2 Cryptoristiques, les phnomnes au point de vue cach.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
102
2me groupe :
1 Troponomiques, lois et causes de changement.
2 Cryptologiques. Recherche de ce qu'il y a de plus cach. 7
Si nous passons l'examen de cette classification d'Ampre, nous
approuvons d'abord la premire division fondamentale en sciences
cosmologiques et en sciences noologiques ; mais cette division n'est
pas assez justifie.
Sans discuter sur la place de chaque science dans le tableau gnral, contentons-nous de dire que le principe gnral nous parat artificiel et arbitraire, savoir la division entre le phnomne et les lois et
les subdivisions de l'apparent et du cach. Il nous semble que l'application de ces quatre points de vue ne peut qu'altrer le vrai rapport des
sciences. En gnral, c'est la mme science qui s'occupe des phnomnes [105] et des lois et qui passe du point de vue apparent au point
de vue cach.
En outre, cette distinction ne s'applique pas aux embranchements.
En effet, le second groupe (les sciences naturelles) ne reprsente pas
des lois ou des causes par rapport au premier (sciences cosmologiques
proprement dites). De plus, on ne voit pas que la physique soit plus
cryptologique que la mathmatique, et que les sciences mdicales le
soient plus que les sciences naturelles. Sans doute la mdecine est plus
difficile apprendre que l'histoire naturelle, parce qu'elle est un art ;
mais c'est l un autre point de vue.
C'est surtout la division des sciences en trois ordres que les
quatre points de vue sont venus s'appliquer, mais encore imparfaitement.
Considrons, par exemple, le domaine que nous connaissons le
mieux, celui des sciences philosophiques. Il se divise en deux sousembranchements : 1 la philosophie proprement dite ; 2 la morale. La
philosophie proprement dite se divise en deux sciences de premier
ordre : la psychologie et l'ontologie. Or la morale ne fournit de lois
que pour la premire, savoir la psychologie. En outre, la mtaphysique ou ontologie fournit des lois pour l'tre en gnral, par cons7
Voir Ampre, tome Ier, p. 43-44.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
103
quent des lois plus leves que celles de la morale. De plus, il faut distinguer les lois et les rgles. La morale donne des rgles ; mais la psychologie contient dj en elle-mme des lois.
Maintenant la morale, qui devrait reprsenter une science de lois et
de causes, contient une premire partie, ethnologie ou science des
murs, c'est--dire de conditions subjectives de l'action : or ce n'est
pas l une science de lois, mais de phnomnes.
En outre, la mtaphysique ou ontologie occupe dans cet ordre,
comme les mathmatiques dans l'autre, un rang trop subordonn. Elle
perd son rle de science universelle, de science matresse.
Une autre faute signale plus tard par Auguste Comte, c'est [106]
d'avoir ml les arts et les sciences ; et de plus l'art, quoique venant
aprs la science, ne reprsente pas quelque chose de plus cryptologique que la science. Ainsi la technologie n'est pas cryptologique par
rapport la physique, ni l'agriculture par rapport la gologie et la
botanique, ni la zootechnie par rapport la zoologie. Ce ne sont pas l
des sciences, mais des arts qui ne doivent pas figurer dans un tableau
de ce genre.
La classification d'Ampre a donc de trs grands dfauts ; et, malgr l'norme labeur dont elle est la preuve, elle a laiss en dfinitive
trs peu de traces.
IV. Classification d'Auguste Comte.
Retour la table des matires
Auguste Comte commence l'exposition de ses vues sur la classification des sciences par la critique de ses devanciers. 8 Il croit que la
principale cause des checs subis dans cette question tient l'tat confus o sont les diffrentes sciences. Les unes sont arrives ce qu'il
appelle l'tat positif, les autres en tant encore l'tat thologique et
mtaphysique : premire cause d'chec. Une seconde, c'est que la plupart des classifications ont confondu deux sortes d'objets, les sciences,
et les arts. Mais il faut distinguer la spculation et l'action. Dans une
8
Cours de philosophie politique, 2e leon.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
104
classification des sciences, on ne doit tenir compte que de la spculation. Sans doute l'action repose sur la spculation, mais ce serait se
faire une ide trs imparfaite des sciences que de n'y voir que la base
des arts. La science repose sur un besoin plus lev, un besoin fondamental de l'intelligence, celui de connatre les lois des phnomnes.
Ce qui le prouve, c'est l'tonnement et mme la frayeur que nous
prouvons lorsque nous rencontrons un phnomne qui se produit ou
semble se produire en dehors des lois de la nature, tant notre esprit
croit instinctivement l'uniformit de ces lois.
[107]
Auguste Comte combat donc trs nergiquement la doctrine que
les sciences doivent avoir une utilit immdiate. On ne peut d'ailleurs
prvoir jamais l'utilit d'une dcouverte quelconque de la science ; et,
comme le dit d'Alembert, l'art de la navigation ayant t renouvel par
l'application de la thorie des sections coniques, le matelot qu'une
connaissance exacte de la longitude prserve du naufrage, doit la vie
un thorme d'Archimde ou d'Apollonius .
En consquence, le systme des sciences tant la base de celui des
arts, c'est par le premier qu'il faut commencer.
D'ailleurs, chaque art exige la runion de plusieurs sciences. par
exemple, l'agriculture exige la gologie, la botanique et la chimie ; la
pdagogie suppose la morale, l'hygine, la mdecine. Il est donc indispensable que le systme des sciences soit fond avant qu'on puisse
organiser le systme des arts.
Maintenant, mme en se bornant aux sciences proprement dites,
c'est--dire la pure thorie, il faut faire de nouvelles distinctions : 1
les sciences abstraites, qui ont pour objet la dcouverte des lois ; 2
les sciences concrtes et particulires, principalement descriptives, qui
sont des applications de ces lois aux tres naturels existants. Par
exemple, la physiologie gnrale a pour objet l'tude des lois de la
vie ; la botanique et la zoologie sont l'tude des tres rels dans lesquels ces lois gnrales sont ralises. La chimie est l'tude des lois de
la composition et de la dcomposition des corps ; la minralogie est
l'tude des corps rels qui rsultent de ces compositions et de ces dcompositions. Dans la premire, les faits n'ont en quelque sorte qu'une
existence artificielle : par exemple le chlore, qui, par l'tendue de ses
affinits, a une grande importance en chimie, n'en a aucune en minra-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
105
logie ; dans celle-ci, au contraire, ce sera le granit ou le quartz qui occuperont le premier rang.
En outre, les sciences concrtes exigent non seulement l'tude de la
science abstraite correspondante, mais de beaucoup d'autres. Ainsi, la
gologie exige non seulement la physique et la chimie, mais l'astronomie, la palontologie, etc.
[108]
En rsum, le domaine de la science se composant de sciences spculatives et de sciences pratiques ou d'arts, on ne classera que les
sciences spculatives. Les sciences se divisant en sciences abstraites et
sciences concrtes, on ne classera que les sciences abstraites, que
Comte appelle sciences fondamentales.
Si maintenant on procde la classification de ces sciences fondamentales, il est impossible qu'il n'y ait pas quelque arbitraire, car en
principe on devrait les enchaner dans leur ordre naturel de telle sorte
que l'on puisse les exposer successivement sans faire de cercles vicieux ; mais c'est ce qui est impossible.
En effet, il y a dans toute science deux marches distinctes : la
marche historique, la marche dogmatique ; tout autre mode d'exposition n'est que la combinaison de ces deux-l. Ou bien l'on expose les
connaissances dans l'ordre o l'esprit humain les a dcouvertes ; ou,
au contraire, on les expose dans l'ordre interne et logique qui les unit
entre elles. Cette seconde mthode, ou exposition dogmatique, ne peut
avoir lieu que lorsque la somme des connaissances est assez tendue
pour pouvoir tre expose didactiquement. La premire mthode est
d'autant plus facile, et la seconde d'autant plus difficile, que la somme
des connaissances est plus ou moins vaste. Par exemple, il serait impossible d'exposer aujourd'hui la physique d'une manire historique ;
au contraire, telle science rcente, par exemple la microbiologie, ne
peut tre encore expose que d'une manire historique. Il y a toujours
cependant dans toute science une partie historique : c'est celle des travaux les plus rcents ; et d'ailleurs le mode dogmatique a le grand inconvnient de ngliger la manire dont les connaissances se sont formes, si important pour l'histoire de l'esprit humain.
Mais ce n'est pas la mme chose d'exposer une science suivant le
mode historique, ou de faire l'histoire de cette science. L'histoire des
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
106
sciences ne peut tre qu'une partie du dveloppement de l'histoire gnrale. De plus, aucune science [109] ne s'est dveloppe sparment.
Impossible de comprendre l'histoire de la physique sans l'histoire de
l'astronomie, des mathmatiques et de la mcanique. De plus, on ne
peut comprendre l'histoire d'une science si l'on ne sait pas cette
science ; et en outre, dans la mme science, les diverses parties se sont
dveloppes simultanment. Ainsi le mode historique ne peut tre introduit que d'une manire secondaire et provisoire dans l'exposition
d'une science, et doit constituer plus tard une science distincte, faisant
partie de l'histoire.
Auguste Comte expose ces vues pour qu'on ne se mprenne pas sur
ce qu'il appelle l'ordre et la dpendance des sciences fondamentales. Il
ne s'agit point d'un ordre purement historique ; car telle science place
avant telle autre peut avoir eu besoin de celle-ci pour telle ou telle de
ses parties. Ainsi l'astronomie, quoique antrieure la physique,
comme plus simple, a cependant besoin de l'optique. Il s'agit d'une
conformit gnrale entre l'ordre indiqu et l'histoire scientifique de
l'esprit humain, en prenant pour base l'enchanement logique naturel,
lequel doit avoir un certain rapport, sinon dans le dtail, au moins
dans l'ensemble, avec l'ordre historique : car l'espce, comme l'individu, a d aller du simple au compos, du plus facile au plus difficile.
Il s'agit donc, pour classer et coordonner les sciences, de considrer les diffrents ordres de phnomnes et la dpendance respective de
ces diffrents ordres. Les sciences doivent tre entre elles comme les
phnomnes eux-mmes.
Comte tablit donc la loi suivante, savoir que les phnomnes les
plus simples sont en mme temps les plus gnraux, ce qui est presque
une proposition identique : car ce qui se reproduit le plus souvent est
par l mme le plus indpendant des circonstances particulires, et par
consquent le plus simple. Les sciences devront donc se produire et se
suivre en raison de leur ordre de simplicit et de gnralit ; et, le plus
simple tant en mme temps le plus facile, le mme ordre doit indiquer approximativement l'ordre de leur dveloppement.
[110]
D'aprs ces considrations, on divisera les phnomnes en deux
groupes : 1 les phnomnes des corps bruts ; 2 les phnomnes des
corps vivants ; or, ceux-ci, tant plus compliqus que ceux-l, doivent
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
107
en dpendre ; ceux-l au contraire ne dpendent pas des seconds.
Donc les phnomnes physiologiques ou biologiques ne doivent tre
tudis qu'aprs les phnomnes inorganiques.
Cette distinction entre la matire brute et la matire vivante n'implique d'ailleurs aucune distinction essentielle de nature entre ces deux
matires. C'est l une question de mtaphysique qui n'est pas du domaine de la philosophie positive, laquelle ne sait rien de la nature intime des choses. Mais il y a, mme empiriquement, une distinction
suffisante entre les corps vivants et les corps bruts ; et quand mme on
devrait ultrieurement ramener les uns aux autres, la division n'en
subsisterait pas moins ; car parmi ces phnomnes, les uns seraient
toujours plus gnraux que les autres et devraient toujours les prcder.
Il y aura donc deux physiques : 1 la physique inorganique ; 2 la
physique organique.
La physique inorganique se divise son tour en deux parties, suivant qu'elle tudiera les phnomnes gnraux de l'univers, ou physique cleste (astronomie) ; ou les phnomnes particuliers de la terre,
physique terrestre.
Or les phnomnes astronomiques tant les plus gnraux et les
plus simples sont impliqus dans la physique terrestre (par exemple la
loi de la gravitation) ; tandis que les phnomnes de la physique terrestre ne sont pas impliqus dans les premiers. Le phnomne physique le plus simple est plus compliqu que les phnomnes astronomiques les plus compliqus ; d'o il suit que la physique cleste viendra, dans l'ordre des sciences, avant la physique terrestre.
Celle-ci son tour se divisera aussi en deux parties : 1 la physique
au point de vue mcanique ; 2 la physique au point de vue chimique.
La distinction approfondie de ces deux ordres de phnomnes viendra
plus tard dans le systme [111] d'Auguste Comte, lorsqu'il arrive
l'exposition gnrale de ces diffrentes sciences. Ici, il nous suffit de
la connaissance vulgaire que nous avons tous sur la distinction de la
physique et de la chimie.
Or, les phnomnes chimiques sont plus compliqus que les phnomnes mcaniques, et ils contiennent quelque chose de plus ; et cela
serait encore vrai, dit Auguste Comte, lors mme que tous les phno-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
108
mnes chimiques seraient expliqus un jour par la physique ; ce serait
toujours un cas plus compliqu, qui, tout en supposant la connaissance
des plus simples, constituerait cependant un domaine diffrent.
Mme division dans la physique organique. Ici encore, deux sortes
de phnomnes : l'individu et l'espce, et l'espce considre surtout
en tant que sociable : c'est surtout dans l'homme que cette division est
fondamentale. Dans les phnomnes sociaux on voit se manifester les
lois physiologiques qui gouvernent l'individu (par exemple l'hrdit),
ce qui n'implique nullement que les phnomnes sociaux ne soient
qu'un cas particulier des phnomnes physiologiques. Ce sont des
phnomnes homognes, non identiques. Les faits sociaux ont un caractre propre et essentiel. Il y aura donc une physique sociale distincte de la physiologie proprement dite.
On pourrait aller sans doute plus loin et diviser la physique organique en deux branches distinctes, vgtale et animale, et l'on trouverait encore que la premire doit prcder la seconde. Mais cette division appartient plutt au domaine de la physique concrte, et a peu
d'importance au point de vue de la physiologie gnrale.
Il y aura donc jusqu'ici cinq sciences fondamentales et subordonnes les unes aux autres, en raison de leur simplicit ou gnralit respectives. Ces cinq sciences sont : l'astronomie, la physique proprement dite, la chimie, la physiologie ou biologie, la sociologie.
On remarquera que dans la premire leon d'Auguste Comte, o se
trouve expose la classification prcdente, l'auteur a omis volontairement, pour la considrer part, une classe de [112] faits et de
sciences qui sont cependant de la plus haute importance, et qui sont la
base du systme : ce sont les sciences mathmatiques. Il les a mises
part, prcisment parce qu'il lui tait impossible d'en donner, comme
pour les autres sciences, une ide suffisante en quelques mots, et en
s'en rfrant aux ides de tout le monde. Tout le monde comprend la
diffrence de l'organique et de l'inorganique, de l'individu et de la socit, et aussi, quoique un peu plus difficilement, la diffrence du
point de vue physique et du point de vue chimique. Il n'est pas aussi
facile de faire comprendre ce que c'est que les mathmatiques et ce
qu'il y a de commun entre toutes les sciences qui portent ce nom. Aus-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
109
si est-ce l'objet d'une recherche spare 9 dans la doctrine d'Auguste
Comte. Mais, sans nous engager dans cette recherche, qui nous dtournerait de notre objet, contentons-nous de constater, avec Auguste
Comte, qu'il y a une classe de sciences appeles mathmatiques qui
ont pour objet le nombre et l'tendue, que ces sciences tudient les
faits les plus gnraux et les plus simples, qu'elles sont par consquent
antrieures toutes les autres, que l'astronomie elle-mme les suppose
et en dpend.
Il reste donc six sciences fondamentales : 1 les mathmatiques ;
2 l'astronomie ; 3 la physique ; 4 la chimie ; 5 la biologie ; 6 la
sociologie.
Auguste Comte, aprs avoir expos cette classification, en fait ressortir l'importance aux quatre points de vue suivants : 1 la conformit
de ce plan avec l'ordre naturel et habituel adopt par les savants, et qui
doit reprsenter, vraisemblablement l'ordre des choses : car il est
prsumer qu'ils ont t dtermins spcialiser leurs tudes d'aprs les
diffrences les plus saillantes des phnomnes ; 2 la conformit avec
le dveloppement de la science elle-mme ; 3 le degr de perfection
relative de chaque science, qui est en raison directe de la simplicit et
en raison inverse de la complexit des phnomnes ; 4 enfin cet ordre
nous donne la place d'une [113] ducation scientifique rationnelle, qui
doit, elle aussi, commencer par les tudes les plus simples et s'lever
par degrs aux plus composes.
Le principal mrite de cette classification, l'une des parties les plus
solides de la philosophie d'Auguste Comte, c'est la clart et la nettet.
Nul doute que si on renonce d'une part la distinction du subjectif et
de l'objectif ; si, d'un autre ct, on rejette absolument toute notion
d'absolu et par consquent toute mtaphysique, il n'y a pas d'autre
classification possible que celle d'Auguste Comte. Nous allons voir en
effet que M. Herbert Spencer a plutt gt que perfectionn le systme
en essayant d'en changer les distributions intrieures sans en changer
le principe fondamental.
A. Comte, Cours de philosophie positive, 3e leon.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
110
V. Classification d'Herbert Spencer.
Retour la table des matires
Herbert Spencer a donc critiqu la classification d'Auguste Comte
et en a substitu une nouvelle dont voici les bases :
Il tablit d'abord deux grandes classes de sciences : 1 celles qui se
rapportent aux relations des choses ; 2 celles qui se rapportent aux
phnomnes et aux choses elles-mmes.
La premire classe porte donc sur les relations ou les formes vides
des choses : 1 sur les relations les plus gnrales, par exemple la logique ; 2 sur des relations gnrales encore, mais plus dtermines :
l'espace et le temps ; ce sont les mathmatiques.
La seconde classe se divise son tour en deux : 1 ou bien on tudie les modes des choses sparment ; 2 ou bien on les tudie en tant
qu'ils composent le phnomne total.
En tout, trois ordres de sciences : 1 les sciences abstraites ; 2 les
sciences abstraites-concrtes ; 3 les sciences concrtes.
Spencer distingue sa dfinition des sciences abstraites de celle
d'Auguste Comte. Celui-ci confond l'abstrait et le gnral ; et pour lui,
la mme science peut tre abstraite ou concrte, selon qu'elle tudiera
les lois gnrales ou les objets particuliers [114] rgis par ces lois. Il y
aura ainsi une mathmatique abstraite et une mathmatique concrte,
une physiologie abstraite et une physiologie concrte.
Pour Herbert Spencer, le mot abstrait a un autre sens et signifie un
fait dtach de la somme des faits qui composent un phnomne complet. L'abstrait, dit Spencer, ne peut tre peru d'aucune manire ; il ne
peut tre que conu. Le gnral, au contraire, peut tre peru dans un
fait particulier. L'abstrait est tir des cas particuliers. Les mathmatiques pures ne sont pas plus abstraites que les mathmatiques appliques. L'abstrait de Comte n'est que le concret gnralis.
Les trois ordres de sciences prcdents se composent de deux
sortes de vrits : les vrits gnrales et les vrits particulires. Ainsi les sciences abstraites comprennent : 1 ce qu'il y a de commun
entre toutes les relations en gnral ; 2 ce qu'il y a de commun entre
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
111
chaque ordre de relations en particulier. De l deux sciences : la logique, qui porte sur les rapports de concidence et de proximit dans le
temps et dans l'espace, abstraction faite de la quantit ; 2 les mathmatiques, qui ont pour but les mmes rapports, mais au point de vue
de la quantit.
La deuxime catgorie, celle des sciences abstraites-concrtes,
porte, non sur des relations, mais sur des choses, et sur les choses
telles qu'elles se manifestent dans leurs modes diffrents, quand
ceux-ci ont t spars artificiellement les uns des autres . Plus concrtes que les premires, plus abstraites que les secondes, elles sont,
par rapport celles-ci, des sciences idales. Par exemple, le mouvement abstrait spar des autres phnomnes physiques (rsistance,
frottement, etc.) est l'objet de la mcanique. Le mouvement concret
(sensible ou non sensible) est l'objet de la physique ou de la chimie. Il
y aura donc, comme dans le premier groupe, deux divisions : 1 des
sciences plus gnrales comprenant des vrits plus gnrales : le
mouvement abstrait ;. 2 des sciences plus particulires contenant des
vrits particulires, [115] par exemple tel ou tel mouvement, avec
redistribution de matire dans la chimie, sans redistribution de matire
dans la physique.
Le troisime groupe a pour objet le rel, c'est--dire la complexit
totale de tous les antcdents et de tous les consquents. Ainsi l'astronomie ne s'occupe pas d'une plante unique, mais de toutes les plantes ; non d'une seule espce de perturbations, mais de toutes les perturbations. Ici encore deux ordres de vrits, les unes plus gnrales,
les autres moins gnrales : 1 les phnomnes tudis dans leurs
lments ; 2 dans leur totalit. Le premier de ces deux groupes aura
pour objet les lois de l'volution (philosophie de Spencer lui-mme) ;
le second, les lois de distribution de la matire et du mouvement dans
les tres rels, suivant cet ordre : astronomie, minralogie, gologie,
physiologie, psychologie, sociologie.
Pour rsumer ce systme obscur et compliqu, ce qui est remarquer c'est que : 1 la classification n'est plus linaire, porte sur une
seule ligne, comme dans Comte ; elle est trinitaire, trichotonique. De
l trois systmes : 1 lois des formes (relations) ; 2 lois des facteurs
(proprits) ; 3 lois des produits (agrgations ou choses).
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
112
Quant au fond, H. Spencer introduit ou plutt rtablit contre Auguste Comte : 1 la logique pure ; 2 la mtaphysique sous le nom de
philosophie de l'volution ; 3 la psychologie subjective ct de la
physiologie ; en un mot, il rintroduit la philosophie tout entire ;
mais, au lieu de lui faire une place part, il l'a mle dans la srie. Or,
ou il n'y a pas de philosophie du tout, et c'est Comte qui a raison ; ou
il y a une philosophie, et elle doit reposer sur des fondements tellement diffrents des autres sciences qu'elle ait une place part. La
question est de savoir si la pense est un simple accident de l'organisation ou une chose en soi, irrductible autre chose et conditionnant le
reste des choses. Dans cette dernire hypothse, la philosophie s'oppose la science comme le moi au non-moi.
[116]
De mme, si la notion d'absolu n'est qu'une fiction de l'esprit, il n'y
a pas de mtaphysique, et les sciences se rduisent aux mathmatiques
et la physique. En supposant mme qu'il y ait une science qui tudie
les conditions gnrales de l'tre (volution ou non), une telle science
n'aura rien de commun avec les autres sciences ; elle n'est pas susceptible de vrification exprimentale ; elle rpond encore quelque besoin d'absolu qui est dans l'esprit et que la science positive ne satisfait
pas. La place d'une telle science est au sommet et non pas au milieu.
Mais si l'on n'admet pas ces considrations, nous avouons que nous
ne saurions trouver aucun avantage dans la classification de Spencer.
Celle de Comte est plus simple, plus claire, plus conforme l'usage.
La distinction de l'abstrait et du gnral telle qu'elle est donne par H.
Spencer est bien subtile et n'a gure d'utilit. Nous admettons que la
division ne doit pas tre linaire, mais c'est la condition qu'on spare
des choses relles, et non des points de vue abstraits.
La classification de Spencer a un autre dfaut : c'est de briser les
cadres des sciences existantes, pour les faire cadrer avec les besoins
de la classification a priori ; c'est aussi ce qu'avait fait Ampre. Auguste Comte se conforme plus l'usage ; et, comme il l'a remarqu
non sans raison, la division spontane des sciences parmi les savants a
d se faire d'aprs le principe de la plus grande diffrence. Ainsi,
quand on ne verrait pas clairement la distinction thorique de la physique et de la chimie, cette distinction n'en existerait pas moins en fait.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
113
Pour nous rsumer sur toutes ces classifications diffrentes, nous
dirons que :
1
La classification d'Aristote est suranne ;
Celle de Bacon, superficielle ;
Celle Ampre, artificielle et complique ;
Celle de Comte, simple et solide, mais incomplte et mutile ;
Celle de Spencer, plus large que celle de Comte, mais encore incomplte, et d'ailleurs complique et artificielle
comme celle d'Ampre.
[117]
Essayons notre tour, en tenant compte de tous les travaux antrieurs, d'esquisser un plan de classification.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
114
[118]
Introduction la science philosophique
Leon VII
CLASSIFICATION
DES SCIENCES (SUITE)
Retour la table des matires
Messieurs,
En vous promettant de vous prsenter un essai de classification des
sciences, je ne me suis nullement engag donner un plan systmatique et complet, semblable celui d'Ampre ou d'Herbert Spencer.
Outre que cette uvre supposerait un travail considrable et que le
temps nous manquerait pour cette entreprise, j'ajoute que, comme je
l'ai dit dj, je n'ai pas beaucoup de foi dans cette sorte de tentative.
L'ide de classer des sciences comme on classe des objets me parat
une ide fausse. Je crois que la classification empirique adopte spontanment par les savants est toujours vraisemblablement la meilleure ;
ainsi, ce que nous avons faire sera de nous attacher seulement
quelques ides philosophiques qui dominent le dbat et prsenter le
plan le plus commode pour nous rendre compte du tableau gnral des
diffrentes sciences et pour arriver dterminer le plan de la philosophie.
La premire question est de savoir si nous admettrons le principe
d'une classification linaire comme celle d'Auguste Comte, ou binaire
comme celle d'Ampre, ou mme trinaire comme celle d'Aristote, Bacon ou Spencer.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
115
Exposons d'abord le dbat entre la classification linaire et la classification binaire.
Voici les raisons que l'on peut faire valoir en faveur de la classification linaire.
L'univers est un, et les phnomnes s'y enchanent dans un ordre
croissant ou dcroissant de simplicit et de complexit. [119] Soit que
l'on considre l'ordre logique et purement abstrait, soit l'ordre historique et gnral, on voit les choses se dvelopper dans l'ordre du
simple au complexe, de l'homogne l'htrogne.
Nous voyons d'abord la nature sous la forme de matire brute, base
ncessaire, substratum premier de tout ce qui doit tre par la suite.
Que la matire soit antrieure la vie, et la base de la vie, c'est ce que
prouvent les considrations suivantes : 1 l'analyse chimique nous
montre que les lments de la matire vivante sont les mmes que
ceux de la matire brute ; 2 l'astronomie et la gologie nous montrent
que la terre a t d'abord impropre la vie, parce qu'elle aurait commenc par un tat d'incandescence o tout tre vivant, au moins dans
les limites de notre exprience, est impossible. Au-dessus de la matire brute vient donc s'lever la matire vivante, qui n'est qu'un compos plus complexe quant la matire, mais qui se manifeste par un
tat nouveau, irrductible jusqu'ici aux lois de la matire brute, et que
l'on appelle organisation. Dans cet ordre nouveau d'existence, deux
sortes d'tres se distinguent : les vgtaux et les animaux. Nous
n'avons pas rechercher si les vgtaux sont antrieurs aux animaux,
ou s'ils sont contemporains ; ni si les espces les plus simples ont prcd les plus composes. Disons seulement que, parmi les espces
animales, il en est une qui est la plus complexe de toutes, et qui a besoin de toutes les autres pour subsister. C'est l'espce humaine, dont
l'tude est ncessairement lie celle de toutes les autres espces animales, et qui sert en mme temps bien faire comprendre la structure
et l'organisation de ces mmes espces.
Ainsi le fait saillant est celui-ci : l'homme est dans la nature ; il fait
partie de la nature ; il contient en lui toutes les formes infrieures. La
structure de son corps est analyse par la chimie organique ; les oprations vitales (digestion, respiration, scrtion), par la chimie physiologique. La physique rend compte des phnomnes de chaleur et d'lectricit qui se passent dans les corps organiss. Enfin la physiologie a
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
116
bien [120] son objet propre : ce sont les conditions mmes de la vie ;
mais elles sont les mmes dans l'humanit et dans l'animalit, et mme
dans la vgtalit.
Maintenant dans l'homme mme apparaissent des phnomnes
nouveaux, savoir les faits d'intelligence et de moralit, et le phnomne suprieur de la sociabilit. Mais l'homme mental et moral a sa
base dans l'homme physique. On ne connat pas d'esprit pur. L'esprit a
pour condition la matire. Il nat, se dveloppe, dfaille et s'vanouit
avec elle. La disparition de l'esprit concide avec la dissolution du
corps ; de plus, les faits propres l'homme, intelligence, dsirs, passions, sociabilit, se retrouvent un moindre degr, mais un certain
degr, dans l'animalit.
De tous ces faits il rsulte que la science de l'homme, mme de
l'homme intellectuel et moral, dpend des conditions tudies par les
sciences antrieures. On voit par l quelles sont les ides qui ont conduit Auguste Comte et ses disciples faire sortir les sciences morales
et sociales des sciences physiques et naturelles, et par consquent
n'admettre qu'une seule ligne de sciences, ligne sur laquelle les
sciences se succdent et se superposent dans l'ordre de complexit des
phnomnes.
Voil donc les raisons qui militent en faveur de la thorie linaire.
Mais considrons les choses sous une autre face, et nous verrons
qu'elles se prsenteront nous d'une manire toute diffrente.
En effet, nous remarquerons que dans cette srie croissante de
phnomnes il y a un point o apparat un fait tout fait nouveau et
htrogne avec tous les autres : c'est le fait de conscience. On parat
tre d'accord aujourd'hui pour ramener tous les phnomnes physiques
au mouvement : or, entre un fait de conscience et un fait de mouvement il y a un abme. Un fait aussi compltement nouveau ne doit-il
pas tre considr comme le point de dpart d'une srie de sciences
d'un tout autre ordre ?
[121]
L'indpendance du subjectif (ou fait de conscience) l'gard de
l'objectif a t mise en pleine lumire par Descartes dans son cogito. Il
a montr que je puis feindre, comme il dit, que le monde corporel
n'existe pas ; mais je ne puis feindre que je ne sois pas, moi qui pense
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
117
et qui doute. Une telle supposition (la non-existence du monde corporel) est peut-tre contraire l'instinct naturel des hommes, mais elle
n'a rien de contraire la logique, et elle fait parfaitement comprendre
la diffrence du subjectif et de l'objectif : l'objectif, dont je puis douter
sans tomber en contradiction avec moi-mme ; le subjectif, dont il
m'est impossible de douter, puisque ce qui douterait en moi ce serait
prcisment ce subjectif mme, dont, par hypothse, on croirait pouvoir douter.
Il ne s'agit pas de savoir si substantiellement et dans l'absolu des
choses le moi est identique ou n'est pas identique au non-moi, mais si,
au point de vue de l'exprience, cette distinction n'est pas donne
d'une manire irrductible.
Le fait de conscience est donc certain, et il se distingue essentiellement de tout ce qui a prcd. De deux choses l'une en effet : ou
bien c'est un fait absolument nouveau, venant s'ajouter au fait naturel
du mouvement, et alors il y a un saltus absolu entre l'un et l'autre, et il
se prsente une nouvelle srie de phnomnes et par consquent une
nouvelle srie de sciences : ou bien on suppose (avec Leibniz) que la
conscience prexiste et accompagne tous les tats physiques, depuis la
matire inorganique jusqu' l'homme. Mais, dans ce cas, le fait de
conscience tant contemporain du fait physique, les deux phnomnes, quoique lis, sont htrognes ds leur origine ; et par consquent, en vertu du principe mme qui fonde la distinction des
sciences, il y a lieu d'admettre deux lignes parallles de sciences : les
sciences de la conscience et les sciences de l'inconscience ; et ce serait
faire une ptition de principe que de tout rduire une seule srie, par
la raison que les deux phnomnes n'en formeraient qu'un seul,
puisque la question finale est prcisment [122] de savoir s'il n'y a l
qu'un phnomne ou s'il y en a deux. C'est donc trancher a priori la
question de l'unit ou de la dualit, que d'tablir une seule ligne de
sciences ; et que l'on ne dise pas qu'tablir deux lignes ce serait trancher la question dans le sens oppos ; non, car la sparation des
sciences ne tranche nullement la question de l'essence mtaphysique
des phnomnes ; ce n'est qu'une prcaution pour sauvegarder l'individualit et l'indpendance des phnomnes, et qui n'exclut rien ultrieurement.
cette premire considration, on peut en ajouter deux autres.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
118
1 Non seulement la conscience est un fait nouveau, et qui, en tant
que fait nouveau, est entirement distinct des faits qui le prcdent,
mais en outre le monde extrieur dont on essaye de faire sortir ce fait
est, au contraire, lui-mme tributaire et dpendant du fait de conscience. En effet, ce monde extrieur ne nous est connu que par nos
sensations, et il est en quelque sorte le produit de nos sensations. Peu
importe qu'il soit ou qu'il ne soit pas quelque chose en dehors de nous.
L'important c'est qu'il ne se manifeste qu'en nous et par nous. Le fait
de conscience ne peut donc tre considr comme l'effet d'un monde
dont il est, au contraire, en un certain sens la cause. Si nous dcomposons, en effet, le monde extrieur en ses lments, nous n'y trouvons
rien autre chose que des sensations : couleurs, sons, saveurs, odeurs,
figures et mouvements, tout cela se ramne des choses vues et senties. Sans doute il ne faut pas se hter de tirer de ce fait une dclaration d'idalisme ; car ce ne serait chapper un embarras que pour en
introduire un autre, et d'ailleurs il ne serait pas sage de faire reposer
une classification des sciences, travail tout prparatoire, sur un systme de mtaphysique. Mais, sans aller jusqu' dire avec Fichte : Le
monde est ma cration , je puis bien admettre, avec Schopenhauer,
que le monde est ma reprsentation . Il n'est nullement ncessaire
de dire que le monde est constitu substantiellement par mes sensations, qu'il est l'uvre de l'imagination ; [123] il suffit que, comme
phnomne, il soit en partie au moins l'uvre de ma sensibilit, pour
que le point de vue interne soit autoris se sparer du point de vue
externe et s'opposer celui-ci. De mme, rciproquement, il n'est
nullement ncessaire de soutenir que la conscience n'est qu'un phnomne de la matire, pour tre autoris admettre l'existence des
sciences objectives en tant que distinctes des sciences subjectives.
Donc, ni l'indpendance des sciences physiques et naturelles ne repose
sur le matrialisme, ni l'existence indpendante des sciences psychologiques ne repose sur le spiritualisme ; mais le double courant des
unes et des autres repose sur le fait primitif de l'opposition du moi et
du non-moi, du sujet et de l'objet. Ce qui est vrai, c'est que si, en un
sens, le moi est conditionn par le non-moi, en un autre sens le nonmoi est conditionn par le moi. De cette double et rciproque dpendance nat la ncessit de sparer les deux ordres de sciences, les
sciences de la nature et les sciences de l'humanit, et par consquent
d'adopter la division binaire, et non la division linaire.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
119
2 Une seconde considration, qui n'est qu'un corollaire de la prcdente, mais assez important pour tre signal part, c'est que
l'homme, le moi, l'esprit, se distingue de tous les autres objets qui le
prcdent dans l'histoire de la nature, en ce qu'il est non seulement,
comme les autres, un objet de science, mais en mme temps le sujet
de la science. Une pierre est un objet de science, mais elle ne fait pas
la science, ni d'elle-mme, ni des autres tres. Les astres, la terre, les
minraux, les plantes, les animaux mmes, ne sont point capables de
science. Ils ne s'tudient pas eux-mmes au point de vue scientifique ;
encore moins sont-ils capables de faire de l'homme un objet de
science. Ils subissent la science, ils ne la font pas. Ils sont le terme
passif auquel s'applique la science ; ils ne sont point le sujet actif qui
applique la science ce terme. L'homme, au contraire, est sans doute
aussi, comme les autres, un objet de science ; son corps et mme son
esprit peuvent tre tudis en tant qu'objet ; [124] mais il faut que ce
soit l'esprit qui fasse cela. L'homme tudie l'homme ; et lors mme
que l'on fait tous ses efforts dans la science nouvelle pour dgager
l'tude de l'homme de toute subjectivit, pour en faire un objet pur,
celui-l mme qui fait ces efforts est encore un homme ; et c'est l'esprit humain qui cherche s'objectiver et s'impersonnaliser. Enfin le
philosophe mme qui construit la srie linaire dont nous avons parl,
qui voit les phnomnes allant du simple au compos, et les phnomnes natre les uns des autres par une volution graduelle, c'est encore un homme. C'est l'esprit humain lui-mme qui se met en dehors
de la srie en la construisant, et qui se met par l mme hors de pair.
Et quand mme on soutiendrait que la science elle-mme est encore
un phnomne qui nat de tous les phnomnes antrieurs, toujours
est-il que ce phnomne se sait lui-mme, qu'il se remarque lui-mme,
et qu'il remonte toute la srie antrieure. un moment donn de l'volution, il y a un phnomne qui se retourne, pour ainsi dire, qui rflchit tous les autres et qui se sait, se connat, se contemple dans toutes
ses oprations.
D'aprs ces considrations, nous croyons avec Ampre la ncessit de sparer les sciences en deux groupes, auxquels nous donnerons
comme lui le nom de sciences cosmologiques et de sciences noologiques, ou mieux encore sciences de la nature et sciences de l'humanit. Passons aux subdivisions.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
120
Pour les sciences de la nature, nous n'avons rien de mieux faire
que de suivre l'ordre d'Auguste Comte, ordre d'ailleurs tout fait conforme celui de la ralit.
Dans la nature, en effet, les tres se divisent en deux classes : les
inorganiques et les tres vivants. De l deux grandes classes de
sciences : physique et biologie.
La physique son tour peut se diviser en deux parties : la physique
abstraite ou idale, qui tudie les conditions les plus gnrales de la
matire ; et la physique concrte, qui s'occupe de la matire elle-mme
telle qu'elle existe. La [125] premire partie comprend les mathmatiques ; la seconde retiendra le nom de physique.
Les conditions les plus gnrales de la matire, celles qui sont les
plus susceptibles de mesure, sont : le nombre, l'tendue et le mouvement. De l trois sciences mathmatiques : 1 l'arithmtique ; 2 la
gomtrie ; 3 la mcanique. En outre, en dehors et au-dessus de ces
trois sciences, relativement concrtes, il en est une plus abstraite : c'est
l'arithmtique gnralise ou l'algbre, dont le dveloppement donne
le calcul diffrentiel et intgral.
Passons la physique. Celle-ci se divise en deux parties, comme le
dit Auguste Comte : 1 la physique de l'univers ou physique cleste,
autrement dit astronomie ; 2 la physique du globe que nous habitons,
ou physique terrestre ; celle-ci se divise son tour en deux sciences,
suivant qu'elles considrent les phnomnes qui ne modifient pas la
constitution de la matire ou les phnomnes qui sont accompagns de
changement dans la composition des corps, en d'autres termes la physique proprement dite et la chimie.
Toutes ces sciences font partie de ce que Comte appelle les
sciences abstraites ou fondamentales, celles qui tudient les lois gnrales des phnomnes et non les tres ou objets particuliers pour lesquels ces lois se ralisent. Celles-ci sont les sciences concrtes. Il y a
deux sciences concrtes se rattachant la physique terrestre. Ce sont
la gologie et la minralogie.
Passons au second groupe de sciences cosmologiques, savoir les
sciences qui concernent la vie. Ici, comme tout l'heure, on peut distinguer avec Comte les sciences abstraites elles sciences concrtes.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
121
Les premires recherchent les lois de la vie en gnral ; les secondes
tudient les tres vivants.
La science de la vie en gnral est la biologie. On peut la diviser,
comme le fait Auguste Comte, en trois grandes sciences : la biotomie,
la biotaxie et la bionomie. La biotomie rpond ce que l'on appelle
anatomie. C'est la science de la structure matrielle des tres vivants.
Le mot est mal fait, parce [126] qu'en ralit ce n'est pas la vie qu'on
divise (biotomie) ; ce sont les organes de la vie.
La biotaxie est la science des classifications. Les tres vivants forment une multitude, immense et indfinie. Si l'on n'tablit pas quelque
ordre dans cette multitude, la science est impossible. Ici, la vrit, on
entre dj dans le domaine des tres vivants considrs d'une manire
concrte ; mais ce sont encore des conditions gnrales, des lois selon
lesquelles les tres vivants peuvent tre classs. Le principe, par
exemple, sur lequel reposent aujourd'hui les classifications dites naturelles, le principe de la subordination des caractres, est bien une vritable loi ; de plus, la thorie des classifications, par laquelle on dbute
toujours, soit dans l'tude de la botanique, soit dans celle de la zoologie, est une uvre assez complique pour tre spare de ces deux
sciences et considre part comme une science distincte : c'est l ce
qu'Auguste Comte appelle la biotaxie.
La troisime science, ou bionomie, correspond ce que l'on appelle la physiologie, et surtout la physiologie dite gnrale, qui tudie les lois gnrales de la vie, considres en dehors de la structure et
de la forme propre telle ou telle classe d'tres. Elle comprend aussi
la physiologie dite compare, dans laquelle, partant de la physiologie
humaine, on montre les dgradations successives des fonctions en
descendant jusqu'aux tres les plus infimes ; ou bien, partant de ces
formes infrieures, on remonte de proche en proche jusqu' la physiologie humaine ; et enfin, la physiologie humaine proprement dite, qui,
tant la science de l'tre organis le plus. parfait, sert de base ou de
type toute physiologie.
ces diverses sciences abstraites viennent s'ajouter comme connexes deux sciences concrtes : la botanique et la zoologie.
Passons aux sciences de l'humanit. Nous avons spar ces
sciences des premires par la raison qu'elles reposent toutes sur un fait
nouveau et fondamental, irrductible aux faits physiques, savoir le
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
122
fait de conscience. la vrit, ce fait parat exister chez les animaux
aussi bien que chez [127] l'homme ; mais ce n'est que par la conscience de l'homme que l'on peut pntrer dans la conscience de l'animal.
Par l l'homme se distingue de la nature extrieure. Mais ce n'est
pas dire que l'homme ne puisse s'tudier lui-mme qu' titre d'tre
conscient. Le fait de conscience est la base de son existence, mais il
est li d'autres manifestations externes qui peuvent tre tudies indpendamment du fait de conscience.
Ces manifestations extrieures sont au nombre de trois :
1
Le changement dans le temps et dans l'espace ;
La parole ;
La socit.
De l trois ordres de sciences entre lesquelles se partage la science
de l'humanit.
1 L'homme change. Sans doute l'animal change aussi ; la vie d'un
individu du rgne animal n'est pas absolument semblable celle d'un
autre individu. Mais ces changements sont tellement peu de chose et
ont si peu d'importance qu'ils se perdent dans l'uniformit gnrale, et
qu'une gnration dans son ensemble est entirement semblable une
autre gnration. Au contraire, dans l'espce humaine, les diffrences
individuelles sont considrables ; multiplie et accumules, elles tablissent entre une gnration et une autre des diffrences bien plus
considrables encore. De la multiplicit des intrts, des dsirs et du
besoin combin avec les diffrences de caractre et les diffrences de
situation, naissent de nombreuses diffrences dans les actions ; et
lorsque ces actions prennent une grande importance, on les appelle
des vnements ; ces vnements en suscitent d'autres qui leur succdent dans un certain ordre, et qui ont une grande influence sur le bonheur ou le malheur des hommes. Enfin, parmi les hommes il en est qui
s'lvent au-dessus des autres par leurs mrites, leurs vertus ou mme
leurs crimes et qui ont plus que d'autres de l'influence sur la marche
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
123
des vnements : ce sont les hros, les hommes clbres quelque
titre que ce soit. Dans ce changement [128] perptuel, il y a cependant
certaines uniformits : certaines causes produisent en gnral certains
effets. Dterminer ces conditions gnrales et uniformes dans la varit infrieure des individualits et des actions humaines, tel est le rle
des sciences appeles historiques. L'histoire, voil donc une premire
science se rattachant aux sciences de l'humanit.
2 L'homme parle. Sans doute tous les animaux ont un langage ;
mais l'homme seul a le langage articul, la parole. Seul il emploie
sciemment des sons distincts et dtermins l'expression de ses sentiments et de ses penses. Or, les sentiments et les ides tant en
nombre indtermin, il doit y avoir un nombre correspondant de combinaisons vocales ; maintenant, ces combinaisons variant suivant les
temps et les lieux, chaque groupe de combinaisons constitue ce que
l'on appelle une langue. L'tude de ces langues donne naissance un
nouvel ordre de sciences que l'on appelle sciences philologiques. C'est
que les changements oprs dans la formation de ces combinaisons
vocales sont soumis des lois. Il y a donc lieu rechercher les lois de
la formation du langage comme celles de la formation des tres organiss. Rapprocher les langues les unes des autres, former des familles
et des groupes, montrer l'identit sous la diffrence, c'est l'objet de la
philologie compare.
3 Un troisime ordre de faits particuliers l'espce humaine, ou
qui du moins s'y est dvelopp d'une manire exceptionnelle, c'est le
fait de la socit. L'homme vit en socit ; sans doute ce n'est pas l un
fait exclusivement propre l'homme. Les animaux aussi vivent en socit. Ils ont d'abord cette premire socit que l'on appelle la famille,
puis cette socit plus gnrale qui groupe un certain nombre d'individus de la mme espce dans un but commun et sous une sorte de gouvernement commun ; mais, sans examiner les analogies et les diffrences des socits animales et des socits humaines, il suffit de faire
remarquer que les premires sont restes un tat tout rudimentaire,
tandis que chez l'homme le fait social a pris des dveloppements considrables. [129] On pourra, si l'on veut, traiter de la sociologie animale, comme le germe de la socit humaine ; mais ce sera toujours
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
124
dans l'homme qu'il faudra tudier le fait de la socit. Nous avons dj
fait remarquer que le fait de conscience lui-mme prend son origine,
selon toute apparence, dans l'animal, et que par l la zoologie entre
dj pour une part dans les sciences que l'on peut appeler sciences morales ou noologiques ; il n'en cote pas davantage d'admettre que, par
le fait de la socit, les animaux entrent aussi pour une part minime
dans les sciences sociales : ce sont l les pntrations rciproques des
sciences les unes dans les autres. C'est ainsi que la physique pntre
dans l'astronomie, l'astronomie dans la gologie. Quoi qu'il en soit de
cette parenthse, il reste qu'il y a tout un groupe de sciences parmi les
sciences de l'humanit qui ont pour objet l'tude de la socit ; par
exemple, la science du gouvernement ou politique ; la science du droit
ou jurisprudence ; la science de la richesse ou conomie politique.
En distinguant les sciences de la nature et les sciences de l'humanit, nous n'avons pas voulu dire que ces deux ordres de sciences n'ont
point de rapport entre elles. L'histoire, par exemple, tient la gographie, qui tient la gologie et l'astronomie ; plus particulirement, la
psychologie ou science de l'homme intellectuel et moral tient la physiologie ou science de l'homme physique. Mais, pour unir avec fruit, il
faut distinguer avec prcision.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
125
[130]
Introduction la science philosophique
Leon VIII
OBJET DE LA PHILOSOPHIE :
1 La science des faits de conscience,
la psychologie
Retour la table des matires
Messieurs,
Vous vous rappelez pourquoi nous avons cru devoir essayer de
faire une classification des sciences. C'tait dans l'espoir que, dans
cette numration, nous rencontrerions la philosophie, et que nous
n'aurions qu' en constater l'existence au mme titre que celle des
autres sciences. C'est ce qui nous est arriv. La mthode que nous
avons employe est celle-ci :
Passer en revue tous les objets de la connaissance, et numrer
toutes les sciences qui correspondent ces diffrents objets. Puis, s'il
reste quelque objet qui n'ait pas t observ et occup par quelque
science, considrer cet objet comme un bonum vacans qui a le droit de
devenir l'objet d'une science nouvelle ou tout au moins d'une tude, si
l'on chicane sur le mot science. Reste savoir si cette tude concide
avec ce qu'on appelle en gnral philosophie, et si les objets en question correspondent l'objet ou aux objets que l'on attribue gnralement la philosophie : or c'est ce qui a lieu en effet.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
126
Aprs avoir numr tous les objets connaissables dans le monde
physique, et avoir fait ainsi la part des mathmatiques, de la physique,
de la chimie et des sciences biologiques, nous avons rencontr l'espce humaine ; nous l'avons considre d'abord par le dehors, et
trois points de vue : l comme changeant dans l'espace et dans le
temps ; 2 comme vivant en socit ; 3 comme possdant le langage
articul. De l [131] trois groupes de sciences, 10 que nous rangeons
d'ordinaire
sous le titre de sciences morales.
Voici toutes les sciences qui ont autorit et qui sont considres
par tout le monde comme des sciences. En avons-nous oubli une
seule ? Je ne le pense pas ; toutes celles que nous pourrions avoir
omises rentreraient dans celles que nous avons mentionnes.
Maintenant, ne reste-t-il plus rien ? Si vraiment ; nous l'avons vu, il
reste un fait distinct et nouveau, celui-l mme qui nous a servi distinguer deux classes de sciences, celles de la nature et celles de l'humanit, savoir le fait de la connaissance de soi-mme. Ce fait est-il
un fait ? Qui pourrait le nier ? Est-il important ? Mme rponse. Est-il
spcial, c'est--dire aussi distinct des autres, que ceux-ci le sont entre
eux ? S'il en est ainsi, pourquoi ne serait-il pas l'objet d'une science ?
Il y a donc un nouvel ordre d'tudes, savoir la science psychologique.
Dira-t-on que cette science en suppose d'autres ? Mais c'est le
propre de toutes les sciences. En principe, il n'y a qu'une seule
science, comme il n'y a qu'un seul univers. C'est la ncessit de la division du travail qui a amen la division des sciences. Elles ont toutes
rapport les unes aux autres : ce qui ne les empche pas d'tre des
sciences distinctes et indpendantes. Pourquoi n'en serait-il pas de
mme de la psychologie ? Au fond, la philologie repose bien plus encore et d'une manire bien plus troite sur un fait physiologique. Dirat-on que la philologie fasse partie de la physiologie ? Sans doute, si
l'on admet en principe que l'homme n'est qu'un corps organis, c'est-dire si on rsout d'avance et a priori la question mme pose par la
philosophie ; alors tout ce qui touche l'homme relve de la physiologie ; mais mme dans ce cas il y aurait encore une histoire, une sociologie et une philologie. Eh bien ! pourquoi en serait-il autrement de la
10
Sciences historiques, sciences sociales, sciences philologiques.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
127
psychologie ? Le fait, c'est que j'ai conscience de penser, et [132]
qu'en mme temps je n'ai aucune conscience des conditions organiques de ma pense. Je n'ai pas conscience de mon cerveau ; je ne
sais pas mme que j'ai un cerveau. Il y a l une analyse faite par la
nature des choses, et cette analyse autorise l'tude distincte et provisoirement spare de la science psychologique et de la science physiologique. La question des rapports reste ouverte ; elle ne doit pas tre
rsolue prmaturment, car l'analyse doit prcder la synthse.
Tout ce que nous concluons se rsout ceci : il y a au moins un objet nouveau non encore appropri par aucune autre science : c'est le
fait de conscience. Ce fait, avec tout ce qu'il contient, a droit une
science spciale. Cette science est la psychologie.
C'est ici le cas de nous demander 11 ce qu'il est advenu aujourd'hui
de la clbre dfinition donne par Jouffroy dans sa prface de Dugald
Stewart en 1826 : La psychologie est la science des faits de conscience. Y a-t-il encore aujourd'hui une science de l'observation intrieure, une science de l'homme qui se regarde penser, comme ferait
quelqu'un qui se mettrait la fentre pour se voir passer dans la rue ?
Ou nous nous trompons fort, ou nous croyons pouvoir affirmer que
cette dfinition de Jouffroy, malgr toutes les plaisanteries et toutes
les objections auxquelles elle a t en butte, malgr les psychologies
diverses qui se sont prsentes pour prendre la place de la psychologie
dfunte, que cette dfinition, dis-je, malgr tout cela, est demeure
triomphante, inbranlable et inbranle. Il n'est pas, je crois, aujourd'hui, un philosophe, ni mme un physiologiste clair et comptent
qui nie l'existence d'une science des faits de conscience, d'une psychologie subjective, fonde sur l'observation interne, les autres psychologies que l'on a dcouvertes depuis (exprimentale, compare, physiologique, morbide, etc.), n'tant que [133] des extensions, des vrifications, des contre-preuves de la premire, mais reposant sur elle et ne
pouvant exister sans elle. C'est ici l'exemple d'une vrit solide en philosophie, survivant toutes les controverses, comme les vrits scientifiques ; et c'est par l mme une vrit scientifique.
11
Cette dfense de la psychologie, avec dtermination prcise de son objet, appartient a un autre cours que celui des leons prcdentes. Il nous a sembl qu'elle
tait ici sa place, et qu'elle compltait utilement ce que nous avons dit plus
haut sur ce mme sujet.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
128
Il est ncessaire de rappeler tout d'abord quelques notions lmentaires qui se trouvent en tte de tous les traits de philosophie, et sans
lesquelles la discussion suivante manquerait de base. On appelle faits
de conscience les faits qui nous sont attests par la conscience, c'est-dire par le sentiment intrieur qui accompagne ces faits mesure
qu'ils se produisent. Ainsi, je sens, j'ai des sensations ; et je sais que je
sens et que j'ai telles sensations. Je pense et je sais que je pense et que
j'ai telles ou telles penses ; je veux et je sais que je veux, et que j'ai
telles ou telles volitions ; nous ne pouvons sentir, penser et vouloir
sans le savoir, sans en tre intrieurement avertis, et, pour rappeler un
adage scolastique : non sentimus nisi sentiamus nos sentire ; non intelligimus nisi intelligamus nos intelligere. Non seulement ces faits
nous sont connus intrieurement mesure qu'ils se produisent, mais
encore ils ne sont connus que par nous, nul autre il que le ntre ne
pntre dans notre intrieur ; nul autre homme ne sent notre sensation,
ne pense notre pense ; notre me n'a pas de fentre pour le regard des
autres hommes. Ce sentiment intrieur qui accompagne ces faits internes s'appelle conscience ou sens intime ; l'tre dans lequel se passent ces faits s'appelle le moi ou le sujet ; de l l'expression de subjectif, applique aux faits de conscience, terme qui s'oppose celui d'objectif, par lequel on dsigne tout ce qui se rapporte l'objet, ou au
non-moi, c'est--dire tout ce qui se passe en dehors du moi.
On remarquera, et c'est l un point essentiel, que la dfinition de
Jouffroy, si prcise et si limite qu'elle paraisse, n'exclut cependant
aucune des formes extensives que pourra prendre ultrieurement la
psychologie, si le besoin s'en faisait sentir.
[134]
Par exemple, quoique la psychologie soit essentiellement la
science des faits de conscience, elle n'en est pas moins autorise cependant tudier en mme temps des phnomnes d'un autre ordre,
que l'on appelle aujourd'hui phnomnes inconscients, si ces phnomnes viennent se rencontrer dans le cours de notre tude : d'abord,
c'est une question de savoir si les phnomnes dits inconscients ne
sont pas tout simplement des faits de moindre conscience ; en second
lieu, on sait que, suivant la doctrine d'Aristote, c'est la mme science
qui s'occupe des contraires : ainsi, la morale est la fois la science du
bien et du mal ; la logique, la science du vrai et du faux ; la mtaphysique, la science de l'tre et du non-tre. La psychologie, par analogie,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
129
pourra tre la fois la science du conscient et de l'inconscient. Il faut
d'ailleurs ajouter que la psychologie ne peut pas tre la science de
l'inconscient en gnral, mais de l'inconscient en tant qu'il est vraiment en rapport avec le conscient, intercal dans la srie du conscient,
servant expliquer le conscient ; autrement, si l'on ngligeait cette
restriction, la psychologie embrasserait tous les phnomnes de l'univers. Ce n'est donc qu'en tant qu'ils peuvent devenir faits de conscience proprement dits que les phnomnes inconscients entrent dans
la psychologie. Pour rappeler un exemple devenu classique, le philosophe cossais Hamilton, traitant de ce sujet, nous dit : Il me vient
l'esprit un cas, dont j'ai t rcemment frapp. Je pensais la montagne du Ben-Lomond, et cette pense fut immdiatement suivie de la
pense du systme d'ducation prussienne ; il n'y avait pas moyen de
concevoir une connexion entre ces deux ides en elles-mmes. Cependant un peu de rflexion m'expliqua l'anomalie. La dernire fois
que j'avais fait l'ascension du Ben-Lomond, j'avais rencontr son
sommet un Allemand ; et bien que je n'eusse pas conscience des
termes intermdiaires entre Ben-Lomond et les coles de Prusse, ces
termes taient indubitablement : Allemand, Allemagne, Prusse ;
et je n'eus qu' les rtablir pour rendre vidente la conscience des
[135] extrmes. Dans ce cas, on voit clairement que l'inconscience
est ce qui n'est pas actuellement dans la conscience, mais ce qui y a
t, ce qui en a disparu, ou ce qui peut y rentrer : c'est l'analogue du
conscient, l'intermdiaire entre les faits conscients.
La dfinition de Jouffroy n'exclut pas davantage d'autres faits qui
ne sont pas des faits de conscience, qui mme sont des faits objectifs,
des faits externes proprement dits, mais qui pourraient tre ncessaires
pour la description exacte des faits internes, par exemple certaines
donnes physiologiques qui accompagnent toujours suivant les uns,
frquemment suivant les autres, les phnomnes de conscience. En
tant que ces conditions peuvent tre indispensables pour l'analyse et la
description mme des faits mentaux, la science des faits de conscience
est implicitement autorise les utiliser ; et, pour employer un
exemple trs simple, aucun psychologue, mme de l'cole de Jouffroy,
ne se fera scrupule de distinguer la vision de l'audition, en signalant
les organes diffrents auxquels ces deux fonctions sont associes ; et
lorsqu'on distingue les sens et les organes des sens, on ne peut s'empcher de signaler prcisment l'existence de ces organes. Par la mme
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
130
raison, aucun psychologue ne se privera d'tudier les faits de l'habitude ou de l'instinct, quoique ces faits se passent en grande partie dans
le domaine organique, dans l'ordre des mouvements ; mais les mouvements ne sont point tudis, dans ce cas-l, titre de mouvements et
comme phnomnes mcaniques du corps humain ; ils ne le sont qu'en
tant qu'ils sont lis des phnomnes de conscience. Il en est ici de la
psychologie comme de l'histoire, laquelle, par exemple, tout en se
rapportant essentiellement la catgorie du temps, ne laisse pas
d'avoir gard aussi l'tude des lieux, c'est--dire la gographie ; et
cependant on ne dfinira pas l'histoire par la gographie ; et l'on continuera de dire que l'histoire est la science des vnements passs,
quoiqu'il soit videmment sous-entendu que ces vnements se sont
passs dans certains lieux.
[136]
Non seulement la dfinition de Jouffroy n'exclut aucun des progrs
possibles de la psychologie dans l'ordre des faits, elle n'exclut pas davantage l'extension possible de la psychologie du ct de la mtaphysique ; par exemple, elle n'exclut pas la doctrine de ceux qui prtendent, et nous sommes de ceux-l, que la conscience n'atteint pas seulement des phnomnes, mais qu'elle pntre jusqu' la cause et la
substance, c'est--dire jusqu' l'me. Je dis que la dfinition de Jouffroy n'exclut pas ce point de vue, qu'il a du reste lui-mme adopt plus
tard ; car il est possible que l'analyse des faits de conscience nous
conduise jusque-l ; mais, pour viter toute ide prconue, nous devons carter toute doctrine dans la dfinition de la science, afin de ne
parler que de ce qui est universellement accord. C'est pour cela, par
exemple, que nous ne dirons point que la psychologie est la science de
l'me ; car, sans croire, comme le disait Jouffroy dans cette mme prface, que le problme de l'me est un problme prmatur, nous pensons que ce serait une solution prmature que de l'introduire dans la
dfinition mme de la science. Mme le mot de facult, comme le mot
me, engage des questions mtaphysiques qu'il faut ajourner sans les
exclure. Quant aux limites qui sparent la psychologie de la mtaphysique, il n'est pas plus facile de les fixer a priori que de fixer les limites de la psychologie et de la physiologie, du conscient et de
l'inconscient ; mais il en est de mme des limites de toutes les
sciences. L'important pour chacune d'elles est de fixer le point essen-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
131
tiel et caractristique qui est l'objet de la science : or cet objet, c'est ici
le fait de conscience.
L'adversaire le plus intraitable, le plus intransigeant de la psychologie subjective, de la psychologie la Jouffroy, a t Auguste
Comte : Les mtaphysiciens, dit-il, ont imagin dans ces derniers
temps de distinguer, par une subtilit fort singulire, deux sortes d'observation d'gale importance, l'une extrieure, l'autre intrieure, et
dont la dernire est uniquement destine l'tude des phnomnes
intellectuels. [137] Quant observer les phnomnes intellectuels
pendant qu'ils s'excutent, il y a impossibilit manifeste. L'individu
pensant ne saurait se partager en deux, dont l'un raisonnerait tandis
que l'autre se regarderait raisonner. Telle tait la premire objection
d'Auguste Comte. Il en ajoutait deux autres, de non moindre importance : Une telle mthode, disait-il, en la supposant possible, devait
tendre rtrcir extrmement le champ de l'intelligence en la limitant,
de toute ncessit, au seul cas de l'homme adulte et sain, sans aucun
espoir d'clairer jamais une doctrine aussi difficile par la comparaison
des diffrents ges, ni par la considration des divers tats pathologiques. Enfin il imputait cette mthode ce qu'il appelait l'interdiction absolue jete sur toute tude intellectuelle ou morale, relative
aux animaux, de la part desquels les psychologues n'attendent sans
doute aucune observation intrieure .
Ainsi : 1 impossibilit de s'observer soi-mme ; 2 la psychologie
rduite l'tude de l'homme adulte et de l'homme sain ; 3. exclusion
de l'tude psychologique des animaux, tels sont les trois points qu'Auguste Comte dnonce comme les vices essentiels de la mthode psychologique subjective. Ces objections sont importantes, surtout les
deux dernires, parce qu'elles ont ouvert la voie de nouvelles recherches psychologiques. Mais si elles font pressentir et ont plus ou
moins amen des accroissements notables en psychologie, elles ne
portent pas, on ralit, sur l'essentiel de la thse de Jouffroy ; elles ne
la renversent pas ; elles ouvrent la voie, et cette voie est lgitime,
une psychologie objective faite par le dehors ; mais elles ne dtruisent
pas la ncessit d'une psychologie faite par le dedans, et qui est la
psychologie proprement dite.
Posons d'abord quelques principes qui sont accords par tout le
monde et par tous les savants, quand il s'agit des autres sciences, et
que l'on oublie aussitt qu'il est question de psychologie. Toute m-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
132
thode scientifique est une mthode d'abstraction. Elle consiste toujours dmler un fait [138] simple dans la srie des faits complexes
au milieu desquels il se trouve en ralit engag. Le point de dpart
ncessaire d'une science est de dmler l'ordre de faits spcifiques et
caractristiques qui constituent cette science. Nul doute que, dans la
ralit, les faits physiques proprement dits ne soient profondment
intercals et entremls avec les faits chimiques ; on les distingue cependant les uns des autres ; il y a des chimistes et des physiciens, des
chaires de chimie o il n'est pas question de physique et des chaires de
physique o il n'est point question de chimie ; ou du moins, dans chacune de ces sciences, les faits de l'ordre voisin n'interviennent qu'en
sous-ordre et sont subordonns au fait principal. Qu'a donc fait Thodore Jouffroy ? Il a mis en relief et en pleine lumire l'ordre de faits
caractristiques dont s'occupe la psychologie. Ces faits, ce sont les
faits subjectifs, avec le sentiment intrieur qui les accompagne : or
c'est bien l un ordre de faits sui generis et irrductibles, et il tait de
toute ncessit de les dgager de ce qui n'tait pas eux ; c'est cela
mme qui est l'objet propre, original, de la psychologie : c'est de l
qu'elle doit partir, si elle veut tre une science, et non un amas confus
de plusieurs sciences. Une fois l'existence de ces faits subjectifs tablie et reconnue, on pourra discuter sur la manire de les tudier ou
sur les recherches ultrieures auxquelles ils peuvent donner lieu ; on
verra alors que les trois objections prcdentes portent sur la forme et
les applications, mais non sur l'essence de la mthode psychologique.
Il est en effet vident, pour ce qui concerne le premier point, que,
dans la mthode de Jouffroy, le principe laisse ouverte la question de
savoir si c'est au moment mme o les faits ont lieu, ou plus tard et
aprs coup, que l'observation est possible. Jouffroy n'a pas trait cette
question. Il n'a pas cru ncessaire d'entrer dans le dtail du mode d'observation dont il s'agit. Il est certain que si un homme observe en luimme la passion non au moment o elle a lieu, mais plus tard par le
souvenir, et en se rappelant les diffrents moments [139] de cette passion, il est vident, dis-je, que c'est bien l de l'observation intrieure,
telle que l'entendait Jouffroy : et l'omission d'une telle distinction n'a
rien qui compromette la doctrine fondamentale de l'existence des faits
subjectifs et de la possibilit de les connatre par l'observation interne.
Cette rponse a t faite Auguste Comte par un philosophe non
suspect, li d'amiti avec lui, et qui passe pour tre plus ou moins de
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
133
son cole, M. John Stuart Mill. Il lui rpond mme sur ce point d'une
manire assez dure : Il n'est pas bien ncessaire, dit-il, de faire une
rfutation en rgle d'un sophisme dans lequel la seule chose surprenante serait qu'il impost quelqu'un. Premirement, on pourrait renvoyer M. Comte l'exprience et aux crits de MM. Cardaillac et
Hamilton, pour prouver que l'esprit peut avoir conscience de plusieurs
choses la fois, et mme le pouvoir d'y faire attention. En second lieu,
il aurait pu venir l'esprit de M. Comte qu'il est possible d'tudier un
fait par l'intermdiaire de la mmoire, sinon dans le moment o nous
le pensons, du moins un moment aprs, etc. est le mode d'aprs lequel
s'acquiert le meilleur de notre science sur les actes intellectuels.
Cette mme pense, savoir que la psychologie se fait non par la
conscience immdiate, mais par la mmoire, tait venue l'esprit,
avant M. Stuart Mill, d'un philosophe contemporain de Jouffroy,
l'auteur clbre de la Rfutation de l'clectisme, Pierre Leroux ; mais il
en avait tir une objection contre Jouffroy : Il ne s'agit pas, disait-il,
d'une observation directe de l'me par elle-mme, mais sur les oprations de l'me, ce qui est bien diffrent. Mais je ne sais si c'est l vritablement une objection contre Jouffroy. On peut faire remarquer
avec justesse que celui-ci ne s'est pas exprim avec assez de prcision,
qu'il n'a pas prvu l'objection qui lui serait faite sur la difficult pour
l'me de s'observer au moment mme, et il aurait d dire qu'il s'agit
plutt d'une observation indirecte et distance, comme s'exprimait
Pierre Leroux ; mais il n'y a rien dans les principes poss par Jouffroy
qui s'oppose cette manire d'entendre les choses : c'tait [140] une
prcision de plus apporte son analyse, mais non une rfutation.
Quant la distinction invoque par Pierre Leroux entre l'me ellemme et ses oprations, elle ne pouvait porter en aucune faon contre
la doctrine de Jouffroy ; car c'est lui prcisment qui, dans cette mme
prface, avait le plus nettement et le plus hardiment distingu l'me de
ses phnomnes ou oprations, au point d'avoir crit cette proposition
qui lui a t plus tard si violemment reproche : Le problme de
l'me est un problme prmatur.
Au reste, tout en laissant la plus large part, avec Pierre Leroux et
Stuart Mill, l'observation indirecte en psychologie par l'intermdiaire
de la mmoire, nous sommes loin, quant nous, d'accorder qu'il ne
puisse pas y avoir d'observation directe de l'me par elle-mme. C'est
sans doute un fait trange et inexplicable que celui de la rflexion ;
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
134
mais il ne l'est pas plus que celui de la conscience, et celui-ci ne peut
pas tre ni. Kant a parfaitement fait ressortir ce qu'il appelle le paradoxe de la conscience , savoir le fait d'un tre se connaissant luimme, et, comme il s'exprime, affect par lui-mme : car il y a
toujours l quelque chose de double, quelque degr qu'on suppose la
conscience ; par exemple, je souffre, et en mme temps je sais que je
souffre : il y a deux faits en un seul : c'est donc un redoublement ;
mais c'est ce redoublement mme qui fait l'originalit irrductible de
ce fait. Or la rflexion ne fait autre chose que grossir le fait et mettre
en relief ce qui est obscur, et nous rendre attentifs nous-mmes.
Nous pouvons donc la fois penser, et penser que nous pensons. Par
exemple, je veux savoir si l'ide de couleur est insparable de l'ide
d'tendue : j'voque dans mon esprit un point lumineux dans le ciel,
ou un point blanc sur un tableau noir, et je vois toujours cette couleur
tendue. L'observation est donc ici contemporaine du fait lui-mme ;
et la distinction de la conscience et de la mmoire est insignifiante, car
c'est le mme fait de part et d'autre. On remarquera enfin que l'objection elle-mme suppose l'analyse intrieure qu'elle dclare impossible,
car [141] on ne saurait jamais parle dehors, par exemple en observant
un cerveau, si le raisonnement ou la rflexion sur le raisonnement sont
deux oprations successives ou simultanes. L'objection elle-mme
suppose donc l'emploi de la mthode psychologique.
La seconde objection d'Auguste Comte est que la psychologie se
borne l'tude de l'homme adulte et sain, au lieu de l'tudier travers
les diffrents ges ou dans les altrations de ses facults mentales.
C'est donc une science qui se place en dehors des conditions de la ralit.
On est surpris qu'Auguste Comte, en empruntant cette objection
Broussais, ait t assez aveugl par le parti pris et par la prvention,
pour ne pas voir que cette objection portait tout aussi bien sur la physiologie que sur la psychologie, et qu'il avait lui-mme d'avance rfut
cette objection en distinguant la physiologie ou biologie de l'histoire
naturelle et de la pathologie.
En effet, n'est-il pas vident que la physiologie, tout comme la
psychologie, ne s'occupe que de l'homme adulte et ne traite que secondairement des diffrents ges ? Par exemple, elle tudie fond les
fonctions gnratrices ; or ces fonctions n'ont pas lieu dans l'enfance,
et elles n'ont plus lieu dans la vieillesse. De mme, la physiologie
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
135
n'tudie que l'homme sain, et cela est ncessaire : car comment comprendre la pathologie ou la science de l'tat anormal, sans comparaison avec l'tat normal ? Et saurait-on ce que c'est que la maladie, si on
ne connaissait pas la sant ? Enfin, comment la thrapeutique seraitelle possible, c'est--dire comment pourrait-on ramener l'homme de
l'tat pathologique l'tat normal, si on ne connaissait pas ce dernier
tat ?
On ne voit donc pas pourquoi on n'appliquerait pas la psychologie ce que l'on accorde pour la psychologie. Ce qu'il y a de surprenant,
c'est que c'est Auguste Comte lui-mme qui a pos sur ce point les
vrais principes. Sans doute, dit-il, il tait non seulement invitable,
mais encore rigoureusement indispensable que la biologie comment
par un tel [142] point de dpart (la considration de l'homme), afin de
se constituer une unit fondamentale qui pt servir ensuite la coordination systmatique de la srie entire des cas biologiques. Un tel
type ne pouvait en effet, sous peine de nullit radicale, tre arbitrairement choisi ; et ce n'est point uniquement, ni mme principalement
comme le mieux connu et le plus intressant, que le type humain a d
tre ncessairement prfr ; c'est surtout par la raison profonde qu'il
offre en lui-mme le rsum le plus complet de l'ensemble de tous les
autres cas. Ainsi, une premire analyse de l'homme envisag l'tat
adulte et au degr normal sert former la grande unit scientifique
suivant laquelle s'ordonnent les termes successifs de la srie biologique. Ainsi, l'objet de la physiologie, c'est bien, suivant Comte,
l'homme adulte et normal, prcisment le mme qu'il reproche aux
psychologues d'avoir tudi intellectuellement. C'est l, dit-il, l'unit
fondamentale dont on tudiera plus tard les variations et les dgradations. Mais en psychologie aussi n'a-t-on pas besoin d'un type et d'une
unit fondamentale ? L'homme adulte, c'est l'homme complet,
l'homme arriv au plein dveloppement de sa nature. Sans doute la
physiologie exige l'tude des diffrents ges et mme doit remonter
plus haut, jusqu' l'embryon : mais doit-on confondre la physiologie
avec l'embryologie ? Sans doute encore l'ide de dveloppement et
d'volution a d s'introduire dans la science, et la mthode comparative, comme l'a remarqu Auguste Comte, a renouvel toute l'histoire
naturelle, et il en sera de mme en psychologie. Mais la physiologie
ne cessera jamais d'exister comme science distincte, prenant pour base
le type le plus complet de l'tre vivant. De mme, en psychologie,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
136
l'ide de mouvement, de variation, d'volution, s'introduira de plus en
plus, soit au point de vue de l'histoire des socits, soit au point de vue
des altrations morbides ; mais ces tudes comparatives n'excluent pas
et mme exigent une unit, un terme de comparaison, qui est l aussi
l'homme adulte et l'homme normal.
[143]
Auguste Comte a pos lui-mme avec beaucoup de prcision la
diffrence qui spare le domaine de la biologie du domaine des autres
sciences qui lui servent de complments, de confirmations ou de rectifications. Les mmes principes s'appliquent rigoureusement la psychologie et ses annexes. Il distingue deux ordres de sciences, les
sciences abstraites et les sciences concrtes. La science abstraite est
celle qui tudie les lois gnrales et fondamentales. La science concrte tudie ces mmes lois modifies par les circonstances diverses
de la ralit. La science abstraite de la vie, c'est la biologie ou physiologie proprement dite ; les sciences concrtes sont : 1 l'histoire naturelle ; 2 la pathologie. Ces deux ordres de considration, dit Auguste Comte, sont galement trangers par leur nature au vrai domaine
philosophique de la biologie. En effet, celle-ci doit toujours se borner
l'tude essentielle de l'tat normal, en conservant l'analyse pathologique comme un simple moyen d'exploration. De mme, quoique des
observations d'histoire naturelle puissent fournir l'anatomie et la
physiologie de prcieuses indications, la vraie biologie n'en doit pas
moins, tout en se servant d'un tel moyen, dcomposer toujours l'tude
de chaque organisme dans celle de ses parties constituantes, tandis
qu'une telle dcomposition est directement oppose au vritable esprit
de l'histoire naturelle.
Ces principes, trs solides en eux-mmes, peuvent s'appliquer, sans
presque y rien changer, la science psychologique. Sans doute il y a
une histoire naturelle de l'me, savoir l'histoire de ses diffrents tats
aux diffrents ges, aux diffrents sicles, suivant les sexes, les tempraments, etc. Ce sont des sciences concrtes. La psychologie proprement dite est une science abstraite, comme la physiologie. C'est
elle qui fonde les sciences concrtes, qui sans elle seraient impossibles. Rciproquement, la psychologie puise des donnes prcieuses
dans l'une ou l'autre de ces deux sciences ; mais elle s'en distingue. Si
la psychologie n'existe pas d'abord pour elle-mme, elle n'existera pas
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
137
du tout, et les autres [144] sciences qui se rattachent elle cesseront
d'avoir la moindre clart.
Auguste Comte, poursuivant les consquences qui drivent, selon
lui, de la mthode psychologique d'observation intrieure, affirme
qu'une telle mthode exclut absolument toute tude des facults mentales des animaux.
O voit-on que Jouffroy ait jet une telle interdiction sur la psychologie animale ? Il y a l une mprise sur le sens essentiel de la
thorie de Jouffroy. Ce que celui-ci a voulu tablir et ce qu'il a tabli
magistralement, c'est qu'il y a des faits subjectifs, et que ces faits sont
essentiellement distincts des faits objectifs ou physiologiques auxquels ils sont ncessairement unis : la psychologie a donc un objet
propre qui la spare de la physiologie. Maintenant, que ces faits subjectifs se passent chez les autres hommes, au lieu de se passer en nous,
chez les animaux au lieu de se passer chez les hommes, ce n'en sont
pas moins des faits subjectifs qui relvent de la psychologie et non de
la physiologie. Mais, dit-on, les animaux ne peuvent pas s'observer
eux-mmes. Il n'y aura donc point de psychologie animale, si la mthode d'observation intrieure est la seule mthode psychologique.
Mais Jouffroy, en signalant la mthode d'observation intrieure
comme la principale, n'a nullement exclu la mthode d'observation
indirecte, savoir celle qui s'exerce sur les autres, et qui par induction
conclut des signes ou des actes extrieurs aux faits mentaux qu'ils expriment. L'une de ces mthodes n'exclut pas l'autre. De ce que je
m'tudie moi-mme, s'ensuit-il que je ne puisse pas chercher deviner
ce qui se passe dans la pense d'autrui ? Cela n'est pas plus interdit au
philosophe qu'aux autres hommes, et cette double tude a lieu tous les
jours chez les hommes. Si donc Jouffroy a parl surtout de l'observation intrieure et subjective, c'est qu'il avait dterminer le caractre
essentiel et propre de la psychologie, savoir le caractre subjectif ;
de mme que Claude Bernard, lorsqu'il a essay de dterminer le caractre exprimental de la physiologie, n'a parl que de [145] l'exprimentation ; mais il n'a pas exclu par l ni la mthode comparative ni
la mthode d'anatomie pathologique. De mme Jouffroy a mis en relief le rle de l'observation intrieure, parce que c'tait le point essentiel tablir ; mais il n'a rien ni ; et si on lui et parl de cette mthode objective indirecte, il et rpondu infailliblement qu'elle tait un
corollaire et une contre-preuve de l'observation intrieure. En fait, les
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
138
psychologues n'ont jamais ignor cette mthode d'observation par le
dehors. Les cossais, les matres de Jouffroy, s'en sont beaucoup servis. Dans la Philosophie de l'esprit humain, de D. Stewart, le troisime volume est consacr la psychologie des animaux, celle des
ges, des sexes et des professions. Tout ce que l'on peut dire, c'est que
depuis Jouffroy, et peut-tre sous l'impulsion mme des objections
exagres d'Auguste Comte, la psychologie objective a fait beaucoup
de progrs : mais c'est le propre de toutes les sciences.
Pour en revenir ce qui concerne les facults animales, on peut
dire que ce sont encore les psychologues ou philosophes qui, avant ces
derniers temps, avaient le plus travaill sur ce sujet. Ainsi, sans parler
de Bossuet, qui a crit un chapitre substantiel sur la question dans la
Connaissance de Dieu et de soi-mme, nous venons de nommer Dugald Stewart, qui a laiss des pages trs fines sur les facults des animaux compares celles de l'homme. Avant lui, Condillac crivait
son Trait des animaux. En Allemagne, Reimarus, disciple de Leibniz
et matre de Kant, publiait un des ouvrages les plus riches en observations de ce genre, intitul : Considrations sur l'instinct des animaux.
Plus anciennement, Montaigne, dans un esprit sceptique et un peu par
jeu, faisait aux animaux une large part dans son clbre chapitre intitul Apologie de Raymond de Sbonde. La philosophie n'a donc jamais interdit l'tude mentale des animaux, et la psychologie de Jouffroy n'est nullement tenue de l'interdire.
Ce qui explique du reste la raret des travaux des psychologues sur
cette question, c'est que le sujet d'observation [146] leur manque et
qu'ils ne peuvent avoir de mnagerie dans leur cabinet ; ils ne peuvent
donc avoir l-dessus que des ides vagues. Ce serait plutt aux naturalistes qu'il faudrait reprocher d'avoir nglig ce ct de la science. Ils
ont, en effet, des animaux leur disposition, et ils en ont trs peu tir
parti. Le meilleur ouvrage qui ait t crit sur ce sujet est la Lettre sur
les animaux de Ch. Leroy, qui n'tait ni un philosophe ni un naturaliste, mais un simple capitaine des chasses, et la mthode de Leroy
n'est pas autre chose que celle que nous indiquions plus haut, savoir
une mthode psychologique indirecte, qui conclut la similitude des
causes par la similitude des effets. En effet, il montre que les animaux
sont susceptibles de faire des expriences comme les hommes, en
comparant les actions animales et les actions humaines ; et ces actions
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
139
humaines elles-mmes, nous ne les comprenons que par analogie avec
ce qui se passe en nous-mmes.
D'ailleurs, ici encore, dans cette question, nous n'avons rien de
mieux faire que d'invoquer le tmoignage d'Auguste Comte luimme et d'appliquer la psychologie ce qu'il dit de la physiologie. Il
distingue, avec Bichat, les fonctions organiques des fonctions animales (ou vie de relation). Or, pour ces dernires fonctions, dans lesquelles rentrent videmment les facults intellectuelles et morales,
Auguste Comte affirme la ncessit de commencer par l'homme et
non par l'animal. Toute recherche, dit-il, soit anatomique, soit physiologique, relative la vie animale elle-mme, serait essentiellement
obscure si on ne commenait pas par la considration de l'homme,
seul tre o un tel ordre de phnomnes soit jamais immdiatement
intelligible. C'est ncessairement l'tat vident de l'homme de plus en
plus dgrad, et non l'tat indcis de l'ponge de plus en plus perfectionne que nous pouvons poursuivre dans toute la srie animale. Si
nous paraissons ici nous carter de la marche ordinaire, o nous procdons toujours du sujet le plus gnral et le plus simple au plus particulier et au plus complexe, c'est uniquement [147] afin de nous mieux
conformer, sans purile affectation de symtrie scientifique, au vrai
principe philosophique, qui consiste passer constamment du plus
connu au moins connu. Appliquez ces principes la psychologie, et
vous comprendrez que Jouffroy ait voulu constituer la psychologie
humaine, c'est--dire la psychologie subjective, avant la psychologie
animale, qui se fait par le dehors.
En rsum, la polmique d'Auguste Comte n'branle pas le moins
du monde les principes poss par Jouffroy, savoir l'existence de faits
subjectifs aussi certains, sinon plus, que les faits objectifs ; de plus, la
possibilit de connatre et d'analyser ces faits par l'observation ; la distinction de l'observation interne et de l'observation externe, en un mot
l'existence d'une psychologie subjective, comme base de toutes les
recherches sur les facults intellectuelles et morales.
Pour complter notre dmonstration, examinons maintenant la mthode qu'Auguste Comte propose de substituer celle de Jouffroy.
Elle consiste en deux points : 1 tudier les facults non en ellesmmes, mais dans leurs organes ; 2 les tudier encore non en ellesmmes, mais dans leurs rsultats. En un mot, la doctrine a pour but de
faire rentrer la psychologie dans la physiologie et dans l'histoire natu-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
140
relle. Il loue Destutt de Tracy d'avoir eu le courage de dire que l'idologie est une partie de la zoologie ; mais Tracy s'tait content de le
dire, et son idologie tait reste purement abstraite, spare absolument de toutes les conditions organiques et des origines zoologiques.
Il s'agit donc de reprendre et de mettre en pratique l'aphorisme de Tracy.
Quant nous, il nous semble que la proposition de Tracy ne signifie pas grand'chose. On peut, en effet, convenir que l'homme, ayant un
corps organis comme les autres animaux, sera appel un animal, et
mme les coles de philosophie le dfinissent un animal raisonnable,
et, ce titre, on peut dire sans grande hardiesse que tout ce qui concerne l'homme rentre dans la zoologie ; on le dira de l'histoire aussi
bien que de la psychologie. Mais je demande si ce sera une [148] proposition bien fconde et qui avancera beaucoup la science que de dire
que l'histoire fait partie de la zoologie. Il n'en faudra pas moins traiter
l'histoire par les mmes mthodes qu'auparavant, et la proposition ne
fera pas dcouvrir un seul fait nouveau. Il en est de mme de la proposition de Destutt de Tracy. On aura beau affirmer que la psychologie
ou l'idologie rentrent dans la zoologie, il n'y aura jamais d'autre
moyen de connatre l'homme que de l'appeler s'observer lui-mme.
Examinons cependant si les deux procds d'Auguste Comte valent
mieux que le de Socrate.
Pour le premier point, Auguste Comte affirme qu'il faut appliquer
la psychologie le principe fondamental de la physiologie : pas d'organes sans fonctions, pas de fonctions sans organes. Le problme physiologique se ramne donc ceci : tant donn l'organe, trouver la
fonction ; tant donne la fonction, trouver l'organe. Cette rgle une
fois pose, il faut l'appliquer partout ; or, nul ne doute que l'intelligence ne soit attache un organe, le cerveau : donc c'est dans le cerveau qu'il faut tudier l'intelligence. Examinons cette assertion.
C'est dj une grande exagration de subordonner absolument la
fonction l'organe et de poser en principe que, l'organe tant donn,
on doit en dduire la fonction. Claude Bernard a plusieurs fois critiqu
cette mthode qui subordonne la physiologie l'anatomie par le mme
genre de confusion qui subordonne ici la psychologie la physiologie.
Il n'est pas vrai du tout, dit Claude Bernard, que de l'organe on puisse
dduire la fonction. On aurait pu observer le foie pendant des sicles,
sans jamais en dduire sa fonction glycognique : il a fallu l'apprendre
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
141
d'ailleurs. Claude Bernard cite encore ce fait que dans les animaux
suprieurs les cellules sensitives sont triangulaires, et les cellules motrices quadrangulaires. Outre que cette diffrence ne nous apprend
absolument rien sur la diffrence de la sensibilit et du mouvement, et
sur l'attribution de ces fonctions l'une plutt [149] qu' l'autre de ces
deux formes, on aurait tort d'associer chacune de ces deux fonctions
chacun de ces deux genres de cellules, puisqu'il arrive prcisment
que, chez les oiseaux, c'est la disposition inverse qui a lieu, c'est-dire que ce sont les cellules motrices qui sont triangulaires, et les sensitives quadrangulaires.
En outre, lors mme qu'on accorderait sans restriction l'axiome
prcdent, il y aurait toujours entre les fonctions intellectuelles et les
fonctions organiques une diffrence fondamentale : c'est que, pour les
fonctions organiques, c'est le mme ordre d'observation qui nous
donne la fois la fonction et l'organe ; en mme temps que vous
voyez l'organe, par exemple l'estomac, vous pouvez voir la digestion
(comme dans le cas de l'ouverture de l'estomac par une blessure). Si
vous pouviez voir directement le cur, vous verriez en mme temps,
et par le mme acte d'observation, l'organe et ses mouvements. Quand
il s'agit, au contraire, des organes crbraux, le mme mode d'observation ne vous donne pas la fois l'organe et la fonction ; et il vous faut
recourir, pour constater la fonction, un autre mode d'observation, qui
est l'observation intrieure ou la conscience. Il faut donc, pour faire la
thorie complte des fonctions crbrales, rassembler les deux ordres
d'oprations que vous ne connaissez que sparment. S'il est vrai
qu'un cerveau vu du dehors ne manifeste aucune pense (car un ignorant qui verrait un cerveau pour la premire fois ne saurait dire si c'est
l'organe de la pense ou l'organe de la circulation), rciproquement, le
sentiment de la pense en nous-mme ne nous suggre pas davantage
l'ide d'un cerveau. Comment une telle diffrence ne compterait-elle
pour rien ? Et, de quelque manire qu'on s'y prenne, peut-on viter
l'emploi d'une mthode psychologique diffrente de la mthode physiologique ? car le cerveau ne porte pas crits sur ses lobes, comme les
crnes phrnologiques que l'on vend chez les marchands, les noms des
facults.
Bien entendu, et nous ne saurions trop le rpter (car [150] c'est sur
notre exclusivisme prtendu que l'cole adverse tablit son propre exclusivisme), bien entendu, nous ne nions pas l'importance d'une psy-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
142
chologie physiologique ; et Jouffroy lui-mme ne la niait pas ; au contraire, il professait expressment cette doctrine de l'union des deux
sciences, en se plaignant qu'elles ne fussent pas assez surs. En voici
la preuve : L'une et l'autre, en effet, disait-il (la psychologie et la
physiologie), s'occupent bien de certains phnomnes qui ne sont pas
dans leurs attributions : la physiologie, de phnomnes psychologiques ; la psychologie, de phnomnes physiologiques ; et elles ont
raison de s'en occuper ; autrement elles seraient incompltes. Car ce
n'est pas la vie psychologique ni la vie physiologique telles qu'elles
pourraient se dvelopper si elles taient isoles, que les deux sciences
ont pour objet de connatre, mais chacune de ces deux vies, telle
qu'elle s'accomplit dans l'homme, c'est--dire dpendante de l'autre,
modifie par l'autre, mutile peut-tre, peut-tre agrandie par l'autre.
C'est pourquoi ces deux sciences ne doivent point demeurer et n'ont
jamais t trangres l'une l'autre. Elles doivent se prter des secours
mutuels ; et s'il y a un reproche leur faire, c'est de n'avoir pas t
jusqu'ici aussi surs qu'il est ncessaire chacune d'elles qu'elles le
soient. 12
Il n'est donc point question de sparation et d'isolement. Un seul
point dbattre est de savoir, non s'il doit y avoir une psychologie
physiologique, mais si celle-ci doit remplacer l'autre. On cherche aujourd'hui les prodromes physiologiques de l'attention ; mais le feraiton, si la psychologie ne nous avait appris qu'il y a une facult appele
attention, et si l'analyse de cette facult n'avait provoqu plusieurs
problmes ? Par exemple, on distingue une attention volontaire et une
attention involontaire, comme si ce n'tait pas l une distinction psychologique, que la physiologie pure n'aurais jamais pu dcouvrir. On
cherche l'origine du moi dans la [151] rsultante des fonctions du cerveau. Vraie ou fausse, cette thorie serait-elle ne, si la psychologie
n'avait fourni la notion du moi et sa distinction d'avec le non-moi ? On
cherche la localisation des facults ; mais le ferait-on si l'on ne connaissait pas les facults elles-mmes ? Il est donc certain que l'on ne
peut tudier les facults de l'esprit dans leurs organes, avant de les
tudier en elles-mmes, sauf ensuite les rattacher par voie de concomitance leurs corrlatifs organiques, laissant d'ailleurs a une
science plus haute, la mtaphysique, la question de savoir si ces corr12
Nouveaux Mlanges philosophiques, p. 208.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
143
latifs sont, ou non, la vritable substance de l'esprit. Voil le vrai systme scientifique que l'on ne repousse que par des ides prconues.
Examinons maintenant la seconde rgle d'Auguste Comte : tudier
les facults humaines non en elles-mmes, mais dans leurs rsultats.
Par exemple, c'est en regardant agir les animaux, les fous, les sauvages, les enfants, et je suppose bien aussi un peu l'homme adulte et
sain, que l'on connatra les facults intellectuelles et morales de l'espce humaine. C'est toujours le mme malentendu. Que l'observation
objective soit ncessaire pour confirmer, contrler, rectifier, dvelopper les conclusions obtenues dj par la mthode subjective, c'est ce
qui est aujourd'hui universellement accord ; mais que par elle-mme,
et rduite elle seule, elle soit incapable de donner aucun rsultat,
c'est ce qui est vident. En effet, ce que nous voyons des facults humaines par le dehors, ce ne sont pas les faits eux-mmes, savoir les
penses, les volitions et les passions : ce sont leurs signes externes.
Or, ces signes doivent tre interprts ; ils n'ont aucune valeur, si ce
n'est par comparaison avec les signes qui accompagnent d'ordinaire
nos propres oprations. La psychologie objective n'est donc pas une
science de faits : c'est une science de signes qui n'atteint les faits
qu'indirectement et en passant par le domaine de la conscience subjective. Elle n'est une science d'observation qu'au second degr. Or, un
esprit vraiment scientifique peut-il croire avoir vraiment servi la
science en substituant l'observation des faits eux-[152] mmes la
mthode interprtative qui n'atteint les faits qu' travers leurs signes ?
On dit que la mthode indirecte est plus fconde que la mthode directe. C'est toujours le mme sophisme : titre de rectification et de
complment, oui peut-tre ; titre de base scientifique, non. Mme les
faits contradictoires que cette mthode indirecte peut faire dcouvrir
n'ont de signification et d'intrt que par comparaison avec les faits
gnraux et normaux attests par l'observation intrieure. On recherche aujourd'hui de tous cts ce que l'on appelle le ddoublement
de la personnalit ; mais ces faits ne sont vraiment intressants que
dans leur rapport avec la thorie de l'unit du moi, telle qu'elle rsulte
ou parat rsulter de l'observation subjective. Supposez que l'on n'ait
aucune notion de l'unit de conscience, de l'identit personnelle, et les
faits de ddoublement n'ont plus qu'une valeur de raret, de curiosit :
ce sont des anecdotes, des jeux de la nature, comme le veau deux
ttes, dont s'tonne le vulgaire. La thorie de la conscience retombera
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
144
dans le vague o elle est pour le sens commun ignorant. Il en est de
mme des faits par lesquels on tablit ou on essaye d'tablir ce que
l'on appelle des consciences collectives. Ces faits, si on ne les rapproche de la thorie psychologique de l'impntrabilit des consciences, n'ont plus qu'une valeur littraire, comme lorsqu'on dit : la
conscience d'une nation, la conscience d'une arme. C'est seulement
lorsque, par l'observation interne, on a trouv le principe de l'individualit des consciences, c'est alors seulement que ces faits contradictoires prennent toute leur valeur, soit que, par une analyse plus avance, on puisse les faire rentrer dans la loi commune, soit qu'ils ouvrent
la voie une thorie plus comprhensive et plus profonde.
En rsum, Auguste Comte, dans sa critique de la psychologie, n'a
prouv qu'une chose : c'est qu'il ignorait compltement la science qu'il
voulait proscrire. Voyons si la thse a t fortifie par les arguments
des nouveaux critiques.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
145
[153]
Introduction la science philosophique
Leon IX
SUITE DE LA DISCUSSION
SUR l'OBJET DE
LA PSYCHOLOGIE
Retour la table des matires
Messieurs,
Nous avons expos d'abord sous sa forme la plus aigu et la plus
tranchante le conflit de la psychologie et de la physiologie, et la prtention de l'une de ces sciences se substituer l'autre. Dans cette
premire phase de la question, l'indpendance et mme l'existence de
la psychologie subjective est absolument nie, et la seule mthode reconnue est celle qui tudie les facults humaines dans leurs organes et
dans leurs rsultats. Cette premire phase est reprsente par Auguste
Comte, et elle est presque contemporaine des revendications de Jouffroy en faveur de la psychologie subjective. Mais, depuis cette
poque, l'objet de la discussion s'est dplac, et la question s'est circonscrite sur un terrain plus limit. On ne conteste plus, comme Auguste Comte, la possibilit de l'observation subjective ; on ne nie plus
la diffrence d'une psychologie humaine et de la psychologie animale ; mais on affirme que, les phnomnes mentaux tant toujours
lis certains phnomnes objectifs, savoir les phnomnes nerveux, la psychologie ne peut pas tre exclusivement la science des
phnomnes subjectifs, mais qu'elle doit tre concurremment et ins-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
146
parablement la science des faits subjectifs et objectifs la fois. De l
la formule suivante qui tablit autrement qu'on ne le faisait auparavant
l'objet et les rapports des deux sciences. Le processus nerveux
simple face, dit M. Ribot, dans l'introduction de son livre sur la Psychologie allemande, appartient au physiologiste ; le processus nerveux
double face appartient [154] au psychologue. Cette doctrine est
celle de M. Taine en France et de M. Herbert Spencer en Angleterre.
Cette manire de poser la question est beaucoup plus fine, beaucoup plus savante et plus philosophique que la doctrine d'Auguste
Comte ; mais on voit que, mme si on acceptait par hypothse cette
position de la question, la psychologie subjective aurait conserv encore une bonne partie de ses positions. Au lieu d'tre totalement limine, comme elle aurait d l'tre par les objections de Broussais et
de Comte, elle resterait au moins la moiti de la science de l'homme ;
elle en reprsenterait la face interne, tandis que la physiologie tudierait en mme temps la face externe. Ce ne seraient plus, si l'on veut,
deux sciences spares ; ce seraient cependant encore deux points de
vue distincts, et la distinction de ces deux points de vue serait encore
une distinction fondamentale et de premier ordre. C'est cette vrit qui
reste la base de la psychologie et sans laquelle on ne sait plus ni ce
qu'on dit ni de quoi l'on parle.
Au reste, le philosophe de nos jours qui a le plus dfendu le principe prcdent ( savoir l'union insparable des deux faits, mental et
nerveux), et qui a fait de ce qu'il appelle la correspondance la base de
sa psychologie, M. Herbert Spencer, a maintenu lui-mme, nous
l'avons dit, la distinction des deux points de vue avec la mme rigueur
qu'avait fait Jouffroy. Voici comment il s'exprime : La psychologie
subjective, dit-il, est une science complte, unique, indpendante de
toutes les autres, quelles qu'elles soient ; et elle s'oppose elles
comme une antithse. Les penses et les sentiments qui constituent
une conscience et qui sont inaccessibles tout autre que le possesseur
de cette conscience forment une existence qui ne peut se placer parmi
les existences dont les autres sciences s'occupent. Quoique une accumulation d'expriences nous ait conduit croire que l'esprit et l'action
nerveuse sont les deux cts, objectif et subjectif, d'une seule et mme
chose, nous restons incapable de voir et mme d'imaginer quels rapports il y a entre les deux. L'esprit continue [155] d'tre pour nous
quelque chose sans parent avec les autres choses ; et de la science qui
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
147
dcouvre par introspection les lois de ce quelque chose, il n'y a aucun
passage, aucune transition, aux sciences qui dcouvrent les lois des
autres objets.
Ainsi Spencer, comme Jouffroy, admet l'indpendance de la psychologie subjective ; il admet en outre que la psychologie dite objective n'existe et n'a de sens que par son rapport la psychologie subjective, puisque celle-ci seule donne une signification aux faits signals
par la premire. La seule diffrence, c'est que Spencer fait une science
totale des deux psychologies, subjective et objective, tandis que Jouffroy en fait deux sciences spares, quoique unies entre elles ; mais
ces deux ides sont-elles bien diffrentes l'une de l'autre ? Puisque
cette science totale se compose de deux sciences, ne peut-on pas les
traiter sparment, ou les traiter ensemble, comme on voudra ? La
premire mthode sera plus conforme l'analyse, la seconde la synthse. Sans doute, le second point de vue est aussi ncessaire que le
premier ; car l'unit des choses est aussi utile connatre que leurs
diffrences. Mais, depuis Bacon et Newton, il a t convenu que l'analyse doit prcder la synthse. Il est donc tout fait conforme aux habitudes del science moderne de traiter de la psychologie subjective
avant de passer l'objective. En outre, si, comme Spencer le dit, la
premire est ncessaire pour interprter la seconde, si celle-ci lui emprunte ncessairement ses data, il y a un grand intrt assurer la fidlit de ces data, en tudiant d'abord les faits subjectifs en euxmmes et en suivant la conscience jusqu'o elle peut nous conduire.
C'est une abstraction sans doute ; mais toutes les sciences sont des
abstractions, et il n'y aurait pas de science si de telles abstractions
n'taient pas permises.
Si l'on cherche la signification de ce dbat, qui n'a l'air de porter
que sur une question de forme, on verra qu'il repose sur certaines proccupations, et que chacun des deux adversaires, des deux comptiteurs, s'il est permis d'ainsi parler, [156] en ayant l'air de ne s'occuper
que d'une question de mthode, pense une question finale dont nul
ne consent se dsintresser, et craint que l'autre parti ne prenne des
avantages pour la solution de cette question. D'un ct, en effet,
l'cole matrialiste craint que si elle accorde l'avance une existence
indpendante la science subjective, ce ne soit une concession de
fond et une sorte d'engagement en faveur de l'existence indpendante
de l'esprit. De l'autre ct, les spiritualistes craignent qu'en accordant
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
148
l'insparabilit des phnomnes nerveux et des phnomnes intellectuels et moraux, on n'accorde par anticipation la dpendance de l'esprit
l'gard de la matire, et mme la substantialit de la matire l'gard
de l'esprit.
Pour ce qui est du premier point, nous nous contenterons de rappeler les prcautions extrmes avec lesquelles Jouffroy, dans sa clbre
prface, a essay de sparer le problme psychologique du problme
mtaphysique. Ces prcautions lui ont t assez durement reproches
par les thologiens pour qu'il ait au moins l'honneur de n'avoir point
sacrifi un intrt scientifique un intrt de dogme. Assurment,
disait-il, cette question de l'me est fort importante en elle-mme ;
mais, quelque solution qu'on lui donne, ce que nous nous sommes
propos dans ce discours n'en restera pas moins vrai. Soit, en effet,
que l'on admette une me, soit que l'on rapporte au cerveau les phnomnes que ses partisans lui. attribuent ; il n'en est pas moins indispensable, si l'on veut connatre compltement la nature humaine, de
faire la science des phnomnes de conscience quelque principe
que puissent se rattacher ces faits, ils n'en sont pas moins ce qu'ils
sont. La science de ces faits et de leurs lois est donc parfaitement indpendante del solution dont il s'agit D'ailleurs, il n'est pas moins
vident que, dans l'tat actuel de cette science, cette question est prmature.
Il est permis de penser que Jouffroy est all trop loin en disant que
le problme de l'me est un problme prmatur. Il ne l'est pas plus
que les autres problmes de la mtaphysique. [157] Si, d'ailleurs, ce
problme est actuellement prmatur, on peut dire qu'il le sera toujours ; et entre prmatur et insoluble, il n'y a pas grande diffrence. Il
n'en est pas moins vrai que la question de l'me peut tre carte et
ajourne d'un commun accord, et que l'on peut soutenir les droits
d'une psychologie subjective sans violer les lois de la neutralit scientifique.
Que si, du reste, on souponne les psychologues subjectivistes de
travailler subrepticement pour l'intrt du spiritualisme mtaphysique,
on est tout aussi autoris souponner les psychologues objectifs qui
n'admettent pas, mme avec Spencer, une psychologie subjective, de
ne soutenir cette thse que dans l'intrt prmdit du matrialisme.
Ds lors, le soupon tant le mme de part et d'autre, pourquoi ne pas
le rejeter des deux cts ? et pourquoi ne pas se borner l'examen des
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
149
choses telles qu'elles sont ? Or cet examen nous apprend, comme le
dit M. Spencer, deux vrits indubitables : 1 la psychologie subjective est une science indpendante de toutes les autres ; 2 la psychologie objective emprunte toutes ses donnes la psychologie subjective.
Quoi qu'il en soit, soit qu'on spare, soit qu'on runisse les deux
parties de la psychologie, nous admettons qu'il y a en effet deux psychologies : l'une qui se fait par la conscience, l'autre par l'observation
des autres hommes, et qui, selon l'expression de Comte, tudie les facults dans leurs organes et leurs rsultats ; mais, relativement cette
psychologie objective, nous ferons deux observations. La premire,
c'est qu'il n'est pas lgitime cette psychologie objective ou physiologique de se qualifier elle-mme de nouvelle psychologie, tandis qu'on
affublerait la psychologie subjective de la qualification de vieille psychologie. Ces pithtes sont injustes et antiscientifiques ; elles ont
pour objet de surprendre la faveur de ceux qui ne rflchissent pas, en
usurpant les avantages du progrs et de la nouveaut. Il importe sans
doute assez peu qu'une science soit ancienne ou nouvelle, pourvu
qu'elle soit vraie. Mais, de plus, ces qualifications sont inexactes.
[158] Les deux psychologies existent concurremment depuis longtemps. Le XVIIe sicle a parfaitement connu la psychologie objective.
Le Trait des passions est par moiti un trait de physiologie. Descartes expliquait les passions par le mouvement des esprits animaux ;
Malebranche expliquait la mmoire et l'imagination de la mme manire, et l'on pourrait retrouver textuellement dans Malebranche les
explications rcentes donnes sur la mmoire. Bossuet, dans la Connaissance de Dieu et de soi-mme, traite d'abord de l'me, puis du
corps, puis de l'union de l'me et du corps, et s'tend longuement sur
les lois physiologiques des sensations : il a en outre un chapitre sur la
psychologie des animaux. Au XVIIIe sicle, Charles Bonnet et Hartley
ont commenc parler de vibrations nerveuses comme phnomnes
concomitants des penses. Mme l'cole cossaise a constamment ml dans ses analyses la physiologie la psychologie. Dans les Recherches sur l'entendement humain, de Thomas Reid, se trouve un
chapitre sur la gomtrie des visibles, un autre sur le strabisme, un
autre sur le mouvement parallle des yeux. Pour remonter plus haut, la
psychologie humaine, dans Aristote, est une partie de la psychologie
animale ou gnrale. On voit que rien n'est plus ancien que l'ide
d'une psychologie objective. C'est au contraire un fait tout moderne et
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
150
qui date seulement du XVIIIe sicle, que l'tablissement d'une psychologie purement subjective. C'est dans Locke qu'on la trouve pour la
premire fois : Je ne parlerai pas, dit-il, de l'me en physicien. De
l cette doctrine a pass Hume ; en France, Condillac et Laromiguire, et enfin Jouffroy. Elle a t tablie sous l'empire de l'esprit
scientifique du XVIIIe sicle, qui en tout prfrait l'analyse la synthse : c'est donc par rigueur de mthode, et non par aucune prvention mtaphysique, que la psychologie subjective a t cre ; et s'il y
a une psychologie toute moderne, c'est celle-l.
Une autre observation importante, c'est qu'il ne faut pas confondre
la psychologie objective avec la psychologie physiologique. Toute
psychologie physiologique est, il est vrai, [159] objective ; mais toute
psychologie objective n'est pas physiologique. Par exemple, un voyageur qui nous rapporte les murs des sauvages, et nous n'avons pas
d'autres moyens de les connatre, est un psychologue, mais il n'est pas
un physiologiste ; car il n'est besoin d'aucune physiologie pour savoir
que les sauvages sont imprvoyants, cruels, menteurs, et qu'ils ont des
sens trs fins, et des affections trs mobiles, mais trs vives. Une mre
qui a tudi les facults de l'enfance, comme Mme Necker de Saussure,
dans son livre de l'ducation progressive, est psychologue ; mais il
n'y a l nulle physiologie. Dans les livres si intressants qui ont t
faits rcemment sur la psychologie de l'enfance, par M. Bernard Prez, il n'est nullement question de physiologie. C'est tout simplement
la psychologie subjective qui sert de type et laquelle on rapporte le
dveloppement intellectuel et moral de l'enfant. Un magistrat, un aumnier de prison, qui tudieraient l'tat mental des prisonniers, seraient encore des psychologues sans tre des physiologistes. Le meilleur observateur des animaux, Charles Leroy, nous l'avons dit dj,
tait un capitaine des chasses du roi Louis XVI ; il n'tait pas un physiologiste, ni mme un naturaliste.
On voit que la psychologie objective se divise en deux parties, en
deux genres : 1 la psychologie compare ; 2la psychologie physiologique. La premire n'est qu'une extension de la psychologie subjective. Son objet propre est toujours le fait de conscience. Ce sont les
faits de conscience des autres hommes que vous tudiez par le moyen
de l'induction, et que vous comparez aux faits de conscience que vous
constatez en vous-mme. C'est de la psychologie subjective indirecte.
Au contraire, la psychologie physiologique est essentiellement objec-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
151
tive, parce qu'elle a pour objet non les faits de conscience eux-mmes,
mais les conditions physiologiques et organiques des faits de conscience, c'est--dire quelque chose d'extrieur et d'objectif.
Les mdecins eux-mmes, en tant qu'ils tudient les tats de conscience chez les malades, font de la psychologie [160] objective, non
physiologique. Par exemple, l'tude de l'hallucination ou des perceptions fausses est une tude de psychologie subjective indirecte, et non
de physiologie, si ce n'est en tant que l'on pourrait dterminer les conditions crbrales de l'hallucination : or, c'est prcisment l ce qu'on
ignore le plus. Un livre comme celui de M. Brierre de Boimont est un
livre riche en faits psychologiques, mais ne contient que trs peu de
documents physiologiques. Le fait que ces observations psychologiques sont faites par un mdecin ne suffit pas pour en faire de la physiologie. Tout homme est psychologue, et le mdecin peut tre psychologue au mme titre que les autres hommes. Ce qui fait que ce sont
les mdecins qui font ces sortes d'observations, c'est qu'ils ont seuls
ces sortes de malades sous leurs yeux, tandis que les philosophes de
profession n'ont pas des fous ou des hallucins dans leurs cabinets. Ce
n'en est pas moins au fond la mme mthode, ici directe, l indirecte,
mais ayant un seul et mme objet, savoir les faits subjectifs, les faits
de conscience.
Nous n'avons pas puis l'histoire du conflit qui s'est lev de nos
jours entre la psychologie et la physiologie. Nous en avons vu deux
priodes : dans la premire, les deux points de vue sont rigoureusement spars. Jouffroy part de la mthode psychologique interne
comme d'une mthode absolument suffisante en elle-mme, sans nier
cependant et mme en proclamant trs haut la ncessit, du concours
des deux sciences, mais sans y insister ; dans la mme priode, au
contraire, Auguste Comte nie absolument le procd psychologique
subjectif, et n'admet que la mthode physiologique et organique, sauf
se contredire cependant, lorsqu'il en arrive la physiologie intellectuelle et morale, en prenant comme division principale la distinction
de l'esprit et du cur, distinction qui est toute psychologique. Dans la
seconde priode, qui est celle de M. Herbert Spencer, les deux psychologies, l'une subjective, l'autre objective, sont admises concurremment comme ncessaires pour constituer la psychologie totale ;
mais elles sont encore soigneusement distingues, et [161] mme la
prpondrance est assure la mthode subjective, non seulement
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
152
parce qu'elle est une introduction ncessaire l'autre science, mais
encore parce qu'elle constitue la psychologie un cachet et un caractre propres d'indpendance.
Il nous reste faire connatre une troisime priode : celle dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. On reconnat encore, comme
Spencer, les deux psychologies spares, mais en renversant leur
ordre de valeur respective, c'est--dire en considrant la psychologie
subjective comme un simple vestibule ou passage la psychologie
objective et physiologique, laquelle est la seule vritablement scientifique. Ce point de vue a t dvelopp par M. Ribot dans ses divers
ouvrages, et surtout dans la prface de son livre sur a Psychologie allemande.
Voici la premire objection qu'il fait valoir contre la psychologie
classique. La psychologie subjective, dit-il, est purement descriptive ;
elle n'est pas explicative. Elle ne sort pas du domaine de la conscience
vulgaire ; elle ne va pas jusqu' la conscience scientifique, et ne
s'lve pas au-dessus des considrations littraires et de sens commun.
Cette objection contient deux considrations diffrentes et mme
htrognes. En effet, une connaissance purement descriptive n'quivaut pas du tout la connaissance vulgaire. Quand mme la chimie se
bornerait la description des corps, elle serait encore trs au-dessus de
la connaissance vulgaire. Dire d'ailleurs que la psychologie de Condillac ou de Leibniz quivaut la conscience vulgaire d'un paysan ou
mme de l'homme le plus instruit, est une assertion qui ne mrite
vraiment pas d'tre discute. Mme le fait de mettre en ordre les notions de la conscience vulgaire est quelque chose qui est encore infiniment au-dessus des forces de cette mme conscience. Mais, indpendamment de ce travail de coordination, que d'innombrables constatations ou mme d'analyses de faits se rencontrent dans les traits de
psychologie que ne connat pas la conscience vulgaire ! J'envie, pour
ma part, les savants qui se croient tellement au-dessus de [162] la psychologie classique qu'ils u'ont plus rien y apprendre. Quant moi,
qui, depuis plus de quarante ans, tudie ces sortes de matires, j'avoue
que je n'ouvre pas un trait de psychologie, je ne dis pas des plus
grands matres, mais des plus humbles, un Cardaillac, un Adolphe
Garnier, sans y apprendre quelque chose que je ne savais pas. Il y a
donc l tout autre chose que de la littrature et du sens commun.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
153
La psychologie, mme subjective, est donc une science. Admettons
qu'elle ne soit que descriptive. Qu'importe ! Est-ce qu'une science descriptive n'est pas une science ? La minralogie n'est qu'une science
descriptive ; elle ne trouve ses explications que dans la chimie. La minralogie n'est-elle donc pas une science ? L'anatomie, et en grande
partie l'histoire naturelle, sont des sciences descriptives ; ne sont-ce
pas des sciences ? Est-ce qu'il n'a pas t toujours reconnu qu'avant
d'expliquer les faits, il faut les connatre, et par consquent les dcrire ? quoi servirait-il de perfectionner les moyens l'explication, si
l'on perdait le sens des faits expliquer ? Or, c'est la psychologie subjective qui seule peut nous donner les faits qui sont la matire de l'explication.
Est-il vrai maintenant de dire que la psychologie ne soit que descriptive et non explicative ? C'est une erreur. La psychologie a sa
disposition deux moyens d'explication qui lui sont propres, et sans
lesquels il est impossible de faire un pas dans la science : 1 un mode
d'explication mcanique par l'association des ides (Hume, Mill, Bain,
H. Spencer) ; 2 un mode d'explication dynamique par l'intervention
de l'activit de l'esprit dans les phnomnes passifs (Leibniz, Maine de
Biran, Laromiguire).
Ces deux modes d'explication sont si lgitimes que, la plupart du
temps, les prtendues explications physiologiques consistent les
transporter purement et simplement dans le cerveau et dans les cellules nerveuses, en admettant tantt un mcanisme, tantt un dynamisme crbral, trs souvent mls ensemble, et qui ne sont que la
traduction objective et matrielle du mcanisme et du dynamisme
mental. Par [163] exemple, on supposera une facult de rminiscence
dans les cellules nerveuses, parce qu'on sait que les ides renaissent
dans l'esprit par la mmoire. On expliquera la sensation d'effort par le
travail du cerveau, sans se demander ce que c'est qu'un travail et si ce
n'est pas une tension de l'activit telle que nous la sentons en nousmmes quand nous avons la sensation d'effort. Ici les faits objectifs
n'auraient aucune signification si nous ne les traduisions en faits de
conscience. Ce qui le prouve, c'est que les cartsiens ont expliqu
exactement de la mme manire qu'on le fait aujourd'hui les faits de
mmoire et d'imagination, quoique leur science du cerveau ft absolument dans l'enfance : c'est qu'ils traduisaient, comme les psychophysiologistes actuels, les faits subjectifs en faits objectifs, qu'ils ne
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
154
connaissaient pas directement, mais qu'ils imaginaient la ressemblance des faits subjectifs.
D'ailleurs, la physiologie d'aujourd'hui ne fait gure autre chose
que de constater le sige des faits : elle en donne la topographie, mais
la topographie n'est pas une explication. Je ne dis pas qu'elle ne puisse
fournir un moyen d'analyse ; par exemple, la distinction des cinq sens
vient de la distinction des organes que l'exprience vulgaire suffit
nous faire connatre. Mais, dans bon nombre de cas, il s'agit d'une corrlation et non d'une explication. Par exemple, une des plus belles dcouvertes de l'anatomie moderne est d'avoir distingu dans le cerveau
quatre siges diffrents du langage, savoir le sige de la parole
crite, de la parole lue, de la parole entendue et de la parole parle.
Soit ; nous expliquons ainsi les anomalies du langage, par exemple
comment on peut perdre le sens de la lecture, et non celui de l'criture,
etc. Mais le vrai problme de la psychologie est plus gnral et d'un
tout autre ordre. Il peut s'noncer ainsi : comment apprenons-nous
parler ? Or, ici, que nous sert la topographie prcdente ? On aura
beau nous dire que pour apprendre parler nous exerons la troisime
circonvolution frontale gauche, cela ne nous expliquera absolument
rien, et ne nous apprendra que ce que nous savons, savoir que nous
apprenons [164] parler. De mme que nous voyons que pour apprendre marcher il faut exercer les jambes, nous concluons d'avance,
par analogie, que pour parler il faut exercer son cerveau. Mais ici
l'opration est beaucoup plus dlicate, et le schme d'un cerveau dont
les cellules vibrent ne nous est d'aucun secours. C'est donc la psychologie subjective qu'il faut avoir recours.
Il est trs vrai que la psychologie normale a beaucoup apprendre
au contact de la psychologie physiologique. Celle-ci lui fournit des
moyens d'analyse, soit par la pathologie, qui est une sorte d'exprimentation naturelle, soit par l'exprimentation artificielle, qui est possible dans certains cas ; mais il n'est pas moins vrai que la psychologie
physiologique a besoin du concours de la psychologie subjective. Par
exemple, il serait impossible de dmler et d'analyser les faits confus
dont se compose la vie infrieure de l'me, si ce n'tait la lumire
des analyses faites dans la psychologie suprieure. Ainsi, lorsque l'un
des crateurs de la psycho-physique, Wundt, nous dit que les sensations sont des raisonnements, il explique les modes infrieurs de l'esprit par des modes plus levs. On ne saurait rien comprendre aux
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
155
modes morbides de la conscience si l'on ne partait de la conscience
normale. Nous l'avons dit dj, c'est par comparaison avec l'unit de
conscience constate dans l'tat normal que l'on est frapp des faits de
multiplicit de conscience que l'on tudie aujourd'hui. De mme
l'automatisme des alins ou des somnambules ne se comprend bien
que par antithse avec la volont ; et ce qui peut rester de spontanit
dans ces cas obscurs n'est aperu que par analogie avec la spontanit
vritable. Ainsi, c'est toujours la psychologie subjective qui sert de
lumire la psychologie objective.
Non seulement la psychologie n'a pas toujours besoin d'emprunter
ses explications la physiologie ; mais, dans certains cas, c'est ellemme, au contraire, qui vient en aide la physiologie et qui lui apporte ses propres explications ; c'est cette mthode que M. Helmholtz
emploie et dfend dans son Optique [165] physiologique : 13
Quelque opinion que l'on professe sur les actions psychiques, et si
difficile que puisse tre leur explication, elles n'en possdent pas
moins une action relle, et leurs lois nous sont familires jusqu' un
certain point par les faits de l'exprience journalire. Quant moi, je
crois que c'est suivre une voie plus sre que de rattacher l'explication
des phnomnes de la vision des faits qui, sans doute, rclament
eux-mmes une explication, mais dont l'existence est hors de doute,
je veux parler des actions psychiques les plus simples, que de la
faire reposer sur des hypothses relatives une disposition anatomique, mais inconnue du systme nerveux, hypothses arbitraires,
inventes ad hoc et qui ne reposent sur aucune espce d'analogie.
Aussi n'ai-je pas hsit me servir d'explications fondes sur les actes
psychiques ou plus simples de l'association des ides. L'optique
physiologique d'Helmholtz n'est, en effet, qu'une extension du mode
d'explication employ pour la premire fois par Malebranche et Berkeley, et qui ramne des associations et des malentendus les actes
en apparence les plus simples de la vision.
La seconde objection de M. Ribot porte sur la mthode de la psychologie. Cette mthode est purement et simplement une mthode
d'observation, non d'exprimentation ; elle ne connat, suivant les distinctions tablies par Stuart Mill, que la mthode de concordance, tout
au plus celle de diffrence, mais non celle des variations concomi13
Voir traduction franaise, p. 1000.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
156
tantes. Cette objection n'est pas sans fondement. Il est trs vrai que la
psychologie objective fournira toujours plus de moyens l'exprimentation que la psychologie subjective. Mais, rciproquement, il est certain aussi que la psychologie objective contiendra toujours un lment
d'infriorit qui ne permet pas de la rapprocher des autres sciences.
C'est la difficult de l'interprtation des faits. Dans toutes les sciences
naturelles, en effet, ce sont les faits eux-mmes qui tombent sous nos
yeux. En [166] psychologie objective, ce sont les signes des faits. Il
reste toujours savoir quels sont les faits rels, c'est--dire les faits
intrieurs correspondant aux signes physiques, lesquels seuls tombent
sous nos sens. Ainsi, quiconque a observ un petit enfant sait quel
point il est difficile de deviner ce qui se passe dans cette petite cervelle et quels sont les processus mentaux correspondant aux faits extrieurs. Il en est de mme de l'tat mental des animaux, de celui des
fous, des somnambules, des aveugles-ns, des sourds-muets, etc. Il y
aura toujours l une difficult fondamentale pour la psychologie objective. C'est encore l une raison considrable de ne pas sacrifier la
psychologie subjective la psychologie objective : car si la difficult
pour celle-ci est dans l'interprtation des faits, combien cette difficult
sera-t-elle augmente si l'on se prive du concours de la science, qui,
seule, possde les principes de l'interprtation demande !
En outre, sans mconnatre les droits de la psychologie physiologique et en lui laissant ouvert tout le champ qu'elle aspire conqurir,
toujours est-il que sur beaucoup de points il n'y aura de longtemps
d'autre psychologie possible que la psychologie subjective. En un mot,
la connaissance de ce qu'on appelle les concomitants physiques n'est
possible que sur un petit nombre de faits touchant la vie animale.
Mais quel est le concomitant physique qui distingue l'induction et la
dduction, le souvenir du pass et la prvision de l'avenir, l'ide du
nombre et l'ide de dure, l'amour de soi et l'amour des autres ? Quels
sont les concomitants physiques qui accompagnent l'amour de la patrie, le sentiment esthtique ou religieux, l'ide du devoir ou l'ide du
droit ? et pour tous ces faits, il n'y a pas d'autre mthode que la mthode psychologique proprement dite.
La distinction des deux espces de psychologie n'est pas moins
importante, au point de vue de la psychologie objective qu' celui de
la psychologie subjective ; c'est la condition d'tre spare que la
psychologie objective sera tudie dans toute son extension, au lieu
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
157
d'tre disperse dans les divers [167] chapitres de la psychologie subjective. Considrons, en effet, les diffrentes parties de la psychologie
objective. On peut en distinguer trois principales : 1 la psychologie
animale ; 2 la psychologie morbide ; 3 la psychologie physiologique. Or dans la psychologie proprement dite, il n'y a pas place pour
un expos complet des facults animales, encore moins pour une thorie complte de la folie et moins encore pour une physiologie de la
pense. Les diverses parties de la psychologie objective ont donc intrt tre tudies pour elles-mmes, et, par consquent, la psychologie subjective en doit rester distincte.
Il est inutile d'ajouter que la distinction thorique des deux psychologies, sur laquelle nous avons tant insist, n'entrane nullement dans
la pratique une sparation absolue. C'est la division du travail scientifique qui a amen la division des sciences. C'est l un besoin de l'esprit, qui ne peut pas voir bien toutes choses la fois et qui est oblig
de distinguer pour prciser ; mais les intrts de la mthode abstraite
ne doivent pas l'emporter sur ceux de la science elle-mme. Une fois
bien assurs que nous ne confondrons point les faits subjectifs avec
les faits objectifs, nous ne nous ferons aucun scrupule, toutes les fois
que le besoin s'en fera sentir, d'invoquer le secours de la psychologie
objective et mme de la physiologie, et de leur emprunter les faits
dont nous aurons besoin. Le droit de ces emprunts est vident ; car il
est rciproque, puisque la psychologie objective, de son ct, est force des emprunts semblables, sans lesquels elle ne pourra faire un
pas. Ces sortes d'emprunts sont d'usage dans toutes les sciences. Nul
doute que l'histoire ne soit distincte de la gographie, et rciproquement. Et, cependant, l'histoire emprunte constamment la gographie,
et la gographie l'histoire. La physique est distincte de la mcanique,
et cependant tous les traits de physique commencent par des notions
mcaniques. La physique emprunte la chimie pour la thorie de la
photographie, la physiologie pour la thorie de la vision ; enfin, les
industries elles-mmes s'empruntent [168] les unes aux autres, sans
cesser pour cela d'tre distinctes.
En rsum, l'tablissement d'une psychologie subjective fonde sur
l'observation intrieure, comme le demandait Jouffroy, reste encore
aujourd'hui la seule base scientifique possible d'une philosophie de
l'esprit humain. Mais cette psychologie n'exclut aucun progrs ; elle
s'accommode avec tous les accroissements que le temps a pu apporter,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
158
et, en particulier, avec tous ceux d'une psychologie objective, compare, exprimentale, comme on voudra l'appeler. Il n'est pas ncessaire
de dtruire ce qui est acquis pour introduire quelque chose de nouveau. Cette mthode rvolutionnaire, si mauvaise en politique, l'est
encore plus dans la science : l, surtout, les rsultats obtenus deviennent la base des rsultats conqurir ; c'est l'ancien qui est la garantie
du nouveau et le gage de l'avenir.
En rsum, il rsulte de la discussion prcdente que la doctrine de
Jouffroy, malgr les dveloppements dont elle a pu tre l'objet trs
lgitimement, est reste victorieuse. Il est dmontr qu'il y a au moins
un objet, savoir le moi, le sujet sentant, voulant et connaissant, qui
est un objet indpendant et irrductible la science extrieure, et que
cet objet peut tre revendiqu par la philosophie. Or, en fait, nous savons que cet objet a toujours fait partie des recherches des philosophes depuis le de Socrate jusqu'au cogito de Descartes.
Reste savoir si cet objet est le seul que puisse revendiquer la philosophie. C'est ce que nous verrons dans les leons suivantes.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
159
[169]
Introduction la science philosophique
Leon X
OBJET DE LA PHILOSOPHIE :
(SUITE)
2 Les sciences mtaphysiques
Retour la table des matires
Messieurs,
Nous avons tabli avec de longs dveloppements l'existence et le
droit d'un ordre de sciences spciales, savoir les sciences psychologiques. Avec elles peut-on dire que la srie des sciences soit acheve,
que la table en soit complte ? Nous ne le pensons pas.
Au del et au-dessus de toutes les sciences spciales, y compris la
psychologie, n'y a-t-il plus rien ? n'y a-t-il que le vide ?
Nullement ; nous prtendons qu'il existe encore un ordre de
sciences nouveau, qui doit tre plac en dehors et au-dessus des
sciences de la nature et des sciences de l'humanit.
1 En effet, il y a d'abord au moins ceci, savoir rmunration et la
classification des sciences. Ce que nous avons rsum prcdemment
peut devenir objet de science, matire de science. On ne peut numrer les sciences sans les dcrire, sans en fixer l'objet, le but, la mthode, l'importance relative, les corrlations et les dpendances, enfin
sans les ranger dans un certain ordre. De l une science gnrale sup-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
160
rieure aux sciences particulires, et que l'on pourrait appeler l'pistmographie ou pistmotaxie. En un mot, que le positivisme nie l'existence d'une science suprieure appele mtaphysique, je le veux bien ;
mais il ne niera pas l'ide d'une science gnrale venant aprs les
sciences particulires. Pour les rsumer, les enchaner et les synthtiser, il doit reconnatre au moins ceci, savoir une place faire la
philosophie positive. Mme en se restreignant dans ces limites, il y
aura une philosophie premire.
[170]
Comment l'appellera-t-on ? On craint de l'appeler mtaphysique,
parce que ce mot semble indiquer une solution dogmatique sur la nature et l'essence des choses. Mais si l'on considre l'origine historique
du mot ; si ce sont, comme on l'a dit, les diteurs d'Aristote qui ont
intitul son ouvrage sur la philosophie premire, , ce qui
vient aprs la physique, il n'y aurait nulle improprit appeler de ce
nom toute conception quelle qu'elle soit qui, venant aprs la physique,
c'est--dire aprs les sciences particulires, jouerait le rle de philosophie premire. 14 En ce sens, il est trs juste de dire qu'une gnralisation de sciences est une mtaphysique de la science.
Constatons donc d'abord qu'au-dessus des sciences particulires il
y a place pour une philosophie des sciences et pour une philosophie de
la science.
2 Mais cette philosophie de la science, mme au point de vue positif, peut s'entendre de deux manires : ou bien elle est purement formelle, comme dans Auguste Comte, ou elle devient objective et relle,
comme dans Herbert Spencer. Voyons la diffrence de ces deux
points de vue.
La philosophie premire, telle que l'entend Auguste Comte, n'a pas
pour objet les choses elles-mmes, mais seulement les sciences qui
s'occupent de ces choses. Il n'y a pas de philosophie de l'univers ; il
n'y a philosophie que des sciences de l'univers. Sur chacune de ces
sciences, il se pose les quatre questions suivantes : 1 Quel est l'objet
de cette science ? quelle en doit tre la dfinition ? 2 Quelle en est la
mthode ? 3 Quels en sont les rapports avec les autres sciences ? 4
14
Le chef actuel du positivisme, M. Lafite, a intitul son dernier ouvrage : Essai
de philosophie premire.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
161
Quelle en est l'influence sur le progrs intellectuel de l'humanit ?
Sans doute, en rpondant ces quatre questions, Auguste Comte atteignait indirectement les choses elles-mmes, mais seulement travers
des considrations purement logiques sur la nature des sciences.
Mais ne peut-on pas concevoir une autre philosophie positive [171]
que celle d'Auguste Comte, une philosophie qui traverserait les
sciences pour aller aux choses ; qui, au lieu de s'arrter des considrations logiques sur les sciences, passerait la considration gntique
des phnomnes ; qui, au lieu de se borner dire comment les
sciences s'enchanent, chercherait comment les phnomnes s'enchanent ; qui, au lieu de se borner cette loi subjective, que notre esprit
va du simple au compos, transporterait cette loi dans la nature ; qui
nous dirait que c'est la nature qui avant nous va du simple au compos, du plus facile au plus difficile ; en un mot, qui substituerait l'volution subjective des sciences une volution objective enveloppant
tous les phnomnes de l'univers sous une mme loi ?
Si donc il y a place pour une philosophie positive, considre
comme philosophie premire, n'y a-t-il pas place aussi pour une philosophie de l'volution ? Nous aurions alors deux formes de la philosophie positive : l'une formelle et logique, l'autre relle et objective. On
ne peut pas dire que l'une soit moins lgitime que l'autre ; et la premire n'a gure d'intrt qu'en tant qu'elle conduit la seconde : car si
nous nous intressons l'ordre et la liaison des sciences, c'est parce
que nous nous intressons l'ordre et la liaison des phnomnes. Au
fond, ce que nous voulons savoir et ce qui est le principe de l'activit
philosophique, c'est l'explication de l'unit de l'univers. C'est ce sentiment instinctif de l'unit de l'univers qui nous pousse rechercher
l'unit scientifique. Chercher relier les sciences les unes aux autres,
c'est chercher mettre dans le cadre de nos recherches scientifiques
l'ordre et l'harmonie que nous voyons dans les choses. Donc la philosophie positive enveloppe inconsciemment la philosophie de l'volution, ou toute autre semblable, en un mot une philosophie cosmologique. Elle ne peut donc la rcuser et lui fermer la voie : celle-ci existe
au mme titre qu'elle-mme. Elle est, aussi bien qu'elle, plus qu'elle
encore, une philosophie premire.
Mais dj nous nous rapprochons beaucoup de ce que l'on [172]
appelle gnralement une mtaphysique. Nous avons dj fait remarquer que la philosophie grecque son origine n'a t qu'une philoso-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
162
phie de l'volution. Tous les premiers philosophes grecs sont partis de
l'ide d'une substance unique qui, par des condensations et des rarfactions alternatives, a donn naissance tous les phnomnes de la
nature. N'est-ce pas la loi que M. H. Spencer appelle loi de l'intgration et de la dsintgration ? On peut dire aussi que la philosophie
d'Aristote, qui n'est qu'un passage continuel, une ascension progressive de la matire la forme, est encore, mme en admettant un certain principe de discontinuit, une philosophie de l'volution. la vrit, la vieille mtaphysique s'appliquait surtout la recherche des
principes hyperphysiques ; mais elle avait une partie qui se bornait
la considration du monde, et que Kant appelait la cosmologie rationnelle. Or, on se demande de quel nom on pourrait qualifier l'volutionnisme d'Herbert Spencer, si ce n'est du nom de cosmologie ; et si
l'on fait observer que l'ancienne cosmologie posait des problmes que
l'volutionnisme n'examine pas, savoir l'infinit du monde, la divisibilit de la matire, etc., toujours est-il que c'est une vue d'ensemble
sur le dveloppement des choses, et en cela une sorte de mtaphysique. Si l'on nous oppose que cette cosmologie nouvelle se fait avec
une somme de connaissances empruntes aux sciences, nous aurons le
droit de rpondre que c'est ce qui a toujours eu lieu. La cosmologie
s'est toujours inspire de la science du temps ; souvent aussi elle l'a
prcde, et a anticip sur l'avenir. C'est ainsi que Dmocrite a anticip sur la chimie moderne, que l'axiome des anciens, Ex nihilo nihil,
anticipe sur ces deux principes de la science moderne : Rien ne se
cre, rien ne se perd. La quantit de matire reste toujours la mme.
De mme Descartes, par son mcanisme universel, a anticip sur le
mcanisme scientifique moderne, et sa thorie de l'automatisme a prpar la thorie des actions rflexes. Dans tous les temps la cosmologie
a emprunt la science ou a anticip sur la science. Au reste, il en est
[173] encore de mme aujourd'hui. Est-ce que l'volutionnisme de
Spencer reprsente exactement les donnes scientifiques actuelles ?
N'y a-t-il pas encore beaucoup faire pour que la science justifie ses
inductions ? Par l, l'hypothse de Spencer ressemble aux grandes hypothses cosmogniques ou cosmologiques proposes par la mtaphysique du pass.
Ainsi le positivisme se trouve plac dans cette alternative : ou bien
de s'en tenir la position d'Auguste Comte, c'est--dire de borner la
philosophie la juxtaposition d'un certain nombre de propositions ma-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
163
trielles empruntes aux sciences spciales, en y ajoutant des considrations gnrales, mais purement logiques, sur les sciences ; ou
bien, s'il veut dpasser ce maigre domaine, accepter la philosophie
d'Herbert Spencer, ou toute autre analogue, et par l rentrer en partie
dans les voies de la mtaphysique. Or, si nous consultons l'tat actuel
du monde philosophique, il nous semble que le positivisme du prsent
est beaucoup plus celui d'Herbert Spencer que celui d'Auguste Comte.
Le pur comtisme n'a plus gure d'adhrents en France ; la seule revue
positiviste qui et quelque action a succombe. C'est donc en tant
qu'volutionnisme que le positivisme actuel est puissant. Or, encore
une fois, en quoi les Premiers Principes de Spencer diffrent-ils des
Principes de la philosophie de Descartes, ou mme de la Physique
d'Aristote, si ce n'est par le bagage scientifique d la diffrence des
temps ? Sans doute il y a dans Spencer des donnes scientifiques que
Descartes ne possdait pas, comme il y en a dans Descarles d'autres
qu'Aristote n'avait pas connues. Mais ces trois ouvrages n'en sont pas
moins du mme genre et se rattachent une mme science.
Il importe sans doute assez peu que l'on appelle ou que l'on n'appelle pas mtaphysique cet ordre de recherches. Toujours est-il qu'il y
a une philosophie premire, distincte des sciences proprement dites et
qui leur est suprieure, en ce sens qu'elle vient aprs elles pour les unir
et les couronner. C'est cette science que les Allemands appellent philosophie de la nature, science plus ou moins suspecte aux [174] savants de profession, comme la Philosophie de l'histoire (y compris
celle de Comte) l'est aux historiens, mais qui n'en rpond pas moins
un besoin lgitime de l'esprit, savoir le besoin de synthse et de gnralit. Ce besoin, Auguste Comte a toujours dclar qu'il fallait lui
donner satisfaction. Il a toujours blm, et mme avec une certaine
hauteur, les savants qui ne savent pas s'lever au-dessus de leur spcialit. Une philosophie de la nature est donc lgitime et indispensable.
Maintenant il faut reconnatre que M. Herbert Spencer reste fidle
aux donnes de l'cole positiviste, en ce qu'il affirme que la science ne
peut pas s'tendre au del de l'univers phnomnal et des donnes exprimentales. Tout ce qui n'est pas objet immdiat d'exprience, ou
rductible quelque objet immdiat d'exprience, n'est pas objet de
science, ou mme objet de connaissance. Il spare la ralit en deux
domaines : le domaine du relatif ou du connaissable, et le domaine de
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
164
l'absolu ou de l'inconnaissable. La mtaphysique, en tant que science
de l'inconnaissable, est donc limine du domaine des sciences ; elle
n'a pas d'objet, elle n'est rien.
Il faut y regarder de plus prs. Il n'est peut-tre pas aussi facile que
l'on croit de sparer le domaine du connaissable et celui de l'inconnaissable ; et un peu de mtaphysique ne serait peut-tre pas inutile
pour faire voir les difficults du problme. La science doit se borner
aux phnomnes, dit-on. Trs bien ; mais qu'est-ce qu'un phnomne ?
Peut-il y avoir phnomne sans qu'il y ait de l'tre quelque degr ?
La science se borne la sensation ; j'y consens ; mais qu'est-ce qu'une
sensation ? Peut-il y avoir sensation sans qu'il y ait quelque ide,
quelque pense ? Platon a montr, dans le Thtte, que l'ide de phnomne, c'est--dire de quelque chose d'essentiellement fluide, toujours en mouvement, en gnration, , comme il s'exprime,
est contradictoire, qu'il faut un certain principe de fixit et d'unit pour
qu'on puisse dire d'une chose qu'elle est ceci ou cela. Car si son essence est de changer, l'instant mme o vous dites [175] qu'elle est
ceci, elle est dj devenue cela, et par consquent elle n'est ni l'un ni
l'autre. Ne faut-il pas quelque chose qui persiste ? Le phnomne suppose l'tre quelque degr, et par consquent la sensation suppose la
pense. Mais si le phnomne contient dj de l'tre, si la sensation
contient de la pense, vous ne pouvez rduire le connaissante au phnomne et la sensation sans les dtruire l'un et l'autre. Quel est donc
le principe d'unit li indissolublement la sensation ? Quelles en sont
les lois ? Admettons que ce soit l'inconnaissable : il faudra au moins
reconnatre que l'inconnaissable est ml au connaissable, qu'il en
constitue l'essence, et par consquent qu'il n'est pas entirement inconnaissable. Admettez-vous au contraire que l'inconnaissable est tout
fait en dehors du connaissable qu'est-ce alors que cet inconnaissable
transcendant ? Est-ce quelque chose comme l'espace et le temps,
comme l'me ou la libert ? Mais ce sont l des principes plus ou
moins lis la ralit phnomnale. Est-ce un absolu en dehors de
toute ralit ? Quel est cet absolu ? Est-il positif ou ngatif ? Est-il la
mme chose que l'infini ou lui est-il oppos ? Que de questions
examiner pour fixer d'une manire certaine les choses auxquelles
l'homme ne doit pas penser ! Suffira-t-il, pour carter toutes ces questions, de l'argument vulgaire des dissentiments philosophiques, sans
se demander si ces dissentiments vont aussi loin qu'on le dit ou qu'on
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
165
le croit, s'ils ne pourraient pas tre classs ou tags en quelque sorte
en propositions plus ou moins disputes, dont quelques-unes sont
presque communes toutes les coles et par consquent plus gnrales, les autres moins gnrales, jusqu' ce qu'on arrive aux propositions les plus prcises, qui constituent alors seulement les dissentiments irrductibles ? Suffira-t-il d'opposer toutes ces recherches
cette fin de non-recevoir, tire de l'opposition des systmes de mtaphysique ? Ne faut-il pas traiter les questions en elles-mmes ? En un
mot, n'y a-t-il pas l place pour une science nouvelle, la critique de la
connaissance ? La science suprieure que nous cherchons ne sera
[176] donc plus seulement une thorie des sciences, ou une philosophie de la nature. Elle sera encore une idologie ou analyse de l'entendement humain, ou une critique de la science et de la connaissance
humaine. La philosophie premire sera donc une critique de la pense,
elle existera au mme titre que les autres sciences.
Nous sommes donc ici en prsence d'un autre systme, d'une autre
cole. Du positivisme nous passons au criticisme. Le criticisme aussi
bien que le positivisme se refuse admettre une mtaphysique. Il prtend que l'esprit humain ne peut pas dpasser ses propres limites, et
qu'il ne peut pas s'lever au-dessus d'une science purement humaine.
Soit ; mais ce n'est pas l nier la mtaphysique, c'est simplement la
limiter et la circonscrire : car dans tous les temps le problme de la
valeur et des limites de la connaissance a t pos et a fait partie des
problmes de mtaphysique. Le Thtte de Platon, le Discours sur la
Mthode, les Nouveaux Essais sur l'entendement, la Recherche de la
vrit, sont videmment des traits de critique de la connaissance. Le
criticisme a dtach ce problme ; il l'a spar des autres et il l'a formul d'une manire prcise en demandant comment on peut passer du
domaine subjectif au domaine objectif. Il est arriv certaines conclusions qui lui sont propres ; mais il n'en est pas moins un rameau conserv de l'ancienne mtaphysique.
Ainsi du domaine possd et explor par la mtaphysique il subsisterait au moins deux rgions occupes et vivantes, savoir la philosophie de la nature et la critique de la connaissance. Mais n'y a-t-il pas
encore quelque chose de plus ?
Supposons que la critique de la connaissance d'une part et la philosophie de l'volution de l'autre aient russi, comme elles le prtendent,
par des mthodes diffrentes, sparer la connaissance humaine en
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
166
deux parties distinctes, savoir le phnomne et le noumne, le connaissable et l'inconnaissable, d'un ct le relatif, de l'autre l'absolu :
ces deux domaines, qui se touchent et. se bornent l'un l'autre, [177]
sont-ils aussi spars qu'on le prtend ? Sont-ils l'un l'autre comme
quelque chose est rien ? Si le domaine qui dpasse le relatif n'est que
le domaine du nant, pourquoi en parlons-nous, pourquoi l'opposonsnous au relatif ? pourquoi le relatif ne serait-il pas tout ? Mais s'il est
tout, ne devient-il pas par l mme l'absolu ? et c'est l encore une solution mtaphysique ; car dire, par exemple, que le monde se suffit
lui-mme, ce n'est point carter la mtaphysique, c'est tout simplement
affirmer une mtaphysique la place d'une autre. Ds lors, le champ
est ouvert la comptition des autres systmes. Si, au contraire, on
revient la distinction du connaissable et de l'inconnaissable, est-il
donc bien certain que ces deux domaines ne pntrent pas l'un dans
l'autre, qu'ils soient absolument l'un hors de l'autre ? Une telle sparation est-elle rationnelle ? Il ne le semble pas. Aussi ne s'y tient-on pas
la rigueur. Soit que, avec M. Spencer, on affirme que l'inconnaissable se manifeste par le moyen du connaissable ; soit que, avec Kant,
on affirme que l'absolu se manifeste dans l'ordre pratique et moral,
dans l'un et l'autre cas on affirme un certain lien entre les phnomnes
et les noumnes, entre le connaissable et l'inconnaissable. On admet
donc que l'inconnaissable est connaissable dans une certaine mesure.
Or, cette mesure ne peut tre fixe que par l'examen mme de la question ; sans anticiper sur les solutions, sans en prjuger aucune, il reste
qu'il y a place pour une science de l'inconnaissable, dans la mesure o
il touche au connaissable et y pntre. ce titre, il y aura donc encore
place pour une mtaphysique ou pour quelque chose d'analogue.
Reste enfin une dernire considration. Nous avons distingu les
sciences en deux classes : les sciences de la nature et les sciences de
l'humanit ; en termes plus abstraits, la science de l'objectif et la
science du subjectif. Nous avons vu qu'on peut indiffremment considrer le sujet comme dpendant de l'objet, ou l'objet comme dpendant du sujet. Le positivisme exclut absolument la seconde de ces
dpendances ; l'idalisme [178] en exclut la premire. Elles sont
vraies toutes deux, et, au point de vue purement empirique, on doit
admettre l'une et l'autre. La science se trouve donc par l ramene un
dualisme qui ne satisfait pas l'esprit. Empiriquement, on peut partir
soit de l'un soit de l'autre de ces deux points de vue, et admettre ainsi
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
167
deux sries de sciences ; mais la pense va plus loin ; elle cherche la
conciliation. Il y a donc l un nouveau problme. Quel est le vrai rapport du subjectif et de l'objectif ? Quel est le lien qui les unit ? Quel
est le premier des deux termes ? En un mot, d'o viennent la nature et
l'humanit ? Nous arrivons ici la mtaphysique proprement dite, qui
sera le terme de cette recherche.
Ainsi l'existence d'une science fondamentale, science premire et
science centrale, laquelle toutes les autres aboutissent et dont elles
relvent toutes, se trouve justifie par une srie de preuves ascendantes en quelque sorte, qui nous en montrent les diffrents degrs.
Cette science est lgitime et ncessaire :
1
En tant que philosophie positive ou logique des sciences ;
En tant que synthse de l'univers, soit sous la forme de philosophie de l'volution, soit sous toute autre forme ;
En tant que critique de la connaissance ;
En tant que science de l'inconnaissable, dans la mesure o
il est connaissable ;
Enfin en tant que synthse finale, ou synthse des sciences
de la nature et des sciences de l'humanit.
Or, tous ces points de vue runis constituent la science mme appele mtaphysique depuis Aristote jusqu' Hegel.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
168
[179]
Introduction la science philosophique
Leon XI
UNIT DE LA PHILOSOPHIE
Retour la table des matires
Messieurs,
Dans les deux leons prcdentes, nous avons dmontr l'existence
de deux sciences dont l'objet n'est pas compris dans le domaine des
sciences positives : 1 la science des faits de conscience, ou psychologie ; 2 la science de la plus haute gnralit possible, ou mtaphysique. Chacun de ces objets (le moi ou la plus haute gnralit possible) peut tre considr comme un bonum vacans dont une science a
droit de s'emparer. Donc il y a deux sciences distinctes des sciences
positives et particulires.
Maintenant, avons-nous le droit de runir ensemble ces deux
sciences, de leur donner un nom commun, le nom de philosophie, et
ne nous reste-t-il pas encore voir si les objets de ces deux sciences
concident avec ceux que l'on attribue gnralement la philosophie ?
Car il n'est pas besoin d'une grande attention pour voir que ce sont
prcisment les objets que l'on attribue en gnral la philosophie, qui
a toujours compris d'une part la science de l'esprit humain, de l'autre la
science des premiers principes et des premires causes. Ces deux objets exigent une science. La philosophie a toujours rclam ces deux
objets de la philosophie : donc ce sont les objets de la philosophie.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
169
Mais nous rencontrons ici une difficult plus dlicate. Nous donnons la philosophie deux objets diffrents, d'une part la science psychologique, de l'autre la philosophie premire. Les anciens disaient :
Philosophia est notitia rerum humanarum divinarumque. Mais comment une mme science peut-elle [180] avoir deux objets aussi diffrents que l'homme et Dieu ? Si l'on veut conserver l'universalit primitive, il faudra ajouter un troisime terme, le monde, et dire avec Bacon
que la philosophie a un triple objet : l'homme, le monde et Dieu. Mais
alors, la philosophie ira se confondre avec la totalit des autres
sciences, et elle cessera d'avoir un objet elle, un objet dtermin ?
Pour carter tout d'abord cette dernire difficult, disons que si la
philosophie parle du monde, ce ne peut tre que du monde en gnral
qu'il est question : car pour les parties du monde, elles sont les objets
des sciences spciales. Mais tout ce qui concerne le monde en gnral
rentre dans ce que nous avons appel la science des plus hautes gnralits. Car il est possible qu'il n'y ait rien au del du monde ; et quand
mme il y aurait quelque tre au del, la science des plus hautes gnralits aurait toujours s'occuper de la substance du monde (essence
de la matire), de son tendue, de ses limites, de l'ordre gnral des
phnomnes, en un mot de tout ce qui, d'aprs Kant, constitue la troisime partie de la philosophie premire, savoir la cosmologie rationnelle.
Laissons donc de ct cette difficult secondaire ; reste la vraie la
question de savoir comment on peut runir en une mme science deux
objets aussi diffrents l'un de l'autre que, d'un ct l'esprit humain, de
l'autre l'ensemble et l'origine des choses.
Sans doute, s'observer soi-mme peut tre l'objet d'une tude spciale.
Sans doute, gnraliser le plus possible tous les phnomnes de
l'univers est aussi une lude des plus lgitimes.
Mais il y a l deux mthodes, deux domaines, et par consquent
deux philosophies, et non pas une seule.
Et cependant l'histoire est l qui nous montre que tous les grands
philosophes ont eu la fois, et ml souvent d'une manire indissoluble, une psychologie et une mtaphysique. Platon mle sans cesse
ses recherches sur l'me avec les recherches sur les ides et sur le di-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
170
vin. Descartes, dans ses [181] Principes de la philosophie, fait entrer
la fois une certaine thorie psychologique de la connaissance et une
mtaphysique. Dans l'thique de Spinoza, aprs le premier livre (de
Deo) vient le second (de Mente) et le troisime (de Affectibus). Dans
Kant mme, vous avez une anthropologie et une critique de la connaissance. Enfin, de nos jours, M. Herbert Spencer a runi dans tous
ses traits une cosmologie, une psychologie, une biologie, une
thique, exactement comme les autres philosophes.
L'histoire mise part, si nous consultons maintenant l'opinion
commune, l'opinion gnrale, on trouve que les deux traits caractristiques de ce qu'on appelle l'esprit philosophique correspondent aux
deux ordres d'tudes et de sciences que nous avons signals.
D'un ct, en effet, le philosophe est celui qui rentre en lui-mme,
qui s'tudie lui-mme, qui se rend compte de ses ides, qui rflchit,
ce qui signifie prcisment l'acte de revenir sur soi-mme. L'un des
traits caractristiques du philosophe est donc l'esprit de rflexion.
D'un autre ct, tout le monde reconnat aussi que l'un des traits caractristiques de l'esprit du philosophe est le got des ides gnrales,
des vues d'ensemble, l'esprit de synthse ; c'est ce que Platon exprime
lorsqu'il dit : , c'est--dire celui qui voit
tout d'ensemble. En crant un barbarisme par voie d'analogie, on pourrait exprimer la premire ide en disant aussi :
, celui qui se voit lui-mme.
On rsume ces deux ides en disant que l'autopsie et la synopsie,
c'est--dire l'esprit de rflexion et l'esprit de synthse, constituent les
deux formes de l'esprit philosophique.
Reste toujours la question de l'unit.
Si cependant on pouvait trouver un fait dans lequel se fondraient
les deux concepts prcdents, peut-tre trouverait-on l ce qui sert de
fond commun aux deux groupes de sciences signales et qui serait
l'objet unique de la philosophie.
Ce fait, c'est la pense.
[182]
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
171
La pense a, en effet, un double caractre : 1 elle se sait ellemme et elle peut revenir sur elle-mme ; 2 elle est la facult de lier,
d'unir, de gnraliser : elle est une synthse.
L'esprit de rflexion et l'esprit de synthse se runissent donc dans
le fait de la pense. On peut donc dire que la pense, considre
comme telle, est l'objet propre de la philosophie. Cette science peut se
dfinir la science de la pense, ou, pour emprunter Aristote la formule qu'il applique l'acte pur, on dira : La philosophie est la pense de la pense.
Appliquons cette dfinition toutes les parties de la philosophie.
1 La psychologie a pour objet les faits de conscience. Or c'est ce
que Descartes appelle des penses. Qu'est-ce qu'une chose qui
pense ? C'est une chose qui doute, qui entend, qui conoit, qui affirme,
qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. C'est
donc l'ensemble de ces faits de conscience qui constitue les penses.
tudier la conscience, c'est tudier la pense.
2 La logique est la science des lois rgulatrices de la pense : c'est
donc la pense de la pense.
3 Les ides du Beau et du Bien sont au nombre des ides fondamentales de la pense. L'esthtique et la morale sont des sciences qui
ont pour objet la pense de la pense.
4 Reste la mtaphysique ou philosophie premire, c'est--dire la
science des premiers principes et des premires causes ou, si l'on ne
veut pas aller jusque-l, la science des plus hautes gnralits possibles.
Or la loi de la plus haute gnralit possible est la loi fondamentale
de la pense. Tous les autres objets de la science, tous les objets particuliers nous sont donns : les minraux, les vgtaux, les animaux, les
phnomnes physiques sont donns. Mais la plus haute gnralit possible n'est pas donne ; c'est un besoin de l'esprit ; c'est la loi impulsive de notre pense. Que contient cette loi ? Qu'implique-t-elle ?
C'est ce que la science elle-mme nous apprendra. Mais, quelle que
soit cette loi, il n'en est pas moins vrai que la science [183] qui a pour
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
172
guide la loi fondamentale de la pense est bien, on peut le dire, la
science de la pense elle-mme, et peut tre dfinie la pense de la
pense.
la vrit, la mtaphysique, qui est la science la plus haute de
toutes, et qui repose la fois d'un ct sur les sciences objectives, de
l'autre sur l'tude de l'esprit humain, doit tre conue comme tant
l'unit du subjectif et de l'objectif : et la notion de la plus haute gnralit possible contient la fois des lments objectifs et des lments
subjectifs. La mtaphysique n'est donc pas seulement la science du
sujet, c'est--dire la science de la pense ; elle doit tre aussi la science
de l'objet ; et ce serait la restreindre que de la rduire n'tre que la
pense de la pense.
Sans doute il ne faut pas oublier que la science de la plus haute gnralit possible comprend la fois les deux mondes, et que par l elle
s'lve au-dessus de la psychologie proprement dite. Elle n'est pas
seulement la science de la pense, elle est encore la science de l'tre ;
par l elle ne se rallie pas seulement aux sciences psychologiques,
mais encore aux sciences cosmologiques ; elle est le confluent des
deux courants antrieurs. Mais de ces deux courants l'un est conscient,
l'autre est inconscient. La pense se demande quelle est son origine et
son essence ; le monde ne se le demande pas. La pense recherche
quel lien l'attache au monde ; le monde ne demande pas quel lien l'attache la pense. La science qui traite des rapports de la pense et du
monde est donc encore une science de la pense par la pense.
On peut dmontrer la mme vrit d'une manire plus profonde. Ce
que la pense recherche dans le monde, c'est l'intelligible. Le monde
ne devient objet de science qu'en tant qu'il est une logique, et un objet
de l'art qu'en tant qu'il est une esthtique. Il y a une logique de la nature. Sans quoi, on ne pourrait pas construire d'avance la science de la
nature comme l'on fait l'aide des mathmatiques. La nature est donc
aussi une pense, mais une pense objective, inconsciente, une pense
en soi. Dans la conscience, la [184] pense devient subjective, s'apparat elle-mme ; elle est pour soi.
Dans la plus haute gnralit possible, la pense en soi doit s'accorder avec la pense pour soi. Tel est le problme de la mtaphysique. Dans ce sens, il sera donc vrai la rigueur de dire que la mta-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
173
physique, comme les autres parties de la philosophie, est la pense de
la pense.
l'aide de cette dfinition, nous distinguerons facilement la philosophie des autres sciences. Les savants pensent les objets. Les philosophes pensent la pense des objets. Le savant a pour objet les astres,
les plantes, les animaux. La philosophie a pour objet la pense de ces
choses. Jamais le savant ne revient sur la pense pour l'examiner en
tant que pense, ou, quand il le fait, il est par l mme philosophe ;
mais il le fait rarement, et seulement dans des notes, dans des prfaces, mais non dans des traits spciaux. Le gomtre se sert constamment de l'ide d'espace, de temps, de mouvement. Il ne se demande pas quel titre il pense l'espace, le temps, le mouvement. Le
physicien accepte l'existence des corps ; il ne se demande pas quel
titre il pense qu'il y a des corps. Il emploie des mthodes. Il ne se demande pas quels sont les principes et les rgles de ces mthodes.
Voil donc une ligne de dmarcation nette entre la philosophie et
les sciences. On pourra aussi, l'aide de cette mme dfinition, essayer de classer les diffrents systmes de philosophie et apprcier
dans quelle mesure ils sont ou ne sont pas philosophiques, et comment
ils le sont plus ou moins les uns que les autres.
Nous avons dfini la philosophie la pense de la pense. Cette dfinition nous a servi distinguer la philosophie de la science. La
science pense le monde, la philosophie pense la pense du monde. La
science est objective ; la philosophie est subjective, du moins immdiatement ; elle est objective mdiatement.
Nous allons essayer, l'aide de cette formule, de classer et de
coordonner les uns par rapport aux autres les divers systmes de philosophie.
[185]
Au plus bas degr de l'chelle, nous plaons le matrialisme.
Le matrialisme, en effet, a bien, comme tous les systmes, pour
objet la pense de la pense ; mais il lui est impossible de penser la
pense en elle-mme. Il ne peut la saisir que dans son substratum matriel. La pense l'embarrasse, et il cherche la rduire le plus possible. S'il ne tenait qu' lui, la pense n'existerait pas et ne subsisterait
pas. Traduire en effet la pense en fonction crbrale, c'est la traduire
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
174
en ce qui n'est pas elle, en ce qui n'a aucun rapport avec elle. Car quel
rapport y a-t-il entre un fait de conscience et une forme ronde ou carre, un mouvement circulaire ou rectiligne ? Ce systme est un premier effort philosophique sans doute, puisqu'il l'interroge sur la nature
et l'origine de la pense ; mais c'est un effort qui ne s'est pas encore
dgag du monde extrieur ; il ne s'applique pas la pense comme
tel, en tant qu'elle apparat une conscience. Aussi voit-on que le matrialisme ne lient aucun compte du fait de conscience ; il n'en parle
jamais ; c'est pour lui un fait non avenu. C'est donc le systme qui est
le plus loin possible de l'objet propre de la philosophie, savoir la
pense de la pense.
Au-dessus du matrialisme nous plaons le positivisme. Le positivisme, en effet, quand il est consquent avec lui-mme, ne considre
la matire que comme la condition de la pense, et non comme son
substratum, puisqu'il j'carte toute notion de substratum, toute notion
de premire origine. Ce systme laisse donc libres toutes les conceptions mtaphysiques sur la matire et l'origine de la pense. Ces conceptions n'ont de valeur pour lui qu' titre de conceptions subjectives,
mais non scientifiques ; pour lui, aucune de ces conceptions ne s'impose l'esprit, et pas plus la conception matrialiste que les autres. La
pense se trouve donc indirectement et provisoirement affranchie du
substratum matriel ; elle peut tre pense sans lui. En fait, les positivistes ne restent pas souvent fidles cette neutralit, et ils s'expriment presque toujours comme les matrialistes eux-mmes ; mais cela
est [186] contraire l'esprit mme du systme ; car ou nous ne connaissons pas les choses en soi, mais seulement les apparences des
phnomnes, et par consquent nous ne pouvons rien tablir sur le
principe de la pense : elle est donc une science hypothtique, distincte de la matire, ds lors point de matrialisme ; ou bien nous affirmons dogmatiquement que la pense est une proprit de la matire ; nous prononons sur les choses en soi, et ds lors plus de positivisme. Il est donc certain que le positivisme, comme tel, rend au
moins possible l'indpendance de la pense, et par l se rapproche plus
que le matrialisme du vritable objet de la philosophie.
En second lieu, il est encore vrai de dire que le positivisme se rapproche de cet objet, savoir la pense de la pense, en tant qu'il se
donne comme une philosophie des sciences. Il n'est pas une science ;
mais il est une critique des sciences, une gnralisation des sciences.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
175
Il revient sur les ides fondamentales de chaque science, sur leurs mthodes, sur leur importance intellectuelle et morale. Le positivisme ne
pense donc pas les objets ; mais il pense la pense scientifique de ces
objets. Or cela est essentiellement philosophique. Aussitt qu'un savant raisonne et rflchit sur les principes de la science, il devient philosophe. Rflchir sur les principes de toutes les sciences et lier ensemble toutes ces rflexions, c'est donc, fortiori, faire uvre de philosophie.
Cependant, si le positivisme est suprieur au matrialisme en ce
qu'il laisse les questions ouvertes, au moins en thorie, car dans la pratique il ne le fait pas toujours, il n'est encore pas tout fait philosophique, parce qu'il ne considre pas le fait de la pense en lui-mme
comme fait sui generis, comme fait de conscience. Pas plus que le matrialisme, il ne reconnat le fait de conscience ; il ne le voit que par
son rapport avec le cerveau. Il ne croit pas que l'esprit puisse se reconnatre lui-mme. Il ne voit la pense que sous sa forme scientifique. Sans doute il est philosophe, en tant qu'il rflchit la science ;
mais tout le concret, tout le contenu de cette philosophie est emprunt
aux sciences ; elle n'est que la servante [187] des sciences, ancilla
scientiarum, comme la philosophie du moyen ge tait la servante de
la thologie. Si les sciences ne lui fournissaient ses donnes, elle n'aurait rien dire. Ce n'est donc pas une philosophie indpendante ; elle
est, au contraire, essentiellement dpendante ; sur chaque problme,
elle est oblige d'attendre les rsultats de la science positive. Comme
philosophie, elle n'a pas de domaine propre, elle n'a pas de contenu
elle : et en cela elle n'est pas une philosophie.
Le matrialisme et le positivisme ont un caractre commun : c'est
de ne s'appuyer que sur le dehors ; ce sont deux philosophies exclusivement objectives. Elles sont l'une et l'autre en quelque sorte la
science elle-mme devenue philosophie. Elles ne sont philosophiques
que relativement, en ce sens qu'elles tmoignent d'un certain besoin de
rflexion et de gnralit, mais au fond elles appartiennent plutt au
domaine scientifique qu'au domaine philosophique. Dans le conflit qui
s'lve entre la science et la philosophie, elles sont invitablement du
ct des sciences ; c'est le fait extrieur ramen le plus prs possible
des faits intrieurs par la puissance de la rflexion, mais c'est toujours
le fait extrieur qui est la base et la matire de la pense ; ce n'est pas
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
176
la pense elle-mme, ce sont des tendances vers la philosophie ; ce
n'est pas encore la philosophie.
Nous entrons dans la philosophie proprement dite avec une philosophie que l'on a souvent appele du nom de positivisme, mais qui
s'en distingue profondment : c'est le phnomnisme subjectif, tel qu'il
est reprsent en Angleterre par M. Stuart Mill, en France par M.
Taine. C'est le systme qui prend pour objet les faits de conscience,
les faits subjectifs, et qui n'admet gure autre chose que des faits subjectifs. C'est le phnomnisme de David Hume, reprsent, dit-on,
dans l'antiquit par Protagoras, si du moins l'exposition de Platon dans
le Thtte est fidle. Dans cette philosophie, la pense n'est accepte
qu' titre de sensation, mais au moins le fait de conscience est reconnu
comme tel. Le subjectif n'est [188] point ramen l'objectif soit d'une
manire violente comme dans le matrialisme, soit d'une manire indirecte et dtourne comme dans le positivisme. Le subjectif est tellement l'objet propre de la philosophie que c'est au contraire l'objectif
qui est ramen au subjectif, le corps n'tant que la somme de nos sensations quand il est prsent, et la somme des possibilits de sensation
quand il est absent. Que ce soit l un excs de subjectivisme, cela est
possible ; mais l'excs mme prouve bien que nous avons chang de
principe. La pense, sous la forme la plus humble, qui est la sensation,
est considre en elle-mme et non plus dans son substratum matriel,
ou dans cette application spciale que l'on appelle la science. C'est
bien la pense de la pense ; et mme on peut dire que cette philosophie s'lve au-dessus de sa propre base ; car cette base est la sensation, tandis qu'en elle-mme cette philosophie est une pense ; car la
sensation d'une sensation ne serait pas une philosophie. La sensation
devient objet de philosophie en tant qu'on la pense, en tant qu'on la
rflchit : c'est la pense de la sensation qui est la philosophie : or cela
serait-il possible, si la sensation n'tait que sensation ? Mme l'association des ides, laquelle on a recours comme un deus ex machina, ne suffirait pas encore pour faire une philosophie ; car il faut encore penser l'association. Cette facult de rflexion ou de retour sur
soi-mme parat donc dpasser la sensation elle-mme. Mais la sensation appartient au domaine de la pense, quoiqu'elle n'en soit ellemme que l'lment infrieur. Nous sommes donc ici sur le terrain
propre de la philosophie. Le phnomnisme subjectif est pour nous la
premire doctrine philosophique proprement dite, les deux prc-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
177
dentes (matrialisme et positivisme) appartenant encore au domaine
de la science positive.
Le phnomnisme subjectif est suprieur au positivisme en ce que
celui-ci n'emprunte toutes ses donnes qu'au domaine extrieur et au
domaine des sciences positives, tandis que lui-mme emprunte les
siennes au domaine de la conscience, c'est--dire de la pense. Nanmoins, ce n'est encore qu' la [189] partie infrieure de la pense que
le subjectivisme s'adresse, c'est--dire la sensation. Mais la pense
comme telle ne trouve encore dans ce systme aucune place distincte ;
elle n'y a aucune individualit, aucune force, aucune forme, au point
que l'on se demande comment la sensation peut arriver se penser
elle-mme, s'interroger sur sa nature et son origine. Une philosophie
nouvelle trs suprieure au phnomnisme rpond cette question ;
c'est le criticisme. Le criticisme est bien, proprement parler, une
pense de la pense. La pense, comme telle, y est rpute distincte de
la sensation ; et c'est bien cette pense qui se pense elle-mme. Cette
pense a intrinsquement ses formes, ses lois, ses concepts, son essence propre. Elle aies formes de la sensibilit (l'espace et le temps),
les lois de l'entendement ou catgories (unit, cause et substance, action et raction, etc.) ; elle a des ides : le moi, la matire, Dieu, en un
mot l'absolu. Elle connat titre de possible la libert, et en mme
temps, par une autre de ses fonctions, elle conoit le devoir. Donc,
dans ce systme, la pense a un contenu, un fonds de ralit qu'elle
n'emprunte pas la sensation ; elle a donc une existence propre.
L'analyse et la synthse de la pense est elle-mme une pense : c'est
bien une pense qui se pense elle-mme.
On pourrait mme aller jusqu' dire que, de toutes les philosophies,
la philosophie critique est celle qui correspond le mieux la dfinition, si toutefois on n'entend parler que de la pense subjective. C'est
elle qui a sciemment, systmatiquement, mthodiquement pos le
problme de l'examen et de la critique de la pense par elle-mme.
Nous sommes donc ici en face d'une philosophie vritable et d'une
philosophie suprieure au subjectivisme phnomniste, en ce que la
pense n'est pas seulement la forme de la philosophie, mais qu'elle en
est la matire. Au fond, dans le phnomnisme il y avait bien de la
pense ; car la sensation ne peut pas revenir sur elle-mme en tant que
sensation. Mais la pense se mconnaissait elle-mme en se perdant
tout entire dans la sensation. Ici, dans le criticisme, elle se distingue,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
178
elle s'lve au-dessus de la [190] sensation, elle juge la sensation, elle
se prend elle-mme pour objet.
Mais la pense a-t-elle achev son uvre, s'est-elle saisie tout entire quand elle ne se prend qu' litre de pense subjective n'ayant pas
d'autre fonction que d'tre la forme et la rgle de la sensation ? La
pense n'a-t-elle aucun contenu objectif, sauf la sensation ? S'il en est
ainsi, le criticisme se ramne pratiquement au phnomnisme. La pense n'tant qu'une rgle et une forme, tout ce qu'il y a de rel dans la
pense lui vient de la sensation ; nous ne connaissons rien vritablement que la sensation ou le phnomne. Sans doute nous connaissons
que nous connaissons. Le retour sur la pense et sur la connaissance
se trouve expliqu, la pense n'est pas un rsidu de sensation ; elle
n'est pas un pur rien ; mais elle n'a aucun contenu objectif, sauf appel
ultrieur et passablement artificiel la facult morale. On peut donc
concevoir une philosophie dans laquelle la pense ne serait pas une
pure forme et contiendrait une matire intellectuelle plus ou moins
mle ou sensible, mais qui aurait en elle-mme plus de corps et de
ralit ; en un mot, je puis concevoir une pense pleine au lieu d'une
pense vide. La pense serait la fois subjective et objective ; elle ne
serait pas seulement pense, elle serait lie l'tre, ou mme elle serait
l'tre.
Nous arrivons ainsi la mtaphysique proprement dite, celle qui
ne distingue pas la pense de l'tre, qui admet la fois une pense
subjective et une pense objective et qui les runit l'une et l'autre dans
la pense absolue.
Nous appellerons cette philosophie dans la forme la plus gnrale,
l'idalisme ; mais elle se prsente sous deux formes : le spiritualisme
et le panthisme.
Ces deux doctrines ont les traits communs suivants :
1 Elles se sparent du positivisme en ce qu'elles admettent l'une et
l'autre comme fait part, sui generis, et irrductible le fait de la
pense, et elles l'tudient comme tel.
2 Elles se sparent du phnomnisme en ce qu'elles considrent,
avec le criticisme, la pense comme ayant ses lois et [191] ses
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
179
formes propres, en un mot son essence, et comme tant la loi et
la rgle de la sensation.
3 Enfin elles s'lvent au-dessus du criticisme en s'levant audessus du subjectivisme, en considrant la pense non pas
comme une pure forme, une collection de moules vides attendant la matire de la sensation, matire fluide et chaotique aussi
indtermine en elle-mme que la forme vide de la pense.
Elles admettent que la pense convient l'tre, est adquate
l'tre, qu'elle est la fois subjective ou objective, identit du sujet et de l'objet.
Tel est le point culminant de l'lude de la pense par elle-mme, en
un mot de la philosophie.
Mais ici ces deux conceptions entrent en conflit l'une avec l'autre.
De part et d'autre, on admet comme faits de conscience une pense
subjective et une pense objective, lies l'une l'autre d'une manire
plus ou moins intime ; mais l'une et l'autre sont des penses finies,
limites, contingentes.
De l deux questions :
1 Y a-t-il une pense absolue, existant en soi dans toute sa plnitude, ou bien seulement en tant que substance, fonds, essence
de la pense finie ? La premire solution est celle du spiritualisme ; la seconde, celle du panthisme.
2 Dans la pense absolue o se fondent le sujet et l'objet, est-ce le
sujet qui prime l'objet, ou l'objet qui prime le sujet ? Dans le
premier cas, vous avez ce que l'on appelle le Dieu personnel ;
dans le second, le Dieu impersonnel. La premire solution est
celle du spiritualisme ; la seconde, celle du panthisme.
De ces deux solutions, laquelle rpond le mieux la dfinition que
nous avons donne de la philosophie, savoir la pense de la pense ?
Selon nous, la solution spiritualiste est la plus haute et la plus
large. En effet : 1 elle affranchit la pense absolue des limites de la
pense finie ; 2 elle fait prdominer le sujet sur l'objet : or c'est dans
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
180
le sujet que la pense se sait pense. Une pense qui ne se sait pas,
une pense qui dort, est un rve [192] et non une pense. Le Dieu panthistique est un Dieu somnambule. Le Dieu spiritualiste est un Dieu
veill. Les Dieux veillent, dit Aristote, et ne dorment pas comme
Endymion.
Telle est donc dans son ensemble, d'aprs notre dfinition, l'chelle
et la hirarchie des systmes mtaphysiques, du moins si l'on accorde
que la philosophie est la pense de la pense.
Maintenant y aurait-il une autre philosophie, une philosophie qui
serait encore la pense, mais la pense de quelque autre chose qui serait au del de la pense ? Ce serait une question examiner. Nous
l'indiquons comme question ouverte ; et peut-tre aurons-nous occasion d'y revenir plus tard. Contentons-nous de dire que ce quelque
chose, si on en admet l'existence, est plutt du domaine de la religion
que du domaine de la philosophie La philosophie peut devenir religion ; mais elle n'est pas la religion, et la religion n'est pas la philosophie. On peut admettre cependant qu'il y a un passage du connaissable
l'inconnaissable, et ce passage appartiendra aux deux domaines ;
mais le moment o la philosophie s'chappe elle-mme, se transforme en autre chose qu'elle-mme, ne peut pas tre pris comme le
caractre essentiel de la philosophie : c'en est la limite, mais non le
fond.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
181
[193]
Introduction la science philosophique
Leons XII et XIII
DES RAPPORTS
DE LA PHILOSOPHIE
ET DE LA THOLOGIE
Retour la table des matires
Messieurs,
Aprs avoir essay d'approfondir la question de l'objet de la philosophie, la suite de ces tudes nous amne traiter des rapports de la
philosophie avec tout ce qui l'avoisine, non seulement avec les autres
sciences, mais encore avec tous les ordres d'tudes, toutes les applications d'esprit qui constituent le domaine de l'activit intellectuelle. La
philosophie a des rapports avec tout ce qui touche l'esprit humain,
avec les sciences d'abord, mais aussi avec les lettres, avec l'histoire,
avec la politique, avec la religion. Pour commencer cette analyse par
le ct le plus lev, considrons d'abord les rapports de la religion et
de la philosophie.
En mditant sur ce sujet dlicat, il nous est arriv quelque chose de
semblable ce qui se passa dans l'esprit de J.-J. Rousseau lorsqu'il
voulut concourir, par son premier crit, sur le sujet propos par l'Acadmie de Dijon. On sait que cette Acadmie demandait si le progrs
des lettres et des arts avait t favorable ou contraire l'amlioration
des murs. On raconte (c'est Marmontel qui atteste ce fait dans ses
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
182
Mmoires) que J.-J. Rousseau, tant all voir Diderot. alors prisonnier
au chteau de Vincennes, o il tait enferm pour quelques incartades,
lui annona son dessein de travailler sur cette question. Et quel parti
comptez-vous prendre ? demanda Diderot. L'affirmative, rpond
Rousseau, savoir que les murs ont profit du progrs de la civilisation. Eh quoi ! dit Diderot, c'est le pont aux nes ; c'est le contraire
qu'il faut soutenir, si l'on veut dire quelque chose de [194] nouveau.
Rousseau fut frapp de ce conseil. Il y vit un rle original prendre.
Le gnie du paradoxe s'veilla en lui. Pour dire la vrit, c'tait son
vrai gnie, c'tait sa vraie pense encore enveloppe, que Diderot
avait, sans le savoir, dmle et provoque. Rousseau prit le parti que
l'on sait, qui dcida de sa carrire et l'entrana dans une lutte mort
contre la civilisation.
Toutes proportions gardes, et les diffrences mises part, nous
avons, comme Rousseau, dans l'examen de la question pose, pass du
pour au contre ou, si l'on veut, du contre au pour par des rflexions
quelque peu semblables. En effet, notre premire ide avait t celleci : montrer la diffrence de la philosophie et de la religion, tablir
fortement l'indpendance de celle-ci l'gard de celle-l, l'une fonde
sur la libert d'examen, l'autre sur la croyance l'autorit. Nous comptions mme rclamer, pour la philosophie, le droit de se passer de la
religion ou de se substituer elle, le droit de la critiquer et, s'il le fallait dans l'intrt de la libert de l'esprit, le droit de la combattre. Enfin
nous voulions nous placer exclusivement au point de vue de ce qu'on
appelle la libert de la pense. Mais, aprs rflexion, nous nous
sommes dit nous-mme ce que Diderot disait Rousseau : C'est le
pont aux nes. Qui conteste en effet aujourd'hui la philosophie le
droit de se dgager de la religion, de s'en sparer et mme de la combattre ? C'est un droit tellement reconnu que, dans certains milieux,
c'est mme un devoir. C'est la vrit officielle. Un esprit vraiment indpendant aujourd'hui, au lieu de hurler avec les loups et de rpter
pour la millime fois les objections de Voltaire et de Diderot, a peuttre quelque chose de mieux faire. Sans aliner son libre examen,
sans renoncer ses croyances rationalistes, il sera peut-tre plus tent
de rechercher par o la religion est digne de respect pour le philosophe, par o elle sert la vrit, que d'ajouter aux attaques striles
dont elle peut tre l'objet. Peut-tre est-il plus sage de faire voir les
affinits de la religion et de la philosophie, que leurs oppositions et
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
183
leurs [195] incompatibilits, de chercher par o l'on s'entend que par
o l'on se spare. Un tel ordre d'ides serait plus opportun, plus vrai et
peut-tre mme plus philosophique, comme nous allons essayer de le
montrer.
Ce qui nous a mis sur la voie de cette pense, c'est la critique des
positivistes, critique qui porte la fois contre la thologie et contre la
philosophie et qui les enveloppe dans une mme proscription. Pendant
longtemps, les philosophes mme spiritualistes, lorsqu'ils taient en
mme temps rationalistes, se plaaient en libres penseurs en face de la
thologie, et en cela ils taient bien dans leur droit ; mais ils croyaient
de leur intrt d'accuser hautement cette sparation ; ils nourrissaient
un esprit de suspicion, qui n'tait pas sans doute sans fondement, mais
qui leur faisait considrer leur cause comme absolument spare de
celle de la thologie, et plutt mme comme oppose. Les positivistes
les ont forcs dans ce retranchement. Ils ont fait une objection solide
et profonde qui changeait la face des choses ; cette objection, c'est que
la mtaphysique n'a pas se prvaloir grandement de son indpendance l'gard de la thologie, que cette indpendance est toute ngative et purement critique ; mais que, pour le fond des choses, pour la
partie positive de la doctrine, toute la substance de la mtaphysique
n'est que la thologie transforme, traduite en langage abstrait, ayant
pass des entits surnaturelles conues comme personnalits concrtes, aux entits logiques conues comme substances et qualits mtaphysiques ; mais le fond, serait toujours le mme de part et d'autre.
Il ne servirait du reste de rien certaines coles mtaphysiques, plus
ou moins tmraires ou indpendantes, de se dgager leur tour en
renvoyant l'objection aux doctrines spiritualistes, et en les appelant
des thologies au mme litre que les religions elles-mmes ; ce serait
l une tactique aussi maladroite que peu loyale, et du reste inutile, car
les positivistes, et avec raison, ne sparent pas les coles les unes des
autres. C'est la mtaphysique tout entire, quelle qu'en soit la forme,
qui est, [196] selon eux, issue de la thologie. Cela est aussi vrai du
panthisme et de l'idalisme que du thisme et du spiritualisme. Hegel
et Schelling sont aussi bien sortis de la thologie protestante que Descartes et Malebranche de la thologie catholique ; Socrate, Platon et
Aristote n'ont fait que purifier la mythologie populaire, et l'cole
d'Alexandrie n'a trouv des conceptions nouvelles, en mtaphysique,
que parce qu'elle s'est inspire des religions orientales.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
184
Il faut donc donner raison aux positivistes sur ce point ; leur critique est fonde. La mtaphysique sort de la thologie, et il y a une
parent, une affinit trs troite entre la doctrine thologique et les
doctrines mtaphysiques ; et, sauf la diffrence de forme, leur valeur
au fond est la mme de part et d'autre.
Cela tant, en abandonnant, comme elle le fait d'ordinaire, la thologie aux attaques du positivisme et du matrialisme, la mtaphysique
court risque de s'immoler elle-mme. Car, ou bien il faut dire que les
doctrines thologiques sont absolument et radicalement fausses, et
cela aussi bien dans le fond que dans la forme ; et alors elles entranent avec elles tout ce qui vient d'elles, savoir le fond commun des
mtaphysiques et des thologies ; ou bien il faut reconnatre que les
vrits mtaphysiques, qui se rattachent la thologie par le fond, ne
cessent pas d'tre des vrits parce qu'elles sont enveloppes sous une
forme thologique et mme mythologique. Sans doute, la mtaphysique n'est pas engage dans la question de la vrit historique des religions positives : c'est une question qui reste ouverte et que chacun
rsoudra comme il l'entendra ; mais la mtaphysique est intresse,
pour le fond, dans les solutions thologiques, car c'est son propre domaine.
Cette justice rendre la thologie est aussi facile au libre penseur
qu'au croyant. Si la thologie est rvle, il est vident qu'il faut la
respecter. Si elle est d'origine humaine, pourquoi la mtaphysique ne
ferait-elle pas cause commune avec une uvre qui vient comme elle
de l'initiative et de [197] l'invention de l'esprit humain ? On peut
mme dire qu'il y a plus d'invention en thologie que dans la mtaphysique proprement dite, puisque c'est par la thologie que la mtaphysique a commenc. Il est vrai que, souvent, c'est l'inverse et la rciproque que l'on peut soutenir, et les thologies savantes sont aussi
bien l'effet que la cause des systmes mtaphysiques ; mais cela ne
fait qu'un lien de plus entre les deux sciences. On comprend l'aversion
et la rvolte de la philosophie contre la thologie tant que celle-ci a t
oppressive et dominatrice, et qu'elle a enchan la libert de l'esprit
humain ; mais, une fois affranchie d'un joug dshonorant, la mtaphysique doit avoir assez de lumires pour reconnatre, sous la forme d'un
dogme dont elle peut rejeter la lettre, mais qui lui appartient par l'esprit, une vrit qui ne cesse pas d'tre une vrit parce qu'elle est enveloppe sous les voiles de l'imagination. Combien de vrits ont t
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
185
trouves par les potes et qui n'en sont pas moins des vrits ! Que si,
au contraire, la thologie vient d'en haut, pourquoi la philosophie refuserait-elle de s'alimenter une source plus haute qu'elle-mme ?
tout point de vue, l'hostilit l'gard de la thologie est une trahison
l'gard de la mtaphysique elle-mme.
Ces considrations se justifieront mieux par le fait, en tudiant de
plus prs les relations plus prcises de la religion et de la philosophie.
Et d'abord, qu'est-ce que la religion ? Il n'est pas facile de rpondre
cette question ; il n'est pas facile de trouver une dfinition qui s'applique toutes les religions et qui comprenne la fois le ftichisme du
sauvage et la religion chrtienne. Mais nous n'avons pas besoin ici
d'une dfinition scientifique et rigoureuse de la religion en gnral.
Nous n'avons qu' considrer la religion que nous connaissons immdiatement, celle avec laquelle nous vivons et qui nous est familire
ds notre enfance, et que la philosophie rencontre sans cesse ct
d'elle dans le monde extrieur. C'est avec celle-l que la philosophie a
des rapports actuellement. Ceux [198] qu'elle a pu avoir autrefois avec
d'autres religions appartiennent l'histoire ; c'est donc seulement de la
religion chrtienne qu'il sera question ici.
Demandons-nous donc maintenant ce qui constitue la religion
chrtienne : c'est, ce qu'il nous semble, l'existence de certaines vrits appeles dogmes, auxquelles il faut croire si l'on veut tre vritablement chrtien. Il n'est pas dit que l'on doit croire ces dogmes sans
preuves : ce serait une erreur ; ce qui est vrai, c'est que la dmonstration des dogmes n'est pas tire des dogmes eux-mmes, comme pour
les vrits philosophiques, mais de preuves extrinsques, d'une nature
diffrente des dogmes mmes, savoir des faits historiques dont le
caractre surnaturel prouve pour ceux qui croient l'origine divine des
dogmes imposs. En un mot, c'est par les miracles, les prophties, la
tradition, l'autorit de l'criture, que l'on prouve la vrit des dogmes,
ou encore par la supriorit de la morale. Mais toutes ces preuves sont
extrieures au dogme lui-mme : celui-ci, en tant que vrit, doit tre
cru sans dmonstration.
La religion paenne n'avait pas de dogmes. Les dieux taient des
personnages surnaturels, chargs de veiller aux diffrentes oprations
de la nature ou aux intrts des hommes. On leur offrait des sacrifices
pour se les rendre favorables ou pour conjurer leur malveillance : voi-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
186
l tout. Il n'y avait pas un systme de vrits enchanes reprsentant
l'ordre des choses divines et rpondant aux problmes que soulve la
curiosit humaine sur l'origine des choses ; ou du moins ce qu'il y
avait en ce genre au fond des croyances mythologiques n'tait pas
formul d'une manire prcise. De mme, le judasme et le mahomtisme n'ont pas ou n'ont que trs peu de dogmes. Ce sont des religions
qui, sauf leur ct historique et national, ne diffrent pas beaucoup du
disme tel que peuvent le concevoir sans rvlation les philosophes
rationalistes.
Je ne voudrais pas me hasarder sur le terrain des religions orientales, que je ne connais pas. Il est possible que l'on y retrouve quelque
chose d'analogue ce que l'on appelle des [199] dogmes dans la religion chrtienne, c'est--dire des conceptions plus ou moins profondes,
plus ou moins intelligibles sur l'essence des choses et sur la nature de
la Divinit. S'il en tait ainsi, il faudrait dire des religions orientales,
par rapport aux philosophies de l'Orient, ce que nous avons dire du
christianisme par rapport aux philosophies de l'Occident.
Cela pos, examinons d'un peu plus prs ce que l'on appelle
dogmes en thologie, et l'on verra que ces dogmes, en tant qu'exprimant la nature divine, l'origine et la fin des choses, contiennent en ralit une mtaphysique ; que la religion, dans ce qu'elle a de plus lev,
peut tre considre comme une mtaphysique de sentiment, de mme
que la mtaphysique peut tre appele une religion de raison.
En effet, les dogmes sont des vrits surnaturelles, c'est--dire rvles et suprieures la raison. En tant que suprieurs la raison, les
dogmes sont appels des mystres. C'est le propre du christianisme,
c'est--dire de la plus haute religion connue, d'imposer des mystres
la croyance de l'humanit.
La notion de mystre n'a pu natre dans l'esprit humain que lorsque
la distinction du naturel et du surnaturel, du rationnel et du rvl s'est
forme d'une manire claire et distincte. Dans les religions primitives,
comme on l'a souvent remarqu, le naturel et le surnaturel ne se distinguent pas l'un de l'autre : le surnaturel est partout dans la nature. De
mme, il n'y a gure de diffrence entre le rationnel et le rvl. Tout
est rvl. Tout parle par la voix des dieux ; tout est dieu ; et rien n'est,
proprement parler, rationnel et humain. Mais lorsque, par le progrs
de la science, de la philosophie et de l'industrie, les hommes sont arri-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
187
vs se former quelque ide des lois de la nature et des lois de l'esprit,
ils ont vu qu'il y avait certaines vrits et certaines actions qu'ils pouvaient obtenir par les forces seules de la nature et par celles de leur
esprit ; et ils ont appliqu ces vrits et ces actions la qualification
de naturelles ou humaines, les choses humaines tant elles-mmes des
choses naturelles. Mais en mme temps, comme ils continuaient
croire qu'il y avait un domaine [200] suprieur soit aux lois de la nature, soit aux puissances de leur propre esprit, ils ont appel supranaturel ou surnaturel tout ce qui dpassait la puissance connue de la nature ou de leur esprit. La religion alors s'est retire dans ce domaine du
surnaturel, laissant le monde proprement dit aux disputes humaines
(tradidit mundum dispuitationibus), et l'on pourrait ajouter : aux oprations humaines (operationibus). Tout ce qui est, tout ce qui se fait au
del est du domaine du mystre et du miracle.
On a beaucoup disput entre thologiens et philosophes sur la
question de savoir si les mystres sont simplement suprieurs la raison, ou s'ils ne lui sont pas contraires. Tout le Discours prliminaire
de Leibniz sa Thodice sur la Conformit de la foi et de la raison
est consacr celle question.
Nous ne toucherons pas ce dbat. En un sens, tout ce qui est suprieur la raison est en cela mme, au moins en apparence, contraire
cette raison. Cette distinction d'ailleurs, capitale lorsqu'il s'agit d'imposer la croyance absolue a ces dogmes considrs comme vrits rvles, est beaucoup moins importante lorsqu'on n'y voit que des
symboles et des enveloppes sous lesquelles sont caches des vrits
rationnelles. En effet, on comprend que l'on n'admette pas comme venant de Dieu mme une doctrine qui renverserait les bases de la raison, qui par consquent dtruirait en moi les principes mmes l'aide
desquels je puis m'lever jusqu' Dieu. Mais, si l'on considre les
dogmes comme des vrits mystiques trouves spontanment par l'enthousiasme et par l'imagination, on peut y voir des pressentiments, des
prlibations de la vrit divine, mais non des vrits littrales et matrielles qu'il faut admettre dans leur sens troit, quels que soient les
inconvnients qui puissent rsulter de l pour l'autorit de la raison.
ce point de vue, il est peu important d'insister sur la diffrence
de ce qui est contraire ou suprieur la raison, puisqu'on peut toujours
supposer que ce qui nous parat contraire aux lois de la raison tient,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
188
non pas au fond de la vrit elle-mme, mais la forme sous laquelle
elle nous est prsente.
[201]
Si nous laissons de ct cette difficult, il ne nous sera pas aussi
indiffrent de savoir si les mystres, par cela seul qu'ils sont incomprhensibles, doivent tre par l mme et dans la rigueur dclars inintelligibles. Toute la question est l. Les dogmes chrtiens, titre de
mystres, sont-ils, proprement parler, des non-sens ? ou ne sont-ce
pas des vrits obscures dpassant la porte de l'exprience, mais qui,
sous d'apparentes contradictions, contiennent quelque chose de rel et
de concret ? Sont-ce des propositions semblables celles dont parle
Stuart Mill : Un Humphry Davy est un Abracadabra, l'expression
Humphry Davy n'ayant aucun sens, et celle d'Abracadabra pas davantage ? Dans ce cas, il ne serait pas permis de dire de ces propositions
qu'elles sont des dogmes et des mystres : ce seraient de purs nonsens, des nants de pense, et c'est abaisser le principe de la croyance
que d'obliger l'esprit croire de purs mots qui ne reprsentent rien,
ou qui pourraient mme reprsenter le contraire de ce que l'on voudrait croire, comme, par exemple, substituer le diable la place du
bon Dieu, ou introduire telle superstition qu'on voudrait. Le principe
de l'incomprhensibilit des mystres ne peut aller jusque-l : Je
puis, dit Stuart Mill, si j'ai confiance en celui qui me dit cela, je puis
croire qu'il dit quelque chose, et mme que ce quelque chose est vrai ;
mais alors ce n'est pas la chose mme qui est l'objet de ma croyance,
parce que je ne sais absolument pas ce que c'est. Dans ce cas, la
croyance porterait sur la personne et non sur la chose elle-mme ;
mais de telles propositions n'auraient rien avoir avec la philosophie.
Mais il n'en est pas ainsi. Des mystres ne sont pas des non-sens absolus ; ce ne sont pas mme des propositions absolument contradictoires : ce sont des propositions ayant un sens, lequel prsente une apparence de contradiction. Voil ce que nous entendons par mystres,
et nous ne pensons pas que la thologie les entende autrement.
Vrifions celle doctrine sur les principaux mystres chrtiens. Les
trois grands mystres sont : la Trinit, l'Incarnation et la Rdemption,
tous trois lis ensemble et faisant un [202] systme indissoluble. Si
l'on considre ces trois dogmes quant au fond, on verra que, si l'on
carte l'lment incomprhensible qui les constitue mystres, ce qui
restera au fond, ce sont de vritables solutions mtaphysiques.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
189
Le mystre de la Trinit consiste dire qu'il y a en Dieu trois personnes qui ne sont pas trois dieux, mais qui ne font qu'un seul et
mme Dieu. En outre, ces trois personnes sont gales entre elles,
quoique la seconde soit engendre par la premire, et que la troisime
procde des deux autres. Le Pre est crateur ; mais le Fils est aussi
crateur, et le Saint-Esprit l'est galement. O rside le mystre ? Il est
dans le dogme de l'unit de substance, concidant avec la pluralit des
personnes. Il semble qu'unit de substance et unit de personne soient
et ne puissent tre qu'une seule et mme chose. Cependant c'est l une
doctrine si peu contraire la raison qu'on peut mme demander si elle
est suprieure la raison. Le panthisme au moins le nierait, puisque
sa prtention est prcisment de concilier l'unit de substance avec la
multiplicit infinie des personnes. Aujourd'hui mme, dans certaines
conditions maladives, on croit voir une certaine pluralit de personnes
se manifester dans un seul et mme individu. C'est donc une question
sur laquelle la mtaphysique peut tre divise : elle ne peut donc reprocher la thologie une doctrine qui, mme mtaphysiquement,
pourrait tre soutenue. En tout cas, ce qu'on ne peut contester, c'est
que la doctrine trinitaire offre un sens, et mme un sens clair l'esprit.
En effet, d'une part nous savons ce que c'est que l'unit de substance, puisque nous la sentons en nous-mme ; de l'autre nous savons
ce que c'est qu'une personne, puisque nous en sommes une ; ce qui
nous chappe, c'est comment concilier l'unit avec la multiplicit. la
vrit, dans le moi l'unit du sujet se concilie trs bien avec la pluralit
des attributs ; mais ce qui fait la diffrence, c'est que, dans le dogme
de la Trinit, il ne s'agit pas seulement d'attributs, mais de personnes,
dont chacune, ce qu'il semble, doit tre un tre elle seule, comme
en nous-mme, puisque nous sommes [203] la fois, au moins l'tat
normal, un seul tre et une seule personne. Ainsi les deux termes des
mystres nous sont connus et sont compris par nous : ce qui est obscur, c'est le comment de leur union. Le dogme de la Trinit a donc un
sens ; mais de plus c'est un sens mtaphysique, et d'une mtaphysique
profonde. C'est la solution d'un problme pos par toutes les philosophies : l'origine des choses est-elle l'unit ou la pluralit ? Le christianisme rsout le problme en posant l'origine l'unit unie la multiplicit d'une manire ineffable, non pas une multiplicit quelconque,
mais une multiplicit dfinie et limite. En effet, ou l'on pose l'unit
pure, comme Parmnide, et de cette unit vide rien ne peut sortir ; ou
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
190
l'on pose une multiplicit indfinie, comme les Ioniens et les Atomistes ; mais, la quantit tant infiniment divisible, il n'y a pas d'lments premiers ; ou enfin, comme Platon, on pose la fois l'unit et la
dyade indfinie ; mais deux principes indfinis ne se dterminent pas
l'un l'autre, et il semble que l'on ne sort pas encore de l'indfini. Dans
la Trinit chrtienne, l'unit n'est pas lie au nombre en gnral, la
quantit en soi, mais un nombre fixe qui est, ce qu'il semble, le
minimum possible pour qu'un tre soit quelque chose de dfini : car la
premire condition pour l'tre, c'est d'tre ; la seconde, c'est d'tre
quelque chose de dtermin, c'est--dire d'avoir une forme ; la troisime, c'est que la forme soit unie la substance par un principe de
vie et d'activit, en un mot qu'il y ait un passage de l'un l'autre. Ce
n'est donc pas le nombre indfini qui s'unit une unit indfinie. C'est
l'unit vivante et concrte ramene des conditions essentielles. Tel
est le sens mtaphysique de la Trinit chrtienne, et que les thologiens, sous une forme ou sous une autre, en ont tir. Revenons
nous-mmes, dit Bossuet : nous sommes, nous entendons, nous voulons tre, entendre et vouloir font une seule me heureuse et juste
qui ne pourrait ni tre sans tre connue, ni tre connue sans tre aime. Car que serait-ce une me d'tre sans se connatre, et que serait-ce de se connatre sans s'aimer ? Ainsi, notre manire imparfaite
et [204] dfectueuse, nous reprsentons nos mystres incomprhensibles.
Si nous passons au mystre de l'Incarnation, li celui de la Trinit, nous y trouverons, comme dans le prcdent, une incomprhensibilit lie des termes qui sparment sont comprhensibles. L'ide de
l'Homme-Dieu peut paratre sans doute une ide contradictoire. Mais
on ne peut nier que d'une part nous ne sachions ce que c'est que
l'homme, et de l'autre nous savons aussi ou nous croyons savoir ce que
c'est que Dieu : au moins entendons-nous par ce terme la cause suprme, l'tre souverainement parfait, cause du monde et crateur de
l'homme. Le mystre ne consiste donc pas ici introduire des termes
inintelligibles, mais unir entre eux d'une manire inintelligible des
termes parfaitement clairs. Sans doute, il y a dans cette proposition :
Dieu s'est fait homme, une sorte de contradiction ; et Spinoza disait
qu'avant d'admettre que Dieu s'est fait homme, il admettrait que le
cercle s'est fait carr. Mais c'est l une exagration : car le dogme ne
consiste pas dire que Dieu est devenu homme, qu'il s'est chang en
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
191
homme, et qu'il a cess d'tre Dieu, comme dans les mtamorphoses
de la mythologie, ce qui serait en effet une contradiction ; mais ce que
l'on dit, c'est que Dieu, restant Dieu, a revtu la nature humaine, c'est-dire qu'en Jsus-Christ les deux natures se sont unies et forment un
seul et mme tre, de mme que, dans l'homme, l'me et le corps,
quoique htrognes, se runissent en un mme tre. Seulement, dans
Jsus-Christ, l'unit des deux natures, leur intussusception est bien
plus grande et va presque jusqu' la contradiction : c'est pourquoi c'est
un mystre, mais ce mystre n'est pas un non-sens. C'est la solution
d'un problme mtaphysique : comment l'infini peut-il entrer en rapport avec le fini ? De quelque manire qu'on rsolve le problme, il
semble qu'on se heurtera toujours une sorte de contradiction. Il y a
incompatibilit entre les deux termes, et cependant ils sont unis. Dans
le dogme de l'Incarnation, la solution prend une forme en quelque
sorte plus dramatique : ce n'est pas [205] l'infini en gnral qui s'unit
au fini en gnral, c'est une personnalit concrte, Dieu, qui s'unit
une individualit concrte, tel homme ; c'est l, si l'on veut, un mystre, mais ce mystre reprsente sous la forme la plus vive le mystre
des mystres, la coexistence et la cohabitation de Dieu et du monde.
Le mystre de la Rdemption est la consquence des deux autres.
On peut mme dire que les deux autres n'ont t construits que pour
rendre possible celui-l. Le dogme de la rdemption se rattache un
autre dogme chrtien, le dogme de la chute et du pch originel : c'est
une solution du problme du mal. Le pch originel en explique l'origine ; la rdemption en montre la fin. La chute est une rupture de
l'homme avec l'infini ; elle a donc d tre suivie d'une expiation infinie, puisque l'humanit tout entire a t condamne dans le premier
homme. une chute infinie il faut une rparation infinie ; ou plutt,
un chtiment ne pouvant tre en proportion avec l'offense, il faut une
expiation infinie, qu'aucune victime humaine ne peut offrir. Il n'y a
donc que Dieu qui puisse racheter l'homme. Mais Dieu se chtiant luimme pour rparer la faute de l'homme envers lui serait une contradiction par trop absurde. Il faut donc que ce ne soit pas Dieu tout entier qui paye pour l'homme, mais seulement une partie de Dieu, une
personne divine qui accepte le rle de victime. De l la doctrine de la
Trinit. Sans Trinit, point d'Incarnation ; sans Incarnation, pas de
Rdemption, pas de sauveur. Le fini alors serait en face de l'infini,
rien et tout, sans intermdiaire. L'homme prirait sans misricorde et
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
192
sans secours. Le mal, dans cette hypothse, serait ternel et absolu. Au
contraire, la doctrine du Rdempteur rouvre le chemin du ciel et ramne la joie et l'espoir dans le monde : Une immense esprance a
travers la terre ! dit le pote. Tel est le sens philosophique de la
rdemption. Sans doute un Dieu qui meurt et qui meurt pour l'homme
est quelque chose d'incomprhensible ; on l'admet cependant : c'est
pourquoi c'est un mystre. Mais enfin, ce n'est pas un non-sens. Nous
comprenons l'ide de Dieu ; [206] nous comprenons l'ide de mort et
de douleur, l'ide d'expiation : c'est encore le lien des ides qui nous
chappe. Nanmoins la pense d'une rdemption et d'une rparation
divine, prise en soi, est au fond une pense philosophique qui rpond
un problme de l'esprit : c'est la solution du problme du mal. La solution sceptique est dsesprante ; la solution optimiste parait froide et
faible. La solution chrtienne a une grandeur qui a sduit un Pascal,
un saint Augustin. Elle n'est donc pas quelque chose de si mdiocre ;
et il n'y a que les petits esprits qui pourraient se croire le droit de la
regarder d'en haut.
En un mot, pour nous rsumer, les trois grands mystres chrtiens
constituent un systme de mtaphysique qui rpond trois grandes
questions : 1 Comment l'un peut-il s'unir au plusieurs ? 2 Comment
l'infini peut-il entrer en rapport avec le fini ? 3 Quelle est l'origine du
mal et quelle en est la fin et la consommation ?
Le nud du systme est dans l'ide du Mdiateur. L'esprit est plac
en face de ce dilemme : ou pas de Dieu, ou un Dieu infiniment loign
de l'homme, un Dieu indiffrent, abstrait, reposant, comme disait
Cousin, sur le trne de son ternit solitaire . Des deux cts,
l'homme est seul et sans espoir. La mtaphysique chrtienne offre un
milieu, un moyen terme. Elle unit l'homme et Dieu parle mystre de
l'Homme-Dieu. Dieu n'est plus un Dieu mort ; le monde n'est plus une
nature maudite. Dieu est humain ; le monde est divin. L'homme est le
sanctuaire o s'opre le miracle de la divinisation du fini. Tel est le
sens de la mtaphysique chrtienne, qui semble avoir cherch une solution diffrente et du disme et du panthisme et les absorber l'un et
l'autre, selon la mthode hglienne, dans une conception suprieure.
Nous rsumerons donc cette premire partie de notre thse par
cette proposition : les mystres de la religion renferment une mtaphysique. Notre seconde proposition corrlative sera celle-ci : toute
mtaphysique contient des mystres.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
193
Il suit des deux propositions prcdentes que, de part et [207]
d'autre, en philosophie et en thologie, il y a une mtaphysique, de
part et d'autre aussi il y a des mystres. Il y a donc parit, quant au
fond, entre les deux sciences, malgr les dissemblances de leurs
formes. Il y a donc affinit entre la philosophie et la thologie.
Mais nous avons maintenant tablir la seconde partie de notre
thse, savoir que la philosophie, aussi bien que la thologie, a ses
mystres.
Ce terme de mystre peut s'entendre dans deux sens.
Ou bien on peut l'entendre dans un sens ngatif, c'est--dire comme
des obscurits impntrables, des problmes insolubles : Il y a plus
de choses sous le ciel et sur la terre que notre esprit n'en peut comprendre, dit Horatio dans Hamlet. Ce n'est pas en ce sens que nous
entendons la proposition prcdente. Ce ne serait en effet qu'une rptition banale de ce qui a t cent fois dit sur les limites et les ignorances de la philosophie. Multa nescire est qudam pars sapienti.
Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Ce sont l les diffrentes expressions de cette premire manire d'entendre le mot mystre en philosophie.
Mais ce n'est pas ainsi qu'on l'entend en thologie. Le terme de
mystre y est pris dans un sens positif, et non ngatif. Il exprime alors
non des problmes non rsolus, mais au contraire des solutions de
problmes auxquelles manquent un ou plusieurs termes pour qu'elles
deviennent intelligibles pour l'esprit. Tel est le mystre en thologie.
Nous l'avons vu en effet : le dogme de la Trinit, savoir l'alliance de
l'unit divine avec la triplicit des personnes ; le dogme de l'Incarnation, savoir la fusion incomprhensible de la nature divine et de la
nature humaine ; la Rdemption, savoir le salut des hommes par la
mort d'un Dieu, ne sont pas de pures ngations. Ce sont des vrits
positives qui ont un contenu rel, et qui rpondent des problmes ;
qui enfin satisfont leur manire aux besoins de la nature humaine,
mais en confondant la raison, en lui demandant de se soumettre, d'oublier ses habitudes de circonspection logique, absolument incapables
[208] d'atteindre aux vrits profondes qui touchent au fond des
choses. Voil bien le sens des mystres thologiques. Eh bien, c'est
prcisment dans le mme sens que nous prtendons qu'il y a des mystres en philosophie.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
194
Hegel, dans son Histoire de la philosophie, critique svrement ce
qu'il appelle la philosophie de l'entendement, c'est--dire la philosophie du XVIIIe sicle que l'on appelle en Allemagne die Aufklrung (la
philosophie des lumires), et que Schelling, par ironie, appelait die
Ausklrung (l'absence de lumires. Le caractre de cette philosophie,
dit Hegel, est de voir partout des contradictions ; son procd est ce
qu'il appelle encore Entweder Oder (ou ceci ou cela). Mais elle oublie
qu'il y a toujours un troisime terme (ein Drittes). Hegel raille particulirement comme basse et peu philosophique la polmique banale
contre les mystres chrtiens : Un ne peut pas tre trois ; Un Dieu
ne peut se faire homme ; Nul n'est responsable des fautes d'autrui.
Il n'a pas assez de mpris pour ce qu'il appelle la platitude (die Plterei) de cette philosophie. Il veut dire par l que la philosophie des
mystres est suprieure en profondeur au pur rationalisme, au disme
populaire de Voltaire et de Rousseau.
Tous les plus grands philosophes ont eu le sentiment qu'au-dessus
de la sphre des ides claires et distinctes revendiques par Descartes,
au-dessus de la philosophie humaine, si l'on peut parler ainsi, c'est-dire de la philosophie adapte et proportionne nos facults, il y a
place pour une philosophie suprieure correspondant, dans l'ordre philosophique, la doctrine des mystres en thologie. Comment en effet
oserait-on soutenir que notre raison est la mesure de l'ordre des choses
et qu'il n'y a rien au del de ce que nous pouvons comprendre clairement et distinctement ? Et n'est-ce pas la raison elle-mme qui nous
dit cela ? Bien plus, sans pouvoir saisir distinctement cet au del, ne
peut-elle pas en avoir le pressentiment, la perspective, et essayer d'atteindre une reprsentation inadquate sans doute, mais aussi rapproche que possible de cette rgion suprme qu'elle ne peut qu'entrevoir,
[209] sans cependant y tre absolument aveugle. C'est cette rgion que
nous appelons le champ des mystres en philosophie.
Montrons-le par quelques exemples. S'il y a une philosophie avide
des ides claires et distinctes, et qui ait essay de rapprocher l'vidence philosophique de l'vidence gomtrique, qui ait enfin cherch
carter le sentiment et l'imagination du domaine de la philosophie,
c'est assurment celle de Descartes. Eh bien, Descartes lui-mme ne
s'est pas content d'une philosophie mi-cte, borne aux vrits du
sens commun et ne dpassant pas les limites de l'entendement. Il ne
s'est pas content de ces simples et lumineuses dmonstrations de
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
195
l'existence de Dieu qui ont pu faire un instant l'illusion que la philosophie allait devenir une science exacte comme la gomtrie elle-mme.
Non, il est mont beaucoup plus haut, et il semble avoir dpass en
hardiesse toutes les autres philosophies, lorsqu'il est all jusqu' soutenir cette trange doctrine que non seulement Dieu a cr le monde,
ce qui n'est rien, mais, ce qui est bien plus extraordinaire, qu'il s'est en
quelque sorte cr lui-mme, qu'il est l'auteur de son tre et la cause
propre de son existence.
Tous ceux en effet qui ont lu le Discours d la Mthode et les Mditations se souviennent que dans ce que l'on appelle la seconde
preuve de l'existence de Dieu, qui peut aussi bien tre considr
comme un dveloppement de la premire, Descartes raisonne ainsi :
Car si j'eusse t seul et indpendant de tout autre, en sorte que
j'eusse eu de moi-mme tout ce peu que je participais de l'tre parfait,
j'eusse pu avoir de moi par mme raison tout le surplus que je connaissais
me manquer, et ainsi tre moi-mme infini, ternel, immuable, tout connaissant, tout-puissant, et enfin avoir toutes les perfections que je pouvais
remarquer tre en Dieu. (Discours de la Mthode, 4e partie, dit. Cousin,
I, p. 161.)
Le mme raisonnement est encore plus hardiment dvelopp dans
les Mditations (I, 284) : Or, si j'tais indpendant [210] de tout
autre et que je fusse moi-mme l'auteur de mon tre, je ne douterais
d'aucune chose, je ne concevrais point de dsirs, et enfin il ne me
manquerait aucune perfection, car je me serais donn moi-mme
toutes celles dont j'ai en moi quelque ide, et ainsi je serais Dieu ; car
il est trs certain qu'il a t beaucoup plus difficile que moi je sois sorti du nant qu'il ne me serait d'acqurir les lumires et les connaissances de plusieurs choses que j'ignore. Et certes, si je m'tais donn
ce plus que je viens de dire, c'est--dire si j'tais moi-mme l'auteur de
mon tre, je ne me serais pas au moins dni les choses qui se peuvent
avoir avec plus de facilit.
Dans cette argumentation, Descartes semble bien entendre que
l'tre qui est par soi a d se donner l'tre lui-mme ; car, pour prouver que je ne suis pas cet tre, il montre que je suis imparfait ; tandis
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
196
que l'tre par soi devrait tre parfait, puisque, s'tant donn luimme le plus, savoir l'tre, il aurait pu en mme temps se donner le
moins, savoir les attributs. Raisonnement qui serait faux si l'tre par
soi n'existait que par la nature des choses : car alors la mme nature
aurait pu faire qu'il ft la fois et ncessaire dans son origine et imparfait dans ses attributs.
cet argument de Descartes, beaucoup d'arguments furent opposs au nom de la philosophie que Hegel et appele philosophie de
l'entendement. tre par soi, disait-on, peut s'entendre en deux sens,
l'un ngatif, l'autre positif : ngatif, c'est--dire ne pas tre par autrui ;
positif, c'est--dire tre par soi-mme comme par une cause. Dans le
second cas en effet, disait le thologien Caterus, ce qui serait par soimme comme par une cause et se donnerait l'tre soi-mme, si par
un choix libre et prmdit il se donnait tout ce qu'il voudrait, sans
doute qu'il se donnerait toutes choses, et, partant, il serait Dieu . Mais
c'est ce qui est impossible : car Dieu n'est pas par lui-mme, comme
par une cause, et il ne lui a pas t possible avant qu'il ft de prvoir
ce qu'il pourrait tre, pour choisir ce qu'il serait aprs.
Croit-on que Descartes va se laisser flchir par ce raisonnement
[211] si vident et si accablant ? Eli bien, non ! Il persiste, et il dclare
que ces mots tre par soi ne doivent pas s'entendre dans un sens ngatif, savoir n'avoir pas besoin de cause . Il faut l'entendre au contraire dans un sens positif, c'est--dire tre soi-mme comme par une
cause ; et cette cause est l'immense et incomprhensible puissance
qui est contenue dans son ide puissance si pleine et si abondante
qu'en effet elle soit la vraie cause pourquoi il est, et il ne peut y avoir
d'autre cause que celle-l . Sans doute il n'est pas ncessaire d'aller
jusqu' dire que Dieu est la cause efficiente de lui-mme, pour ne pas
entrer en discussion sur le sens du mot de cause ; nanmoins, parce
que nous voyons que ce qui fait qu'il est par soi ou qu'il n'a pas de
cause diffrente de lui-mme ne procde pas du nant, mais de la relle et vritable immensit de sa puissance, il nous est loisible de penser qu'il fait en quelque faon la mme chose l'gard de soi-mme
que la cause efficiente l'gard de son effet, et partant qu'il est par
soi-mme positivement. Tels sont les propres mots de Descartes en
rponse Caterus.
Cette rponse de Descartes ne satisfit point Arnauld. Il reprit les
objections de Caterus, et insista de nouveau en disant qu' on ne peut
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
197
concevoir sans absurdit qu'une chose reoive l'tre, et nanmoins que
cette mme chose ait l'tre auparavant que nous ayons conu qu'elle
l'avait reu. Or cela arriverait si nous attribuions les notions de cause
et d'effet une mme chose au regard de soi-mme. Car quelle est la
notion d'une cause ? Donner l'tre. Quelle est la notion d'un effet ? Le
recevoir. Or la notion de la cause prcde naturellement la notion de
l'effet. Il ajoutait : Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas, donc
personne ne peut donner l'tre que celui qui l'a dj ; or, s'il l'a dj,
pourquoi se le donnerait-il ? On ne saurait donc concevoir que Dieu
soit par soi positivement, comme s'il s'tait lui-mme produit ; car il
aurait t dj auparavant que d'tre. 15
[212]
Ces objections pressantes donnent bien la doctrine de Descartes
leur vrai caractre. Il s'agit bien de savoir si Dieu est la cause de son
propre tre, s'il s'est produit lui-mme, s'il s'est engendr lui-mme, ce
qui parait absurde et incomprhensible, puisque alors il fallait qu'il ft
avant d'tre. Et cependant, encore cette fois, Descartes ne se laisse
point branler ; il veut bien que le mot de cause n'implique pas comme
d'ordinaire l'antriorit par rapport l'effet ; mais il ne veut pas renoncer l'ide que Dieu est par lui-mme comme par une cause ; il ne
veut pas admettre que l'expression tre par soi ne soit que ngative. Il
faut une cause et une cause positive l'existence de Dieu comme
toute autre chose. J'estime, rpond-il Arnauld, 16 j'estime qu'il est
ncessaire de montrer qu'entre la cause efficiente proprement dite et
point de cause, il y a quelque chose qui tient comme le milieu, savoir l'essence positive d'une chose laquelle l'ide ou le concept de la
cause efficiente se peut tendre, en mme faon que nous avons coutume d'tendre en gomtrie le concept d'une ligne circulaire la plus
grande qu'on puisse imaginer au concept d'une ligne droite, ou le concept d'un polygone rectiligne d'un nombre infini de cts au concept
de cercle.
15
16
d. Cousin, t. II, p. 24.
OEuvres, id., V ; Cousin, 11, p. 56, fin.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
198
De l (c'est--dire des objections d'Arnauld), on doit galement infrer que ce n'est pas une cause efficiente proprement dite, ce que j'avoue,
mais non point que ce n'est point du tout une cause positive qui par analogie puisse tre rapporte la cause efficiente C'est pourquoi, lorsqu'on
demande si quelque chose peut se donner l'tre soi-mme, il faut entendre la mme chose que si on demandait, savoir si la nature ou l'essence
de quelque chose peut tre telle qu'elle n'ait pas besoin de cause efficiente
pour tre ou exister.
Et je pense qu'il est manifeste que la considration de la cause efficiente est le premier et le principal moyen, pour ne pas dire le seul et
l'unique, que nous ayons pour prouver [213] l'existence de Dieu. Or, nous
ne pouvons nous en servir si nous ne donnons l'occasion notre esprit de
rechercher les causes efficientes de toutes les choses qui sont au monde,
sans en excepter Dieu mme ; car pour quelle raison l'exempterions-nous
de cette recherche avant qu'il soit prouv qu'il existe ?
Ainsi, selon Descartes, l'axiome de causalit est absolu et universel. Il ne doit pas s'exprimer seulement comme on le fait d'ordinaire
depuis Kant : Tout phnomne, c'est--dire tout ce qui commence
d'exister, a une cause ; mais, d'une manire plus gnrale, sous cette
forme : Tout a une cause. C'est ce principe qui nous conduit jusqu' Dieu ; mais nous ne devons pas exempter Dieu lui-mme ; car
alors le principe perdrait sa force. Dieu a donc besoin d'une cause ; et
nous avons le droit de demander pourquoi il existe, ou, ce qui est la
mme chose, pourquoi il n'a pas besoin d'autre cause efficiente que de
lui-mme ; et ce pourquoi est prcisment ce qui tient lieu pour lui de
cause efficiente.
Il est vident que, dans cette discussion, Descartes s'lve audessus des ides moyennes dont se contente la raison humaine en tant
qu'elle est claire et distincte elle-mme. Nous ne voyons en effet
d'une manire claire que deux choses : ou bien la cause efficiente proprement dite, en tant qu'elle est distincte de son effet et qu'elle le contient a priori, et par consquent qu'elle lui est antrieure ; ou bien
pas de cause. Et cependant il est en mme temps vident pour la raison qu'il doit y avoir un troisime terme, ein Drittes, comme dit Hegel ; car, quoiqu'il soit vrai d'un ct que la notion de cause efficiente
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
199
ne peut s'appliquer proprement Dieu par rapport lui-mme dans le
sens habituel que nous attachons au mot de cause, cependant, d'un
autre ct, il n'est pas moins vrai que pas de cause est insuffisant ; car
il faut une raison propre pour qu'un tre n'ait point de cause ; et c'est
cette raison propre qui tient lieu de cause ; comme il n'y a point
d'autre tre avant Dieu, la raison propre pour laquelle il n'a pas de
cause doit tre cherche en lui-mme ; et cela c'est la cause ; il est
donc sa cause lui-mme.
[214]
Si l'on se contente de dire que l'tre par soi ne doit s'entendre que
dans un sens ngatif, c'est--dire signifiant seulement que Dieu n'a pas
de cause, son existence alors n'est plus qu'un fait brutal, sans raison. Il
est parce qu'il est. Mais, si l'on admet le fait brutal l'origine des
choses, qu'a-t-on besoin de Dieu, et ne peut-on pas dire de l'tre quelconque qui serait par lui-mme, qu'il est parce qu'il est ? Or cela peut
tre aussi bien dit de la matire que de Dieu. Il faudra donc une raison ; or cette raison ne peut tre, comme dit Descartes, que l'infinie
et incomprhensible puissance de Dieu . Dieu est si puissant et si
grand que sa puissance fonde son tre, et si parfait que son essence
emporte l'existence.
On ne peut chapper ce dilemme de Descartes : ou point de
cause, et par consquent point de Dieu ; ou Dieu cause de soi, dans le
sens positif du mot. Et cependant il nous est impossible de comprendre qu'une chose soit cause de soi. Nous sommes donc l en prsence d'une incomprhensibilit fondamentale qui confine aux mystres de la thologie. Car s'il est obscur de dire que Dieu engendre le
Fils, combien plus obscur de dire que Dieu s'engendre lui-mme ! ou
plutt n'est-ce pas la mme chose ? n'est-ce pas prcisment la doctrine de la gnration du Fils qui, traduite en langage philosophique
abstrait, est devenue dans Descartes la doctrine de Dieu cause de soi ?
Dieu en tant qu'il engendre est le Pre : c'est l'infinie et incomprhensible puissance dont parle Descartes ; Dieu en tant qu'engendr
est le Fils. Ces deux points de vue de la mtaphysique deviennent des
hypostases et des personnes en thologie. Dieu s'engendre lui-mme,
puisqu'il est Dieu en tant que Fils, tout aussi bien qu'entant que Pre.
Non seulement cette doctrine a de l'analogie avec les mystres
thologiques, mais il est littralement vrai qu'elle se rattache au
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
200
dogme de la Trinit ; et Descartes lui-mme ne contestait pas le rapport, et il y fait allusion : Car, dit-il, de mme que les thologiens
ont dit que le Pre est le principe du Fils, sans dire cependant que le
Fils soit principi, de mme je dis que Dieu est cause de lui-mme,
sans aller jusqu' [215] dire que Dieu est l'effet de lui-mme ; car l'effet est moins noble que la cause Et quoique encore les thologiens
craignent d'employer le mot cause dans la procession des personnes de
la Trinit, et prfrent le mot principe, ce n'est pas une raison de
craindre tant le mot de cause quand il s'agit de Dieu l'gard de luimme ; car il n'y a pas craindre que l'on suppose qu'il est moindre
que lui-mme, comme on pourrait le supposer des personnes de la
Trinit.
Descartes conclut de l qu'il a pu attribuer Dieu la dignit d'tre
la cause, sans qu'on puisse infrer de lui qu'il lui ait attribu l'imperfection d'tre effet . On voit ici encore une autre incomprhensibilit,
savoir une cause sans effet ; et cependant on ne pourrait attribuer
Dieu la qualit d'tre effet l'gard de lui-mme, sans tomber dans la
doctrine alexandrine de la procession, c'est--dire de la chute des divers tats divins et de l'ingalit des hypostases, doctrine que le christianisme avait rpudie. Ainsi Descartes, sans vouloir toucher au mystre de la Trinit, s'en est videmment inspir : et ce n'est pas une exagration de dire que la doctrine de Dieu causa sui est un mystre.
La doctrine quasi mystique de l'infinie et incomprhensible puissance de Dieu conduit Descaries une autre doctrine qui ne contredit
pas moins, en apparence du moins, les exigences de la raison et qui ne
peut tre non plus appele autrement qu'un mystre philosophique.
C'est la doctrine de la cration des vrits ternelles.
D'aprs tous les philosophes, les vrits ternelles et ncessaires
sont fondes en Dieu ; mais, dans l'opinion gnralement admise, et
qui parat la plus conforme la raison, les vrits ternelles rsident
dans l'intelligence divine, et elles ont pour fondement l'essence divine
elle-mme ; elles sont donc immuables et ternelles comme cette essence. Mais Descartes ne se contente pas de dire que les vrits ternelles sont fondes sur l'essence de Dieu. Il veut les subordonner encore, plus l'infinie et incomprhensible puissance de Dieu , et il
les rattache sa volont. Les vrits ternelles sont donc [216] cres
et produites par Dieu aussi bien que les vrits contingentes. Dieu est
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
201
l'auteur de la vrit comme il est l'auteur du monde. Ces vrits, ditil, ont t tablies par Dieu et dpendent de lui aussi bien que les cratures. Autrement, lui imposer de contempler et de reconnatre des
vrits qu'il n'aurait pas faites, ce serait l'assujettir au Styx et aux destines. Ces vrits, dit-il encore, ne sont vrits que parce que Dieu
les connat ; mais il ne faut pas dire que Dieu ne les connat que parce
qu'elles sont des vrits. Il ne faut pas dire : Les vrits subsisteraient s'il n'y avait point de Dieu ; car l'existence de Dieu est la premire de toutes les vrits. La raison qu'en donne Descartes est trs
remarquable : D'une part, dit-il, ces vrits sont proportionnes
notre entendement, mais l'infinie puissance de Dieu est au-dessus de
notre entendement ; donc elles sont quelque chose de moindre que
l'infinie puissance de Dieu . Et, si l'on demande en quel genre de
cause Dieu est l'auteur des vrits ternelles, il faut rpondre qu'il en
est efficient et totalis causa, et qu'il en est cause comme de l'existence
des cratures. Les vrits ne viennent pas de Dieu comme les rayons
du soleil viennent de cette source : ce n'est donc pas par manation
qu'elles drivent de Dieu, mais par une vritable cration, Illas creavit ; ou du moins, si l'on a peur de ce mot, Illas disposuit et fecit ; et
il ajoute : Je dis que je le sais, et non pas que je le conois et le
comprends. Mais qui a ncessit Dieu les crer ? Je dis qu'il a t
aussi libre qu'il ne ft pas vrai que toutes les lignes tires du centre
la circonfrence fussent gales, comme de ne pas crer le monde, et il
est certain que ces vrits ne sont pas plus jointes son essence que
les autres crations. Il faut admettre que Dieu a t de toute ternit indiffrent toutes choses, n'y ayant aucune ide qui reprsentt
d'avance le vrai ou le bien, rien qui ft l'objet de l'entendement divin
avant d'avoir t constitu tel par la volont ; et ce n'est pas parce qu'il
tait meilleur que Dieu crt dans le temps que Dieu a cr dans le
temps ; mais c'est parce que Dieu a cr dans le temps que cela est
meilleur. Descartes applique ce raisonnement mme [217] aux vrits mathmatiques, comme nous l'avons vu dj par l'exemple de
l'galit des rayons du cercle ; et il va jusqu' dire : Ce n'est pas
parce qu'il est impossible que les trois angles d'un triangle n'galent
pas deux droits que Dieu a voulu qu'il en ft ainsi ; mais c'est parce
qu'il l'a voulu ainsi que cela est vrai. Il s'ensuit que Dieu aurait pu
vouloir le contraire ; il aurait pu vouloir que 2 et 2 fissent 8, au lieu de
4. Enfin Dieu aurait pu faire qu'il y et des montagnes sans valles, et
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
202
des valles sans montagnes. Il aurait pu vouloir qu'il ne ft pas vrai
que les contradictoires ne pussent exister ensemble .
Ainsi, d'aprs ce dernier texte, on voit que Descartes, avant Hegel,
allait jusqu' mettre en question le principe de contradiction, ou du
moins le subordonner comme tout le reste la volont divine. Cependant il faut reconnatre que Descartes a singulirement attnu la
doctrine lorsqu'il a dit ailleurs que nous ne devons concevoir aucune
diffrence de priorit en Dieu entre l'entendement et la volont, car il
n'y a qu'une seule action simple et pure ; ce que les mots de saint Augustin expriment fort bien : quia video, ea sunt, parce qu'en Dieu videre et velle ne sont qu'une seule et mme chose (dit. Cousin, t. IX,
p. 172) . C'est l sans doute une rserve importante ; car alors ce n'est
pas la volont seule qui a fait la vrit ; il est vrai que l'entendement
n'a pas la priorit sur la volont, mais rciproquement la volont n'a
pas la priorit sur l'entendement : ce qu'il y a de paradoxal dans la
doctrine s'efface en grande partie. Il n'en est pas moins vrai que la volont est un des facteurs de la vrit, et que Descartes a cru que toutes
les vrits ternelles, y compris le principe de contradiction, sont des
vrits contingentes.
Une telle doctrine est incomprhensible ; et cependant, non seulement Descartes la recommande malgr son incomprhensibilit, mais
c'est l prcisment la raison mme pour laquelle il pense qu'on doit
l'admettre. Il lui semble que, si nous connaissions l'origine de la vrit, cela suffirait pour que cette origine suppose ne ft pas la vraie. En
quoi de telles affirmation [218] diffrent-elles des affirmations contenues dans les mystres chrtiens ? D'autre part, si on admet la doctrine
de Descartes, les mystres proprement dits cessent leur tour d'tre
incomprhensibles : car ce que l'on objecte aux mystres, c'est qu'ils
semblent violer le principe de contradiction. Mais si ce principe luimme est contingent, quoi d'tonnant que Dieu et tout ce qui constitue
la nature divine soient au-dessus de la raison ?
Il y a du reste une telle analogie entre l'incomprhensibilit thologique et l'incomprhensibilit mtaphysique, que Descartes rpond
l'objection qu'on lui fait de la mme manire que les thologiens lorsqu'on la leur fait eux-mmes.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
203
J'avoue, dit-il, que nous ne pouvons comprendre cela ; mais, d'un
autre ct, je comprends fort bien que rien ne peut exister en quelque
genre que ce soit qui ne dpende de Dieu. Ce serait une chose tout fait
contraire la raison de douter des choses que nous comprenons fort bien,
cause de quelques autres que nous ne comprenons point.
Il n'entre pas dans le plan de cette tude de prendre parti pour ou
contre la doctrine de Descartes ni sur Dieu causa sui, ni sur la cration
des vrits ternelles. Ce que nous retenons seulement, c'est que le
philosophe des ides claires et distinctes a enseign dogmatiquement
la doctrine des obscurits ncessaires ; c'est que pour lui cette doctrine
est une doctrine philosophique qu'il essaye de dmontrer rationnellement, et non par les arguments extrinsques de l'autorit et de la tradition ; enfin, c'est au nom de la raison que Descartes exige que l'on
s'lve au del de la raison ; et cependant cette doctrine contient un
lment d'incomprhensibilit que l'on pourrait la rigueur taxer de
contradiction : en un mot, ce sont des mystres ; et si Descartes nous
propose de tels mystres, ce n'est pas parce qu'il se serait attard en
thologie, sans s'lever jusqu' la philosophie, mais c'est que la philosophie moyenne, celle de l'entendement, ne lui a pas paru suffisante,
et qu'il a cherch s'lever au del. Il y a donc, en philosophie mme,
une rgion suprieure qui correspond la rgion [219] des mystres
en thologie, et de part et d'autre on professe qu'il faut monter jusqu'
l'incomprhensibilit pour comprendre le comprhensible.
Nous avons pris pour premier exemple la philosophie qui repose
sur le principe des ides claires et distinctes, comme la plus loigne
de toute ide mystique et par consquent de la tentation d'introduire le
mystre dans la science ; et cependant nous y avons trouv le mystre.
C'est donc qu'il y a l un vritable besoin de l'esprit. Ce n'est pas seulement un besoin de l'imagination, savoir le besoin de se reprsenter
sous forme sensible le monde intelligible ; c'est un besoin de la raison
dont la loi fondamentale est de se connatre elle-mme, et par l mme
de se reconnatre des limites avec une tendance inne dpasser ces
limites, c'est--dire avec un besoin de concevoir l'inconcevable et de
comprendre l'incomprhensible. Mais si ce besoin se manifeste si nettement dj dans la philosophie des ides claires, combien plus pres-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
204
sant encore sera-t-il dans les philosophies qui ont par elles-mmes une
tendance mystique et font une large part l'enthousiasme, l'amour,
l'extase, par exemple dans la philosophie de l'cole d'Alexandrie !
La doctrine alexandrine de l'Un au-dessus de l'tre,
, ne peut-elle pas, elle aussi, tre appele un mystre ? On sait en
quoi consiste cette doctrine. Dieu, dans le systme alexandrin, se
compose de trois hypostases. Il est a la fois un et triple, comme dans
la Trinit chrtienne. L'expression d'hypostase est mme celle que le
christianisme a emprunte la langue grecque pour exprimer les personnes de la Trinit, et c'est ce terme que les Latins on traduit par persona. On pourrait donc dire que les Alexandrins ont reconnu aussi
trois personnes dans la Trinit ; mais, outre que, dans la foi chrtienne, le mot de personne est arriv prendre un sens de plus en plus
concret, et qu'au lieu de puissances abstraites et mtaphysiques, on a
entendu par l des personnalits vivantes, outre cette premire diffrence, il y en a une autre : c'est que, dans la thologie chrtienne, les
trois [220] personnes sont gales entre elles, tandis que dans la thologie alexandrine elles sont ingales et que chacune drive de la prcdente par voie de descente et de chute. Ainsi au plus bas degr est
l'me ou principe de vie : c'est l'me du monde, c'est le dieu stocien.
Plus haut est l'Intelligence (le ;), qui est en mme temps l'tre ;
car l'tre, c'est l'intelligible, et il y a identit entre l'intelligible et
l'intelligence : c'est en mme temps le dieu de Platon et celui d'Aristote. Mais Aristote s'arrte l. Il pense que l'identit de l'intelligible et
de l'intelligence suffit pour constituer l'unit divine. Platon semble
dj avoir voulu s'lever plus haut, et, dans quelques textes obscurs de
la Rpublique, on pressent la doctrine alexandrine.
Aux dernires limites du monde intellectuel, dit-il dans la Rpublique, est l'ide du bien, qu'on aperoit avec peine, ,
mais qu'on ne peut apercevoir sans conclure qu'elle est la cause de
tout ce qu'il y a de beau et de bon, et que c'est elle qui produit directement la vrit et l'intelligence. Considre cette ide comme le
principe de la science et de la vrit ; et, quelque belles que soient la
science et la vrit, tu ne le tromperas pas en pensant que l'ide du
bien en est distincte et les surpasse en beaut ; que l'on peut considrer
la science et la vrit comme ayant de l'analogie avec le bien ; mais on
aurait tort de prendre l'une et l'autre pour le bien lui-mme, qui est
d'un ordre tout autrement relev. On voit par ces textes que Platon
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
205
plaait dj le bien au-dessus de l'intelligence, tandis qu'Aristote
l'identifiait l'intelligence ; mais, dans un autre passage, Platon allait
plus loin encore : Tu peux dire, ajoutait-il, que les tres intelligibles
ne tiennent pas seulement du bien ce qui les rend intelligibles, mais
encore leur tre et leur essence, quoique le bien lui-mme ne soit point
essence, mais quelque chose fort au-dessus de l'essence en dignit et
en puissance. Ainsi, dans Platon dj, au moins dans ce passage,
[221] on voit l'ide du bien suprieure non seulement l'intelligence,
mais l'essence. Celle doctrine a t dveloppe par l'cole d'Alexandrie, qui en a fait la base de sa philosophie. Plotin enseigne explicitement que pour trouver le principe suprme ou le bien, il faut s'lever
au-dessus de l'intelligence et de l'tre. La raison est que le premier
principe doit tre absolument un ; or l'intelligence n'est pas une, car
elle implique la dualit de l'intelligence et de l'intelligible et, comme
nous disons, la distinction du sujet et de l'objet, de l'tre et de la pense ; or partout o il y a dualit il faut aller au del. Le premier principe sera donc au-dessus de la pense et au-dessus de l'tre. Il sera par
l mme au-dessus de notre intelligence ( ).
Nous ne pourrons en parler que ngativement ; nous savons cependant
qu'il est et qu'il n'y a rien de plus parfait.
Qui pourrait contester cette doctrine le caractre de mystre ?
Peut-tre au contraire lui reprochera-t-on prcisment d'tre trop un
mystre, et de n'tre pas assez une doctrine philosophique. Cependant,
on y est conduit par le raisonnement et la rflexion. Elle est donc philosophique au mme litre que toutes les autres hypothses des philosophes ; car si Dieu est, par essence, l'tre en soi, il doit y avoir en lui
une raison de son tre, comme le disait Descartes ; et, s'il est l'intelligence en soi, il doit y avoir en lui une raison de son intelligence. Or
cette raison de l'intelligence et de l'tre doit tre quelque chose de suprieur l'intelligence et l'tre ; autrement elle n'en saurait tre la
raison. On voit que cette conception repose sur la raison elle-mme et
non pas seulement sur le sentiment, l'extase ou la foi. C'est la raison
elle-mme qui encore ici atteste la ncessit de quelque chose de suprieur la raison. Et cependant comment nous serait-il possible de
comprendre quelque chose de suprieur l'intelligence et l'tre,
puisque, ne possdant l'un et l'autre que par participation, il nous est
impossible de pntrer jusqu' leur essence. Nous ne pouvons donc
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
206
que croire ce principe transcendant. Est-ce l autre chose qu'un mystre ?
[222]
Je ne parlerai pas des philosophes comme Malebranche ou comme
Pascal qui ont introduit la thologie dans la philosophie, celui-ci en
proposant la doctrine de la chute originelle comme solution du problme du mal, celui-l en affirmant que le motif de la cration pour
Dieu a t l'Incarnation du Verbe ; car c'est l le seul motif digne de
lui, Dieu ne pouvant agir que pour un motif infini, et le motif ne pouvant tre autre que la prsence de l'infini dans la cration. Ces conceptions de Pascal et de Malebranche vont au del de ce que nous prtendons soutenir : ce n'est plus seulement l'affinit des deux sciences,
c'est leur fusion et peut-tre leur confusion. Mais combien d'autres
doctrines peuvent tre signales comme portant le caractre de mystre ! Par exemple, la doctrine si clbre et si scandaleuse de Hegel
sur l'identit des contraires n'a-t-elle pas pris sa source dans le besoin
de la raison de s'lever au-dessus d'elle-mme ? Le P. Gratry la dnonait avec indignation dans son livre les Sophistes et la critique,
sans songer qu'il frappait par l mme peut-tre sur la doctrine chrtienne. En effet, cette thse si rvoltante du philosophe allemand,
qu'tait-ce autre chose en ralit que la traduction abstraite et mtaphysique de la doctrine des mystres ? On nous enseigne thologiquement qu'au-dessus de la rgion de l'entendement, il y a une rgion
de vrits mystiques, o 1 est identique 3, o Dieu est homme, o
l'ternel tombe dans la mort. Ce sont l des contradictions au moins
apparentes qui cachent, dit-on, des vrits plus profondes, bien autrement intressantes que les vrits terre terre de l'entendement. Quoi
d'tonnant qu'un philosophe ait traduit cela en langage rationnel et en
une doctrine philosophique ? L'entendement, dira-t-il, ne voit les
choses que d'une manire simple : une chose est elle-mme et non pas
une autre. L'un est l'un ; l'tre est l'tre ; l'homme est l'homme. Dj
une cole de l'antiquit, poussant ce principe l'extrme, avait ni la
possibilit du jugement. Il ne faut pas dire, disait Antisthne, que
l'homme est bon, mais que l'homme est homme et que le bon est bon.
Mais qu'est-ce que cela nous apprend ? Au-dessus [223] de la philosophie de l'entendement est celle de la raison pure, qui nous apprend
que l'identit ne produit rien et n'a qu'une valeur logique. La contradiction est la condition de la vie. L'un doit tre multiple ; le mme doit
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
207
tre autre, comme l'avait dj pens Platon. Ainsi la pntration intime
des contraires est le principe constituant la ralit. Qui ne voit que
c'est le principe mme de la thologie introduit par Hegel dans la mtaphysique ?
Je ne doute pas non plus que le prestige exerc aujourd'hui sur les
esprits par la philosophie de Kant n'ait sa raison dans ce sentiment du
mystre, ce besoin de mystre que satisfaisait la religion, mais que la
philosophie rencontre son tour comme un de ses principaux ressorts.
Si le kantisme n'tait, comme on le dit, qu'une doctrine critique, s'il
n'tait que la ngation de la mtaphysique, pourquoi le prfrerait-on
au positivisme, qui dit la mme chose d'une manire beaucoup plus
simple et beaucoup plus claire ? Mais c'est que le kantisme est tout
autre chose ; c'est qu'il nous ouvre des perspectives que le positivisme
ne connat pas. Ce domaine des noumnes qui nous est ferm, et qui
est cependant le seul rel, et o nous pntrons par la morale, c'est-dire par la foi, ces antinomies qui se concilient peut-tre quelque part,
ce moi qui se substitue tout, et qui est tout prt redevenir Dieu,
cette libert autonome qui se donne elle-mme la loi, et des lois plus
svres qu'aucune de celles qu'imposent les lgislateurs humains, autant de mystres auxquels les no-kantiens croient comme l'vangile. Non seulement tout cela ressemble la thologie, mais, bien
plus, on peut dire que tout cela n'est au fond que la thologie protestante traduite en langage philosophique.
Ces analogies, ces affinits profondes de la thologie et de la philosophie nous expliquent comment il se fait que souvent les plus
croyants en religion ont t les plus hardis en mtaphysique, pourquoi
les Pascal, les Malebranche et les Fnelon sont les plus tmraires des
mtaphysiciens franais. Dans l'histoire de la philosophie, saint Anselme, le cardinal [224] de Cuza, etc., sont aussi au nombre des plus
hardis penseurs, sans compter dans l'antiquit Origne, Denys l'Aropagite. Bien loin d'touffer la pense, la grande thologie la conduit
sur les cimes les plus levs, et la doctrine des mystres lui ouvre les
voies les plus larges.
Je voudrais tirer une conclusion pratique de cette tude : c'est que
je crois peu philosophique de laisser entirement de ct, comme
n'ayant rien apprendre aux philosophes, l'tude de la thologie. Je
crois au contraire qu'un philosophe qui entrerait dans cette tude en
retirerait du profit. Je voudrais que les thologiens eux-mmes en re-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
208
vinssent aux fortes ludes thologiques et ne craignissent pas plus que
leurs anciens d'en tirer de savantes conceptions mtaphysiques. Au
moins au point de vue historique, l'histoire savante de la thologie serait un complment utile l'histoire de la philosophie. Mme dogmatiquement, les esprits libres qui sont placs au point de vue rationaliste
pourraient trouver dans cette tude quelque chose qui fconderait leur
propre pense. Bien loin de croire, avec les positivistes, que l'esprit
humain doit s'carter de la thologie aussi bien que de la mtaphysique, pour se borner aux sciences positives, je pense au contraire que
l'on doit revenir des sciences positives la mtaphysique, et de la mtaphysique la thologie, afin que toutes les sphres de la pense humaine soient en mme temps cultives.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
209
[225]
Introduction la science philosophique
Leon XIV
RAPPORTS DE LA PHILOSOPHIE
ET DES SCIENCES.
EXAMEN DU POSITIVISME.
Retour la table des matires
Messieurs,
Aprs avoir tudi les rapports de la philosophie et de la religion,
passons aux rapports de la philosophie et des sciences. Si, par son ct
spculatif, la philosophie touche la religion, par son ct concret et
exprimental la philosophie touche aux sciences. Elle remplit l'entredeux. Nous n'avons pas craint de montrer les affinits de la philosophie et de la religion, parce qu'il nous a sembl que le danger n'tait
pas de ce ct. Aujourd'hui, c'est plutt du ct des sciences positives
qu'il faut dfendre l'indpendance de la philosophie : car il n'est plus
craindre que la philosophie soit la servante de la thologie ; il est plutt craindre qu'elle ne devienne la servante des sciences, ancilla
scientiarum, tant la faveur gnrale se porte de ce ct.
Sans mconnatre l'alliance de la philosophie et des sciences, nous
avons donc surtout dfendre notre indpendance. Nous arrivons ainsi cette question que nous avions ctoye et annonce dans notre
premier semestre, mais que nous avions ajourne, savoir si la
science peut remplacer la philosophie.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
210
Cette proposition peut avoir deux sens : ou bien la science, comme
science, savoir les mathmatiques, la physique, l'histoire naturelle,
peuvent-elles subsister toutes seules, de manire remplacer compltement la philosophie, et qu'il n'y ait plus de philosophie du tout ? Cela est absolument [226] impossible. Il manquerait alors l'esprit de gnralit et de synthse qui fait ncessairement dfaut aux sciences particulires : car on ne fait des progrs dans ces sciences qu'en s'y enfonant d'une manire tout fait spciale. Le progrs mme des
sciences qui consiste dvelopper de plus en plus l'esprit de spcialit
prouve la ncessit d'une tendance oppose qui contrebalance cet excs, et par consquent de l'esprit philosophique. En fait, malgr cette
tendance vers la spcialit, jamais on ne s'est tant occup de philosophie, jamais on ne s'est tant intress la philosophie que depuis qu'on
a dit que l'on n'en ferait plus. On ne voit donc pas que jusqu'ici les
sciences soient en tat de prtendre supplanter la philosophie.
Mais on peut donner la proposition prcdente un autre sens :
c'est qu'il y aurait une philosophie nouvelle dont les doctrines seraient
les gnralits de toutes les sciences ; c'est la prtention du positivisme, prtention que nous avons a examiner. Nous nous tions engag, l'entre de ce cours, faire l'examen du positivisme ; mais nous
n'en avions pas trouv l'occasion. Cette occasion se prsente naturellement ici.
Le positivisme est parti de cette conception que toutes les sciences,
de mme que l'esprit humain en gnral, passent par trois phases ou
trois tats : l'tat thologique, l'tat mtaphysique, l'tat positif. Il nous
montre que la chimie, la physique, la mdecine, etc., ont d'abord cru
des personnalits surnaturelles, des puissances mystrieuses mles
aux choses et agissant par des moyens miraculeux, puis des entits
abstraites, des facults occultes, des substances spirituelles. Enfin
elles sont arrives l'tat positif, c'est--dire l'observation des phnomnes et de leurs rapports : c'est alors seulement qu'elles sont devenues des sciences. La physique, depuis les expriences de Galile, la
chimie depuis Lavoisier, la physiologie depuis Haller et Bichat, ont
pris le caractre de sciences positives.
Cela pos, si l'on veut que la philosophie son tour devienne une
science positive, il faut qu'elle subisse les mmes [227] rvolutions. A
l'origine, elle a t thologique ; depuis des sicles, elle est devenue
mtaphysique. Il est temps qu'elle devienne positive. La philosophie
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
211
positive sera donc celle qui s'appuiera sur les donnes des sciences
concrtes, et qui empruntera tout son contenu aux sciences exprimentales.
Grce ce contenu exprimental, la philosophie positive croit pouvoir s'opposer toutes les philosophies jusqu'alors connues, et elle les
enveloppe toutes sous le nom de mtaphysique. Elle se met elle-mme
part, comme quelque chose d'autre, comme une science positive qui
sera la mtaphysique peu prs ce qu'est la chimie par rapport l'alchimie, l'astronomie par rapport l'astrologie, etc. En un mot, elle
s'oppose la philosophie vulgaire comme la science la mtaphysique. C'est cette position habile qui a fait le succs du positivisme,
mais c'est cette position mme dont nous croyons pouvoir contester la
lgitimit.
Le positivisme a-t-il le droit de se mettre ainsi part et en dehors
des autres systmes de philosophie, de se crer une situation privilgie leur gard, en disant : Les autres coles sont des opinions, des
systmes plus ou moins arbitraires ; nous, nous sommes une science ?
Nous ne le croyons pas.
Sans doute la division de la philosophie en systmes contradictoires est un fait troublant pour l'esprit. Mais le positivisme est-il en
dehors des systmes, ou n'est-il pas lui-mme un systme soumis aussi
bien que les autres la controverse, et n'ayant pas plus qu'eux le caractre d'une science positive ? Voil la question.
Sans doute encore, si l'on accorde que l'esprit humain est incapable
de rien connatre au-dessus des phnomnes et des phnomnes physiques, voil la mtaphysique limine, et par l mme le positivisme
confirm dans toutes ses prtentions. Mais le postulat dont on part ici
est la doctrine mme d'un de ces systmes de mtaphysique que l'on
limine ; c'est la doctrine du scepticisme. Le positivisme, par son ct
ngatif, n'est donc autre chose que le scepticisme, c'est--dire prcisment l'un de ces systmes en dehors desquels il cherche se placer.
[228]
Remarquez que le ct ngatif du positivisme, savoir l'exclusion
de toute recherche spculative, est le caractre essentiel du positivisme : car, par son ct positif, lorsqu'il essaye de caractriser et de
coordonner les donnes des sciences concrtes, en quoi nous dit-il
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
212
quelque chose de contraire tout ce qui a t avanc par tous les mtaphysiciens ? Est-ce qu'Aristote, Bacon, Descartes, Leibniz, n'ont
pas, eux aussi, gnralis et coordonn les rsultats des sciences de
leur temps ? Ce qui caractrise la philosophie dite positive, c'est
d'avoir dit qu'il ne faut faire que cela : or c'est l du scepticisme, et pas
autre chose. La prtendue exclusion de la mtaphysique revient donc
tout simplement liminer tous les systmes au profit d'un seul sans
discussion.
Il faut accorder que la science positive s'oppose la mtaphysique
par un caractre remarquable, savoir la cessation de toute controverse sur un problme rsolu, et un progrs constant dans la somme
des vrits acquises. Mais cet avantage qui est au profit de la science
prtendrait-il tre mis galement au profit de la philosophie positive ?
C'est ce qui est fort douteux, car science positive et philosophie positive sont deux choses distinctes. La science est la science ; le positivisme est un systme de philosophie qui concourt avec tous les autres,
qui a, comme les autres, ses avantages et ses inconvnients, son fort et
son faible, mais qui n'est pas une science dans le sens propre du mot,
mais simplement une manire de voir sur la science, c'est--dire une
philosophie comme les autres, se prsentant avec ses chances et ses
risques, sans aucun droit de prtendre l'infaillibilit qui est le propre
de la science faite et dmontre.
Comprenez bien ce jeu et cette tactique employs habilement et inconsciemment par le positivisme. Voyant la solidit del science et
l'instabilit apparente de la philosophie, ils se sont dit : Fondons la
philosophie sur les sciences, et nous participerons aux avantages de la
science elle-mme. Mais c'est l un vritable sophisme. Comme
science, oui, vous tes infaillible, mais vous n'tes pas une philosophie ; comme philosophie, [229] vous n'tes pas plus une science que
les autres systmes. Au reste, cette sorte de jeu qui consiste se
mettre en dehors de la philosophie pour la rfuter et la remplacer, en
arguant de ses ternelles controverses, comme si l'on n'tait pas soimme un des combattants, ce jeu, dis-je, a t plusieurs fois jou en
philosophie, et par les plus grands hommes.
Par exemple, la religion est, comme la science, un domaine
d'infaillibilit ; elle s'appuie sur la rvlation, sur la parole mme de
Dieu, ct de laquelle toutes les opinions humaines sont de vritables bgayements d'enfants. Lorsque la religion dit qu'il faut croire,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
213
au lieu de se consumer en controverses striles, elle peut avoir raison
son point de vue, aussi bien que la science, lorsque celle-ci nous dit
qu'il ne faut affirmer que ce qui est dmontr par l'exprience et par le
calcul. Chacune de ces deux puissances, religion et science, peut se
croire autorise mpriser la philosophie et s'en passer. Mais ce qui
peut tre vrai de la religion ou de la science doit-il tre accord toute
philosophie qui prtendra relever de la religion ou de la science ?
L'infaillibilit propre la religion et la science doit-elle profiter
une philosophie qui s'appuie sur l'une ou sur l'autre ? videmment il y
a l une captation subreptice de l'esprit qui n'est pas plus lgitime dans
un cas que dans l'autre. Eh bien ! l'attitude qu'Auguste Comte a prise
l'gard de la philosophie en se couvrant de la science, Pascal l'avait
prise de la mme manire en se couvrant de la religion. Par cela seul
qu'il s'inspire du dogme religieux, il croit avoir le droit de se placer en
dehors de la philosophie proprement dite, de la regarder de haut, avec
le plus profond mpris : Mpriser la philosophie, c'est vraiment philosopher ; et encore : La philosophie ne vaut pas une heure de peine.
videmment il exceptait de ce jugement sa propre philosophie. Ces
jugements acerbes signifient tout simplement que tous les autres philosophes ont tort, et que lui seul a raison, parce qu'il s'appuie sur la
rvlation, qui est la seule vrit. Mais autre chose est la rvlation,
autre chose la philosophie de Pascal. La rvlation a son autorit
propre, qui ne relve pas [230] de la raison, tandis que le systme de
Pascal relve de la raison aussi bien que les autres systmes ; et je ne
suis pas plus forc de m'y soumettre qu' celui de Leibniz. C'est un
systme comme les autres, plus profond peut-tre, plus vrai peut-tre,
je n'en sais rien ; mais, en tout cas, c'est un systme. Le fait d'enseigner le pch originel ne lui confre pas une infaillibilit propre ; car
je puis croire au pch originel sans nier le droit naturel, comme Pascal, sans jouer Dieu pile ou face, comme dans le fameux morceau
sur le pari, sans dire enfin, comme il le fait, que nous ne savons de
Dieu ni ce qu'il est ni s'il est. Voil donc un exemple d'un penseur essayant de se sparer des autres philosophies, pour luder l'objection
qui leur est commune toutes, savoir l'instabilit et la discorde des
opinions, et essayer de bnficier d'une autorit diffrente. Mais c'est
l un vritable jeu, et personne ne s'y laisse prendre.
Voici un autre exemple du mme artifice. Il est vident que tous
les hommes ne peuvent pas tre philosophes. Cependant il faut une
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
214
rgle. Les hommes, pour la plupart, la trouvent dans leur propre cur.
Sans doute on peut dire d'une manire gnrale : Un bon cur vaut
mieux que toute philosophie. Un saint Vincent de Paul, un abb de
L'pe, peuvent tre suprieurs devant Dieu tous les mtaphysiciens. Tout cela, dis-je, peut tre vrai au point de vue pratique. De l
la tentation pour un philosophe de fonder sa philosophie sur le cur et
de se sparer par l de tous les autres, en rclamant pour sa philosophie par rapport aux autres le privilge qui appartient au cur dans la
vie pratique. C'est ce qu'a fait Rousseau dans le Vicaire Savoyard.
Voyez comme il parle des philosophes.
Je consultai les philosophes ; je feuilletai leurs livres ; j'examinai
leurs diverses opinions ; je les trouvai tous fiers, affirmatifs, dogmatiques
mme dans leur scepticisme prtendu, n'ignorant rien, ne prouvant rien, se
moquant les uns des autres Quand ils seraient en tat de dcouvrir la vrit, qui d'entre eux prendrait intrt elle ? Chacun sait bien que son systme [231] n'est pas mieux fait que les autres ; mais il le soutient parce
qu'il est lui. Il n'y en a pas un seul qui, venant connatre le vrai et le
faux, ne prfrt le mensonge qu'il a trouv la vrit dcouverte par un
autre L'essentiel est de penser autrement que les autres. Chez les
croyants il est athe, chez les athes il serait croyant.
Je pris donc un autre guide, et je me dis : Consultons la lumire
intrieure.
Ainsi Rousseau, comme Pascal, comme Auguste Comte, se met
part des philosophes, auxquels il oppose, comme toujours, leurs contradictions et leur esprit de systme. Sa rgle lui, c'est la lumire intrieure, la conscience, le cur. Mais il ne voit pas qu'il n'est luimme qu'un de ces philosophes auxquels il s'oppose. Sans doute il
s'appuie surtout sur le sens commun, sur l'instinct du cur et de la
conscience ; mais ce n'est pas cependant sans employer le raisonnement, et mme quelquefois un raisonnement assez subtil. Ou bien il
faut croire navement, de la foi du charbonnier, parce qu'on n'a ni le
temps ni la force de se livrer la mtaphysique ; ou bien, mme si l'on
s'appuie sur le sens commun, on fait de la mtaphysique, on entre dans
la lice, on est un des combattants. De quel droit s'excepte-t-on du jugement acerbe que l'on porte sur tous les autres ? Le tableau de J.-J.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
215
Rousseau peut s'appliquer lui-mme aussi bien qu' n'importe quel
autre. Lui-mme avait plus que personne le dsir et le got de ne point
penser comme les autres. Si, dans le Vicaire Savoyard, il soutient le
devoir et le sens commun, partout ailleurs sa philosophie est une philosophie du paradoxe ; et son disme lui-mme, en face du salon du
baron d'Holbach, tait encore un paradoxe. On pourrait donc, dans le
camp adverse, lui appliquer le trait mme par lequel il termine sa diatribe, savoir que le philosophe cherche tellement se distinguer, que
chez les athes il se fait croyant. C'tait sa propre histoire. Quoiqu'il
en soit, la philosophie de la conscience et du cur est une philosophie
comme une autre : c'est un demi-scepticisme et un demi-dogmatisme
qui rpond un certain tat d'esprit, [232] un certain besoin de
l'me, mais qui n'est pas d'une autre essence que les autres systmes
de philosophie.
Grce ces exemples, nous pourrons mieux comprendre ce qu'il y
a de sophistique dans la conception d'une philosophie positive. Le sophisme est celui-ci : il y a des sciences positives qui ont une certitude
absolue ; nous n'avons qu' construire une philosophie sur les
sciences, et nous aurons une philosophie positive qui jouira des
mmes avantages que la science elle-mme. C'est l un abus de mots.
Il y a dans la philosophie positive la fois du philosophique et du
positif ; mais ce qui est positif n'est pas philosophique, et ce qui est
philosophique n'est pas positif. En effet, cette philosophie se compose
de deux choses : 1 de donnes positives et concrtes empruntes aux
sciences proprement dites ; or cela, c'est de la science ; ce n'est pas de
la philosophie ; 2 de considrations gnrales, de rflexions sur ces
donnes positives ; or cela, c'est bien de la philosophie, mais ce n'est
plus de la science dans le sens propre du mot ; ce sont des vues du
mme ordre que celles des autres philosophies, soumises comme
celles-ci la contradiction, susceptibles d'interprtations diverses, de
plus ou de moins, n'ayant nullement le caractre d'infaillibilit absolue
qui parat tre le propre des vrits scientifiques proprement dites.
Ce qui donne surtout aux vrits scientifiques leur caractre positif,
c'est l'emploi de la mthode exprimentale et du calcul ; or les conceptions positives ne sont pas, plus que les autres conceptions philosophiques, du domaine de l'exprimentation et du calcul.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
216
Prenons, par exemple, ces deux thormes principaux de l'cole
positiviste : la thorie des trois tats et celle des six sciences fondamentales.
Ni l'une ni l'autre de ces thories n'est susceptible d'tre soumise
l'exprience et au calcul. La premire est une induction tire de l'histoire de la civilisation et de l'histoire des sciences, peu prs comme
la thorie du progrs dans Condorcet, ou dans V. Cousin la thorie des
quatre systmes [233] fondamentaux, le sensualisme, l'idalisme, le
scepticisme et le mysticisme. Cette thorie des trois tats peut s'entendre de beaucoup de manires. On peut soutenir qu'ils ne sont pas
ncessairement successifs, mais simultans. On peut soutenir, et c'est
notre opinion, qu'il y a un mouvement de retour en sens inverse. On
peut donc admettre ces trois phases, et diffrer sur l'interprtation des
phases. Ce n'est pas l une vrit positive semblable la loi de la
chute des corps. Tout au plus cela pourrait-il ressembler ce que l'on
appelle dans la science des thories ; mais prcisment une thorie
c'est ce qu'il y a dans la science de moins positif.
De mme la distinction des six sciences fondamentales est loin
d'tre une vrit positive, au-dessus de toute contestation. Elle est susceptible de contradiction, de discussion, de modification. Elle ne peut
tre objet ni d'exprience ni de calcul. C'est une vue vraie ou fausse
sur l'enchanement des sciences, qui est du mme ordre, nous l'avons
vu plus haut, que les vues des autres philosophes sur les mmes matires.
Le caractre distinctif, avons-nous dit, des sciences positives (et
c'est Auguste Comte lui-mme qui a le plus insist sur ce critrium),
c'est la cessation de controverse. Mais le positivisme, comme la philosophie, a-t-il mis fin aux controverses ? A-t-il tu la mtaphysique ?
En aucune faon. La mtaphysique a continu combattre le positivisme, comme le positivisme combat la mtaphysique. Dans le sein
mme de son cole, le positivisme n'a pas tu l'esprit de controverse.
Il a suscit des coles diffrentes qui relvent de lui : d'un ct les orthodoxes, de l'autre le positivisme indpendant, puis des ramifications
voisines et profondment diffrentes. Le positivisme anglais, par
exemple, a rtabli une grande partie de ce qu'Auguste Comte avait ni.
Celui-ci avait ni la psychologie subjective : Mill l'a rtablie. Il avait
ni l'existence de l'absolu : Herbert Spencer l'a rtabli sous le nom
d'inconnaissable. Auguste Comte avait ni toute hypothse sur l'ori-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
217
gine des choses : H. Spencer a construit une vraie hypothse de cosmogonie universelle.
[234]
On dira sans doute que Comte a laiss aprs lui au moins ceci, savoir : l'esprit positif, l'esprit exprimental, qui fait sans cesse de nouveaux progrs. Cela est vrai ; cela prouve le mrite de cette philosophie que nous ne mettons point en question en ce moment ; mais cela
ne prouve pas que le systme en tant que systme ait subsist. Ce qui
subsiste, disons-nous, c'est l'esprit positif, l'esprit exprimental. Mais
c'est ce qui subsiste de tous les grands systmes. L'esprit cartsien,
c'est--dire le got des ides claires et distinctes, a subsist. L'esprit
voltairien, c'est--dire l'habitude de n'tre dupe de rien, a subsist.
L'esprit critique, savoir la mthode qui consiste faire la part dans la
connaissance du subjectif et de l'objectif, a subsist. L'esprit clectique, ou la tendance trouver du vrai partout, a subsist. Il en est de
mme de l'esprit positif, qui n'est autre chose que l'esprit baconien.
Ainsi la tendance exprimentale, le got du concret, reste comme un
des lments lgitimes de la philosophie et, je le veux bien, c'est l un
gain du positivisme ; mais il n'a pas pour consquence l'absorption de
la philosophie dans les sciences. Comme systme, le positivisme a
donc chou.
Admettons mme encore, si l'on veut, le thorme fondamental du
positivisme, savoir la loi des trois tats. Nous ne sommes point forcs d'admettre les consquences que l'on en tire. Ce sera, si l'on veut,
une loi historique de passer du point de vue thologique au point de
vue mtaphysique, et enfin au point de vue exprimental. Mais qui
prouve qu'il n'y a point une loi inverse, qui consisterait remonter la
srie aprs l'avoir descendue ? Ils n'ont vu que la loi descendante, et
non la loi ascendante ou rascendante, qui n'est pas moins vraie que
l'autre. Car, arrivs au terme de l'esprit positif, le besoin d'une explication plus haute et plus gnrale se fait sentir ; on revient au point de
vue mtaphysique, et bientt on est ramen la plus haute explication
possible, c'est--dire l'explication thologique. C'est du moins ce qui
est arriv Auguste Comte lui-mme, puisque sa seconde philosophie, qu'il appelle philosophie subjective, n'est autre chose qu'une mtaphysique [235] et une thologie. Seulement, ayant supprim toute
mtaphysique, il a t oblig de reprendre toutes choses par le com-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
218
mencement, et il est revenu au ftichisme, c'est--dire la thologie la
plus grossire.
Nous n'avons pas voulu discuter le positivisme dans sa partie dogmatique, dans son contenu philosophique : car, ce point de vue, il
n'est autre chose que le scepticisme et le sensualisme ; et ce n'est pas
le lieu d'examiner ces deux systmes, examen qui nous entranerait en
pleine mtaphysique. Nous nous sommes content de discuter l'attitude inadmissible du positivisme qui consiste s'opposer lui-mme
toutes les autres philosophies, comme les sciences positives ellesmmes, comme la chimie l'alchimie, l'astronomie l'astrologie. C'est
l une prtention nullement justifie. En rsum, lorsque la philosophie se borne tre une philosophie des sciences, elle n'a pas russi
se constituer par l en science positive ; elle n'est autre chose qu'une
servante des sciences, ancilla scientiarum, les suivant pas pas, et
n'ayant d'autre autorit que celle qui appartient toute autre philosophie. Est-ce pour un si mince rsultat que l'on aura mutil la pense
humaine, en lui interdisant les plus hautes recherches ? En ralit, le
savant proprement dit ne s'intresse pas plus aux conceptions positives
qu' toute autre conception philosophique ; il les carte toutes galement comme opinions arbitraires et individuelles. On n'a donc rien
gagn se mettre au service des sciences ; on a seulement perdu le
point d'appui qui est le fond solide de la philosophie, savoir le fait de
conscience ; mais on n'en a pas trouv d'autre la place. Nous n'avons
pas revenir ici sur ce que nous avons tabli dans nos premiers cours
sur l'objet propre de la philosophie. Il nous suffit d'avoir dmontr le
peu de validit de l'entreprise qui enlverait la philosophie ellemme pour la faire reposer sur un domaine qui ne lui appartient pas en
propre.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
219
[236]
Introduction la science philosophique
Leon XV
RAPPORTS DE LA PHILOSOPHIE
ET DES SCIENCES (SUITE)
Retour la table des matires
Messieurs,
Aprs avoir discut les prtentions des sciences rgenter ou
mme supplanter la philosophie, nous avons revenir une question
plus modeste, qui est de dterminer avec prcision le rapport de ces
deux puissances, les services qu'elles peuvent se rendre l'une l'autre,
leurs affinits et leurs oppositions.
Il y a deux choses considrer : 1 le point de vue de la sparation ; 2 le point du vue de la runion et de la conciliation. Sparer et
runir, telles sont les deux oprations de l'esprit. Nous avons donc
nous demander comment les sciences el la philosophie sont distinctes
et indpendantes l'une de l'autre, comment elles sont unies, lies ensemble et respectivement ncessaires l'une l'autre.
L'indpendance des sciences et de la philosophie, si elle existe,
doit tre rciproque. C'est cette seule condition qu'elles contracteront
une alliance solide, dans laquelle aucune d'elles ne sera vassale de
l'autre.
Disons d'abord qu'en conservant, suivant l'usage, le mot de
sciences pour dsigner les tudes concrtes et positives, qui ont l'uni-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
220
vers extrieur pour objet, nous ne consentons pas pour cela abandonner pour la philosophie le nom de science ; elle est une science au
mme litre que toutes les autres sciences morales ; mais ici nous la
comparons aux sciences proprement dites. C'est des sciences ainsi entendues que nous avons tablir d'abord l'indpendance l'gard de la
philosophie.
Les sciences, dans l'antiquit et au moyen ge, taient [237] subordonnes la philosophie. Elles ont rclam leur indpendance avec
juste droit. Il est trs vrai, et sur ce point les positivistes ont raison,
que les sciences n'ont fait de vritables progrs que depuis qu'elles se
sont spares de la mtaphysique.
1 En effet, si nous considrons, par exemple, la physique de l'antiquit, la physique d'Aristote, nous verrons que ce qui distingue cette
physique de la physique moderne, c'est qu'elle est tout entire pntre
de mtaphysique, et mme qu'elle n'est autre chose qu'une partie de la
mtaphysique. Voici, en effet, les diffrentes questions traites dans la
Physique d'Aristote. Livre Ier : les principes de l'tre, la matire et la
forme ; la puissance, l'acte et la privation. Livre II : de la nature ; opposition de la nature et de l'art. Livre III : la dfinition du mouvement ; l'infini. Livre IV : l'espace, le temps, le vide. Livre V : les diverses espces de mouvements. Livres VI et VII : la divisibilit de la
matire et du mouvement. Livre VIII : de l'ternit du monde et du
premier moteur. On voit que c'est l un trait complet de mtaphysique. Jusqu'aux XVIIe sicle, la physique a t encombre de questions
mtaphysiques ; l'infini, le vide, le continu, les quatre causes ; toutes
les objections des positivistes sont justement appliques cette sorte
de physique. C'est la grande rvolution opre par Galile d'avoir limin la mtaphysique de la physique, et d'avoir rduit cette dernire
science des phnomnes d'observation et de calcul, des phnomnes observables et, autant que possible, mesurables.
2 Un autre abus de l'intervention de la mtaphysique dans les
sciences tait l'abus des causes finales. La cause efficiente peut tre
objet d'exprience, si on entend par l les circonstances dterminantes
d'un fait ; mais le but d'un phnomne ne peut tre qu'une conception
de l'esprit. Le but ne se voit pas, il ne tombe pas sous les sens ; il est
cach, il est induit ; il n'est pas peru. La cause finale ne servait pas
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
221
dcouvrir l'essence des phnomnes, en faire connatre les lments,
les conditions et les lois. Elle masquait l'ignorance, [238] et par consquent ne poussait pas la recherche de la vrit. Ce n'tait pas prcisment dans la physique proprement dite que l'on employait la cause
finale ; c'tait en physiologie. C'est Galien surtout, plus encore
qu'Aristote dans la physique, qui faisait abus de la cause finale. Les
sciences naturelles ont donc demand tre affranchies des causes
finales, comme la physique tre affranchie des causes mtaphysiques ; cette double rclamation tait lgitime et devait tre accueillie.
3 Enfin les sciences ont rclam galement contre les prtentions
des mtaphysiciens rgenter la science, lgifrer pour elle, lui
fournir ses principes et ses mthodes. Les principes de la gomtrie ne
sont pas des principes philosophiques, mais mathmatiques. Les principes de la mcanique et de la physique (par exemple la loi de l'inertie
et la loi d'galit de l'action et de la raction) sont des principes mcaniques et physiques. Ce sont, comme l'a dit Aristote, des principes
propres, qui ne viennent pas d'une science suprieure. De mme pour
les mthodes. Ce n'est pas Aristote qui a enseign la mthode d'Euclide aux mathmaticiens ; ce n'est pas Bacon qui a enseign la mthode inductive aux physiciens : c'est Galile. Lorsque ces deux personnages sont runis en un seul, comme dans Descartes, on peut se
demander si c'est le philosophe qui a instruit le mathmaticien, ou le
mathmaticien qui a instruit le philosophe. Le philosophe d'ailleurs ne
traite de la mthode que de la manire la plus abstraite et la plus gnrale. Le savant au contraire invente tous les jours des mthodes nouvelles pour des questions nouvelles.
La conclusion de toutes ces observations aboutit cet axiome clbre que l'on impute je ne sais quel savant, soit Newton, soit
d'Alembert, et qui se formule ainsi : O physique, garde-toi de la mtaphysique !
Rciproquement il n'est que juste de protester galement contre la
prtention de la science positive dominer et absorber la philosophie. 17
17
Voir sur cette question le livre remarquable de M. Liard : la Science positive
et la Mtaphysique.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
222
[239]
1 Les problmes de la physique ont une limite. Est-il juste de mesurer d'aprs celle limite les efforts de la philosophie, et d'exclure pour
cette raison tous les problmes qui ne tombent point sous la science
positive ? De ce qu'un problme est insoluble pour la physique, s'ensuit-il qu'il soit insoluble en soi et d'une manire absolue ?
2 Nous avons vu, du reste, et nous n'avons plus besoin de revenir
sur celle dmonstration, que la mtaphysique, ou, d'une manire plus
gnrale, la philosophie, repose sur deux faits essentiels et spcifiques : 1 le fait de conscience ; 2 le fait de la plus haute gnralit
possible.
Disons seulement quelques mots de ce second point de vue.
En caractrisant la philosophie par l'ide de la plus haute gnralit
possible, nous avons voulu viter de prendre parti pour une solution
plutt que pour une autre dans les diverses questions qui s'agitent en
mtaphysique, par exemple dans la question du relatif et de l'absolu.
Nous voudrions rallier l'ide de la philosophie en gnral mme
les empiristes, mme les positivistes. Il y a l dj un fondement la
distinction de la mtaphysique et des sciences positives, en ce que les
sciences se bornent des gnralits partielles et non absolument gnrales. Seulement, cette sorte de philosophie ne serait pas encore entirement indpendante des sciences, parce que le terme de la plus
haute gnralit possible n'implique pas assez que cette gnralit est
d'un autre ordre que les autres ides gnrales ; il n'y aurait donc entre
la philosophie ou mtaphysique et les sciences qu'une diffrence de
degr. Mais c'est une question prcisment de savoir si entre l'objet de
la mtaphysique et celui de la physique il n'y a qu'une diffrence de
degr, ou s'il n'y a pas une diffrence d'espce ; ce que nous appelons
matire, me, Dieu, ne serait-ce que la plus haute gnralit des phnomnes physiques, psychologiques ou cosmiques ? Ou ne sont-ce
pas des thses d'un tout autre ordre ? Sans affirmer d'avance que c'est
cette seconde solution qui est la vraie, on accordera cependant aussi
qu'on ne peut pas [240] non plus affirmer d'avance qu'elle est fausse ;
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
223
et ce serait le faire si on disait que le terme de la plus haute gnralit
possible ne doit s'entendre que d'une gnralit analogue celle des
phnomnes. Nous conserverons donc cette expression, la condition
que la question reste ouverte, et par consquent que l'indpendance de
la philosophie soit sauvegarde.
Le rsum de ce second examen sera donc une proposition analogue celle qui rsumait le premier, et que l'on peut formuler ainsi :
O mtaphysique, garde-toi de la physique !
Aprs avoir spar ces deux domaines, faut-il cependant s'arrter a
un divorce absolu ? Faut-il que les sciences physiques et mathmatiques et les sciences philosophiques et morales restent absolument
trangres les unes aux autres ? Non ; deux raisons s'y opposent : 1
l'unit de l'esprit humain ; 2 l'unit de l'univers.
1 Il n'y a pas deux sortes d'esprit humain, l'un tourn vers le dehors, l'autre tourn vers le dedans ; l'un se bornant aux phnomnes,
l'autre s'levant aux causes et aux principes. Il n'y a qu'un seul esprit
humain, obissant partout aux mmes lois, exerant partout les mmes
facults, et qui ne se satisfait compltement que par la runion et la
synthse de toutes les connaissances. Sans doute la connaissance adquate de toutes les sciences est impossible ; mais c'est un besoin lgitime de se rapprocher de ce but et de runir, dans la mesure du possible, le gnral et le particulier.
2 Mme considration pour l'unit de l'univers. L'objet de la
science en gnral (philosophie comprise), c'est l'univers tout entier,
non telle ou telle partie de l'univers. Non seulement toutes les parties
de l'univers forment un seul et mme tout, mais l'univers lui-mme ne
peut tre spar de ses causes et de ses principes.
Ainsi l'unit subjective et l'unit objective de la pense et de l'tre
nous imposent l'obligation de rapprocher autant [241] que possible
nos connaissances les unes des autres, et surtout la connaissance du
gnral de la connaissance du particulier. Considrons donc de plus
prs la corrlation des deux sciences, savoir la science positive et la
philosophie. Cette question se divise en deux parties :
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
Secours de la science positive envers la philosophie ;
Secours de la philosophie envers la science positive.
224
I. Le principe gnral est celui-ci : la distinction n'empche point
l'union. En effet : 1 la distinction de la pense subjective et du milieu
objectif (y compris le corps humain) n'exclut pas l'tude des conditions organiques auxquelles cette pense est assujettie. Par consquent
la psychologie est unie la physiologie, comme nous l'avons vu plus
haut. L'tude de la perception extrieure est lie l'tude des organes
des sens. L'lude de l'habitude est lie l'tude des fonctions motrices ; enfin l'lude de l'intelligence est lie l'lude des fonctions
crbrales. Donc corrlation incontestable entre la science de l'esprit
et la science du corps. Cette corrlation rpond l'unit de l'tre humain.
2 Non seulement la distinction de l'esprit et du corps n'exclut
point la connaissance du corps et, au point de vue de l'tude des facults et des fonctions, appelle ncessairement l'union des deux sciences,
mais mme la question mtaphysique de l'essence de l'me exige la
connaissance du corps ; car pour savoir si deux substances sont distinctes, si l'me est une chose et le corps en est une autre, il faut savoir
ce que c'est que le corps ; or, pour cela suffit-il de la connaissance
vulgaire ? ne faut-il pas demander aux sciences de la matire ce
qu'elles entendent par matire ? Comment trancher le dbat entre
Leibniz et Descartes, entre ceux qui prtendent que l'essence des corps
est l'tendue, et ceux qui prtendent que c'est la force, sans quelques
connaissances empruntes la mcanique ? Lors mme qu'on soutiendrait, ce qui est possible, que ce dbat dpasse la porte del
science exprimentale, encore faudrait-il savoir quelles sont les donnes de la science exprimentale en cette question, pour tablir que
nous avons le [242] droit de la dpasser. De mme, peut-on soutenir
l'atomisme philosophique sans avoir quelques notions de l'atomisme
physique et chimique ? La philosophie peut-elle tre indiffrente entre
l'hypothse des crations spciales et l'hypothse de l'volution ? Et
peut-on avoir un avis sur ces hypothses sans avoir tudi les faits que
les naturalistes des deux coles font valoir en faveur de leur opinion ?
Et de mme, comment les mtaphysiciens pourraient-ils parler de la
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
225
nature de la vie et choisir entre l'hypothse de l'animisme, du vitalisme et de l'organicisme, sans se mettre au courant des arguments que
les mdecins ont avancs pour l'une et l'autre de ces hypothses ; sans
tudier, par exemple, les livres de l'cole de Montpellier ou ceux de
l'cole de Paris ?
3 Il en est de mme encore pour la thodice. Cette science repose, en partie du moins, sur le principe des causes finales. Or, pour
prouver qu'il y a des causes finales dans le monde, il faut d'abord connatre le monde. Comment affirmer qu'il y a un plan dans l'univers, si
l'on ne sait rien de l'univers ? Le mtaphysicien le plus loign de la
science positive n'est pas sans savoir que les savants ne sont pas favorables aux causes finales et les liminent autant que possible dans
l'explication des phnomnes. Ne faut-il pas savoir pourquoi ? Et ne
ft-ce que pour faire voir la diffrence du point de vue mtaphysique
et du point de vue scientifique, et pour montrer que l'exclusion relative
des causes finales, exige par la mthode empirique, n'entrane pas
l'exclusion absolue au point de vue des choses en soi, en un mot pour
justifier cette distinction, ne faut-il pas se mettre en prsence du point
de vue scientifique, et par consquent le connatre ? Quand mme
nous soutiendrions que le principe des causes finales est absolument a
priori et n'a pas besoin de l'exprience, il faut toujours cependant pouvoir comparer l'ide la ralit : car si en fait le monde n'tait qu'un
chaos ; s'il n'tait, comme le prtendent les pessimistes, qu'un sjour
de misres, il serait alors peu utile de possder a priori un axiome strile qui ne trouverait aucune application dans le monde rel.
[243]
4 De mme encore pour les autres parties de la philosophie par
rapport aux sciences voisines avec lesquelles elles sont en contact :
par exemple, la morale, le droit naturel, la politique, exigent des connaissances en jurisprudence, en conomie politique et en histoire.
5 Vient ensuite la thorie des mthodes. La logique pure, la logique formelle, peut certainement se constituer sans emprunter
grand'chose aux sciences. Mais il n'en est pas de mme de la logique
applique ou mthodologie. Peut-on expliquer la thorie des mthodes
scientifiques sans exemples ? Et o chercher des exemples, si ce n'est
dans les sciences ? C'est ainsi que la distinction de l'analyse et de la
synthse exige des exemples emprunts la gomtrie ; la thorie de
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
226
la mthode exprimentale exige des exemples emprunts la physique ; la mthode de classification, des exemples tirs des sciences
naturelles ; la mthode historique, des exemples tirs de l'histoire, etc.
II. Si la science est utile la philosophie en lui fournissant une partie de la matire, rciproquement la philosophie est ncessaire la
science pour lui donner la conscience claire de la mthode et de ses
principes.
1 La philosophie tudie les notions fondamentales dont chaque
science part, et qu'elle accepte comme donnes, sans en analyser ni la
nature ni l'origine. Par exemple, la gomtrie part de l'ide d'espace,
sans s'interroger sur la nature de l'espace. L'arithmtique part de l'ide
du nombre, la mcanique de l'ide du mouvement, la physique de
l'ide de matire, la physiologie de l'ide de vie, et beaucoup d'autres
notions sont mles celles-l ; et c'est ce qui explique la Physique
d'Aristote, qui n'est qu'une mtaphysique : la question du plein et du
vide, la question du fini et de l'infini, sont de ce genre. Que la science
puisse se constituer comme science en parlant de ces donnes comme
faits, sans en rechercher la nature et l'origine, cela est possible : il
semble cependant que la science suivra d'autant plus profondment les
consquences de ces donnes, qu'elle en aura mieux analys les principes. En supposant mme que nous ne puissions rien [244] savoir sur
ces principes, encore faut-il savoir que nous ne pouvons rien savoir.
2 Les mthodes dans leurs applications sont inventes par les
sciences elles-mmes ; elles n'ont pas besoin de les emprunter d'ailleurs ; mais ces mthodes leur tour, pour tre bien comprises, ont
besoin d'tre ramenes aux facults de l'esprit et leurs lois primordiales. C'est ainsi que la logique a le droit de dire qu'elle enseigne aux
sciences leurs mthodes. Elle ne leur apprend pas s'en servir, mais
elles en donnent l'explication et la raison.
3 La philosophie est ncessaire pour donner aux sciences le got
et le besoin des ides gnrales et la pense de l'univers. L'absolu,
comme le dit Kant, est l'aiguillon qui pousse toujours en avant la pense scientifique.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
227
4 Enfin la philosophie explique la science ; elle en donne la raison
d'tre et la fin. Comment cela ? En lui montrant le caractre infini de
la raison humaine et la tendance dsintresse vers le bien, le beau et
le vrai. S'il y a une recherche dsintresse de la vrit, c'est que la
pense est un absolu qui se pense elle-mme. Mais elle ne peut se
penser sans penser quelque chose. Il faut que la pense s'applique
une matire. En tant qu'elle se tourne vers un objet, la pense devient
science ; en tant qu'elle se tourne vers elle-mme , elle devient philosophie. C'est donc le mme principe qui s'applique dans les deux cas,
et en ce sens la science elle-mme est philosophie.
Tels sont les rapports les plus gnraux de la philosophie et des
sciences. Pour des rapports plus particuliers, il faudrait entrer dans les
diffrentes sciences et les diffrentes parties de la philosophie. Nous
avons dit dj que la psychologie a surtout rapport la physiologie ; la
morale et le droit se lient la jurisprudence et l'conomie politique ;
la logique, aux mathmatiques ; la cosmologie gnrale, la physique
et l'astronomie ; mais c'est dans l'tude spciale de ces diffrentes
sciences que ces rapports ressortent avec le plus d'vidence. Les considrations gnrales qui prcdent suffisent pour le but que nous
poursuivons en ce moment.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
228
[245]
Introduction la science philosophique
Leon XVI
RAPPORTS DE LA PHILOSOPHIE
ET DE LHISTOIRE
Retour la table des matires
Messieurs,
Nous avons examiner maintenant les rapports de la philosophie et
de l'histoire.
Ces rapports peuvent tre ramens deux points de vue diffrents :
ou bien la philosophie subit la loi de l'histoire , ou bien l'histoire subit
la loi de la philosophie. Le premier de ces points de vue nous donne
l'histoire de la philosophie ; le second, la philosophie de l'histoire.
On pourrait concevoir un troisime point de vue donnant lieu une
nouvelle science qui n'existe pas encore et que l'on pourrait appeler la
philosophie par l'histoire. La philosophie et l'histoire ont en effet un
seul et mme objet, savoir l'homme, j'entends l'homme intellectuel et
moral ; mais elles l'tudient diffremment. La philosophie tudie
l'homme abstrait, l'homme en gnral avec ses facults permanentes ;
l'histoire nous montre l'homme concret, l'homme rel, avec toutes les
phases et toutes les vicissitudes de son dveloppement. C'est ainsi que
l'histoire des races humaines, le passage de la barbarie la civilisation, l'histoire des langues, etc., nous montre comment l'espce humaine, malgr les lignes persistantes et universelles de sa constitution,
se diversifie dans son dveloppement.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
229
Ce point de vue nous donnerait donc, ct de la philosophie proprement dite, une seconde philosophie fonde sur l'histoire. Cette seconde philosophie fait sans doute, en un sens, partie de la philosophie
de l'histoire ; mais elle pourrait en tre dtache et subsister par ellemme. C'est ce que [246] Bacon appellerait un desideratum. Ainsi,
ct de la psychologie pure, ou mme mle elle, il pourrait y avoir
une psychologie historique, ou histoire des facults humaines ; la psychologie pure nous dcrirait l'imagination ; la psychologie historique
ferait l'histoire de l'imagination : elle dcrirait l'imagination chez les
sauvages, dans les diffrentes races humaines ; elle nous dirait quelles
sont les images qui occupent l'esprit de ces races, les mtaphores dont
elles se servent de prfrence, etc. De mme, ct de l'analyse abstraite des raisonnements, soit par la psychologie, soit par la logique,
on ferait l'histoire de l'art de raisonner ; on remarquerait, par exemple,
l'absence de liaison logique chez les Chinois et les Hbreux. En logique, ct des thories gnrales viendrait se placer l'histoire des
mthodes ; en morale, l'histoire des murs ; en politique, l'histoire des
constitutions.
Cette philosophie par l'histoire servirait de complment, de contrepreuve, de vrification la philosophie proprement dite. Les lments de cette philosophie commencent se rassembler aujourd'hui.
On en trouverait de remarquables modles dans les ouvrages de M.
Taine, d'Herbert Spencer ; elle se mle ce que l'on appelle aujourd'hui la sociologie.
Il est remarquer d'ailleurs que ce n'est pas seulement en philosophie que le point de vue historique, le point de vue du devenir, du
changement, a t introduit de nos jours. C'est encore dans les
sciences proprement dites. Jusqu' notre sicle, ou tout au moins jusqu'au XVIIIe, la nature tait considre comme immuable. Mais on a
fini par s'apercevoir que la nature elle-mme avait chang travers les
sicles. C'est d'abord en gologie que ce point de vue a pntr, et est
devenu prdominant. Buffon fait un livre sur les poques de la nature, Cuvier sur les Rvolutions du globe. Plus tard, comme dans la
politique, l'ide de rvolution a t remplace par celle d'volution ;
les changements lents ont succd aux changements brusques. Depuis,
par l'hypothse du transformisme, le devenir et l'historique ont pntr
en zoologie. Dj l'embryologie avait introduit l'ide du devenir dans
le dveloppement [247] de l'individu ; et par analogie on fut amen
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
230
admettre une embryologie des espces, les espces primitives tant
considres comme les embryons des espces actuelles. Enfin, mme
en astronomie, la thorie nbulaire, comme on l'appelle, celle qui
forme le monde cleste par la comparaison des diffrentes nbuleuses,
l'ge do chacune d'elles tant proportionnel son degr de condensation, et qui en particulier explique notre monde plantaire par la condensation et le brisement d'une nbuleuse primitive, tout cela c'est de
l'histoire applique la formation de l'univers. Par l encore, l'histoire
s'unit la philosophie, ou du moins la cosmologie.
On pourrait encore signaler, parmi les rapports des deux sciences,
l'influence des ides sur les vnements, et l'influence des vnements
sur les ides. Mais le premier de ces deux points de vue rentre dans la
philosophie de l'histoire, le second dans l'histoire de la philosophie ;
car d'une part c'est bien le propre de la philosophie de l'histoire de
chercher les causes gnrales et philosophiques des vnements humains, et, de l'autre, l'histoire de la philosophie, qui a pour objet le
dveloppement des systmes, doit rechercher les causes intrieures et
extrieures qui dterminent ce dveloppement.
Il reste donc, comme nous l'avons dit d'abord, deux points de vue
essentiels considrer, soit l'histoire s'imposant la philosophie, soit
la philosophie s'imposant l'histoire.
Le premier nous prsente la philosophie soumise la loi du temps ;
le second, la loi du temps soumise la philosophie.
I. Considrons d'abord la premire de ces deux ides.
En principe, la philosophie, comme toutes les sciences, a pour objet l'univers : il est immuable, car la vrit, de sa nature, est immuable.
En tant que mtaphysique, la philosophie est la science de l'absolu.
Elle a pour objet la pense de la pense. Or les lois de la pense sont,
comme les lois de la nature, universelles et permanentes.
Cependant cette science est une science humaine ; et, en [248] tant
qu'elle est faite par des hommes, elle est soumise toutes les conditions de l'humanit, c'est--dire la loi de la vicissitude, des changements, des degrs, du progrs et des chutes qui est la loi du temps.
la vrit, il en est de mme dans toutes les sciences. La gomtrie elle-mme, qui est par excellence la loi de l'immobile, puisqu'elle
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
231
fait abstraction du mouvement, et la science du ncessaire, puisqu'elle
a pour objet les rapports des quantits, la gomtrie elle-mme a son
histoire ; elle n'a pas t cre tout d'un coup : elle est donc soumise
la loi du temps. Les sciences physiques ont d galement se dvelopper dans le temps, et il en est de mme de toutes les sciences ; toutes
sont discursives ; l'esprit humain ne voit les choses que les unes aprs
les autres. La philosophie, sous ce rapport, est donc semblable toutes
les autres sciences.
Cependant il y a des diffrences importantes :
1 Dans les autres sciences, le temps ne fait autre chose que dcomposer, dcouper en quelque sorte les recherches en diffrentes
parties. Le tout tant collectif, tant l'assemblage d'un certain nombre
de vrits partielles, on ne peut connatre ce tout que par l'addition et
la division des parties. En philosophie, l'intervention du temps a des
effets beaucoup plus graves, et elle modifie la science d'une manire
plus importante. Sans doute, comme nous avons essay de l'tablir, il
y a en philosophie, comme dans les autres sciences, beaucoup de vrits acquises et dont le nombre peut augmenter sans cesse. Il n'en est
pas moins vrai que la philosophie n'est pas seulement une somme de
vrits partielles, qui peuvent se sparer les unes des autres ; elle a
pour objet le tout considr dans son unit, et, d'un mot plus court,
l'absolu, l'tre en tant qu'tre, en un mot l'indivisible. Comment donc
l'unit, l'immuable, l'absolu, seraient-ils soumis la loi du temps ? Ici
ce ne sont plus les diffrentes parties de l'objet qui sont aperues successivement ; ce sont les points de vue. C'est toujours le mme objet,
mais aperu sous des jours diffrents. Par exemple, l'ide de Platon,
l'acte d'Aristote, [249] sont une seule et mme chose, savoir l'tre
absolu, l'tre en tant qu'tre, mais d'une part considr comme principe d'unit dans le multiple, de l'autre comme principe de dtermination et de perfection. L'atome d'picure et la monade de Leibniz reprsentent l'un et l'autre les lments des choses, mais l'un au point de
vue de l'tendue, l'autre au point de vue de la force.
La philosophie, c'est donc l'absolu vu travers les phases du changement. C'est, comme l'a dit Hegel, l'absolu prenant conscience de luimme dans une conscience, et traversant successivement toutes les
phases travers lesquelles il peut se contempler lui-mme. Seulement
Hegel ne veut pas admettre un autre absolu que celui-l, tandis que
nous admettons, quant nous, un absolu transcendant qui, en lui-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
232
mme immobile et indivisible, se manifeste dans la raison humaine
par un absolu mobile et changeant. L'un est in fieri ; l'autre est in
esse ; l'un est dans le devenir : c'est l'absolu humain ; l'autre est dans
l'tre : c'est l'absolu divin.
2 Une seconde diffrence, c'est que la science gomtrique ou
physique ne s'applique qu' la nature extrieure et objective et ne dpend que trs peu du milieu humain et historique o elle se dveloppe,
tandis que la philosophie, ayant en grande partie pour objet la connaissance de l'homme, est plus ou moins influence par l'homme luimme, par l'tat de la civilisation, des murs, de l'esprit du sicle, etc.
La philosophie du XVIIIe sicle ne ressemble pas celle du XVIIe ni
celle du XIXe. Il faut reconnatre en outre une influence directe exerce
par les vnements sur les parties de la philosophie qui touchent la
socit, par exemple la morale, le droit naturel, la politique. Ainsi les
murs, les institutions, les caractres des diffrents peuples se font
plus ou moins reconnatre dans leurs systmes de philosophie. Mme
le caractre propre et individuel de chaque philosophe est aussi pour
quelque chose dans la construction des systmes. Montaigne, Pascal,
Descartes, ne peuvent pas avoir le mme systme de philosophie. La
vie de J.-J. Rousseau, son enfance, sa jeunesse [250] vagabonde, ses
humiliations, expliquent sa philosophie pessimiste et misanthropique.
Plus l'histoire de la philosophie se dveloppera, plus on verra qu'elle
est insparable d'une part de l'histoire politique, de l'autre de la biographie.
En un mot, par l'histoire la philosophie d'impersonnelle devient
personnelle, d'absolue devient relative, de divine devient humaine, et
cela d'autant plus que l'on se place davantage au point de vue de l'histoire, au lieu de se placer au point de vue de la philosophie.
II. Considrons maintenant non plus l'histoire dans la philosophie,
mais la philosophie dans l'histoire, autrement dit la philosophie de
l'histoire. C'est l'inverse du spectacle prcdent, et l'on peut dire que la
philosophie de l'histoire est en quelque sorte la rciproque de l'histoire
de la philosophie.
L'histoire, l'inverse de la philosophie et des autres sciences, est
une science du particulier. Elle a pour but et pour matire les noms
propres, les faits et les dates, c'est--dire des temps dtermins, des
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
233
personnes dtermines et des phnomnes ou un ensemble de phnomnes qui composent ce que l'on appelle un vnement, c'est--dire
un grand fait dtermin. La philosophie, en intervenant dans l'histoire,
y introduit le gnral, l'universel, et, dans une certaine mesure, l'absolu. Il y a plusieurs degrs :
1 L'histoire devient plus philosophique lorsque, des noms, des
faits et des dates, elle passe aux vnements plus gnraux et plus intellectuels ; par exemple, l'histoire des institutions, des lettres et des
arts, et enfin l'histoire mme de la philosophie, c'est l'histoire de l'esprit humain dans ses manifestations ; c'est l'extrieur de la psychologie, mais c'est l'intrieur de l'histoire. Ces sortes d'vnements, en effet, ne sont pas visibles, comme un avnement, un couronnement, une
mort, une bataille, un trait de paix. Ils sont quelque chose de plus
abstrait, et l'ide du temps y joue un moindre rle, car des institutions
sont plus stables que la vie d'un homme. Les lettres, les arts et les
sciences sont des produits plus abstraits, plus impersonnels que les
vnements particuliers de la vie extrieure des nations.
[251]
2 L'histoire devient plus philosophique encore lorsque, au del
des vnements historiques connus, elle cherche pntrer jusqu'aux
origines des nations, des races, de l'humanit. D'abord il ne s'agit plus
ici d'vnements prcis, mais d'vnements en gnral ; par exemple,
les migrations des peuples, leur genre de vie, leur degr de civilisation ; en second lieu, la mthode devient plus conjecturale, plus inductive ; elle a plus d'analogie avec la mthode philosophique, qui va du
complexe au simple, de l'apparent au cach, et qui interprte plus ou
moins librement des signes souvent fugitifs et accidentels.
3 Un degr nouveau de philosophie s'introduit encore dans l'histoire lorsque, au lieu d'tudier certains faits particuliers, ou mme certaines conditions, elle cherche embrasser toute une poque pour en
faire ressortir l'esprit gnral (par exemple le sicle de Louis XIV), ou
bien tout un peuple pour faire ressortir les causes de sa grandeur et de
sa dcadence (Montesquieu). Elle devient toute philosophique lorsque, laissant de ct la suite des temps, elle tire des faits des rgles
pour la politique et pour la conduite des princes et des peuples (par
exemple les Discours sur Tite-Live de Machiavel).
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
234
4 Plus philosophique encore lorsqu'elle embrasse la totalit des
temps, et domine par une ide gnrale l'histoire tout entire, comme
dans l'Essai sur les murs ou le Discours sur l'histoire universelle.
5 Enfin elle devient tout fait philosophique et presque mtaphysique lorsque, planant au-dessus de l'histoire proprement dite, elle
cherche dcouvrir non plus la loi du dveloppement d'un peuple et
d'une race, mais la loi du dveloppement du genre humain tout entier.
Bossuet, Herder, Vico, Turgot, Condorcet, Auguste Comte, ont, les
uns aprs les autres, essay de dcouvrir cette loi suprme : c'est le
point o l'histoire confine la mtaphysique et devient elle-mme mtaphysique.
Nous voyons comment il est vrai de dire que la philosophie de
l'histoire est la rciproque de l'histoire de la philosophie. Celle-ci nous
montre comment la philosophie devient [252] histoire, celle-l comment l'histoire devient philosophie. L'une va du gnral au particulier,
l'autre du particulier au gnral. L'une part de l'impersonnel, de l'infini, de l'absolu et devient personnelle, relative, finie ; l'autre, au contraire, part du fini et du relatif et cherche s'lever jusqu' l'absolu et
l'infini. L'une et l'autre nous reprsentent en sens inverse les deux
faces des choses dans le monde de notre exprience. L'une et l'autre
sont l'expression respectivement diffrente de l'absolu, et, suivant
l'expression de Platon, reprise par un pote moderne, l'une et l'autre
sont, un point de vue oppos, l'image mobile de l'immobile ternit.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
235
[253]
Introduction la science philosophique
Leon XVII
LES RAPPORTS DE
LA PHILOSOPHIE ET DE
LA GOGRAPHIE
Retour la table des matires
Messieurs,
Aprs avoir expos les rapports de la philosophie et de l'histoire,
nous voudrions tudier les rapports de la philosophie et de la gographie. Ce sujet peut paratre d'abord assez paradoxal ; nous nous htons
de l'expliquer.
Nous ne voulons pas chercher le rapport possible entre les systmes des philosophes et la configuration gographique d'un pays,
comme si l'on disait que, l'Angleterre tant une le, elle doit avoir un
systme de philosophie troit et circonscrit ; ou encore que la Hollande, tant une plaine, devait engendrer le systme de l'unit de substance, comme on a dit que le dsert est monothiste . Nous laissons
de ct ces rapprochements arbitraires. Ce qu'ils pourraient avoir de
vrai rentrera dans les rapports de la philosophie et de l'histoire. Il peut
tre vrai, en effet, que telle configuration gographique contribue
dterminer le caractre d'un peuple et le caractre de sa philosophie,
comme, par exemple, l'Angleterre tant une le, le peuple anglais a d
tre un peuple commerant, et l'habitude du commerce a dtermin
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
236
l'esprit positif et pratique de ce peuple et par consquent sa philosophie. De mme la situation moyenne de la France, son climat tempr,
a sa part dans le caractre du peuple franais, qui est une moyenne
entre le Nord et le Midi, et par l mme dans le caractre de la philosophie franaise, qui n'est ni absolument transcendante comme en Allemagne, ni exclusivement empirique comme en Angleterre. Mais
tous ces rapports, vrais ou faux, rentrent [254] dans l'histoire de la philosophie et ne seraient pas d'ailleurs assez nombreux pour mriter une
considration part.
Ce que nous entendons par rapport de la gographie et de la philosophie est beaucoup plus simple : c'est le dveloppement gographique de la philosophie.
La philosophie subit les lois de l'espace aussi bien que celles du
temps. Elle est ne quelque part, elle passe de contres en contres,
elle suit certains chemins. tudier ces migrations, dresser cet itinraire
philosophique, c'est ce que j'appellerai l'histoire gographique de la
philosophie. Nous en donnerons aujourd'hui une esquisse rapide.
Il serait intressant de commencer cette histoire par l'Orient ; mais
les documents sont trop rares et trop peu accessibles pour nous aventurer dans cette recherche. C'est encore aujourd'hui un problme de
savoir si l'Orient a agi sur la Grce en philosophie, et un autre problme de savoir si ce qui aurait prcd en Orient ne serait pas une
thologie plutt qu'une philosophie. Nous n'examinerons pas les hypothses des Allemands, par exemple celle de M. d. Rthe, qui fait
venir tous les systmes grecs de l'gypte et de la Perse : de l'gypte
tous les systmes panthistes, et de la Perse les systmes thistes ; ni
l'hypothse de M. Gladisch, qui reconnat cinq sources la philosophie grecque, et rattache l'latisme l'Inde, le pythagorisme la
Chine, le thisme d'Anaxagore la Jude, l'hraclitisme la Perse, et
l'atomisme la Phnicie. Toutes ces hypothses sont arbitraires, et
tout ce que l'on peut dire, c'est que, d'une manire gnrale, la Grce
tient de l'Orient sa langue, sa mythologie, sa civilisation ; mais on ne
voit pas qu'elle lui ait emprunt la philosophie proprement dite.
Nous prendrons donc la philosophie grecque comme elle se prsente nous, c'est--dire sans anctres connus, et nous la considrerons comme autochtone. Nous bornant aux faits historiques apparents
et absolument certains, nous rappellerons que la philosophie est ne
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
237
dans cette pninsule asiatique que l'on appelait l'Asie Mineure, et qui
forme aujourd'hui la [255] plus grande partie de la Turquie d'Asie.
Cette pninsule, qui, dans sa partie occidentale, borde ce que les anciens appelaient la nier ge, et nous Archipel, tait occupe par des
provinces peuples par des colonies grecques, soit que ces colonies
fussent venues de la Grce, soient qu'elles aient t formes par des
migrations semblables celles qui avaient peupl la Grce elle-mme.
Ces colonies, d'abord indpendantes, avaient t conquises par les Lydiens et ensuite par les Perses, et elles venaient de tomber sous la domination de ce dernier empire l'poque mme o commence l'histoire de la philosophie, c'est--dire vers le VIe sicle avant notre re.
C'est l'une de ces provinces, l'Ionie, qui fut le premier thtre des spculations philosophiques, et qui donna son nom la premire cole
grecque. Les philosophes de cette cole appartenaient aux diffrentes
villes situes sur les bords de la Mditerrane. Thals, Anaximandre et
Anaximne, les deux premiers du VIe sicle, le troisime du Ve, taient
tous les trois ns Milet. Le dernier Ionien, Diogne d'Apollonie,
tait, comme son nom l'indique, d'une ville de la Mysie, autre province grecque confinant la Lydie. Une branche de l'cole ionienne,
l'cole d'Hraclite, venait d'phse, ville appartenant galement l'Ionie. Plus tard encore Clazomnes, autre ville d'Ionie, donnait naissance au philosophe Anaxagore.
Si l'on rflchit cette circonstance |que la philosophie est ne en
Asie Mineure et non dans la Grce proprement dite, qu'elle s'est manifeste tout d'abord dans des provinces qui touchaient au grand empire
d'Orient, aux Mdes, aux Perses, et par l mme aux Assyriens et aux
Babyloniens, tandis que, d'un autre ct, par mer et par le commerce,
elles taient en rapports constants avec la Phnicie et l'gypte, on ne
peut contester que si la philosophie, comme telle, est bien une invention grecque, cependant cette invention a d tre prpare par le contact immdiat de la civilisation orientale. Nul doute que la science
n'ait exist en Assyrie et en gypte avant de paratre dans la Grce ;
or, dans ces temps primitifs, la philosophie ne se distingue pas nettement de la science. Elle peut [256] donc tre rattache, comme celleci, une influence orientale. Mais cette influence est vague, obscure,
indtermine, et la philosophie n'en reste pas moins une uvre originale et essentiellement grecque, de mme qu'un fils peut avoir un gnie original, tout en devant la vie son pre.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
238
La philosophie et l'esprit philosophique sortirent bientt du cercle
troit de leur premire origine et se rpandirent dans les les de la mer
ge. C'est de ces les que vont partir les divers rayonnements de la
philosophie, pour se rpandre dans les autres parties de la civilisation
grecque, savoir dans la Sicile et dans la Grande-Grce. C'est en effet
Samos, le de l'Archipel, qu'est n le clbre Pythagore, le fondateur
de ce qu'on appelle l'cole italique, qui fait le pendant de l'cole ionienne et partage avec celle-ci toute la premire priode de la philosophie grecque depuis le VIe jusqu'au Ve sicle. Pythagore, dont la lgende raconte de merveilleux voyages, avait au moins voyag jusqu'en Sicile ; et ce fut dans celle le lointaine, rameau dtach du gnie
grec, qu'il fonda l'cole pythagoricienne. Ce fut galement d'une ville
ionienne, Colophon, situe sur le continent, mais au bord de la mer,
que partit le fondateur de l'cole late. Xnophane de Colophon fut le
fondateur de cette cole. le tait une ville de la Grande-Grce, c'est-dire de la partie mridionale de l'Italie. Ainsi les deux fondateurs de
la philosophie dite italique taient Ioniens.
Aprs Pythagore et Xnophane, le dveloppement des coles continua de se faire dans la Sicile et dans la Grande-Grce. Philolas, le
plus grand des pythagoriciens, est de Tarente, ville italique, ainsi
qu'Archytas, autre pythagoricien clbre. Parmnide et Znon, les
deux hros de l'cole late, sont l'un et l'autre de la ville d'le, galement dans la Grande-Grce. Empdocle, philosophe original et indpendant, se rattachant dans une certaine mesure au pythagorisme,
est d'Agrigente, ville de Sicile.
Ainsi la philosophie grecque est ne et s'est dveloppe sur les
confins de la circonfrence que formait alors la civilisation [257]
grecque : l'Orient, en Asie Mineure, tout prs des grands empires
asiatiques ; en Occident, dans la Sicile et en Italie, aux dernires limites qu'avaient atteintes les migrations hellniques. Ce double fait
semble indiquer que la civilisation grecque s'est dveloppe de la circonfrence au centre ; au moins ce fut le cas pour la philosophie.
Disons encore qu'une autre grande cole grecque tait ne sur un
autre point de cette circonfrence, savoir l'cole atomistique fonde
par Leucippe et Dmocrite, l'un et l'autre de la ville d'Abdre, ville qui
faisait partie de la Grce du Nord, dans la Thrace, mais encore sur les
bords de la mer ge. Ainsi, sur trois points diffrents : l'Ionie, la
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
239
Grande-Grce et la Thrace, la philosophie s'tait fonde et dveloppe
au VIe et au Ve sicle avant notre re.
Mais, pendant ces deux sicles, la civilisation, l'art, les grandes institutions politiques et sociales, avaient pris un essor remarquable dans
la Grce proprement dite, et surtout dans cette partie de la Grce que
l'on appelle l'Attique, dont la capitale tait Athnes. Athnes, ville de
commerce, situe sur les bords de la mer ge, s'tait peu peu enrichie et allait bientt conqurir l'empire de la mer. C'est l qu'allaient
aussi converger et prendre racine tous les rameaux de la philosophie
grecque : on peut dire mme qu' partir de cette poque, vers le milieu
du Ve sicle, Athnes et la philosophie sont deux noms insparables.
L'closion de la philosophie Athnes fut dtermine par l'arrive
dans cette ville et la rencontre, diverses reprises, d'un certain nombre
de personnages, habiles parleurs, habiles raisonneurs, qui ont fond la
rhtorique et introduit par la critique la connaissance des ides philosophiques. Il n'est pas invraisemblable non plus que plusieurs philosophes clbres, Parmnide, Hraclite, Znon d'le, soient venus
Athnes et y aient caus et discut sur la philosophie. Mais le fait est
certain surtout pour les sophistes. Aucun sophiste n'est d'Athnes
mme, mais tous y sont venus. Gorgias est de Lontium, ville de Sicile, et avait reu l'influence de l'cole d'le ; Protagoras [258] tait
d'Abdre, c'est--dire de Thrace, et parat avoir reu l'influence d'Hraclite, et peut-tre aussi de Dmocrite, et en gnral relve des coles
ioniennes. L'un et l'autre vinrent Athnes non pour discuter sur des
choses spculatives, mais pour traiter les affaires de leurs pays respectifs. En mme temps ils apprirent aux Athniens l'art de parler, de
converser, et les initirent au got des ides philosophiques.
Ainsi, du Nord et de l'Occident la philosophie spculative et la philosophie empirique, conduites l'une et l'autre jusqu'au scepticisme,
vinrent converger et se rencontrer au centre de l'empire grec, dans la
capitale de la civilisation grecque. Les autres sophistes, entre autres
Prodicus de Cos et Hippias d'le, l'un de la mer ge, l'autre de la
Grce du Nord, vinrent galement Athnes, soit pour des affaires
publiques, soit pour des colloques philosophiques, et contriburent par
l faire d'Athnes le centre de l'activit philosophique.
Athnes, jusque-l, n'avait rien produit en philosophie, et elle
commenait seulement recevoir quelques germes venus d'ailleurs ;
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
240
mais elle inaugura bientt son apparition sur la scne philosophique
par un coup d'clat, dont l'action a rejailli sur l'histoire de l'humanit
tout entire. Ce qui fixa surtout la scne de la philosophie Athnes,
ce fut l'apparition d'un homme de gnie, d'une originalit sans gale,
qui ne fut pas seulement un grand philosophe, mais un grand homme,
et qui, dans l'histoire des hommes, peut tre compar aux grands fondateurs de religion : nous voulons parler de Socrate. Ce qui dtermina
Socrate philosopher, ce fut prcisment la prsence des sophistes
Athnes. En les combattant il cra la philosophie morale, et en mme
temps la critique philosophique. Il fit descendre, dit-on, la philosophie
du ciel sur la terre, c'est--dire qu'il carta les recherches physiques et
cosmogoniques pour se livrer la psychologie et la morale ; mais,
en mme temps, il fit une rvolution dans l'art de raisonner par son
inimitable maeutique, le plus merveilleux instrument pour la libert
de l'esprit.
Aussi, partir du sicle de Pricls, dont Socrate tait contemporain, [259] la pense philosophique se concentra Athnes. Ses principaux disciples, Xnophon, Platon, Antisthne, sont Athniens. S'il
se produit encore quelques mouvements philosophiques sur la circonfrence hellnique : Cyrne, sur les ctes de l'Afrique ; Mgare,
dans la Grce du Nord, ce n'est plus qu'un rayonnement de la philosophie attique. Aristippe, le chef de l'cole cyrnaque ; Euclide, celui de
l'cole de Mgare, sont l'un et l'autre disciples de Socrate. Ils sont venus Athnes pour l'couter : preuve que sa rputation s'tendait au
loin, et que l'on savait dj o il fallait aller pour apprendre la philosophie.
Aprs Socrate, la philosophie se fixe Athnes pour plusieurs
sicles. Platon, le premier, y fonda un enseignement rgulier, une
cole proprement dite, l'Acadmie. Cette cole, avec diverses vicissitudes de doctrine, dura jusqu'au Ier sicle avant notre re. L'ancienne
Acadmie d'abord, avec Speusippe et Xnocrate, la nouvelle Acadmie ensuite, avec Arcsilas et Carnade, continurent l'uvre de Platon l o il l'avait fonde. C'est encore Athnes que se fonde une
seconde grande cole philosophique, ct de l'Acadmie, celle du
Lyce. Aristote, le fondateur de cette seconde cole, n'est pas
d'Athnes ; il est de la Grce du Nord, de Stagyre, ville de Thrace. Il
passa plusieurs annes la cour de Philippe, roi de Macdoine ; mais
il avait appris la philosophie Athnes l'cole de Platon ; il fonda sa
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
241
propre cole ct de celle de Platon, et cette cole dura aprs lui
comme celle de l'Acadmie. Thophraste la continua ; et il y avait encore Athnes une cole pripatticienne l'poque de Cicron,
puisque son fils tait venu Athnes suivre les leons du pripatticien Cralype.
Ce n'est pas seulement l'cole de Platon ou l'cole d'Aristote qui se
sont fixes Athnes aprs Socrate ; ce sont encore l'cole picurienne et l'cole stocienne. picure tait d'Athnes comme Platon ; il
y passa toute sa vie, qui fut longue et qui s'tend du IVe au IIIe sicle.
Le fondateur de l'cole rivale, de l'cole stocienne, Znon, n'tait pas
d'Athnes ; il tait n [260] Citium, dans l'le de Chypre ; mais, attir
Athnes par des affaires de commerce, il fut entran vers la philosophie en frquentant les derniers reprsentants de l'cole cynique,
cole secondaire issue galement de Socrate, comme toutes les autres
que nous venons de nommer, et qui avait t fonde par Antisthne et
Diogne. Crantor, le dernier philosophe de celle cole, fut le matre de
Znon, et nous marque le passage du cynisme au stocisme.
Les deux autres grands stociens, Clanthe, n en Asie Mineure ;
Chrysippe, n en Cilicie, galement en Asie Mineure, vinrent l'un et
l'autre sjourner Athnes ; le premier, de 300 220 ; le second, de
280 208. L'un et l'autre prirent la succession de Znon et dfendirent
ses doctrines contre les acadmiciens et les picuriens.
Ainsi, jusqu'au IIe sicle avant l're chrtienne, tout le travail philosophique fut concentr Athnes. Mais bientt ce mouvement allait
se disperser et se gnraliser ; sans compltement abandonner
Athnes, qui resta un centre d'tudes trs recherch, la philosophie
rayonna en sens divers, pour aller bientt se fixer dans un autre centre.
Deux vnements historiques importants ont amen celle rvolution : d'une part les conqutes d'Alexandre, de l'autre la conqute romaine. Par le premier, la Grce ne fut plus seulement en Grce, mais
en Orient ; parle second, elle entra en communication avec Rome.
Considrons d'abord le rayonnement des diverses coles grecques
dj signales. Dans le Ier sicle avant l're chrtienne, nous voyons la
philosophie stocienne et acadmique se rpandre hors de la Grce
continentale et retourner dans les les de la mer ge. Rhodes principalement de vint le sige d'une cole clbre. Pantius, le matre de
Cicron, tait de Rhodes ; Posidonius, l'un des derniers stociens, avait
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
242
fond Rhodes une cole o il avait eu pour auditeurs Pompe et Cicron. Antiochus eut aussi dans la mme le une cole mi-stocienne,
mi-acadmique. Rhodes peut donc tre considre comme le lieu de
passage qui a conduit la philosophie d'Athnes Rome.
[261]
L'vnement le plus intressant de cette poque pour l'histoire gnrale de l'esprit humain, ce fut l'arrive de la philosophie Rome,
devenue alors la capitale du monde, mais qui en philosophie ne fut
que la vassale de la Grce. Ce n'en est pas moins un fait trs important
que la traduction de la philosophie du grec en latin. Beaucoup
d'uvres ou de doctrines philosophiques qui avaient t perdues nous
ont t conserves par les crits de Cicron qui sont ou des traductions
ou des commentaires de la philosophie grecque, et, en outre, ce n'a pas
t un petit avantage pour la philosophie picurienne d'avoir trouv
pour traducteur un grand pote et d'avoir associ ses doctrines au gnie potique de Lucrce.
Cependant, quelque importante qu'ait t pour la conservation de la
philosophie grecque l'intervention de Rome, ce n'est encore qu'un dplacement, ce n'est pas une cration.
L'autre vnement dont nous avons parl, savoir la conqute de
l'Orient par Alexandre, fut d'un bien autre intrt pour l'avenir de la
philosophie, car il eut pour consquence la cration d'un centre nouveau de pense et d'une laboration nouvelle pour la philosophie
grecque, rajeunie et fconde par l'infusion de l'esprit oriental. Jusqu'
quel point l'Orient avait-il pntr dans la philosophie primitive de la
Grce ? Nous avons dit qu'on ne peut le dterminer avec prcision.
Mais, ici, nous saisissons cette influence d'une manire directe et historique, ou pour mieux dire gographique.
Ce centre nouveau de la civilisation et de la philosophie a t la
ville d'Alexandrie, fonde par Alexandre l'entre du Delta et des
bouches du Nil, et qui est devenue l'entrept du commerce (comme
aujourd'hui encore) entre l'Asie et l'Europe, mais qui de plus, cette
poque, fut le foyer de la science et de la culture intellectuelle en
mme temps que de l'esprit religieux.
On peut signalera Alexandrie, dans les deux premiers sicles de
l're chrtienne, trois ou quatre grandes coles philosophiques et reli-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
243
gieuses : 1 l'cole juive d'Alexandrie, fonde par Aristobule et constitue surtout par Philon le Juif, [262] contemporain de Jsus et le plus
grand philosophe de celle priode : il runit en lui Mose et Platon. On
disait de lui : Moses platonisans ou Plato judaisans ; les deux doctrines taient d'ailleurs interprtes par l'esprit oriental, c'est--dire par
l'esprit panthistique, qui n'appartient en propre ni la Grce ni la
Jude ; 2 ct de l'cole juive il faut compter, Alexandrie encore,
l'cole gnostique, plus thologique que philosophique, manant d'un
christianisme plus ou moins altr par les doctrines de la Perse et de
l'gypte ; le gnosticisme, originaire de la Syrie, fut reprsent en
gypte par Basilide et Valentin dans le Ier et le IIe sicle de l're chrtienne ; ces doctrines tranges, malgr leur forme thologique, n'en
ont pas moins eu une trs profonde influence sur toutes les doctrines
mystiques htrodoxes du moyen ge ; 3 la troisime cole est l'cole
chrtienne d'Alexandrie, savoir l'cole de Clment d'Alexandrie et
d'Origne ; c'est encore une cole plus religieuse que philosophique,
inspire de l'esprit chrtien, mais mle de l'esprit platonicien, et qui a
laiss galement de grandes traces dans l'avenir ; 4 enfin, l'cole
paenne d'Alexandrie, ou no-platonicienne, fonde par le portefaix
Ammonius Saccas, contemporain d'Origne, et constitue surtout, organise et dveloppe par Plotin, le plus grand philosophe grec depuis
Aristote et Platon.
Ici, cependant, il ne faut pas s'exagrer le sens de cette expression :
cole d'Alexandrie. Plotin, la vrit, est n Alexandrie et y a reu
les leons d'Ammonius Saccas ; mais il a pass une grande partie de
sa vie Rome, y a enseign pendant douze ans et y est mort. Porphyre, son disciple, est n galement Alexandrie et vint galement
Rome. Rome a donc t pour sa part dans la formation et la propagation du no-platonisme. Ce fut cependant Alexandrie que Porphyre,
aprs la mort de Plotin, transporta son cole, et ce fut l que Jamblique lui succda.
Alexandrie continua tre un centre d'tudes et de spculations
philosophiques jusqu'au IVe sicle. cette poque, l'intolrance chrtienne, devenue de plus en plus menaante, [263] commena en
rendre le sjour dangereux. On sait que la clbre Hypatie fut massacre dans une meute de chrtiens fanatiques. Ds lors la philosophie
abandonna ce sjour inhospitalier, et elle vint redemander un renouvellement d'clat et un reste de scurit la vieille et illustre capitale
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
244
des tudes antiques et des croyances paennes, la ville de Socrate,
Athnes. La rforme de Julien avait arrt un instant le cours triomphant du christianisme, et donn un nouveau stimulant l'hellnisme.
Athnes tait reste intacte au milieu du renouvellement universel. Ce
fut vers ce temps que Plutarque le Vieux (qu'il ne faut pas confondre
avec le clbre biographe) introduisit Athnes les ides alexandrines. Il eut pour successeur Syrianus, qui lui-mme eut pour successeur le clbre Proclus, rnovateur et second fondateur de la philosophie alexandrine, le reprsentant le plus illustre de ce qu'on appela
l'cole d'Athnes, la dernire grande cole grecque. Cette cole dura
jusqu'au commencement du VIIe sicle. La chaire tait alors occupe
par Damascius, qui, indpendamment de son mrite personnel, a cette
gloire dans l'histoire d'avoir t le dernier philosophe classique de la
Grce, comme Thals en a t le premier. En 629, l'empereur Justinien, domin par ses prjugs dvots et superstitieux, se pronona
contre la philosophie. Il ferma l'cole d'Athnes, et les matres de cette
cole, Simplicius et Damascius, en mme temps que le dernier
alexandrin Olympiodore, furent obligs de quitter la Grce et se rfugirent en Asie, la cour du roi Chosros, connu par son got pour les
tudes philosophiques et les tudes grecques. Ce got nous est attest
par un crit de Priscien intitul : Solutiones rerum de quibus dubitavit
Chosroes, Persarum rex. Il parat que deux ou trois ans aprs cette
hgyre, Chosros, ayant fait la paix avec Juslinien, stipula dans son
trait avec cet empereur que les philosophes exils pourraient rentrer
dans leur patrie. Il est donc probable que les trois rfugis revinrent en
Grce et purent encore y publier quelques-uns de leurs ouvrages, mais
sans y enseigner. Les grandes coles grecques taient finies.
[264]
Ainsi, la philosophie grecque, partie de l'Asie Mineure, rpandue
travers la mer ge, passant de Samos ou de Colophon en Sicile et
dans la Grande-Grce, concentre Athnes pendant quatre sicles,
ayant rayonn ensuite Alexandrie et Rome, revenue Athnes
pendant un sicle ou deux, puis ayant jet quelques rameaux dans
l'Asie Mineure, d'o elle tait partie et o se conservrent quelquesuns de ses vestiges, finit, aprs une priode de douze cents ans, sa brillante histoire.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
245
[265]
Introduction la science philosophique
Leon XVIII
SUITE DES RAPPORTS
DE LA PHILOSOPHIE
ET DE LA GOGRAPHIE
Retour la table des matires
Messieurs,
Comment, aprs cette ruine et cet vanouissement, la philosophie
a-t-elle repris son cours ? Quelles nouvelles tapes a-t-elle parcourues,
quelles nouvelles contres a-t-elle traverses, c'est ce qu'il nous reste
maintenant tudier.
Nous venons de voir finir la philosophie grecque en mme temps
que l'hellnisme paen, vers le VIIe sicle de notre re. Nous avons
nous demander maintenant comment elle a refleuri, et par quels chemins elle a pass dans l'Europe occidentale, pour donner naissance
ce qu'on appelle la philosophie du moyen ge et la philosophie moderne.
Le fait principal qui a servi conserver la tradition de la philosophie, et ramener l'lude des grands philosophes grecs, fut (le croirait-on ?) l'apparition de Mahomet et l'entre du peuple arabe sur la
scne de la civilisation. On sait que Mahomet, en mme temps qu'il a
t un fondateur de religion, a t en outre un fondateur d'empire :
Le temps de l'Arabie est la fin venu, dit-il dans Voltaire. La race
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
246
arabe se rvla tout de suite comme race conqurante, unissant le fanatisme du proslytisme l'ambition de la conqute. Rassembls en
peuple par Mahomet, les Arabes s'lancrent aprs lui en dehors des
contres de l'Arabie. Les successeurs immdiats du Prophte conquirent successivement la Syrie sur les empereurs d'Orient, la Perse, o
ils renversrent le trne des Sassanides, puis l'gypte encore sur les
Grecs, puis toutes les ctes de l'Afrique jusqu'au Maroc ; et enfin, traversant la Mditerrane et pntrant jusqu'en Espagne, ils occuprent
[266] ce pays sur les Visigoths et s'y tablirent pour plusieurs sicles.
Ce flot envahisseur pntra mme jusqu'en France et vint se briser
contre les armes de Charles Martel la bataille de Poitiers. Ainsi, en
un sicle, la conqute arabe tait passe des confins de la Chine jusqu'aux bords de l'Atlantique. En mme temps ce peuple qui au temps
de Mahomet, tait encore un peuple de pasteurs, un peuple nomade,
commena rapidement se civiliser, se faire aux murs, au luxe,
aux sciences et aux arts de la Grce. Il se cra un mouvement que l'on
a appel la civilisation arabe, dont les centres ont t Damas en Syrie,
Bagdad surtout, l'uvre des califes, et enfin Samarcande, dans le pays
des Turcomans. Tels furent en Orient les siges principaux de la civilisation arabe. En Occident et en Espagne, ce furent surtout Grenade
et Cordoue. Cette civilisation brillante, mais un peu superficielle, a
servi de transition entre la civilisation grco-romaine et la civilisation
moderne. Les Arabes ont t les intermdiaires entre les coles
grecques et les coles du moyen ge. tudions d'un peu plus prs, en
ce qui concerne la philosophie, ce singulier phnomne.
Lorsque les Arabes conquirent la Syrie et la Perse, ils durent rencontrer dans ces deux pays des traditions grecques, des coles
grecques, des ouvrage de littrature, de science et de philosophie
grecques. Les choses ont beau finir, elles ne finissent jamais compltement. Il reste des germes qui refleurissent. Nous avons vu que le roi
perse Chosros s'occupait de philosophie. Nous savons qu'il s'tait fait
nombre de traductions des philosophes grecs en syriaque. On signale
la Bibliothque nationale l'existence d'un manuscrit syriaque de Paul
le Perse, qui contient l'abrg de la Logique d'Aristote. Il existe encore
un certain nombre de manuscrits de ce genre : par exemple, l'Isagoge
de Porphyre. Il y eut donc une continuation d'tudes philosophiques,
trs abaisses sans doute, mais non compltement abandonnes, dans
l'Asie grecque, et mme dans les tats voisins. Lorsque les Arabes se
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
247
furent tablis en Syrie et commencrent s'occuper des sciences,
[267] ils durent s'instruire auprs des matres grecs, car ils n'eurent
jamais par eux-mmes aucune originalit. Leur esprit subtil, logique et
terre terre se trouve plus son aise dans les crits d'Aristote que
dans ceux de Platon. Ce furent surtout les crits logiques d'Aristote
qu'ils se mirent d'abord tudier. Ds le Xe sicle, on trouve des traductions arabes de la Logique d'Aristote. Les principaux traducteurs
arabes furent Assan ben Ishak, mdecin nestorien de Bagdad, vers le
milieu du IXe sicle, et son fils Hischak au Xe sicle, Yahya ben Adi et
Isa bon Zaara. On traduisit aussi les commentateurs d'Aristote. Platon
au contraire fut peu cultiv et peu traduit. On signale cependant un
auteur du XIIIe sicle, Djemal-Eddin, comme ayant traduit la Rpublique, les Lois et le Time.
Les Abbassides en Orient, les Ommiades en Espagne, essayrent
de crer un mouvement intellectuel et scientifique. Le plus grand nom
de l'Arabie asiatique fut Avicenne, sujet persan, n Bouckara dans
ce qu'on appelle aujourd'hui le Turkestan. Il se fit une rputation immense dans tout l'Orient, surtout comme mdecin ; mais il s'est aussi
beaucoup occup de philosophie, et on a de lui des commentaires
tendus sur la Mtaphysique et la Logique d'Aristote. Il est aussi
l'auteur d'ouvrages originaux, l'un intitul la Gurison, l'autre la Dlivrance.
Mais c'est surtout en Espagne que l'influence arabe nous intresse,
car elle a t le principal instrument de la renaissance de la philosophie en Occident. On cite, comme ayant particulirement encourag
les lettres et les arts, le calife Hakem. Sous lui, l'Andalousie s'leva
la plus haute culture. Les livres composs en Perse et en Syrie taient
lus en Espagne en mme temps qu'en Orient. Hakem, dit-on, envoya
mille divars d'or pur Abul-Farady pour avoir le premier exemplaire
de son Anthologie. Il avait de nombreux agents chargs de lui procurer
les livres de l'Orient, au Caire, Bagdad, Damas, Alexandrie. On
dit que le catalogue de sa bibliothque comprenait 44,000 volumes.
C'est [268] au Xe sicle, poque de la plus profonde barbarie en Occident, qu'est prcisment le point culminant de la civilisation arabe.
Mais bientt une raction se manifesta. Almanzor fait brler tous les
livres de philosophie et de sciences, et ne conserve que les livres de
thologie et de mdecine. Le XIe sicle est, pour l'Espagne arabe, un
sicle de barbarie et de guerres civiles. Mais au XIIe sicle le mouve-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
248
ment recommence. Averros, le plus grand nom de la philosophie
arabe en Espagne, comme Avicenne en Orient, naquit Cordoue au
commencement du XIIe sicle ; il mourut en 1198. Il remplit donc le
sicle tout entier. Ses uvres sont immenses. Il commenta presque
tous les ouvrages d'Aristote. Ses uvres personnelles sont : Destruction de la Destruction, rfutation du philosophe Algazali ; Destruction
des philosophes, trait de l'union de l'intellect avec l'homme.
En rsum, la philosophie grecque, presque entirement rduite
la philosophie d'Aristote, avait pass de Syrie, de Perse et d'gypte en
Espagne, d'o elle allait bientt sortir pour se rencontrer avec le mouvement philosophique occidental, en raison de la proximit de la
France et de l'Espagne.
Nous avons donc maintenant nous demander o en tait arrive
la philosophie de l'Occident la fin du XIIe sicle, lorsqu'elle se rencontra avec la civilisation arabe.
Nous avons vu prir en 529, Athnes, la dernire cole philosophique de la Grce. Mais il n'est pas probable que toute culture philosophique ait disparu. Les livres subsistaient, et, si petit que ft le
nombre des lecteurs, il dut y en avoir cependant. Seulement il n'y eut
plus de grandes coles. On cite un commentateur de l'empire grec du
e
e
X au XI sicle, la fois politique et philosophe, le clbre Psellos :
mais c'est le seul nom connu. Rien ou presque rien ne vint de Constantinople en Occident, du moins avant les croisades.
Dans l'empire d'Occident, en Italie et en Gaule, bientt appele
France, la culture grecque fut presque abandonne ; [269] ce qui reste
en philosophie, ce sont des ouvrages latins, Lucrce, Cicron et les
Pres, surtout saint Augustin, la principale source du platonisme en
Occident. Quelques grands noms surnagent, entre autres celui de
Boce et de Cassiodore, ministres l'un et l'autre du roi Thodoric ; le
premier, dont les travaux sur Aristote et sur l'Isagoge de Porphyre sont
la base de toute la philosophie du moyen ge. Boce et Thodoric, en
tant que celui-ci encouragea l'tude des lettres, voil le seul chanon
que nous trouvions entre l'antiquit et le moyen ge.
On sait combien il a fallu de temps pour que les tudes recommenassent en France. Grgoire de Tours disait : V diebus nostris, quia
periit studium litterarum a nobis. Les tudes recommencent sous
Charlemagne par la fondation de l'cole du palais, et par les soins
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
249
d'Alcuin. La mme cole se continua sous les auspices du successeur
de Charlemagne, Charles le Chauve, la cour duquel vivait l'cossais
Scot rigne, vritable prodige pour son temps. Vers cette poque,
l'Irlande et l'Angleterre (Alcuin tait d'York) entrent pour leur part
dans la renaissance classique, mais envoient leurs enfants au centre de
l'empire franc, Aix-la-Chapelle, o rsidait Charlemagne et o il
avait fond son cole. Ainsi peu peu l'Occident barbare s'veillait
la vie de l'esprit ; commenant par la grammaire, comme les enfants, il
allait bientt s'lever la logique et de l la mtaphysique et toutes
les parties de la philosophie. C'est seulement la fin du XIe sicle que
recommence vritablement la philosophie. Voyons ce qu'on possdait
cette poque : nous l'avons dit dj, rien ou presque rien des crits
grecs. La langue grecque tait en partie ignore. Scot rigne savait le
grec : mais c'tait une rare exception. Lui-mme ne parat avoir connu
de Platon que le Time. Il connaissait aussi Denys l'Aropagite. On
cite encore, au XIIe sicle, un commentaire du Time par Guillaume de
Conches ; mais en gnral trs peu de chose sur Platon, si ce n'est par
l'intermdiaire de saint Augustin. Qu'avait-on d'Aristote ? Rien que
les ouvrages [270] de logique, et encore traduits et abrgs par Boce.
C'est avec ces maigres documents et avec l'Isagoge de Porphyre que
s'tablit la premire grande discussion philosophique du moyen ge.
O a lieu cette discussion ?
C'est Paris, l'ombre de Notre-Dame, que Guillaume de Champagne pose la thse de la ralit des universaux. Le moine de Compigne Roscelin lui oppose la thorie nominaliste, et Abailard, le
grand professeur, qui rassemblait sur la montagne Sainte-Genevive
des milliers d'tudiants, essaya de concilier les deux doctrines dans la
thorie conceptualiste.
Quelque bizarres que soient alors les formes de la pense, quelque
subtils que soient les raisonnements, quelque obscur que soit le langage, on ne peut nier que ce ne soit la philosophie qui recommence
cette poque dans cette mmorable controverse. Ainsi, depuis Athnes
o elle avait paru mourir en apparence, la philosophie avait dormi et
sourdement germ pour renatre six sicles aprs Paris, qui, pendant
tout le moyen ge, reprit le sceptre qu'Athnes avait eu dans l'antiquit.
Cependant, le fait capital signaler, c'est qu'avant la fin du XIIe
sicle l'Occident ne possdait gure qu'Aristote, et d'Aristote que les
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
250
ouvrages logiques. Les recherches devaient donc surtout porter sur les
difficults logiques. Sans doute il tait rest quelques vestiges de mtaphysique grecque par saint Augustin et par les ouvrages du faux Denys l'Aropagite ; on avait des commentaires du Time et les commentaires de Macrobe. Mais tout cela tait rare, dispers. On tait encore
trop faible pour philosopher autrement que sur un texte donn. Sauf
quelques hommes de gnie, Scot rigne et saint Anselme, on dut se
mettre l'cole et commencer par le plus facile, la grammaire et la
logique.
On peut considrer l'introduction des uvres d'Aristote sur la philosophie naturelle, la mtaphysique et la physique, comme un fait dcisif dans le dveloppement de la philosophie du moyen ge. Or cette
introduction fut le fait des Arabes.
[271]
Nous voyons en effet, vers le milieu du XIIe sicle, une grande entreprise de traductions faites sur les traductions arabes, par les soins de
Raymond, archevque de Tolde. Ces traductions se firent surtout par
l'intermdiaire des juifs. De nombreux traducteurs chrtiens furent
aussi employs. Le principal est Michel Scot, qui est surtout cit
comme ayant introduit les ouvrages d'Aristote l'aide de ses traductions. Voici le texte de Roger Bacon : Tempore Michaelis Scot, qui
annis 1230 transactis apparuit, deferens librorum Aristolelis parles
aliquas de naturalibus et mathematicis cum expositoribus sapientibus,
magnificata est Aristotelis philosophia apud Latinos.
Non seulement on avait traduit les uvres d'Aristote, mais encore
des uvres juives et arabes, les crits d'Avicenne, d'Al-Faradi, la
Source de vie de Ibn-Gebirol (Avicembron), le de Causis, ouvrages
d'origine alexandrine, etc.
L'introduction de ces documents nouveaux (pripatticiens, alexandrins, juifs et arabes) parat avoir jet quelque trouble et quelque hsitation dans les tudes philosophiques ; on y rattacha les thories aventureuses et panthistiques qui commencrent paratre vers cette
poque : l'cole de Chartres (Thierry de Chartres et Gilbert de La Pore), Amaury de Bne et David de Dinant. On signale mme celle
poque quelques traces d'picurisme. Le concile de Paris en 1210
condamna ces doctrines : quelques hrtiques mme furent brls. Le
mme concile interdit la lecture des livres de philosophie naturelle, et
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
251
mme condamna certains ouvrages crits en franais. C'tait la condamnation expresse des Ausculationes physic d'Aristote, qui venaient de s'introduire dans les coles. Le concile de 1215 portait expressment cette prescription : Non legantur libri Aristotelis de Metaphysice et de naturali philosophia. Ainsi, en 1215, Aristote est proscrit ; et cependant vingt ans plus tard on voit Albert le Grand et saint
Thomas d'Aquin commenter la Physique et la Mtaphysique, aussi
bien que les autres ouvrages d'Aristote, et celui-ci devient bientt le
matre suprme et incontest de la scolastique. [272] Comment s'expliquer ce paradoxe historique ? Voici cette explication, qui a t dcouverte par M. Haurau. En 1231, le pape Grgoire IX renouvelait
l'interdiction du concile de 1215 ; mais, en mme temps, dix jours
aprs, il nommait une commission pour examiner et expurger les deux
ouvrages incrimins. Il est probable que, grce cette expurgation, les
ouvrages susdits rentrrent peu peu dans les coles, que bientt
mme il ne fut plus question d'expurgation. Enfin l'autorit d'Aristote
revint si bien en faveur qu'en 1266 une dcision de prlats portait
qu'on ne serait pas reu aux examens de la licence si l'on n'avait pas lu
ces deux ouvrages.
partir de ce moment, les tudes philosophiques des coles portent sur la philosophie tout entire, et non plus seulement sur la logique. C'est ce fait capital qui doit tre rapport l'influence arabe.
Ainsi Aristote, conserv par parties dans les vieilles contres de l'Occident romain, tait revenu tout entier de l'Orient et de la Syrie par
l'Afrique et l'Espagne dans la France, dsormais l'hritire de l'ancienne Grce.
Le fait essentiel signaler, au point de vue gographique, c'est qu'
partir de cette poque le centre des tudes philosophiques est Paris.
Sans doute, les plus grands gnies de ce temps ne sont pas Franais.
Ils viennent soit de l'Allemagne, soit de l'Italie, soit de l'Angleterre ;
mais tous viennent pour s'instruire et pour enseigner Paris.
Voici, par exemple, les principaux personnages du moyen ge,
dont les noms se rattachent l'histoire de l'universit de Paris.
Alexandre de Hales, n en Angleterre, fit ses tudes Paris et y sjourna jusqu'en 1258. Il appartenait l'ordre des franciscains. Robert
de Lincoln (ou Robert Grosse-Tte), n dans le comt de Suffolk, fit
ses tudes Oxford, mais il vint Paris se perfectionner auprs des
matres en philosophie. Guillaume d'Auvergne, Vincent de Beauvais,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
252
enseignrent Paris. Jean de la Rochelle, franciscain comme
Alexandre de Hales, lui succda dans sa chaire en 1238. Albert le
Grand, dominicain, ayant fait ses tudes Padoue, fut envoy Paris
en 1245, et il y enseigna trois ans, jusqu'en 1248, d'aprs [273] l'ordre
de ses suprieurs, retourna Cologne, alla Rome pour y plaider la
cause des moines contre l'universit de Paris. Saint Thomas d'Aquin,
n en Sicile, prs d'Aquino, eut pour matre a Cologne Albert le Grand
et le suivit Paris, o il reut le doctorat, et enseigna lui-mme
comme son matre Albert le Grand. Il plaida Rome la cause des
ordres mendiants contre le reprsentant de l'universit de Paris, Guillaume de Saint-Amour. Jean Fedenza de Bonaventure, n Orvieto
(1221), tudia Paris sous Alexandre de Hales et Jean de la Rochelle ; il enseigna galement en mme temps que saint Thomas
d'Aquin, et avec celui-ci dfendit la cause des ordres religieux contre
l'universit de Paris. Celle lutte des moines et de l'universit nous
prouve combien on considrait comme important de s'assurer la possession de la ville de Paris pour y exercer l'influence thologique et
philosophique. Ces trois noms (Albert le Grand, saint Thomas, saint
Bonaventure) appartiennent l'ordre des dominicains ; Roger Bacon
et Duns Scots ont l'un et l'autre franciscains. Le premier, n en 1214
en Angleterre, dans le comt de Somerset, vint faire ses tudes en
France dans l'universit de Paris : on dit mme qu'il y enseigna. Duns
Scot, n galement dans la Grande-Bretagne, enseigna d'abord Oxford, puis Paris, o il reut le grade de docteur. Le mme fait se continua au XIVe sicle : Raymond Lulle, n Palma, dans l'le de Majorque, aprs beaucoup d'aventures, vint comme les autres Paris, o
il enseigna le Grand Art. Guillaume d'Ockam, n dans la province de
Surrey, vint galement Paris, o il suivit les leons de Duns Scot ;
on ne nous dit pas s'il y enseigna.
Ainsi le fait gnral qui ressort de tous ces exemples, c'est que si
Paris n'a produit rellement aucun des grands hommes qui ont illustr
la philosophie du moyen ge ; si, d'un autre ct, il y eut diverses
coles importantes en Europe ( Oxford, Cologne, Rome), Paris
fut cependant considr comme le lieu de concentration, o l'on venait
de toutes parts. Nul ne se croyait un matre vritable s'il n'avait tudi, reu ses [274] grades ou mme enseign Paris. La diversit
d'origine est elle-mme une preuve de ce fait : car comment se seraiton rencontr de tant de cts divers, s'il n'y avait eu une tradition, une
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
253
opinion qui faisait de Paris la tte du mouvement philosophique ?
C'est l le trait caractristique de la philosophie au moyen ge.
Comment est ne maintenant et par quels chemins a pass la philosophie moderne ? C'est le dernier point examiner pour achever cette
tude.
Si l'on met part le mouvement mystique allemand qui se dveloppa sur les bords du Rhin au XIVe sicle et dont les principaux reprsentants sont Tauler, Suzo, Ruysbroeck, et surtout matre Eckart,
mouvement qui plus tard, par Nicolas de Kss (XVe sicle) et Jacob
Boehme (XVIe), se transmit la philosophie allemande moderne, mais
qui resta en dehors de l'volution gnrale de la philosophie europenne ; si, dis-je, on excepte ce mouvement, on peut dire que la philosophie de la Renaissance eut pour centre l'Italie, comme celle du
moyen ge avait eu la France.
L'vnement capital et dcisif, ce fut la rapparition des manuscrits
grecs en Occident. Sans doute, il faut accorder que la rupture de l'Occident avec l'Orient grec n'avait pas t absolue, que les croisades
n'avaient pas t sans quelque influence, qu'il y avait eu quelque infiltration de la science grecque. Au XIVe sicle dj, Ptrarque savait le
grec et avait en sa possession des manuscrits grecs. Mais deux vnements importants prcipitrent le mouvement de la restauration
grecque en Occident. Ce fut d'abord le concile de Florence qui avait
eu pour but la runion des deux glises, l'glise romaine et l'glise
grecque ; et en second lieu la conqute de Constantinople par les
Turcs, qui chassa en Europe un grand nombre de savants. Mais le
premier vnement est de beaucoup le plus important au point de vue
philosophique.
Le concile de Florence, en effet, en 1440, a t le point de dpart
de la restauration du platonisme dans les coles d'Occident. Parmi les
reprsentants de l'glise grecque ce concile, [275] se trouvaient plusieurs personnages dont le nom est ml celle uvre de restauration
platonicienne, et qui ont eu un grand retentissement dans la premire
moiti du XVe sicle. C'taient Gmiste Plthon, Thodore Gaza, Gennadius, Georges de Trbizonde et le cardinal Bessarion. Le premier,
Plthon, platonicien passionn, avait compos un crit sur la Diffrence de Platon et d'Aristote, et un trait de Legibus imit de la Rpublique de Platon. Son adversaire, Gennadius, patriarche d'Alexandrie,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
254
dfendit Aristote contre lui et fit brler son trait des Lois. Plthon fut
galement attaqu par Thodore Gaza, et surtout par Georges de Trbizonde, qui dploya dans cette querelle une virulence et une pret
blmes de tous. La querelle fut termine par la haute impartialit du
cardinal Bessarion, qui crivit contre Georges de Trbizonde son trait
In Calumniatorem Platonis, et qui dfendit Platon sans attaquer Aristote.
Le sjour de Plthon Florence eut encore une consquence intressante pour la rnovation philosophique. Il convertit les Mdicis la
philosophie platonicienne. Cme de Mdicis devint un zl platonicien, et il fit instruire par G. Plthon dans cette mme philosophie son
fils Pierre et son neveu Laurent. Cme se sentit mme tellement enflamm d'amour pour cette philosophie, qu'il songea rtablir l'Acadmie de Platon, c'est--dire une cole destine conserver et
transmettre le feu sacr du platonisme. Il destina cette uvre considrable un jeune homme de l'esprit le plus brillant, fils de son mdecin, Marsile Ficin, qui fut plus lard le traducteur et l'interprte enthousiaste de Platon et de Plotin. L'Acadmie platonicienne fut fonde.
Laurent de Mdicis, alors au pouvoir, s'y intressa comme avait fait
Cme. On reproduisit mme le Banquet de Platon, o chacun des
convives, prenant le rle et le nom des personnages de Platon, refit
son tour un discours sur l'Amour. Ficin fit plus que jouer au platonicien. Il traduisit Platon, et sa traduction, fidle et intelligente, jouit
encore aujourd'hui d'une grande autorit. C'est elle qui est jointe la
plupart des ditions de Platon. Marsile Ficin [276] contribua en outre
renouer la tradition de la philosophie alexandrine.
ct de la renaissance platonicienne, il faut placer galement la
renaissance pripatticienne. Le moyen ge n'avait connu Aristote que
par des traductions barbares et des commentaires plus ou moins infidles, et, de plus, il avait t tudi avec les proccupations exclusives
de l'orthodoxie. L'introduction des uvres grecques d'Aristote inspira
une philosophie aristotlique indpendante, et mme plus ou moins
htrodoxe. Telle fut l'uvre de l'cole de Padoue, illustre par Pomponace, Cesalpini, Crmonini dans les XVe et XVIe sicles, et qui fait
pendant l'cole platonicienne de Florence alors prpondrante.
Entre ces deux coles, l'une et l'autre italiennes, il faut nommer la
philosophie cabalistique, renouvele de l'ancienne Grce, dont le principal promoteur est Pic de La Mirandole, mais dont le dveloppement
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
255
se fit surtout en Allemagne, o elle alla se joindre au mouvement
mystique dont nous avons parl.
Enfin, dans le mme temps, nous voyons encore en Italie commencer la philosophie exprimentale avec Tlsio, qui tait du royaume de
Naples et qui parait avoir eu quelque influence sur Bacon. Il se fit
mme de grandes constructions mtaphysiques l'image des systmes
anciens : Jordano Bruno, Campanella, Vanini, dploient une grande
ambition philosophique : tous les trois taient Italiens. Ainsi la source
italienne de la philosophie moderne n'est pas contestable. C'est encore
dans la mme contre qu'avec Lonard de Vinci et Galile commence
le vrai emploi de la mthode exprimentale. partir de cette poque,
on peut dire que la philosophie n'a plus de centre proprement dit. Elle
se partage entre les diffrents pays de l'Europe ; mais l'Italie est dpossde de son influence.
On voit d'abord la philosophie moderne natre en Angleterre avec
Bacon ; mais, au XVIIe sicle, elle ne sort pas de l'Angleterre. Elle s'y
confine, et sa principale uvre est la cration de la philosophie exprimentale et de la Socit [277] royale de Londres. La vritable hgmonie de la philosophie, au XVIIe sicle, appartient la France. La
philosophie de Descartes renouvelle l'uvre de Socrate, et veille
l'volution philosophique en posant comme principe le : Je pense,
donc je suis. Son influence ne se borne pas la France ; elle s'tend en
Hollande, o Descartes avait vcu, et elle engendre une autre grande
doctrine originale, o l'influence cartsienne vient se joindre celle
des vieilles traditions cabalistes et orientales, celle de Spinoza. Elle
s'tend jusqu'en Allemagne, o Leibniz fonde galement une grande
cole en rconciliant la nouvelle philosophie avec les scolastiques.
Avec le XVIIIe sicle, l'influence philosophique, au moins dans la
premire partie, revient l'Angleterre. La philosophie de Bacon, de
Locke et de Newton, passe la mer et arrive en France par l'importation
de Voltaire ; mais, dans la seconde moiti, l'hgmonie revient la
France. L'Encyclopdie inaugure le rgne social et politique de la philosophie. Pendant tout le XVIIIe sicle, ce rle lui est reconnu ; et c'est
en France que celle philosophie nouvelle a son domicile. La manifestation extrieure de ce grand fait a t la Rvolution franaise.
Au commencement du XIXe sicle, le contre de l'influence philosophique se dplace. Il n'est plus en France, mais en cosse et en Alle-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
256
magne. En cosse, la philosophie exprimentale traditionnelle se marie un sage spiritualisme. Reid et Dug Slewart sont les reprsentants
trs estimables de ce mouvement. En Allemagne, le mouvement critique inaugur par Kant se transforme en un dogmatisme mtaphysique transcendant et dmesur. En France, la philosophie subit
l'influence de l'cosse et de l'Allemagne et cherche une voie moyenne
entre l'une et l'autre. Royer-Collard et Jouffroy reprsentent le mouvement cossais, et V. Cousin le mouvement allemand. La France a
donc t cette poque une sorte de trait d'union. Elle a surtout eu
pour rle la rsurrection dos doctrines spiritualistes. Mais, dans la seconde partie du sicle, la France redevient centre en renouvelant la
philosophie exprimentale, unie la philosophie encyclopdique. Auguste [278] Comte est le chef de cette nouvelle philosophie. Le Comtisme renvoie en Angleterre la philosophie de Bacon transforme et
dveloppe, et donne naissance une cole qui est la dernire grande
cole philosophique du XIXe sicle : savoir l'cole de l'association et
de l'volution de Stuart Mill et d'Herbert Spencer. Nous n'avons pas
juger l'poque actuelle. Disons seulement qu' l'heure qu'il est, la philosophie existe l'tat diffus dans trois grands pays philosophiques de
l'Europe : l'Angleterre, la France et l'Allemagne, auxquelles s'associe
un moindre degr l'Italie. Rappelons si l'on veut l'intervention
trange de la Russie, sous la forme du nihilisme, et nous aurons peu
prs le tableau complet de la gographie philosophique l'poque actuelle. L'avenir peut encore nous rserver d'autres centres de pense
dans les grands pays qui n'ont encore t jusqu'ici que des tributaires
dans l'uvre de la civilisation, savoir la Russie et les tats-Unis.
Peut-tre y aura-t-il un jour une philosophie russe, une philosophie
amricaine ; mais, si nous exceptons le phnomne bizarre du nihilisme, qui n'est lui-mme qu'une importation allemande et franaise ;
si en Amrique vous exceptez le nom d'un grand moraliste, Emerson,
ces deux pays ne peuvent pas compter comme ayant introduit un apport de vritable poids dans la philosophie de notre temps.
Qui sait aussi si l'Asie elle-mme, qui a jou un rle si vaste et si
peu connu dans les destines primitives de la philosophie, qui sait,
lorsqu'elle entrera tout fait dans le courant de la civilisation europenne, si elle n'apportera pas son tour un lment de pense nouveau et original, si la philosophie ne retournera pas aux sources dont
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
257
elle est partie ? Mais cartons ces rves indtermins de l'imagination,
et arrtons ici le voyage philosophique qui, parti de Milet, nous a conduit Paris, Londres et Berlin.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
258
[279]
Introduction la science philosophique
Leon XIX
RAPPORTS DE LA PHILOSOPHIE
ET DE LA LITTRATURE
Retour la table des matires
Messieurs,
Nous avons tudier aujourd'hui les rapports de la philosophie et
de la littrature.
Nous nous sommes efforc, au dbut de ce cours, de prouver que la
philosophie est une science, et par l mme il semble que nous soyons
tenu de demander que la philosophie soit place au nombre des
sciences. C'est ce que beaucoup d'esprits sont tents de dsirer. Ils
voudraient, par exemple, que la philosophie cesst de faire partie des
Facults des lettres, pour passer aux Facults des sciences. Je ne crois
pas que cela soit dsirable. La philosophie, tout en tant une science,
n'en est pas une au mme titre que les autres. Elle est la science des
gnralits les plus hautes ; en s'enfermant dans le cadre des autres
sciences, elle deviendrait bien vite leur tributaire et leur vassale, ancilla scientiarum.
Mais si la philosophie est une science, pourquoi la mettre parmi les
lettres ? C'est que les lettres elles-mmes sont des sciences dans une
certaine mesure. Par exemple, l'histoire est une science, la gographie
en est une, et mme la littrature en est encore une un certain degr ;
car la potique et la rhtorique sont des sciences, et l'histoire littraire,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
259
la grammaire, la philologie, sont encore des sciences. La philosophie
peut donc se trouver ct de toutes ces ludes, sans perdre son caractre de science.
la rigueur, et en se plaant un point de vue idal, je crois que la
philosophie devrait constituer elle seule une facult que l'on appellerait Facult des sciences philosophiques [280] et qui serait l'unit et le
couronnement des Facults des lettres et des Facults des sciences ; ce
serait le moyen terme entre les unes et les autres. La philosophie elle
seule suffirait sans aucun doute constituer une seule Facult. La mtaphysique y occuperait la premire chaire. La psychologie, la logique, la morale, l'esthtique, le droit naturel, la politique, composeraient les chaires voisines. L'histoire de la philosophie se composerait
d'autant de chaires qu'il y a de grandes priodes dans l'histoire de
l'humanit. Enfin un certain nombre de cours annexes seraient occups par la philosophie de la religion, la philosophie des sciences, la
philosophie de l'histoire, etc.
C'est l, je le veux bien, un idal et une utopie, mais qui explique
pourquoi nous ne tenons nullement quitter le voisinage des lettres
qui sont nos mres nourricires, pour prendre celui des sciences qui ne
sont que nos parentes, et nous croyons par l beaucoup mieux prserver notre indpendance. Les lettres n'ont aucune prtention de nous
dominer ; les sciences nous rgenteraient et nous asserviraient.
Indpendamment des liens de tradition qui nous unissent aux
lettres, il est d'autres raisons qui touchent au fond des choses. Pascal,
dans un passage clbre, a distingu entre l'esprit de gomtrie et l'esprit de finesse. Or la philosophie a plus besoin encore de l'esprit de
finesse que de l'esprit de gomtrie. En se rattachant exclusivement
aux sciences, la philosophie perdrait l'esprit de finesse auquel elle doit
ses plus grandes richesses, et cette dlicatesse qui est l'accompagnement de l'esprit de finesse. C'est ce qu'il nous faut examiner de plus
prs.
Il s'est rpandu de nos jours un prjug nouveau sur les rapports de
la philosophie et des lettres. Lorsqu'on a voulu jeter de la dfaveur
contre une certaine doctrine philosophique, on a dit : C'est de la littrature ; comme si la littrature ne se composait que de mots et
comme si la beaut littraire ne concidait pas avec la grandeur de la
pense. Une thorie philosophique qui serait littraire, comme la tho-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
260
rie [281] de l'amour dans Platon, peut tre en ralit beaucoup plus
profonde et beaucoup plus philosophique que les thories d'apparence
scientifique, comme la thorie gomtrique de la cration dans le Time.
Considrons donc la philosophie dans son rapport avec la littrature. Nous croyons pouvoir avancer les deux propositions suivantes :
1
Les grands philosophes sont en gnral de grands crivains ;
Les grands crivains sont en gnral de grands philosophes
et pourraient faire partie d'une histoire de la philosophie.
I. Pour le premier point, n'est-il point vident que dans l'histoire de
la littrature grecque on voit figurer toute la chane des philosophes ?
Peut-on exposer les origines de la posie grecque sans parler des
pomes philosophiques, dont il ne nous reste que quelques fragments,
mais admirables, tels que les pomes de Xnophane, de Parmnide,
d'Empdocle ? La sophistique n'appartient-elle pas l'histoire des
lettres autant qu' l'histoire de la philosophie ? Les sophistes, en effet,
ne sont-ils pas les crateurs de la rhtorique ? Platon n'appartient-il
pas l'histoire de la littrature et de la posie ? Cette forme si originale du dialogue, l'introduction de personnages vivants et pittoresques,
cette figure de Socrate particulirement, si originale et si puissante ;
les accidents des dialogues qui les font ressembler des drames ;
quelques-uns mme, comme le Criton et le Phdon, qui sont de vritables drames ; le mlange de la posie et de la philosophie, l'introduction des mythes et des fables, et enfin, par-dessus tout, cotte langue
incomparable de richesse, de souplesse, de finesse, d'abondance, de
prcision, tout cela ne rentre-t-il pas dans la littrature ? Et Xnophon
n'est-il pas aussi du domaine des lettres, autant au moins que de celui
de la philosophie ? Les Mmorables sont une uvre exquise qui met
en scne le Socrate rel, avec autant de got et d'esprit que Platon a
mis d'clat dans le portrait du Socrate idal. Les conversations si [282]
vivantes, si familires, si naturelles, de Socrate avec ses disciples et
ses adversaires, ne sont-ils pas un objet d'admiration pour la critique
littraire aussi bien que pour l'analyse philosophique ? Il en est de
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
261
mme de l'conomique de Xnophon, qui nous prsente une peinture
exquise de la femme en Grce, et le sentiment le plus dlicat de
l'amour conjugal et de la dignit fminine. Aristote, en gnral, est
moins littraire que Platon. La forme de son exposition est plus scientifique et plus abstraite, et plusieurs de ses ouvrages, les Analytiques,
la Mtaphysique, la Physique, le trait de l'me, chappent entirement la critique littraire ; et cependant, combien de parties encore
dans ces uvres relvent de la critique littraire ! Que de pages dans
la Morale peuvent tre places, comme peinture de murs, ct des
Caractres de Thophraste et de La Bruyre ! La description des passions, dans la Rhtorique, celle des quatre ges, sont des tableaux de
la plume la plus fine et la plus pntrante. La Politique est encore une
uvre littraire qui, par le merveilleux esprit d'observation et par les
nombreux traits de murs que l'on peut y relever, intresse, comme
l'Esprit des lois, autant la littrature que la philosophie. Plutarque et
Lucien, qui ne sont point sans importance en philosophie, sont tout
entiers du domaine de la littrature. Enfin les grands moralistes
stociens, pictte et Marc-Aurle, qui ont crit tant de pages sublimes, seront-ils rejets de la littrature ? La critique littraire n'a-telle pas le droit de s'en occuper, sinon pour la puret de la langue, au
moins pour la beaut des penses ?
D'un autre ct, tous ces ouvrages que nous venons de citer, auraiton le triste courage de les rpudier au nom de la philosophie, sous prtexte que ce sont des crits littraires ? Refusera-t-on le caractre philosophique au Banquet de Platon, aux Mmorables de Xnophon, la
Politique d'Aristote, aux Penses de Marc-Aurle ? On voit donc qu'il
est impossible de fixer une limite absolue entre la philosophie et les
lettres. Il n'en est pas de mme des autres sciences. Euclide, Hippocrate, Diaphante, Ptolme, n'appartiennent [283] pas l'histoire des
lettres grecques, si ce n'est d'une manire extrieure, et on ne les tudiera pas au point de vue littraire, c'est--dire au point de vue de l'art
et du got.
On peut faire la mme observation sur la littrature latine. Lucrce,
les uvres philosophiques de Cicron et de Snque, sont une portion
importante de la littrature latine. Lucrce reprend la tradition des
grands pomes philosophiques de la Grce. D'une part il relve videmment de l'esthtique et de la critique littraire, qui il appartient
de juger de la posie ; de l'autre, de la philosophie, sans laquelle il est
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
262
inintelligible. En supposant qu'on rserve exclusivement la philosophie les Acadmiques de Cicron, le de Finibus, le de Fato, le de Divinatione, il resterait encore les Tusculanes, le de Officiis, le de Legibus, mme le de Natura deorum, qui, par leur beaut morale, par
l'ampleur et la science du style, relveraient de la littrature. De mme
pour les Lettres Lucilius, de Snque, o il y a tant d'esprit, tant de
verve, tant de traits profonds, que la littrature ne peut consentir se
rcuser et se priver du droit de les admirer et de les juger ; il en est
de mme, du reste, dans ses autres ouvrages : le de Beneficiis, le de
Vita beata, le de Clementia, etc., un auteur tel que Snque, qui, ainsi
que Plutarque, alimente sans cesse Montaigne, lequel en faisait ses
dlices, ne peut pas ne pas tre rput philosophe, et en mme temps il
est au nombre des plus grands crivains.
Si nous continuons cette mme rvision dans la littrature moderne, nous trouverons galement qu'il n'y a jamais eu sparation absolue entre la littrature et la philosophie, entre les grands philosophes
et les grands crivains. Au XVIe sicle, par exemple, on trouve le plus
grand des philosophes et en mme temps le premier de nos crivains :
c'est Montaigne. ceux qui voudraient exclure de la philosophie tout
ce qui est littraire, nous demanderons : Que ferez-vous de Montaigne ? videmment vous ne pouvez le refuser la littrature. Direzvous pour cela que ce n'est pas un philosophe ? Ce penseur si vari, si
fin, si dgag, d'un bon sens si [284] ferme et si libre qu'admirait tant
Pascal, le repousserez-vous en disant : C'est de la littrature ? Un
tel littrateur ne vaut-il pas plus comme philosophe qu'un Cesalpini,
un Campanella, un van Helmont, dont les noms sans doute appartiennent l'histoire de la philosophie, mais dont les penses sont ensevelies dans les cendres de l'oubli, tandis que nous vivons encore des
penses de Montaigne ?
Il n'en est certainement pas de mme de Descartes. Descartes appartient surtout l'histoire des sciences et l'histoire de la mtaphysique. C'est un philosophe dans le sens propre du mot ; et pendant
longtemps on n'a pas introduit le nom de Descartes dans l'histoire de
la littrature franaise. Il n'en est question ce point de vue ni dans La
Harpe ni dans les critiques littraires du XVIIIe sicle. Mais de nos
jours un grand critique, M. Nisard, a jug que c'tait l un oubli injuste
et prjudiciable la vritable intelligence de notre littrature. Non
seulement il a fait une place Descartes dans son Histoire de la litt-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
263
rature franaise, mais il lui a fait une place d'honneur. Il lui attribue
pour la prose un rle peu prs semblable celui que tout le monde
attribue Malherbe. Descartes aurait servi constituer la prose franaise, comme Malherbe constituer la posie. Ce rle de fondateur et
d'organisateur de la prose franaise, on l'attribuait Balzac, et il est
certain que, pour ce qui regarde la cration de la priode et de la
phrase, Balzac a eu la plus grande influence ; mais M. Nisard considre cette influence comme peu de chose en comparaison de l'esprit
d'ordre, de mthode, de clart, de sincrit avec soi-mme, de responsabilit devant le lecteur que Descartes a introduite dans notre littrature, et qui en fait la suprme originalit. Il y a en outre, dans le Discours de la Mthode, un mlange de navet et de grandeur, d'esprit,
dans le sens propre du mot, et de force d'expression (surtout dans la
premire partie), qui en fait une uvre littraire excellente. Et cependant n'est-ce pas aussi une uvre de philosophie ? Je ne parle pas seulement des parties techniques de l'ouvrage, comme, par exemple, de la
mthode cartsienne, en [285] tant que mthode mathmatique et mtaphysique. Je parle de cette mthode d'affranchissement non seulement l'gard de la tradition et de l'autorit, mais l'gard de toutes
les superstitions et de toutes les idoles dans le sens de Bacon, idoles
d'rudition, idoles d'imagination, idoles d'coles, etc. Cet affranchissement n'est-il pas une uvre philosophique ? et en mme temps n'estil pas aussi une uvre littraire ? Dans une thse ingnieuse intitule
l'Esthtique de Descartes, M. Krantz a fait de celui-ci l'inspirateur de
toute la thorie classique franaise : c'est l sans doute une thse un
peu paradoxale, mais qui ne manque pas de vrit.
Descartes n'est pas le seul philosophe du XVIIe sicle que l'on
puisse appeler un grand crivain. Cela est vrai encore, mais plus
forte raison, de Pascal. N'a-t-on pas le droit d'admirer en lui non seulement la pense la plus profonde, mais l'imagination la plus originale
et la plus mouvante sensibilit ? ceux qui veulent rejeter absolument la littrature de la philosophie, n'aurons-nous pas le droit de demander, comme pour Montaigne : Que faites-vous de Pascal ? Aurez-vous le courage de l'exclure du rang des philosophes ? Qui perdrait le plus un ostracisme aussi ridicule ? Ce ne serait pas Pascal ;
ce serait la philosophie. La pense cesse-t-elle d'tre la pense parce
qu'elle est exprime en beaux termes ? Bien au contraire, certaines
profondeurs et finesses de la pense chappent la formule abstraite
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
264
et technique, et ne peuvent trouver d'expression que dans la langue de
l'imagination et du sentiment. Le plus profond en philosophie n'est pas
toujours le plus abstrait. Un cri de Pascal dit plus que toutes les formules d'Hegel. Pascal est donc la fois philosophe et crivain. Inutile
d'ajouter que cela est galement vrai de Malebranche, aussi subtil,
aussi fin comme penseur que brillant et spirituel comme crivain. Une
langue un peu flottante, mais noble, abondante, lumineuse, pleine de
grce et quelquefois d'loquence, s'unit en lui la plus sublime philosophie.
Passons au XVIIIe sicle. Ce sicle, si l'on veut en exclure tout ce
qui est littraire, ne compte pour ainsi dire pas en [286] philosophie.
Except Condillac et quelque peu Diderot, vous n'avez gure au XVIIIe
sicle de philosophie technique, abstraite, mtaphysique dans le sens
purement scientifique du mot. Mais y aurait-il rien de plus bizarre et
de plus paradoxal que de soutenir que le XVIIIe sicle n'a pas eu de philosophie ? Qu'appelle-t-on donc la philosophie du XVIIIe sicle ? N'estce pas un grand vnement dans l'histoire ? Cette philosophie n'a-telle pas, en dfinitive, renouvel la manire de penser dans le monde ?
Voltaire, Rousseau et Montesquieu, d'Alembert et Diderot seront-ils
considrs comme n'ayant rien voir avec la philosophie ? Ici encore
nous demanderions : Qui est-ce qui perdrait dans cette conclusion ? Ne serait-ce pas avant tout la philosophie elle-mme ? La philosophie, pour exister, doit-elle absolument s'abstraire de la vie sociale, des mouvements extrieurs, de l'volution des ides, se borner
analyser des statues idales, ou oprer des expriences sur des malades vivants ? Tout ce qui touche l'me, la destine humaine, la
destine des socits, doit-il la laisser indiffrente ? Ne pas savoir qu'il
y a des religions, ne pas savoir qu'il y a des gouvernements, se retrancher comme la gomtrie et comme la physique dans un monde purement abstrait, cela est-il possible pour la philosophie ? Et cela serait-il
dsirable ? Une philosophie ainsi mutile ne perdrait-elle pas un de
ses caractres les plus saillants, la gnralit ? La philosophie est une
rsultante de la civilisation et un instrument de civilisation. ce titre,
les philosophes du XVIIIe sicle sont au premier rang des philosophes.
Mais ce n'est pas par la pense pure, la pense abstraite, que la philosophie agit sur le monde ; c'est aussi, c'est surtout par la plume, par le
style, par l'loquence.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
265
Inutile de prolonger cette preuve. Il est dmontr que la philosophie ne peut pas se sparer de la littrature, ni la littrature de la philosophie. Il en est de mme d'ailleurs en Angleterre qu'en France. Bacon, Hume, Adam Smith, sont la fois philosophes et crivains ; et
l'histoire littraire de l'Angleterre ne serait pas complte si on omettait
leurs noms. Quant [287] l'Allemagne, la vrit que nous venons
d'tablir est encore bien plus frappante qu'ailleurs, et, comme l'a dit un
habile critique, la littrature, l surtout, est imprgne de philosophie : 18 les phases de l'une correspondent aux phases de l'autre.
II. Considrons maintenant le second point de vue que nous avons
annonc, et que nous avons exprim ainsi : les grands crivains sont
en gnral de grands philosophes.
Il n'y a point ici de redite et de tautologie. Nous avons d'abord parl des philosophes qui sont notoirement et aux yeux de tous considrs comme philosophes, et nous avons montr que la plupart d'entre
eux sont des crivains. Maintenant nous avons en vue les grands crivains proprement dits, notamment les potes, et ceux-l mmes qui ne
s'occupent pas de matires philosophiques, et c'est de ceux-l que
nous disons que, sans le savoir et sans le vouloir, ils sont en mme
temps des philosophes.
Par exemple, dans l'antiquit, Homre tait considr comme la
source de toutes les sciences ; et Horace disait qu'il nous instruisait
mieux que Chrysippe et Crantor. On trouve dans Homre non seulement une morale, mais encore une thodice. Chez lui, le polythisme
tend devenir monothisme. Les potes gnomiques appartiennent
l'histoire de la philosophie aussi bien qu' l'histoire littraire : c'est
l'origine de la morale. On peut dire que le rle qui appartient chez les
modernes l'loquence sacre appartient chez les Grecs aux potes.
C'est Pindare, c'est Eschyle, c'est Hsiode qui sont les prtres, les
thologiens. La thorie mystrieuse du Destin, de la Ncessit, inspire
les grandes tragdies d'Eschyle et de Sophocle. Le Promthe
d'Eschyle nous offre la lutte mmorable de la personnalit humaine et
de la tyrannie divine. Chez les Romains, la grande pope de Virgile
est anime par un vague sentiment panthistique et par une sensibilit
18
Em. Grucker, Histoire des doctrines littraires en Allemagne, prface.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
266
profonde qui fait pressentir le dveloppement prochain de l'ide de
charit. Horace est le pote de l'picurisme pratique, [288] de la douce
indiffrence, de la volupt dlicate et sense, tandis que Lucrce est le
pote de l'picurisme thorique, avec ses nombreux aspects. Enfin les
potes Juvnal, Perse, Snque le Tragique, comme l'a si bien montr
notre collgue M. Martha, 19 sont des potes stociens.
Si nous passons notre littrature franaise, personne ne s'tonnera
que l'on parle de la philosophie de Molire ou de la philosophie de La
Fontaine. J'ai moi-mme tudi, au point de vue psychologique, les
tragdies de Racine. J'ai montr que l'on peut trouver dans Racine les
lois de la psychologie des passions, par exemple ce que j'ai appel la
loi d'oscillation ou de fluctuation ou passage du pour au contre ; la loi
de suggestion ou de persuasion indirecte, si intressante comparer
avec la suggestion somnambulique ; enfin la loi de transformation,
savoir comment une passion devient successivement toutes les
autres. 20 Quant Molire, j'ai galement essay de dgager de la comdie sa philosophie, notamment dans Tartuffe, le Misanthrope et
Don Juan. Le Tartuffe soulve la question de l'hypocrisie, beaucoup
plus difficile qu'on ne le croit vulgairement. Par exemple, un homme
qui a des passions ou mme des vices doit-il par l mme renoncer
la pit et toute moralit, c'est--dire se donner tous les vices parce
qu'il en a quelques-uns ? Et s'il cherche concilier les deux choses, ne
sera-t-il pas aussitt accus d'hypocrisie ? C'est encore une question
philosophique de savoir jusqu' quel point la comdie a le droit de
toucher la morale et la religion. Le Misanthrope nous montre l'opposition de la vertu et du monde et soulve cette question : la vertu
pure et raide, telle qu'elle est enseigne par l'cole, est-elle compatible
avec les exigences de la vie mondaine ? Quant Don Juan, il met en
prsence l'incrdulit athe de la fin du XVIIe sicle avec la foi nave,
la foi du charbonnier, reprsente par Sganarelle. 21 Inutile d'insister
sur La Fontaine : tout le monde reconnat que [289] ses fables ne sont
pas moins profondes qu'agrables et que l'apologie y estime forme de
la morale. Inutile de revenir sur ce que nous avons dit de Voltaire et
de Rousseau. Au XIXe sicle, qui ne reconnatra dans Lamartine la re19
20
Les Moralistes sous l'empire romain.
Voir notre livre sur les Passions dans la littrature du dix-septime sicle.
21 Sur la philosophie de Molire, voir mme ouvrage.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
267
naissance du spiritualisme, dans V. Hugo une inspiration manifestement panthistique, dans Alfred de Vigny une thorie pessimiste, dans
George Sand une philosophie vague sans doute, mais fortement imprgne d'utopie humanitaire ? Enfin, pour ne pas oublier les littratures trangres, qui douterait que Shakespeare et Gthe ne soient des
philosophes, et Hamlet et Faust des pomes philosophiques ?
En un mot, si l'objet de la philosophie, comme l'a dit Bacon, est
l'homme, la nature et Dieu, l'objet de la littrature est galement
l'homme, la nature et Dieu. Seulement, ce que la philosophie tudie
par la rflexion, par l'analyse abstraite, la littrature l'tudie par une
autre sorte d'analyse, que l'on peut appeler l'analyse d'intuition, ou
l'analyse immdiate, l'analyse du sentiment. La philosophie est donc,
en ce qui concerne l'homme, une sorte de littrature abstraite, et la littrature une sorte de philosophie vivante, sensible, anime.
Au lieu de dmontrer ce principe par l'histoire, qui nous a paru la
mthode la plus intressante, nous aurions pu prendre la mthode
thorique et montrer, par exemple, comment en littrature les genres
viennent en quelque sorte se fondre insensiblement dans la philosophie ; comment le pome didactique, la satire, l'apologue, sont des
dmembrements de la morale ; comment la rhtorique, la potique, la
critique littraire, se rattachent l'esthtique ; comment la posie dramatique et le roman relvent de la psychologie. Mais on ne peut tout
dire, et ces diffrents rapports ressortent suffisamment de ce que nous
avons dit.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
268
[290]
Introduction la science philosophique
Leon XX
RAPPORTS DE LA PHILOSOPHIE
ET DE LA POLITIQUE
Retour la table des matires
Messieurs,
Nous ne savons s'il y a lieu de rechercher quels sont les rapports de
la philosophie et de la politique ; car la politique elle-mme, j'entends
la politique gnrale, est une partie de le philosophie. Ce serait donc
rechercher les rapports de la philosophie avec elle-mme. Cependant,
un autre point de vue, la politique peut tre considre part comme
une science spciale indpendante ; quand mme on n'y verrait qu'une
partie de la philosophie, il y aurait toujours lieu de se demander quels
sont les rapports de cette partie avec les autres, psychologie, logique,
etc.
Platon a dit que tant que les philosophes ne seraient pas rois, ou
que les rois ne seraient pas philosophes, il n'y aura pas de remdes aux
maux qui dsolent les tats. En revanche, Frdric II disait au contraire : Si j'avais une province punir, je la ferais gouverner par un
philosophe.
Nous ne mritons ni cet excs d'honneur ni cette indignit . Les
philosophes en tant que philosophes ne sont pas plus aptes que les
autres gouverner les hommes ; mais ils ne le seraient peut-tre pas
moins, et un peu de philosophie ne ferait pas de mal aux politiques.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
269
Enfin il est vident que les ides philosophiques sont ncessaires
l'intelligence de la politique.
II y a donc une philosophie de la politique, comme de l'histoire,
comme de la littrature.
Les sciences philosophiques avec lesquelles la politique est le plus
troitement en rapport sont : la psychologie, la logique, [291] la morale et le droit naturel. Nous avons longuement dvelopp ailleurs les
rapports de la politique avec la morale et le droit naturel, 22 et nous y
renverrons nos lecteurs. Nous nous bornerons ici aux rapports qui
unissent la politique la psychologie et la logique.
I. La psychologie politique. Le modle achev de ce que l'on
peut appeler la psychologie politique est la Rpublique de Platon.
Platon, dans sa Rpublique, part de cette ide que l'tat est semblable l'individu, qu'il en est l'image agrandie. C'est, par exemple,
pour savoir ce que c'est que la justice dans l'individu qu'il tudie la
justice dans l'tat. L'individu a trois facults : les sens, le cur, la raison. De mme l'tat a trois classes d'hommes, exerant trois fonctions
fondamentales : les classes laborieuses (laboureurs et artisans), ayant
pour fonction la subsistance ou la satisfaction des sens ; les guerriers,
ayant pour fonction la dfense de l'tat, et pour vertu le courage qui
vient du cur ; et enfin les magistrats, qui ont pour fonction le gouvernement, et qui correspondent la raison.
On peut trouver que ce sont l des rapports assez arbitraires et qui
ne jettent pas un trs grand jour sur le rle de l'tat ; mais ce qui est
vraiment admirable dans la Rpublique de Platon, c'est la comparaison
qu'il tablit entre les diffrents gouvernements et les caractres humains. De mme qu'il y a quatre espces de gouvernements, il y a
quatre espces de caractres. Les quatre gouvernements sont : la timocratie ou aristocratie, l'oligarchie, la dmocratie, la tyrannie. Il y a
galement quatre caractres d'hommes : le timocratique, fond sur
l'honneur ou l'amour des honneurs ; l'oligarchique, sur l'amour du
gain ; le dmocratique, sur l'amour de la libert ; le tyrannique, sur
l'amour du pouvoir.
22
Voir notre Histoire de la science politique, lre et 3e dition, introduction.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
270
On peut trouver de la psychologie politique chez tous les publicistes. Mais je signalerai surtout un travail contemporain o a t reprise l'ide de Platon, mais avec des diffrence [292] importantes. On
trouvera cette thorie dans le livre de M. Bluntschli sur l'tat, et cet
auteur lui-mme, dans cette partie de son livre, ne fait que reproduire
la thse d'un crivain suisse, M. Rohmer, qui l'a expose en 1842 dans
un livre allemand intitul : Lehre van den politischer Parteien.
L'ide capitale de cet ouvrage est d'expliquer non les gouvernements, mais les partis politiques, et de les comparer non aux caractres humains, mais aux diffrents ges. De mme qu'il y a quatre
ges : l'enfance, la jeunesse, l'ge mr et la vieillesse, il y a quatre partis ncessaires et fondamentaux dans un tat libre : le radicalisme, le
libralisme, le conservatisme et l'absolutisme.
Selon l'auteur, le radicalisme correspond l'enfance, l'absolutisme
la vieillesse, le libralisme la jeunesse, et le conservatisme la maturit.
Le but de cette thorie est facile saisir.
On considre gnralement le libralisme et le conservatisme,
c'est--dire les doctrines moyennes, comme les formes timides et inconsquentes des doctrines extrmes, le radicalisme et l'absolutisme.
La pense de l'auteur est au contraire que les deux formes extrmes ne
sont que des formes rudimentaires ou dgnres, que les vrais reprsentants de la politique sont les partis moyens qui correspondent aux
deux poques vivantes et fcondes de notre vie, savoir la jeunesse et
l'ge mr. Le radicalisme est une politique qui tient l'enfance, c'est-dire l'ignorance des conditions de la vie relle ; l'absolutisme correspond la vieillesse, c'est--dire l'ge o on ne vit plus que par la
mmoire La politique, comme la vie, n'est vraiment l'uvre que de
la jeunesse et de l'ge mr. Elle est la transaction entre le got de la
nouveaut qui caractrise la jeunesse, et le got de l'ordre et des habitudes qui correspond l'ge mr.
Cette thorie est ingnieuse et sduisante sous sa forme gnrale ;
mais, examine de prs, elle paratra plus paradoxale que solide. On
peut en conserver les grandes lignes ; mais les dtails doivent tre corrigs.
[293]
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
271
Il est bien vrai que le radicalisme se caractrise, comme l'enfance,
par l'agitation et le mouvement ; que l'excs d'imagination et l'absence
de raison calme, l'ignorance des conditions de la vie relle des nations
et des individus, appartiennent galement l'un et l'autre. Mais est-il
vrai de dire, par exemple, comme l'auteur, que l'enfant est tourn
vers l'avenir ? N'est-il pas beaucoup plutt enferm dans le prsent ?
Peut-on dire aussi que l'enfant croit la possibilit d'un monde nouveau ? Rien de moins juste. L'enfant ne s'occupe pas d'un monde
nouveau. Il jouit de celui o il est. Est-il vrai encore de diriger l'enfant ainsi dtruire ? Oui ; il aime casser ses jouets ; mais il ne
cherche pas dtruire ce qui l'entoure. Il est au contraire trs attentif
au milieu o il est, et trs effray d'en sortir. On ne peut pas dire non
plus que l'esprit de rvolte soit un des caractres de l'enfant et qu'il a
un amour exagr de l'indpendance. Ce serait l le caractre de la
jeunesse, non de l'enfance. Au contraire, l'enfance est en gnral docile ; elle a besoin de protection et aime la protection ; l'enfant se met
toujours sous la protection de sa mre. Comment surtout peut-on attribuer l'enfant le got de l'idalisme abstrait qui caractrise le radicalisme ? L'auteur cite Robespierre comme le type absolu de la doctrine radicale ; mais rien de moins enfant que Robespierre ; rien ne
ressemble moins l'enfance que le jacobinisme. L'enfance est
joyeuse ; le jacobinisme, l'anarchisme et mme le radicalisme sont des
doctrines tristes. Le mme auteur nous dit encore que l'enfant aime
pousser les choses l'extrme et poursuivre un principe de dduction en dduction ses dernires consquences . L'enfance n'est pas
si logique ; elle se soucie peu des principes, et encore moins des consquences : elle est essentiellement intuitive, et ne s'intresse qu' ce
qu'elle voit.
Mmes exagrations dans le rapprochement que fait l'auteur entre
la jeunesse et le libralisme. En gnral il nous semble que l'auteur
avance d'un cran le caractre de chaque ge et lui prte le caractre de
l'ge suivant.
Sans doute la jeunesse aime la libert, la nouveaut, l'indpendance. [294] Mais tout cela est commun au radicalisme et au libralisme. Sans doute la jeunesse entre dans la vie avec une pleine confiance en elle-mme. Sans doute elle soulve tous les problmes .
Mais est-il vrai de dire que la jeunesse aussi critique sans dtruire,
qu'elle prfre les rformes aux rvolutions ? Il nous semble que la
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
272
jeunesse n'est pas si sage ni si conservatrice. S'il y a un ge au contraire o l'on aime les rvolutions, c'est quand on est jeune. L'auteur,
en vrai protestant, nous donne dans Luther le type du libral qui n'est
pas radical. C'est y mettre de la bonne volont. Changer de fond en
comble la religion de son temps, rompre avec une autorit sculaire,
dtruire la discipline ecclsiastique, le clibat des prtres, la confession, etc. ; aliner tous les biens ecclsiastiques pour les attribuer aux
laques, tout cela ne ressemble pas mal du radicalisme, et nos radicaux d'aujourd'hui ne sont gure que de ples libraux ct de ce
prtendu libral. Sans doute il y a eu de plus radicaux que lui ; mais
c'est le propre de toutes les opinions politiques. Pour suivre la comparaison de l'auteur, il nous semble que la jeunesse a plus de rapports
avec le radicalisme qu'avec le libralisme, et que les faits qu'il impute
l'enfance s'appliquent surtout la jeunesse ; par exemple, le got des
principes abstraits et des consquences extrmes, la tendance de
l'imagination considrer l'avenir plus que le prsent, et croire la
possibilit d'un monde nouveau, tout cela est le fait de la jeunesse et
non de l'enfance.
La conservation maintenant, pour l'auteur, se rattacherait l'ge
mr. Deux forces inverses maintiennent les tats : la force librale,
qui cre, et la force conservatrice, qui garde ; l'une appartient la jeunesse, l'autre l'ge mr. L'homme de trente quarante ans est moins
occup acqurir des biens nouveaux qu' amliorer ce qu'il a. Ici encore il nous semble que l'auteur anticipe. L'homme de trente quarante ans n'est pas si conservateur, ni pour ce qui concerne ses intrts
propres, ni pour ceux de l'tat ; c'est au contraire le temps des entreprises hardies : on veut faire fortune ; on veut arriver [295] dans le
monde. On risque beaucoup pour l'un et l'autre ; ce n'est qu'au del
que commence le besoin de conserver.
Sans pousser plus loin cette ingnieuse comparaison des ges et
des partis, nous dirons que, si l'on veut conserver la thorie, il faut
avancer d'un tage ou d'un cran les observations de l'auteur. Sans
doute il y a quelque chose d'enfantin dans le radicalisme ; mais de
mme il reste encore de l'enfance dans la jeunesse. En ralit le radicalisme ressemble surtout la premire jeunesse de vingt trente ans ;
le libralisme, la seconde, de trente quarante ans ; le conservatisme, l'ge mr, et l'esprit de raction la vieillesse. Inutile de dire
que cela ne veut pas signifier que tout jeune homme soit radical et tout
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
273
vieillard ractionnaire. On veut dire simplement que les partis politiques ressemblent aux diverses tendances de la nature humaine reprsente par les ges.
II. La logique politique. J'appelle logique politique l'art de raisonner et de discuter en politique. On trouvera les lments de cette
logique dans deux ouvrages anglais publis au commencement de ce
sicle.
L'un est l'ouvrage de Bentham intitul les Sophismes politiques.
Comme il est trs long et assez connu, nous y renverrons nos lecteurs.
L'autre est un piquant et spirituel crit de W. Hamilton, qui a t rcemment traduit en franais par M. Joseph Reinach.
Ce n'est pas un livre rcent ni contemporain : c'est une sorte de rsurrection d'un livre ancien et oubli, paru en 1808, et crit bien longtemps auparavant. Il est donc de la fin du XVIIIe sicle ; mais, s'appliquant l'art de parler dans les assembles politiques, il est encore opportun aujourd'hui. Quelques mots d'abord sur l'auteur.
William Hamilton, qu'il ne faut pas confondre avec le philosophe
du mme nom, a t de son vivant un personnage connu et clbre
pour son esprit, assez mme pour avoir t un de ceux auxquels on a
attribu les Lettres de Junius ; mais cette hypothse parat peu vraisemblable. Avec de grandes [296] facults, Hamilton n'a pas rempli
toutes les promesses qu'il avait donnes de lui son dbut dans la carrire politique. C'est un fait singulier, qu'avec le plus beau talent oratoire et ayant vcu trs longtemps, il n'ait jamais prononc qu'un seul
discours. Aussi fut-il surnomm l'homme au discours unique, single
speech. Il eut parler sans doute plusieurs fois, dans des rapports officiels, litre de haut chancelier d'Irlande ; mais il renona la parole
militante et ne pronona plus un seul discours dans la Chambre des
communes. Ce discours unique, cependant, avait t un vnement, et
Horace Walpole, qui n'tait pas trs bienveillant pour ses compatriotes, dit de lui qu'il avait atteint du premier coup la perfection :
C'est, disait-il, la parole la plus solide qu'il et entendue ; c'est le
discours d'un orateur qui est sur de son talent. Malgr ces brillants
dbuts, Hamilton, par indiffrence, par scepticisme, par une dfiance
croissant avec l'ge, en resta l, et survcut pendant quarante ans son
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
274
chef-d'uvre, que nous ne pouvons pas mme juger, car il n'a pas t
imprim.
Ce fut pendant cette longue carrire qu'il crivit, sous forme
d'aphorismes et de maximes la manire de La Rochefoucauld, un
petit trait de Logique parlementaire, que l'on pourrait tout aussi bien
appeler une Rhtorique parlementaire ; mais, par le mme esprit de
nonchalance, de ddain, d'ataraxie qui caractrisa sa vie, il ne se donna pas mme la peine de publier son livre, et ce fut seulement aprs sa
mort, en 1808, qu'un ami en fit la publication. Ce livre avait obtenu les
suffrages des juges les plus svres : de Samuel Johnson, qui l'avait lu
en manuscrit ; et de Jeffries, le clbre critique de la Revue d'dimbourg, qui en fit un compte rendu trs mordant, mais trs flatteur ;
mais l'opinion publique ne lui fut pas favorable, sans doute cause
des circonstances politiques au milieu desquelles il fut publi. L'ouvrage n'eut aucun succs, et il n'a jamais eu de seconde dition autre
que celle qu'en a donne en franais M. Joseph Reinach ; l'auteur luimme tait fort ignor, et nous ne l'avons connu, en ce qui nous concerne, que par l'introduction du traducteur.
[297]
Cependant ce livre mritait d'tre lu : c'est l'uvre d'un esprit fin et
avis, observateur pntrant, connaissant fond la rhtorique des anciens et l'appliquant habilement aux pratiques de l'lgance moderne.
On peut lui reprocher de l'obscurit, de la subtilit, un bon nombre de
maximes connues et peu d'art dans le classement de ces maximes, dfauts qui sont probablement le rsultat de l'indolence de l'auteur, qui,
n'ayant pas publi son livre, ne s'est pas donn la peine de le corriger.
Mais, malgr ces dfauts, le livre est plein d'humour et d'originalit.
Les observations sont souvent perantes ; sa science de la discussion
parlementaire est profonde. Il dit le secret des orateurs politiques avec
une franchise et une pret dont on ne lui saura pas beaucoup gr.
Le reproche le plus grand, en effet, qui lui ait t adress est celui
d'immoralit. On lui impute d'tre de l'cole des sophistes qui enseignaient prouver le pour et le contre, et faire bonne une cause mauvaise. On prtend que c'est en rponse au livre d'Hamilton que Bentham a publi son livre des Sophismes parlementaires ; et le clbre
diteur de Bentham, Etienne Dumont, dans la prface de ce livre,
parle d'Hamilton avec la plus grande svrit. Comparant l'crit
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
275
d'Hamilton avec celui de Swift, o celui-ci, sous forme d'Avis aux
domestiques, expose ironiquement leurs vices et leurs travers, t.
Dumont ajoute ce qui suit : L'crit d'Hamilton est tout diffrent. Son
livre est une cole o l'art de soutenir ce qui est vrai, et ce qu'on sait
tre faux, l'art d'appuyer une bonne mesure et d'en dfendre une mauvaise, est enseign avec la mme franchise et le mme zle. Ce n'est
point une ironie : c'est le rsultat srieux de l'exprience et de la mditation. Il n'tait pas simplement dans un tat d'indiffrence entre le
faux et le vrai. Il donnait une prfrence dcide la dfense d'une
mauvaise cause, parce qu'elle exigeait plus de dextrit, et qu'une fois
blas sur l'amour du vrai, on se fait un mrite de savoir dcorer le faux
sous des couleurs trompeuses. Enfin, suivant le mme critique, de tous
les moyens captieux enseigns par Hamilton, [298] celui auquel il
donne la palme, c'est l'art de falsifier les opinions de ses adversaires .
Ce jugement est bien dur, mais le traducteur n'est pas loign d'y
adhrer, car il rapproche la Logique d'Hamilton du Prince de Machiavel. Ce serait donc une sorte de rhtorique machiavlique que nous
aurions sous les yeux, et M. Joseph Reinach n'essaye de justifier son
orateur qu'en disant, comme on l'a fait de Machiavel lui-mme, ainsi
que de La Rochefoucauld et quelquefois de La Fontaine, que ces auteurs n'ont eu pour but que de nous montrer ce qui se fait, et non pas
ce que l'on doit faire. Les sentences ne sont pas des prceptes, mais
des maximes et de simples rsums de ce que nous apprennent la pratique et l'exprience.
Je ne sais si c'est pour avoir t prvenu l'avance par ces critiques
svres, moiti acceptes par le traducteur ; mais nous avouons qu'
la lecture, le livre d'Hamilton nous parait beaucoup moins noir que ne
le reprsente t. Dumont, l'diteur de Bentham, qui peut-tre ne l'avait
pas lu. Outre qu'il n'y a en dfinitive qu'un assez petit nombre de
maximes qui mriteraient la qualification de machiavliques, et qu'il
serait souverainement injuste de dire que l'ouvrage dans son entier a
pour but le mensonge, il nous semble en outre que la plupart de ces
maximes rprhensibles ne sont gure plus coupables que ne le sont
les rgles de rhtorique donnes dans les traits des anciens et qui enseignaient pallier ce qu'il y a de faible dans la thse de l'orateur, en
mme temps qu' affaiblir ce qu'il y a de fort dans la thse oppose, et
qui nous enseignent galement que dans les affaires publiques il faut
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
276
savoir, suivant les occasions, soutenir le pour et le contre. Appellera-ton sophistique, par exemple, ou art de plaider la fois le faux et le
vrai, les maximes suivantes :
Pour combattre un projet de modifications constitutionnelles, allguez qu'il est injuste de changer la constitution tablie ; pour la dfendre, dites qu'ajouter ce qui existe, ce n'est pas abroger, mais perfectionner la constitution ?
[299]
Une telle maxime est-elle immorale en soi, parce qu'elle prsente
les deux faces d'une question ? Et est-il un politique qui s'engagerait
l'avance ne jamais changer la constitution, ou dfendre toute espce de changement ? De mme, quand il s'agit de la guerre, Hamilton
rsume tous les arguments qui ont t dans tous les temps ou qui seront ternellement donns pour ou contre :
Pour recommander la guerre, dit-il, affirmez que le moment est venu de nous venger, de dfendre nos allis, d'agir pour le bien public,
etc. Pour combattre la guerre, dmontrez que les griefs sont minimes,
que la guerre n'est jamais avantageuse, que les avantages sont du ct
de l'ennemi. Pour faire cesser une guerre heureuse, dites qu'un gouvernement sage n'attend pas la mauvaise chance et sait profiter de la
victoire. Pour faire cesser une guerre malheureuse, montrez combien
le peuple souffre, dites qu'il vaut mieux cder une partie que de risquer le tout.
Que sont ces maximes gnrales prpares d'avance pour toutes les
causes, sinon ce que les anciens appelaient des lieux communs, et dont
Aristote a donn la thorie dans son livre des Topiques, sans qu'il ait
jamais t appel pour cela un sophiste ? De mme appellera-t-on machiavlisme, jsuitisme oratoire, l'ensemble de ces petites habilets, de
ces ingnieux artifices que connaissent si bien les matres de la parole
dans les assembles politiques, et dont Hamilton nous prsente le piquant tableau ? Quoi de plus vident, par exemple, et mme de plus
lgitime que les rgles suivantes :
Au lieu de nier absolument la thse de votre adversaire, admettezla en partie, en vous attachant prouver que ce principe n'est vrai que
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
277
dans une certaine mesure ; par l vous enlevez l'argument toute sa
force, sans offenser votre adversaire ?
Ou encore :
Admettez ce que dit votre adversaire et dites que cela ne prouve
absolument rien ; car la plupart du temps les orateurs tiennent produire non des arguments concluants, mais des ides qui ne sont justes
qu'en elles-mmes, et non quant aux consquences qu'on en tire. Le
bon sens suffit pour mettre des ides justes ; mais pour trouver des
arguments probants, il faut une raison suprieure.
[300]
On ne peut nier cependant qu'il n'y ait dans notre auteur un certain
nombre de maximes purement sophistiques ; mais est-il certain qu'il
n'y ait pas quelque ironie cache dans quelques-unes de ces
maximes ? Est-il vraisemblable qu'un publiciste, si machiavliste
qu'on le suppose, crivant pour lui-mme, se soit donn la peine de
dire :
Faire du faux le vrai, et vice versa ?
C'est l une rgle bien inutile se donner soi-mme, quand on a
l'intention de la pratiquer. Il est bien plus vraisemblable que l'auteur a
voulu dire qu'en fait l'art de la parole en politique consiste la plupart
du temps faire le vrai du faux et rciproquement : ce qui est une observation chagrine et pessimiste, et d'un esprit plus ou moins blas sur
les choses de ce monde, mais non pas une maxime immorale dans le
sens o on l'entend. C'est dans le mme sens que j'entends la maxime
suivante :
Quand vous ne russissez pas convaincre, tchez d'blouir par
des images.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
278
Quoi qu'il en soit d'ailleurs, et en abandonnant, non pas une quarantaine, mais une dizaine de maximes sur cinq cents dont se compose
l'ouvrage entier, il reste un trait d'une rhtorique trs fine et d'une
logique trs forte, dont nous donnerons quelques exemples. Par
exemple, on remarquera les maximes suivantes, qui ne sont que fines,
sans tre subtiles ni captieuses :
La distinction claire les sujets : la division les embrouille. Que
chacune de vos conclusions soit toujours accompagne de sa restriction. Lorsqu'un argument fort ou une fine riposte vous vient l'esprit, ne l'employez pas sur-le-champ, mais commencez par quelques
raisons moins pressantes, pour prparer l'argument le plus fort.
Est-ce de l'habilet illgitime que de dire :
Attendez le moment opportun, et tchez de ne parler qu'aprs une
personne dont le discours aura t ennuyeux. Quand vous attaquez
une personne, tchez toujours de trouver quelque chose louer ?
[301]
Un rhtoricien blmera-t-il le conseil suivant, parce qu'il prle
l'orateur quelque chose du comdien :
Dterminez l'avance la plus belle partie de votre discours ; rattachez cette partie quelques incidents survenus au cours du dbat,
et, arrivant cette belle partie prmdite, ayez l'air embarrass, employez une expression au-dessous de votre ide, el ayez l'air de rencontrer par hasard la vraie formule. Cet artifice produit un effet extraordinaire ?
N'est-ce pas un artifice de ce genre que recommande Crassus dans
le De Oratore, quand il tablit comme rgle fondamentale que l'orateur doit toujours avoir l'air anxieux et proccup quand il commence
son discours ? N'est-ce pas une habilet lgitime que celle que recommande l'auteur dans la maxime suivante :
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
279
Il est parfois d'un habile politique de ne pas donner un argument
toute sa force, pour pouvoir le dfendre dans la rplique avec une vigueur nouvelle ?
N'est-ce pas connatre fond les rgles de la controverse politique
que d'crire :
Montrer que ceux qui tiennent tel langage en tiendraient un tout
autre en d'autres circonstances ?
Ou encore :
Si vos adversaires ont t au pouvoir, examinez toutes les mesures
qu'ils ont prises, les lois qu'ils ont prsentes, les dbats parlementaires et les journaux du temps : cette recherche vous fournira beaucoup d'arguments ad hominem.
Et encore :
Il est rare que les vraies raisons pour lesquelles on propose une
mesure soient les raisons qu'on dclare. Bien dmler ces raisons,
c'est se fournir une riche et brillante provision d'arguments.
Autre prcepte d'une trs frquente et trs utile application :
Tchez de trouver un prcdent plus fort que la mesure que vous
allez proposer.
[302]
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
280
Rappelons enfin celle-ci, trop souvent oublie par les partis politiques :
Il faut comparer, non pas le bien avec le mal, mais le mal avec le
mal, et accepter le moindre mal.
On voit que si l'on doit faire des rserves sur quelques maximes
d'Hamilton, il y en a un bon nombre qui dnotent un esprit sagace,
avis, expriment, connaissant fond les rgles de la stratgie oratoire, rgles qui, dans la plupart des cas, si elles ne sont pas dpouilles de tout artifice, ne dpassent pas trop cependant le degr d'art et
d'habilet ncessaire ceux qui veulent persuader les hommes. Les
sophismes eux-mmes ne doivent pas tre ignors, si l'on veut apprendre les dmler et les djouer. ce sujet, j'ajouterai cette
analyse que je ne crois pas trop, quoi qu'on en ait dit, que les Sophismes parlementaires de Bentham soient une rfutation d'Hamilton.
Il n'y fait pas du tout allusion cet auteur, et l'objet des deux ouvrages
est trs diffrent. Hamilton ne s'occupe que de l'art de parler. Bentham
touche au fond des choses. Celui-ci combat des erreurs, ou des opinions qu'il juge telles ; l'autre enseigne l'art d'attaquer et de se dfendre dans la guerre de tribun. Quoi qu'il en soit de ce point secondaire, l'crit d'Hamilton est un piquant exemple du rapport de la politique avec la logique et la rhtorique.
Beaucoup d'autres considrations pourraient tre prsentes sur les
rapports de la philosophie et des diverses sciences. Mais nous avons
un trop vaste espace parcourir pour nous arrter plus longtemps sur
ces prliminaires.
Abordons maintenant le fond des choses.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
[303]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
Livre premier
LESPRIT
Retour la table des matires
[304]
281
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
282
[305]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE PREMIER
LESPRIT
Leon I
De la responsabilit philosophique,
propos du Disciple,
de M. Paul Bourget
Retour la table des matires
Messieurs,
Je ne sais si je me fais illusion, mais il me semble qu'il se produit
dans le monde cultiv et pensant je ne sais quelle lassitude des ides
subversives, nihilistes, ngatives, qui ont envahi la philosophie depuis
vingt ans. Il me semble que l'on commence sentir que ces ides,
pousses l'extrme, peuvent devenir dangereuses, et que, pour
qu'elles ne soient pas pousses l'extrme, il est bon qu'elles soient
corriges, tenues en chec par d'autres ides. On commence entrevoir les lacunes, les vides que laisse dans l'me la philosophie sceptique, matrialiste et athe. On en a quelque peu assez de cette philosophie aimable et brillante qui vous dit, en se jouant, que rien n'est
vrai et rien n'est faux ; que le Crateur s'est moqu de nous ; que, malgr tout, cependant, le monde est une comdie assez agrable, lorsqu'on a la chance d'tre bien plac pour en jouir. ct de ce faux
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
283
optimisme, on n'est pas loin non plus d'tre las de ce faux pessimisme
qui n'empche pas d'aller l'Opra et de jouir de toutes choses, et qui
mme, au contraire, nous pousse en jouir le plus vite possible, parce
que c'est autant de gagn sur l'ennemi ; et de ce positivisme terre
terre qui ne demande que des faits et encore des faits, [306] sans jamais rencontrer rien de semblable ce que l'on appelait autrefois des
principes ; et de ce physiologisme qui ne se reprsente un phnomne
intellectuel que sous la forme d'une cellule qui danse, et qui trouve
cela clair ! On est las aussi de cet athisme intolrant qui supprime le
nom de Dieu dans les Fables de La Fontaine ; et l'on a appris qu'il est
plus facile de se dbarrasser de l'ide de Dieu que de la superstition et
du fanatisme. Enfin, de mme qu'en politique on commence comprendre que le dveloppement de la dmocratie n'exige pas la destruction successive de toutes les forces conservatrices, de mme on entrevoit qu'en philosophie il pourrait se former de nouveaux groupes, de
nouvelles directions d'ides, lesquelles, en profitant de tous les progrs qu'a pu faire la science et la pense dans notre sicle, rtabliraient
cependant les principes fondamentaux de la mtaphysique et de la morale.
Nous croyons trouver un symptme de la lassitude dont nous parlons et l'indication d'un besoin nouveau d'esprit dans un livre rcent
qui a fait beaucoup de bruit et qui, tout en appartenant la littrature,
ne relve pas moins de la philosophie. C'est le livre d'un de nos plus
brillants romanciers, M. Paul Bourget. Il est connu de tous ceux qui
lisent. Il a pour titre : le Disciple, et il soulve une question philosophique de la plus haute gravit. Cette question est celle-ci : Les doctrines spculatives sont-elles indiffrentes et absolument innocentes ?
La thorie est-elle sans rapports avec la pratique ? Tel est le problme
que pose avec hardiesse et traite avec une singulire nergie l'auteur
du Disciple. Avant d'examiner cette question en elle-mme, disons
quelques mots du livre qui nous l'a suggre.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
284
I. Le roman.
Retour la table des matires
Le Disciple est un roman d'un intrt puissant, poignant, et qui,
dans la seconde partie surtout, devient vritablement tragique.
L'auteur, dans une belle prface, laisse entrevoir la pense qui l'a inspir. Il a devant lui le jeune homme de nos [307] jours, il veut son
bien, il veut son bonheur ; il lui voudrait un idal auquel peut-tre luimme n'avait pas jusqu'ici beaucoup pens ; mais, quoiqu'il se dfende
d'avoir crit sous le coup de certains vnements lamentables qui ont
profondment remu la conscience publique dans ces dernires annes, il est vraisemblable qu'il a subi lui-mme l'influence de ces vnements. Quoiqu'il en soit, il a devant les yeux deux types de jeunes
gens dont il voudrait dtourner la jeunesse actuelle, l'un et l'autre en
rapport avec certaines philosophies : l'un est le jeune positiviste,
l'autre le jeune critique ; l'un et l'autre reproduisent brutalement dans
la vie des formules abstraites qu'ils ont apprises l'cole. L'un, dit-il,
est cynique et jovial ; il a vingt ans, et toute sa religion tient dans ce
seul mot : Jouis ! Il n'a que lui-mme pour Dieu, pour principe et
pour fin. Il a emprunt la philosophie de ce temps la grande loi de la
concurrence vitale. Il n'estime que le succs, et, dans le succs, que
l'argent. L'autre est un nihiliste dlicat ; il a vingt-cinq ans ; il a
fait le tour de toutes les ides. Ne lui parlez pas d'impit, de matrialisme ; le mot de matire n'a pas de sens pour lui. Le bien et le mal, la
vertu et le vice, ne sont que des objets de pure circonstance. Rien n'est
vrai, rien n'est faux, rien n'est moral, rien n'est immoral. Sa corruption
est bien autrement profonde que celle du jouisseur barbare ; et le beau
nom de dilettantisme dont il la pare en dissimule la frocit. Si j'ai
crit ce livre, c'est pour montrer combien cet gosme-l peut cacher
de sclratesse.
En face de ces deux types misrables et monstrueux, l'auteur,
s'adressant toujours au jeune homme, lui prsente un autre idal : Ne
sois, dit-il, ni cynique ni jongleur d'ides. Attache-toi la branche du
salut. Il faut juger l'arbre par ses fruits. Exalte et cultive ces deux
nergies de l'me : l'amour et la volont. Puisque tu prouves qu'une
me est en toi, travaille ce que cette me ne meure pas en toi avant
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
285
toi-mme. Je te le jure, mon enfant, la France a besoin que tu penses
cela, et puisse ce livre t'aider le penser Fais-moi l'honneur de
croire que je n'ai pas spcul sur des drames qui ont [308] fait souffrir
et font souffrir trop de personnes. Que je voudrais qu'il n'y et jamais
eu dans la vie de personnages semblables, de prs ou de loin, au malheureux disciple qui donne son nom ce roman ! Mais, s'il n'y en
avait pas eu, s'il n'y en avait pas encore, je ne t'aurais pas dit ce que je
viens de le dire, jeune homme de mon pays, qui je voudrais tant
tre bienfaisant, par qui je souhaite si passionnment d'tre aim et de
le mriter !
Voil de bien belles paroles, sorties de l'me, et qui nous expliquent la pense du livre. videmment, l'auteur a t tristement frapp
des interprtations vraies ou fausses, des applications plus ou moins
consquentes auxquelles peuvent conduire dans la pratique de la vie
certaines doctrines philosophiques, qu'il connat bien, pour lesquelles
peut-tre a-t-il eu quelque faiblesse. Il se demande si ces doctrines
sont compltes ; il voudrait que cet ocan de l'inconnaissable qui enveloppe le domaine si troit du connu ne ft pas pour la jeunesse et
pour nous tous un abme noir et vide, et ceux qui le disent, il rpond
courageusement : Vous ne le savez pas.
Il n'y a donc pas se mprendre sur l'objet de cet ouvrage. Il veut
videmment faire entendre que les doctrines ne sont pas absolument
innocentes, qu'elles peuvent conduire de cruelles consquences, si
ces doctrines sont mal interprtes, mal comprises, et surtout lorsqu'elles favorisent elles-mmes ces mauvaises interprtations par leurs
ngations brutales ou par leurs ironies frivoles. Comment va-t-il prouver cette thse, si c'est une thse ?
Il nous met en prsence d'un philosophe qui a considr l'me humaine comme une machine laquelle on peut appliquer les procds
de la mcanique et de la biologie. Il a crit une Psychologie de Dieu
dans laquelle la production ncessaire de l'hypothse Dieu s'explique par le fonctionnement de quelques lois psychologiques rattaches elles-mmes quelques modifications crbrales ; il a publi
aussi une Thorie des passions, qui consiste dans un expos nouveau
et trs ingnieux des origines animales de la sensibilit humaine.
[309] Enfin, dans son Anatomie de la volont, il enseigne que l'avenir
tient dans le prsent, comme les proprits du triangle dans sa dfinition ; et si nous connaissions la position relative de tous les phno-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
286
mnes, nous pourrions prdire, avec une certitude gale celle des
astronomes, le moment o tel criminel assassinera son pre. Ce philosophe reprsente donc lui seul toute la substance de la philosophie
moderne (phnomnisme, physiologisme, volutionnisme, etc.), avec
cette diffrence qu'allant plus loin que le philosophe Herbert Spencer,
il s'applique dmontrer que l'inconnaissable n'existe pas, qu'il n'y a
rien, absolument rien en dehors du monde, rien au-dessus de la
science positive, rien au del des phnomnes et de leurs lois.
Ce philosophe si hardi est un enfant dans la vie. Il se tient loin du
monde et de ses sductions ; il ignore l'ambition, l'argent, l'amour ; il
ne sait rien des affaires de la ralit ; il vit comme un moine et
presque comme un saint dans les environs du Jardin des Plantes. Ce
type de philosophe, dont nous reconnaissons au moins quelques portions chez certains penseurs de ce temps, quoiqu'il ne soit pris tout
entier sur aucun en particulier, est dessin avec beaucoup de finesse et
de relief. Cependant au sein de cette vie paisible et solitaire vient un
jour clater tout coup un vnement terrible et absolument imprvu.
Un des disciples du philosophe, son disciple le plus cher et le plus fidle, attach d'me ses doctrines, les ayant comprises et se les tant
assimiles comme pas un, vient d'tre arrt et emprisonn, accus
d'assassinat sur une jeune fille chez les parents de laquelle il vivait
comme prcepteur. Qu'tait-il arriv ?
Nous n'avons pas faire l'analyse du roman, mais en deux mots
nous devons en dire le sujet, pour apprcier les lments de solution
qu'il apporte au problme philosophique que nous tudions. Donc le
jeune homme est prcepteur dans une famille noble. Il y a l une jeune
fille, dont il complote la sduction. Nous ne connaissons cette jeune
fille, Charlotte de Jussat, que par le rcit de notre hros ; mais ce portrait [310] de profil, plein de grce et de puret, est d'un puissant effet
par contraste avec l'me noire de son cruel sducteur. Il la trompe
donc par un feint amour, ou plutt, dupe de sa propre ruse, il est tromp lui-mme par la comdie qu'il joue ; et il s'aperoit bientt qu'il
l'aime vritablement. Il la trompe encore par la menace d'un suicide ;
il la possde par la promesse d'un suicide commun ; mais une fois la
faute consomme, il se ravise, il trouve que la mort est bien dure ; il
propose sa victime de vivre pour jouir ; mais celle-ci est une me
noble et fire qui ne peut consentir de vivre avec la honte : c'est ellemme qui s'empoisonne sans dire son secret, si ce n'est son frre,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
287
auquel elle raconte par crit toute son histoire. Le jeune homme est
arrt comme coupable, sans l'tre vritablement, du moins de la manire que l'on pense ; mais il l'est plus gravement peut-tre : car c'est
lui qui, par le mensonge, a tromp et entran la malheureuse ; c'est lui
qui lui a promis la mort, et qui s'tait engag mourir avec elle ; et sa
propre lchet ne le justifie pas de la complicit. Puis la vrit se dcouvre ; il est dclar innocent ; mais il n'en est pas moins puni : le
frre de la victime lui brle la cervelle ; et la seule preuve de dignit
morale qu'il donne dans toute cette histoire, c'est de se laisser tuer
tranquillement et sans rsistance.
Le philosophe, auquel le jeune homme a envoy toute sa confession, en est troubl jusqu'au plus profond de l'me. Serait-il pour
quelque chose dans cette horrible histoire ? Il accourt pour lui donner
ses dernires consolations, mais il ne le trouve que mort. La dernire
page du roman qui nous peint son attitude en cette circonstance est
d'une grande beaut : Dans la nuit qui suivit cette scne tragique,
nous dit l'auteur, certes les admirateurs de la Psychologie de Dieu, de
la Thorie des passions, de l'Anatomie de la volont, eussent t bien
tonns s'ils avaient pu voir ce qui se passait dans la chambre n 3 de
l'htel du Commerce, et lire dans la pense de leur implacable et puissant matre. Au pied du lit, o reposait un mort, le front band, se tenait [311] agenouille la mre de Robert Greslou. Le grand ngateur,
assis sur une chaise, regardait tour tour cette femme prier, et le mort
qui avait t son disciple dormir du sommeil dont dormait aussi Charlotte de Jussat ; et pour la premire fois, sentant sa pense impuissante
le soutenir, cet analyste presque inhumain force de logique s'humiliait et s'inclinait, s'abmait devant le mystre impntrable de la destine. Les mots de la seule oraison qu'il se rappelait de sa lointaine enfance : Notre Pre qui tes aux cieux, lui revenaient au cur.
Certes, il ne les prononait pas. Peut-tre ne les prononcera-t-il jamais. Mais s'il existe, ce Pre cleste vers lequel grands et petits se
tournent aux heures affreuses, comme vers le seul recours, n'est-ce pas
la plus touchante des prires que ce besoin de prier ? Et si ce Pre cleste n'existait pas, aurions-nous cette faim et cette soif de lui dans ces
heures-l ? Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouv !
cette minute mme, et grce cette lucidit de pense qui accompagne le savant dans toutes les crises, Adrien Sixte se rappela cette
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
288
phrase admirable de Pascal dans le Mystre de Jsus : Et quand la
mre se releva, elle put le voir qui pleurait !
Laissons maintenant de ct le drame ; examinons le roman au
point de vue philosophique, et demandons-nous ce qu'il prouve, en
supposant qu'un roman doive prouver quelque chose. Le philosophe
Sixte est-il solidaire, est-il responsable en quelque chose du crime de
Robert Greslou ?
Deux facteurs, pour employer la langue scientifique, si propos en
cette circonstance, entrent ici dans la composition des causes qui conduisent au crime final : le caractre du hros et la nature de sa philosophie. Les conditions du roman exigeaient, en effet, que le hros et
un caractre, et, de plus, un caractre individuel comme nous les aimons aujourd'hui ; car on ne se satisfait plus de types purement abstraits. Mais alors quelle part faut-il faire au caractre, quelle part la
doctrine dans la suite des vnements que le drame va nous drouler ?
L'auteur nous prsente un personnage bizarre, [312] sombre, intrieur,
solitaire, atteint d'une sorte de maladie mentale qui consiste se ddoubler lui-mme, se voir vivre comme un tranger : Il y a toujours eu en moi, dit-il, comme deux personnages distincts, un qui allait, venait, agissait, sentait, et un autre qui regardait le premier avec
une impassible curiosit. Il avait l'instinct du mensonge : Il m'est
arriv souvent, dit-il, de raconter mes camarades toute sorte de dtails inexacts sur moi-mme, sur l'endroit de naissance de mon pre, et
cela non pour me vanter, mais pour tre un autre. J'ai got plus tard
des volupts singulires taler les opinions les plus opposes celles
que je considrais comme la vrit, pour le mme bizarre motif. Jouer
un rle ct de ma vraie nature m'apparaissait comme un enrichissement de ma personne. Un autre trait de ce caractre tait une absence complte de sympathie pour les autres ; au rebours de la parole
du Christ, il nous dit qu'il n'avait pas de prochain et qu'il avait exaspr la nature propre de son me pour en faire un exemplaire sans
analogue. En mme temps, la lecture des romans et des posies les
plus effrns bouleversait sa conscience morale. C'taient la Peau de
chagrin, les Fleurs du mal, Rolla, les romans de Stendhal : Toutes
les vertus qu'on m'avait prches durant mon enfance s'appauvrirent
ct des splendeurs de l'opulence, de la frnsie de certaines fautes
Je n'tais pas capable de critiquer la fausset romanesque de tout ce
dcor et de faire le dpart entre les portions sincres et les portions
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
289
littraires de ces pomes. Les profondeurs sclrates de l'me rapparaissaient travers les lignes.
Voil un caractre bien trange, bien particulier, bien antipathique ; et l'on a le droit de se demander si de tels traits de caractre
devaient laisser grand'chose faire aux doctrines thoriques, pour
produire un tre malfaisant et l'entraner aux actions les plus coupables. L'auteur s'est videmment complu dans la peinture de ce caractre, qui n'est pas sans analogie avec le Julien Sorel de Stendhal
dans le Rouge et le Noir. Ce sont l les sentiments complexes et pervers d'un [313] demi-alin plutt que ceux de la nature humaine en
gnral. De temps en temps cependant, le souvenir de la thse philosophique revient sous la plume du romancier. Le hros, qui raconte
lui-mme son histoire, rappelle les influences qui ont agi sur lui, par
exemple celle du scepticisme sentimental de l'auteur de la Vie de Jsus, qu'il ne craint pas de nommer, puis celle du mcanisme mathmatique de son vritable matre, le philosophe Sixte, qui lui a dmontr
avec une dialectique irrsistible que toute hypothse sur la cause premire est un non-sens. Il a appris cette cole voir l'univers tel
qu'il est, panchant sans commencement et sans but le flot inpuisable
de ses phnomnes ; mais cet appel aux doctrines philosophiques
semble un peu juxtapos dans l'ouvrage, et ne revient de loin en loin
que par acquit de conscience et pour le besoin de la cause. On se demande si, toutes ces allusions philosophiques venant disparatre, le
cours du roman en serait bien chang et si les vnements n'auraient
pas march dans le mme sens, comme dans le Rouge et le Noir de
Stendhal, o le hros va au crime par sa perversit propre, et non sous
l'influence d'un systme de philosophie. Et ces doctrines elles-mmes,
pourrait-on dire, sont-elles bien responsables du mal qu'elles ont fait ?
N'est-ce pas lui-mme qui y a introduit le poison qu'il en a tir ? Y a-til jamais eu une doctrine philosophique, ft-ce celle de Lucrce et de
La Mettrie, qui ait inspir un jeune homme la conception sclrate et
machiavlique de sduire une jeune fille dans la maison de laquelle il
a reu l'hospitalit, uniquement pour se venger de quelque piqre
d'amour-propre ? Un tel acte ne suppose-t-il pas une mchancet inne
qu'aucun systme de philosophie n'est capable de produire par luimme ? On ne voit donc pas trs clairement, dans le roman du Disciple, comment les mauvaises doctrines peuvent pousser aux mauvaises actions. Tout au plus pourrait-on dire que l'abus de l'anatomie
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
290
psychologique applique dans la science a pu contribuer exasprer
chez ce cur malade l'abus naturel de l'analyse intrieure. Mais on
peut rpondre que la mthode [314] abstraite de la science n'est pas
faite pour la vie, et de ce qu'une nature dbile et dprave abuse d'un
instrument dont elle ne sait pas se servir, faut-il condamner celui qui a
invent cet instrument ? Assurment, comme dit le philosophique
Sixte lui-mme, c'est comme si on reprochait au chimiste qui a invent la dynamite les attentats auxquels cette substance est employe . C'est aussi, pourrions-nous dire, comme si on reprochait aux
conomistes l'emploi de la mthode statistique, laquelle, applique
la vie pratique, dtruirait tout lan du cur : ce n'est pas la faute de la
mthode, mais de la sottise qui ne la comprend pas.
Pour dmontrer la thse philosophique, il nous semble qu'il et fallu choisir un cas o un seul facteur (sans parler de la libert) put tre
signal comme la cause dterminante du crime, et que ce fut prcisment la doctrine et non le caractre. Pourrait-on faire un roman dans
ces conditions ? Nous n'en savons rien ; mais au point de vue de la
question pose, voici comment nous nous reprsentons les choses.
Imaginons un jeune homme, plus ou moins semblable tous les
autres, n avec un bon naturel, ayant conserv jusque-l les croyances
du cur et les lumires instinctives de la conscience morale ; au lieu
de Robert Greslou, supposez, si vous voulez, un hros de Feuillet, le
hros du Roman d'un jeune homme pauvre. Il entre dans une famille
noble, o se trouve une jeune fille ; il ne forme pas tout d'abord le projet sclrat de la sduire : il aurait horreur de cette pense, si elle lui
venait. Mais peu peu un sentiment, d'abord inaperu, s'empare de
lui, s'chauffe, devient de plus en plus fort, mesure qu'il s'aperoit et
devine qu'il a pour complice innocent le cur de la jeune fille. Bref,
pour abrger cette analyse trop banale, mais par l mme plus vraie,
plus proche de la ralit commune, arrivons au moment o le sentiment devient passion de part et d'autre, et o le combat s'engage entre
la passion et le devoir. L'honneur, la dlicatesse, imposent au jeune
homme l'obligation absolue de vaincre et de contenir la passion, ft-ce
par la fuite. Il est l'hte de la [315] maison ; et la confiance naturelle
de l'hospitalit impose des devoirs aussi bien pour l'me que pour les
choses extrieures. Le mme sentiment qui interdit de prendre un objet dans une armoire ouverte, et qui imprime au vol domestique un
caractre de gravit particulier, permet encore moins de prendre un
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
291
cur et une destine. De plus, il y a l des diffrences de naissance et
de fortune qu'une me noble doit respecter. Abuser de l'entranement
facile de la jeunesse, sortant peine de l'enfance, pour enlever une
jeune fille d'abord l'honneur, puis tous les avantages de son rang, rpugne une conscience dlicate. Il y a donc l un devoir sacr. C'est
dans cette situation psychologique que nous nous demandons si le
choix d'une doctrine philosophique est absolument indiffrent. Supposez que le jeune homme ait reu et conserv avec conviction une doctrine qui soit d'accord avec sa conscience, qui lui reprsente la vie
comme ayant un but, la diffrence du bien et du mal comme essentielle et fondamentale, les lois de l'honneur comme d'accord avec les
lois gnrales de l'univers, et la simplicit lumineuse d'une action
droite comme sanctionne et fortifie par la pense d'une sagesse souveraine et d'une absolue justice. Sans doute, personne ne peut dire que
l'appoint d'une telle doctrine fera ncessairement pencher la balance
du ct du bien, puisque l'homme est libre ; mais, en tout cas, ce qu'on
ne peut nier, c'est que cette doctrine sera un appui pour la cause de la
conscience morale naturelle, puisqu'elle n'est autre chose que l'expression mme de celle conscience. Supposons maintenant, au contraire,
que le jeune homme, dont la conscience jusque-l est reste pure et
dlicate, se soit en mme temps livr l'tude de la philosophie spculative, et qu'il ait t sduit par les opinions du philosophe Sixte ; pendant tout le temps qu'a continu l'innocence du jeune homme, tant
qu'il ne s'est pas trouv en face de la bataille de la vie et du problme,
tant qu'il n'y a pas eu de crise relle, il n'y a pas eu conflit entre
l'homme et le savant. Les bons sentiments et les croyances honntes
ont persist d'un ct, tandis que [316] les tmrits philosophiques se
dveloppaient de l'autre. Mais enfin vient le moment de la crise et du
combat : le bien d'un ct, le mal de l'autre, et pour toute arme une
conscience d'habitude. Serait-il alors indiffrent qu'il ait choisi telle
philosophie plutt que telle autre ? Serait-il arm contre une voix qui
lui crierait du fond de lui-mme : Il n'y a ni vice ni vertu : ce sont les
produits du cerveau ; il n'y a ni bien ni mal : ce sont des accidents fortuits, relatifs la socit humaine, mais n'ayant aucune valeur dans la
nature des choses. Bien plus, si, par impossible, un homme venait
suspendre son crime au moment o il va le commettre, il violerait les
lois de la substance universelle et de la nature divine au profit de
l'idal troit d'une portion infiniment mprisable de l'ensemble des
tres, c'est--dire dans l'intrt exclusif de l'humanit. Du reste, une
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
292
telle suspension des lois de la nature est impossible. Il n'y a point de
libert ; et sache que, de quelle manire que tu te rsoudras, cette dcision aura t invitable. D'ailleurs, la morale elle-mme n'est qu'une
chose factice ; ce que tu appelles honneur n'est que le rsultat d'une
longue laboration historique ; et ce qui le prouve, c'est que cet honneur varie suivant les temps : un sauvage met son honneur scalper
des chevelures ; et, quant au cas qui t'occupe, la puret d'une femme
est un fait absolument indiffrent aux races sauvages. Je me demande si cette analyse dissolvante des principes de la vie et de la socit n'aura aucune action sur la conscience et sur le cur ; si dans la
lutte du devoir et de la passion la volont humaine sera aussi bien arme qu'auparavant. Tel est le problme philosophique que soulve le
roman du Disciple ; et quoique l'on puisse penser que, dans les conditions un peu compliques o il a plac la scne, l'auteur, a pu donner
barre sur lui, et que la solution n'y est pas claire, il reste cependant
se demander si, en simplifiant le problme, en le rduisant ses lments essentiels, on ne mettrait pas en pleine lumire ce que Kant a
appel le conflit de la raison spculative et de la raison pratique. [317]
C'est ce problme que nous avons maintenant tudier en lui-mme,
en dehors de toute invention romanesque et au point de vue de la pure
philosophie.
II. Le problme.
Retour la table des matires
Faut-il rendre un systme de philosophie solidaire de telles ou
telles consquences qui peuvent se produire dans la vie relle ? C'est
ce que j'appelle la responsabilit philosophique. Une telle responsabilit existe-t-elle ? Les philosophes doivent-ils se considrer comme de
purs savants travaillant sur une matire inerte dont les tals, quels
qu'ils soient, sont toujours indiffrents, ou ne doivent-ils pas toujours
avoir devant les yeux qu'ils ont affaire des tres vivants, des mes,
des personnes qui ont elles-mmes leur responsabilit ? Si ces personnes tirent de leurs principes des consquences fcheuses, le philosophe a-t-il le droit de s'en laver les mains et de dire : Cela ne me
regarde pas ?
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
293
ceux qui soutiennent l'existence d'une telle responsabilit, on a
rpondu par deux objections : la premire, c'est que les ides abstraites
et spculatives n'ont aucun rapport l'action : toutes les doctrines
peuvent se rencontrer avec toutes les actions. La seconde, c'est qu'en
admettant cette thse de la responsabilit philosophique, on rtablirait
une orthodoxie, un credo, contraire tous les principes de la libert
scientifique, et que l'esprit de recherche et de dcouverte en philosophie en serait paralys du coup.
Examinons ces deux propositions. Et, d'abord, on s'tonne de voir
soutenir la thse de l'inefficacit pratique des ides dans une cole de
philosophie qui a singulirement contribu tablir et dmontrer
qu'aucune ide n'est absolument inerte et qu'elle tend toujours se traduire en mouvement. C'est en effet une des propositions les plus certaines de la nouvelle psychologie qu'une ide n'est pas autre chose que
la reproduction interne des mouvements qui ont accompagn la premire apparition de cette ide dans la conscience. [318] Au moins en
est-il ainsi pour les ides qui reprsentent une action. L'ide d'un chant
musical consiste le chanter intrieurement ; l'ide des mots et du
langage est un commencement de parole en dedans ; l'animal qui se
reprsente sa proie tend reproduire tous les mouvements qui accompagnent la prhension et le dchirement de la proie. Il est donc permis
de dire qu'aucune philosophie n'est moins autorise que la philosophie
nouvelle (phnomnisme, associationnisme, psychophysique)
rompre le lien qui unit l'ide au fait. Sans doute, il y a plus ou moins
d'intervalle entre l'ide et l'action, et il faut du temps pour que se produisent peu peu des habitudes qui de la notion abstraite nous fassent
passer l'action concrte ; mais, si loigne que l'ide soit de la ralit, elle a en elle-mme une tendance se produire dans cette ralit
mme, et, tt ou tard, s'il y a un vritable lien logique entre la thorie
et la pratique, on peut affirmer que la pratique viendra confirmer la
thorie.
Sans doute, si nous nous plaons dans la conscience du philosophe
pur, on n'y trouvera rien, absolument rien de semblable la tentation
de telle ou telle action qui pourrait tre contenue plus ou moins logiquement dans ses principes, et c'est le sentiment de son innocence
cet gard qui rend ce philosophe si sceptique et si indiffrent l'imputation d'une prtendue responsabilit. Mais cette innocence est trs
facile expliquer. Ce que le philosophe aime dans ses penses, ce
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
294
n'est pas la matire, c'est la forme. Je m'explique. Le philosophe qui
enseignera, par exemple, que le plaisir et mme la volupt est la seule
fin de la vie, est peut-tre lui-mme trs indiffrent cette volupt.
Son plaisir lui, sa volupt, c'est d'avoir dit cela, c'est d'avoir trouv
une proposition gnrale dont il croit pouvoir tout dduire. Celui qui a
dit : Homo homini lupus est peut-tre le meilleur des hommes, un
bourru bienfaisant, un ami excellent ; mais il jouit d'avoir trouv une
formule audacieuse, d'o il tirera les plus belles consquences. Pour
lui, comme l'a dit Spinoza, les passions ne sont que des lignes et des
figures, comme en gomtrie ; [319] et, parce qu'il sait qu'invitablement la haine engendrera le meurtre et la mort, il n'est pas plus dispos tuer pour cela que ne l'est le physicien se servir d'un poignard,
parce qu'il sait que la pointe de ce poignard, dirige suivant les lois de
la mcanique, portera infailliblement la mort. Ainsi chez l'inventeur
d'un systme ou mme chez ses disciples qui, sans avoir le don de
l'invention et du gnie, ont comme lui l'habitude et le got des choses
abstraites, nul passage de la formule l'action. Le plaisir des ides
absorbe leur esprit et le ferme l'invasion et la tyrannie des passions.
Mais ce serait se satisfaire trop bon compte et se borner une
considration bien superficielle des choses que de conclure de l'innocence des hommes l'innocence des ides. Les ides, en effet, ne restent pas longtemps sous leur forme abstraite et spculative ; elles se
traduisent vite en axiomes, en proverbes, en propositions positives,
qui, peu peu dgages de l'chafaudage scientifique, descendent de
la conscience des philosophes dans la conscience du vulgaire. On fait
valoir les hautes difficults de la science mtaphysique pour conclure
que, du haut des sphres sereines o habite la sagesse, selon Lucrce,
elle ne peut atteindre la vie relle. Mais si la construction systmatique d'une philosophie demande, pour tre comprise, de profondes
tudes, il n'en est pas de mme des conclusions. Ces conclusions, sous
leur forme la plus simple, sont la porte de tous les esprits. On a
beaucoup invoqu contre le spiritualisme son accord avec le sens
commun comme une preuve qu'il n'aurait pas de valeur spculative.
Mais le sens commun n'a pas plus de peine a tre matrialiste qu' tre
spiritualiste, athe que croyant, sceptique que dogmatique. Est-il bien
difficile de faire comprendre aux hommes que la vie est mauvaise,
qu'elle n'a pas de but, que les dieux ne s'occupent pas des affaires hu-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
295
maines ? Est-il bien difficile de leur faire comprendre que nous ne
pouvons connatre que ce qui tombe sous nos sens, qu'au-dessus du
inonde sensible il n'y a rien ? Trouverons-nous une grande rsistance
dans la nature humaine lui faire admettre qu'il [320] n'y a pas de libert, et que chacun est fatalement entran par ses passions, par son
temprament et par son milieu ? Est-ce une loi bien difficile faire
pntrer dans l'esprit que celle de la lutte pour la vie et de l'crasement
des faibles par les forts ? Les hommes sont-ils trs disposs rsister
celui qui leur dira que le devoir est une ide vague et asctique, qui
doit tre remplace par celle d'utilit ? Lors donc que la philosophie
purement abstraite sort de la sphre de l'cole, elle se traduit, pour la
plupart des hommes, en propositions simples et familires, d'une clart parfaite, et sont aptes se transformer immdiatement en actions.
La philosophie pessimiste tend produire le suicide ; la philosophie
utilitaire tend se tourner en gosme et en amour de ce qui reprsente
toutes les utilits, l'argent ; la philosophie empirique tend loigner de
tout idal ; la philosophie dterministe tend au relchement de la force
morale, dj si faible par elle-mme ; la philosophie sceptique tend
l'indiffrence en toutes choses. Chez les penseurs, ces consquences
restent l'tat de virtualits abstraites ; mais le vulgaire ne se compose
pas de philosophes abstraits ; il se compose d'hommes ayant avant
tout l'instinct et le besoin de vivre : ce ne sera donc pas le ct logique, la forme pure et spculative de la doctrine qui les sduira ; ce
que le vulgaire cherche dans les propositions finales de chaque systme, ce sont des rgles pour la vie, des directions positives, un credo
quotidien. Bien loin de dire que les hommes n'agissent pas d'aprs des
ides, il faut dire au contraire qu'ils n'agissent que d'aprs des ides ;
et si on quivoque en disant que les vrais moteurs de l'action sont des
sentiments et non pas des ides, nous rpondons que ce sont nos ides
qui se tournent en sentiments ; ou encore que ce sont nos naturels instincts, et souvent les moins bons, qui se traduisent en ides et qui s'y
fortifient en y trouvant leur justification. C'est un besoin invincible de
la nature humaine de penser la vie, de la rendre rationnelle, de la gouverner d'aprs des principes. Chez le dernier des hommes, il y a une
philosophie grossire par laquelle il justifie sa vie. [321] Rien n'est
donc moins innocent que la pense, et c'est un manque de philosophie
que de ne pas le voir.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
296
Mais est-il bien vrai que toutes ces doctrines, appeles mauvaises
doctrines, j'entends le phnomnisme, le positivisme, le scepticisme,
le physiologisme, etc., est-il bien vrai que ces systmes contiennent
les consquences prtendues immorales qu'on leur impute ? Je rpondrai d'abord que je ne crois pas devoir appeler ces doctrines mauvaises, parce que ce serait prjuger ce qui est en question ; en second
lieu, parce qu'il n'y a de mauvais que ce qui est fait dans l'intention de
nuire, et que je n'hsite pas dclarer que les philosophes qui ont introduit ces doctrines n'ont obi qu' l'amour de la vrit ; en troisime
lieu enfin, parce que ces doctrines sont elles-mmes un lment trs
utile et trs ncessaire de la pense et qu'elles reprsentent une partie
de la nature des choses ; elles ne seraient donc mauvaises que par leur
exagration. Quant aux consquences, ce sera la discussion mme
du problme nous apprendre si elles sont, oui ou non, contenues
dans le principe. Contentons-nous d'enregistrer l'aveu d'un des esprits
les plus courageux parmi ceux qui ont admis les principes semblables
ceux du philosophe Sixte, M. Edmond Schrer, que nous avons perdu rcemment. Pour ce philosophe clairvoyant et perant, la consquence invitable du naturalisme moderne, c'est la destruction de la
morale. Voici comment il s'exprime : Ce serait faire injure au lecteur
que de prendre la peine de lui signaler les consquences d'une pareille
manire d'envisager l'homme et son activit, si, comme elle a tout l'air
d'en prendre le chemin, elle parvenait s'tablir dans les esprits. On
ne peut se figurer une rvolution plus complte des notions qui passaient jusqu'ici pour lmentaires. La conscience humaine en serait
altre dans son fond, mme dans son principe. L'homme moral, l'tre
responsable, aurait disparu pour faire place un produit de la nature Il
ne serait plus ce qu'il doit, mais ce qu'il peut. Il n'agirait plus, il se regarderait agir. Il ne voudrait plus, il se verrait vouloir. La personnalit
[322] s'vanouit, elle n'a plus que la valeur d'une impression. L'entit
humaine, le moi volontaire, l'ego a disparu. La vie ressemble une
flamme qui se saurait lumineuse ; mais on souffle la bougie : o donc
est la flamme ? Voil les consquences du phnomnisme, du dterminisme. Quant au scepticisme sentimental et ironique de l'illustre
auteur de la Vie de Jsus, M. Schrer s'exprime avec une svrit et
une duret que nous n'oserions pas employer pour notre compte : Et
cependant, dit-il, avec le phnomnisme mme il y a encore moyen de
s'entendre L'homme sur lequel l'ide du devoir, de l'obligation morale, de la conscience, a le moins de prise, c'est celui qui lient le
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
297
monde pour une ample comdie cent actes divers C'est celui-l
plus qu'aucun autre qui me semble impermable l'ide morale. Que
lui parlez-vous d'obligation et d'effort, de pch et de conversion ? Ce
qui vous parait, vous, les choses les plus profondes de l'me, les intrts suprieurs de l'humanit, ne sont pour lui que le ragot d'un
plaisir : n'insistez pas, de grce : la bonne humeur est sa grande affaire
en ce monde, et vous finiriez par troubler sa bonne humeur. Le pntrant philosophe termine ainsi : Sachons voir les choses comme
elles sont. La morale, la vraie, l'ancienne, l'imprative, a besoin de
l'absolu ; elle aspire la transcendance, elle ne trouve son point d'appui qu'en Dieu. La conscience est comme le cur. Il lui faut un au del. Le devoir n'est rien s'il n'est sublime, et la vie devient chose frivole
si elle n'implique des relations ternelles. Celui qui parle ainsi est-il
un athe converti qui veut nous rvolter contre les doctrines qu'il analyse ? Au contraire, il les adopte dans toute leur tendue, dans toute
leur force ; seulement il en voit clairement et il en tale hardiment
toutes les consquences : Je vois aujourd'hui disparatre une grande
partie de ce que l'humanit tenait jadis pour des titres de noblesse ; ce
mouvement me parat invitable ; les tentatives faites pour l'arrter me
semblent vaines ; mais la fatalit avec laquelle il s'accomplit ne fait
pas que j'en prouve plus de satisfaction On croit trop facilement
que tout changement [323] est une amlioration ; on confond l'volution et le progrs : mais le dclin, la snilit, la mort mme, c'est encore de l'volution.
On voit quel point le problme est grave et terrible. M. Schrer
ne se le dissimule pas : il n'lude pas la question par des faux-fuyants ;
il va droit au but. Il le dit en propres termes : c'est bien de l'existence
mme de la morale qu'il s'agit ; il accepte la consquence, mais en
gmissant et avec une sorte de dsespoir. Et-il accept les mmes
consquences s'il les et vues se produire sous ses yeux dans un drame
rel tel que nous le peint l'auteur du Disciple ? Nous en doutons. Il est
encore facile de consentir thoriquement et littrairement des consquences odieuses : il est difficile de les avoir rellement dans sa conscience. Aprs tout, nous n'avons pas affaire ici ceux qui iraient jusqu' nier la morale elle-mme ; ce n'est pas l'objet de notre recherche.
Nous parlons seulement ceux qui, acceptant dans la pratique la ncessit d'une morale, croient cependant que l'on peut tout penser sans
inconvnient. Nous ne le croyons pas. On doit, comme nous dit
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
298
l'auteur du Disciple, juger l'arbre par les fruits . En un mot, la valeur morale d'une doctrine est, selon nous, un signe de vrit.
C'est ici que se prsente la seconde objection. Que devient la libert philosophique dans cette hypothse ? Si les doctrines doivent tre
juges d'aprs leurs consquences pratiques, ces consquences deviennent par l mme une barrire qu'il est interdit de franchir. N'estce pas l une atteinte au droit d'examen ? N'est-ce pas le retour
l'intolrance ? L'intolrance morale vaut-elle mieux, est-elle plus lgitime que l'intolrance religieuse ? Et o vous arrterez-vous dans cette
voie ? Si vous tablissez, par exemple, que le disme est ncessaire
la morale, ne rencontrerez-vous pas, votre tour, d'autres personnes
qui vous diront du disme ce que vous dites de l'athisme et du matrialisme, savoir qu'un disme abstrait est absolument impuissant ? Il
faut aller jusqu'au Dieu vivant, et bientt la philosophie tout entire
retombera [324] sous le joug de la thologie. Voyez dans quel abme
de questions nous sommes entrans. Nous ne pouvons pas les traiter
toutes. Laissons donc, quant prsent, l'objection tire de la thologie.
Peut-tre la rencontrerons-nous quelque jour, et elle mrite d'tre traite part. Il vaut mieux n'en pas parler que d'en mal parler. Bornonsnous au point de vue purement philosophique.
Est-il vrai que la doctrine qui juge de la mtaphysique par la morale soit contraire la libert de l'esprit ? Nous ne le pensons pas.
Nous affirmons, quant nous, le principe de la libert absolue de la
science, et de la philosophie en tant que science. Le principe suprme
en philosophie, la loi et les prophtes, peut se rsumer dans cette
maxime de Descartes : Ne recevoir aucune chose pour vraie qu'elle
ne me paraisse videmment tre telle. Je ne crois pas qu'on ait le
droit de demander un philosophe autre chose que cela ; s'il pense
clairement et distinctement qu'il n'y a pas de diffrence entre le vice et
la vertu, il a le droit de le penser et de le dire, sauf les rserves exiges
par la prudence et dont nous ne parlons pas ici. On voit que nous
n'imposons par avance aucun credo, aucune orthodoxie.
Maintenant, est-ce porter atteinte la libert scientifique que de signaler certains faits et d'en demander l'explication ? Ces faits, fussentils illusoires, ont droit tre expliqus, au moins titre d'illusions.
C'est ainsi que font les astronomes, qui, tout en nous enseignant les
vrais mouvements du monde, nous expliquent en mme temps les
mouvements apparents. Serait-on tax d'intolrance parce qu'on refu-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
299
serait d'accepter une doctrine astronomique qui se montrerait impuissante expliquer le mouvement apparent du soleil ? Qu'est-ce que juger une doctrine philosophique sur sa morale ? C'est mettre une hypothse philosophique ou scientifique en prsence de certains faits qui,
titre de faits, ont la mme autorit que les autres. Le fait moral parat
jusqu'ici un fait sui generis, irrductible, que l'on ne peut dcomposer
sans le dtruire. Or ce fait moral est un fait que l'inventeur mme
[325] d'un systme ne peut rcuser, car il l'prouve en lui-mme au
moment o il parle. Dites-lui, en effet, qu'il n'est pas sincre, qu'il est
un charlatan, qu'il pose pour le bruit et le scandale ; dites cela un
Spinoza, un Littr, il prouvera une indignation vritable, tout philosophe qu'il est, semblable celle qu'prouve un brave ouvrier qu'on
accuserait tort d'avoir vol. D'o vient ce sentiment de colre qu'il
prouvera celle accusation de dloyaut ? Ce devrait tre l, selon sa
doctrine, une imputation purile : car qu'importe dans le systme des
choses qu'un petit atome, appel philosophe, dise blanc ou noir ? Eh
bien ! non ; ce philosophe, si sceptique qu'il soit, croira que sa parole a
une valeur absolue, et que, fut-il menac de la chute de l'univers entier, il doit dire ce qu'il pense et rien que ce qu'il pense. Il y a donc en
lui, comme chez les autres hommes, un fait moral irrductible. Ce
n'est lui imposer aucun joug dshonorant que de l'inviter se mettre
en prsence de ce fait. Sans doute, de loin il pourra traiter lgrement
les devoirs des autres hommes ; mais lorsqu'il s'agira du sien propre,
du devoir philosophique par excellence, il sera tenu d'en reconnatre
l'implacable autorit. Il y aura donc en lui quelque chose qui chappera sa doctrine.
On admet gnralement de nos jours, sur l'autorit dliant, une
sorte d'antinomie ncessaire entre la science et la morale ; et quelquesuns croient que la philosophie exige que l'on prenne parti pour la
science, en laissant la morale se tirer d'affaire comme elle pourra.
C'est l une grande illusion. Comment ces philosophes ne voient-ils
pas que ce culte de la science, tel qu'on l'a aujourd'hui, cet amour dsintress de la vrit pour elle-mme, cette recherche de l'indpendance de la pense, que tous ces principes de la dcouverte scientifique font eux-mmes partie de l'ordre moral et n'ont de valeur que
dans l'hypothse d'un ordre moral ? Supposez, en effet, qu'il n'y ait pas
d'ordre intelligible suprieur l'ordre sensible, qu'il n'y ait pas une
vrit belle et dsirable par elle-mme ; une pense qui, par son es-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
300
sence, soit inviolable et digne de respect : pour quelle raison ne traiterai-je pas la [326] science comme on traite la religion et la morale,
savoir comme une illusion et une vanit fragiles ? En quoi le plaisir de
savoir est-il suprieur celui de manger ou de boire ou toute autre
volupt ? Pourquoi employer son esprit la recherche des vrits caches plutt qu' gagner de l'argent, afin de jouir de tous les plaisirs ?
Sans doute, dans cette hypothse, la science conserverait encore sa
valeur utilitaire : on la cultiverait pour s'enrichir en enrichissant les
autres. Mais est-ce bien l ce que nos philosophes appellent la
science ? Son objet n'est-il pas de connatre pour connatre, et, selon la
belle pense d'Aristote, n'est-ce pas son inutilit mme qui fait sa
beaut ? C'est ce titre que la science est sur de l'art, de la religion
et de la vertu. Elle ne vaut qu'autant que valent ces choses mmes,
savoir comme le culte de ce qui nous est suprieur, de ce qui rpond
au meilleur de notre me, de ce qui nous apprend prfrer quelque
chose nous-mmes. Le spirituel philosophe qui nous a donn rcemment son Examen de conscience, M. Renan, met hautement la
science au-dessus de la moralit : Il n'y aurait aucune raison, dit-il,
de s'intresser un globe vou l'ignorance. Nous aimons l'humanit
parce qu'elle produit la science. Nous tenons la moralit parce que
des races honntes peuvent seules tre des races scientifiques. C'est
l sans doute une assez pauvre vue sur la destine humaine. Il est un
peu puril de dire qu'il faut que l'honntet existe pour qu'il y ait une
Acadmie des sciences et une Acadmie des inscriptions. Kant a relev de haut, a rfut d'avance, et d'un seul mot viril, ce faible paradoxe,
en disant : Si le monde n'a aucune valeur, comment la contemplation
du monde pourrait-elle en avoir une ? De mme nous dirions volontiers : Si un globe sans science ne mrite pas d'tre habit, un monde
sans morale et sans Dieu ne mrite pas d'tre connu. Il n'en vaut pas la
peine. Nanmoins, il y a quelque vrit dans la pense de M. Renan.
Oui, la moralit est la condition de la science, non seulement en ce
sens qu'un malhonnte homme sera difficilement un savant srieux,
mais encore parce que la science elle-mme, prise en soi, n'est [327]
telle que lorsqu'elle est l'amour pur de la vrit. Or un tel amour fait
partie de la moralit mme : il est un acte de moralit.
Il en est de mme de la libert scientifique, de la libert de penser,
qui de nos jours est devenue une vritable religion, et qui remplace
pour beaucoup la religion. Que signifie la libert de penser, si ce n'est
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
301
le respect inviolable de la pense et la dignit intrieure de la pense ?
Vous levez une statue Etienne Dolet. Est-ce au corps de Dolet, aux
molcules de ce corps que vous rendez hommage ? Non ; ces molcules sont depuis longtemps disperses dans l'univers. Le corps de
Csar, dit Shakespeare, sert boucher un trou. Ce que vous honorez,
c'est donc la pense de l'homme, c'est--dire la partie intangible et invisible de son tre. Celui-l mme qui nie l'esprit, l'affirme en le
niant ; car ce qui nie en nous, c'est l'esprit lui-mme. Il n'y a donc pas,
selon nous, d'antinomie entre la science et la mtaphysique, ni entre la
science et la morale. Si la science devait aboutir la ngation de la
mtaphysique et de la morale, elle aboutirait la ngation d'ellemme. Dans l'ide mme de la science est contenue l'ide du droit,
puisqu'elle rclame la libert ; l'ide du devoir, puisqu'elle s'interdit de
mentir ; et mme l'ide religieuse, car Fnelon nous dit : O raison,
n'es-tu pas le Dieu que je cherches ? et le Dieu de l'criture n'a-t-il
pas dit de lui-mme : Ego sum veritas ?
Si ces considrations sont justes, rclamer en philosophie, au nom
de la morale, contre les abus de la science, ne sera plus un acte d'intolrance contraire la libert ; ce sera plutt sauvegarder la science
elle-mme contre elle-mme, en lui demandant de regarder en face et
de respecter son propre principe. 23
Telles sont les penses qui nous ont t suggres par le beau roman de M. Paul Bourget. Ce livre est un des meilleurs services que la
littrature ait rendus la philosophie. C'est pourquoi nous n'avons pas
cru sortir des limites de la philosophie en le commentant.
23
Sur la mme question, voir plus haut Introduction, leon V.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
302
[305]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE PREMIER
LESPRIT
Leon II
L'HOMME PENSE
Retour la table des matires
Messieurs,
Nous avons maintenant entrer dans l'tude des problmes de la
mtaphysique ; et le premier problme que nous poserons est celui de
l'existence de l'esprit.
Nous avons dit plus haut que la philosophie est la pense de la
pense ; voil donc l'objet et le point de dpart de la philosophie, et
nous poserons d'abord cette proposition que Spinoza donne comme un
axiome, savoir : L'homme pense. 24 C'est la forme qu'il prte au cogito de Descartes. Pourquoi prfrons-nous la forme adopte par Spinoza celle de Descartes ? Personne sans doute n'attache plus d'importance que nous au clbre principe de Descartes, au cogito. C'est,
croyons-nous, le principe fondamental de la philosophie moderne.
Mais ce principe est loin d'tre une vrit simple et immdiate, tire
de l'intuition naturelle des choses : c'est le produit d'une longue et savante laboration, c'est la mise en doute de tout le monde matriel et
24
thique, partie II, axiome 2.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
303
de toute vrit objective, mme de celle des mathmatiques, qui a
conduit Descartes cette dernire proposition. Quand je douterais de
toutes choses, au moins ceci serait-il vrai, savoir que je doute, c'est-dire je pense. Or, pour nous et pour le but que nous nous proposons
en ce moment, ce mode abstrait et spculatif de penser nous parat
prmatur et inutile ; nous aimons mieux, comme Spinoza, nous placer au point de vue de la ralit ; et prenant l'homme rel et concret tel
qu'il nous est donn dans l'exprience, et non pas seulement le moi
philosophique, nous dirons que cet homme rel est dou de la facult
de penser.
[329]
Au reste, sous quelque forme que se prsente cet axiome, soit sous
la forme abstraite employe par Descartes, soit sous la forme concrte
de Spinoza, l'existence de la pense reste le fait fondamental et original sur lequel repose toute la philosophie : aucune autre science n'tudie la pense en tant que pense. Prenons donc pour point de dpart le
fait de la pense.
Ce fait une fois pos, nous avons nous demander ce que c'est que
la pense, d'o elle vient, quoi elle se rattache, quel en est le sujet
d'inhrence ? Ici deux opinions, qui ont pris des formes bien diverses
dans l'histoire, se partagent les esprits depuis les origines de la philosophie. Ou bien l'on admet que la pense se rattache au mme substratum que tous les autres phnomnes de l'univers, et ce substratum est
ce que nous appelons matire ; ou bien la pense se spare de tous les
autres phnomnes et se rattache un substratum propre et indpendant ; et c'est ce que nous appelons esprit. Ces deux opinions, je le
rpte, ont pris des formes trs diffrentes selon les temps et les lieux ;
il y a bien des manires d'entendre soit l'un soit l'autre de ces deux
systmes. Il y en a d'intermdiaires ; il y en a de plus comprhensibles
qui les enveloppent plus ou moins tous les deux. Mais pour voir clair
dans toutes ces formes, pour se guider dans le labyrinthe de ces combinaisons compliques, il faut toujours avoir devant les yeux ces deux
grands types, de mme que le mdecin, pour voir clair dans les maladies compliques et composites qu'il a sous les yeux dans l'exprience,
doit partir de certains schmes abstraits et typiques qui permettront de
dmler et d'interprter le complexum morbide que lui donne l'exprience. Sans doute Platon, Aristote, Descartes, Leibniz, Berkeley,
Kant, ont tous des manires de voir trs diffrentes sur la matire et
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
304
sur l'esprit ; et leurs opinions rentrent difficilement dans les cadres
abstraits et simples que nous devons commencer par poser ; mais, je le
rpte, sans ces deux schmes de matrialisme et de spiritualisme qui
rsument aux yeux du vulgaire toute la philosophie, il serait [330] impossible de rien comprendre toutes les solutions que prsente l'histoire.
Comment se forme l'opinion du matrialiste ? Le voici. Si nous jetons les yeux autour de nous, nous nous voyons entours de choses
que nous percevons par les sens et que nous appelons choses matrielles ou corps. Si maintenant nous nous considrons nous-mmes,
nous voyons notre pense et ce que nous appelons le moi associ
une portion de matire analogue celle des autres tres qui nous entourent ; et c'est l ce que nous appelons notre propre corps. C'est un
corps, car il est tout fait semblable aux autres choses que nous appelons du mme nom ; il est tendu, color, solide, pesant, mobile ; en
outre, il est ntre, parce qu'il nous accompagne constamment et que
nous ne pouvons transporter notre pense, notre moi, d'un point un
autre de l'espace, sans y transporter aussi notre corps.
De plus, dans celle portion de matire qui est notre corps, nous
apercevons, par l'exprience faite sur les autres hommes aprs leur
mort, et quelquefois mme pendant leur vie, une autre portion de matire plus petite, qui parat lie d'une manire bien plus troite encore
la pense que le reste du corps : cette portion de matire, c'est le cerveau, et, d'une manire plus gnrale, le systme nerveux. Ces organes, en effet, accompagnent partout la pense ou la sensibilit, en
un mot la conscience. Partout o il y a pense et sensibilit, il y a un
cerveau et un systme nerveux, ou quelque chose d'analogue. La pense crot et dcrot avec le cerveau. Les dsordres de la pense sont
accompagns des dsordres du cerveau, ou rciproquement. Enfin le
corps entier peut continuer vivre et vgter comme une plante,
lorsque le moi ou la pense a disparu : c'est que le cerveau lui-mme
est en quelque sorte dtruit ou en voie de destruction. Ainsi ce n'est
pas seulement le corps en gnral ; c'est le cerveau ou le systme nerveux qui est li au systme de la pense, et qui en est la condition.
De tous ces faits il est facile de tirer cette consquence qui [331]
parat tout d'abord trs rationnelle : c'est que la pense est une fonction du cerveau. L'esprit, le moi, n'est que la rsultante des combinaisons de la matire.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
305
Admettons pour un instant qu'il en soit ainsi, et montrons que cette
fonction, savoir la pense, se distingue radicalement des autres fonctions corporelles.
Si nous considrons une des fonctions organiques, par exemple la
digestion, la circulation ou telle ou telle scrtion, nous voyons
d'abord par les sens les organes qui accomplissent cette fonction ; et
ces organes sont des corps. Il en est de mme des fonctions crbrales : elles sont lies un organe que nous pouvons saisir par les
sens, et qui par consquent est un corps. Ainsi voil quelque chose qui
est le mme de part et d'autre : d'un ct un estomac, un cur ; de
l'autre un cerveau. Mais si nous comparons maintenant, non plus les
organes, mais les oprations, nous voyons au contraire de part et
d'autre de trs grandes diffrences : d'un ct, en effet, les oprations
des organes aboutissent des phnomnes qui tombent sous nos sens
aussi bien que les organes eux-mmes ; on peut voir digrer un estomac, comme dans les digestions artificielles ; on peut voir le sang circuler, voir galement les poumons respirer, et se produire, comme
dans un vase chimique, l'oxygnation du sang. Toutes ces oprations
sont pour nous objectives et se passent dans l'espace ; les autres
hommes peuvent les apercevoir comme moi-mme ; enfin non seulement ces oprations se passent dans le corps et se ramnent des phnomnes de nature corporelle, mais elles donnent naissance ellesmmes de nouveaux corps : le chyle, produit par l'estomac ou les
intestins ; la bile, scrte par le foie ; la salive, l'urine, etc., tout cela
est corps comme les organes qui les produisent. Ainsi, dans ce cas,
organes et oprations sont homognes. En est-il de mme dans le cas
de la pense ?
Soit donn un cerveau que nous puissions saisir et apercevoir dans
son opration, pendant qu'il fonctionne (ce qui n'est pas impossible,
par exemple dans l'opration du trpan). [332] Que voyons-nous ? Un
organe et rien autre chose. Tout au plus peut-on constater qu'il agit en
se mouvant : car on voit que la compression arrte son action. Une
personne soumise une pression atmosphrique extrieure est interrompue subitement au milieu d'une phrase qu'elle prononce. Cessez la
pression, elle reprend la phrase au point o elle l'a laisse et l'achve.
De l on peut conclure sans doute que l'opration du cerveau consiste
dans certains mouvements. On peut mme concevoir qu'avec le dveloppement ultrieur de nos moyens d'observation on pourrait aller jus-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
306
qu' saisir directement les mouvements crbraux ; mais lors mme
qu'il en serait ainsi, aurait-on atteint la pense elle-mme ? Nous serions arrivs voir de nos yeux les vibrations des cellules crbrales ;
nous ne verrions point pour cela les actions internes auxquelles elles
correspondent, de mme qu'un dentiste voit la dent carie, mais ne
voit pas la douleur cause par la carie de la dent ; de mme aussi que
j'entends le son de la parole, mais que je ne perois pas pour cela la
pense qu'elle exprime. Ainsi, cette opration du cerveau appele pense chappe toute perception extrieure, et ne peut tre connue que
par celui chez qui elle se passe, et au moment o elle se passe. C'est
pourquoi on appelle ces sortes de phnomnes, phnomnes internes,
en opposition avec les autres phnomnes, appels externes : on les
appelle encore subjectifs, et les autres objectifs. Les premiers sont subjectifs, parce qu'ils se passent dans le sujet pensant, et ne sont saisis
que par le sujet lui-mme ; les autres sont objectifs, parce qu'ils viennent de l'objet, et peuvent tre aperus par tous ceux qui sont en prsence de ces phnomnes.
Il y a donc l une distinction fondamentale entre les deux classes
de phnomnes, et il faut en tenir compte dans la comparaison des uns
et des autres. Cette distinction, de quelque manire qu'on l'explique,
s'oppose une complte assimilation.
Si, en effet, on convient d'appeler choses matrielles toutes celles
qui tombent sous les sens externes, et nous n'avons [333] pas (au
moins jusqu'ici) d'autre dfinition que celle-l, nous avons le droit
de dire que la pense, qui ne tombe pas sous les sens, n'est pas une
chose matrielle. Sous une autre forme, on dira : Nous appelons
choses matrielles toutes les choses externes ; or la pense n'est pas
une chose externe : c'est une chose interne et essentiellement interne.
Donc elle n'est pas matrielle.
Mais, demandera-t-on, qu'est-ce que tomber sous les sens ? qu'estce qu'une chose externe ? Je rponds : J'appelle chose externe tout ce
qui peut tre aperu en mme temps par les autres hommes. Par
exemple, une maison, un arbre, le corps de tel ou tel homme sont des
choses externes, parce que tous ceux qui sont en prsence de ces objets voient un arbre et une maison, et les corps de leurs semblables ; et
j'appelle sens externes les sens qui permettent tous les hommes de
voir ces mmes objets ; et cela n'est pas seulement vrai des autres
corps, mais du mien propre ; car les autres hommes (le chirurgien par
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
307
exemple) peuvent voir dans mon corps en certaines occasions ; et
mme, l'aide de certains artifices, je pourrais voir dans l'intrieur de
mon propre corps, aussi bien que les autres : ce corps est donc externe
pour moi aussi bien que le reste.
On peut dire que cette distinction du subjectif et de l'objectif, des
phnomnes internes et des phnomnes externes, des faits psychologiques et des faits physiologiques, est devenue banale en philosophie,
qu'elle est admise par tout le monde, et qu'il s'agit de tout autre chose,
savoir si ces deux sortes de faits ne peuvent pas tre les modifications d'une seule et mme substance. C'est ce que nous verrons plus
lard ; mais quant la distinction en question, celle du subjectif et de
l'objectif, elle est si peu banale, si peu admise universellement, qu'elle
est constamment oublie et mconnue par les physiologistes, mme
par les plus grands. Ils reconnaissent ce qu'il y a d'obscur dans les
fonctions de la pense ; mais ils prtendent que la mme obscurit
rgne de part et d'autre, aussi bien sur les fonctions physiologiques
que sur les [334] fonctions psychologiques. Nous ne savons pas plus,
dit Claude Bernard, comment l'estomac digre, que nous ne savons
comment le cerveau pense. Nous saisissons d'une part l'organe, de
l'autre l'opration ; mais le lien causal, l'action interne qui unit l'un
l'autre l'organe et l'opration, nous chappe des deux cts. Ce n'est
pas une raison pour sparer la fonction de l'organe, pour raliser cette
fonction, en faire un tre part. Autrement, pourquoi ne pas admettre
une entit digestive, aussi bien qu'une entit pensante ? C'tait, du
reste, ce que croyaient certains mdecins, Van Helmont par exemple,
qui introduisait dans chaque organe un tre spcial, un principe directeur, appel archie, charg d'accomplir les fonctions de l'organe. La
doctrine de l'me pensante ne serait qu'un reste de la doctrine des arches.
Nous ne discuterons pas cette opinion de Claude Bernard : ce que
nous voulons faire remarquer surtout, c'est combien ce grand savant
est en dehors de la question, ignoratio elementi. Il ne s'agit pas en effet ici du comment primordial et essentiel de la pense ; et nous accordons aisment que le comment de la circulation et de la digestion
n'est pas mieux connu ; en un mot, comme on l'a dit souvent, les
causes intimes de choses nous sont profondment caches. Mais,
l'obscurit du comment tant la mme de part et d'autre, il reste nanmoins une diffrence et une opposition fondamentale que le physiolo-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
308
giste passe entirement sous silence, savoir que les fonctions physiologiques se manifestent par des phnomnes qui tombent sous les
sens, qui sont par consquent homognes avec les organes qui les produisent, tandis que la pense n'est accessible qu' la conscience et n'est
pas par consquent homogne avec le cerveau, lequel ne tombe pas
sous la conscience et n'est perceptible que par les sens externes. En un
mot, par la conscience l'homme se manifeste comme sujet, tandis que,
dans les fonctions vitales, l'homme est objet aussi bien que tous les
autres tres de la nature.
On rpondra de la mme manire l'objection de Voltaire dans
l'article me du Dictionnaire philosophique : Nous ne [335] comprenons pas plus, dit-il, la vgtation que la pense ; et cependant
nous ne supposons pas dans l'arbre un tre vgtatif distinct de l'arbre
lui-mme. Sans doute, il n'y a pas lieu d'admettre un tre vgtatif ;
mais ici encore la force inconnue qui produit la vgtation se manifeste par des phnomnes externes, tels que circulation et ascension de
la sve, accroissement du vgtal, absorption et exhalaison physiques,
lesquels sont homognes avec l'arbre lui-mme, tandis que, pour passer de l'organisme la pense, il faut changer de mode d'observation
et passer de l'extrieur l'intrieur. Ce n'est donc pas le comment du
fait qui fait la diffrence : ce sont les faits eux-mmes.
Si donc nous nous en tenons aux faits, tout en suspendant nos conclusions, il reste que nous avons sur cette question deux vrits acquises absolument irrcusables et d'un caractre vraiment scientifique.
La premire c'est que la pense ne nous apparat nulle part dans l'exprience sous un correlatum corporel ; la seconde, c'est que la pense
se distingue absolument de tout autre phnomne par cette proprit
d'tre prsente elle-mme par la conscience, et de ne pouvoir tre
perue que par le corps mme qui pense.
Allons maintenant un peu plus loin dans notre dduction.
Cette distinction mme des phnomnes internes et des phnomnes externes est-elle bien fonde et repose-t-elle sur quelque chose
de clair ? Il y a une grande cole de philosophie qui nie qu'il y ait rellement des phnomnes externes. Tous les phnomne, quels qu'ils
soient, sont internes, subjectifs : tous sont des faits de conscience et
rien autre chose. Nous ne pouvons sortir de nous-mmes. Son, couleur, rsistance, tendue mme, ne sont que des modes de notre sensi-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
309
bilit. Il n'y a donc pas d'opposition entre le moi et le non-moi. Il n'y a
que le moi considr divers points de vue.
Sans prendre parti ou pour ou contre cette hypothse, 25 nous
n'avons qu' faire observer que, bien loin de compromettre [336] le
principe de l'indpendance de la pense, elle ne ferait au contraire que
l'exagrer, puisque tous les objets dits externes, y compris notre
propre corps, ne seraient alors que les modes de notre pense. Bien
loin de rduire la pense n'tre que la rsultante des proprits de la
matire, elle affirme que toutes ces proprits de la matire elle-mme
ne seraient que des modes de l'apparition de la pense. Le type de
l'tre ne serait plus la chose tendue et solide appele matire, considre comme le substratum universel de tous les phnomnes et mme
de ce phnomne impalpable que l'on appelle la pense : au contraire,
le substratum serait notre propre moi, notre esprit ; et le corps se rduirait des groupes de phnomnes internes ; la matire en gnral
serait la pense en gnral, c'est--dire ce qu'il y a de commun entre
tous les modes de la pense. Un tel idalisme, loin d'tre contraire au
spiritualisme, serait au contraire un ultra-spiritualisme, un spiritualisme exagr et intemprant.
Sans nous engager dans les conclusions de l'idalisme, et en ajournant la discussion du problme, il est un point cependant que nous
pouvons retenir et que nous avons le droit d'emprunter cette cole :
c'est que la seule chose qui nous soit directement connue, ce sont les
modes et les oprations de notre propre esprit. Autre chose est dire :
Nous ne connaissons immdiatement que nous-mmes ; autre
chose dire : Il n'y a rien en dehors de nous-mmes. Nous cartons
ou ajournons cette seconde conclusion sans la discuter, et nous la laissons la libert de chacun ; mais nous retenons la premire proposition, qui peut-tre ne contient pas la seconde. On ne conclura donc pas
de l ncessairement que les choses extrieures n'existent pas, et
qu'elles ne sont que les modes de notre esprit ; mais on aura le droit de
conclure que nous ne les connaissons que dans leur rapport avec les
modes et les oprations de notre esprit.
Si nous considrons en effet toutes les ides que nous nous faisons
du monde extrieur, nous rappellerons que les Cartsiens et les Lock25
La discussion et l'apprciation de l'idalisme seront l'objet de notre dernier
livre.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
310
istes disaient que nous ne connaissons [337] des choses extrieures
que deux sortes de qualits, les unes appeles qualits secondes, les
autres qualits premires. Or les qualits secondes ne sont, de l'aveu
de tous, que nos propres sensations transfres aux choses extrieures.
Il n'y a rien dans les choses qui ressemble ce que nous appelons chaleur, couleur, son, saveur. Il n'y a en elles que la proprit de produire
en nous ces sensations ; en d'autres termes, il y a une activit ou des
activits qui, mises en rapport avec notre activit propre, dterminent
en nous lesdites sensations. Nous ne pouvons, en effet, concevoir un
effet produit sur nous, sans concevoir en mme temps un pouvoir capable de le produire.
Mais maintenant o puisons-nous l'ide d'activit, si ce n'est dans
la conscience de notre propre tat intrieur lorsque nous agissons,
lorsque nous produisons des mouvements et que nous accomplissons
un certain effort ? la vrit, on peut se demander en quoi consiste ce
sentiment d'activit que nous croyons prouver dans le dveloppement
de notre nergie propre. Mais, quelle que soit en elle-mme la chose
que nous appelons action, toujours est-il que nous ne concevons la
ralit externe que comme une action analogue celle que nous appelons de ce nom en nous-mmes.
On demandera encore comment il se fait que nous puissions soutenir la fois que nous nous distinguons absolument des choses externes, comme quelque chose d'htrogne avec nous-mmes, et en
mme temps cependant que nous ne connaissons les choses extrieures que par analogie avec nous-mmes. Il est facile d'claircir cet
apparent paradoxe. Nous appelons corps, nous appelons choses externes, ce qui est capable de produire en nous certaines sensations. Or,
nous ne sentons pas en nous la facult de produire ces sensations ; ou
du moins, si nous les produisons, c'est prcisment par cette partie de
nous-mmes que nous appelons notre corps, prcisment par cette raison mme : ainsi, grce aux mouvements de ce corps, qui est plus
notre disposition que toutes les autres choses externes, nous pouvons
nous [338] mettre dans les circonstances o nous savons que nous devons prouver telles ou telles sensations : mais ce corps lui-mme est
une chose externe par rapport notre conscience. Autrement nous ne
pouvons, par une action interne, faire apparatre aucune sensation ;
nous ne pouvons produire immdiatement la lumire dans l'obscurit,
changer la temprature d'une chambre, faire natre subitement le bruit
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
311
du tonnerre, etc. Cela seul donc est un corps pour nous qui produit en
nous de telles sensations. Cela n'empche pas que nous ne connaissions les corps que par ces sensations mmes. Abstraction faite des
qualits premires dont nous n'avons pas encore parl, nous ne pouvons dire d'un corps autre chose que ceci : il est chaud, il est sonore, il
est color ; et tout cela n'est que nos sensations, plus la facult de les
produire, c'est--dire quelque chose d'analogue avec notre propre activit.
Passons maintenant ces autres qualits que les Cartsiens et
Locke appelaient qualits premires et qui paraissent plus particulirement propres la matire, et en mme temps plus videmment objectives que les prcdentes. Parmi ces qualits, il en est une surtout
qui parat tre tout fait htrogne avec ce que nous sentons en nousmmes : c'est l'tendue. Aussi les Cartsiens n'hsitaient-ils pas considrer l'tendue comme l'essence mme de la matire, comme tant la
matire elle-mme. En effet, toutes les fois que nous percevons un
corps, nous percevons quelque chose d'tendu, tandis que nous ne percevons en nous-mmes, en tant que nous pensons, aucun lment
tendu. C'est donc l que serait le vritable caractre distinctif du
corps par rapport l'esprit. Examinons de plus prs cette qualit particulirement caractristique.
Si nous rflchissons sur la nature de l'tendue, nous verrons qu'en
elle-mme elle ne contient aucun lment de ralit, s'il ne s'y joint
quelque autre chose qu'elle-mme. Le vide est aussi tendu que le
plein ; un atome vide est gal un atome plein. Prenez, par exemple,
un atome d'picure ; [339] dessinez-en les contours ; puis supprimezle par la pense. Il restera une place qui est absolument adquate en
tendue l'atome lui-mme ; et cependant il n'y a plus rien ; car on
n'identifiera pas la matire avec le vide. Donc le rel de l'atome n'tait
pas l'tendue, mais quelque autre chose, la solidit par exemple, la
pesanteur, ce que vous voudrez, mais non pas l'tendue. Leibniz exprimait peu prs la mme pense en disant que l'tendue n'est autre
chose qu'une continuation, res continuata ; mais, disait-il, pour qu'une
chose soit rpte, continue, il faut d'abord qu'elle existe ; ce n'est
donc pas la rptition de cette chose, savoir l'tendue, qui constitue
l'essence de la chose.
la vrit, on peut se reprsenter une activit qui rayonnerait dans
l'espace ; et rayonner ne signifierait autre chose que produire une ac-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
312
tion distance : or la sphre d'action de cette activit pourrait tre appele une tendue. Il ne serait pas mme ncessaire de supposer un
milieu vide, qui n'est peut-tre qu'une fiction de l'esprit ; mais une activit rayonnante serait une activit exerant son action sur une substance par l'intermdiaire de plusieurs autres ; et l'tendue de ce rayonnement, ce qui se produit pour nous par la perception de l'tendue,
serait le nombre des actions intermdiaires qui la sparent d'une autre
activit. En tant, par exemple, que pour arriver l'me de mon ami
absent je suis oblig d'employer l'intermdiaire de mille agents diffrents, je suis plus loign de lui que lorsque je lui parle lui-mme,
quoique mme alors il y ait encore des intermdiaires. Ainsi l'tendue
est le nombre des agents intermdiaires qui sparent un agent de
l'autre ; et ce titre elle est quelque chose de rel ; mais alors mme
elle ne serait encore qu'une consquence de l'activit ; et le type de
celle-ci serait toujours pris dans la conscience de l'esprit.
Quant la seconde des qualits appeles qualits premires, savoir la solidit, il est encore plus facile que pour les qualits secondes
de la ramener l'ide d'activit ; car ce n'est plus seulement une activit induite, comme dans le cas de la [340] chaleur, de l'odeur, du son,
etc. (dans ces cas, l'activit n'est pas donne directement, mais par
suite de l'application du principe de causalit). La solidit, au contraire, est une activit sentie ; car quand nous rencontrons une rsistance, on peut dire que le sentiment d'une action antagoniste est lie
au sentiment de notre activit propre ; en supposant que, mme dans
ce cas, cette apparente perception d'une activit externe ne soit encore
qu'une induction, toujours est-il que cette induction est bien plus immdiate et bien plus rapide que celle qui est suppose par les qualits
secondes. En tout cas il y a de part et d'autre supposition d'activit.
En rsum, soit que l'on admette que l'tendue n'est autre chose
qu'une notion fictive dont l'origine aurait besoin d'tre ultrieurement
recherche ; soit que l'on admette, avec Leibniz, qu'elle n'est que la
coexistence des substances ou l'ordre des coexistences ; soit que l'on
admette, avec Kant, qu'elle est une forme subjective de notre sensibilit, ou toute autre hypothse, toujours est-il que la doctrine qui ramnerait l'ide du corps l'ide d'une activit faisant quilibre notre
activit propre, tendrait faire du corps 1' analogue de l'esprit , selon l'expression de Leibniz. Ce serait, si l'on veut, de l'esprit infrieur,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
313
muet, sourd et aveugle, mais enfin une certaine forme de l'esprit. Tel
est le dynamisme leibnizien, qui ne peut pas tre appel rigoureusement un idalisme, puisqu'il ne nie pas l'existence de choses extrieures, mais qui est une sorte de spiritualisme universel dans lequel la
diffrence de l'esprit et de la matire tend s'effacer au profit de l'esprit, comme elle tend s'effacer dans le matrialisme au profit de la
matire. C'est cependant vers ce spiritualisme universel que nous inclinons le plus volontiers.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
314
[341]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE PREMIER
LESPRIT
Leon III
LE MATRIALISME ET
LA DIGNIT DE LA PENSE
Retour la table des matires
Messieurs,
Revenons notre point de dpart. Nous sommes partis de ce fait
que l'homme pense, et de cet autre fait que la pense est toujours
coexistante avec une masse matrielle, avec une certaine chose tendue, colore, solide, appele corps, et qu'elle semble par consquent
en tre la proprit. Mais, d'autre part, nous avons fait remarquer que
la fonction pense tait absolument diffrente de toutes les autres
fonctions des corps organiss, les fonctions corporelles en gnral se
manifestant par des phnomnes qui sont homognes avec le corps o
ils se produisent, c'est--dire des phnomnes qui sont, comme le
corps lui-mme, saisis par les sens externes, tandis que la pense et
tout ce qui s'y rattache, sensation, dsirs, volitions, ne sont saisis que
par les sens internes, c'est--dire ne sont accessibles immdiatement
qu' celui qui les prouve. Nous avons tir de l'opposition de ces deux
classes de phnomnes une premire prsomption : c'est qu'il y a deux
existences, l'une qui se manifeste intrieurement par la conscience,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
315
l'autre qui se manifeste extrieurement aux sens, le dedans et le dehors, le dedans correspondant ce que nous appelons esprit, le dehors
ce que nous appelons corps.
En supposant qu'on levt des doutes sur la distinction de ces deux
ordres de faits, il nous a sembl que ces doutes devaient porter bien
plutt sur l'existence externe que sur l'existence interne ; car nous ne
connaissons la premire que par la seconde ; et ce que nous appelons
corps ou matire pourrait bien n'tre que nos sensations objectives.
De l [342] une premire hypothse qui est le contre-pied du matrialisme : c'est l'hypothse qui nie expressment l'existence de la matire,
bien loin d'en faire le substratum de la ralit. Si cependant on ne se
rsigne pas facilement nier toute objectivit, et si l'on se croit oblig
d'admettre quelque chose de rellement extrieur au moi, il sera encore plus philosophique de concevoir avec Leibniz l'essence de la matire sur le type de ce que la conscience nous rvle dans notre propre
esprit, que de concevoir l'esprit sur le type de la matire. Nous concevons par l une seconde hypothse, trs oppose encore au matrialisme, et qui lui est philosophiquement trs suprieure : c'est l'hypothse que l'on peut appeler proprement spiritualisme, ou du moins spiritualisme universel, puisque toute existence, mme celle de la matire, n'est qu'esprit, ou diminutif de l'esprit.
Nous pouvons concevoir encore d'autres hypothses du mme
genre, avant d'tre amens l'hypothse matrialiste. Par exemple, on
peut encore faire l'hypothse de Kant, savoir que nous ne connaissons pas l'essence des choses, pas plus l'essence de la matire que
celle de l'esprit ; nous ne connaissons que des phnomnes, et parmi
ces phnomnes deux classes distinctes, les uns internes, les autres
externes. la vrit, dans cette hypothse l'avantage ne reste pas au
spiritualisme ; mais il ne reste pas davantage au matrialisme. Les
deux systmes sont renvoys dos dos, mais avec cette rserve que si
d'autres ides, d'autres arguments emprunts la morale viennent justifier les opinions spiritualistes, elles ne peuvent pas tre cartes au
nom de la science, puisque au nom de la science nous n'avons le droit
de rien dire : ce sera donc, si l'on veut, une sorte de scepticisme, mais
de scepticisme en dfinitive qui conclut en faveur de l'esprit.
Reste encore une quatrime supposition qui, voisine quelquefois en
apparence du matrialisme, s'en distingue cependant profondment.
C'est l'hypothse qui considrerait le corps et l'esprit, non pas comme
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
316
deux substances distinctes, [343] mais comme les deux attributs d'une
mme substance, de telle sorte cependant que la pense (ou esprit)
reste indpendante de l'tendue (ou matire), et l'tendue indpendante
de la pense. Ce sont deux attributs parallles, mais distincts. Il y a
correspondance, mais non dpendance de l'un l'autre, et en particulier de l'esprit la matire. Dans cette hypothse, les modes de la pense, comme le dit Spinoza, ne s'expliquent que par la pense ; et les
modes de l'tendue ne s'expliquent que par l'tendue ; mais ni la pense ne s'explique par l'tendue, ni l'tendue par la pense. C'est la
mme pense qu'exprimait Leibniz en disant : Il faut expliquer les
phnomnes des corps comme s'il n'y avait pas d'me, et les phnomnes de l'me comme s'il n'y avait pas de corps.
On voit combien d'hypothses pourraient tre faites sur les relations des deux existences, sans que nous soyons forcs d'avoir recours
celle du matrialisme ; et l'on voit que celle-ci, quoique la plus
simple en apparence, est loin d'tre la plus philosophique. Nanmoins,
laissons de ct toutes ces hypothses ; revenons notre point de dpart et rappelons les avantages que prsente l'hypothse matrielle au
point de vue du sens commun.
Pour cela, il faut carter d'abord toutes les conceptions philosophiques que l'on peut se faire sur l'essence de la matire. Parlons de ce
qui nous est donn par l'exprience immdiate : ce qui est donn, c'est
l'existence d'une chose, d'un objet appel corps. Le corps, quelle que
soit son essence interne, nous est immdiatement donn aussi bien que
la pense et en mme temps qu'elle. Tout ce qui nous entoure est
corps, et nous-mmes nous nous connaissons comme corps aussi bien
et au mme titre que les choses extrieures. Maintenant nous avons dit
que la pense est donne en mme temps que la notion de corps. C'est
l un fait incontestable, mais ce fait ne nous est jamais donn sans tre
associ un corps. Appliquons les rgles de la mthode baconienne.
Posita causa, ponitur effectus ; ablata causa, [344] tollitur effectus ;
variante causa, variatur effectus. Eh bien, partout o vous voyez un
cerveau ou un systme nerveux (ou quelque chose d'analogue), vous
trouvez la pense ou son diminutif, la sensation, l'imagination, l'instinct. Partout o disparat le cerveau et le systme nerveux, on voit
disparatre galement la pense. Enfin, toutes les variations de la pense (ge, sexe, temprament, habitudes, etc.) correspondent aux variations du cerveau. Donc, suivant les lois rigoureuses de l'induction,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
317
vous devez conclure que l'organisation et la pense sont dans un rapport de cause effet, sans que vous soyez tenu d'ailleurs de vous prononcer sur la cause premire et l'essence intime des corps et de l'organisation. Sans doute il y aura lieu ensuite de rechercher la cause de
l'organisation elle-mme, et en gnral l'explication de la matire ;
mais c'est l une recherche loigne et peut-tre un problme insoluble. En se tenant aux faits immdiats, l'hypothse la plus simple sera
donc celle qui rattache directement les penses l'organisation et
l'existence matrielle en gnral. Voil les raisons qui militent en faveur de l'hypothse matrialiste.
Et d'ailleurs, pourrait-on dire, n'attache-t-on pas vritablement trop
d'importance cette question de la nature de la substance de l'esprit ?
Quelle que soit, en effet, la substance de la pense, la pense n'en reste
pas moins ce qu'elle est. Un beau vers, une belle mlodie, seront-ils
moins un beau vers, une belle mlodie, pour avoir t labors par un
cerveau plutt que par une me spirituelle ; par une substance compose de parties, que par une substance simple, puisque d'ailleurs nous
ne savons rellement ce que c'est que d'tre simple ? La dcouverte du
systme du monde par Newton est-elle autre chose, dans l'hypothse
matrialiste, que ce qu'elle est dans l'hypothse spiritualiste ? La vertu
reste la vertu, le gnie reste le gnie, la pense reste la pense, quelle
que soit la substance qu'on se reprsente sous ces phnomnes. En
gnral, on peut dire que la dignit intrinsque des choses, leur valeur
propre, tient beaucoup moins leur [345] matire qu' leur forme. Un
Apollon du Belvdre en bois sera plus beau qu'une statue vulgaire en
marbre. Que la matire soit ou non capable de produire la pense,
l'tre pensant n'en aura ni moins de ncessit, ni moins de dignit, et
sa destine ne sera pas moins noble, au moins en cette vie, parce que
son essence ne sera pas celle qu'imaginent les mtaphysiciens ; et
mme la vie future n'est ni plus ni moins assure d'un ct que de
l'autre, car Dieu peut, s'il le veut, anantir une substance simple, aussi
bien qu'il peut faire durer une substance compose. Si l'on ignorait
absolument, par impossible, la manire dont un individu humain vient
au monde, on imaginerait, pour expliquer l'apparition de ce grand
phnomne, une origine surnaturelle : par le fait cependant la gnration humaine ne diffre en rien de la gnration animale : il n'y a pas
deux manires de paratre la surface du jour ; mais, ce fait tant
donn et ne pouvant tre ni, on en prend son parti ; et l'on ne trouve
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
318
pas que la dignit humaine en soit atteinte. En quoi cette dignit serait-elle plus menace parce que la substance aussi bien que l'origine
serait de nature matrielle ? Tout ce qui en rsulterait, serait que la
matire est une substance plus noble que nous ne le pensons, qu'elle a
en elle plus de virtualits que nous n'avons l'habitude de lui en prter,
en vertu de la sparation artificielle que nous avons faite entre le corps
et l'esprit. Locke disait que Dieu, tant tout-puissant, pourrait bien
avoir donn la matire la puissance de penser. S'il en tait ainsi, on
pourrait dire, sans aucun doute, qu'il y a deux sortes ou deux degrs de
matire ; et l'on continuerait distinguer, comme auparavant, la chair
et l'esprit, en opposant la matire pensante celle qui ne pense pas.
On voit donc, ce qu'il semble, que le dbat du spiritualisme et du
matrialisme a moins d'importance qu'on ne lui en prte gnralement.
Examinons cette difficult. On peut rpondre d'abord que le dbat
entre les deux coles ne porte pas seulement sur la matire, mais encore sur la forme, non seulement sur la substance de la pense, mais
sur son essence, car partout le [346] matrialiste applique la mme
mthode : rduire les phnomnes les plus levs et les ramener
ceux qui sont plus humbles et plus grossiers. De mme qu'il ramne
l'esprit la matire, de mme il rduit la pense proprement dite la
sensation, la volont l'instinct et l'action rflexe ; en morale, il ramne le devoir l'intrt ; en esthtique, le beau ce qui touche les
sens ; en politique, le droit la force, et la libert une paix matrielle, ou la rvolte. Ce n'est donc pas seulement une subtilit mtaphysique qui spare le spiritualisme du matrialisme, c'est la direction
totale de la pense, c'est l'volution de toutes les conditions essentielles de la vie.
Mais nous n'insisterons pas sur cette premire rponse bien connue ; nous aimons mieux discuter l'objection en elle-mme, parce
qu'elle nous permettra de mieux pntrer au cur de notre sujet.
Que la substance ou l'tre en gnral, le substratum indtermin de
toutes choses, appel matire dans le langage scolastique, aprs avoir
pris les formes dites matrielles, puisse s'lever aux formes dites spirituelles, ce n'est pas l ce que nous appellerions du matrialisme ; car il
est certain qu'il y a quelque chose de commun entre le corps et l'esprit,
c'est d'tre des substances. Descartes lui-mme dit que l'esprit est une
chose qui pense, et le corps une chose tendue : il est donc incontestable que le corps et l'esprit sont identiques en tant que choses ou
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
319
substances : ces deux choses ne diffrent que par leurs attributs. C'est
de l, la vrit, que Spinoza a pu faire sortir sa doctrine panthistique : c'est, a-t-il dit, que si l'esprit et le corps ne diffrent pas en tant
que substances, ils ne sont qu'une seule et mme substance, diversifie
seulement dans ses attributs ; mais si nous cartons provisoirement
cette conception de l'unit de substance ; si nous nous contentons
d'admettre avec Descartes que les attributs suffisent diversifier les
substances, toujours est-il que la matire des choses est la mme sous
quelque forme qu'elle se prsente. Cette matire premire, cette matire dite aristotlique parce que c'est Aristote qui l'a introduite et explique, cette matire [347] commune, gnrale, indtermine en soi,
et qui ne se dtermine que par ses attributs, ce n'est pas la matire du
matrialiste ; et en tant qu'on soutiendrait qu'elle est capable de passer
des formes purement corporelles (tendue, rsistance, impntrabilit)
aux formes spirituelles (pense et volont), elle franchirait par l
mme l'espace qui spare le corps de l'esprit, et il y aurait encore lieu
de distinguer deux sortes de substances, les corps et les esprits. Dans
ce cas, en effet, il serait indiffrent que ce corps et cet esprit eussent
un fond commun en tant qu'tres ; car ici ce serait bien la forme qui
spcifierait l'tre, et non la matire ; et qu'une telle philosophie ne
puisse pas tre suspecte de matrialisme, c'est ce qui rsulte de ce fait
que c'est l le fond de la philosophie scolastique recommande par
l'glise presque l'gal des dogmes eux-mmes, et comme celle qui
s'allie le mieux l'orthodoxie.
La question telle qu'elle est pose par les matrialistes, si toutefois
ils comprennent bien leur propre systme, est toute diffrente.
La matire des matrialistes n'est pas la matire nue des scolastiques, materia nuda, sorte d'abstraction qu'Aristote lui-mme considrait comme peine relle : c'est la matire revtue de ses proprits
essentielles, materia vestita ; c'est la matire corporelle proprement
dite. C'est cette sorte de matire, savoir le corps, qui est la substance
relle, le fond rel de tout ce qui est. Cette matire corporelle existe en
soi et par soi ; elle est la vraie substance ; tout le reste n'est qu'accident : c'est la matire tendue et solide qui remplit l'espace, soit qu'elle
se confonde avec lui et le remplisse tout entier, et c'est ce qu'on appelle le plein, soit qu'elle flotte dans le vide. Cette matire, ayant par
elle-mme ses attributs et ses proprits, pourrait exister sans qu'il y
et rien dans le monde qui ressemblt la sensation et la pense.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
320
Maintenant, cette matire tant donne, en tant qu'elle forme certaines combinaisons, peut devenir, selon les matrialistes, capable de
sensation ; et la sensation devient la pense. La pense, dans cette hypothse, n'est donc qu'un accident qui [348] s'ajoute la matire dans
certaines conditions, et c'est un accident fortuit ; car si certaines combinaisons ne s'taient pas produites, la sensation, la pense et tout ce
qui s'ensuit ne se prsenteraient pas. Ainsi le corps, la substance tendue et solide est le rel de l'existence ; la sensation, la pense n'est
qu'un mode ; la pense est au corps ce que la rotation est la pierre
qui roule, ce que le rond et le carr sont la substance tendue. Il n'en
est nullement ainsi dans l'hypothse aristotlique. D'abord ce n'est pas
par hasard et par accident que la substance devient pense : c'est en
vertu de sa propre essence, de sa virtualit propre. En second lieu, selon la doctrine d'Aristote, le rel des choses, leur essence, n'est pas
dans la matire, mais dans la forme ; la pense ne vient pas s'ajouter
l'tendue et la solidit, comme un mode l'attribut, mais comme une
essence a une autre essence : or c'est l'essence qui est la vraie substance. Ainsi, au point de vue de l'excellence intrinsque des choses,
autre chose est l'introduction de la pense, mme dans une matire
commune, mais avec sa dignit propre, autre chose l'apparition d'une
pense accidentelle et fortuite, ne du jeu des lments.
la vrit, mme dans ce dernier cas, on pourrait continuer prtendre que le matrialisme ne porte point atteinte la dignit de la
pense, puisque, en dfinitive, il ne soutient pas et ne peut pas soutenir que la pense ne soit pas autre chose qu'un mode de l'tendue ou,
comme on dit, du mouvement ; car cela n'offre aucun sens, la pense
ne pouvant tre que pense, et le mouvement que mouvement ; dans
tous les cas, la pense ne peut tre qu'une addition au mouvement et
l'apparition de quelque chose de nouveau. Mais cette vue, loin de fortifier et de confirmer l'hypothse matrialiste, ne sert qu' en faire ressortir l'inconsquence et le vide : car cette pense qui s'ajoute au mouvement ne vient de rien, contrairement l'axiome ex nihilo nihil : c'est
donc un aveu implicite de l'indpendance et de l'irrductibilit de la
pense ; nanmoins il n'en reste pas moins que le matrialisme, au
moins par intention, voudrait faire de la pense un accident de la matire : [349] c'est cela mme qui le constitue matrialisme ; et de ce
qu'il ne peut pas raliser cette intention, cela vaut simplement contre
la thse, et non pour elle.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
321
Quelques matrialistes plus profonds que les autres, Diderot et Cabanis par exemple, voyant clairement l'impossibilit de faire sortir ce
qui pense de ce qui ne pense pas, et de faire de la pense un accident,
une rsultante des combinaisons de l'tendue, ont soutenu que la pense, sous forme de sensibilit, est une proprit essentielle la matire
et coternelle avec elle, comme la pesanteur, le mouvement, l'impntrabilit. C'est l une doctrine plus philosophique que celle du matrialisme vulgaire ; mais elle sert prcisment prouver que la pense ne
drive pas de la matire corporelle proprement dite, puisqu'elle a son
essence propre, quoiqu'elle puisse coexister avec d'autres proprits.
Si nous rappelons en outre ce que nous avons dit dj, savoir que
l'tendue pourrait bien n'tre qu'un pur phnomne, que la rsistance
et l'impntrabilit peuvent se ramener l'activit, on serait tent de
conclure que les qualits corporelles ne sont que les apparences des
choses, que la sensibilit, la pense, la volont, en sont le fond. Il y
aurait trs peu de chose faire, on le voit, pour transformer la doctrine
de Diderot en celle de Leibniz, et le matrialisme en spiritualisme : ce
serait au moins le dynamisme, le vitalisme, l'hylozosme ; ce ne serait
plus le matrialisme pur. Il y aurait au moins une doctrine hors de
combat : celle de Dmocrite et d'picure, et de leurs continuateurs
modernes : c'est cependant le seul qui mrite, proprement parler, le
nom de matrialisme et qui rponde sa vraie dfinition, c'est--dire
qui admette d'abord une substance dfinie appele matire, comme la
seule ralit, et qui la caractrise par les proprits mcaniques et physiques ternelles et ncessaires, la pense n'tant qu'une circonstance
accessoire dans l'volution de ces proprits. C'est cette doctrine seule
qui met l'esprit dans la matire et qui lui enlve par l mme toute indpendance et toute dignit. Toute autre doctrine, sans tre prcisment spiritualiste, est proprement un acheminement au spiritualisme.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
322
[350]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE PREMIER
LESPRIT
Leon IV
LA CONSCIENCE
Retour la table des matires
Messieurs,
Toute la doctrine philosophique de ce cours repose, on l'a vu, sur le
fait de conscience, sur l'originalit et l'irrductibilit de ce fait. C'est
donc ce fait que nous devons tablir d'une manire plus profonde, par
l'tude et par l'analyse de la conscience.
Nous avons fait porter toute notre argumentation en faveur de
l'existence de l'esprit sur le fait de l'indpendance de la pense. C'est
donc ce fait que nous devons particulirement mettre en lumire.
L'originalit, l'irrductibilit de la pense, voil le fond de toute notre
doctrine.
Nous pourrions d'abord tablir cette indpendance de la pense en
nous plaant au point de vue cartsien, c'est--dire en insistant sur
l'incompatibilit de la pense et de l'tendue, celle-ci tant considre
comme l'attribut essentiel de la matire, et celle-l de l'esprit. L'tendue est un principe de multiplicit et d'extriorit : toutes les parties
sont extrieures les unes aux autres, partes extra partes. La pense, au
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
323
contraire, ou la conscience est un principe de concentration : c'est la
rduction de la multiplicit l'unit.
Mais, sans insister sur cet argument si connu, il nous semble prfrable d'aller plus avant et de nous interroger sur l'essence mme de la
conscience. Nous verrons si c'est l un fait premier qui ne suppose
rien avant lui, ou un compos et une rsultante.
Pour nous rendre compte de la nature de la conscience, puisque la
conscience est une forme de connaissance (tant [351] la connaissance
du moi par lui-mme), commenons par nous demander ce que c'est
que la connaissance en gnral.
La connaissance est l'acte par lequel un sujet, c'est--dire une chose
connaissante, apprhende ou saisit un objet, c'est--dire une chose
connue.
La connaissance laquelle nous sommes le plus habitus, et qui
devient par l pour nous le type de la connaissance en gnral, est la
connaissance des objets extrieurs. Que suppose cette connaissance ?
Elle suppose qu'un objet, c'est--dire une chose existant par elle-mme
(hors de notre pense), entre dans la sphre de notre conscience et
nous est donn par l comme existant. Soit, par exemple, un arbre
percevoir : pour que je le peroive, il faut qu'il me soit donn. Il existe
dj avant que j'aie pu le connatre, il continue exister aprs que je
l'ai connu. la vrit, nous avons vu qu'il y a un systme appel idalisme qui lve des objections contre cette supposition ; mais ce n'est
pas le lieu de le discuter. Nous prenons l'acte de connatre tel qu'il est,
et non tel qu'il peut tre conu l'aide d'une analyse artificielle plus ou
moins exacte de l'acte de connatre. Nous avons, du reste, examin
dj rapidement l'hypothse idaliste ; et nous avons montr que, si on
l'admettait, ce serait prcisment accorder l'autorit de la conscience
plus encore que nous ne demandons, puisqu'on rduirait tout mode de
connaissance celui-l, et tout objet de connaissance au sujet pensant.
Laissons donc de ct quant prsent l'hypothse idaliste, et reprenons la description de l'acte de connatre : nous trouvons que tout
acte de connaissance se prsente nous sous cette forme, savoir : un
sujet capable de connatre et un objet indpendant du sujet, antrieur
et postrieur lui, capable d'tre connu.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
324
Essayons maintenant d'appliquer la conscience cette analyse, et
voyons ce qu'elle nous donnera.
Qu'est-ce que la conscience ? C'est l'acte par lequel le sujet se connat lui-mme, res sui conscia : tel est le fait fondamental. Or celle
dfinition implique deux termes, comme toute [352] connaissance : un
sujet connaissant et un objet connu. Quel est le sujet connaissant ?
C'est moi. Quel est l'objet connu ? C'est encore moi. Donc si l'on veut
appliquer ce cas la formule de l'acte de connatre en gnral, il faudra dire qu'il y a bien l deux termes, mais que ces deux termes sont
identiques : ce sont l sans doute deux points de vue diffrents, ce que
nous exprimons grammaticalement en mettant l'un au nominatif,
l'autre l'accusatif, mais ce ne sont que des diffrences de points de
vue qui n'empchent pas que ce ne soit une seule et mme chose, qui
est la fois connue et connaissante.
Cela tant, essayons d'appliquer la conscience l'analyse prcdemment faite sur la connaissance extrieure. Pour qu'une chose soit
connue, il faut d'abord, avons-nous dit, qu'elle existe ; en second lieu
qu'elle soit donne, dans une exprience, au sujet connaissant. Donc,
pour que le moi connaisse le moi, il faut d'abord que le moi existe, et
en second lieu qu'il apparaisse au moi, qu'il lui soit donn. Mais dire
que le sujet appel moi prexiste l'acte de conscience, c'est dire qu'il
n'est pas encore moi ; car, s'il tait moi, il serait par l mme conscient, puisqu'un moi n'est autre chose qu'un sujet conscient, et une
chose inconsciente peut tre un objet possible de connaissance, mais
non pas un moi. Maintenant, si cet objet (qui doit tre moi) ne l'est pas
encore tant qu'il n'est pas connu, comment devient-il moi ? Comment
puis-je connatre titre de moi ce qui n'est encore pour moi, par hypothse, qu'une chose extrieure ? Jamais je ne pourrai dire d'une chose
qu'elle est moi, si elle ne l'est dj. Cela serait encore vrai lors mme
que, par hypothse, la substance du moi serait une substance spirituelle aussi bien qu'une substance matrielle. Ce n'est pas tant le passage de la matire l'esprit qui est difficile comprendre, que le passage du non-moi au moi. Sans doute la Galathe de J.-J. Rousseau,
dans son Pygmalion, semble se dcouvrir elle-mme lorsque, touchant
son corps, elle dit : C'est moi ; mais c'est simplement son corps, c'est-dire une partie d'tendue colore, qu'elle [353] apercevait au dehors
par les yeux comme quelque chose d'extrieur. Elle s'aperoit que
cette chose fait partie d'elle-mme, parce qu'elle rpond par une sensa-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
325
tion la sensation de la main qui la touche. Mais ce n'est pas le moi en
tant que tel que la statue peut dcouvrir ; le moi n'est pas donn avant
la conscience ; il ne peut tre donn que par la conscience.
Cet ordre de discussion peut s'appliquer toute hypothse qui fait
natre le conscient de l'inconscient. Par exemple, M. de Hartmann,
dans sa Philosophie de l'inconscient, se demande quels sont les facteurs de la conscience. Il y trouve d'une part l'esprit dans son inconscience primitive, et de l'autre la matire qui agit sur lui ; mais l'action
d'une matire inconsciente sur un esprit inconscient ne peut expliquer
en aucune manire l'origine de la conscience. La rencontre de deux
inconscients ne peut pas produire le conscient. M. de Hartmann ajoute
que la conscience n'est que la stupfaction que cause la volont
l'existence d'une ide qu'elle n'avait pas voulue, et qui cependant se
fait subir elle . Mais il ne peut y avoir stupfaction que dans un sujet dj conscient. C'est par la comparaison d'un tat nouveau un tat
antrieur que se produit la stupfaction ; si je n'ai pas dj conscience
de l'tat antrieur, je ne puis le comparer l'tat nouveau ; je ne puis
donc pas tre surpris. En tous cas, la stupfaction ne serait que l'effet
de l'apparition de la conscience ; il n'en serait pas la cause. Sans doute
l'apparition de la conscience est une chose si extraordinaire qu'il
semble que ce fait doive en effet produire en nous une vritable stupfaction, quoique ce soit l une pure illusion de notre imagination ;
mais en ce cas mme la conscience prcderait la stupfaction.
Le raisonnement prcdent s'appliquait au moi objet ; on peut faire
le mme raisonnement sur le moi sujet. Pour que le moi sujet connaisse le moi objet, il faut que le moi sujet soit dj conscient, car sans
conscience point de connaissance. Connatre implique se connatre.
Non intelligimus nisi intelligamus nos intelligere. D'o il suit que,
pour que le moi connaisse le moi, il faut qu'il soit dj moi. Un sujet
qui ne [354] serait pas moi ne connatrait pas et par consquent ne se
connatrait pas : il serait un objet, il ne serait pas un sujet. Ainsi le moi
sujet prexiste tout acte actuel de connaissance, aussi bien que le
moi objet. Le moi ne se rencontre pas, il ne se trouve pas, comme il
trouve les choses du dehors. Il se pose : c'est l le sens de cette expression clbre de Fichte. Pour le moi, se connatre, c'est tre ; tre, c'est
se connatre. Il n'y a pas l'tre d'abord, la conscience ensuite. Il y a ici
rigoureusement identit de l'intelligence et de l'intelligible.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
326
La dduction prcdente se retrouve en effet dans Fichte sous une
forme un peu diffrente, dans un court trait intitul Neue Darstellung
der Wissenschaftlehre, Nouvelle Exposition de la doctrine de la
science : 26
En tant que tu as conscience d'un objet, par exemple de cette muraille qui est devant tes yeux, tu as conscience de la pense de cette muraille, et ce n'est qu'en tant que tu as conscience de cette pense que la
conscience de cette muraille est possible. Mais maintenant, pour avoir
conscience de ta pense, tu dois avoir conscience de toi-mme. Tu as
conscience de toi, dis-tu ; distingue donc ncessairement ton moi pensant
du mme moi en tant qu'il est pens ; mais, pour que tu puisses le faire, il
faut que, dans cette pense, ce pensant soit l'objet d'un pensant plus lev,
pour pouvoir devenir objet de conscience ; tu obtiens ainsi un nouveau sujet qui a conscience de ce qui prcisment tait la conscience. Je continue
argumenter de la mme manire, et, en suivant cette loi, tu ne peux trouver aucun point o l'on puisse s'arrter. Nous sommes entrans ainsi de
conscience en conscience l'infini ; et dans cette voie nous ne rencontrerions jamais un vritable conscient.
En un mot, de cette manire la conscience est inexplicable. Mais
quelle tait la base de notre raisonnement, et pourquoi dans cette voie la
conscience est-elle incomprhensible ? Le [355] voici : c'est que chaque
objet ne peut venir la conscience que sous cette condition que j'aie conscience de moi-mme en tant que sujet conscient. Voil une proposition irrcusable. Mais dans cette conscience de moi-mme, disions-nous, je suis
un objet ; je puis donc dire de cet objet ce que je disais de l'objet prcdent, qu'il a besoin d'un sujet, et cela l'infini. L'erreur venait de ce que
dans chaque acte de conscience nous distinguions un sujet d'un objet ; et
c'est l ce qui rendait la conscience incomprhensible.
Cependant la conscience existe. Donc cette affirmation tait fausse.
Si elle est fausse, le contraire est vrai. Par consquent il y a une conscience
dans laquelle le sujet et l'objet ne peuvent pas tre spars et sont absolument une seule et mme chose. Une telle conscience est celle dont nous
avons besoin si nous voulons comprendre la conscience.
26
Fichtes Werke, t. Ier, p. 526.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
327
Des considrations prcdentes on peut tirer les consquences suivantes :
1 La conscience est un acte, un acte vritable dans le sens propre
du mot : car comment une impression subie passivement sous l'empire
d'une chose externe pourrait-elle rvler un tre le sentiment de son
intriorit ? Si on effet le sujet sentant (quel qu'en soit le substratum)
n'tait qu'une table rase, comment, par cela seul qu'il subirait l'action
du dehors, arriverait-il dire : Moi ? L'affirmation en gnral, mais
surtout l'affirmation de soi-mme, n'est-elle pas videmment une action qui part du sujet sentant et a sa racine en lui ? L'ide du moi pourrait-elle n'tre que ce que l'on appelait dans l'cole une dnomination
extrieure ?
2 La conscience est un acte a priori, car rien d'antrieur ne peut
produire ou engendrer la conscience ; s'il n'y a pas dj une conscience, il n'y en aura jamais. Comment l'intelligence, dit Bossuet,
pourrait-elle natre d'une chose brute et insense ? Quelle que soit
l'origine de la conscience, on peut affirmer qu'elle ne peut se produire
par le fait d'une action imprime un sujet inconscient ; j'entends inconscient dans un sens absolu, c'est--dire sans mme un minimum
[356] rudimentaire de conscience. Dans cette hypothse, il ne pourrait
pas mme y avoir sensation. Donc la conscience suppose la conscience ; elle est donc ncessairement inne. La statue ne sentira rien si
elle n'est pas dj anime ; et mme, tant anime et vivante, elle ne
sentira pas si elle n'est pas sentante ; et qui dit sentante dit consciente ;
elle contient donc la conscience en puissance ; celle-ci est la condition
de la sensation, loin d'en tre l'effet.
3 Il y a deux consciences, comme l'a dit Kant : 1 la conscience
empirique, sensitive, passive, dans laquelle le moi se confond avec les
phnomnes : c'est celle que Condillac exprime en faisant dire sa
statue : Je suis odeur de rose, odeur d'illet, etc. ; 2 la conscience
intellectuelle ou pure, dans laquelle le moi se distingue de ses phnomnes, les subordonne et les enveloppe dans son unit et devient sujet
pensant. Mais, de mme que la conscience, mme passive et empirique, ne peut pas sortir d'une matire insensible, si elle n'y est dj en
puissance, de mme la conscience intellectuelle et rflchie, par laquelle le moi se ddouble et se redouble lui-mme, ne peut sortir d'une
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
328
conscience purement sensible si elle n'y est dj. On comprend en effet qu'une conscience capable de devenir rflchie et double puisse se
prsenter d'abord sous une forme simple en apparence ; mais on ne
comprendrait pas qu'une conscience rigoureusement simple et tout
extrieure soit capable de se rflchir et de se ddoubler. Si donc la
conscience tait absolument identique au phnomne, comment arriverait-elle s'en distinguer ? Si la statue se confond avec l'odeur de
rose et avec l'odeur d'illet, comment arrivera-t-elle s'en sparer et
dire : Moi ? Mais, dira-t-on, il y a quelque chose de commun entre
tous les modes, et c'est cela qu'on appelle moi : soit ; mais qu'est-ce
qui sentira ce quelque chose de commun ? Si le mme qui se manifeste entre tous les tats de conscience n'est qu'une abstraction, qui
est-ce qui fera cette abstraction et o se fera-t-elle ? Ne faut-il pas
qu'il y ait une conscience du mme en mme temps que du divers pour
reconnatre le mme et s'en sparer ? Autrement [357] le moi serait
toujours confondu avec l'tat prsent. Le redoublement du moi ou le
moi rflchi n'est donc possible qu' la condition que le moi empirique, en apparence simple et passif, soit envelopp dans une conscience pure, qui est la conscience de l'identique dans le divers. Le sentiment de l'identique dans le divers ne peut tre un abstrait, un rsidu
tir de la conscience phnomnale. Cette unit fondamentale est la
condition de l'unit de la pense. Elle ne peut tre drive de rien autre
chose.
Ici nous croyons pouvoir dire que c'est interprter bien faux la
doctrine de Kant que de lui prter une sorte de neutralit absolue entre
les deux grandes doctrines du spiritualisme et du matrialisme renvoys l'un et l'autre dos dos ; on ne sait pas plus, dit-on, ce que c'est
que l'esprit, qu'on ne sait ce que c'est que la matire. Nous ignorons
les choses en soi, c'est--dire les tres, les substances. Nous ne connaissons que les phnomnes. Par consquent, la substance esprit nous
est aussi inconnue que la substance corps.
Mais il s'en faut de beaucoup que Kant mette la connaissance
mme phnomnale de l'esprit sur le mme rang que la connaissance
du corps. Oui ; pour les corps, nous ne connaissons que des phnomnes, et nous leur supposons un substratum inconnu. Mais l'esprit
connat en lui-mme autre chose que des phnomnes ; car il connat
les Catgories qui sont les lois a priori de la connaissance : or, un sujet qui a conscience des lois a priori est-il un sujet purement phno-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
329
mnal ? Que sont d'ailleurs ces catgories ? Kant le rpte sans cesse :
ce sont les lois de l'entendement, les actions, les fonctions de l'entendement, Handlungen, Functionen. L'entendement, en prenant conscience de ces actions, prend donc conscience de lui-mme. N'est-ce
pas l l'Intellect de Leibniz ? Est-ce l un sujet purement phnomnal,
comme celui de Condillac, de Hume, de Stuart Mill ? Qu'est-ce donc
que l'entendement ? Kant, il est vrai, dit que nous ne le connaissons
pas en lui-mme, parce que nous ne le saisissons que dans le temps, et
que peut-tre en lui-mme il est intemporel ; mais il n'en [358] a pas
moins conscience de lui-mme en tant qu'entendement ; donc il est
quelque chose, car on ne peut pas avoir conscience d'un rien. Qu'est-il
donc titre d'entendement ? Il est une productivit, une spontanit ;
en d'autres termes, une activit. En quoi cela est-il diffrent de ce que
nous appelons l'esprit ? Enfin quelle est la fonction fondamentale de
cet entendement ? C'est de mettre l'unit dans la pluralit. Mais comment un principe qui par essence serait multiple pourrait-il mettre
l'unit dans la multitude ? En un mot, comment un sujet pensant, dont
la loi est l'unit, dont l'essence est la spontanit, et dont les lois sont
des actions et sont a priori, c'est--dire universelles et ncessaires,
comment un tel sujet diffre-t-il de la chose pensante de Descartes ?
Sans doute il s'en distingue en ce qu'il n'est pas une substance, et qu'en
tant que substance il est inconnu lui-mme. Mais avons-nous besoin
de la notion de substance, si ce n'est titre du permanent dans le divers, de l'un dans le multiple ? Or, ce double titre, l'entendement
n'est-il pas substance ? Descartes lui-mme : semble bien avoir confondu souvent la substance avec l'attribut ; et d'ailleurs, depuis Leibniz, y a-t-il une autre caractristique digne de la substance que l'activit ? Enfin, lors mme que l'on se dciderait appeler moi phnomnal
un entendement actif, apportant l'unit avec lui et constitu par des
lois a priori, ne peut-on pas dire encore avec Ampre que le moi phnomnal ne doit pas tre en contradiction avec le moi noumnal ? Or
ce moi phnomnal est actif ; il ne peut donc driver d'une nature purement inerte ; il porte l'unit avec lui ; il ne peut donc pas driver
d'une chose multiple. Il contient l'a priori de la pense ; il ne peut donc
pas tre une table rase. En un mot, il n'est pas une chose ; mais nous
n'avons qu'un mot pour exprimer ce qui n'est pas une chose : c'est le
mot d'esprit. Il est donc un esprit.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
330
Est-ce dire cependant que nous le connaissions tout entier tel
qu'il est en soi ? Est-il un philosophe qui ait jamais soutenu cela ? En
est-il un qui ait cru que nous connaissions l'me par son ide, comme
dit Malebranche, c'est--dire comme nous [359] connaissons les figures gomtriques ? Faudra-t-il donc dire que, toutes les fois que
nous ne connatrons pas une chose gomtriquement, elle sera pour
nous comme non avenue, elle sera nulle ? Ce qui prouve d'abord que
nous ne connaissons pas l'esprit en soi, c'est que nous n'en connaissons pas l'origine, au moins par la conscience immdiate. Est-il cr
ou drive-t-il de l'esprit divin, comme le mode dpend de la substance ? O se perd-il quand il disparat ? Nous ne le savons pas davantage. Voil l'inconnu ; mais c'est l'absolu du moi qui nous chappe ; ce
n'est pas le moi lui-mme ; le moi concret nous est connu tout autre
titre qu' titre de collection de sensations ou de rsultante de choses
matrielles. Il est au moins ceci, savoir un acte simple suprieur par
lui-mme tout ce que nous connaissons sous le nom de matire. Ce
qui est au del de la conscience ne peut tre que d'ordre suprieur et
en quelque sorte divin. Au del de ce que Kant nous dcrit comme
tant l'esprit, nous ne voyons plus qu'une chose chercher, savoir le
rapport de l'esprit Dieu.
Nous avons dit, en effet, que la conscience est un acte a priori, ingnrable, absolu. Cela tant, comment expliquer les consciences finies ? Ce problme est plutt du ressort de la thodice que de la psychologie rationnelle ; nous ne pouvons donner que quelques indications que nous aurons complter plus tard.
Comment une conscience finie peut-elle tre un acte absolu ?
De deux choses l'une : ou l'on admettra que toutes les consciences
finies sont les manifestations, les projections et rfractions de la conscience infinie : c'est la solution panthistique ;
Ou bien chaque conscience finie est cre au moment de son apparition, et elle est produite d'un seul coup par un acte absolu : c'est la
solution crationniste.
Nous ne prendrons pas parti en ce moment entre ces deux solutions ; peut-tre ne sont-elles pas aussi loignes l'une de l'autre qu'on
pourrait le croire.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
331
[360]
Dans le premier cas, en effet, nous n'admettrions pas la doctrine
d'Hegel, qui consiste dire que Dieu n'arrive la conscience de luimme que dans l'homme. Ce serait dire que la conscience est ne un
jour de l'inconscient, tandis que nous avons essay d'tablir qu'elle est
ingnrable. Nous tenons au contraire pour une conscience infinie et
absolue l'origine des choses. Seulement cette conscience absolue
peut, sans rien perdre de son contenu et de sa valeur, rayonner en
consciences particulires qui seraient, selon l'expression de Leibniz,
les fulgurations de Dieu. Or, en quoi de telles fulgurations seraientelles en fait distinctes de ce que l'on appelle cration ? Car que signifie crer, si ce n'est faire arriver l'extrieur quelque chose qui n'existait pas auparavant ? Or, si la conscience infinie ne perd rien d'ellemme. et si les consciences finies ne font que s'y ajouter, de quelque
manire d'ailleurs que le fini sorte de l'infini, par rayonnement ou par
cration, n'est-ce pas au fond la mme chose ?
En tout cas, et c'est le seul point que nous voulions tablir quant
prsent, c'est que la conscience est un acte irrductible sui generis, qui
ne peut en aucune faon sortir de la matire. Elle est donc d'un ordre
suprieur, et sans aucune analogie avec elle.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
332
[361]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE PREMIER
LESPRIT
Leon V
CONSCIENCE
ET RAISON PURE
Retour la table des matires
Messieurs,
La thorie de la conscience que nous venons de dvelopper semble
bien indiquer que nous ne distinguons pas cette facult de celle que
l'on a appele la raison pure. Et en effet nous admettons qu'elle n'est
qu'une forme, un mode de la raison pure ; elle est la raison tourne
vers elle-mme, se saisissant elle-mme en mme temps qu'elle saisit
l'absolu. claircissons cette conception.
Au commencement de ce sicle, un grand dbat a eu lieu sur l'origine des principes de la connaissance. Il s'agissait de la vieille question de l'innit et de la table rase. Les sensualistes, disciples de Condillac, soutenaient que toutes les ides et toutes les connaissances drivaient de la sensation. Les spiritualistes dfendaient, au contraire, la
doctrine de l'innit, renouvele et rajeunie sous le nom de principes a
priori. C'tait la doctrine de Kant que M. Cousin et ses lves opposaient aux lves de Condillac et de Broussais. Les principes de la
connaissance, disaient-ils, ont deux caractres essentiels : la ncessit
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
333
et l'universalit. Il est vrai ncessairement et universellement que
tout phnomne a une cause , que tout mode suppose une substance , que tout corps est dans l'espace , que tout vnement a
lieu dans le temps . Or il est impossible l'exprience d'expliquer la
ncessit et l'universalit. L'exprience nous montre bien qu'une chose
est, mais non pas qu'elle ne peut pas ne pas tre ; l'exprience nous
apprend encore qu'une chose est vraie ici ou l, mais non pas partout
et toujours. Les principes [362] poss ne peuvent donc pas venir de
l'exprience et sont antrieurs l'exprience. Ils sont a priori.
Maintenant, ces principes antrieurs l'exprience, comment devons-nous comprendre leur formation ? Existent-ils dans l'esprit humain titre de principes tout forms, de propositions toutes faites ?
Non ; ils prexistent par les notions qui les constituent : notion de
substance, notion de cause, notion d'espace, notion de temps, et mme
notion d'infini, de ncessaire, d'absolu. Les principes a priori supposent des concepts a priori. 27 Ces concepts, mis en contact avec les
expriences, donnent naissance aux principes a priori. Par exemple,
l'esprit possdant la notion de substance prononcerait que tout mode
donn dans l'exprience suppose une substance et, l'aide de la notion
de cause, affirmerait que tout phnomne donn dans l'exprience a
une cause. Leibniz avait galement distingu les ides et les principes,
et il formait ses principes l'aide des ides. 28 M. Cousin admettait,
comme Kant, que les principes se forment l'aide des concepts, etc. ;
il attribuait, comme lui, ces concepts et ces principes une autre facult que la sensibilit, et qu'il appelait la raison pure.
Mais en empruntant Kant l'ide des concepts a priori, M. Cousin
avait bien vu les consquences de cette thorie, et il essayait d'y
chapper. Quelles avaient t en effet les consquences que Kant tirait
de son systme de l'a priorisme, et qu'on aurait pu tirer aussi bien du
systme de l'innit ? C'tait la subjectivit de la raison. Comment en
effet admettre que nous puissions connatre d'avance les choses sans
les avoir vues ? Comment, disait dj Voltaire dans Micromgas, l'enfant a-t-il l'ide de Dieu dans le sein de sa mre ? Comment savonsnous d'avance que l'espace a trois dimensions et que le temps n'en a
27
Voyez dans Kant, dans l'Analytique transcendantale, deux parties : Analytique
des concepts, et Analytique des principes.
28 Nouveaux Essais, 1. Ier.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
334
qu'une, que la quantit de matire est toujours la mme, que tout phnomne suppose une cause ? [363] Comment notre esprit est-il dispos de telle faon qu'il soit d'accord avec les choses ? Comment peut-il
y avoir harmonie entre la nature et l'esprit ? Kant ne voulait pas admettre cette harmonie prtablie intellectuelle, comme il l'appelait
(harmonia prslabilita intellectualis), et pour rsoudre la question
prcdente, il admettait que ce n'est pas l'esprit qui se rgle sur les
choses ; ce sont les choses qui se rglent sur notre esprit. Il semblait
donc que le subjectivisme ft la consquence lgitime et ncessaire de
l'apriorisme. M. Cousin avait vu ces consquences et avait essay d'y
chapper par sa thorie de l'aperception pure ou de la raison impersonnelle. Mais qu'tait-ce que cette aperception pure ? Aperception de
quoi ? tait-ce une sorte de vision en Dieu, comme celle de Malebranche ? Dans ce cas, les concepts a priori et les principes qui en rsultent n'auraient t que le dmembrement du concept de Dieu. taitce tout simplement (et il semble bien que, d'aprs les explications de
M. Cousin, ce ft sa pense) la raison spontane, antrieure la raison
rflchie ? Mais alors il est douteux que l'on chappt par l au subjectivisme de Kant : car pourquoi la raison spontane aurait-elle plus
de chances que la raison rflchie de voir les choses telles qu'elles
sont, et pourquoi, si elle porte en elle-mme des concepts a priori, ces
concepts seraient-ils plus exempts du doute qui pse sur toute connaissance antrieure l'intuition immdiate des choses ?
La question en tait l dans l'cole de M. Cousin, lorsque la publication des uvres philosophiques de Maine de Biran vint porter le
problme sur un autre terrain.
Maine de Biran avait essay de trouver un chemin nouveau entre le
condillacisme, qui ramne tout l'extriorit, et le kantisme, qui ramne tout l'esprit des formes abstraites et vides, antrieures et trangres la ralit ; et il s'tait appliqu surtout approfondir la notion
du sujet, et y avait vu un acte premier, permanent, indivisible, cause
et, dans une certaine mesure, substance de tous les phnomnes qui
manent de lui. cet acte il avait rattach toutes les catgories [364]
ou concepts fondamentaux qui ne sont que les diffrentes appellations
de cet acte. Ce ne sont pas simplement des lois, des rgles appeles
unir, synthtiser les phnomnes, comme le disait Kant : ce ne sont
point de simples termes, ou notions logiques qu'un sujet inconnu ou
noumne applique la matire phnomnale externe, autre noumne.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
335
Ce sont les divers points de vue du sujet lui-mme suivant ses diffrents actes, ou suivant les subdivisions de l'acte fondamental qui le
constitue.
Dans cette thorie, les catgories ne sont plus des formes a priori,
antrieures l'exprience ; elles sont tires elles-mmes d'une exprience, mais d'une exprience d'une autre nature, qui n'est plus l'exprience externe : c'est une exprience interne, rflexive, l'exprience
d'un sujet qui se connat lui-mme, qui se prsente lui-mme comme
cause et comme substance : Comment aurions-nous l'ide de l'tre,
disait Leibniz, si nous-mmes nous n'tions des tres ? Nous savons
directement ce que c'est qu'une substance, puisque nous-mmes nous
sommes des substances ; ce que c'est qu'une cause, puisque nous
sommes des causes ; ce que c'est que l'unit et l'identit, puisque nous
sommes un tre identique ; ce que c'est que la dure, puisque nous durons. Biran va mme jusqu' rattacher l'ide d'espace l'exprience de
la conscience, puisqu'il parle d'un espace interne qui serait antrieur l'espace proprement dit.
Telle est la thorie de Maine de Biran sur l'origine des notions fondamentales ; elle est en un sens fidle la thorie de l'cole exprimentale qui ne veut rien admettre a priori, et en mme temps elle refuse de donner comme origine toutes nos connaissances l'exprience
externe. Elle admet l'intuition immdiate, que Kant appelait l'intuition
intellectuelle, non sans doute de la chose en soi extrieure, mais
l'intuition du dedans, qui nous fait pntrer jusqu' l'tre, intuition qui
nous fait saisir immdiatement les lois essentielles de l'tre, lesquelles,
en tant qu'elles tombent sous la conscience, deviennent les lois mmes
de la pense.
[365]
Cette doctrine rpondait beaucoup de difficults auxquelles donnaient lieu la doctrine de Locke et la doctrine de Kant ; mais elle tait
expose elle-mme beaucoup d'objections. Elle expliquait bien les
notions premires (et encore pas celles d'infini et d'absolu, que Biran
tait oblig de rejeter dans le domaine de la croyance), 29 mais elle
n'expliquait pas les principes premiers, qui dans l'cole de Leibniz et
de Kant se reconnaissaient deux caractres : ncessit et universali29
Voir le morceau indit sur l'absolu dans la thse de M. Grard.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
336
t. Elle expliquait, par exemple, comment nous avions la notion de
substance, tant nous-mmes une substance ; mais elle n'expliquait
pas comment nous affirmons que tout mode suppose une substance ;
elle expliquait l'origine de la notion de cause, mais non pas celle du
principe de causalit. En un mot, elle ne rendait pas compte de ces
principes ncessaires et universels qui sont la garantie de la certitude
de la science.
Ces belles considrations de Maine de Biran s'introduisirent vers
1840 dans l'cole spiritualiste, et elles se fondirent ou plutt elles se
juxtaposrent avec les thories antrieures. On enseigna la fois l'origine exprimentale des notions premires dans la conscience, et l'origine rationnelle et a priori des principes premiers. Ce fut la conscience
qui fut charge d'expliquer l'origine de la notion de cause et de la notion de substance, tandis que la raison continuait expliquer les principes premiers. Il y avait l une contradiction manifeste. On sparait
les principes et les notions. Comment cela pouvait-il se faire ? Comment un principe a priori pouvait-il prexister aux notions dont il tait
le rapport ? Locke avait dj fait cette objection Leibniz : comment
un principe peut-il tre inn, lorsque les notions qu'il comprend ne
sont point innes ? Soit, par exemple, le principe de causalit : tout
phnomne suppose une cause. L'ide de phnomne est emprunte
l'exprience externe, l'ide de cause l'exprience interne. Comment
le rapport de ces deux termes [366] peut-il tre dans l'esprit avant les
notions elles-mmes ? Quant supprimer compltement la doctrine
des principes a priori et se borner la thorie de Biran toute seule,
c'est ce que l'on ne pouvait faire sans retomber dans tous les inconvnients des coles exprimentales.
Heureusement un nouveau progrs de la doctrine biranienne permettait d'entrevoir la solution du problme pos : elle recevait une notable amlioration d'un philosophe minent de nos jours, M. Ravaisson, qui, dans son Rapport sur la philosophie du dix-neuvime sicle,
tendait et dveloppait le sens de la doctrine prcdente, en affirmant
que non seulement la conscience pntrait jusqu' la substance du
moi, mais qu'elle allait mme au del et jusqu' l'infini et l'absolu, en
un mot jusqu' Dieu. Voici dans quels termes il s'exprimait :
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
337
Ce dieu particulier (le moi) ne produit rien, ne peut rien sans la vertu
suprieure du Dieu universel qui est le Bien absolu et l'Amour infini. Et ce
grand Dieu, selon une parole clbre, n'est pas loin de nous. Mesure suprieure laquelle nous comparons et mesurons nos conceptions, ou plutt
qui les mesure en nous, ide de nos ides, raison de notre raison, il nous
est plus intrieur que notre intrieur ; c'est en lui, par lui que nous avons
tout ce que nous avons de vie, de mouvement et d'existence. Il est nous,
pourrait-on dire, plus encore que nous ne le sommes, sans cesse et mille
gards trangers nous-mmes. 30
Si Dieu nous est plus intrieur que notre intrieur, c'est que nous en
avons conscience : car autrement comment saurions-nous qu'il nous
est intrieur ? La conscience se confond donc avec la raison pure ; elle
est, comme celle-ci, la facult de l'absolu. Nous admettons pour notre
part cette doctrine, avec cette restriction que nous ne voudrions pas
appeler Dieu ce fond mystrieux et inconnu qui se cache sous la conscience de nous-mmes. L'ide de Dieu est une ide trop [367] complexe, et qui rsulte d'une trop longue laboration philosophique et
sociale, pour qu'on puisse dire que nous avons directement et immdiatement conscience de Dieu ; mais nous accordons volontiers que
nous avons conscience de quelque chose de plus que de nous-mmes,
conscience d'un milieu sans fond o nous sommes plongs et qui nous
dpasse de toutes parts ; en un mot, je crois que l'on peut dire que
nous avons conscience de l'infini et de l'absolu, et, d'une manire plus
gnrale encore, nous avons conscience de l'tre indtermin. Et tant
que nous sommes un tre, nous avons conscience de l'tre en gnral
et de ses conditions fondamentales.
Celle belle conception n'avait pas chapp la haute sagacit de
Victor Cousin ; mais il n'en avait pas tir parti. Voici comment il s'exprimait, en termes admirables, dans l'argument du Premier Alcibiade :
30
Ravaisson, Rapport sur la philosophie du dix-neuvime sicle, lre dition, p.
245.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
338
N'est-ce pas un fait que sous le jeu vari de nos facults, et pour ainsi
dire travers la conscience claire et distincte de notre nergie personnelle,
est la conscience sourde et confuse d'une force qui n'est pas la ntre, mais
laquelle la ntre est attache, que le moi, c'est--dire toute l'activit volontaire, ne s'attribue pas, mais qu'il reprsente sans toutefois la reprsenter intgralement ; laquelle il emprunte sans cesse sans jamais l'puiser ;
qu'il sait antrieure lui parce qu'il se sent venir d'elle et ne pouvoir subsister sans elle ; qu'il sait postrieur lui puisque, aprs des dfaillances
momentanes, il se sent renatre dans elle et par elle ? Exemple des limites
et des troubles de la personnalit, cette force, antrieure, postrieure, suprieure celle de l'homme, ne descend pas des actes particuliers, et par
consquent ne tombe ni dans le temps ni dans l'espace, immobile dans
l'unit de son action infinie et inpuisable, cause invitable et absolue de
toutes les causes contingentes et phnomnales, substance, existence, libert pure Plus l'me se relire des lments profanes qui l'environnent,
plus elle revient et s'attache l'lment sacr, au Dieu qui habile on elle ;
et ainsi elle se [368] connat elle-mme, puisqu'elle se connat non seulement dans son tat actuel, mais dans son tat primitif et futur, dans son essence.
Cette doctrine de la conscience immdiate de l'infini en nous sera
peut-tre accuse de panthisme. Ce n'est pas ici le lieu de discuter le
panthisme : cette discussion viendra en son lieu. 31 Je me contente de
dire que, selon toutes les thologies et toutes les mtaphysiques, Dieu
est partout ; ce que nous appelons conscience de l'infini n'est que la
conscience de l'ubiquit divine. Ce n'est pas tout d'ailleurs de distinguer le sujet humain et le sujet divin ; il faut encore les unir. Ici encore
je ne connais aucune mesure qui permette de fixer le degr d'union en
de ou au del duquel on sera ou l'on ne sera pas panthiste. La distinction des deux sujets est le seul point fondamental ; quant la participation de l'un et de l'autre (selon l'expression de Platon), vous pouvez la supposer aussi intime qu'il vous plaira, pourvu qu'elle n'aille
pas jusqu' l'absorption. Et comment pourrions-nous savoir, moins
d'tre Dieu lui-mme, jusqu' quel point le sujet fini et le sujet infini
peuvent se pntrer sans se confondre ? Le faible du disme philoso31
Voir livre IV.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
339
phique, c'est de concevoir Dieu comme une chose spare, en dehors
du moi, en dehors du monde. Le fort du panthisme est de concevoir
Dieu comme en dedans du monde. Deus est in nobis ; in Deo vivimus.
Dieu est en nous, et nous sommes en Dieu. C'est cette intriorit de
Dieu dans le moi qui fait la force du panthisme, et c'est l l'essence
de toute religion. Le rite par excellence 32 c'est la communion, l'eucharistie ; c'est le symbole le plus pur de l'intriorit divine mle l'intriorit de l'esprit. Le dogme chrtien de l'incarnation est encore un
admirable symbole de l'union du fini et de l'infini : c'est le divin mariage des deux personnalits. Le procs de la transcendance et de
l'immanence touche sa fin, dit M. Littr. Il a raison ; l'une et l'autre
sont la vrit : Dieu est la fois et en nous et hors de nous.
[369]
On demandera quelle diffrence il y a entre cette conception et
celle de la vision en Dieu de Malebranche. Je rpondrai qu'il n'y en a
pas, si ce n'est que, dans notre pense, Dieu est le fondement interne
de l'intuition du moi, tandis que dans Malebranche Dieu est encore, en
quelque sorte, un objet externe. Autrement, c'est bien l'ide de l'tre,
de l'tre infini, de l'tre indtermin, comme dit Malebranche, qui est
le fond dernier de notre raison ; et les catgories ne sont que les lois
de l'tre en gnral, identiques aux lois de la pense.
Cela tant, on peut dire que la conscience et la raison sont identiques. La conscience, c'est la raison elle-mme se renfermant dans la
limite du moi. En prenant conscience de nous-mmes, nous prenons
conscience des conditions universelles de l'intelligibilit. Ce n'est pas
seulement de notre moi individuel, de notre substance individuelle que
nous avons conscience, c'est de cette condition gnrale de toute existence, d'tre la fin cause et substance, unit et identit, et mme encore cause et fin. Ce ne sont point des formes abstraites et vides, s'imposant du dehors des phnomnes qui leur sont htrognes ; ce sont
les lois de la vie dont nous prenons conscience en vivant ; ce sont les
lois universelles de l'tre dans lequel nous sommes plongs : in Deo
vivimus, movemur et sumus.
Nous ne faisons ici que dvelopper la pense de Leibniz dj cite,
savoir que l'ide de l'tre nous est inne, puisque nous sommes des
32
Voir livre IV.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
340
tres. tant des tres, nous participons l'tre ; l'tre individuel et
l'tre universel se confondant en nous, nous ne pouvons saisir l'un
sans pntrer dans l'autre ; nous apprenons ainsi, sans sortir de nousmmes, qu'il n'y a point de phnomnes sans tre et sans action, que
l'tre en lui-mme est essentiellement action, et action permanente,
une et identique. Ce n'est plus seulement une intuition empirique ;
c'est la loi mme de la pense saisie immdiatement dans l'intuition du
moi.
On a dit que si l'tre est objet d'intuition, il deviendra par [370] l
mme un fait, et un fait particulier, et que l'on retombe ainsi dans
l'empirisme. Cette objection est une ptition de principe : car la question est prcisment de savoir si l'intuition est capable d'aller au del
des phnomnes et d'atteindre l'tre. On se demande pourquoi on
pourrait nier a priori la possibilit d'une conscience de l'tre, et pourquoi, par cela seul que l'tre prendrait conscience de lui-mme, il deviendrait un pur phnomne, le phnomne de lui-mme . Ce serait
refuser ternellement l'tre la possibilit de se connatre, et l'on se
demande si, aprs tout, il ne vaudrait pas mieux pour l'tre de passer
l'tat de phnomne de soi, que de rester dans une ternelle ignorance.
Si donc on admet une conscience de l'tre par lui-mme, pourquoi n'y
aurait-il pas des manifestations diverses de cette conscience dans le
moi particulier ? Pourquoi le moi ne serait-il pas une des fulgurations
de cette conscience universelle ?
En rsum, la thorie de Biran pousse jusqu' Malebranche, la vision en Dieu transport du dehors au dedans, la raison identifie avec
la conscience, l'ide de l'tre en gnral consubstantielle l'ide du
moi, telle est la solution que nous donnons au problme de l'origine de
la connaissance a priori. Nous opposons rsolument cette sorte d'intuitionnisme raliste au formalisme mcanique de Kant, qui ne vit que de
fantmes. l'armature de fer invente par ce philosophe, et qui se
compose de trois ou quatre cuirasses superposes, nous substituerons
le jeu libre et vivant de l'esprit se pensant lui-mme et qui est la fois
tre et pense. C'est le dveloppement naturel du cogito cartsien.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
341
[371]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE PREMIER
LESPRIT
Leon VI
LE CERVEAU ET LA PENSE
Retour la table des matires
Messieurs,
Nous avons fait reposer toute la force de notre doctrine sur le fait
que nous avons appel l'indpendance de la pense ; et nous avons
tabli ce fait en nous appuyant surtout sur le caractre absolu et ingnrable de la conscience. La conscience ne peut avoir sa raison d'tre
qu'en elle-mme. Elle est donc substantiellement indpendante de
l'existence matrielle laquelle elle est jointe, et dont elle subit la
vrit les conditions.
Mais c'est cela mme, c'est cette dernire circonstance qui cre une
difficult nouvelle. Une indpendance qui ne rside que dans la nature
de la substance est-elle suffisante ? quoi sert-elle, si en fait et dans
son dveloppement elle subit des conditions, et si ces conditions sont
celles de la substance matrielle laquelle elle est unie ? Comment
parler d'indpendance de la pense, en prsence de ces trois lois que
nous avons nonces : point de cerveau, point de pense ; partout
o il y a cerveau, il y a pense ; variations du cerveau, variations
correspondantes dans la pense. En supposant donc que l'on admette
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
342
une indpendance de la pense que l'on pourrait appeler subjective, en
ce sens que le sujet pensant n'aurait sa raison d'tre qu'en lui-mme, il
est impossible de nier une certaine dpendance objective, c'est--dire
l'assujettissement du sujet des conditions matrielles et physiologiques. M. H. Spencer, par exemple, admet comme nous l'indpendance des deux classes de phnomnes (sensation et mouvement), la
sensation, dit-il, ne pouvant se traduire en termes [372] de mouvement, ni le mouvement en termes de sensation . Mais il tablit ce
qu'il appelle la loi de correspondance, c'est--dire la ncessit d'une
concomitance constante d'un lment physique avec un lment mental, et mme le conditionnant. Or, pratiquement, quelle diffrence y at-il entre dire : La pense n'est qu'une fonction du cerveau, ou
dire : La pense ne se manifeste que par le moyen du cerveau ? La
matire, au lieu d'tre la substance des phnomnes, en sera la loi ncessaire ; or, tre un mode de cerveau, ou bien ne pouvoir agir sans
lui, n'est-ce pas la mme chose au point de vue de ce que nous avons
appel la dignit de la pense ?
Il ne suffit donc pas d'tablir une indpendance de substance, il
faudrait pouvoir tablir une indpendance de fait.
Et mme, en y regardant de prs, on peut se demander si ce rapport
du cerveau et de la pense est bien facile comprendre dans l'hypothse d'une indpendance substantielle. Le spiritualisme croit pouvoir
expliquer suffisamment les faits en admettant que le cerveau est l'instrument, l'organe de la pense, sans en tre le substratum. Cette ide
d'un organe de la pense est-elle quelque chose de rationnel et d'intelligible dans la supposition d'une indpendance substantielle ? Comment l'me, qui, par hypothse, serait substantiellement indpendante
et dont l'essence serait de penser, est-elle oblige cependant en fait
d'avoir recours une autre substance qu'elle-mme pour accomplir ses
propres oprations, c'est--dire pour penser ? On comprend que pour
accomplir une action externe il faille un organe du mme ordre et de
la mme nature que l'objet de l'action, une main pour prendre, des
jambes pour marcher ; on comprend, par exemple, que pour transporter le corps d'un point un autre de l'espace, il faille un organe mobile
que Platon compare un char ; que pour renouveler l'air "vital qui entretient notre existence, il faille une sorte de creuset, o s'accomplisse
l'action chimique appele oxygnation du sang ; de mme pour la nutrition ; de mme aussi pour la vision, l'audition, la gustation. Mais en
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
343
est-il de [373] mme pour la pense ? Il semble que non. La pense
est l'acte propre de l'esprit, et elle se renferme dans l'esprit. Or, comment un tre, pour accomplir son action propre, a-t-il besoin de l'opration d'un autre tre ? Comment puis-je penser avec autre chose et
par autre chose que mon esprit ? Penser avec mon cerveau n'est pas
plus intelligible pour moi que de penser avec le vtre. En un mot, la
doctrine du cerveau instrument ne semble gure moins matrialiste
que la doctrine du cerveau substance.
Cette difficult, ce qu'il nous semble, n'a jamais t examine
d'assez prs ; voyons quelle en est la valeur. Remarquons d'abord qu'il
y a une partie des fonctions du cerveau qui chappe l'objection : ce
sont les fonctions motrices. Le cerveau n'est pas seulement un organe
de perception et de pense ; il est aussi organe de volont. La volont
sans doute est aussi une action interne comme la pense, mais une action qui, tout interne qu'elle est, a un but externe, qui est de produire
du mouvement : car toute action se traduit en mouvement. Il faut donc
agir sur les organes moteurs ; et pour cela on comprend l'utilit et
mme la ncessit d'un organe central ou mme de plusieurs, soit cerveau, soit moelle pinire, etc.
Cela tant, le cerveau tant l'intermdiaire par lequel l'me agit sur
le monde extrieur, on comprend dj par analogie comment il peut
tre ncessaire de supposer un organe central qui, rciproquement,
transmette au sujet les actions du monde extrieur, de sorte que l'on
pourrait dire que le cerveau n'est pas l'organe de la pense, mais qu'il
en est en quelque sorte l'objet et le terme immdiat. Expliquons-nous.
Toute pense suppose deux choses : un sujet et un objet. Il ne suffit
pas que je pense, il faut que je pense quelque chose ; ce quelque
chose, c'est l'univers.
Si l'on suppose un esprit pur, un esprit sans organe mis en prsence
de l'univers, qu'arriverait-il ? Comment pourrait-il le saisir, le percevoir, le comprendre, c'est ce que nous ne pouvons dire, ce mode de
perception et d'intuition nous tant [374] absolument inconnu. Mais ce
que nous concevons facilement, c'est qu'il puisse y avoir avantage
pour le sujet pensant tre mis en rapport immdiat avec un univers
rduit et condens, o toutes les actions du dehors qui nous sont ncessaires soient enregistres comme dans un phonographe, de telle
sorte que chacun de nous ait, pour ainsi dire, son univers propre qui
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
344
soit insparable de son existence et o il puisse lire comme dans un
livre. Cet univers propre de chacun de nous, ce microcosme, comme
l'appelaient les alchimistes, c'est le cerveau. Toutes les actions de
l'univers extrieur auxquelles sont lies et rpondent nos propres actions, sont condenses dans notre cerveau, qui est la fois un organe
rcepteur, et un organe actif et moteur. C'est au cerveau que nous
sommes immdiatement unis ; et c'est par le moyen de cet univers en
raccourci que nous passons l'univers rel, en vertu de la mme loi
qui nous fait situer les objets de la vision l'extrmit des rayons
qu'ils nous envoient, ou que nous sentons les objets au bout d'un bton. C'est la pense de Leibniz lorsqu'il dit que l'me est le miroir de
l'univers ; mais ce miroir de l'univers a pour intermdiaire le corps
propre ; et c'est par ce corps propre que nous percevons les autres
corps. Cette doctrine est le dveloppement de celle que Leibniz a rsume dans la Monadologie.
Ainsi, quoique chaque monade cre reprsente tout l'univers, elle
reprsente plus directement le corps qui lui est affect particulirement et
dont elle fait l'entlchie ; et comme ce corps exprime tout l'univers par la
connexion de toutes les matires dans le plein, l'me reprsente aussi tout
l'univers, en reprsentant le corps qui lui appartient d'une manire particulire.
On comprend par l comment une substance spirituelle est unie
un corps, quelle que soit d'ailleurs la nature essentielle de ce qui constitue le corps en gnral. Le corps propre semble jouer pour la pense
le mme rle que l'organe de la vision pour la perception des images.
On conoit une sensibilit lumineuse sans appareil optique ; car, tous
les rayons [375] tant confondus, il n'y a plus d'autre vision que celle
de la sensibilit la lumire ; mais par le moyen de l'appareil optique
appel il, soit l'il simple des animaux suprieurs, soit les yeux
composs dits facettes des insectes, l'animal peut percevoir des
images, c'est--dire des objets distincts. Par analogie, on peut concevoir qu'une monade simple, mise en contact avec l'univers entier pris
dans son ensemble, n'aurait que la perception confuse de l'tre et serait
dans cet tat que Leibniz appelle la perception sans aperception. Ne
percevant rien de distinct, elle ne percevrait rien proprement parler
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
345
et n'aurait que la pense en puissance. Au contraire, par le moyen des
organes des sens qui font office de discriminateurs et qui nous prsentent sparment les diverses qualits des corps, le son sans lumire, la
chaleur sans la rsistance, etc., grce au cerveau surtout, qui, conservant la distinction de ces proprits, les fait converger cependant de
manire sauvegarder l'unit et l'individualit des objets , nous arrivons connatre les objets distincts les uns des autres. Si le caractre
propre de la pense, comme le disent les Anglais, est la discrimination ; si penser c'est distinguer ; s'il est vrai aussi, comme dit Kant,
que penser soit ramener la multiplicit l'unit, la machine qui nous
sert discerner les objets, et en mme temps les concentrer en un
point favorable, sera une machine penser.
Ces actions de l'univers externe, une fois imprimes dans le cerveau, y subsistent ; et la mmoire est l'art par lequel nous tirons de ce
phonographe intrieur les paroles qui y sont enregistres. Lorsqu'une
de ces cellules se dtruit, il y a un son qui disparat, une image de
moins. Si le dsordre se met dans l'appareil, notre esprit se drange,
comme il se drangerait coup sr si l'univers tombait dans le chaos.
En un mot, rien de plus facile comprendre que les trois propositions
ci-dessous : point de pense sans cerveau ; point de cerveau sans pense ; point de changement dans l'un des deux termes sans changement
dans l'autre. Cette dpendance apparente de la pense au cerveau reprsente simplement le rapport [376] ncessaire de la pense son
objet, ou du moins son objet fini, savoir l'univers ; et demander
pourquoi il y a un cerveau, c'est demander pourquoi il y a un univers.
Maintenant ce mode de connaissance par l'intermdiaire du cerveau est-il le seul ? L'esprit ne peut-il pas connatre immdiatement la
chose sans organe comme il se connat .lui-mme ? Nous n'en savons
rien. En fait, il n'en est pas ainsi ; c'est pourquoi il est profondment
vrai de dire avec Kant que nous ne connaissons pas les choses en soi,
c'est--dire d'une manire purement intellectuelle, comme Dieu les
connat par exemple. C'est encore dans ce sens qu'il est vrai de dire
qu'il n'y a point d'intuition intellectuelle. Nanmoins, de ce que ce
mode de connaissance est en dehors de notre connaissance, il ne s'ensuit nullement qu'il soit impossible en soi. De l la possibilit d'une
survivance de la raison pure, soit sans organes, soit lie d'autres organes qui nous sont absolument inconnus.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
346
Nous croyons avoir expliqu d'une manire gnrale la loi de correspondance entre le physique et le moral. Reste examiner maintenant si cette correspondance est aussi absolue et aussi rigoureuse
qu'on le dit. Nous ne contestons pas les faits ; mais le dbat peut avoir
lieu sur l'interprtation des faits. Nous croyons que, lors mme qu'on
admettrait cette correspondance entre les deux lments, l'un mental,
l'autre physique, il n'y aurait rien en conclure contre le principe de
l'indpendance de la pense.
En effet, il ne s'agit pas de soutenir l'existence d'une pense pure
sans aucun mlange d'ides sensibles. Une telle pense, nous venons
de le voir, n'est pas le fait de l'homme. Il n'y a pas plus de pense pure
que d'esprit pur, c'est--dire d'esprit sans corps, au moins dans la
sphre de notre connaissance. Mais il suffit que les choses spirituelles
et intelligibles soient en fait et ncessairement associes des ides
sensibles, pour que le fait de la correspondance s'explique de la manire la plus naturelle. L'entendement, le , est sans matire,
, comme dit Aristote, si ce n'est par accident ; mais cette [377]
union accidentelle suffit pour qu'aucune opration intellectuelle n'ait
lieu sans que le cerveau y soit intress. Mais il nous faut examiner de
plus prs la loi dont il s'agit.
L'cole empirique moderne tient honneur d'avoir tabli celle loi,
savoir qu'il n'y a pas de phnomnes mentaux qui ne soient point
accompagns de phnomnes physiques, et rciproquement. Il y a l
une erreur historique : ce n'est pas l une dcouverte. Cette loi tait
parfaitement connue des cartsiens. On peut dire que c'est Descartes
qui l'a dcouverte et qui en a fait l'usage le plus neuf dans son Trait
des passions. C'est Malebranche qui l'a dveloppe dans sa Recherche
de la vrit ; et si les cartsiens faisaient quelques rserves, nous allons voir que ces rserves sont encore de mise, mme aujourd'hui.
En effet, il ne s'agit pas, nous l'avons vu, d'une pense pure, d'un
esprit pur, d'une pense ou d'un esprit sans aucun contact avec les
choses matrielles. Pas de pense sans organe, et par consquent sans
images sensibles. Mais, cela accord, s'ensuit-il que dans cet ensemble
complexe que l'on appelle phnomnes intellectuels, tout sans exception corresponde un phnomne physique, et ne peut-il pas se faire
que, dans cet ensemble, li en gnral des reprsentations sensibles,
il y ait quelques lments qui ne correspondraient pas ces reprsentations et l'action des choses extrieures sur le cerveau ?
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
347
Signalons quelques-uns de ces lments, hypothtiquement sparables de cette exprience sensible. Il ne peut entrer dans notre plan
d'introduire ici pisodiquement une discussion spciale et approfondie
sur l'origine des ides. Il nous suffira d'indiquer comment il pourrait
se faire que, mme dans l'hypothse de la correspondance, il y ait encore dans chaque pense concrte et actuelle un lment intelligible
qui ne relverait pas de la matire.
Prenons pour exemple l'ide du Temps, et cherchons nous reprsenter par quel moyen matriel cette ide aurait pu s'introduire dans
l'esprit. On comprend en effet que la [378] couleur, par exemple, tant
une qualit des corps et, si l'on veut, un mouvement extrieur, ne
puisse arriver l'esprit qu'en produisant dans le cerveau un mouvement correspondant au mouvement externe et qui soit la condition de
la sensation, et de mme pour toutes les sensations qui appartiennent
l'tendue. Mais quelle peut tre la forme d'un mouvement, soit extrieur, soit crbral, qui correspondrait l'ide de temps ? Cette ide ne
peut avoir qu'une forme interne, au sens subjectif : c'est une ide essentiellement intellectuelle. 33 Et cependant, comme elle n'existe jamais seule, mais qu'elle accompagne toutes les autres ides, il suffit
que ces ides soient sensibles ou lies des conditions sensibles, pour
que l'ide de temps fasse partie d'un complexum dont l'un des termes
est ncessairement crbral et organique. Et quel moyen aurait-on de
prouver que tous les lments du fait intellectuel sans exception sont
reprsents dans le fait physique qui lui correspond ? Par quelle analyse dcomposerait-on le fait crbral, et dans quelles balances le placerait-on pour pouvoir affirmer, comme Lavoisier dans la thorie de la
combustion, qu'il n'y a rien de plus dans le phnomne intellectuel que
dans le fait physique, les deux phnomnes tant htrognes et entirement incommensurables ? Pour prouver que l'ide de temps dpend
du cerveau, on invoquera les altrations de la mmoire ; mais si le matriel de la mmoire est altr, on conoit que la forme, c'est--dire
l'ide de temps, reste l'tat de forme vide, et que par suite les souvenirs soient dsordonns et mme dplacs dans le temps ; mais cela ne
prouve pas que le temps soit li telle ou telle condition crbrale.
Ainsi, par exemple, les souvenirs d'enfants, ou plutt les impressions
33
J'entends par l qu'elle n'a pas une forme matrielle et physique. Autrement
j'admets volontiers, avec Kant, qu'il est une loi de la sensibilit.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
348
de l'enfant revenant seules dans la vieillesse, pendant que les impressions prsentes disparaissent toutes, le vieillard redeviendra enfant,
tombera en enfance comme on dit : mais ce n'est pas la notion de
temps qui est altre ; ce sont les impressions qui y sont jointes.
[379]
On peut en dire autant de la notion de causalit. Sans doute, si on
russit identifier, comme les phnomnistes, la cause une simple
concomitance ou succession de phnomnes, on pourra ( l'aide toutefois de l'ide du temps) trouver une origine externe et physique
l'ide de cause. Mais c'est l une thse fort sujette controverse. Nous
ne voulons pas nous y engager. Disons seulement que, pour peu qu'on
refuse d'admettre l'origine externe de la notion de causalit, soit que
l'on admette que cette notion est due au sentiment intrieur de notre
activit personnelle, soit qu'on la considre comme une loi a priori,
dans les deux cas c'est une notion qui n'est pas produite par une action
physique du dehors sur le cerveau, par un mouvement crbral particulier. Or cette notion se mle sans cesse toutes nos expriences et
ne se manifeste jamais l'tat pur ; elle est donc toujours associe
des ides de phnomnes sensibles. On comprend ainsi que toutes les
oprations intellectuelles auxquelles elle est mle soient accompagnes de phnomnes physiques correspondants, sans qu'on puisse
distinguer dans le total ce qui est intelligible et ce qui est sensible. Il
n'en est pas moins vrai que, dans cette hypothse, il y aurait l un lment qui n'aurait point de correspondant organique, ou du moins dont
la part dans le complexum ne saurait pas reprsenter organiquement.
plus forte raison en est-il de mme des notions purement mtaphysiques, savoir les notions d'infini, d'absolu et de parfait, si l'on
admet la ralit de ces notions ; or, pour peu qu'on admette que ces
ides ne sont pas simplement la ngation de leurs contraires, fini, contingent, imparfait, et qu'elles ont un contenu propre, on ne se reprsentera aucune action physique externe, aucune vibration crbrale capable d'expliquer l'apparition de telles ides dans notre conscience.
Mme l'ide d'inconnaissable, par laquelle l'cole de Herbert Spencer
a remplac toutes les autres, par cela seul qu'elle les domine et les enveloppe et qu'elle n'est aucune d'elles en particulier, n'est reprsentable par aucun [380] mouvement crbral distinct ; elle n'est dans
aucune cellule ; elle est, dit Spencer, le fond mme de la pense ; elle
ne peut donc venir d'ailleurs : car quelle sensation pourrait reprsenter
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
349
l'inconnaissable ? Que toutes ces ides d'ailleurs soient mles des
ides purement sensibles, et qu'il soit impossible de les obtenir exprimentalement l'tat pur, cela est certain ; de l vient l'tat de mlange auquel elles se prsentent nous ; mais l'existence de cet lment pur n'en serait pas moins certain, comme ces substances dont les
chimistes admettent l'existence quoiqu'ils ne les aient jamais rencontres l'tat pur dans la ralit.
Indpendamment des concepts prcdents, dont on pourrait multiplier la liste, il y a encore un ordre de faits qui ne peuvent tre reprsents physiquement, mme lorsqu'ils sont accompagns de corrlations physiques. Ce sont les rapports logiques des ides et des penses. quel mouvement crbral peuvent se rapporter toutes les oprations qui sont reprsentes dans l'esprit et dans le langage par les
mots or, donc, car, puisque ? Quelle forme de vibration peut correspondre dans le cerveau ces sortes de phnomnes ? la vrit, on
fait de grands efforts aujourd'hui dans l'cole empirique pour ramener
les rapports logiques de simples rapports de coexistence et de succession. Mais ce fait mme et cet effort nous prouvent combien il est
difficile de comprendre directement que le raisonnement, en tant que
tel, que la justesse des liaisons logiques soit un phnomne crbral.
Sans doute, on trouve qu'un homme qui travaille de l'esprit a consum
au bout d'une heure ou deux une certaine quantit de substance organique, qu'il a brl, comme on dit, une certaine quantit de matire ;
mais il en serait tout fait de mme dans le cas o le raisonnement
serait un acte entirement spirituel ; car le raisonnement porte toujours
sur des choses relles ou sur des choses qui, mme spirituelles, se rapportent ncessairement des choses sensibles qui sont reprsentes
dans le cerveau d'une manire quelconque. Le cerveau tant oblig
d'accomplir un travail, on comprend [381] qu'il s'use aussi bien que
toute machine ; mais cela ne prouve nullement que l'opration intellectuelle en elle-mme soit machinale.
Rien ne prouve donc que les rapports logiques soient reprsents
dans le cerveau par un lment quelconque, et, quoique le dsordre
crbral amne le dsordre logique, il n'y a rien en conclure : car il
est facile de comprendre que, si la matire de la pense est trouble, la
pense elle-mme soit trouble, et dans la mme proportion. Si, par
hypothse, dans un ministre ou dans une grande maison de commerce, tous les papiers, tous les documents se trouvaient tout coup
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
350
confondus ensemble de manire former un vritable chaos, aucune
force intellectuelle ne serait capable de rtablir l'ordre et le lien dans
cet amas confus ; et cependant, dans ce cas, on ne peut confondre la
facult intellectuelle avec les pices ou documents dont elle se sert.
Par analogie, nous dirons que le dsordre intellectuel qui pourrait tre
la consquence d'un dsordre crbral ne prouve nullement que le raisonnement, en lui-mme, en tant qu'opration logique, dpende des
conditions crbrales.
Quant la rduction des rapports logiques des rapports de juxtaposition externe de sensations, nous ne pouvons entrer dans l'analyse
de cette question, qui embrasse toute la logique ; disons seulement que
la liaison logique des ides semble si peu se confondre avec la loi
d'association empirique, que l'une doit sans cesse se dfendre contre
l'autre ; l'enchanement continuel des impressions est absolument le
contraire de la pense libre. Plus la loi d'association domine, plus
l'intelligence est asservie, moins le sujet a la possession de lui-mme.
Leibniz a suffisamment insist sur les diffrences des conscutions
auxquelles obissent les intelligences animales et les liaisons logiques
et rationnelles qui constituent l'entendement des hommes.
J'en dirai autant de toutes les oprations par lesquelles l'esprit agit
et travaille sur la matire de ses ides de manire la faire servir des
combinaisons nouvelles : l'attention, la [382] rflexion, la combinaison, l'analyse et la synthse, et, d'une manire gnrale, tout ce que
l'on appelle l'activit de l'esprit. Comment se reprsenter sous la forme
d'un mouvement physique le fait de la rflexion d'une pense qui se
redouble, qui revient sur elle-mme ? Comme nous l'avons dit dj
plus haut, le philosophe Fichte a justement fait remarquer que le mouvement extrieur constitue une srie simple o chaque fait est la suite
du prcdent, tandis que la pense constitue une srie double qui revient sur elle-mme. La loi de la correspondance ne prouve rien contre
cette indpendance de la rflexion et des facults discursives : car ces
facults s'appliquent quelque matire, et c'est cette matire qui est
labore par le travail crbral. Ainsi, mme si l'on considre la rflexion comme indpendante en soi, mme alors son opration serait
toujours accompagne d'un travail crbral, et ce travail ne prouverait
rien contre l'indpendance de la facult.
Il en est encore de mme d'un autre fait intellectuel qui chappe
galement toute reprsentation physique, savoir le fait de l'inven-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
351
tion intellectuelle. Comment la susceptibilit nerveuse des cellules qui
n'agissent qu'autant qu'elles ont t affectes par une action du dehors,
en vertu des lois du dterminisme, comment, dis-je, cette susceptibilit passive qui ne retient que les impressions pourrait-elle anticiper sur
l'avenir et mettre en lumire des ides dont le type matriel n'existe
pas ? Comment aussi, dans le cas o le gnie joue sur les cellules crbrales comme sur les touches d'un piano, comment se produit-il sur
ces diffrentes louches une harmonie toute nouvelle ? Par exemple
dans le cas d'une cration musicale, il a fallu toucher les notes les plus
diffrentes et les plus loignes. Comment a-t-il pu en sortir un air
nouveau ayant son commencement, son milieu et sa fin, formant un
tout, si l'invention n'et t qu'une rsultante obissant au dterminisme, au lieu d'tre une activit indpendante qui lui commande ?
Mais nous insisterons bientt sur ces diffrents faits.
Allons enfin jusqu'au fait initial et caractristique de la [383] pense, savoir le jugement. Toute pense, et en particulier le jugement,
qui est l'acte essentiel de la pense, est une synthse. Penser, c'est ramener la multiplicit l'unit, comme Kant l'a profondment enseign. Il n'y a pas de pense dans une simple juxtaposition d'lments
diffrents. Les philosophes anglais ont dit : Penser, c'est discriminer ;
cela est peut-tre vrai en un sens ; mais, en un autre, on peut dire plus
vritablement encore : Penser, c'est identifier, c'est mettre l'unit dans
la pluralit. Or comment cet acte d'unification est-il possible ? Si ce
principe ne possde pas dj l'unit par lui-mme, comment le multiple pourrait-il apporter l'unit dans la multiplicit ? Le principe qui
domine et gouverne le multiple est donc suprieur au multiple. Les
travaux rcents sur la localisation crbrale rendent plus ncessaire
que jamais le principe d'unit. On distingue aujourd'hui dans le cerveau quatre siges diffrents pour la facult du langage, et par suite
quatre espces de langage : le langage lu, le langage crit, le langage
entendu et le langage parl. Cependant, trs souvent dans un seul et
mme acte les quatre langages sont runis. Quand j'cris, je lis ce que
j'cris ; j'entends les mots et je les prononce mentalement ; ainsi il y a
quatre mots dans mon esprit, et je les pense la fois comme un seul
mot ; et de plus je comprends ce que ce mot signifie. Frapperait-on
la fois dans quatre endroits diffrents, s'il n'y avait pas un seul et
mme agent pour concentrer ces quatre actions en une seule ?
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
352
Pour conclure, c'est au nom de la science que l'on cherche a rduire
l'homme n'tre qu'un objet matriel. Mais on peut dire qu'en parlant
ainsi la science se rfute elle-mme. En effet, l'homme se distingue de
tous les autres objets de la nature prcisment en ceci qu'il est capable
de science. Il n'est pas seulement l'objet de la science, il en est le sujet.
Une pierre est objet de science ; mais elle n'est pas capable de science,
elle ne peut faire la science ni d'elle-mme ni des autres choses. Les
astres, la terre, les minraux, les plantes, les animaux, ne sont pas capables de science. Ils n'tudient ni [384] eux-mmes ni les autres objets au point de vue scientifique. Ils subissent la science, ils ne la font
pas. Ils sont le terme passif auquel s'applique la science ; ils ne sont
pas le terme actif qui applique la science ce terme. Au contraire,
l'homme est sans doute, comme tout le reste, un objet de science. Sans
doute son corps et mme son esprit doivent tre contempls litre
d'objet par l'esprit. Mais il faut que ce soit l'esprit lui-mme qui fasse
cela ; et lors mme que l'on prend toutes les mesures pour dgager de
la science de l'homme toute subjectivit, pour en faire un pur objet,
c'est encore l'homme qui fait cela. C'est l'esprit humain lui-mme qui
cherche s'objectiver, s'impersonnaliser. Le philosophe mme qui
construit la srie des tres, qui dcrit l'chelle des phnomnes allant
du simple au compos, et qui fait natre toutes les formes les unes des
autres, celui-l se distingue lui-mme de toute la srie en un sens que
c'est lui-mme qui la fait, lui qui en reconnat l'unit.
Il y a donc un moment, dans la srie phnomnale, o il y a un
phnomne qui se retourne en quelque sorte vers tous les autres, qui
rflchit tous les autres et les subordonne lui, et qui se connat et se
contemple dans cette opration. Par l mme l'esprit atteint une dignit qui ne se rencontre pas dans les choses extrieures. Mais comment
serait-il capable d'atteindre cette dignit, s'il ne l'avait pas dj ?
C'est cause de ce caractre essentiel que Pascal a pu dire : Nous
relevons de la pense, non de l'espace et de la dure. S'il en est ainsi,
comment ce principe dominateur des phnomnes ne serait-il que l'accident d'un de ces phnomnes, savoir de celui que nous appelons
cerveau ? La pense est donc principe, et non pas effet.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
353
Ainsi, mme en admettant comme un fait rel la loi de correspondance, quoiqu'elle ne soit qu'une hypothse, il reste tabli que si la
pense dpend plus ou moins du cerveau par la matire, elle en demeure indpendante par la forme et dans ses oprations fondamentales. ludions de plus prs. quelques-unes de ces oprations.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
354
[385]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE PREMIER
LESPRIT
Leon VII
LATTENTION
Retour la table des matires
Messieurs,
Nous avons vu dans la dernire leon qu'il y a toute une partie de
la connaissance qui semble tre essentiellement supra-physique, supra-crbrale. Ce sont ces faits que l'on appelle dans l'cole notions et
vrits premires si l'on est dogmatiste, lois et formes de la pense si
l'on est criticiste. Mais lors mme qu'on laisserait de ct toute notion
intellectuelle proprement dite, il y aurait quelque chose qu'on ne pourrait se reprsenter sous forme de mouvement physique. C'est l'activit
mme de l'esprit, l'acte par lequel la pense se rend visible ellemme, l'effort qui se dirige sur un point plutt que sur un autre de la
connaissance, en un mot l'attention.
C'est au commencement de ce sicle que le rle considrable de
l'attention dans la connaissance a t mis en lumire par les philosophes franais. Pour Condillac, toutes nos ides et toutes nos facults
n'taient que des sensations transformes. Quand mme on admettrait
cette loi pour nos ides, il n'en serait pas ncessairement de mme
pour les facults. Supposons, si l'on veut, que nos ides ne contiennent
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
355
rien autre chose que ce que nous devons la sensation, cela ne prouverait pas que nos sensations pussent d'elles-mmes et par leur propre
jeu se transformer en ides. L'acte de juger ou de penser peut tre essentiellement diffrent du fait de sentir, lors mme que nos jugements
ne feraient que porter sur des sensations ou des extraits de sensations.
C'est ce que J.-J. Rousseau a expos avec beaucoup de force et de
clart.
Apercevoir, c'est sentir ; comparer, c'est juger : juger et [386] sentir
ne sont pas la mme chose. Par la sensation, les objets s'offrent moi spars, tels qu'ils sont dans la nature ; par la comparaison, je les remue, je
les transporte en quelque sorte l'un sur l'autre pour prononcer sur leur diffrence ou leur similitude, et en gnral sur tous leurs rapports. Selon moi,
la facult distinctive de l'tre actif ou intelligent est de pouvoir donner un
sens ce mot est. Je cherche en vain dans l'tre sensitif cette force intelligente qui superpose et qui prononce. Cet tre passif sentira chaque chose
sparment, ou mme il sentira l'objet total form des deux ; mais, n'ayant
aucune force pour les replier l'un, sur l'autre, il ne les comparera pas ; Il ne
jugera pas.
Voir deux objets la fois, ce n'est pas voir leurs rapports ni juger de
leurs diffrences ; apercevoir plusieurs objets les uns hors des autres, ce
n'est pas les nombrer. Je puis avoir en mme temps l'ide d'un grand bton
et d'un petit bton sans les comparer, sans juger que l'un est plus petit que
l'autre. Je puis voir la fois ma main entire sans faire le compte de mes
doigts. Les ides comparatives plus grand, plus petit, de mme que les
ides numriques d'un ou de deux ne sont pas des sensations, quoique mon
esprit les produise l'occasion des sensations.
On pourrait faire quelques objections cette analyse de Rousseau
et faire remarquer, par exemple, qu'il fait commencer trop tard le rle
de l'activit de l'esprit, en le rduisant la comparaison ; ce rle
commence bien plus tt : mme pour voir un seul objet, il faut dj un
effort de l'esprit, un acte suprieur la sensation ; mais Rousseau, en
choisissant un moment plus avanc de la connaissance, a l'avantage de
rendre la chose encore plus claire et plus saisissante.
Laromiguire a dvelopp et fortifi la pense de J.-J. Rousseau, et
a tabli la diffrence de la sensibilit et de l'entendement, en s'ap-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
356
puyant sur cette considration gnrale que l'une est passive et que
l'autre est actif : Comment veut-on, dit-il, que la simple capacit de
sentir, qu'une proprit toute passive, soit la raison de ce qu'il y a d'actif dans nos modifications ? [387] La passivit deviendrait-elle activit ? se transformera-t-elle en activit ? (Leons de "philosophie,
part. I, le. V et XI.)
Pour rendre cette distinction sensible, il faut concentrer le dbat sur
un fait prcis, sur le fait de l'attention. C'est, en effet, par l'attention
que l'activit de l'esprit se manifeste tout d'abord. Peut-tre y a-t-il un
autre mode de l'activit de l'esprit que l'attention ; mais celui-ci est
celui que la conscience saisit le plus directement et qui est le plus accessible tous. Demandons-nous donc ce que c'est que l'attention.
Suivant Condillac, l'attention que nous donnons un objet n'est, de
la part de l'me, que la sensation que cet objet fait sur nous . (Logique, part. I, ch. VII.) Ainsi, dans l'attention l'me est toute passive ;
nulle raction qui vienne d'elle.
Pour Laromiguire, au contraire, l'attention est quelque chose de
plus que la sensation, ou mme d'entirement diffrent.
En effet, dit-il, on distingue dans l'organe deux tats opposs : celui
o il reoit l'impression de l'objet, et celui o il se dirige sur l'objet. Il faut
de mme distinguer dans l'me deux tats opposs ; celui dans lequel elle
reoit les sensations et celui dans lequel elle agit ou elle ragit sur la sensation. C'est ce second tat et non le premier qui constitue l'attention.
Condillac, cependant, n'avait pas ignor cette distinction du passif
et de l'actif dans l'esprit, car il disait : Un tre est actif ou passif selon que la cause de l'effet produit est en lui ou hors de lui. (Trait
des sensations, part. I, ch. II, 11.) Mais il n'appliquait cette distinction qu' la diffrence de la mmoire et de la sensation, et il la ngligeait quand il parlait de l'attention l o elle et t beaucoup plus
frappante. Il disait que, dans la mmoire, l'me est active parce qu'elle
a en elle la cause qui rappelle la sensation, et passive au moment o
elle prouve une sensation, parce que la cause qui la produit est hors
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
357
d'elle. 34 Mais si l'me est passive [388] dans la sensation, et que
l'attention ne soit qu'une sensation, comme nous l'avons vu plus haut,
il s'ensuit que l'me est passive dans l'attention : la premire
odeur, dit Condillac, la capacit de sentir de notre statue est tout entire l'impression qui se fait sur son organe. Voil ce que j'appelle
attention. (Ibid., 1.)
Il est difficile d'employer une expression plus vague que celle-ci,
tre tout entire , car c'est luder la difficult, ou plutt c'est ne pas
la voir. L'me peut tre tout entire un phnomne de deux manires : elle peut tre toute une douleur en ce sens que la douleur
dtruit entirement toute puissance d'agir ou de penser ; elle peut y
tre au contraire tout entire en ce sens qu'elle s'applique tudier
cette douleur ou la dominer. Ainsi la mme expression peut signifier
la fois l'tat passif et l'tat actif. Elle laisse donc la question en suspens.
On peut dire que dans sa thorie Condillac confond l'effet avec la
cause. Une sensation trs forte et trs vive provoque l'attention, mais
ne la constitue pas. Un coup de foudre clate subitement et passe instantanment. Je n'tais pas attentif au moment o il a clat, puisque je
ne m'y attendais pas : je ne deviens attentif que quand la sensation a
cess ; et si le coup ne se reproduit pas de nouveau, je suis attentif
sans qu'il y ait sensation. Ce qui trompe ici, c'est qu'il y a trs peu de
sensations instantanes. En gnral, la sensation dure ; or l'attention,
une fois veille, se confond avec la sensation continue qui est la
fois la cause et l'effet de l'attention.
Un autre fait signaler, c'est que l'attention n'est pas toujours la
sensation exclusive. L'astronome observe le ciel, et tout d'abord il voit
les toiles en mme temps, et plus nettement celles qui ont la lumire
la plus vive ; mais il sait qu'il y a dans tel endroit du ciel telle plante
peine lumineuse qui chappe ses sens : il dirigera son attention de
son ct, et finira par voquer l'image qu'il attend, et qu'il distinguera
mieux que toute autre, parce qu'il veut la voir. Ainsi de l'image au stroscope, qui ne jaillit pas du premier coup, [389] mais qui se produit
la suite d'un effort d'attention. Un musicien qui coute un orchestre
peut, par l'attention, rendre exclusive une sensation qui ne l'tait pas,
ou qui mme tait efface et couverte par toutes les autres.
34
Trait des sensations, I.1er, chap. II, 2, note.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
358
Diverses objections furent adresses Laromiguire sur la diffrence de la sensation et de l'attention. Il nous rapporte ces objections
et les discute avec beaucoup de finesse. C'est la meilleure discussion
qui existe en philosophie sur cette question capitale. Nous la rsumerons, en nous permettant d'y ajouter au besoin quelque claircissement
et quelque dveloppement.
1 L'me est elle-mme la propre cause de ses sensations. Il n'y a
donc pas lieu de distinguer un tat passif et un tat actif, la sensation
rsultant dj de l'activit de l'me.
Voici en effet comment s'exprime Charles Bonnet : Le corps
n'agit pas sur l'me comme un corps agit sur un autre corps ; mais, en
consquence de l'action des fibres nerveuses, il se passe dans l'me
quelque chose qui rpond cette action ; l'me ragit sa manire ;
et l'effet de cette raction est ce que nous nommons sensation.
Si Charles Bonnet considre la sensation comme une action de
l'me, plus forte raison en sera-t-il de mme de Stahl, qui attribuait
l'me toutes les fonctions de la vie, mme vgtative et nutritive ; dans
ce systme, et fortiori, la sensation doit avoir sa source dans l'activit de l'esprit.
ceux qui formulent cette objection, Laromiguire rpond : Direz-vous, lorsque l'on fait l'amputation un malade qui ne peut tre
sauv que par cette cruelle opration, que c'est l'me du malade qui se
donne les douleurs atroces qu'il prouve ? L'me ne fait donc pas ellemme ses sensations ; elle les reoit et les prouve bon gr mal gr ;
car elles sont le rsultat ncessaire des mouvements imprims aux
fibres nerveuses.
Peut-tre cette rponse paratra-t-elle un peu superficielle, quoiqu'il
soit vrai de reconnatre qu'il y a une diffrence entre l'activit hypothtique et inconsciente par laquelle l'me produirait [390] ses sensations, et l'activit volontaire et rflchie dont nous avons conscience
dans l'attention. Mais nous croyons que l'on pourrait ajouter quelques
mots cette rponse.
En effet, ceux qui diraient que l'me produit elle-mme ses sensations, nous dirions qu'ils nous accordent beaucoup plus que nous ne
demandons. Il s'agit, en effet, de savoir si tout vient du dehors ou si
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
359
l'esprit coopre en quelque chose par son activit propre ce qui se
passe en lui ; or, dans l'objection prcdente, on affirme que non seulement l'esprit coopre, mais encore qu'il est le seul principe d'action,
que tout vient de lui, et qu'il produit lui-mme non seulement la
forme, mais la matire mme de ses sensations. Or, si l'activit est ncessaire et si elle est suppose l o elle est si peu visible et o elle est
masque par les apparences de la passivit, plus forte raison l'activit de l'esprit sera-t-elle reconnue dans le fait de l'attention volontaire
et rflchie. Si l'esprit est dj la cause de ses sensations, plus forte
raison sera-t-il la cause de ses penses, c'est--dire de la combinaison
de ses sensations.
D'ailleurs, quand mme on accorderait que l'me produit ses sensations, cet acte primitif serait encore diffrent de l'acte ultrieur par lequel elle ragit sur ses sensations premires. Celui-ci serait encore un
degr suprieur d'activit : c'est de celui-ci que nous avons conscience ; et si nous supposons l'activit dans la premire sensation, c'est
par analogie avec l'acte dont nous avons conscience et qui s'oppose
la sensation mme.
2 Si l'me ne produit pas ses sensations, si elle est passive au
premier moment o elles se produisent, ne sort-elle pas de cet tat
passif l'instant mme o elles sont produites ? N'agit-elle pas aussitt qu'elle les prouve ?
Rponse. Oui, sans doute, l'me sort de l'tat passif l'instant
mme o elle prouve une sensation douloureuse. Nous sommes d'accord ; mais je soutiens que, l'activit qui se montre la suite de la sensation se montrt-elle au mme instant, elle n'est pas une modification
de la sensation : c'est un phnomne d'une nature tout oppose.
[391]
En effet, la raction de l'me sur ses sensations ne se confond pas
plus avec la sensation que l'acte par lequel un mur renvoie une balle
ne se confond avec le fait de la recevoir. Toujours est-il que la premire impression vient du dehors, et que la raction vient du dedans.
Ce qui prouve d'abord que la seconde est postrieure la premire,
c'est qu'elle peut subsister quand l'autre a disparu. Un clair subit vient
blouir mes yeux et provoquer mon attention ; mais il a dj disparu
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
360
quand je tourne les yeux du ct o il a paru. J'entends un cri, j'coute,
et je n'entends plus rien. Les deux faits sont donc distincts l'un de
l'autre, et je puis les distinguer encore mme quand ils sont runis.
3 La sensation ne peut se sparer de l'attention. Par cela mme
que nous sentons, nous sommes attentifs : ce n'est qu'un seul fait qui
se spare en deux par abstraction.
Rponse. J'accorde, dit Laromiguire, que la sensation ne puisse
se sparer d'une attention involontaire ou instinctive. Je ne saurais accorder qu'elle soit insparable de l'attention volontaire, c'est--dire de
l'attention proprement dite. Dans le nombre considrable des sensations que j'prouve, il en est trs peu sur lesquelles je ragisse volontairement, ou sur lesquelles je dirige mon attention. Mais admettons
cependant que tout phnomne de sensation soit implicitement accompagn d'un acte d'attention volontaire ou involontaire : s'ensuit-il
qu'il n'y ait l qu'un seul et mme phnomne ? Dire que deux choses
sont insparables, c'est dire qu'elles sont deux, et non pas une seule.
Le recto et le verso d'une feuille de papier sont insparables ; est-ce
dire qu'ils ne sont pas distincts ? L'ide d'un corps choquant est insparable de l'ide d'un corps choqu : s'ensuit-il que ces deux ides
soient une mme ide ?
4 Si l'attention n'est pas la sensation, qu'est-elle donc ? Dfinissez-nous l'attention.
Rponse. L'attention tant le premier emploi de notre activit, le
premier de nos modes d'action, chercher dfinir l'attention, c'est
chercher l'impossible. Dfinir un fait, c'est [392] montrer le fait antrieur dont il drive. Donc un fait premier n'est pas dfinissable.
L'activit de l'me ne peut pas se dfinir ; nous ne la connaissons que
parce que nous en sentons l'exercice ; et mme, proprement parler, c'est
l'action et non l'activit que nous sentons. Mais ni l'action ni l'activit ne
pourront jamais se dfinir, et pour les reconnatre il faudra toujours en appeler l'exprience, la seule exprience.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
361
Il ne faut donc pas confondre l'attention avec l'ide fixe ou la sensation exclusive. Il ne faut pas dire que dans l'attention nous sommes
frapps, absorbs, obsds par une image. 35 Toutes ces expressions
reprsentent un tat passif, et non un tat actif. L'obsession est le contraire de l'attention. Lorsque je suis obsd par un air de musique qui
se chante malgr moi dans mon cerveau, je ne suis pas attentif, je suis
possd et domin par une force qui n'est pas la mienne. Un oiseau
fascin par un serpent, ou un livre par un chien d'arrt, ne sont pas
attentifs ; au contraire, tre attentif dans ce cas, ce serait surveiller
toutes les dmarches du serpent ou du chien, de manire a les viter ;
ce n'est pas tre immobilis devant lui. Un homme attentif au danger
n'est pas un homme absorb et domin par la sensation prsente ; car
alors il lui serait impossible de surmonter ce danger : c'est celui qui,
en face du feu, par exemple, voit en mme temps les circonstances
environnantes, et non seulement ce qui est en face de lui, mais ce qui
est ct, et tient compte du pril qui peut venir par derrire. C'est la
peur extrme qui produit cette fascination, laquelle ne laisse subsister
qu'une seule sensation. C'est l'attention qui corrige, quilibre, compare
les sensations les unes par les autres. Mme dans l'attention extraordinaire que nous donnons un spectacle, l'audition d'une musique, la
lecture d'un livre, l'attention qui nous absorbe, au point de nous faire
oublier les autres sensations, n'est pas une ide fixe ; ce n'est point l
une sensation passive ; autrement [393] nous entendrions sans comprendre ; nous serions bercs et enivrs par une srie de sons sans percevoir la suite de la mlodie. Mme ce qu'on appelle les yeux fixes
n'est pas encore un regard attentif. Celui qui a les yeux fixes ne regarde point du tout : il ne fait que subir passivement l'action de la lumire. Le regard, au contraire, le vrai regard n'est jamais compltement immobile ; il parcourt rapidement et en apparence involontairement l'objet qu'il regarde ; il en fait la fois l'analyse et la synthse.
Il s'ensuit aussi que l'attention et la sensation se distinguent par le
sige de chacune d'elles, mme au point de vue de la conscience. Nous
localisons la sensation dans l'organe, et l'attention dans le cerveau.
C'est du dedans que part l'attention, c'est du dehors que part la sensation. Sans doute il y a une raction qui est inhrente la sensation
elle-mme ; car sentir, c'est ragir ; un tre inerte ne sentirait pas. La
35
Taine, Intelligence, liv. II, ch. II.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
362
sensation suppose la vie, et la vie est une action. Mais autre chose est
la raction qui est inhrente au systme nerveux et qui constitue prcisment la sensibilit, autre chose la raction sur la sensation ellemme. Par exemple, entendre est dj par soi-mme un phnomne
actif, mais qui ne se distingue pas de la sensation ; mais couter est
quelque chose de plus : c'est concentrer, diriger, fixer l'organe de manire prolonger, raviver, aiguiser la sensation.
La sensation nous reprsente les phnomnes dans leur forme
brute, discordante, incohrente ; l'attention les coordonne et en fait des
touts rgls. Par exemple, si j'ouvre les yeux devant un ciel toil, je
ne vois qu'une multitude de points brillants jets au hasard sur un fond
bleu ou noir. Si je regarde avec attention, ces points brillants se groupent et forment des masses diffrentes suivant les diffrentes rgions
du ciel, et mme elles affectent certaines figures plus ou moins rgulires que l'on a compares d'autres figures imaginaires auxquelles
elles ressemblent et d'o elles ont tir leurs noms. Si je vois une foule
d'hommes et que je me contente [394] de recevoir passivement les
sensations qui me viennent de leur similitude, je n'ai sous les yeux,
qu'un tableau confus et mouvant o rien ne ressort. Que si, au contraire, je dirige mon attention sur cette foule, j'en viens peu peu
dmler les figures, et, dans l'ensemble, discerner certains groupes
spars et plus ou moins coordonns.
De tous ces faits concluons, avec Maine de Biran, que toute impression affective porte au point d'occuper toute la sensibilit, et de
devenir, comme le dit Condillac, exclusive de toute autre, annule
notre attention, bien loin de la constituer ; que l'influence de l'attention ne consiste pas rendre l'impression plus vive, mais l'intuition
plus nette ; que l'attention commande par la vivacit des impressions n'est pas plus la vritable attention, que l'impulsion aveugle
d'une passion n'est la volont .36
la thorie de l'attention se rattache la distinction du mode passif
et du mode actif de nos diffrents sens, distinction fondamentale qui
est due la psychologie franaise de notre sicle, et qui a t labore
36.
Essai sur les fondements de la psychologie, uvres indites, d. Ern. Naville, t.
II, p. 87-89.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
363
surtout par Maine de Biran, Laromiguire et le physiologiste Buisson. 37
On peut, en effet, distinguer dans l'usage des sens deux modes, le
mode actif et le mode passif : par exemple une vision passive et une
vision active, une audition passive et une audition active, un toucher
passif et un toucher actif, etc. ; et de mme, quoique un moindre degr, pour les autres sens. Or l'exercice actif de nos sens n'est autre
chose que l'attention.
Il n'est personne, dit Buisson, qui confonde voir et regarder, et qui
n'attache au mot voir l'ide d'un effet involontaire, et au mot regarder
l'ide d'une action trs volontaire. On dit qu'on n'a pu s'empcher de voir ;
on ne dit pas, quand on parle exactement, qu'on n'a pu s'empcher de regarder. On dit [395] un enfant de regarder un tableau, de jeter les yeux sur
un livre ; on ne lui commandera jamais de voir un tableau, de voir un livre.
On plaint quelqu'un de n'avoir point vu ; on lui reproche de n'avoir point
regard. Disons plus, et remarquons, avec Stahl, que le regard ne suppose
pas la vision opre, mais seulement la volont ou, si l'on veut, le dsir de
voir ou regarder rellement, mme dans les tnbres : Oculi qua patet illorum usus, quin etiam qua non patet, in ipsis usque tenebris, vivida intensione actuantur.
Veut-on avoir l'ide de la vision passive, considrons un homme
profondment occup des mditations intrieures, et ayant les yeux
ouverts : il verra sans voir, parce que, comme on le dit, son esprit est
ailleurs. Dans le fait du regard, au contraire, tout change de face :
L'il, jusque-l passif et inerte, s'anime et se dirige vers l'objet, et
semble aller au-devant de l'impression, au lieu d'attendre que cette
impression vienne le trouver. Mme au point de vue physique et organique, l'tat de l'il est diffrent selon qu'il s'agit de voir et de regarder. En effet, dans le regard les yeux prennent un clat nouveau,
une expression particulire. Mais en quoi consiste cet tat nouveau ?
C'est ce qu'il n'est pas facile d'expliquer.
37
Voir l'intressant crit, trop oubli, intitul : De la division des phnomnes
physiologiques ; Paris, 1802.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
364
Ce n'est pas un changement de direction de la part de l'il ; car 1
souvent l'il est dj fix sur l'objet avant le regard ; 2 souvent l'il
change de direction, quoique la vision devienne passive ; c'est ce qu'on
voit chez les personnes qui rflchissent profondment et qui promnent
les yeux de tous cts sans rien regarder. Ce n'est pas une ouverture
plus grande des paupires, car, 1 souvent on diminue cette ouverture dans
le regard le plus attentif, et elle demeure trs grande dans la vision la plus
passive ; 2 l'ouverture de la paupire n'a pour effet que de laisser dcouvert une plus grande tendue de la sclrotique, ce qui ne peut influer
sur la vision. Serait-ce une plus grande dilatation de la pupille ? Mais cette
dilatation tient la quantit des rayons lumineux : la pupille sera trs rtrcie dans le regard [396] attentif d'un corps trs lumineux, tandis qu'elle
sera dilate l'excs si la vision passive s'exerce dans un endroit peu clair.
Buisson conclut que nous ignorons le mode de changement que le
regard dtermine dans l'organe, mais qu'il doit y en avoir un.
Selon lui, le regard actif est beaucoup plus frquent que la vision
passive, et mme la vision passive n'est souvent qu'un regard moins
attentif. Aussi reconnat-il que l'on peut tirer de l une objection
contre la distinction propose. Mais lors mme qu'on ne pourrait pas
dterminer dans quels cas il y aurait vision active et dans quels cas
vision passive, la distinction subsisterait nanmoins.
Mais, en ne supposant qu'une seule espce de vision, il faudrait toujours admettre : 1 un premier temps o les objets, indpendamment de la
volont, viennent faire impression sur l'il libre ; 2 un second temps dans
lequel l'me, avertie par cette impression, veut se procurer une connaissance plus prcise de l'objet. On conviendra qu'il n'y a pas de raison suffisante du regard sans une premire sensation visuelle que la volont n'a pas
commande.
Outre le regard purement optique, qui consiste fixer les yeux sur
les objets pour les mieux voir, il y a ce que l'on peut appeler un regard
intellectuel, qui consiste fixer les yeux sur les signes pour se donner
des ides. C'est ce qui a lieu dans la lecture.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
365
La lecture suppose ncessairement la vue ; mais lire ne consiste pas
regarder des lettres ; car ce ne serait qu'peler plus ou moins vite. On ne
cherche pas seulement dans la lecture se former une image plus complte
des lettres et des mots. Quel rapport y a-t-il entre l'impression physique
que font sur l'il les caractres, et cette multitude de phnomnes intellectuels qui ont lieu alors ? Quelle proportion entre l'image produite et l'exercice si actif, si compliqu, de l'me ? Il y a donc, entre regarder et lire,
un intervalle que toute la physique et la physiologie ne sauraient remplir.
La [397] lecture est tout entire intellectuelle, quoique la vue des mots
soit son moyen ordinaire.
Enfin une autre espce de regard qui se distingue encore plus de la
vision passive et mme de la vision active, c'est le regard expressif ou
affectif. C'est l sans doute un phnomne d'une autre nature et qui n'a
plus rapport au sens de l'il comme organe visuel, mais seulement
comme organe d'expression. Mais ce fait sert prcisment prouver
que le regard est autre chose que la vision, puisqu'il peut servir tout
autre chose qu' voir.
De mme que nous distinguons entre la vue et le regard, on peut
distinguer entre l'audition et l'auscultation.
Si j'interroge sur cette diffrence un homme simple et sans instruction, il me rpondra qu'il ne peut pas s'empcher d'entendre, mais qu'il est
le matre d'couter, qu'il n'coute que quand il veut entendre plus exactement, et qu'il entend mal lorsqu'il n'coute pas ; que ce qu'il a entendu
l'engage couter pour mieux entendre ; que, souvent forc d'entendre des
sons qui lui dplaisent, il prend parti de ne point couter ; enfin que souvent il a beau couler de ses deux oreilles, il n'entend rien.
D'o il suit, suivant Buisson : 1 qu'il y a deux auditions, l'une passive, l'autre active ; 2 que l'audition passive ne donne lieu qu' des
sensations confuses ou inexactes, et que l'auscultation seule donne des
notions distinctes ; 3 que l'audition prcde et dtermine l'auscultation, celle-ci n'ayant d'autre raison pour vouloir et rechercher une sensation plus exacte, que la sensation inexacte dj prouve ; 4 enfin
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
366
que l'audition suppose l'action des rayons sonores sur l'oreille, tandis
que l'auscultation suppose seulement la volont ou le dsir d'entendre,
c'est--dire qu'on coute sans rien entendre, comme on regarde sans
voir.
C'est ce que Stahl exprime avec beaucoup d'nergie : Quando obscuritas loci, vel latebr circum imminent vere arriguntur, intenduntur
etiam et veluti ad acute audiendum dirujuntur aures, ne utique fallere
possit sonus.
[398]
On peut objecter encore, ajoute Buisson, qu'on coute presque
toutes les fois qu'on entend. Il rpond : 1 qu'il ne s'agit pas de savoir
si ces deux choses sont souvent runies, mais si elles sont distinctes ;
2 que pour juger si la distinction est exacte, il faut prendre chaque
phnomne dans le cas o il est le plus marqu et le plus simple.
Ainsi supposons un auteur assez appliqu la composition d'un ouvrage pour entendre peine les bruits qui viennent frapper son oreille,
vous aurez l'exemple de l'audition la plus passive. Supposez un musicien occup juger le mrite d'un concert, vous aurez l'exemple de
l'auscultation la plus active.
On peut trouver que le premier des exemples prsent par Buisson
n'est peut-tre pas trs bien choisi ; car, prcisment dans ce cas, on
pourrait dire que l'auteur n'a pas entendu parce qu'il n'a pas cout,
comme Archimde au sige de Syracuse. Mais on peut rendre, je
crois, la distinction sensible par un autre concept. Si, par hasard, le
temps, aprs avoir t beau, se couvre subitement sans que j'y fasse
attention, et qu'un violent coup de tonnerre vienne clater, videmment je l'ai entendu sans l'avoir cout, puisque je ne m'y attendais
pas ; mais ds lors, mon oreille est tendue, et j'attends un second
coup : s'il ne vient pas, j'aurai cout sans entendre.
En rsum, l'auscultation est la volont prsente dans l'audition.
Le regard est la volont prsente dans la vision.
En vertu des mmes principes, le toucher sera la volont prsente
dans le tact.
Pour Buisson, c'est le toucher qui est actif ; c'est le tact qui est passif. On entend par tact la facult qu'a un organe de ressentir des impressions de solidit, de fluidit, chaleur et froid, lorsqu'un corps est
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
367
appliqu sur lui. On entend par toucher la facult qu'ont certains organes de s'appliquer sur les corps pour en recevoir les impressions de
solidit, fluidit, froid ou chaleur Dans le tact, les corps sont appliqus sur l'organe ; dans le toucher, l'organe s'applique sur les corps.
[399]
D'o il suit que la diffrence entre le tact et le loucher, c'est le
mouvement. Les parties du corps qui sont immobiles ne sont susceptibles que du tact. Les parties mobiles, notamment la main, sont susceptibles du loucher. De l une grande diffrence. Dans le tact, l'organe passif demeure toujours dans le mme rapport avec l'objet. Dans
le toucher, l'organe actif change sans cesse de rapport avec celui-l.
Le tact est involontaire ; le toucher est volontaire. Le premier reoit
les impressions ; le second va au-devant des impressions.
Le toucher peut donc tre dfini : le tact aid d'un mouvement qui
dtermine la volont. C'est parce que c'est la locomotion volontaire
qui seule change le tact en toucher qu'on retrouve le toucher partout
o le mouvement est possible. On peut toucher par le coude, par la
langue, en serrant les jambes, etc.
Enfin, on peut faire la distinction du passif et de l'actif dans le got
et dans l'odorat, aussi bien que dans les autres sens. Il y a une olfaction et une gustation, comme une auscultation et un regard.
Attention et mouvement. Il suit des faits prcdents que l'attention, dans les sens, semble consister dans un mouvement de l'organe
sensitif qui succde l'impression purement passive de ce mme organe. Que l'attention suppose et implique le mouvement des organes,
c'est ce qui est vident ; mais rside-t-elle, consiste-t-elle exclusivement dans ce mouvement ? On peut en douter. Le mouvement pris en
lui-mme n'est pas un acte d'intelligence. Le mouvement de l'il n'est
pas un fait plus intellectuel que le mouvement du bras. Il est la condition, non l'essence de l'intelligence : c'est parce qu'il rend l'impression
plus nette qu'il sert l'intelligence. C'est donc la facult de concevoir les
choses clairement et distinctement qui caractrise l'intelligence. Or,
cette facult ne rside pas dans les sens, mais l'action part de plus
haut.
Non seulement le mouvement n'est pas l'attention, mais encore
l'exprience atteste qu'il peut y avoir mouvement sans attention,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
368
comme lorsque l'on meut les yeux de ct et d'autre [400] sans rien
regarder et sans rien voir ; il faut qu'il y ait tension de l'il vers l'objet ; il faut qu'il y ait effort pour passer de la vision au regard. De
mme le tact devient toucher lorsqu'il est accompagn d'effort ; dans
l'auscultation, on tend l'oreille ; dans l'olfaction, on dilate les narines
pour flairer, etc. C'est ce fait de l'effort que Biran a dml aprs
Buisson, et que celui-ci n'avait pas suffisamment signal. Nous ne
pourrions y insister ici sans passer du domaine de l'intelligence dans
celui de l'activit.
Mais l'effort lui-mme ne parat pas puiser l'acte de l'attention :
car il peut y avoir tension de l'organe sans qu'il y ait attention, comme
dans le regard fixe, o l'organe est tendu vide pendant que l'esprit est
ailleurs. Lorsqu'un homme lutte contre un autre pour sauver sa vie,
l'effort de ses membres ne constitue pas un acte d'attention ; ou plutt
son attention se porte sur les mouvements de l'adversaire pour les viter et les djouer, mais non pas pour connatre la force et la figure de
son corps. Il y a donc deux sortes d'attention de nature trs diffrente,
qui peuvent s'appliquer une mme sorte d'effort. Enfin le regard expressif tout aussi bien que le regard intuitif est accompagn d'un certain effort ou tension, et cependant il ne constitue pas un phnomne
d'attention.
C'est donc l'activit intellectuelle elle-mme (de quelque manire
qu'on s'en reprsente le substratum qui est l'essence et le principe de
l'acte attentif. Elle se sert de l'effort et du mouvement, mais elle n'est
elle-mme ni l'effort ni le mouvement. On pourra, si l'on veut, se la
reprsenter comme la raction du cerveau sur l'organe sensitif. Ce sera, comme dit Biran, un symbole commode pour imaginer ce qui ne
peut pas s'imaginer ; mais qui dit activit crbrale, dit prcisment ce
qui chappe aux sens et ce qui ne peut tre connu que par la conscience. Les sens, dans le cerveau, ne nous donnent qu'une masse tendue et colore ; quant l'activit du cerveau, nous ne la voyons pas, et
nous ne pouvons nous la reprsenter que sous la forme de l'activit qui
est en nous, et qui nous est prsente par la conscience dans l'acte attentif. [401] Ainsi, c'est l'activit subjective dont nous avons conscience qui nous conduit supposer dans le cerveau une activit objective. C'est donc dans le moi que vous puisez le type de l'activit.
On dira que l'activit crbrale n'est autre chose que du mouvement ; qu'il y a deux sortes de mouvements, celui qui va de l'organe au
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
369
cerveau, et qui est la sensation, et celui qui va du cerveau l'organe, et
qui est l'attention. Mais, n'y eut-il que cela, voil dj un fondement
suffisant pour distinguer psychologiquement la sensation de l'attention : car le mouvement rgressif est assez diffrent du mouvement
progressif, pour se traduire psychologiquement en deux phnomnes
subjectivement diffrents ; or, faisant abstraction de la cause, laquelle
est hypothtique, il reste deux phnomnes irrductibles l'un l'autre,
et c'est le seul point en question, tant qu'on reste dans la psychologie
proprement dite. Mais, acceptant mme la question telle qu'on la pose,
nous avons le droit de nous demander s'il n'y a, mme objectivement,
rien autre chose que du mouvement ; si, par exemple, le passage du
mouvement d'une cellule l'autre n'implique pas une certaine force,
une certaine activit. Une simple succession de mouvements se traduirait-elle la conscience sous cette forme nergique que nous appelons
l'action ? On abuse ici du caractre indfinissable de ce fait lmentaire que l'on appelle l'action, pour soutenir qu'il n'existe pas. Mais la
sensation elle-mme est-elle plus dfinissable ? Et l'aveugle-n ne
pourrait-il pas dire aussi : Dfinissez-moi la couleur, autrement je
nie le fait, et je prtends qu'il se rduit des phnomnes du tact.
Arrivs aux faits primitifs, les mots nous font dfaut pour les expliquer. Que s'il y a un fait de conscience primitif qui exprime le moment
o le sujet subit le mouvement, quoi d'tonnant qu'il y ait aussi un
autre fait subjectivement primitif qui reprsente le moment o le sujet
recommence le mouvement en sens inverse ; et s'il y a dans la sensation (expression psychologique, par hypothse du mouvement affrent) quelque chose de nouveau et d'autre que [402] ce mouvement
lui-mme, pourquoi n'y aurait-il pas quelque chose de plus dans le
sentiment psychologique de l'action, que dans le mouvement effrent ? Quelque effort qu'on fasse aujourd'hui pour rduire le rle de la
conscience, on ne peut pas faire qu'elle ne soit rien ; autrement une
pierre serait la mme chose qu'un animal ; le chien qui sert de joujou
aux enfants serait la mme chose qu'un chien vivant. On ne peut nier
ici un fait nouveau et htrogne qui succde au mouvement reu.
Pourquoi nierait-on davantage le fait qui prcde, ou mme, si l'on
veut, qui accompagne le mouvement produit ? Et quoi d'tonnant que
lorsque le mouvement vient du dehors, il se prsente la conscience
sous une forme, et qu'il se prsente en mme temps sous une autre
forme lorsqu'il vient du dedans ?
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
370
Mais nous avons suppos jusqu'ici que le sentiment de l'action ne
serait que l'cho et l'accompagnement du mouvement, le ct interne
du mouvement ; voyons s'il ne serait pas encore quelque chose de
plus.
Un mouvement de retour, qui succderait au mouvement affrent,
et qui aurait pour effet la tension de l'organe, ne serait autre chose
qu'un mouvement rflexe ; or l'attention est tout autre chose. L'acte
par lequel je cligne des yeux lorsqu'on fait le mouvement de me frapper ne se confond en aucune manire avec l'acte de fermer volontairement la paupire ; de mme l'acte par lequel l'il devient fixe, sous
la sollicitation d'une sensation externe, ne se confond pas avec la tension volontaire de l'organe qui est l'attention. Dans le mouvement rflexe, il n'y a qu'un seul fait psychologique, la sensation, qui dtermine mcaniquement le mouvement. Dans l'acte attentif, il y a deux
faits psychologiques : 1 la sensation reue ; 2 le dsir ou l'ide de la
connaissance. Une sensation vient me frapper ; j'prouve le dsir de la
prolonger, de la rendre plus nette et plus distincte ; plus tard, l'exprience que j'ai de cet effet de l'attention me suggre l'ide de la connaissance. Le dsir de connatre, ou la pense de la connaissance, sont
donc le principe de l'attention et servent [403] d'intermdiaire entre la
sensation produite par le mouvement affrent et le mouvement rgressif qui constitue la tension de l'organe. C'est ce qui explique le caractre libre qui existe dans l'attention, et qui n'a pas lieu dans le regard
fixe ou dans la fascination, lesquels ne sont qu'une pseudo-attention.
Dans l'attention, au contraire, j'ai conscience d'tre plus ou moins
matre de mon attention, de pouvoir la suspendre, la prolonger, la varier de plusieurs manires. J'accorde que l'habitude d'appliquer son
attention certains objets finit par produire une disposition constante
de l'organe se tourner vers ces objets, et par suite une sorte d'obsession, plus ou moins analogue celle qui vient de la sensation externe.
Par exemple, le mathmaticien finit par ne plus pouvoir se sparer de
ses nombres et de ses figures. Il continue presque malgr lui les voir
idalement, les combiner, en tirer des proprits nouvelles. Le philosophe (et c'est une exprience que nous avons faite bien souvent) ne
peut plus se dlivrer de ses raisonnements, de ses thories, de ses souvenirs idaux, de sa terminologie ; c'est mme pour lui une fatigue.
Ainsi il pense malgr lui, et par consquent son attention ne dpend
plus de lui et retourne plus ou moins l'tat mcanique, dont nous
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
371
avons cherch la distinguer : mais ce sont l les effets connus de
l'habitude. On sait que l'habitude tend produire un automatisme tout
fait semblable celui de la vie organique proprement dite. Mais cet
automatisme n'est plus en ce cas que conscutif ; il est la consquence
des actes antrieurs de l'attention. Ce n'est qu'un long exercice d'attention qui peut produire la lin cette tension maladive : ce dernier fait
n'est donc qu'une dviation qui ne dment et ne contredit en rien le
caractre essentiel du fait principal.
Il suit de cette analyse que l'attention est un fait essentiellement
psychologique, puisque, si l'on supprime le dsir ou l'ide de la connaissance, il ne reste qu'un simple phnomne rflexe n'ayant plus que
les dehors de l'acte attentif. Pour qu'il y ait attention, il faut qu'il y ait
dsir de connatre, ide de [404] quelque chose connatre. Je regarde
du ct o j'entends du bruit, par curiosit, c'est--dire pour savoir
quelle est la cause de ce bruit. L'action subite et mcanique que produit en moi un bruit clatant n'est pas l'attention : car cette action peut
me dterminer tout aussi bien m'loigner, me dtourner du bruit,
qu' me diriger de son ct : or s'loigner de la cause de la sensation,
c'est ne pas y faire attention. D'ailleurs, en psychologie, les faits doivent tre tudis dans leur dveloppement complet. C'est l'attention
complte que nous dcrivons. Il peut y avoir des formes frustes de l'attention qui en sont ou des dbris, ou des linaments, ou des parties, et
qui vont se confondre plus ou moins avec les pures actions rflexes ;
mais, dans l'attention proprement dite, l'action part du moi, puisqu'elle
a son origine dans le dsir et dans l'ide que nous avons de la connaissance.
Le sentiment de l'activit que nous prouvons dans l'acte de l'attention n'est donc pas seulement la conscience du mouvement organique ;
c'est la conscience de la force inhrente au dsir ou l'ide, forme qui
est capable de dterminer le mouvement : c'est la conscience du passage de l'ide au mouvement, ou si l'on veut la transformation de l'ide
en mouvement. Or, si l'on accorde que le mouvement, dans la srie
affrente, a pu un certain moment se mtamorphoser en sensation,
c'est--dire en un phnomne psychique purement subjectif, pourquoi
se refuserait-on d'admettre qu'un autre phnomne psychique (dsir ou
ide) peut se mtamorphoser rciproquement en un mouvement rgressif qui retourne l'organe ? Maintenant, si l'on admet ces deux
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
372
phnomnes subjectifs : sensation et dsir (ou ide), pourquoi n'admettrait-on pas un tat de conscience correspondant au passage du
mouvement la sensation, et un autre tat de conscience correspondant au passage du dsir ou de l'ide au mouvement ? L'un serait ce
qu'on appelle l'tat passif, l'autre l'tat actif ; et ainsi la distinction de
l'activit et de la passivit ne serait pas une distinction mtaphysique
et ontologique, mais vraiment psychologique. La distinction de la
[405] sensation et de l'attention serait donc en principe fonde sur
l'exprience.
Mais ce serait trop encore rduire le rle de l'activit intellectuelle,
que de n'y voir autre chose qu'un dsir ou une ide se transformant en
mouvement : car dans le sens ordinaire des termes une telle transformation ne se produit pas. Il ne suffit pas de dsirer voir, ou d'avoir la
pense de voir, pour tre capable de regarder. Malebranche disait que
l'attention tait une prire que nous adressons Dieu . Mais l'attention est plus qu'une prire. Elle suppose quelque chose d'autre qui
vient de nous. Pour passer du dsir ou de l'ide l'excution, il faut
une action spciale. Il arrive souvent qu'on dsire voir quelque chose
que telle personne vous montre (par exemple dans une lunette ou un
microscope) ; on se met la lunette avec un dsir trs vif et l'ide de
ce qu'on veut voir ; et cependant on ne voit rien, parce qu'on ne regarde pas vritablement. Pour regarder, il faut une application particulire, un effort propre de l'esprit qui n'est pas le mme que celui de
l'organe : car on peut fatiguer l'organe sans avoir vritablement regard. Dans l'attention complte et vritable, il y a, comme nous l'avons
dit, non seulement tension, mais direction, gradation, appropriation.
Quand il s'agit des yeux, je n'ai gure conscience des diffrents mouvements ou degrs de mouvement que je puis leur imprimer ; mais j'ai
cette conscience bien plus nette quand il s'agit de la main. Or, dans ce
cas, je sais bien que, pour palper avec sret et prcision, il faut diriger la main sur les diffrentes parties de l'objet, en graduer les pressions, en approprier les mouvements. Il faut donc, pour regarder, un
effort directeur, qui n'est ni une simple pense ni un simple dsir :
c'est cet effort directeur qui est la racine de l'attention, et qui se traduit
la conscience sous forme de sentiment de l'action intellectuelle applique au dehors. L'attention est dans un acte d'initiative, ou du
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
373
moins elle se prsente comme telle la conscience ; et la psychologie
n'est pas tenue d'aller plus loin. 38
38
Pour complter ces vues sur la nature de l'attention, il faut consulter les chapitres qui traiteront plus loin de l'effort et de la volont, livre V, ch. I et II.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
374
[406]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE PREMIER
LESPRIT
Leon VIII
L'IMAGINATION CRATRICE
Retour la table des matires
Messieurs,
L'un des faits psychologiques qui paraissent le mieux manifester
l'activit propre de l'esprit et sa supriorit sur les sens et sur les organes, est le fait de l'imagination cratrice et du gnie dans les lettres,
les arts et les sciences.39 De tous les faits internes, c'est celui qui rsiste le plus l'explication exprimentale ; car l'exprience ne se compose que d'lments emprunts au pass, de faits antrieurement fournis. Le gnie, au contraire, a pour caractre propre de trouver et mme
de produire quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore vu dans le
monde. Aussi l'cole exprimentale ne s'est pas encore beaucoup
avance sur ce terrain. Il semble qu'elle ait eu conscience de sa faiblesse. Mais ce qu'elle n'a pas fait, ou ce qu'elle a fait faiblement, on
comprend cependant qu'elle puisse essayer de le faire. On devine
peu prs ce qu'elle pourrait dire en cette occasion, et l'on construira
facilement soi-mme une thorie empiristique du gnie.
39.
Voir le travail de M. G. Sailles sur le Gnie dans l'Art, l'une des thses les
plus brillantes de la Facult des lettres de Paris.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
375
Le gnie, pourrait-on dire, est un fait mental qui se ramne
d'autres faits mentaux plus simples. C'est une rsultante. Les faits
mentaux, selon l'cole psychophysiologique, se composent de deux
lments : l'un subjectif et psychologique, l'autre objectif et physiologique. Or les faits subjectifs ne sont que l'cho, l'expression, le reflet
des faits objectifs et physiologiques, qui sont les seuls rels. Les faits
mentaux sont donc des phnomnes crbraux : un esprit, c'est un cerveau. Supposons [407] donc un cerveau compos d'un trs grand
nombre de cellules ; car le gnie a besoin d'une riche matire, et le
nombre des sensations et des images doit tre, toutes choses gales
d'ailleurs, proportionn au nombre des cellules crbrales. Supposons
en outre que chacune de ces cellules soit doue d'une vive sensibilit
et trs impressionnable par les choses extrieures, et capable en outre
de recevoir un grand nombre d'impressions distinctes, qui ne se confondent pas entre elles et qui, multiplies par le nombre des cellules,
augmentent autant la richesse des donnes dont le gnie peut faire
usage. Enfin, et c'est l le point essentiel, supposons que ces impressions cellulaires soient susceptibles d'une reviviscibilit trs vive, de
telle sorte que le moindre phnomne accidentel puisse, par action
rflexe, mettre en branle ce clavier sensible et provoquer, comme le
disait Mme de Svign, un ballet d'esprits. On comprend trs bien,
dans cette hypothse, que celui des hommes qui, par exemple, dans
une socit primitive, sera dou de cette sensibilit exceptionnelle, et
chez lequel, sous l'empire d'une motion quelconque, cet orchestre
intrieur viendrait jouer en quelque sorte spontanment, chez lequel
les images, exprimes par des mots, se presseront en abondance, paratra aux esprits obtus qui l'environneront une sorte de dieu, l'organe
de Dieu mme. Quels seront les sujets de ces premiers chants ? Ce
seront vraisemblablement les images les plus ordinaires et les plus
familires aux peuples barbares, savoir des images de combat. Le
barde n'aura pas grand effort faire pour trouver des chants mouvants et pathtiques. Il n'aura qu' se ressouvenir. Les combats auxquels il aura assist, les pisodes de ces combats, les diffrents hros
qui s'y sont signals, les alternatives de succs ou de dfaite de la tribu, les triomphes dfinitifs, la perte des ennemis, tout cela se reproduira dans son esprit comme des tableaux auxquels il assisterait actuellement, et il les reproduira sous les couleurs de la ralit ; tandis
que les auditeurs n'ayant pas assez de sensibilit et d'irritabilit crbrale pour retrouver ces images dans leur mmoire les reconnatront
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
376
[408] cependant quand on les leur prsentera ; ils en jouiront sans
avoir la peine de les inventer. dfaut de combats et de scnes guerrires, ce sont les scnes des champs, les amours ingnus des ges
heureux, ou encore les histoires des dieux, qui ne sont autre chose que
les grandes scnes de la nature traduites dans des images et des tableaux emprunts la vie humaine, c'est--dire encore la mmoire.
Cependant, ici dj un lment nouveau vient se joindre au souvenir : c'est la fiction. L commence l'invention, la cration, la production du nouveau.
Il y a deux sortes de mmoires. L'une est la reproduction fidle des
scnes que les sens nous ont montres ; c'est la mmoire proprement
dite, mais qui, lorsqu'elle est trs vive et trs colore, prend dj le
nom d'imagination. L'imagination descriptive, par exemple, n'est que
la facult de conserver avec une extrme prcision et une grande richesse de couleurs la mmoire des lieux. Le talent des portraits dans
les Mmoires, par exemple chez Saint-Simon, chez Retz, n'est encore
qu'une mmoire riche, fidle et anime de ce qu'on a vu et senti dans
le commerce des hommes.
Mais ct de cette mmoire qui est la reproduction vive et fidle
de la ralit, il y en a une autre qui ne garde pas la figure totale des
objets, mais qui dans chacun d'eux ne saisit qu'un trait saillant, et
laisse tomber les autres, de telle sorte que ces traits, dpouills de
leurs accessoires, ne sont plus que des points de repre sans liaison,
qui cependant, en vertu de la loi de l'association des ides, se rappellent l'un l'autre, se tiennent ensemble et forment des tableaux incohrents, qui tantt sont compltement absurdes, comme dans les rves,
et tantt forment des ensembles qui plaisent l'imagination, soit parce
qu'ils ne sont pas trop loigns de la ralit, soit, au contraire, parce
qu'ils s'en loignent tellement qu'ils sduisent par le contraste mme.
Tels sont, par exemple, les contes de fes, qui sont au nombre des plus
anciennes fictions de l'humanit, comme les chants de guerre et
d'amour en sont les plus anciens souvenirs.
[409]
Beaucoup des crations de la mythologie antique, passes dans le
domaine de l'art, s'expliquent comme nous venons de le dire, c'est-dire par une sorte d'agglutination entre des dbris de souvenirs, subsistant seuls dans le naufrage de mille autres lments subordonns, qui
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
377
contribuaient former le tableau. Par exemple, vous avez vu une
femme au bord d'un fleuve ou d'un lac, et dans ce lac un beau poisson
nageant et frtillant : or, qu'est-ce qui vous reste dans la mmoire ?
C'est la tte de la femme et la queue du poisson ; parce qu'en effet,
dans une femme, ce qui frappe le plus, c'est la figure, et dans un poisson qui nage et qui prend ses bats, c'est la queue. Runissez ces deux
lments, vous avez un tre qui a la figure et la tte de la femme et qui
se termine en poisson. Supposez en outre que vous ayez entendu cette
femme chanter : vous avez la Sirne. Supposez encore un homme
cheval : la mmoire n'a conserv que la tte de l'homme et la croupe
du cheval : vous avez le Centaure.
L'imagination n'est donc d'abord autre chose que la mmoire disloque. L'imagination cratrice proprement dite est d'abord prcde de
l'imagination destructive. Il faut que les touts de la mmoire soient
d'abord briss pour donner naissance aux touts nouveaux de l'imagination. Mais c'est ici que l'cole empirique serait certainement embarrasse, ou plutt on peut dire qu'elle l'a t, puisqu'elle n'a fait encore
jusqu'ici aucun effort pour s'emparer de ce domaine : savoir la puissance inventrice et cratrice. Une nous appartient pas sans doute de
prvoir ce qu'un esprit ingnieux et puissant (tel que serait, par
exemple, un Herbert Spencer) pourrait inventer pour expliquer
l'invention ; nous ne pouvons que ttonner et essayer d'une explication
analogue celles que l'empirisme nous prsente dans les autres domaines de la psychologie.
Nous pensons donc que, pour expliquer la possibilit de crer des
ensembles, des combinaisons, qui ne soient pas de simples reproductions de la ralit, l'empirisme invoquerait la possibilit d'unir la mmoire l'imagination, c'est--dire [410] le souvenir et la fiction : l'une
donnerait la rgularit et l'ordre, l'autre la nouveaut. Dans un rcit,
par exemple, compos d'une suite d'aventures incohrentes, comme
les contes de fes, le jeu des associations amnerait de temps en temps
des suites plus ou moins rgulires, ayant de l'analogie avec la vie,
que le pote aura retrouves dans ses souvenirs, et qui trouveront un
cho dans l'me de ceux qui l'couteront ; et les fictions incohrentes
et drgles pliront devant ces fragments de ralit et de naturel.
L'ide d'une mre se sparant de son poux au moment du combat,
avec son enfant sur les bras, veillera la fois l'ide du sourire et des
larmes, et le pote trouvera ce trait admirable : ;
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
378
mais n'est-ce pas qu'il a vu quelque tableau semblable, ou que mme,
n'ayant rien vu de tel, il en construit un nouveau par analogie avec la
ralit ? Or, lorsque de pareilles scnes se prsentent au milieu de tableaux incohrents et sans ralit, qui ne plaisent que par l'tranget,
le pote et les auditeurs s'aperoivent de la diffrence ; peu peu les
uns et les autres s'habituent rejeter comme fade et rpugnant tout ce
qui sort des conditions du cur humain ou qui n'a pas quelque analogie avec les motions naturelles. Le travail, l'art, l'ducation, tendent
faciliter cette opration et faire prdominer les combinaisons heureuses sur les combinaisons fortuites et drgles. Mais le fond est
toujours la mmoire et la sensibilit.
Essayons de montrer par quelque exemple comment on pourrait
soutenir que le gnie n'est qu'une mmoire.
L'une des plus belles choses de la littrature moderne est le dbut
du Vicaire savoyard. J.-J. Rousseau transporte son lve sur le haut
d'une montagne, en prsence du lever du soleil, pour lui parler de religion. Il dcrit, par quelques traits simples et puissants, le tableau que
le vicaire et son lve ont devant les yeux, puis il ajoute : Aprs
avoir quelque temps contempl ce spectacle en silence, l'homme de
Dieu parla ainsi Quelle scne et quel milieu pour faire entrer
l'ide religieuse dans l'me d'un jeune homme ignorant ! Ce qui fait la
beaut et la grandeur de ce tableau, c'est que [411] l'association entre
l'ide du soleil et l'ide de Dieu est une association naturelle, aussi
ancienne peut-tre que l'humanit. Le culte du soleil a d tre un des
premiers cultes, et l'on nous dit que le mot mme de Dieu signifie :
quelque chose qui brille. Cette association s'est depuis longtemps
teinte et efface dans nos socits civilises, d'une part parce que le
lever du soleil est un spectacle assez rare pour la plupart des hommes
et peut-tre aussi trop familier quelques-uns, et aussi parce que l'ide
de Dieu s'est jointe tant d'autres lments diffrents, et a pris des
formes si concrtes et si compliques, que l'association primitive s'y
est tout fait noye ; mais elle ne fait que dormir dans les consciences
humaines ; et, soit titre d'impression naturelle, soit titre d'impression hrditaire, elle est prte se rveiller dans telle circonstance dcisive. Or, les mmes raisons qui font que cette association dort chez
les foules, expliquent aussi pourquoi les poles, les philosophes, les
thologiens, en ont fait si rarement usage. Bossuet avait autre chose
faire, pour enseigner la religion, que de rveiller une sentimentalit
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
379
vague en prsence d'un spectacle potique. Lui-mme tait trop occup et d'une manire trop pratique pour s'amuser voir le lever du soleil et en tirer quelques motions !
Supposez maintenant un jeune aventurier, un vagabond, un polisson chapp de chez ses parents, courant les grandes routes, couchant
la belle toile, dou de la sensibilit la plus vive ; plus d'une fois il a
d, dans ses courses pied, dans ses excursions de montagne, voir
lever le soleil : il l'a vu bien souvent aussi, des Charmettes, sur cette
colline dlicieuse faisant face aux plus admirables montagnes, et il a
conserv de ce spectacle la plus vive image. De l'autre, ce garnement
sans foi et sans murs, ayant chang plusieurs fois de religion, n'en
avait sans doute aucune ; nanmoins c'tait un Genevois : c'tait un
fils de Calvin ; or, Calvin a imprim toutes les gnrations de Genve qui l'ont suivi un profond caractre religieux. Un protestant,
quelque phase d'opinion qu'il traverse, est toujours un chrtien. Le
sentiment [412] religieux tait donc profondment ancr dans l'me de
Rousseau, quelque relches que fussent ses croyances positives ; et
c'tait prcisment le relchement de ces croyances qui, dpouillant
l'ide religieuse de tous ses accessoires hrditaires, laissait en prsence les deux lments de la vieille association primitive, l'ide du
soleil et la croyance en Dieu. Rousseau fut donc, grce aux circonstances, l'un des premiers chez lequel la posie de la nature rveilla le
sentiment religieux. Puis, devenant crivain, faisant l'ducation de son
mile, ayant, par un paradoxe singulier, prtendu qu'il ne fallait pas
parler de Dieu aux enfants, mais ajourner cette instruction au moment
o ils seraient en tat de la comprendre, il fit de cette rvlation l'objet
d'un pisode particulier de son livre. Or, au moment de commencer
l'exposition, l'ide de Dieu voqua en lui le souvenir des scnes de la
nature auxquelles elle s'tait trouve le plus profondment associe.
Le sentiment religieux rveilla l'image de la nature et son plus beau
spectacle. De l cette description si sobre et si simple, qui encadre si
merveilleusement le dveloppement philosophique qui va suivre. C'est
l certainement une chose trouve ; mais cette trouvaille n'est qu'un
souvenir.
L'invention musicale et potique. Malgr cette explication plus
ou moins vraisemblable que nous venons d'esquisser, et que de plus
habiles rendraient sans doute plus vraisemblable encore, nous croyons
cependant que l'invention et la cration dans les arts est un fait sui ge-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
380
neris qui ne peut tre expliqu par des associations, et que le gnie
n'est pas une mmoire.
Essayons de signaler quelque fait caractristique, significatif, et,
comme dit Bacon, prrogatif, une sorte d'experimentum crucis qui
tienne en chec la thorie empirique et donne l'avantage la thorie
contraire. Ce fait, selon nous, c'est l'invention musicale. Tous les
autres arts sont imitatifs. La musique seule est un art vritablement
crateur ; c'est pourquoi, dans les autres arts, on peut toujours plus ou
moins bien expliquer le gnie par la mmoire ; mais cela est impossible en musique, comme nous l'allons voir.
[413]
La peinture et la sculpture reposent indubitablement sur l'imitation : sans doute ce n'est pas l'imitation seule qui constitue le beau ;
mais c'est l'imitation qui est la base du beau. En dfinitive, que reprsente l'artiste ? Des arbres, des fleurs, des animaux, des figures
d'hommes, de femmes, de vieillards, d'enfants, etc. Or, rien de tout
cela n'est invent par lui. Le peintre et le sculpteur ont pris tous leurs
modles dans la ralit ; et mme toujours il leur faut de vritables
modles, posant devant eux, sans quoi le dessin devient incorrect,
inexact, et l'uvre d'art pche par la base.
Dans la posie, on ne reproduit pas les formes du corps, comme
dans la sculpture et la peinture ; on peint les mes, les caractres, les
passions ; mais rien de tout cela n'est invent par le pote. Pour que
son uvre soit vraiment belle, il faut que ses personnages soient plus
ou moins semblables la ralit ; c'est la conformit avec la vie relle
qui fait le charme de ces peintures, quelque idalises qu'elles puissent
tre. Les vnements qui forment le fond matriel de la posie pique
et dramatique (les deux plus grandes formes de posie) doivent tre
galement plus ou moins semblables aux vnements que prsente ou
que peut prsenter la vie, soit dans l'histoire en gnral, soit dans l'histoire des individus.
On voit que dans ces trois grands arts : sculpture, peinture et posie, l'imitation et la mmoire forment en quelque sorte la base premire, et fournissent toutes la matire sur laquelle travaille l'artiste. De
l une certaine facilit apparente expliquer par l'exprience la production du gnie dans ces diffrents arts ; mais si nous passons la
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
381
musique, nous nous trouverons dans un ordre d'ides tout fait diffrent.
La nature ne fournit au musicien aucun modle sur lequel il puisse
construire ses compositions et ses inventions. Dans la nature, si vous
exceptez le chant des oiseaux, le son n'est la plupart du temps que du
bruit. Le bruit de la mer, le bruit des ruisseaux, le bruit du vent dans
les feuilles, le bruit de la foudre, voil ce que la nature nous donne ;
rien de tout cela n'est de la musique, ou du moins de la mlodie : ce
sont tout [414] au plus des accompagnements. Les chants des oiseaux
ont quelque chose de plus. Ce sont de vritables mlodies, mais des
mlodies toujours les mmes, et tellement courtes qu'elles ne fournissent l'art que des motifs accidentels, quelques agrments de dtail,
mais non des modles vritables. Voici, par exemple, le chant du rossignol, qui est ce qu'il y a de plus parfait dans le chant des oiseaux. Il
se compose de trois ou quatre phrases : un petit sifflement plein de
douceur, quelques notes plaintives d'une mlancolie dlicieuse, une
roulade perle d'une agilit et d'une lgance exquise : enfin, c'est une
toute petite symphonie, qui a son introduction, son andante et son allgro. Mais comme tout cela est court ! On jouit et on souffre la fois
et de la dlicatesse du plaisir et de sa brivet. Mais surtout, combien
il est monotone, toujours le mme, sans la plus petite varit ! Peuttre l'aide de l'habitude dcouvririons-nous quelques nuances ; mais
jamais un seul rossignol n'a eu l'ide d'ajouter une note au chant traditionnel. Quoi de plus simple cependant, ce qu'il semble, quoi de plus
facile ! Comment un rossignol amoureux et artiste n'a-t-il pas eu la
pense, pour plaire sa belle, de varier, ou tout au moins d'allonger
les diffrentes phrases de son chant ! Aucun ne l'a fait ; et jamais la
musique, dans la nature, ne s'est leve au del. Dira-t-on que c'est l
le premier modle dont l'homme est parti pour arriver ce qui constitue l'art musical ? qu'il y a donc eu l aussi imitation et mmoire ?
Mais pourquoi supposerait-on une telle imitation ? Puisque l'oiseau
chante et que l'homme chante galement, qu'a-t-il eu besoin de l'oiseau pour apprendre chanter ? L'oiseau n'imite pas l'oiseau : pourquoi l'homme imiterait-il l'oiseau ? N'y et-il pas d'oiseau dans le
monde, l'homme chanterait, parce qu'il a la facult de chanter ; de
mme qu'il parle, parce qu'il a la facult de parler, sans avoir besoin
pour cela d'imiter aucun autre animal, puisqu'il est le seul qui jouisse
de cette facult. Ainsi l'homme chante comme l'oiseau : voil le fait
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
382
primitif. Mais la diffrence capitale, c'est que l'oiseau n'a qu'un chant,
toujours le mme, et restreint dans les bornes les plus troites ; [415]
tandis que l'homme cre des chants nouveaux l'infini. Quelle distance du chant du rossignol l'opra des Huguenots ? Tout l'intervalle
est d'invention humaine, et n'a pas eu de modle dans la nature. 40 Ce
n'est pas en combinant le chant de la fauvette avec le chant du rossignol, en y ajoutant comme basse le bruit du vent ou celui du ruisseau,
qu'un musicien composera une mlodie quelconque. Ce peut tre l un
jeu agrable qui, trait par un musicien habile, pourrait tre de
quelque prix ; mais ce ne serait qu'un jeu artificiel, n'ayant aucun rapport avec le chant humain proprement dit.
Je laisse dans la musique toute la partie que l'on appelle l'harmonie, o la science est tellement mle l'art qu'il est difficile de la sparer. Je ne signale que la mlodie. C'est le propre de l'homme
d'inventer des motifs, des chants originaux. Un motif est quelque
chose d'absolument nouveau introduit dans le monde. L est la diffrence de la musique et des arts plastiques. Le Jupiter olympien, si divin qu'il soit, n'est cependant qu'un homme ; et il est probable que
quelque homme a pos comme modle ; mais la Romance du saule de
Rossini est un tout absolument cr. Rien de semblable n'avait t entendu auparavant ; et nous pouvons l'entendre aujourd'hui quand nous
voulons. Voil donc dans l'Univers une sorte d'tre nouveau, de type
vivant, d'unit concrte, qui sort pour ainsi dire ex nihilo, car la matire prexistante, savoir les sept notes de la gamme, n'a aucune proportion pour la richesse et la dignit avec les combinaisons varies
que le musicien en a tires ; ou, pour mieux dire, ce ne sont pas mme
des combinaisons : ce sont des organismes, o la forme est tout, et la
matire peu de chose. D'ailleurs la gamme elle-mme a t une dcouverte du gnie humain.
Impossible donc d'expliquer la cration musicale par la mmoire et
le souvenir : l'automatisme crbral ne sert plus [416] rien ici. Remuez tant que vous voudrez les cellules du cerveau ; rveillez tous les
sons dont elles ont t frappes : elles ne vous donneront jamais ce
40
M. G. Sailles a fait trs bien remarquer que la musique ne peut se prter la
thorie platonicienne des types idaux, comme la peinture. Cette observation
est trs juste ; mais cela vient justement de ce que la musique n'a pas de modle dans la ralit et dans la nature. Car les idaux platoniciens ne sont que
les tres rels idaliss.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
383
qu'elles ne possdent pas, savoir un chant nouveau sur motif, l'air le
plus simple du monde, ft-ce le Clair de la lune.
dfaut de l'imitation de la nature, dira-t-on que les musiciens
s'imitent eux-mmes, et que les diffrents chants musicaux ne sont
que les diffrentes modulations varies d'un mme type indfiniment
transformable ? C'est absolument le contraire de la ralit. Il n'y a
point d'art o l'imitation et la rminiscence aient moins de part et
moins de mrite. Dans tous les autres arts, l'imitation peut cense tre
du gnie. L'Iphignie et la Phdre de Racine sont encore des chefsd'uvre, quoiqu'elles ne soient que des imitations, quelquefois mme
des traductions. De mme un sculpteur moderne peut s'illustrer par
l'imitation de la sculpture antique. En musique, au contraire, la rminiscence est toujours une preuve de faiblesse ; et si les musiciens peuvent imiter les procds et les artifices des grands matres, ils ne peuvent en copier les mlodies. En ce genre, c'est la nouveaut qui est la
condition ncessaire du gnie.
Une seule ressource resterait l'empirisme pour expliquer l'invention musicale ; mais elle est tellement force qu'elle est elle seule une
rfutation de l'hypothse. C'est la thorie du ttonnement, et par consquent du hasard. Pour les autres arts, on peut, sans trop d'absurdit,
faire une certaine part l'lment fortuit dans la cration artistique,
parce que le fond emprunt la ralit et conserv par la mmoire a
dj par lui-mme une certaine organisation, celle du monde extrieur,
du monde rel. Le jeu de l'imagination provoqu par des excitants, et
plus ou moins dirig par l'habitude, pourrait sembler suffisant pour
faire rapparatre quelques formes rgulires et coordonnes. Mais ici
rien de semblable. .Rien d'ordonn ne nous est donn par la nature en
fait de mlodie musicale : nous n'avons notre disposition que les sept
notes de la gamme avec leurs degrs. Il faudrait donc supposer [417]
que le musicien voque au hasard telle ou telle note, telle ou telle srie
de notes, et que lorsqu'un commencement de mlodie apparat, il le
conserve et le met part pour en faire le dbut de son air ; puis, par un
nouveau ttonnement, il essayerait une autre suite qui puisse faire
corps avec la premire, jusqu' ce qu'enfin il ait trouv une fin qui
complte le tout ; et, la premire phrase de son chant tant ainsi trouve, il passerait la seconde par le mme procd, c'est--dire en invoquant exclusivement le principe des chances heureuses, jusqu' ce
qu'il ait achev la mlodie tout entire ? Est-il quelqu'un qui puisse
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
384
croire que l'invention musicale soit le rsultat d'un procd aussi barbare et aussi grossier ? Quel temps ne faudrait-il pas pour que le
simple jeu des notes puisse, par une rencontre fortuite, produire le motif le plus simple ? S'il en tait ainsi d'ailleurs, tout le monde pourrait
inventer en musique ; il n'y aurait pas de gnie proprement dit. Car le
hasard est au service de tout le monde, et tout le monde peut gagner
au jeu. En supposant qu'une certaine ducation et un certain exercice
abrge le ttonnement et facilite l'apparition des chances heureuses, au
moins tous ceux qui savent la musique devraient-ils trouver quelque
chose aussitt qu'ils se mettent au piano. Pourquoi n'en est-il pas ainsi ? Pourquoi les uns trouvent-ils toujours quelque chose, et les autres
ne trouvent-ils rien ? L'hypothse qu'un air de musique puisse tre invent par l'addition successive des notes prises au hasard est dmentie
encore par la construction mme de tout air, o le commencement est
prcisment command par ta fin. Les dernires notes du motif doivent avoir t donnes avec les premires : c'est l, plus que nulle part
ailleurs, que le tout doit prcder les parties, que la synthse doit prcder l'analyse et n'en tre pas simplement la rsultante. Le gnie est
prcisment cette puissance synthtique qui prcde toute analyse ; et
nulle part cette puissance synthtique n'est plus visible que dans
l'exemple que nous venons d'tudier, c'est--dire dans l'invention musicale.
[418]
Une fois que nous avons trouv le point fixe contre lequel vient
chouer toute thorie empirique, nous n'avons plus qu' revenir sur
nos pas et retrouver dans les autres arts les signes de cette puissance
synthtique si videmment cratrice, qui se manifeste en musique.
C'est la posie qui, aprs la musique, est l'art le plus crateur, car on
peut crer plus facilement des vnements que des objets, des caractres que des figures ; et les choses morales, les passions et les penses, se prtent plus de combinaisons que les formes purement plastiques. Parmi les types invents par la posie, ceux qui manifestent le
plus la puissance cratrice sont ceux qui ne sont point emprunts
l'histoire ou la tradition, mais qui sont sortis tout entiers de l'imagination du pote, ceux aussi qui ne reprsentent pas les caractres les
plus habituels dans l'espce humaine, mais de vritables individualits
qui n'auraient jamais exist, si le gnie des potes ne leur avait donn
naissance. De ce genre sont l'Alceste de Molire, don Quichotte, Ha-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
385
mlet, Faust. Ces personnages ne sont pas pris dans le commun de la
vie, comme Harpagon ou G. Dandin. On dispute mme sur leur caractre et sur leur vraie signification, comme on le fait prcisment sur
les personnages rels et vivants, dont on n'a jamais compltement la
clef. Mais ce qui est certain, c'est que ce sont des personnages rels,
des individualits nouvelles qui n'existaient pas auparavant et qui ont
t cres par le gnie des potes. Tous les connaissent et les reconnaissent : ce sont, comme on dit, des types. Or ces types ne viennent
pas de la mmoire. Ni don Quichotte, ni Hamlet, ni mme Alceste,
n'ont eu de modles. Tout au plus quelques traits pars, recueillis par
hasard, ou plutt remarqus par le gnie, ont pu donner l'veil la
pense du pote, et encore on peut se demander si c'est le dtail accidentel qui a suggr la pense totale, ou si ce n'est pas prcisment la
pense du tout qui, se faisant immdiatement jour, a amen la remarque de l'accident, de mme que la pomme de Newton a t moins
l'occasion de la dcouverte que la dcouverte elle-mme, apparaissant
tout d'un [419] coup dans un dtail fortuit, comme le chant du musicien lui apparat tout coup la premire note.
Nous ne pouvons qu'esquisser ce tableau. On voit qu'en partant
d'un fait caractristique et significatif, on pourrait ensuite, en redescendant la srie, retrouver dans toutes les uvres de la posie et de
l'art les signes et les preuves de l'invention et de la cration, jusque
dans les uvres qui ne sont, en apparence, que des imitations. Un portrait, par exemple, semble bien n'tre autre chose qu'une copie,
puisque son principal mrite est la ressemblance ; et cependant c'est
encore une cration, car il y a rapprocher tous les traits distinctifs du
personnage et en composer l'expression la plus vraie et en mme
temps la plus gnrale. Il faut dgager le vrai personnage de tous ses
accessoires, de tout le fatras des dtails matriels qui effacent et dtruisent la vie. Peut-tre le modle lui-mme ne se connat-il pas ainsi ; c'est lui, c'est plus que lui, c'est lui-mme dans son idal, et cependant cet idal doit tre vivant, parlant, rel. Tout cela ne se fait pas
avec de simples souvenirs, car des souvenirs se confondraient et se
brouilleraient les uns les autres. Mais, dira-t-on, c'est que le peintre
aura su remarquer dans un regard, dans un sourire, dans une pose,
l'homme tout entier. Cela est vrai ; mais c'est toujours la pomme de
Newton : cette remarque, c'est le portrait lui-mme ; et c'est la puissance du peintre qui a veill la sagacit de l'observateur.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
386
En rsum, quand nous parlons d'imagination cratrice, nous l'entendons au propre et non au figur. On dit gnralement dans l'cole
que le terme d'imagination cratrice est pris ainsi par analogie, parce
qu'en ralit l'imagination ne cre rien et ne fait que se servir d'lments prexistants, des sons, des couleurs, des matriaux divers ; et on
rserve le nom de cration la production de la matire. Mais on peut
se demander si, ct de la cration de la matire, il n'y a pas aussi la
cration de la forme, et si faire sortir d'une matire ce qui n'y est pas,
savoir une chose ordonne, ce n'est pas aussi faire quelque chose de
rien. Le dmiurge de [420] Platon ne cre pas la matire du monde,
mais de cette matire dsordonne il tire l'ordre et l'harmonie. L'ordre
vient donc de quelque chose qui n'est pas l'ordre, c'est quelque chose
d'ajout la pure matire : c'est de l'tre en plus, c'est donc de la cration au sens propre du mot. Si dans un bloc de marbre, comme le disait Leibniz, on suppose un Hercule dessin d'avance, l'acte du sculpteur qui se bornerait dgrossir le marbre et dgager la statue virtuelle ne serait pas sans doute un acte crateur ; mais si nulle figure
n'est dessine d'avance, celui qui d'un bloc brut fera sortir un Jupiter
aura fait quelque chose de rien ; car entre une pierre et un Jupiter, il y
a un abme. Ainsi, la cration de la matire n'est pas la seule que l'on
puisse appeler ex nihilo, et mme c'est une question de savoir si le
type absolu de la cration doit tre cherch dans l'acte qui produit la
matire ou dans celui qui produit la forme, c'est--dire dans l'acte qui
produit quelque chose qui ne signifie rien, plutt que dans la cration
de quelque chose de raisonnable. L'un est un acte de puissance, l'autre
un acte de sagesse. Or la sagesse est suprieure la puissance. Si, par
impossible, un homme tait dou de la facult de crer la pierre par un
fiat de la volont, serait-il par l suprieur celui qui cre la statue ?
Sans doute, celui qui runit les deux actes est le crateur par excellence ; mais il ne faut pas que le type de la cration soit emprunt
l'un de ces actes l'exclusion de l'autre. Ce n'est donc pas par mtaphore, mais en vrit, que le gnie est dit crateur ; il participe par l
la puissance divine, et c'est juste titre qu'on l'a toujours considr
comme inspir de Dieu. Cette puissance cratrice dfie toutes les explications exprimentales ; elle implique une force inne qui dpasse
de beaucoup toutes les facults de combinaison et d'arrangement auxquelles on serait tent de la rduire. Elle est, proprement parler, une
gnration spontane.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
387
[421]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE PREMIER
LESPRIT
Leon IX
Lunion de lme et du corps.
le sens du corps.
La localisation des sensations.
Retour la table des matires
Messieurs,
La doctrine de l'esprit vient se heurter contre une difficult fondamentale qui a mis quia tous les mtaphysiciens, et qui est le grand
cheval de bataille des adversaires de la mtaphysique. C'est la question de l'union de l'me et du corps. Comment, dit-on, cette substance
immatrielle que vous appelez l'esprit est-elle associe une substance corporelle ? Comment agit-elle sur celle-ci et en subit-elle l'action ? C'est l une de ces questions insolubles dans lesquelles se sont
perdus les philosophes, construisant hypothses sur hypothses et suscitant sans cesse des controverses striles et sans issue.
Nous reconnaissons l'impuissance de la mtaphysique dans cette
question. Remarquons cependant que les prtendues innombrables
hypothses introduites ce sujet par les mtaphysiciens se rduisent
deux : l'hypothse de l'influence physique, et l'hypothse de la conco-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
388
mitance ; encore la premire est-elle peine une hypothse ; elle n'est
que le fait lui-mme expliquer donn comme fait primitif et indmontrable, savoir l'action rciproque des substances. La seconde
hypothse consiste transformer les prtendues actions des substances
l'une sur l'autre en une simple correspondance, et dire que les dveloppements de l'une correspondent la srie des dveloppements de
l'autre. Les deux formes de cette doctrine sont l'occasionnalisme de
Malebranche et l'harmonie prtablie de Leibniz ; mais ce ne sont que
deux [422] formes d'une seule et mme ide. Quant aux autres hypothses signales dans les manuels comme rpondant la question de
l'union de l'me et du corps, elles n'ont nullement cette valeur et cette
porte. Par exemple, on cite l'hypothse des esprits animaux de Descartes et le mdiateur plastique de Cudworth. Mais les esprits animaux ne sont pas des intermdiaires entre l'me et le corps ; ce sont
des agents purement corporels, nullement spirituels, sur lesquels l'me
agit directement et par l'intermdiaire desquels elle agit sur le reste du
corps. Le problme reste donc toujours le mme : comment l'me agitelle sur les esprits animaux, et rciproquement comment les esprits
animaux agissent-ils sur l'me elle-mme ? Et on en revient toujours
aux deux hypothses prcdentes : ou il y a action immdiate, ou il n'y
a que correspondance et simultanit d'action. Quant la soi-disant
hypothse du mdiateur plastique attribue au philosophe anglais
Cudworth, nous avons dmontr dans notre thse latine 41 (il y a plus
de quarante ans) qu'une telle hypothse n'existe pas et n'a jamais exist. Le philosophe auquel on l'impute a soutenu une tout autre doctrine,
qui n'a d'ailleurs aucun rapport avec la question de l'essence de l'me
et du corps. En rsum, les mtaphysiciens n'ont fait propos de ce
problme que les hypothses que l'on peut faire dans l'tat actuel de
nos connaissances.
Mais s'il est juste de reconnatre que la mtaphysique spiritualiste
n'a pas jet une grande lumire sur la question, il faut reconnatre en
mme temps que la difficult dont il s'agit ne porte pas seulement sur
une seule doctrine, mais sur toutes les doctrines ; que toutes sans exception rencontrent le mme cueil, le mme obstacle, la mme obscurit : c'est ce qui deviendra sensible par l'examen des diffrentes
doctrines philosophiques relatives la nature et l'origine de la pense.
41
De plastica natun vita apud Cudworthum ; Paris, 1848.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
389
Par exemple, admettons un instant, avec les matrialistes, [423]
que la pense ne soit pas l'attribut d'une substance spirituelle ; qu'il n'y
ait pas deux substances, l'une spirituelle, l'autre matrielle, mais une
seule, savoir la substance matrielle : comprendra-t-on mieux pour
cela que la pense sorte de la matire et agisse sur elle ? De quelque
manire que l'on rsolve la question de la substance, peut-on faire que
la pense, en tant que pense, soit un phnomne matriel ? Peut-on la
voir, la toucher, la mesurer, la palper, etc. ? Or, c'est ces signes seulement qu'on reconnat ce qu'on appelle la matire. En d'autres termes,
la pense est-elle identique l'tendue et au mouvement, et comment
la faire sortir de l'tendue et du mouvement ? et rciproquement,
comment la pense peut-elle produire le mouvement ? On rsout cette
dernire difficult en disant que la pense n'agit pas, qu'elle n'est qu'un
cho, une expression, une ombre. Toujours est-il que cette ombre n'a
aucune similitude avec le corps dont elle est l'ombre. Comment donc
vient-elle s'ajouter aux phnomnes purement corporels ? Comment la
matire peut-elle penser ? Ceux qui nous prsentent cette hypothse
peuvent-ils prtendre nous offrir quelque chose de plus clair que
l'harmonie prtablie ou l'influx physique ? Ils chouent aussi bien
que les spiritualistes expliquer l'union du physique et du moral ;
mais ils chouent d'une manire plus grave ; car les spiritualistes ne
rencontrent l qu'une obscurit, tandis que le matrialisme repose sur
une contradiction.
On a cru lever toutes ces difficults par une expression qui a fait
fortune de nos jours : c'est l'expression de monisme. Il n'y a pas, diton, deux substances ; il n'y en a qu'une, la fois corporelle et spirituelle, pense et tendue, comme le veut Spinoza ; sensation et mouvement, comme le dit Herbert Spencer. Substituez le monisme au dualisme, toutes les difficults de l'union des substances disparaissent.
C'est une grande illusion. Rien de plus vague que cette thorie. En ralit, tout le monde est moniste, et tout le monde est dualiste. Dans aucun systme moderne il n'y a dualit sans [424] unit, ni unit sans
dualit. Il n'y a qu'un seul systme que l'on puisse appeler dualisme
dans le sens prcis du mot ; mais il n'existe plus depuis longtemps :
c'est le dualisme de Zoroastre et des manichens, qui pose en face l'un
de l'autre, comme galement ncessaires et ternels, le principe du mal
et le principe du bien ; c'est encore le dualisme d'Aristote et de Platon,
qui pose la coexistence ternelle de la matire et de Dieu. Mais, de-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
390
puis le christianisme, personne n'a jamais soutenu ni l'une ni l'autre
hypothse. Il n'y a pour tous sans exception qu'un seul principe, qui
est Dieu. Descartes ramne tout Dieu aussi bien que Spinoza. Il est
donc moniste. D'un autre ct, Spinoza spare la pense et l'tendue
avec la mme rigueur que Descartes, et il affirme comme un thorme
fondamental que les modes de la pense ne peuvent s'expliquer que
par la pense, et les modes de l'tendue que par l'tendue. Il est donc
dualiste, tout autant que les spiritualistes. Tout le dbat se concentre
sur un point, savoir le degr de distinction qui spare les tres finis
de l'tre infini ; en d'autres termes, c'est de savoir si les tres finis doivent tre appels substance. C'est la question du panthisme. Mais,
cette question rserve, et nous la discuterons plus tard, ne peut-on
pas dire que, dans Spinoza, l'me est aussi profondment distincte du
corps que dans Descartes ? Le problme de l'union reste le mme, et la
solution est la mme que celle des autres cartsiens, savoir l'hypothse de la correspondance. Pas plus dans Spinoza que dans Malebranche et dans Leibniz, l'me n'agit directement sur le corps et rciproquement : il y a seulement concomitance de dveloppement. Il en
est de mme dans la philosophie de Herbert Spencer. C'est la mme
substance, l'inconnaissable, qui se manifeste la fois par le fait de la
sensation et par le fait du mouvement ; mais, suivant Herbert Spencer
lui-mme, ces deux phnomnes sont absolument irrductibles l'un
l'autre. On ne peut traduire la sensation en termes de mouvement, ni
traduire le mouvement en termes de sensation. Voil bien un dualisme, aussi rigoureux que celui [425] de Descartes. Quant l'action
rciproque des deux sries de phnomnes, elle ne s'explique que par
le recours l'inconnaissable, comme dans Spinoza par le recours la
substance. On voit qu'aucune doctrine n'a supprim le problme de
l'union de l'me et du corps, et n'en a donn une solution nouvelle.
Cependant, ne pourrait-on pas se borner au pur phnomnisme,
supprimer absolument l'ide de substance et n'admettre que l'existence
des phnomnes ? Soit ; mais prcisment alors, vous aboutissez au
plus pur et au plus rigoureux dualisme ; car vous ne pouvez mme
plus chercher de conciliation l'union des deux sries phnomnales
dans l'ide de substance, puisqu'il n'y a point de substance. Il n'y a
plus de pont entre la sensation et le mouvement, plus de passage. C'est
la pure doctrine de la correspondance, sans aucune cause ni agent suprieur. Dans Malebranche et dans Leibniz, il y a une cause suprme
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
391
de cette correspondance ; ici il n'y a plus rien ; c'est le fait matriel
constat, sans rien de plus.
Une forme plus savante du phnomnisme est celle qu'a propose
M. Taine, et que l'on pourrait appeler le phnomnisme moniste. Il n'y
a pas deux phnomnes ; il n'y en a qu'un seul, considr deux
points de vue diffrents, le dedans et le dehors. L'vnement mental
est identique en substance l'vnement physique ; et, runis, ils forment non pas un couple, mais un fait unique qui ne se distingue en
deux que pour notre point de vue, comme le concave et le convexe, le
droit et le gauche, l'intrieur et l'extrieur. Mais c'est l une pure hypothse tout fait arbitraire, et qui ne repose sur aucune donne relle.
qui fera-t-on croire qu'au point de vue de l'exprience ma pense soit
identique au mouvement du cerveau qui l'accompagne et dont je n'ai
aucune connaissance, si ce n'est acquise, induite, indirecte et non perue ? qui fera-t-on croire qu'un syllogisme (au point de vue exprimental) est identique un mouvement en zigzag, si tant est que cette
sorte de mouvement ou toute autre soit la forme extrieure d'un syllogisme ? Le seul moyen d'identifier ces deux [426] phnomnes, c'est
l'ide de substance. Sans doute, je comprends (sauf rserves) qu'une
mme chose, un mme tre, puisse tre la fois tendu et pensant ;
mais une pense n'est pas tendue, et une tendue n'est pas une pense. L'exemple du concave et du convexe n'est pas concluant : ici, en
effet, il n'y a pas deux choses ; il n'y en a qu'une, savoir la ligne,
considre soit en dedans, soit en dehors ; et il est bien vident que
c'est la mme ligne ; or c'est l un objet d'exprience, et les deux aspects qu'elle prsente sont eux-mmes aspects de l'exprience. Mais
dans le rapport de la pense et du mouvement, ce qui est par hypothse le mme. de part et d'autre ne tombe pas sous l'exprience ; nous
ne percevons au contraire que la diffrence. En fait, il y a deux phnomnes : il y a concomitance ; il n'y a pas identit. Pour vous,
comme pour nous, le passage est incomprhensible. Une dernire hypothse par laquelle on essaye de rapprocher plus intimement encore
ces deux attributs ou les deux classes de phnomnes, c'est ce qu'on
appelle l'idalisme, qui consiste n'admettre comme rel que le sujet
pensant, et faire de l'tendue une forme ou un mode de la pense. Il
n'y a plus chercher comment l'un agit sur l'autre, puisqu'un seul est
rel et que l'autre terme est idal. Je n'ai point d'ailleurs jusqu'ici cart d'une manire absolue cette hypothse ; j'ai dit mme que c'tait un
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
392
ultra-spiritualisme et qu'elle nous accordait plus que nous ne demandions ; mais, au point de vue de la question qui nous occupe, je me
demande si elle offre rellement l'avantage qu'elle nous promet, savoir si elle carte compltement le problme de l'union de l'me et du
corps. Je dis que la difficult ici n'est qu'carte et lude, mais non
supprime : car elle revient sous une autre forme. Comment ce qui est
intendu (car pour Kant le sujet pensant est intendu, puisque l'tendue n'est que la forme des choses extrieures), comment, dis-je, un
sujet intendu est-il forc de percevoir les choses sous la forme de
l'tendue ? Comment la pense ne se peroit-elle que sous la condition
de l'tendue ? Le dualisme que vous croyez avoir cart quant la
substance [427] revient au point de vue des facults. L'homme ne sera
pas compos, si vous le voulez, de deux substances ; mais il sera
compos de deux facults irrductibles, la sensibilit et l'entendement.
D'o provient cette nouvelle dualit ? Cette difficult est si relle que
c'est elle qui a ramen aprs Kant un monisme plus ou moins semblable celui de Spinoza, que nous avons dj discut.
On n'attend pas de nous que nous discutions ici tous les systmes
de philosophie que l'on peut concevoir. Mais nous nous bornons signaler ce point de vue : c'est que dans tous les systmes on retrouve
toujours, sous une forme ou sous une autre, la dualit fondamentale
que Descartes a signale la base de son systme, savoir la pense
et l'tendue ; que cette dualit n'a pas t supprime parce que l'on a
montr que ces deux formes de l'existence impliquent un principe
unique : car tout philosophe (sauf le dualisme antique) commence et
finit par l'unit, et par consquent est moniste ; et rciproquement tout
philosophe est dualiste, puisque pas un ne peut nier la diffrence au
moins phnomnale de la pense et de l'tendue ; et encore, dans Spinoza lui-mme, cette distinction est plus que phnomnale, car ce n'est
pas une diffrence de mode, mais une diffrence d'attribut. Il y a donc
pour tous les philosophes sans exception un problme : c'est le passage de l'un de ces termes l'autre. C'est une difficult essentielle
qu'aucun systme n'a pu viter et qu'aucun d'eux n'a encore leve.
Nous n'avons donc pas expliquer plus que les autres l'inexplicable, ni comment l'me agit sur le corps, ni comment le corps agit sur
l'me. Nous prenons le fait de la correspondance : le comment nous
chappe. Mais, sans nous heurter ce comment, peut-tre pourronsnous savoir ou du moins conjecturer jusqu'o va cette union et de
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
393
quelle nature elle est. Est-ce une union purement extrieure et en
quelque sorte accidentelle, une simple juxtaposition de substances ?
l'homme est-il, comme le disait un disciple de Descartes, un tre par
accident, entendant par l qu'il ne peut pas tre de [428] l'essence d'un
esprit d'tre uni un corps ? En un mot, suivant l'expression consacre, l'me est-elle dans le corps comme le pilote dans son navire ? ou
bien (seconde hypothse) les deux substances sont-elles intimement
unies, c'est--dire lies par un lien intrieur de substance substance,
se pntrant l'une l'autre ? Le corps, dit-on, est l'instrument de l'me ;
mais, dit Bossuet, c'est un instrument qui diffre des autres ; car si
nous brisons ou perdons un de ces instruments matriels et extrieurs
dont nous nous servons, il n'en rsulte rien pour nous-mmes ; nous
n'avons qu' en chercher un autre, au lieu que, si notre instrument organique est bris, bless, affect d'une manire quelconque, nous en
souffrons et mme nous en mourons. D'o Bossuet conclut que
l'homme est un tout naturel, c'est--dire une substance intelligente,
ne pour vivre dans un corps et lui tre intimement unie . C'est cette
doctrine que la philosophie scolastique exprimait en disant avec Aristote que l'me est la forme du corps . C'est ce qui explique aussi
que la scolastique paraissait craindre dans Descartes les excs du spiritualisme cartsien, et c'est en se plaant ce point de vue qu'Arnauld
disait Descartes : Ne craignez-vous pas que l'on vous confonde
avec les anciens platoniciens, qui faisaient de l'me un esprit pur ?
Sans vouloir embrasser toutes les questions que le problme pos
pourrait soulever et entraner avec elle, nous voudrions restreindre le
dbat autant que possible sur un terrain positif et concret, et plus ou
moins accessible l'exprience, par consquent sur un terrain psychologique. Il nous semble, en effet, que, si le corps n'est que juxtapos
l'me comme un instrument extrieur, les sensations que nous situons
dans le corps, comme une douleur la tte, la dent, la main, n'y
sont situes que par suite de l'exprience et de l'habitude qui nous ont
permis de constater qu' telle sensation correspond telle modification
corporelle. Si, au contraire, la localisation des sensations dans le corps
est spontane et naturelle, antrieure l'exprience ; si nous [429]
sentons dans notre corps, non par habitude, mais par instinct, c'est que
notre me est unie notre corps d'une manire vritablement intime,
que le corps organis fait partie de notre tre, qu'il est nous quelque
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
394
degr, et que l'me n'est pas dans le corps comme le pilote dans son
navire.
Le problme de la localisation des sensations devient donc la traduction exprimentale du problme mtaphysique, la communication
des substances. Nous ne saisirons sans doute pas par l l'action respective de l'me et du corps ; mais nous verrons qu'il y a autre chose dans
cette action qu'une simple correspondance ou concomitance, savoir
une pntration, une intussusception rciproque. Cela ne porte point
atteinte la distinction ; car de ce que deux choses sont distinctes, il
ne s'ensuit pas qu'elles ne puissent tre unies l'une l'autre. La question toute mtaphysique de l'union de l'me et du corps sera donc
remplace pour nous par la question exprimentale de la localisation
des sensations.
Lorsque nous prouvons une sensation, soit externe, soit interne,
nous la rapportons la plupart du temps un endroit dtermin du corps
que nous appelons sige de la sensation. Sommes-nous piqus ou brls, nous savons immdiatement o nous avons t piqus ou brls.
L'blouissement caus par le soleil nous affecte les yeux ; le bruit d'un
canon, les oreilles ; la saveur d'un vin, la bouche. Nous rapportons la
migraine la tte, la colique aux entrailles, etc. Ainsi de toutes nos
sensations.
Les faits que nous venons de dcrire s'appellent la localisation des
sensations. Comment cette localisation a-t-elle lieu ? Est-elle un fait
primitif, constitutif de la nature humaine ? Est-elle, au contraire, le
rsultat de l'exprience et de l'habitude ? Nous retrouvons ici le dbat
qui a t soutenu principalement l'occasion de la vision. La thorie
de la vision a suscit deux coles : l'cole innistique ou nativistique,
comme l'appelle Ilelmholtz, laquelle attribue la plus grande part des
phnomnes de la vision aux dispositions innes de la vue, et l'cole
empiristique, qui explique au contraire, le [430] plus qu'elle peut, les
perceptions visuelles par l'association des ides, par l'induction et par
l'exprience. C'est ainsi que, suivant cette dernire cole, la vue ne
percevrait primitivement que des plans ; l'exprience seule, aide du
toucher et du mouvement, lui apprendrait discerner les distances et
les reliefs. C'est l'exprience qui nous ferait reconnatre la forme et la
figure, qui redresserait pour nous les objets primitivement renverss,
qui peut-tre mme nous montrerait comme simples des objets qui
d'abord nous auraient paru doubles ; et on sait enfin que, suivant cette
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
395
cole, ce sont les diffrentes apparences lumineuses qui sont les
signes des objets rels. Au contraire, suivant l'cole innistique, l'exprience peut bien servir, la vrit, perfectionner et claircir ces
diverses notions, mais elle ne les produit pas ; et la vue toute seule
aurait en elle-mme la facult de nous faire connatre toutes les modifications de l'tendue aussi bien que de la couleur.
Le mme problme peut tre pos l'gard de la localisation des
sensations. Au point de vue de l'homme adulte rflchissant sur ses
tats de conscience, il semble bien que rien n'est plus spontan et plus
naturel que la localisation de nos sensations. C'est immdiatement,
sans aucune tude ni rflexion, que nous rapportons la tte ou au
ventre les douleurs diverses dont ces organes sont le sige. Sommesnous piqus ou brls dans l'obscurit, nous n'hsitons pas porter
tout de suite la main la partie affecte, et nous ne nous trompons gnralement point. Qui a jamais cru qu'un mal de dents ft dans le
pied ? Rarement, et seulement dans les parties profondes, nous avons
quelque doute sur le point prcis de la sensation ; mais nous ne nous
trompons gure sur la rgion affecte.
C'est cette association troite et invincible de la sensation et de
l'organe qui rend si difficile comprendre pour les jeunes gens, et en
gnral pour les personnes trangres aux tudes philosophiques, ce
que nous appelons le point de vue psychologique ou objectif, c'est-dire la sparation du [431] fait de conscience et de la partie matrielle
laquelle nous le rapportons. Pour le sens commun, c'est l'organe qui
sent ; et tout ce que nous pouvons obtenir de lui, c'est de consentir
dire que le moi se sent dans l'organe. Rien ne parat donc au premier
abord plus vident et plus conforme l'exprience que la doctrine
d'une puissance inne et spontane de localisation.
Cependant la psychologie nous a appris nous dfier de ces prtendues vidences et de ces soi-disant innits, qui, considres de
plus prs, ne sont que des rsultats de l'habitude et de l'association.
Voyons comment on pourrait expliquer, comment on a expliqu en
effet les faits prcdents.
Primitivement, dirait-on, le moi ne connat que lui-mme et ses
tats de conscience : pour lui, il n'y a pas encore de corps, pas plus de
corps propres que de corps extrieurs. Quand il commence distin-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
396
guer quelque chose d'extrieur, son propre corps est confondu par lui
avec les autres, et il ne les peroit que comme il peroit les autres
corps, c'est--dire par la vue et par le toucher ; mais il s'habitue peu
peu discerner une certaine portion de matire qui accompagne toujours ses sensations, et dont il ne se spare jamais. Il arrive par l
distinguer ce corps des autres corps, et se l'attribuer d'une manire
plus particulire ; il sent que ce corps est lui, comme un instrument
habituel et ncessaire ; mais ce corps ne lui est cependant pas plus
qu'un autre instrument. Si un enfant tait n manchot ou mutil d'une
jambe et qu'on remplat cette jambe ou ce bras qui manquent par un
membre postiche, il s'habituerait ce membre postiche, comme il le
fait ses bras et ses jambes, et il croirait que ces instruments factices
font partie de lui-mme. Bossuet distingue la vrit entre les instruments ordinaires et le corps humain : Qu'on brise le pinceau d'un
peintre ou le ciseau d'un sculpteur, dit-il, il ne sent pas les coups dont
ils sont frapps ; mais l'me sent tous ceux qui blessent le corps, et au
contraire elle a du plaisir quand on lui donne ce qu'il faut pour l'entretenir. Mais si l'on appliquait un enfant [432] aussitt n des lunettes pour lui garantir la vue, lorsque ces lunettes seraient brises il
prouverait une douleur vive par suite de l'blouissement, et peut-tre
par habitude placerait-il cette douleur dans l'instrument bris. Plusieurs faits semblent indiquer qu'il pourrait bien en tre ainsi. Ainsi,
par exemple, nous sommes tellement habitus nos vtements qu'ils
semblent presque faire partie de notre corps. Notre moi n'est pas seulement l'me et le corps runis, c'est le corps habill ; et ce qui fait que
nous ne nous confondons pas tout fait avec nos vtements, c'est que
nous les tons, nous les changeons, et que mme, dans certains cas,
comme dans le bain, nous les quittons tout fait. Mais si l'on supposait un enfant qui n'et jamais quitt ses habits, c'est une question de
savoir si pour lui les habits ne feraient pas partie du moi. On sait que
celui qui a pris l'habitude de marcher avec une canne se sent comme
incomplet et mutil lorsque cette canne vient lui manquer. Mme
l'illusion qui consiste sentir dans l'organe ne manque pas d'une certaine analogie dans le cas d'un instrument artificiel ; car quand on se
sert d'un bton pour toucher un objet dur ou mou, il semble bien que
l'on sent la duret ou la mollesse au bout du bton ; et maintenant
mme, o j'cris ces lignes, je sens la rsistance du papier au bout de
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
397
la plume et non au bout des doigts. 42 Enfin, un argument souvent employ et qui a une grande force, c'est le fait de l'amput, souffrant au
membre qu'il n'a plus. Dans les expriences de rhinoplastie, o l'on
prend une partie de la peau du front pour faire un nez, il arrive que si
l'on [433] prouve ensuite quelque sensation, une dmangeaison par
exemple, au bout du nez, on rapporte la sensation l'endroit primitif,
c'est--dire au front. Ces illusions du sens localisateur ne dposentelles pas contre l'innit de ce sens, de mme que, dans la thorie de la
vision, les illusions de la perspective dposent contre les partisans de
la thorie innistique ?
La doctrine prcdente parat bien tre celle que Descartes expose
au VIe livre des Mditations, lorsqu'il dit :
Mais il y a plusieurs autres choses qu'il semble que la nature m'ait
enseignes, lesquelles toutefois je n'ai pas vritablement apprises d'elle,
mais qui se sont introduites dans mon esprit par une certaine coutume que
j'ai de juger inconsidrment des choses Je remarque que la nature du
corps est telle qu'aucune des parties ne peut tre mue par une autre partie
un peu loigne qu'elle ne le puisse tre aussi de la mme sorte par chacune des parties qui sont entre deux, quoique cette partie plus loigne
n'agisse point De sorte que, s'il y a quelque cause qui excite non dans le
pied, mais dans quelqu'une des parties du nerf qui est tendu depuis le pied
jusqu'au cerveau, le mme mouvement qui se fait ordinairement quand le
pied est mal dispos, on sentira de la douleur comme si elle tait dans le
pied, et le sens sera naturellement tromp.
42
Si de naissance un bton avait t soud l'une de nos mains, comme les
longs poils sensitifs et explorateurs du chat sont souds ses joues et ses
lvres, comme le bois du cerf est soud son front, comme la barbe et les
dents sont soudes notre peau, nous situerions nos lvres au bout du bton,
comme trs probablement le chat situe ses attouchements au bout de sa moustache, et le cerf au bout de ses cornes, comme trs certainement nous situons
nos contacts au bout de nos poils de barbe et de nos dents. (Taine, de l'Intelligence, 1. II, ch. II, 3 dit, tome II, p. 135.) Voir dans ce chapitre un grand
nombre de faits en faveur de l'opinion prcdente emprunts a Muller (Physiologie, 1. III, sect. 3, ch. II), Weber (Ilandwrterbuch, de Rudolph Wagner,
art. Tactsinn, 2e part., p. 488 et suiv.), Vulpian (expriences de Paul Bert sur
la greffe animale, Leons sur la physiologie des systmes nerveux).
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
398
D'aprs cette thorie, comment s'expliquerait donc la localisation ?
Par une association que l'habitude tablirait entre la sensation prouve et la perception objective de l'organe affect. Par exemple, la sensation du mal de tte n'apporte par elle-mme aucune notion de tte ;
mais l'exprience nous apprend que lorsque nous prouvons cette douleur, nous la soulageons en portant la main cette partie de nos organes appele tte ; que nous la soulageons encore en dposant notre
tte sur un oreiller et en lui mettant des compresses d'eau froide, etc. ;
cette association une fois tablie, si nous prouvons de nouveau la
mme sensation, nous penserons ncessairement la tte, et nous dirons que nous [434] avons mal la tte. De mme pour la colique,
pour le mal de dents, etc., un cataplasme sur le ventre soulage la colique : donc elle a eu lieu dans le ventre ; l'extraction d'une dent enlve la douleur : donc elle avait son sige dans la dent.
Cette thorie est trs nettement rsume par l'un des philosophes
les plus distingus de l'cole empiristique, M. Taine : C'est une loi,
dit-il, qu'une sensation nous parat situe l'endroit o nous avons
coutume de rencontrer sa cause ou condition ordinaire, et cet endroit
est celui o le toucher explorateur peut, en agissant, interrompre ou
modifier la sensation commence. 43
Le mme philosophe tire de cette loi les consquences suivantes :
1 le jugement localisateur est toujours faux, car jamais le toucher ne
peut aller dans les centres sensitifs, interrompre ou modifier la sensation commence ; 2 le plus souvent le jugement localisateur doit
situer la sensation peu prs l'extrmit extrieure des nerfs ; car si
l'excitation de tout le cordon nerveux est l'antcdent normal de la
sensation, notre toucher ne peut atteindre que les environs de son extrmit extrieure ; 3 le jugement localisateur ne doit pas situer la
sensation l'endroit exact o se trouve l'extrmit du nerf branl,
mais aux environs ; car le toucher n'atteint pas l'endroit exact ; 4
en plusieurs cas, le jugement localisateur doit tre vague, car il y a des
endroits o le toucher n'atteint pas, par exemple l'intrieur des
membres et du corps ; partant, nous n'en situons que par approximation et vaguement les sensations dont le point de dpart est dans le
43
Taine, de l'Intelligence, 1. II, ch. n, 3 dit., tome II, p. 143.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
399
ventre, la poitrine, l'estomac, non plus que les sensations partielles
dont se compose une sensation totale musculaire. 44
On voit qu'un grand nombre de faits et des inductions trs plausibles paraissent autoriser l'hypothse d'une localisation acquise et artificielle des sensations. Et cependant, nous ne croyons pas que cette
thorie soit la vraie ; nous [435] croyons au contraire que la facult de
localiser est inne, sans nier toutefois qu'elle ne puisse se perfectionner par le concours des sens externes. Tous les faits invoqus en faveur de l'hypothse empiristique peuvent s'expliquer dans la thorie
contraire ; et, en revanche, il est un certain nombre de faits significatifs et, comme Bacon les appelait, des faits cruciaux, qui ne peuvent
s'expliquer que dans la thorie de l'innit, et qui par consquent doivent faire pencher la balance en faveur de cette seconde opinion.
quelles conditions des sensations qui seraient, par hypothse, purement subjectives pourraient-elles, l'aide de l'exprience et de l'habitude, tre localises dans telle ou telle partie du corps ? C'est videmment la condition d'tre diffrentes suivant les diffrentes parties du corps, et par consquent de pouvoir en devenir les signes lorsqu'elles se renouvellent ; c'est, en second lieu, la condition que nous
les ayons dj prouves, et que nous les reconnaissions lorsqu'elles
reparaissent, de telle sorte qu'elles ramnent l'esprit l'image de la
partie du corps antrieurement affecte. Mais s'il nous arrivait de localiser sans erreur sensible des sensations identiques dans toutes les parties du corps, ou des sensations que nous n'avons pas encore ressenties, il faudrait, selon nous, reconnatre que la facult de localisation
est inne. Car de quels signes pourrait-elle se servir pour diversifier
les siges de ces sensations ?
Ainsi deux sortes de faits tmoigneraient, selon nous, en faveur de
l'hypothse innistique : 1 les sensations homognes ; 2 les sensations prouves pour la premire fois, la condition que dans ces
deux cas il y et localisation : or c'est ce qui a lieu. Examinons ces
deux sortes de faits.
1 Sensations homognes. Rappelons-nous l'explication prcdente. Une sensation est prouve : le toucher explorateur vient emp44
Taine, ibid.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
400
cher, modifier cette sensation ; l'ide de cette sensation s'associe
celle de la partie du corps que le toucher explorateur nous a dsigne
(par exemple, mal de tte soulag par la main froide) ; si cette sensation se renouvelle, nous [436] penserons la tte ; et ces deux ides
n'en feront plus qu'une, qui sera le mal de tte : soit ; mais, s'il en est
ainsi, c'est que le mal de tte est une sensation spcifique sui generis,
que nous ne confondons avec aucun autre ; autrement, cette sensation
venant reparatre, comment saurions-nous qu'elle a eu lieu dans la
tte plutt que dans toute autre partie du corps o nous aurions pu
galement l'prouver ? C'est pourquoi l'exprience peut nous apprendre localiser des sensations dissemblables : par exemple le mal
de tte, le mal de dents, la colique, etc., parce que ce sont des sensations trs distinctes que nous n'prouvons que dans certaines parties
dtermines et dont chacune, restant toujours la mme, est trs reconnaissable. Personne, en effet, ne confond ces trois sensations : par
consquent, quand elles se reproduisent, elles ramnent avec elles
l'ide de places distinctes et spares. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Il y a un bon nombre de sensations que j'appellerai homognes, qui
sont les mmes dans toutes les parties du corps, et que nous localisons
cependant avec une entire certitude. Par exemple, une piqre, une
coupure, une dchirure, une brlure, nous donnent toujours la mme
sensation, dans quelque partie du corps que nous la ressentions. Une
piqre la main droite ne diffre en rien d'une piqre la main
gauche ; une brlure ou une coupure au pied ne diffrent en rien d'une
brlure ou d'une coupure la main. Supposons donc que nous ayons
prouv une premire fois telle de ces sensations et que le toucher explorateur ou la vue nous en aient fait remarquer le sige dans la main
gauche : la seconde fois que nous serons piqus ou brls, si nous ne
voyons pas l'organe bless, nous croirons encore que c'est la main
gauche ; mais peut-tre sera-ce la main droite, ou au pied, ou telle
autre partie ; plusieurs expriences de ce genre ayant t faites, l'association tant rompue chaque fois entre la sensation et l'organe, nous
devrons prendre l'habitude, selon les principes mmes de la thorie
associationiste, de ne plus localiser du tout. Voil ce qui devrait arriver dans le cas de sensations homognes, [437] c'est--dire identiques
dans toutes les parties du corps. Mais l'exprience nous apprend au
contraire que non seulement nous continuons localiser, mme dans
ce cas, mais que nous le faisons sans nous tromper jamais d'une manire apprciable : jamais personne n'a confondu une piqre droite et
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
401
une piqre gauche, lors mme que cette sensation a lieu dans l'obscurit. En quelque partie du corps qu'on soit piqu, coup, brl, on
reconnat immdiatement le sige de la sensation. Il en est de mme
des dmangeaisons, qui sont galement des sensations homognes :
nulle diffrence entre une dmangeaison gauche ou droite, la
main ou la jambe, dans telle ou telle partie du corps. Cependant estil une sensation plus facile localiser ? en est-il qui demande moins
de rflexion, moins de comparaison ? En parlant, en crivant, en marchant, sans y penser mme, on sent la plus lgre dmangeaison, et on
porte la main, sans se tromper, la partie affecte (comme l'oreille,
par exemple, au moment o j'cris ces lignes). 45 La localisation est
donc certaine, presque infaillible, quelques lignes prs ; et cependant
la sensation est absolument homogne dans toutes les parties du corps.
Sans cet lment de localisation inne, impossible de s'expliquer
comment des sensations homognes peuvent devenir signes de places
diffrentes. Rappelons-nous l'usage que l'on fait de l'explication empiristique dans la thorie de la vision. On prtend que les diffrences de
distance ou de relief ne sont pas perues directement par la vue, mais
qu'elles sont simplement induites des diffrences de lumire et
d'ombre, ou des diffrences de couleur qui les accompagnent ; soit ;
mais il faut qu'il y ait des diffrences dans la distribution des lumires
et des ombres, dans les distributions de couleurs ; car si, toutes les
distances, les sensations de couleur ou de forme taient identiques,
elles ne pourraient plus servir de signes pour discerner les degrs de la
profondeur ; [438] et alors, ou bien la vue n'aurait aucune perception
de ce genre, ou il faudrait reconnatre qu'une telle perception, si elle
existait, est une perception spontane et inne. C'est l prcisment le
cas des sensations homognes dans le corps humain : tant les mmes
dans toutes les places, elles ne peuvent devenir le signe d'aucune
d'elles en particulier. Habitus la thorie empiristique, et entrans
par cette thorie, les philosophes de cette cole finissent par l'appliquer, sans s'en apercevoir, mme au cas o la condition fondamentale
fait dfaut.
Peut-tre, pour luder ces consquences videntes, se rsoudra-t-on
soutenir qu'il n'y a pas de sensations rigoureusement homognes, et
45
On dira que j'ai provoqu la sensation rien qu'en en parlant : cela est vrai ; mais
je ne l'ai pas provoque l'oreille plutt qu'ailleurs.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
402
qu'il y a toujours de petites diffrences qui les diversifient suivant les
places ; nous aurions conscience, dirait-on, de ces diffrences : et cela
suffirait pour autoriser des inductions diffrentes suivant les cas. J'accorde qu'il n'y a pas de sensations rigoureusement homognes, d'aprs
le principe des indiscernables de Leibniz ; mais les diffrences tiennent aux diffrences de cause et non aux diffrences de place : par
exemple, nous distinguerons bien une piqre d'pingle et une piqre
d'aiguille ; mais deux piqres dues une mme cause n'ont entre elles
aucune diffrence, quelle que soit leur place. Supposer ces diffrences
dans l'intrt de la thorie, c'est faire de la psychologie conjecturale,
non exprimentale. C'est d'ailleurs remplacer le mystre par le mystre, car on n'carte l'innit que par la crainte du mystrieux : or, quoi
de plus mystrieux que des diffrences infinitsimales, inaccessibles
la conscience et servant de base aux inductions les plus prcises et les
plus certaines ?
2 D'ailleurs cette hypothse, elle-mme si peu vraisemblable,
viendrait son tour chouer devant cet autre fait : c'est que nous localisons avec une absolue certitude des sensations que nous prouvons
pour la premire fois : car alors on ne peut plus invoquer l'exprience,
l'habitude, l'association. Or, il est des sensations de ce genre : ce sont,
par [439] exemple, les sensations morbides, nes de blessures internes. Par exemple, celui qui a pour la premire fois une fluxion de
poitrine ou une pleursie, prouve ce que l'on appelle un point pneumonique, ou pleurtique, qu'il n'a jamais ressenti auparavant et qu'il
ne peut par consquent avoir associ par habitude avec telle ou telle
place ; et cependant le malade sait parfaitement dire s'il ressent ce
point droite ou gauche, en haut ou en bas du poumon. Sans doute
la localisation est ici moins prcise que pour les sensations extrieures ; nous ne nions pas, en effet, comme nous l'avons dit dj, que
la reprsentation objective de l'organe par le moyen de la vue et du
toucher ne contribue notablement la prcision de la localisation. La
rgion affecte nous parat donc plus vague en dedans qu'en dehors.
Mais, en gnral, les limites d'erreur ne sont pas trs larges ; et il y a
une suffisante exactitude pour que l'on dise que la sensation est rellement localise. Celui qui a une lsion au cur prouvera une sensation vive de douleur, qu'il localisera, mme la premire fois, dans cet
organe et non dans le foie ou dans la vessie ; et de mme pour les sen-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
403
sations douloureuses de ces deux organes. Il est un mal peu grave,
mais accompagn d'une douleur trs vive, que l'on appelle le coup de
fouet : c'est le sentiment vif et aigu prouv dans le mollet, qui ressemble au cinglement subit d'un coup de fouet. Ceux qui sont atteints
de cette affection, qui est rare, n'hsitent pas la rapporter immdiatement la partie blesse, quoiqu'ils ne l'aient jamais ressentie auparavant. Que viennent faire ici l'exprience et l'habitude, puisqu'il s'agit
d'une premire sensation ?
Tous ces faits prouvent, selon nous, une facult naturelle et spontane de localisation. Sans doute, cette facult n'est pas absolument
exacte ; elle dsigne plutt souvent une rgion qu'un point prcis ; il
peut y avoir une erreur de quelques millimtres ; trois millimtres,
par exemple, deux pointes de compas sont senties comme une seule.
Ces faits ne prouvent nullement que la facult de localisation ne soit
[440] pas inne, car c'est l un fait commun tous nos sens. Dans
tous, quand il s'agit de sensations trs rapproches, il y a un champ
plus ou moins indistinct o elles se confondent. Combien de personnes ne savent pas distinguer une couleur d'une autre, quand elles
sont trs rapproches, ou une saveur d'une autre : par exemple deux
crus diffrents quand il s'agit de vins ? Combien sont incapables de
distinguer un dise d'un bmol, ou mme deux demi-tons ? En conclut-on que la vue est impropre par elle-mme reconnatre les couleurs, l'oue reconnatre les sons, et le got les saveurs ? On dira que
l'habitude et l'exercice y font beaucoup : cela n'est pas douteux ; mais
c'est l'habitude et l'exercice de tel sens, et non pas son association avec
un autre. Chaque sens s'instruit lui-mme, voil la vrit, et cela n'est
pas contraire la doctrine de l'innit ; mais la vue n'a pas besoin de
toucher pour apprendre distinguer une couleur, ni le got de la vue
pour distinguer une saveur, ni l'oue d'aucun autre pour distinguer un
son. Le sens localisateur peut donc avoir certaines indterminations,
sans qu'on en puisse conclure qu'il n'est pas inn.
Et d'ailleurs, qui peut dire quel est le minimum apprciable d'une
sensation ? On s'tonne que deux pointes de compas nous en paraissent une seule. Mais qu'est-ce donc dj qu'une pointe de compas ?
Elle nous parat un point invisible : mais en ralit, cependant, c'est
dj un compos qui a une tendue relle, et qui affecte un certain
nombre de parties distinctes que nous ne pouvons pas discerner : de
mme tout point lumineux, au-dessous duquel il n'y a plus rien pour la
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
404
vision, n'est cependant qu'un compos de points lumineux que nous ne
distinguons pas les uns des autres. La consquence tirer de ces faits,
c'est que la perception sensible n'a jamais qu'une valeur relative et approximative, mais non pas que chaque sens n'ait pas ses perceptions
propres et naturelles qui lui sont vritablement innes. Pour la mme
raison, on devra accorder que le sens localisateur n'a lui-mme,
comme les autres, qu'une valeur relative ; qu'il [441] prsente, audessous de certaines limites, une certaine indtermination ; mais on
n'en conclura pas que ce sens localisateur n'est pas un sens naturel au
mme titre que les autres ? D'ailleurs, si le sens localisateur n'est pas
naturel en nous, ce ne serait pas seulement une distance trs petite
que les deux pointes du compas devraient tre senties comme une
seule ; ce serait une distance quelconque : car les deux pointes produisant une sensation absolument identique, il n'y a aucune raison de
les distinguer l'une de l'autre, si ce n'est par la diffrence des places ;
on devrait les confondre toujours, ce qui n'a pas lieu. Le fait signal
constitue donc une limite, mais non une erreur de la facult localisatrice.
Il n'en est pas de mme cependant de toutes les illusions de cette
facult. Quelques-unes, il faut le reconnatre, sont de vritables erreurs, comme, par exemple, l'illusion de l'amput qui sent la douleur
au membre qu'il n'a plus. Comment concilier un tel fait avec l'hypothse d'une facult inne de localisation ? Nous pensons que c'est ici
qu'il faut faire intervenir la thorie associationiste. L'association, dont
la thorie contraire la ntre se sert pour expliquer la perception proprement dite, la perception normale, nous semble devoir tre rserve
exclusivement l'explication de la perception errone. Ici deux observations sont ncessaires pour arriver la solution de la question.
La premire, que nous avons dj indique plusieurs fois, c'est que,
tout en soutenant une facult inne de localisation, on n'est pas engag
soutenir que l'association n'y joue aucun rle. On soutient seulement
ceci : c'est que l'me, quand elle prouve des sensations, les situe dans
un certain espace auquel elle est unie et dont elle ne se spare pas ;
mais elle ne donne pas cet espace une forme dtermine. Elle ressent
une douleur qu'elle localise en un certain point, la main, par
exemple, mais elle ne sait pas que c'est une main ; en mme temps
qu'elle a ce sentiment inn et subjectif de localisation, elle a des sens
externes, la vue et le toucher, qui lui reprsentent la main d'une ma-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
405
nire objective comme les [442] autres corps. Elle associe donc ce
sentiment subjectif de localisation, sentiment toujours plus ou moins
vague, la reprsentation objective de main, de pied, etc., et cette association donne videmment une bien plus grande prcision la localisation. Si c'est l ce que veulent dire les partisans du toucher explorateur, ils ont raison. Mais videmment ils veulent dire quelque chose
de plus ; ils entendent que ce n'est pas seulement la prcision de la
perception qui vient de l'association, mais la perception mme, savoir la perception dans un lieu, ou localisation. C'est au contraire de
cette perception en elle-mme, sans en dterminer le degr de prcision, que nous soutenons l'innit.
La seconde observation importante pour expliquer les erreurs de
localisation, c'est qu'il ne faut point s'tonner que nous admettions une
facult perceptive, et cependant plus ou moins indtermine, ayant
besoin du concours des autres sens pour arriver la dtermination et
la prcision. En effet, autre chose est percevoir, autre chose est mesurer. Une facult ne peut pas avoir en elle-mme sa propre mesure sans
perdre par l son titre tre une facult perceptive indpendante. Par
exemple, personne ne contestera que la perception du temps et de la
dure ne soit due la conscience ; et cependant la conscience par ellemme ne nous donne pas la mesure exacte du temps, et pour cette mesure nous avons besoin de recourir aux sens extrieurs, par exemple
la vue. Nous pouvons mme nous tromper gravement quant cette
mesure. Si, par exemple, pendant que nous sommes occups ; travailler avec une grande contention d'esprit, la pendule de notre cabinet
se trouve, par une raison quelconque, avance ou retarde, nous pourrons nous tromper de quelques heures sans nous en douter. Et cependant est-il un psychologue qui soutiendrait que la vue nous fournit la
notion du temps ? La conscience donne le temps, mais elle ne le mesure pas. On nous dit seulement qu'il s'est coul un certain temps et
que les diverses parties de ce temps sont les unes hors des autres ;
quant la reprsentation objective [443] de ce temps, elle est due au
sens extrieur. Ne peut-on point appliquer la mme doctrine au sens
de l'tendue interne ? La conscience nous apprend que nos sensations
sont dans l'tendue et qu'elles sont les unes hors des autres ; mais la
forme de cette tendue, la reprsentation totale de ce groupe de sensations, ne se forme qu' l'aide de la vue et du toucher. Il y a donc deux
procds de localisation qui travaillent concurremment dans l'enfant
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
406
nouveau-n : c'est le sens du dedans et le sens du dehors, et c'est de
leur concours que se forme la perception de notre propre corps et la
localisation actuelle de nos sensations.
D'aprs ces principes, il n'est plus difficile d'expliquer les illusions
signales. Le sens localisateur interne ayant pris l'habitude de s'appuyer sur le sens localisateur externe et trouvant mme dans celui-ci
une clart reprsentative qui lui manque lui-mme, se laisse peu
peu dpossder de sa fonction propre et se subordonne au sens extrieur, de mme que, chez la plupart des hommes, le toucher se laisse
subordonner la vue et perd par l les qualits de prcision dont il
serait susceptible et qu'il retrouve chez les aveugles de naissance. Cela
tant, lorsque tel organe a disparu, la reprsentation de cet organe ne
laisse pas que de subsister, au moins pendant un certain temps, et le
sens interne continue revtir sa propre sensation de la forme du sens
externe : il dira donc toujours : J'ai mal aux pieds, j'ai mal la
main, sans avoir ni main ni pied ; nanmoins la localisation dans
l'espace et une distance indtermine des centres n'en reste pas
moins l'opration inne du sens interne. L'erreur n'est pas une erreur
de perception, mais une erreur de prcision. Je puis percevoir trs nettement qu'un lieu n'est pas un autre, sans pouvoir dire avec prcision
quel intervalle il y a entre eux.
Pour le dire en passant, l'explication prcdente pourrait s'appliquer peut-tre d'autres cas, par exemple la perception de la distance. On refuse cette perfection la vue en invoquant les erreurs
qu'elle commet dans ce genre, et en [444] particulier les illusions de la
perspective et de la peinture. Mais ne peut-il pas se faire que la vue ait
le sentiment de la troisime dimension comme des deux autres, sans
en avoir la mesure ? Ne peut-on pas distinguer, avec un philosophe
amricain, ce qu'il appelle le quale et le quantum dans l'espace ? Le
quale, c'est ce qui constitue l'espace, savoir les trois dimensions ; le
quantum, c'est la dtermination et la mesure. Or, que dans un espace
qui en soi est homogne et qui ne fournit aucun point de repre, la vue
ait besoin de signes indicateurs, par exemple de couleurs, de lumire
ou d'ombre, pour valuer et dterminer les distances, cela se comprend
de soi ; mais s'ensuit-il que l'espace en gnral, avec ses trois dimensions, ne prexiste pas dans l'acte inn de la vue ? Nous inclinons,
pour nous, le croire, et nous pensons qu'il y aurait lieu rviser ce
que l'on appelle la doctrine de Berkeley, appuye de l'exprience de
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
407
Cheselden ; et ici encore l'hypothse inniste devrait reprendre l'avantage.
Pour en revenir notre question, nous devons nous borner ici des
considrations purement psychologiques. Nous n'avons pas voulu, en
effet, franchir les limites de la psychologie. Mais il est facile de voir
que nous touchons au problme le plus dlicat et le plus profond de la
mtaphysique, savoir au problme d'union de l'me et du corps.
Comment l'me peroit-elle son propre corps et se l'attribue-t-elle en
propre ? L'me est-elle dans le corps comme un pilote dans son navire, ou lui est-elle intimement unie ? Le compos humain, comme
l'appellent les scolastiques, est-il un tre par accident, comme disait
un disciple de Descartes, ou un tout naturel, comme le dit Bossuet ?
Le moi est-il exclusivement rduit la partie subjective et pensante de
notre tre, ou est-il, comme le croit le sens commun, l'me et le corps
runis ? Quel est le sige de l'me ? Est-elle unie au corps tout entier
ou une seule partie et mme un seul point ? La conscience, si elle
nous donne immdiatement l'tendue interne de notre corps, peut-elle
donc atteindre le vrai moi ? La conscience diffuse dans tout le corps
est-elle du [445] mme ordre que la conscience de la monade dominante qui est le sige de la pense et de la volont ? Y a-t-il lieu admettre, avec certains physiologistes et psychologues rcents, des moi
secondaires et des sous-consciences subordonnes au moi humain et
la conscience proprement dite ? Nous ne voulons pas ici entrer dans
toutes ces questions, qui sont d'un autre domaine. Nous avons voulu
nous circonscrire sur un point trs prcis, o il nous semble que l'on
peut dire quelque chose de positif. Nous croyons avoir dmontr par
des faits, inexplicables dans toute autre hypothse, l'existence d'une
facult inne de localisation. Nous ne voulons pas dpasser cette conclusion, qui parat par elle-mme assez importante. 46
[446]
46
Voir dans la Revue philosophique notre tude sur la Perception de la distance
par la vue (janvier 1879).
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
[447]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
Livre deuxime
LES PASSIONS
Retour la table des matires
[448]
408
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
409
[449]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE DEUXIME
LES PASSIONS
Leon I
Le fond commun
des phnomnes psychologiques.
La sensibilit physique.
Retour la table des matires
Messieurs,
Nous suivrons, dans le plan de ce cours, peu prs l'ordre de Spinoza dans son thique. Celui-ci, aprs avoir trait de l'me (de
Mente), vient traiter des passions (de Affectibus). En suivant cette
mme voie, nous rencontrons maintenant la question des passions, si
intimement lie la question de la libert, dont nous parlerons ciaprs.
Sans admettre, avec Condillac, que toutes nos facults ne sont que
la sensation transforme, nous sommes obligs de reconnatre que
toute vie psychologique commence par la sensibilit, et par la sensibilit physique. Au-dessous il n'y a pas de conscience, et par consquent
pas de vie psychologique ; au-dessus sont les facults d'un ordre suprieur qui se dvelopperont plus tard, mais qui ne paraissent pas contemporaines de nos premires impressions psychologiques. Les im-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
410
pressions et les premires ractions qu'elles produisent en nous sont
provoques par l'action des objets extrieurs sur nos organes, ou sont
le rsultat de la vitalit de ces organes. La sensibilit physique n'est
donc pas proprement parler une facult spciale ; c'est le fond commun d'o partent toutes nos facults. Toutes, l'origine, plongent dans
ce [450] fond commun, toutes y ont des racines. L'intelligence commence par la sensation Le sentiment commence par le plaisir et la
douleur attachs aux sensations et aux impulsions qui en drivent. La
volont commence par les mouvements instinctifs qui rsultent de ces
impulsions. En un mot, les trois facults que l'on distingue ordinairement dans l'homme, et que l'on a raison de distinguer, ne se sparent
pas l'origine, et elles tiennent par leurs racines la vie animale.
C'est pour avoir nglig de mettre part ce fond commun de la vie
psychologique, et avoir voulu l'encadrer titre de facult spciale
dans la srie de nos facults, que la psychologie est en gnral si embarrasse de dire ce que l'on doit entendre par sensibilit ; car tantt
on admet avec Kant que la sensibilit est la facult de recevoir des
impressions ou des reprsentations du dehors, et on l'oppose l'entendement. La sensibilit se compose alors de ce qu'on appelle les sens ;
mais que deviennent le plaisir et la douleur, les inclinations, les dsirs,
les affections, tout cet amas de faits motifs qui d'une part se distinguent des sens, et de l'autre peuvent s'lever, aussi bien que l'intelligence elle-mme, jusqu'au domaine le plus sublime. Il faudra donc ou
bien refuser, contre l'usage, la dnomination de sensibilit ces derniers phnomnes, ou embrasser dans une mme dnomination deux
faits aussi diffrents que la sensation de couleur et l'amour de la patrie. D'un autre ct, ce que l'on fait souvent, on restreindra le terme
de sensibilit la facult d'prouver du plaisir ou de la douleur, et
conscutivement des inclinations et des affections. Mais alors que faiton des sens proprement dits, c'est--dire des fonctions qui nous mettent en rapport avec le monde externe ? On est oblig d'en faire des
facults intellectuelles, et encore ici de violenter la langue, pour leur
enlever tout caractre sensitif. Enfin, on distingue une troisime facult que l'on appelle activit, et dans laquelle on distingue trois modes :
l'instinct, l'habitude et la volont. Mais en quoi l'instinct (premier
mode de l'activit) se distingue-t-il des instincts, ou tendances, ou impulsions [451] spontanes que l'on rattache la sensibilit ? C'est ce
que l'on n'explique pas.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
411
Ces difficults ne peuvent disparatre que si l'on distingue la sensibilit physique des trois facults, comme tant leur fond commun, leur
substratum. Nous admettons, quant nous, que les trois facults ne se
distinguent que par le haut, et qu'elles ont toutes trois des racines sensitives. La sensibilit physique n'est donc pas une facult spciale, ni
mme la partie d'une autre facult plus gnrale appele sensibilit.
Elle est une proprit fondamentale inhrente la vie animale, et peuttre identique la vitalit en gnral ; et c'est du fond de cette proprit commune et essentielle qu'mergent les trois facults lies un
tronc commun. Sans doute l'intelligence se distingue du cur, et le
cur se distingue de la volont. Voil les trois facults. Mais l'intelligence a ses racines dans les sens, le cur a ses racines dans les apptits, et la volont a galement les siennes dans l'instinct. Au lieu des
trois facults, on peut donc admettre en psychologie trois groupes de
facults, composs chacun de deux termes : les sens et l'entendement ;
les apptits et les sentiments ; l'instinct et la volont. Les trois
termes infrieurs sont les formes de la vie animale, les trois termes
suprieurs sont les formes de la vie humaine. Les trois termes infrieurs se distinguent peine les uns des autres ; ils vont se perdre euxmmes dans un fond commun o tout s'identifie. C'est mme la division des trois facults suprieures qui a permis d'tablir quelque distinction dans les termes infrieurs ; mais au fond ils se confondent :
sensations, apptits, instincts, tout s'identifie. L'instinct de succion, par
exemple, dans l'enfant nouveau-n, est la fois un instinct et un apptit, et il est accompagn de sensation. C'est ce fond obscur que Maine
de Biran appelle la vie affective de l'esprit, et que Cabanis appelle les
premires dterminations de la sensibilit.
tudions donc d'abord ce premier fond commun de la vie psychologique.
Tout en admettant avec Cabanis que la sensibilit physique [452]
est le dernier terme auquel on arrive dans l'tude des phnomnes, et
tout en admettant encore, si l'on veut, avec lui que le physique et le
moral se confondent leur source, nous n'admettrons pas pour cela
que, comme il le dit encore, le moral n'est que le physique considr
sous certains points de vue particuliers . De mme que Kant nous dit,
au dbut de son grand ouvrage : Toutes nos connaissances naissent
avec l'exprience, mais ne naissent pas de l'exprience, de mme on
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
412
peut dire que le moral en nous n'apparat qu'aprs ou avec le physique ; mais cela ne veut pas dire qu'il en vient.
Si donc nous voulons remonter jusqu'au premier fait psychologique, on est conduit au point o la sensibilit vient s'ajouter la vitalit proprement dite, ou mme se confond avec elle : car, suivant un
grand nombre de physiologistes, suivant Cabanis notamment et
Claude Bernard, la sensibilit n'est pas une proprit ajoute la vie ;
c'est la vie elle-mme. Vivre, c'est sentir.
Comment comprendre cette proposition ? Car en gnral on distingue l'tre vivant de l'tre sensible, et par exemple le vgtal de
l'animal ; on n'accorde l'un que les fonctions de nutrition et de reproduction ; on rserve l'autre les fonctions de relation, dont la premire est la sensibilit, et la seconde la motilit.
Mais les physiologistes dont je parle ne sparent pas la sensibilit
des autres proprits vitales. Voici un tre vivant, animal ou vgtal.
quoi reconnaissez-vous qu'il est vivant ? ce signe que, mis en
contact avec les objets extrieurs, il ragit, c'est--dire il entre de luimme en action. Sans doute les corps inorganiques ragissent galement, car c'est un axiome de la physique qu'il n'y a pas d'action sans
raction ; mais les ractions vitales sont infiniment plus nergiques, au
moins en apparence, que les ractions physiques et chimiques. Sans
insister sur ces diffrences, disons que ces ractions sont ou bien des
mouvements, ou des changements de coloration, ou des changements
de temprature, ou [453] tels autres phnomnes, diffrant suivant les
organes et les fonctions. Or, puisque ces organes taient prcdemment inertes au repos, puisque le contact des agents a t ncessaire
pour veiller leur activit, il a donc fallu qu'ils subissent quelque modification par le contact, qu'ils en subissent l'impression, en un mot
qu'ils l'aient sentie. La sensibilit n'est donc que la facult de recevoir
les impressions du dehors et de ragir sous l'influence de ces impressions. S'il en est ainsi, on comprend que la sensibilit s'identifie avec
la vie, qu'elle soit la vitalit elle-mme.
C'est dans ce sens qu'il sera permis de dire avec Bichat :
L'estomac est sensible la prsence des aliments ; le cur est sensible l'abord du sang, le conduit excrteur au contact du fluide qui lui est
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
413
propre ; la peau, les yeux, les oreilles, les membranes du nez et de la
bouche, sentent l'impression des corps qui les touchent.
Dans ce sens gnral, le terme de sensibilit s'appliquera aussi bien
aux vgtaux qu'aux animaux. La plante appele sensitive, et c'est de
l que lui vient son nom, ressent l'impression du contact, puisqu'elle se
replie sous cette impression. Toutes les plantes qui recherchent la lumire sont donc sensibles la lumire. Suivant Claude Bernard, qui a
fait des expriences l-dessus, les agents anesthsiques agissent sur les
plantes de la mme manire que sur les animaux. Le chloroforme insensibilise la sensitive et en arrte les mouvements. Dj au XVIIIe
sicle on avait fait des expriences analogues. On avait trouv
dimbourg que la sensitive s'immobilise lorsqu'on l'arrose avec de
l'opium. Claude Bernard raisonne donc ainsi : puisqu'un mme agent
produit les mmes effets sur les vgtaux et les animaux, il faut qu'il y
ait une proprit commune entre les uns et les autres. Or, chez les
animaux cette proprit s'appelle sensibilit : elle doit donc s'appeler
du mme nom chez les vgtaux.
Sans doute, c'est l un raisonnement plausible, et tant qu'il ne s'agit
que d'une question de nom, on peut accepter la dnomination de Cabanis et de Cl. Bernard, et entendre [454] par sensibilit toute espce
de rceptivit organique ayant pour effet de produire des ractions
particulires. Mais on se demande si, en tendant de cette manire le
sens du terme de sensibilit, on ne finit pas par lui ter toute signification prcise ; car ce serait arbitrairement que l'on rduirait la sensibilit ainsi dfinie aux tres vivants. Les tres inorganiques eux-mmes
ont aussi la proprit de recevoir les actions du dehors et de ragir
contre elles. Par exemple, la limaille de fer qui se prcipite sur l'aimant aussitt qu'elle a t mise en sa prsence, a bien l'air d'avoir t
impressionne par l'aimant et d'avoir ragi par un mouvement d'attraction. La plaque photographique qui est impressionne par la lumire
peut tre dite sensible la lumire. En prsence de telles ou telles
substances, les corps de la chimie changent de couleur, de temprature, de poids, et ce qu'on appelle affinit ressemble bien l'action
vitale. La sensibilit finirait donc par se confondre avec cette proprit
lmentaire de toute substance matrielle, savoir de recevoir des actions du dehors et de ragir contre ces actions.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
414
C'est pourquoi les psychologues en gnral veulent que l'on rserve
le terme de sensibilit un ordre de faits dtermins, savoir une
certaine proprit du systme nerveux, accompagne de conscience et
manifeste surtout par le plaisir et la douleur. Sentir, ce n'est pas seulement vivre, c'est jouir et souffrir avec ce qui s'ensuit, savoir les
mouvements d'attrait et de rpugnance conscutifs au plaisir et la
douleur. Les psychologues, en effet, demandent ce que c'est qu'une
sensibilit non sentie, ce que c'est que des impressions de sensibilit
qui ne sont pas des sensations. Cabanis a essay de rpondre cette
difficult :
Aprs avoir lu cet article, dit-il, un ami trs vers dans les matires
philosophiques me dit : Vous tablissez donc qu'il peut y avoir sensibilit sans sensation, c'est--dire sans impression perue ? Oui, sans
doute ; c'est mme un point fondamental dans l'histoire de la sensibilit
physique. Mais ce que nous croyons pouvoir appeler dans ce cas [455]
sensibilit, n'est-il pas ce que les physiologistes dsignent sous le nom
d'irritabilit ? Non ; et voici la diffrence. L'irritabilit est la facult de
contraction qui parat inhrente la fibre musculaire Mais dans les
mouvements organiques coordonns, il y a plus que cela, tout le monde en
convient ; car, outre ceux de ces mouvements qui sont dtermins par des
impressions perues, il en est plusieurs qui sont dtermins par des impressions dont l'individu n'a nulle conscience et qui, le plus souvent, se drobent eux-mmes son observation ; ils cessent lorsque l'organe n'a plus
de communication avec les centres sensibles ; ils cessent en un mot avec la
sensibilit ; ils sont suspendus et renaissent avec elle Ainsi, comme
nous n'appelons sensation que les impressions perues, il y a bien vritablement sensibilit sans sensation.
Ainsi, suivant Cabanis, la sensibilit se distingue de cette autre
proprit qu'Haller avait appele irritabilit et qui consiste dans la
proprit qu'a le muscle de se contracter au contact. Stimulez un
muscle, il se raccourcit, et c'est en cela qu'il est irritable. La sensibilit
est tout autre chose. Elle a lieu dans les mouvements coordonns ;
c'est--dire que lorsqu'on irrite une partie du corps, le corps tout entier, ou tout un systme d'organes, est m d'une manire sympathique
et coordonne. Or, quoique, dans ce cas-l, il y ait des impressions
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
415
dont nous avons conscience, il y en a aussi une multitude dont nous
n'avons point conscience et qui cependant dterminent des effets. Par
exemple, dans l'acte de la dglutition, de la natation, de la marche, de
la parole, le nombre des impressions conscientes est bien peu de chose
en comparaison de celles qui nous chappent et qui cependant sont
ncessaires pour dterminer les mouvements appropris que l'acte
exige. Dans bien des cas aussi, l'exprience nous montre la persistance
des mouvements quand la conscience semble avoir disparu : tel est le
cas de la grenouille dcapite qui continue nager, se cacher, etc.
En rsum, suivant Cabanis, il y aurait sensibilit lorsqu'une [456]
action exerce sur une partie du corps se communique une autre partie du corps et mme au corps tout entier ; il y aurait irritabilit lorsque le muscle irrit ragit sur place par la contraction contre la stimulation.
Bichat admet peu prs la mme doctrine que Cabanis. Seulement
il remplace le terme vague d'irritabilit par le terme plus prcis de
contractilit, ou proprit de se contracter sous l'irritation. Il en distingue deux espces : la contractilit animale ou volontaire, et la contractilit involontaire ou inorganique. Il admet la mme distinction
pour la sensibilit. La sensibilit est la facult de recevoir une impression ; quand elle n'est que cela, c'est la sensibilit organique ; mais
quand il s'y ajoute la facult de rapporter cette impression un centre,
c'est la sensibilit animale. Or, rapporter une impression un centre,
c'est ce qu'en termes psychologiques nous appelons avoir conscience.
La sensibilit animale, c'est donc la sensibilit consciente ; la sensibilit organique, c'est la sensibilit non consciente.
Seulement, en quoi consiste cette facult de recevoir des impressions ? C'est ce que Bichat ne nous explique pas ; car tous les corps
sans exception sont capables de recevoir des impressions. En quoi
donc consiste ce genre d'impressions qu'on ne sent pas et qu'on appelle cependant sensibilit ? Il est vident que nous ne comprenons la
sensibilit inconsciente ou organique que par analogie avec la sensibilit animale. C'est parce que, dans certains cas, nous avons conscience
du plaisir ou de la douleur, que nous supposons quelque chose de
semblable, mme lorsque nous ne sentons plus ni plaisir ni douleur.
Par exemple, la rougeur d'une membrane tant accompagne d'une
douleur que nous localisons dans cette membrane, nous disons que la
membrane est sensible ; nous dirons donc encore qu'elle est sensible
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
416
quand elle rougit sous une excitation, mme lorsqu'il n'y aurait pas de
plaisir ou de douleur. Nous sommes avertis par le plaisir et la douleur
de la prsence d'une proprit appele sensibilit ; et nous continuons
l'appeler [457] ainsi dans les cas purement organiques o il n'y a ni
plaisir ni douleur.
Au reste, Bichat jette un grand jour sur la question en montrant
qu'entre la sensibilit organique et la sensibilit animale il n'y a qu'une
diffrence de degr. En effet :
1 L'une succde l'autre d'une manire insensible. Par exemple,
nous avons la sensation du trajet des aliments dans la bouche et dans
l'arrire-bouche ; cette sensation s'affaiblit ds le commencement de
l'sophage, devient presque nulle au milieu et disparat la fin. Ce
sont cependant les mmes membranes qui doivent recevoir des sensations analogues.
2 Divers excitants appliqus au mme organe peuvent y dterminer l'un et l'autre mode de sensibilit. Par exemple, irrits par les
acides, les ligaments ne transmettent rien au cerveau ; mais sont-ils
tordus, distendus, dchirs, une vive sensation de douleur en est le
rsultat.
3 L'inflammation d'une partie, en exaltant la sensibilit organique,
la transforme en sensibilit animale.
Ainsi, un certain degr d'excitation, l'impression est transmise au
cerveau, il y a conscience ; un degr infrieur, l'action s'arrte l'organe, qui seul reoit l'impression sans la transmettre, et il n'y a pas
conscience. En consquence, suivant Bichat comme suivant Cabanis,
la conscience n'est pas indispensable pour constituer la sensibilit.
Cette proprit, avec ou sans conscience, est commune tous les organes. Elle en est, dit Bichat, le vritable caractre vital ; et, dans
chaque organe particulier, la somme de sensibilit dont il dispose
constitu sa vie propre . On peut donc dire que, pour Bichat
comme pour Cabanis, vivre, c'est sentir .
C'est la mme doctrine que nous trouvons dans Claude Bernard.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
417
Il conteste, comme nous l'avons dj vu, que la sensibilit soit la
facult propre des animaux. Il conteste le mot de Linn : Mineralia
crescunt, vegetalia vivunt, animalia sentiunt. [458] Il faut dire au contraire que la sensibilit est le caractre propre et essentiel de toute matire vivante.
Seulement il revient l'irritabilit hallrienne, au lieu de la contractilit de Bichat : la contraction est le fait du muscle ; or il y a
d'autres modes de raction qui ne sont pas des contractions ; tout organe ragit contre l'irritation, et en cela il est irritable.
La vraie difficult est de distinguer l'irritabilit de la sensibilit.
Nous avons vu comment Cabanis entend cette diffrence. L'irritabilit,
c'est la raction de l'organe isol ; la sensibilit, c'est la raction du
systme soit total, soit partiel, dans l'organisme en gnral. Claude
Bernard admet la mme distinction, en ajoutant d'ailleurs qu'il n'y a l
qu'une diffrence de degr. Voici comment il explique l'irritabilit.
Le protoplasma ou matire premire de l'tre vivant jouit de la facult remarquable de se dplacer, de changer de forme sous l'influence des
excitants ; il est contractile. Cette facult de mouvement est visible dans
toutes les masses protoplasmiques, dans les lments embryonnaires du
tissu conjonctif, dans les globules blancs du sang chez les animaux suprieurs. La motilit et l'irritabilit sont d'ailleurs deux proprits corrlatives qu'on ne saurait sparer l'une de l'autre ; le mouvement est un effet
dtermin par l'influence d'un agent ; l'agent, c'est l'excitant. La facult de
ragir par une manifestation physique, mcanique ou chimique contre
l'excitation, c'est l'irritabilit.
Si nous nous demandons maintenant, d'aprs cette dfinition, en
quoi la facult de ragir de la nature vivante se distingue del facult
de ragir de la matire brute, puisque, dans aucun cas, il n'y a d'action
sans raction, il se trouve que la diffrence, suivant Claude Bernard,
est dans la proportion. Dans la matire brute, l'action est gale la
raction ; dans la matire vivante, il semble qu'il n'en soit pas ainsi.
Par exemple, le plus lger contact peut dterminer la sensitive replier ses feuilles ; la plus lgre impression de froid peut dterminer
des congestions considrables.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
418
[459]
En un mot, sans rechercher si l'irritabilit peut se rduire des proprits mcaniques et chimiques, et si nous nous en tenons l'tat actuel de nos connaissances, on trouve qu'il y a un mode de raction
propre aux tres vivants ; et c'est le mode d'action que l'on appelle irritabilit.
Maintenant, en quoi ce mode d'action se distinguera-t-il de cet
autre mode d'action que l'on appelle sensibilit ?
Selon Claude Bernard, l'irritabilit ne serait que la forme lmentaire de la sensibilit ; et la sensibilit ne serait au contraire qu' une
forme trs leve de l'irritabilit .
Pour bien comprendre cette doctrine, il faut retrancher du terme de
sensibilit le sens exclusivement psychologique que lui donnent les
philosophes, savoir le fait d'prouver des sensations agrables et dsagrables, la suite de certaines modifications corporelles ; pour les
psychologues, son caractre distinctif serait la conscience.
Or cette signification ne peut pas tre celle des physiologistes, par
la raison que le domaine de la conscience leur est ferm. Ils n'tudient
et ne connaissent que les faits objectifs, matriels et tangibles. Or, ce
sont ces phnomnes matriels, accompagnant d'ordinaire les phnomnes de conscience, et pouvant se reproduire en l'absence de cette
conscience, ce sont, dis-je, ces phnomnes qui constituent pour le
physiologiste la sensibilit. Il y a l, dit Claude Bernard, un ensemble de phnomnes organiques ayant pour point de dpart l'impression d'un agent extrieur, et pour terme la production d'un acte
fonctionnel variable, mouvement, scrtion, etc. Donc ce qui caractrise la sensibilit, c'est la raction matrielle une stimulation.
Ainsi, pour les psychologues, la sensibilit est, suivant Cl. Bernard,
l'ensemble des ractions psychiques provoques par la modification
externe . Pour les physiologistes, la sensibilit est l'ensemble des
ractions physiologiques de toute nature provoques par les mmes
modifications .
Mais nous avons vu dj que l'irritabilit est aussi la raction
contre des stimulants externes. O donc est la diffrence ? [460] La
voici, selon Cl. Bernard. L'irritabilit, selon lui, c'est la facult de raction dans la cellule, c'est--dire dans l'lment primordial. Cl. Ber-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
419
nard la dfinit la sensibilit de la cellule. La sensibilit, c'est, au
contraire, la facult de raction dans l'appareil nerveux tout entier ou
dans une portion de cet appareil autre que la cellule excite .
Lorsque cette raction se communique au centre, elle devient consciente, et c'est alors la sensibilit psychologique ; quand elle s'arrte
aux centres secondaires, elle est inconsciente ; mais elle n'en est pas
moins la sensibilit.
On voit que la dispute des psychologues et des physiologistes n'est
gure qu'une dispute de mots. En effet, les psychologues accordent
qu' l'origine des phnomnes psychiques il se passe dans les organes
certaines ractions qui peuvent encore avoir lieu mme quand il n'y a
plus de phnomnes psychologiques. Seulement ils demandent qu'on
n'appelle pas cela sensibilit, puisqu'il n'y a rien de senti. De l'autre
ct, les physiologistes accordent qu'il y a une sensibilit consciente
qui est du domaine exclusif de la psychologie. Seulement ils croient
avoir le droit de dsigner sous le mme nom, savoir le nom de sensibilit, les ractions physiologiques qui sont la condition de la sensibilit, mme quand il n'y a rien de senti.
Les faits sont donc accords de part et d'autre ; il ne s'agit que d'un
mot. Les physiologistes demandent qu'on tende le mot de sensibilit
jusqu'aux phnomnes non sentis, lorsque ce sont des phnomnes de
raction gnrale. Nous demandons pour notre part que l'on tende le
nom d'irritabilit aux mmes phnomnes, en distinguant l'irritabilit
partielle et l'irritabilit gnrale.
Quoiqu'il en soit de ce dbat, entre la sensibilit purement organique ou irritabilit gnrale, qui est le domaine propre de la physiologie, et la sensibilit consciente, qui est le domaine de la psychologie,
il y a une sorte de vie crpusculaire, intermdiaire entre la conscience
et l'inconscience, une sensibilit sourde, diffuse, indtermine, dont
nous ne pouvons [461] nous faire une ide qu'en pensant l'tat intermdiaire entre le sommeil et la veille, ou dans l'vanouissement,
dans tous ces tats mixtes que l'on ne peut pas dcrire, mais qui ne
nous sont pas entirement inconnus, et qui sont pour nous le type de la
vie animale infrieure, type que l'on peut mme, l'aide de l'imagination, supposer jusque dans les plantes. Cette sensibilit informe, qui
est aux tats infrieurs de conscience ce que le protoplasma des protozoaires est aux formes organiques des embranchements suprieurs, est
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
420
la racine de la vie psychologique. C'est l que plongent toutes nos facults leur origine ; c'est de la qu'elles mergent en se distinguant.
C'est l que dorment, confondus, le sentiment, la pense, la volont,
en attendant qu'elles se sparent dans leur dveloppement.
Cette sorte de vie obscure et enveloppe a t en gnral nglige
par la psychologie classique. Ni l'cole de Condillac, ni l'cole cossaise, ni l'cole psychologique franaise de Jouffroy et de Ad. Garnier,
n'ont fait place dans leurs tudes cette existence primitive, qui est
cependant le fond premier de tout le reste. Deux philosophes seulement, notre connaissance (la philosophie contemporaine mise part)
ont port leurs regards sur cet ordre de phnomnes : Cabanis et
Maine de Biran. Celui-ci donne ces faits le nom de vie affective, et il
en parle souvent par opposition avec le moi ou la personnalit proprement dite. Cabanis consacre ce sujet toute une tude dans ses
Rapports du physique et du moral (10e mmoire, intitul les Premires Dterminations de la sensibilit). Nous rsumerons les ides
de ces deux philosophes.
Que faut-il entendre, suivant Biran, par tat affectif ?
C'est, dit-il, ce qui reste d'une sensation complte quand on en
spare l'individualit personnelle, et avec elle toute forme d'espace et
de temps, tout sentiment de causalit interne ou externe . Par
exemple, si, par hypothse, dans les innombrables sensations que nous
prouvons chaque heure de la dure, si nous retranchons l'ide du
moi avec toute [462] notion d'espace, de temps, de causalit, que
reste-t-il ? Ne reste-t-il alors que des phnomnes organiques, des
changements de mouvement perceptibles du dehors, tels que dplacements, raccourcissements, ou encore changements de coloration, de
temprature ? Ou bien reste-t-il quelque chose d'interne, de subjectif,
de psychologique ? Maine de Biran rpondait oui ; il reste un tat de
ce genre qui n'est pas mme encore la sensation, mais ce qu'il appelle
l'affection. Ce n'est pas l, dit-il, une abstraction. C'est un mode positif et complet dans son genre qui dans l'origine a form notre existence tout entire, et constitue celle d'une multitude d'tres vivants.
C'est l'tat dont nous nous rapprochons lorsque notre nature intellectuelle s'affaiblit et se dgrade, que la pense sommeille, que la volont
est nulle, que le moi est comme absorb par les affections sensibles.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
421
Pour Maine de Biran, comme pour Cabanis et pour Bichat, cet tat
est contemporain du premier dveloppement de l'tre organis : car,
dit-il, commencer vivre, c'est recevoir des impressions, en tre affect et ragir en consquence. Seulement les physiologistes ne
voient que les effets externes. Biran pense, au contraire, que l mme
o il n'y a pas de moi, pas de conscience proprement dite, il y a cependant encore quelque chose de psychologique et de subjectif, une
sensibilit diffuse, non concentre, ne se rsumant pas en une conscience individuelle et personnelle, mais que nous ne pouvons concevoir sans lui attribuer une demi-conscience, une conscience rudimentaire, extrieure en quelque sorte, et qui se confond absolument avec
l'impression elle-mme. Dans cet tat, la statue de Condillac, selon la
juste expression de ce dernier, devient odeur de rose . Ce sont les
perceptions sans aperception de Leibniz ; ce sont les sensations matrielles dont parle Buffon. Maupertuis attribuait celle sorte de sensibilit aux dernires particules de la matire, mme inorganique, et Bacon
lui-mme avait dit : La perception est partout, ubique est perceptio.
Cet tat appel affectif peut tre, suivant Biran, considr [463]
deux points de vue : 1 au point de vue de l'affection immdiate et
partielle ; 2 au point de vue de l'affection gnrale de tout le systme.
En effet, ou bien la sensibilit est concentre en un point de l'organisme, ou elle est la rsultante des actions subies par l'organisme tout
entier. Or, comme c'est toujours par la confusion que tout commence,
l'affection gnrale prcde l'affection particulire. Cette affection gnrale n'est d'abord que le sentiment vague de l'existence. Supposons
dans ce premier tat quelque impression nouvelle venue du dehors :
cette impression tendra se confondre avec l'affection gnrale ; elle
en modifie le caractre ; elle la teint de ses couleurs ; elle est agrable
ou dsagrable ; mais elle n'est pas ressentie comme telle ou telle
d'une manire distincte ; et l'affection gnrale n'est que la rsultante
de toutes les affections particulires qui se produisent dans une partie
quelconque de l'organisme, mais qui ne s'y circonscrivent pas.
Quoique un tel tat affectif reste en dehors de toute exprience directe, il ne nous est pourtant pas entirement inconnu ; car il continue
subsister, mme au sein de la vie consciente. Il continue tre le
fond inaccessible qui donne le ton notre vie sensible, qui est peut-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
422
tre le fond du caractre el de l'humeur, et peut tre la cause du bonheur et du malheur de chacun de nous.
C'est ainsi, dit Maine de Biran, que nous passons successivement,
sans nous en apercevoir, par toutes les modifications gnrales de l'existence relatives la succession des ges, aux rvolutions du temprament,
l'tat de sant ou de maladie, aux changements des saisons, du climat, de
la temprature Il est aussi le principe de cette sorte de rfraction morale
qui nous fait voir la nature tantt sous un aspect riant et gracieux, tantt
comme couverte d'un voile funbre Aussi le charme, l'attrait, le dgot
ou l'ennui attachs aux divers instants de notre vie dpendent presque toujours de ces dispositions intimes profondment ignores de la sensibilit.
Nous portons en nous la source du bien et du mal, [464] et nous bnissons
ou accusons les hommes, la nature, le destin propice ou contraire. N'est-il
pas, en effet, comme le destin, cet agent invisible et mystrieux de la vie
qui opre en nous, sans nous, et dont nous subissons la loi ?
Tels sont les caractres vagues, indistincts, peine aperus, qui
appartiennent l'tat affectif en gnral, dans lequel viennent se
fondre toutes les impressions internes ou externes, et qui est dj, selon toute apparence, dans l'tre organis ds le premier moment qu'il
commence vivre. Nous pouvons supposer que ce premier tat est
caractris par le plaisir et la douleur, ou plutt par un tat moyen
entre l'une et l'autre : car il n'y a encore ni plaisir ni douleur quand il
n'y a rien de distinct. Ce sont des plaisirs et des douleurs absolument
indtermins et dont nous ne pouvons nous faire une ide qu'en les
comparant ces vagues instincts de tristesse ou de joie par lesquels
nous passons sans savoir pourquoi ni comment, et qui enveloppent
notre tre tout entier. Ce sont ces tats, moins la rflexion que nous y
ajoutons plus tard, qui constituent la vie affective en gnral. Nous
pouvons encore nous en faire quelque ide en nous interrogeant nousmmes et en remarquant, au-dessous de la conscience distincte qui
occupe le sommet de notre vie psychologique, une sorte de sentiment
vital gnral rpandu dans notre corps, que Condillac lui-mme, sans
y insister assez, appelait le sentiment fondamental de l'existence.
Nous remarquons dans cet tat affectif gnral un caractre essentiel que les physiologistes nous ont dj signal. Lorsqu'on parle de la
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
423
sensibilit, on entend d'ordinaire une facult positive qui consiste
recevoir des impressions du dehors, tre affecte, comme dit Kant.
Le mme philosophe la dfinit une rceptivit et l'oppose l'entendement, qui est une spontanit. Sentir, c'est tre touch, frapp, modifi. Mais il est impossible de s'en tenir cette signification du mot.
Toute tentative pour rduire la sensibilit au pur passif rendrait l'analyse de cette facult tout fait impossible. Nous avons vu, en effet,
que, pour le physiologiste comme [465] pour les psychologues, la sensibilit ne serait pas seulement la facult d'tre affect, mais encore la
facult de ragir. C'est, dit Claude Bernard, la raction la stimulation des agents extrieurs . Il y a donc deux choses dans la sensibilit : l la sensation ou excitation venue du dehors ; 2 la raction. Ces
deux choses sont insparables : car, sans raction, nous n'avons aucune preuve de l'excitation. Une membrane rougit sous l'influence
d'un excitant. Il faut qu'elle soit entre en action pour produire ce
changement, et sans ce changement rien ne prouverait que l'excitation
ait eu lieu. Que dit maintenant Maine de Biran ? Il s'exprime de la
mme manire que Cabanis, que Claude Bernard : Vivre, dit-il, c'est
commencer recevoir des impressions et ragir en consquence.
Ainsi, pour les psychologues comme pour les physiologistes, la raction est insparable de l'impression. Sans doute, si nous nous plaons au point de vue de l'adulte, de l'homme complet, chez lequel se
fait la division du travail et o chaque facult travaille sa fonction
propre, on peut distinguer rellement la facult de ragir de la facult
d'tre affect : une nouvelle nous cause une douleur profonde, voil la
part de la sensibilit ; j'entreprends une suite d'actions pour y chapper, voil la part de l'activit ; mais l'origine ces deux faits ne se sparent pas nettement, et mme ne se sparent jamais compltement.
Sans doute, comme le fait remarquer Claude Bernard, la sensibilit ne
se confond pas avec la motilit ; mais c'est la sensibilit qui, excite
par l'agent externe, communique de proche en proche cette excitation
et la transforme en mouvement ou en tout autre mode d'action physique ou chimique. Il y a donc l une proprit vraiment active, puisqu'elle provoque des phnomnes nouveaux, et toute diffrente de
l'impression reue. Ce n'est donc pas le mouvement qui fera partie de
la sensibilit, mais la tendance le produire.
Quand mme d'ailleurs, par une abstraction excessive, on retrancherait de la sensibilit ce qui en est pour le physiologiste [466] le ca-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
424
ractre essentiel, savoir la facult de ragir ; quand mme on la rduirait l'excitabilit, on peut encore se demander si, mme sous ce
terme, il n'y a pas encore un lment actif : car tre excit, stimul,
c'est sortir du repos, c'est encore ragir. Un tre purement inerte n'est
pas stimul, il est mort ; et c'est cela mme qu'on appelle la mort. Que
recherchent les mdecins par les excitants, les toniques, les rvulsifs,
etc. ? Ils cherchent rveiller l'organe, lui rendre de l'lasticit, en
un mot le rappeler la vie. Sans doute par cela mme que l'action
vient d'abord du dehors, il y a l quelque chose de passif ; mais si cette
action ne rencontrait aucune raction, elle serait nulle, et aucun phnomne ne se produirait. Ainsi, mme au point de vue de la sensibilit
physique, l'individu n'est pas une table rase ; il contient dj quelque
innit.
C'est ce qui explique que dans la psychologie de l'homme adulte,
qui est celle de la conscience rflchie, il a toujours t impossible de
sparer les impressions purement affectives ou sensations de ce qu'on
appelle tendances, instincts, inclinations, impulsions etc. ; toutes ces
expressions impliquent manifestement un certain degr d'activit.
plus forte raison en est-il ainsi l'origine de la vie. Bien plus, non seulement nous ne pouvons pas mme alors distinguer la sensibilit de
l'activit, mais encore, dans l'activit elle-mme, nous ne pouvons
point distinguer la facult qui pousse l'action, ou tendance, de la facult qui produit l'action, ou activit proprement dite. Les instincts,
qui ne sont que des impulsions, ne se distinguent pas de l'instinct, qui
est une force excutive dterminant des mouvements objectifs, externes, visibles aux sens. Sentir, dsirer et agir sont donc confondus
dans cette sorte d'embryologie de la vie psychologique. Sans doute,
quand le ftus commence se mouvoir dans le sein maternel, il y a
peut-tre une diffrence entre le mouvement et la sensation ; et les
changements de mouvement correspondent des changements intrieurs de sensibilit, et par consquent quelques apptits distincts du
mouvement et [467] quelques impressions distinctes des apptits.
Mais avant ce moment, l'tre organis tait dj anim d'un mouvement interne ; la vitalit s'accomplissait en lui en vertu de la sensibilit
des parties ; et si quelque chose de subjectif correspond toujours
toute action organique, toutes les facults ont d prexister, mais dans
cet tat d'homognit sans forme et sans couleur que nous avons essay de dcrire.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
425
Indpendamment de cet tat affectif gnral dont nous venons de
parler, Biran signale encore ce qu'il appelle les affections partielles,
qu'il distingue des sensations proprement dites. Mais peut-tre est-ce
l un excs d'analyse. En quoi les affections visuelles et auditives se
distinguent-elles de ce qu'on appelle des sensations ? Sans doute on
peut insister sur le caractre affectif (plaisir ou douleur) que manifestent ces phnomnes ; mais en tant qu'ils se distinguent les uns des
autres, en se rapportant aux divers sens, on ne peut gure les appeler
autrement que des sensations.
Cependant il est certain que, pour dire quelque chose d'intelligible
sur cet tat confus primitif, il faut essayer de le surprendre l o
quelques linaments un peu distincts commencent paratre, et o l'on
peut entrevoir les origines d'une vie psychologique plus complte.
C'est ce tableau que Cabanis a essay de faire dans ses Rapports du
physique et du moral, surtout dans le second mmoire : Histoire des
sensations, et dans le dixime : les Premires Dterminations de la
sensibilit.
Cabanis s'attribue lui-mme le mrite d'avoir introduit un progrs
sensible dans la philosophie de Condillac. Il croit, avec celui-ci, que
tout vient des sens ; mais Condillac n'entendait par sens que les sens
externes. Il ne voyait que les sensations telles qu'elles se manifestent
dans l'adulte. Il crait un homme artificiel auquel il communiquait
volont toutes les facults qu'il faisait natre par un travail abstrait et
en quelque sorte mcanique. Mais Cabanis plongeait au del. Au del
de la sensibilit externe, il voyait la sensibilit interne ; au del des
sensations passives et adventices, il [468] signalait des impulsions,
des innits instinctives. Enfin, avant la psychologie de l'enfant luimme il entrevoyait une psychologie ftale, une psychologie de l'embryon antrieure la naissance. L'enfant qui vient en ce monde n'est
pas une table rase ; il a dj eu une vie psychologique antrieure ; et
cette vie antrieure est la condition premire de la vie ultrieure.
Ainsi la sensibilit externe par laquelle tout commence dans l'cole
de Condillac suppose dj un dveloppement antrieur plus ou moins
accessible la conscience et qui se compose d'impressions internes,
de tendances, apptits ou rpugnances, de mouvements spontans, en
un mot d'une premire vie affective et sensitive dont on ne peut dcrire que les traits gnraux.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
426
Cabanis insiste sur l'importance qu'il peut y avoir en psychologie
signaler cette vie interne primitive qui exerce une influence considrable sur la facult de penser. Voici les faits sur lesquels il insiste : 1
influence de l'tat des viscres sur nos ides et la tournure de notre
esprit ; 2 influence des dsordres produits dans ces organes sur les
facults intellectuelles, et en particulier sur la production de la folie ;
3 influence des organes de la gnration au moment de l pubert sur
les dispositions intellectuelles ; 4 influence de la vie viscrale sur les
songes en l'absence de toute notion externe.
Tous ces faits prouvent que l'intelligence, le sentiment, la volont,
ne sont pas seulement sous l'influence de la sensibilit externe, mais
encore de la sensibilit interne, plus sourde, plus difficile dcrire et
analyser, mais qui n'en existe pas moins d'une manire certaine. C'est
cette sensibilit interne qui se dveloppe avant celle du dehors et qui
commence mme par animer les organes des sens externes pour les
rendre propres leurs fonctions.
Dans le ventre de la mre, dit Cabanis, les animaux n'prouvent
proprement parler aucune sensation. Environns des eaux de l'amnios,
l'habitude mousse et annule [469] pour eux l'influence de ce liquide. La
vue, l'oue, l'odorat et le got ne sont pas sortis de leur engourdissement ;
et les effets du tact extrieur ne paraissent pas diffrents de ceux du tact
des parties internes.
La science n'a pas beaucoup modifi les ides de Cabanis sur la
psychologie de l'embryon, comme on peut le voir dans l'ouvrage de
M. le docteur Preyer sur 1'me de l'enfant. Tout au plus celui-ci affirme-t-il que le tact externe existe dj dans le ftus, comme il l'a
montr en piquant un embryon de cobaye avec une aiguille, et en dterminant par l des mouvements. Mais ce que M. Preyer a surtout
constat, c'est que l'embryon n avant terme devient immdiatement
sensible (sauf pour les sensations de l'oue, qui sont d'ailleurs en retard
mme chez les enfants ns terme), devient, dis-je, immdiatement
sensible aux impressions externes ; en outre, un embryon de sept mois
peut au bout de vingt-quatre heures suivre la lumire ou distinguer le
got de l'eau sucre de celui d'un acide. Il y a donc en lui une sensibilit toute forme qui n'attend que l'occasion pour se manifester. Ainsi,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
427
mme au point de vue de la sensibilit physique, l'individu n'est pas
une table rase. Il ne l'est pas au moment de la naissance, et l'on ne voit
pas quel moment il aurait pu l'tre auparavant.
Cette sensibilit interne et organique ne se prte pas la dcomposition comme la sensibilit externe ; en tout cas, cette dcomposition
est impossible dans L'tat actuel de nos connaissances. Cela tient ce
que la sensibilit externe se trouve naturellement dcompose par la
distinction des organes et surtout par la distinction prcise des impressions attaches chacun de ces organes. Cependant Cabanis signale
comme se rapportant cette sensibilit gnrale le sentiment de bientre ou de malaise du corps en gnral, la sensation de chaleur interne
ou de froid interne, savoir le frisson, la sensation de fatigue, enfin
les sensations de la respiration, de la circulation (le pouls, les battements du cur), la digestion et les diverses excrtions. Il est probable
que ces [470] impressions diverses ne se distinguent gure leur origine ; mais nous les remarquons aprs coup et nous les distinguons les
unes des autres dans le chaos primitif.
ces impressions se lient immdiatement des dispositions actives,
des besoins, des penchants, des instincts. L'instinct est li la sensibilit interne, comme la volont rflchie est lie au jugement raisonn
et par suite la sensibilit externe. Le mouvement est le signe de l'instinct, et le mouvement est aussi essentiel l'tre organis que le sentiment. Sentir et se mouvoir sont les deux proprits vitales par excellence. Dj, dans le ventre de la mre, le petit se meut, et ces mouvements ne sont pas toujours le rsultat du malaise, mais d'un besoin
d'activit inhrent la vie mme. Dj, et probablement ds le point
de dpart de la vie, apparat l'apptit et le besoin. Chaque besoin, dit
Cabanis, tend au dveloppement de quelque facult. Chaque facult
satisfait quelque besoin. La facult produit l'action, et le besoin sollicite la facult produire l'action. Ainsi l'instinct de succion pour les
nouveau-ns est une facult dtermine par le besoin de nourriture, et
est sollicit par l'impression du contact des lvres de l'enfant avec le
sein de la nourrice. Il n'est pas mme besoin de supposer un besoin de
nourriture : c'est le besoin plus gnral de conservation, ou plus gnralement encore le besoin d'activit inhrent chaque organe et qui,
li la sensibilit et la vitalit de l'organe, n'a besoin que de la plus
faible sollicitation externe pour entrer en jeu. N'est-ce pas ce besoin
interne et tout spontan qui pousse les animaux exercer une facult
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
428
avant mme que l'organe existe, comme le petit oiseau qui cherche
voler, et le chevreau qui cherche frapper avec la corne qu'il n'a pas
encore ?
Lorsque la sensibilit externe vient s'exercer au moment de la
naissance, les impressions premires ne se distinguent pas tout d'abord
des impressions antrieures avec la nettet qu'elles auront plus tard.
Tout d'abord elles se perdent sans doute et se confondent dans ce vaste
ensemble qui a constitu [471] jusqu'alors la vie de l'tre organis.
C'est ainsi que la sensation externe de chaud ou de froid ne doit pas se
distinguer du chaud ou du froid interne ; de mme la sensation de contact que lui procure le milieu dans lequel il est plac aprs sa naissance, ne se distingue pas des impressions produites par le milieu liquide dans lequel il nageait jusque-l. Les sensations de la vue et de
l'oue sont d'abord tellement confuses, qu'elles ne peuvent tre remarques. La sensation du got est probablement la premire qui se spcialise et arrive une conscience distincte.
Ainsi la vie animale par laquelle l'homme commence et qui dure
quelque temps encore la naissance, se compose d'un grand nombre
de phnomnes que nous embrassons tous sous le nom gnrique de
sensibilit physique, la fois passive et active et insparable du mouvement. C'est l la base de la vie humaine proprement dite ; ce sont les
premires assises de la vie psychologique.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
429
[472]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE DEUXIME
LES PASSIONS
Leon II
I. La question des penchants
II. Y a-t-il quelque chose d'actif
dans la sensibilit ?
Retour la table des matires
Messieurs,
La sensibilit, avons-nous dit, est la fois passive et active ; elle
est la facult de recevoir des impressions du dehors ; elle est aussi la
facult de ragir contre ces impressions, quelquefois mme d'anticiper
sur elles et de les provoquer.
Elle se compose donc de deux sortes de faits : 1 de faits affectifs,
qui sont le plaisir et la douleur ; 2 de mouvements, qui sont les penchants, les inclinations et, un degr d'nergie suprieure, les passions.
Le plaisir et la douleur sont des tats de l'me ; les penchants, les
inclinations, sont des tendances qui poussent l'action.
Les penchants sont quelque chose de plus intime et de plus profond
que le plaisir et la douleur ; ils semblent tre permanents et inhrents
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
430
la substance mme de l'me ; ils sont antrieurs et postrieurs au plaisir et la douleur ; ils prexistent ces phnomnes et ils subsistent
encore lorsque ceux-ci ont disparu.
l'occasion de ces faits, nous avons quatre questions poser,
quatre recherches instituer :
1 Y a-t-il en effet dans l'me des penchants et des inclinations, et
que faut-il entendre par l ?
2 Les penchants et les inclinations, en supposant qu'il existe
quelque chose de tel, ne devraient-ils pas relever de la facult
appele activit plutt que de la sensibilit proprement dite ?
[473]
3 Les penchants, quelque facult qu'on les rapporte. sont-ils inns ou acquis ?
4 Enfin comment devons-nous les classer ou les distribuer ?
I
Traitons d'abord de l'existence des inclinations.
On se demandera sans doute tout d'abord comment cette question
peut tre pose. Car s'il y a quelque chose dont nous sommes certains,
c'est qu'il y a en nous des attraits ou des rpugnances, des passions et
des inclinations ; et peut-tre mme jouissons-nous davantage des
passions comme telles que des plaisirs qu'elles peuvent nous procurer.
Cependant, si on examine la question au point de vue philosophique,
on verra qu'elle est susceptible d'tre pose.
La psychologie, en effet, est une science exprimentale, une
science de faits tombant sous l'exprience immdiate. Or, des penchants, des tendances, des inclinations, peuvent-elles tre appeles des
faits ? Ne sont-ce pas plutt des causes que nous supposons pour expliquer les faits, des qualits occultes semblables aux proprits de la
matire et aux quiddits des scolastiques ? On dira : J'ai du plaisir
prendre de la nourriture ; donc j'ai en moi un instinct qui me porte
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
431
prendre de la nourriture. J'ai du plaisir apprendre ; donc j'ai un instinct de science et de vrit. Qu'est-ce autre chose que rpter une
deuxime fois sous un nom gnral le fait qui tombe sous la conscience, savoir le fait du plaisir que nous causent, soit les aliments,
soit la science ?
Sans doute, ajouterait-on, il n'est pas impossible que ces phnomnes correspondent quelque chose d'essentiel et de permanent, et
qu'ils soient l'expression de notre nature intime ; mais ce quelque
chose de permanent, que nous supposons tort ou raison, ne tombe
pas sous l'exprience ; c'est un lment qui ne rentre pas dans les
cadres d'une science exprimentale comme la psychologie. C'est la
mtaphysique s'occuper des causes, des essences et de quoi que
[474] ce soit de semblable. Les penchants et les inclinations, si on les
conserve en psychologie, n'y devront figurer que comme des dnominations conventionnelles donnes aux diffrents groupes de plaisirs ou
de douleurs que l'exprience a dmls en nous. C'est ainsi que l'on
entend aujourd'hui les facults de l'me. Ce ne sont pas des forces, des
tres rels ; ce sont des noms donns des groupes de phnomnes.
Or, les inclinations et les penchants ne sont pas des faits ; ce sont des
facults.
Nous croyons au contraire, pour notre part, que les mots de penchants, inclinations, tendances, dispositions, instincts, correspondent,
mme psychologiquement, quelque chose de diffrent des phnomnes effectifs auxquels ils sont lis. Et d'abord la langue populaire
de tous les peuples ne ferait pas une si grande part cet ordre de faits
que l'on appelle mouvements de l'me, entranement des passions, en
latin motus, impetus, impulsus, appetitus, en grec , s'il n'y
avait l que des rsums abstraits destins reprsenter certains
groupes de plaisirs ou de douleurs. Il semble, au contraire, que dans la
sensibilit, aux yeux de la conscience populaire, ce soit prcisment
l'lment actif qui soit le principal et qui enveloppe tous les autres.
Cherchons quels sont les faits rels que reprsentent ces expressions si
multiples.
Au moment o nous prouvons du plaisir et de la douleur, il est
trs vrai que l'inclination satisfaite se confond tellement avec l'motion prouve, que je ne puis voir qu'un seul fait dans la cause et dans
l'effet. Dans ce cas, on peut croire que nous ne supposons une inclina-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
432
tion que pour satisfaire bien ou mal au principe de causalit ; mais il
n'en est pas toujours ainsi.
Supposons le plaisir absent, mais proche, et que nous en soyons
spars par une difficult, surtout par une sorte de prohibition morale
de prudence ou de devoir, en un mot par l'intervention de la raison :
par exemple, le plaisir d'une eau glace pour le malade altr de soif
auquel le mdecin [475] a interdit de boire. N'est-il pas certain qu'en
mme temps que l'imagination nous reprsente d'avance ce plaisir, il
se produit en nous une tendance au mouvement vers l'eau qui nous
attire, tendance tellement relle que nous sommes obligs de faire un
effort trs pnible en sens inverse pour y rsister ? Cet effort est certainement quelque chose de rel, et qui se manifeste la conscience.
Mais si cet effort est rel, ce quoi cet effort fait contrepoids est aussi
quelque chose de rel. Il y a donc en nous quelque chose qui s'oppose
l'effort. Ce quelque chose n'est pas le plaisir actuel, puisqu'il s'agit
d'un plaisir absent, d'un plaisir futur : ce n'est pas non plus le plaisir
pass, puisqu'il est pass. D'ailleurs, comme nous le verrons, l'entranement dont il s'agit peut prcder toute espce de plaisir. C'est une
sollicitation que nous ne pouvons comparer qu' l'action d'une autre
personne qui nous prendrait par la main et nous entranerait malgr
nous o nous ne voulons pas aller.
Il est certain que nous savons trs bien ce que c'est que d'tre attirs, entrans, contraints par une force trangre. Nous le savons par
opposition avec l'effort par lequel nous essayons de contraindre ou
d'entraner quelque personne ou quelque objet externe : chaque effort de notre part correspond un contre-effort de la part de l'obstacle,
chose ou homme, contre lequel nous luttons. Nous cdons, soit contraints par la force, soit plus ou moins sduits par la persuasion, et surtout, comme on dit, entrans, emports ; et mme, quand nous cdons
volontairement, il y a en nous un sentiment d'abandon, de cession,
d'abdication, qui s'oppose dans notre conscience au sentiment de rsistance antrieure et qui implique par suite une force plus ou moins
semblable celle de l'effort personnel.
Or ce que nous prouvons dans le cas de contrainte ou de sduction
d'une force trangre, nous l'prouvons aussi en l'absence de toute
force trangre, par le fait seul de l'attrait et de la rpugnance
qu'exerce sur notre imagination la reprsentation anticipe du plaisir
et de la douleur, et peut-tre [476] mme avant toute reprsentation de
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
433
ce genre ; car de mme que nous supposons des forces en dehors de
nous, quand nous nous sentons entrans ou vaincus par quelque objet
sans notre volont, de mme nous supposons de pareilles forces en
nous quand nous nous sentons entrans, soit malgr nous, soit mme
avec notre connivence, mais contre les dfenses de la raison et les rsistances plus ou moins molles de la volont. Ce sont ces forces internes distinctes de la volont et qui souvent lui sont contraires, dont
nous avons conscience et que nous appelons instincts, penchants, inclinations, passions.
Que l'on ne nous dise pas que, par le mot de forces, nous entrons
dans la mtaphysique et que nous introduisons des entits que la
science exprimentale ne peut reconnatre. Non ; car par le mot de
force, nous n'entendons ici que la cause, quelle qu'elle soit, des phnomnes que nous venons de dcrire. Nous prenons pour type de l'activit l'effort involontaire, quelle que soit d'ailleurs l'essence de cet
effort (analyse qui appartient l'histoire de la volont). Mais, de
mme que les savants prennent leur type de la force dans l'action interne et la transportent ensuite hypothtiquement en dehors par analogie ou par induction, en disant qu'un cheval est une force, qu'un cours
d'eau est une force, de mme nous sommes autoriss dire notre
tour qu'il y a en nous des forces semblables, puisqu'elles nous entranent au mouvement exactement comme des forces trangres pourraient le faire. La nature intrieure de ces forces n'est nullement suppose par l ; mais qu'il y ait quelque chose en nous qui ne soit ni le
plaisir pass, ni le plaisir futur, mais seulement la direction vers le
mouvement, le sentiment du passage d'un mouvement un autre, et
enfin (pourquoi ne pas le dire, puisque c'est le mot vrai ?) de tendance
au mouvement, c'est ce qui nous parat aussi certain que le mouvement lui-mme.
Et mme, si cette tendance n'existait pas, pourquoi irait-on chercher le plaisir ? Les cratures le goteraient quand il [477] se prsenterait devant elles ; mais elles seraient rduites l'attendre quand il
serait absent. C'est ce qui est dmenti par l'exprience. Toutes les
cratures sensibles vont chercher le plaisir ; et cela travers mille prils, mille difficults, et malgr toutes les preuves. Il faut donc qu'il y
ait quelque chose qui les entrane, et c'est l ce que la langue de tous
les peuples appelle penchant et instinct.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
434
La psychologie moderne explique le fait que nous venons de dcrire par ce qu'elle appelle l'action motrice des ides. Aucune ide ne
peut apparatre dans l'esprit sans dterminer une tendance reproduire
la srie de mouvements reprsents par cette ide : c'est ainsi que
l'ide de billement provoque le billement, l'ide de boire provoque
la soif. C'est l une explication qui ne change rien au fait essentiel.
Selon cette hypothse, c'est dans l'ide elle-mme que l'on place la
force motrice ; mais, dans tous les cas, il y a anticipation de mouvement ; l'action motrice de l'ide est prcisment ce que nous appelons
penchant, prdisposition, en un mot tendance au mouvement. Cette
hypothse nous autoriserait donc encore admettre quelque chose qui
ne serait pas le plaisir ou la douleur prsente, mais qui serait l'attrait
du plaisir ou l'aversion de la douleur. L'essentiel de ce que nous demandons nous serait donc accord, savoir l'effort pour atteindre le
plaisir et s'loigner de la douleur. J'ajoute, au reste, que l'hypothse en
question ne me parat pas rpondre tous les cas ; car cet effort ou
nisus inhrent toute crature sensible est antrieur toutes les ides,
et mme toutes les sensations. C'est cet effort pour persvrer dont
parle Spinoza, et qui est la source de notre vie sensible au lieu d'en
tre le rsultat.
Une autre explication consisterait dire qu'il n'y a pas mme action
motrice de l'ide (c'est encore l de la mtaphysique). Il y aurait une
srie de mouvements infiniment petits produits en nous soit par l'habitude, soit par l'hrdit, qui sont les commencements internes, les origines crbrales des mouvements externes. Mais, mme dans cette
hypothse, [478] nous aurions encore conscience d'un entranement
tout fait semblable celui de la chute des corps, ce qui est encore
quelque chose de trs diffrent de ce que serait purement et simplement un sentiment de mouvement passif. Ici vous sentez en effet le
passage d'un mouvement un autre ; vous sentez que l'un commande,
l'autre suit. En un mot, vous ne faites dans ce cas que transporter l'activit dans l'organe au lieu de la placer dans le moi. Dira-t-on qu'au
fond il n'y a rien de semblable ce que nous appelons tendance et activit, qu'il n'y a que succession de mouvements, avec attente de ce
qui doit suivre (plaisir ou douleur), attente qui vient de l'habitude ou
de l'hrdit ? Mais l'attente elle-mme est encore un phnomne actif
qui va vers le plaisir ; car une attente purement passive qui ne consisterait que dans des reprsentations anticipes du plaisir futur ne r-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
435
pondrait pas ce que nous prouvons dans le dsir, puisqu'on peut trs
bien se reprsenter un plaisir sans tendre vers lui.
Quelle que soit donc la nature de la cause laquelle on rapportera
le dsir ou la tendance, disons que tous les faits nous paraissent indiquer une activit spontane dirigeant l'animal vers des actes dont il n'a
d'avance aucune ide ; la prdisposition l'action, en un mot, ne rsulterait donc pas de l'automatisme des ides, mais serait encore quelque
chose d'antrieur. C'est la question de l'innit sur laquelle nous reviendrons, mais qui s'engage dj ds prsent, puisque la prdisposition nous parat antrieure tout phnomne donn ; car, lors mme
qu'on accorderait que ces prdispositions viennent de l'hrdit, elles
n'en seraient pas moins, par rapport l'individu, des tendances innes ;
et les psychologues (Jouffroy et les cossais) n'ont jamais entendu
autre chose ; et, au point de vue de la psychologie exprimentale, il
n'y a pas aller au del.
Ainsi une psychologie purement exprimentale n'a aucune raison
de nier l'existence des penchants et des inclinations, en tant que faits
distincts du phnomne purement affectif. Ce sont plus que des dnominations donnes tel ou tel [479] groupe de faits ; ce sont des
tendances, au sens propre, des prdispositions au mouvement.
La psychologie, d'ailleurs, serait trs embarrasse si, par des scrupules exagrs, elle voulait exclure de la langue scientifique, comme il
semble qu'il faudrait le faire dans un phnomnisme consquent, les
mois de penchants, instincts, inclination, etc. Par exemple, lorsqu'on
se reprsente Hercule entre la Vertu et la Volupt, comment concevoir
ce combat qui se passe dans son me, puisque les deux phnomnes
qui se disputent sa conqute ne sont que dans l'avenir et ne sont pas
encore raliss ? Ce ne pourrait tre que l'ide, l'image, l'anticipation
de la volupt ou de la vertu qui serait dans l'esprit d'Hercule. Mais si
cette image tait absolument froide et immobile (comme elle l'est, par
exemple, chez un anachorte ferm depuis longtemps aux plaisirs de
la chair), pourquoi la lutte serait-elle pnible ? pourquoi mme y aurait-il lutte ? Il faut donc que cette ide soit une ide active, qu'il y ait
dans l'me d'Hercule quelque mouvement qui tende l'acte et qui se
porte du ct de la volupt. Or c'est l ce que nous appelons amour,
dsir, et, lorsque nous le supposons avant toute closion de la sensibilit, penchant, instinct, etc. Comment la langue exprimerait-elle ces
faits, si elle se privait de ce mot et de tout autre analogue ? Dira-t-on,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
436
par exemple, le plaisir patriotique, au lieu de l'amour de la patrie ? le
plaisir maternel, au lieu de l'amour maternel ? Comment le plaisir maternel entranerait-il une mre se jeter dans les flammes pour sauver
son enfant, puisque ce plaisir est nul en ce moment et qu'il sera absolument nul si elle meurt ? Dira-t-on que c'est la fuite de la douleur actuelle qui la pousse s'immoler ? Mais cela mme, cette fuite de la
douleur, est encore quelque chose d'actif qui suppose autre chose que
la douleur elle-mme : car l'me pourrait rester immobile et engourdie
dans la douleur sans en sortir, comme il arrive dans certaines folies ;
et par consquent elle ne fuirait pas mme le mal. Sans cette hypothse des penchants prexistant [480] et survivant aux affections motives, on ne s'expliquerait pas comment il y aurait en nous des prdispositions entranant l'action et devenant la longue des besoins irrsistibles, mme quand elles ne nous causent plus aucun plaisir, mme
quand elles sont suivies de douleur. La disproportion qui existe dans
ce cas entre l'effet et la cause prouve bien que la cause est autre chose
que le nom donn l'effet.
Nous avons essay d'tablir que des penchants ou tendances primitives de la nature humaine, comme les appelait Jouffroy, sont des faits
rels et non des entits mtaphysiques. Maintenant je ne me fais aucun
scrupule de reconnatre que ces faits sont d'une autre nature que les
faits affectifs purs et simples. Ceux-ci, plaisirs et douleurs, ne sont que
des tats de conscience ; ceux-l sont des manifestations de force et
d'activit. Les uns sont borns au plaisir prsent ; les autres sont permanents et durent ; les uns (plaisir et douleur) sont la superficie de
l'me ; les autres semblent appartenir l'tre mme. Si l'objet de la
mtaphysique consiste passer des phnomnes l'tre, on peut dire
qu'il y a quelque chose de mtaphysique dans les penchants ou inclinations. Sans doute, comme l'a enseign Maine de Biran, c'est le fait
de l'effort volontaire qui nous introduit au cur mme de l'activit et
peut-tre mme de l'tre ; mais les inclinations nous y introduisent
dj indirectement par le sentiment que nous avons qu'il y a en nous
quelque chose qui rsiste l'effort. Sans prtendre arriver par l jusqu' la substance de l'me (or il y a plusieurs tapes, plusieurs degrs
dans l'tre), nous croyons cependant que dj, par le sentiment intime
de l'activit spontane qui est en nous et qui se manifeste par les faits
que nous avons signals, par ce sentiment, dis-je, nous dpassons dj
le domaine des phnomnes et nous pntrons dans une certaine me-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
437
sure jusqu' l'tre mme. Nous ne dirons pas pour cela que la psychologie soit la mme chose que la mtaphysique, mais elle nous introduit
dans la mtaphysique.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
438
[481]
II
Nous rencontrons maintenant une seconde question. tant donn
qu'il y a en nous, titre de faits distincts et rels, des inclinations, des
penchants, des instincts, ces faits doivent-ils rentrer dans la facult
appele sensibilit, ou dans la facult appele activit ?
Au premier abord, cette question ne parat pas avoir une grande
importance. En effet, si on laisse de ct l'hypothse des facults, si
on se borne, comme on le fait gnralement aujourd'hui, la description de groupes de faits distincts les uns des autres, peu importe que
tel ordre de faits rentre dans tel ordre plutt que dans tel autre, soit
dsign sous tel nom plutt que sous tel autre. Mais d'abord, il nous
semble que cette question des facults a t traite de nos jours un peu
trop rapidement et sans assez d'examen : je fais, pour moi, des rserves. En outre, ce sera toujours une question de savoir de quel
groupe de faits celui que l'on veut tudier se rapproche le plus ; car on
comprend d'autant mieux les faits qu'ils seront classs d'aprs leurs
analogies les plus prochaines. Enfin, puisque nous avons constat un
lment essentiellement actif dans la sensibilit, la question a vritablement un sens prcis et mrite d'tre examine de plus prs : car
pourquoi les lments actifs de la sensibilit ne se rangeraient-ils pas
sous le titre d'activit ? Et si l'on dit que toutes nos facults sont actives et qu'il n'y a pas lieu d'en distinguer une troisime en particulier
qui porte ce nom de prfrence toute autre, et, par consquent, que
cette troisime facult ne doit pas tre appele activit, mais volont,
que fera-t-on alors de l'instinct et de l'habitude qui sont bien deux
modes d'activit, et non d'intelligence et de sensibilit ? Enfin on
pourra dire que, dans la philosophie du XVIIe sicle, les inclinations
elles-mmes rentraient dans la volont.
Il y a donc l une question, et l'on pourrait soutenir que, [482] les
penchants et inclinations n'tant pas en eux-mmes des phnomnes
affectifs (puisqu'ils ne le deviennent qu'autant qu'ils sont accompagns
de plaisir et de douleur), ces penchants, dis-je, tant plutt des sollicitations l'action, des principes d'action, appartiennent plus l'activit
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
439
qu' la sensibilit. N'est-il pas trange, en effet, d'attribuer deux facults distinctes les instincts et l'instinct ? Car les inclinations s'appellent souvent du nom d'instincts. On dit : l'instinct de conservation,
l'instinct de sensibilit, l'instinct de proprit. Or on tudie en gnral
les instincts dans la sensibilit, et l'on renvoie la question de l'instinct
la volont.
Tout cela est vrai ; et dans le fond l'on ne peut gure distinguer
l'activit passionne qui se manifeste dans les instincts, de l'activit
spontane qui se manifeste dans l'instinct. Il ne faut pas multiplier les
activits sans ncessit.
Nanmoins, tout en reconnaissant cette identit fondamentale, nous
devons croire qu'il y a des raisons pour que les psychologues modernes soient presque tous tombs d'accord pour rattacher la sensibilit, c'est--dire la facult de jouir et de souffrir, les inclinations et
les passions, tandis que l'instinct, l'habitude et la volont constituent le
domaine de l'activit proprement dite. Nous voyons encore cette sparation dans les philosophes les plus rcents. Ainsi M. Bain, dans son
livre motions et Volont, range parmi les motions tous les phnomnes de passion, tous les penchants et les inclinations, et rapporte
la volont des phnomnes de mouvements spontans qui caractrisent ce que nous appelons l'instinct. Jouffroy avait essay de sparer
de la sensibilit proprement dite ce qu'il appelait les tendances primitives de la nature humaine , et nanmoins il laissait la sensibilit
une part considrable encore d'activit, puisqu'il y rapportait l'amour
et le dsir, qui sont certainement des phnomnes actifs. Le philosophe Lon Dumont a essay la mme sparation sans y russir : car
comment parler des plaisirs et des douleurs, sans parler des dsirs et
des aversions, qui sont cependant incontestablement des phnomnes
[483] actifs ? mme les physiologistes qui dfinissent la sensibilit la
facult de ragir, la distinguent encore de la motilit ; et ce serait une
classification tout fait artificielle que de rattacher la sensibilit le
plaisir patriotique, et l'instinct l'amour de la patrie ; la sensibilit le
plaisir du beau, et l'activit l'amour du beau. Ce serait s'exposer
dire deux fois la mme chose. Sans doute, tre affect est une chose,
et ragir en est une autre ; mais quand il s'agit de la dlimitation des
domaines, la commodit du savant doit tre compte pour quelque
chose ; et le langage habituel doit tre d'accord avec l'usage des philo-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
440
sophes. Pour tous les hommes, la sensibilit consiste surtout dans les
mouvements de l'me.
Au reste, il ne manque pas d'un fondement solide pour tablir
qu'entre l'activit passionne qui se manifeste dans les instincts et l'activit spontane qui se manifeste dans l'instinct, il y a autre chose
qu'une diffrence superficielle. En effet, les penchants ou inclinations
se bornent psychologiquement l'tat de tendances indtermines vers
une fin, tandis que l'activit spontane est dtermine et va droit aux
moyens pour atteindre la fin. C'est ainsi que, sans trop de subtilit, on
peut distinguer les instincts ou tendances au mouvement, de l'instinct,
qui est une srie dtermine de mouvements. Autre chose est l'apptit
de la nourriture, autre chose est l'instinct de la trouver et de la conqurir. Les instincts sont des jouissances vagues ; l'instinct est un acte
spcifique et dtermin. Ces deux classes de faits sont gnralement
lis l'un l'autre, mais quelquefois ils sont spars, et l'on comprend
qu'ils puissent l'tre ; l'instinct de la peur n'est pas toujours accompagn de l'instinct de la fuite. L'apptit de la nourriture chez les nouveau-ns pourrait bien ne pas tre accompagn de l'instinct de la succion.
Au fond, instincts au pluriel et instinct au singulier drivent la
fois de l'activit vitale. En tant que cette activit tend se porter vers
certains objets, c'est ce qu'on appelle penchants et instincts, inclinations et passions ; mais en tant que cette mme activit vitale est capable de produire une [484] srie de mouvements dtermins, c'est ce
qu'on appelle au propre l'activit. Il y a, comme on voit, identit au
fond entre les instincts et l'instinct ; mais les instincts sont des dispositions, des impulsions agir ; l'instinct est la facult qui agit. Dans les
instincts, l'action est en puissance ; dans l'instinct, elle est en acte.
Il y a donc lieu d'tudier dans la sensibilit les inclinations ou instincts, en laissant de ct l'instinct, l'habitude et la volont, qui composeraient le domaine de l'activit proprement dite.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
441
[485]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE DEUXIME
LES PASSIONS
Leon III
INNIT DES PENCHANTS
Retour la table des matires
Messieurs,
La troisime question que nous avons signale est celle-ci : les
penchants sont-ils inns ou acquis ?
En un sens on pourrait dire que cette question est en partie rsolue
par nos recherches prcdentes. Car tablir qu'il y a des penchants en
nous qui ne sont pas seulement des noms donns aux diffrents
groupes de plaisirs et de douleurs, mais des prdispositions qui n'attendent pas le plaisir pour se manifester et qui le prcdent, n'est-ce
pas dire que ces prdispositions sont innes ? Cependant les deux
questions ne sont pas absolument identiques ; et l'on pourrait concevoir la rigueur une me l'tat de table rase et sur laquelle le plaisir
et la douleur dtermineraient certains penchants ou certaines inclinations vers certains objets. Le penchant serait postrieur l'exprience
du plaisir, et il pourrait y avoir des dterminations actives, quoique
acquises, qui seraient des habitudes et non des instincts. Mais, mme
dans ce cas, il faudrait toujours supposer une activit prexistante qui
se dterminerait par l'exprience, mais qui n'en serait pas moins ant-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
442
rieure l'exprience. Il n'y aurait d'acquis que la dtermination de
cette activit. Il n'y a donc au fond qu'une seule question, mais deux
points de vue diffrents. Dans le premier cas, c'est l'opposition de l'actif et du passif ; dans le second cas, c'est l'opposition de l'inn et de
l'acquis. Notre nouvelle recherche sera donc, si l'on veut, une confirmation de la premire thse, mais un autre point de vue.
Nous nous trouvons ici en prsence de la fameuse question [486]
de l'innit, si longtemps et si souvent dbattue par les philosophes
dans la thorie de l'intelligence. La mme thorie qui explique tout par
l'exprience dans l'intelligence, tend expliquer de la mme manire
les phnomnes de la sensibilit. Il n'y a, dirait-on, dans l'me aucune
tendance, aucun mouvement dessin d'avance, aucune prdisposition.
Mais aussitt que nous avons fait l'exprience du plaisir, il est naturel
que nous nous portions vers lui, et de mme il est naturel que nous
nous loignions de la douleur ; on ne peut rechercher ni fuir ce qu'on
ne connat pas encore, ignoti nulla cupido. Il faut donc que nous ayons
dj appris connatre l'utile et le nuisible pour qu'il se forme en nous
des attractions et des rpugnances ; et c'est l'ensemble de ces phnomnes que nous appelons inclinations et penchant.
Il nous semble que l'cole empirique commet ici la mme faute que
dans la question de l'intelligence. Elle veut que l'me soit une table
rase, et que tout en elle soit le produit du dehors. Mais comment les
choses extrieures pourraient-elles agir sur le vide, sur quelque chose
d'absolument inerte et indiffrent ? Laissons de ct la question de
savoir si ce quelque chose de prexistant est un esprit ou un organisme
vivant ; dans l'un et l'autre cas, il faut que les choses extrieures rencontrent une matire prdispose, quelques linaments tracs
d'avance. Il est vident d'abord qu'il faut remonter au moins jusqu'avant la naissance. Ce n'est pas l'enfant, au moment o il vient au
jour, qui peut tre appel une table rase. Il a dj des apptits et des
instincts forms dans le sein de la mre. Dira-t-on que, mme alors, il
avait la sensibilit et que c'est la suite des impressions recherches
par lui qu'il s'est form en lui des habitudes que nous appelons des
instincts ? Mais qu'est-ce que cette sensibilit, sinon prcisment une
prdisposition gnrale prouver du plaisir et de la douleur, et mme
certaines prdispositions pour tel ordre de plaisirs ou tel ordre de douleurs ? Ainsi, mme ces sensations intra-utrines antrieures la naissance supposeraient des dispositions vitales intrieures ; et, [487]
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
443
moins de remonter jusqu' l'acte absolument incomprhensible de la
conception, il est impossible de surprendre un premier moment o
l'tre vivant ait jamais t dans un tat d'indtermination absolue et en
quelque sorte de vide au point de vue des impulsions et des penchants.
Une me absolument indtermine serait entirement indiffrente et
ne ressentirait aucun plaisir. De plus, tous les hommes devraient
prouver les mmes plaisirs pour les mmes objets. Pourquoi tel objet
agrable l'un est-il pnible l'autre, si ce n'est parce qu'il y a chez
l'un certaines aptitudes satisfaites, qui chez l'autre n'existent pas ou
sont remplaces par des aptitudes contraires ? Il faut donc qu'il y ait
dj prdisposition pour que l'animal jouisse ou souffre. Et il ne s'agit
pas seulement de puissance nue, comme dit Leibniz, car ce ne serait l
rien que de ngatif ; mais il s'agit de tendances appropries, d'aspirations vers quelque objet rel et concret.
Il est trs vrai cependant qu'il y a des penchants qui naissent de
l'habitude, et tous contractent quelque chose de l'habitude. Il n'est pas
question de soutenir que tous les penchants sont inns. Il n'y en a peuttre qu'un petit nombre, peut-tre qu'un seul, par exemple l'instinct de
conservation, soit dans l'individu, soit dans l'espce. Mais au moins
l'instinct de la nourriture est-il antrieur au plaisir de la nourriture ; car
l'animal n'irait pas chercher la nourriture s'il n'y tait pas sollicit par
l'instinct, puisque ce premier plaisir il ne le connat pas encore, et qu'il
n'a encore fait l'exprience d'aucun plaisir de ce genre. Il en est de
mme de l'instinct sexuel, qui est videmment antrieur au plaisir sensuel ; car les individus ne le rechercheraient pas avant d'avoir prouv
ce plaisir, et par consquent ils ne l'prouveraient pas. D'ailleurs cet
instinct existe avant mme qu'il y ait sensibilit proprement dite, puisqu'il se rencontre mme sur les plantes.
Cet instinct n'est pas, du reste, le seul qui se manifeste chez les
plantes ; et l on peut bien dire qu'ils sont inns, puisqu'ils ne sont accompagns d'aucune sensibilit proprement dite, j'entends de sensibilit sentie, plaisir ou douleur. On peut 488] citer, par exemple, l'instinct des racines qui changent leurs directions pour aller chercher un
terrain humide, un terrain gras, et qui s'loignent des terrains maigres.
Dj Jussieu avait remarqu que le concombre recherche l'eau et
s'loigne de l'huile. On citera encore l'apptit des plantes pour la lumire. La plante appele soleil se tourne toujours vers le soleil. Il est
des plantes qui n'ouvrent leurs fleurs qu' certaines heures de la jour-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
444
ne, et Linn s'tait servi de ce fait pour construire une horloge botanique. La tige du houblon tourne autour de la tige qui la soutient suivant le cours du soleil d'orient en occident, et prit si l'on veut lui imprimer une direction contraire. Enfin nous avons souvent cit
l'exemple de la sensitive.
En affirmant d'ailleurs l'innit des penchants, nous ne prtendons
pas remonter l'origine des choses ; nous n'avons pas rechercher en
ce moment l'origine premire des instincts, mais les dcrire dans leur
tat actuel. Qu' l'origine des choses les instincts aillent se perdre dans
la source mme de la vie et qu'ils se soient peu peu dgags de cette
origine grossire par les sollicitations externes ; qu'ils se soient ensuite
dvelopps par l'habitude et transmis par hrdit, nous n'avons pas
examiner cette hypothse, qui appartient plutt l'histoire de l'espce
qu' la psychologie proprement dite. Mais, mme dans cette hypothse, on est oblig d'accorder, et mme elle implique expressment,
que dans l'individu, et dans l'tat actuel de l'humanit, c'est l'innit
qui a raison : car qui dit hrdit dit par l mme innit.
Non seulement l'instinct ne nat pas toujours des plaisirs, mais au
contraire il se dveloppe souvent aux dpens du bien-tre et de la vie.
M. de Hartmann cite bon nombre d'exemples de ce genre dans sa
Phnomnologie de l'inconscient.
L'instinct prsente cela de grand et d'admirable que ses ordres sont
obis avec un entier dsintressement, mme au prix de la vie. Si le bientre qu'elle prouve vider ses glandes tait le seul motif qui porte la chenille tisser, elle [489] ne tisserait ses fils que jusqu'au moment o son rservoir glandulaire serait vid ; mais elle ne recommencerait pas sans
cesse sa toile, en supposant qu'on la dtruise, jusqu' mourir d'puisement.
Croit-on que les oiseaux ne s'accouplent que pour le plaisir ? Pourquoi ne
renouvellent-ils plus leur action lorsqu'ils ont pondu un certain nombre
d'ufs ? L'instinct reproducteur persiste pourtant. Enlevez un uf de leur
nid, ils s'accouplent de nouveau ; et la femelle pond un nouvel uf. Une
femelle d'Ignea Torquilla dont on enlevait l'uf mesure qu'elle le pondait, s'appariait de nouveau et pondait un nouvel uf jusqu' ce que, au
vingt-neuvime, on trouva l'oiseau mort dans son nid . 47
47
Philosophie de l'Inconscient, t. Ier, 1re partie, III.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
445
Pour discuter avec plus de prcision la question de l'innit des
penchants, choisissons-en un particulier dont l'innit a t trs souvent conteste, et o la part de l'inn et de l'acquis est trs difficile
faire. Je veux parler de l'instinct de la pudeur. C'est une discussion des
plus dlicates ; car on ne peut gure dfendre la ralit et l'innit de
cet instinct sans courir le risque de l'offenser. Dfinir mme la pudeur
est dj quelque chose de scabreux et d'indiscret, 48 car il semble
qu'on ne puisse donner cette dfinition qu'en faisant allusion ce
qu'on ne doit pas nommer ; et mme en ce moment je me demande si
je ne fais pas tort la pudeur en essayant d'en parler sans en parler.
Nous ne pouvons pas mme citer dans leur texte les arguments de
ceux qui prtendent que la pudeur est un instinct acquis. C'tait l'expression des cyniques dans l'antiquit et de plusieurs philosophes du
e
XVIII sicle ; je ne puis pas mme vous citer les sources, car ce serait
vous engager y aller voir. Cependant quelques-uns de ces arguments
peuvent tre signals. On prtend, par exemple, que la pudeur est un
instinct acquis, qui rsulte de la diffrence des murs, des habitudes
et des climats. Les hommes, ayant eu besoin de couvrir le corps pour
se mettre l'abri [490] des intempries de l'air, ont pris l'habitude de
cacher le corps ; et lorsqu'il est par hasard dcouvert, ils prouvent
une certaine honte qui peut s'effacer peu peu par une habitude contraire. Autrement, comment expliquer que la pudeur puisse se dplacer et avoir en quelque sorte des siges diffrents ? Pourquoi, par hasard, les femmes turques mettent-elles leur pudeur se cacher le visage, tandis que les femmes europennes ne se font aucun scrupule
d'aller le visage dcouvert, et pourquoi ces mmes femmes europennes se feraient-elles scrupule de recevoir chez elles dans la journe les paules dcouvertes, et n'prouvent-elles plus aucun scrupule
de ce genre lorsqu'elles vont au bal ? Si la pudeur tait un instinct inn, dit-on, comment ne serait-il pas venu bout de cet usage immodeste ? Comment les femmes, qui sont en gnral pieuses et si dociles
aux ordres de la religion, ont-elles fait sur ce point dans tous les temps
une rsistance dsespre et toujours victorieuse ? C'est une guerre qui
dure depuis des sicles. L'glise a tout fait ; elle a employ tous les
48
Je rappellerai que cette discussion avait lieu dans un cours public, o il y avait
des dames.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
446
moyens, les supplications, les imprcations, les censures, les excommunications, les refus de sacrements. La coquetterie fminine a toujours rsist. Elles ont rpondu : Il n'y a que le nu qui habille ; et
l'glise a t vaincue : elle a cd. Elle a fait comme avec la rpublique, elle en a pris son parti. Aujourd'hui les femmes les plus chrtiennes vont au bal dcolletes, et l'on a vu, sous le dernier rgne, dans
une crmonie solennelle, au mariage du souverain, toute la cour assister, les paules dcouvertes, dans le chur de Notre-Dame. Tout
cela ne prouve-t-il pas que la pudeur n'est qu'une habitude, puisque,
suivant un changement de lieux et de circonstances, elle cesse de
s'imposer ? L'argument mme que l'on donne pour justifier ces infractions la pudeur prouve ce que nous avanons. C'est l'usage, disent
les femmes : tout le monde le fait, il faut faire comme tout le monde ;
mais si c'est une affaire d'usage, le contraire aussi est un usage : la pudeur est une habitude ; il n'y a pas de pudeur inne : ce qu'il fallait
dmontrer.
[491]
Que rpondre ces objections ? Il faut dire sans doute que les degrs et les limites de la pudeur peuvent, comme tous nos instincts, tenir aux formes et aux degrs de la civilisation. Comme le dit Leibniz,
la coutume, l'ducation, la tradition, la raison, y contribuent beaucoup ; mais la nature humaine ne laisse pas d'y prendre part . 49 Il est
certain que la pudeur sera plus ou moins lche suivant que le climat
exigera plus ou moins que le corps soit couvert ou dcouvert. Mme,
dans nos climats, on dcouvre plus le cou et les bras en t qu'en hiver. Mais ce qui prouve que la pudeur ne vient pas de l'usage des vtements, c'est que le premier vtement, le minimum de vtement, est
celui qu'exige la pudeur, et rien davantage. Il ne faut pas d'ailleurs,
comme Leibniz l'a montr contre Locke, confondre l'innit avec
l'universalit. L'inn peut se dvelopper peu peu. La gomtrie est
inne, et cependant il faut l'apprendre. La pudeur peut tre absolument
absente tant que l'humanit n'est pas sortie encore de la vie animale.
Lorsqu'elle apparat, il ne faut pas en conclure qu'elle est acquise,
mais seulement que l'humanit commence avoir conscience de la
nature supra-animale.
49
Nouveaux Essais, 1. 1er, ch. II, 10.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
447
On a essay aussi d'expliquer par l'habitude et l'exprience la pudeur de l'amour, qui donne tant de charme ce sentiment. L'exprience, dira-t-on, aura montr aux hommes que les plaisirs qui sont
associs au sentiment de l'amour sont plus vifs et plus sduisants
quand ils sont gots dans le secret, dans l'ombre et le silence de la
nuit. C'est ce que La Roche Foucauld a exprim d'une manire vive et
hardie dans sa clbre dfinition de l'amour : C'est, dit-il, dans l'me
une passion de rgner ; dans l'esprit, c'est une sympathie ; et dans le
corps, une envie cache et dlicate de possder ce qu'on aime aprs
beaucoup de mystre. Ainsi, le mystre est essentiel l'amour. Cela
tant, et pour augmenter leurs plaisirs, les hommes ont pris l'habitude
de rechercher [492] le mystre dans l'amour, de mettre un voile sur ce
qui en est l'objet et le terme, et d'loigner des yeux et des oreilles tout
ce qui s'y rapporte. De l est ne la pudeur. Je ne conteste pas cette
explication, et mme je l'adopte ; car elle accorde prcisment ce que
nous demandons. Qu'est-ce autre chose que ce besoin de secret qui
ajoute tant de charme l'amour, si ce n'est la pudeur elle-mme ?
Pourquoi ces actions plairaient-elles plus dans le secret, s'il n'y avait
pas prcisment dans la nature humaine un besoin vritable d'carter
des regards des hommes tout ce qui a rapport l'union des sexes ?
Revenons aux instincts en gnral. M. de Hartmann, dans sa Philosophie de l'inconscient, a signal un grand nombre de faits qui prouvent l'innit des instincts.
La plupart des animaux connaissent leurs ennemis naturels avant
qu'aucune exprience les ait instruits de leurs desseins hostiles : un essaim
de jeunes pigeons n'a pas besoin des leons d'un plus ancien pour s'effrayer et se disperser l'approche d'un oiseau de proie. Les bufs et les
chevaux qui reviennent du pturage, o il ne se rencontre pas de lion, ne
s'en montrent pas moins agits la nuit lorsqu'ils flairent l'approche de cet
animal. Des chevaux qui passaient sur une route prs de la vieille mnagerie des btes froces, Berlin, trahissaient leur inquitude et leur crainte,
quoiqu'ils n'eussent jamais vu de lion. Les pinoches nagent sans peur autour des voraces brochets. C'est qu'en effet si, par mgarde, un brochet
avalait une pinoche, cette dernire, avec les piquants dresss qu'elle porte
sur le dos, lui resterait dans le gosier et le condamnerait ensuite mourir
de faim. Le brochet ne pourrait, dans ce cas, transmettre ses descendants
le souvenir de sa douloureuse exprience. La prudence des furets et des
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
448
buses en face des vipres a dj t mentionne. Un jeune busard, devant
lequel on plaait une gupe pour la premire fois, se mit aussitt la manger, mais aprs lui avoir enlev l'aiguillon Un jeune chimpanz, que
Grant observait, tomba dans une grande frayeur [493] la premire fois
qu'il vit un serpent Aucun animal ne mange de plantes vnneuses. Le
singe repousse avec des cris les fruits vnneux qu'on lui prsente. Chaque
animal sait choisir pour sa nourriture les plantes et les viandes qui conviennent son appareil digestif Les animaux trouvent aussi d'euxmmes les remdes que leurs maladies rclament. 50
M. de Hartmann signale avec agrment la diffrence des instincts
entre les garons et les filles.
Que l'on considre une petite fille et un petit garon : la premire,
pimpante, agile, coquette, minaudire, gracieuse comme un petit chat ; le
second, gauche, lourd comme un jeune ours. L'une se pare et s'ajuste,
veille sur sa poupe, fait la cuisine, blanchit et repasse le linge dans ses
jeux ; l'autre btit une maison, joue au soldat, monte cheval sur un bton,
etc. Si le got du jeu n'tait qu'un effet de l'imitation, les garons et les
filles imiteraient de la mme manire, puisqu'ils ne comprennent pas la
diffrence des sexes, et vrai dire cette diffrence n'existe pas encore pour
eux. Comme est trange cette passion de la danse, cette propret, ce got
de sa toilette, cette grce, on pourrait dire cette coquetterie enfantine qui,
chez les petites filles, fait penser leur mission future de conqurir les
hommes ! Combien est caractristique le srieux infatigable avec lequel
les filles veillent sur leurs poupes, les habillent et les dorlotent ! Comme
tout cela rpond la tendresse qui les porte couvrir de baisers et de caresses, lorsqu'elles sont plus grandes, tous les petits enfants, pour lesquels
les jeunes hommes prouvent les mmes aversions que pour de petits
singes ! 51
La thse de l'innit a t soutenue avec beaucoup de verve par
Diderot dans sa rfutation d'Helvtius. Cette rfutation se trouve dans
deux crits de Diderot, l'un de quelques pages sur le livre de l'Esprit,
50
51
Philosophie de l'inconscient.
Ibid., 1er vol., 2e partie, 1.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
449
crit en 1750 et publi [494] dans les ditions de Diderot ; l'autre,
beaucoup plus important, suivant page par page le livre de l'Homme,
ouvrage posthume d'Helvtius. Ce second crit a t publi pour la
premire fois dans la grande dition de Diderot de M. Asszat.
Il est vrai de dire que la question traite par Diderot n'est pas tout
fait la mme que celle que nous discutons en ce moment. Pour nous, il
ne s'agit que de l'innit des penchants. Diderot traite surtout de
l'innit des talents, des vocations du gnie. Il s'agit donc surtout
d'innits intellectuelles : mais au fond c'est la mme question ; car
toute innit de talents et d'aptitudes intellectuelles est accompagne
d'innits instinctives, puisqu'il n'y a pas de talents sans certains gots,
certains penchants, certaines prdispositions. On n'est pas peintre sans
aimer la peinture, philosophe sans aimer les recherches philosophiques.
De plus, il s'agit plutt, dans la thse de Diderot, d'innits individuelles que d'innits gnrales. Ainsi l'innit du gnie est une innit individuelle ; car le gnie consiste prcisment n'tre pas comme
tout le monde. Mais, au fond, la question est toujours la mme.
D'abord, s'il y a des innits individuelles, pourquoi pas de gnrales ?
De plus, il n'est pas ncessaire que tous les hommes aient les mmes
instincts au mme degr. Il suffit donc d'tablir que chez ceux qui les
ont au degr le plus lev, ces instincts sont antrieurs l'exprience.
On conclura par induction ou par analogie qu'il en est de mme des
autres hommes.
Helvtius, dans son livre sur l'Homme, avait soutenu ce paradoxe
que toutes les intelligences sont gales et qu'elles ne diffrent que par
l'ducation, le milieu, les circonstances extrieures. Diderot crivit
pour lui-mme ses observations sur ce livre. Il le suit pas pas, opposant ses rflexions chacune des penses de l'auteur. Ce n'est donc
pas une dissertation en rgle. C'est une sorte de commentaire avec
boutades et sous forme d'improvisation. Ce travail tmoigne d'une
sorte de revirement dans la pense matrialiste de Diderot. [495] En
particulier, il proteste contre la thse exclusivement empiriste d'Helvtius.
1 Il insiste d'abord sur la spcificit des instincts dans les animaux. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi dans l'espce humaine ?
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
450
On ne donne pas du nez un lvrier ; on ne donne pas la vitesse un
chien couchant. Vous aurez beau faire : celui-ci gardera son nez, celui-l
gardera ses jambes. Pourquoi n'en serait-il pas de mme parmi les
hommes ? Pourquoi n'y aurait-il pas dans l'espce humaine la mme varit d'individus que dans la race des chiens ? Pourquoi chacun n'aurait-il pas
ses allures et son gibier ?
2 Si l'ducation fait tout, pourquoi n'obtiendrait-elle pas de tous
les hommes les mmes rsultats ? Pourquoi ne fait-elle pas autant
d'hommes de gnie qu'elle a d'lves ? Si je vous confie cinq cents
enfants, combien me rendrez-vous d'hommes de gnie ? Pourquoi pas
cinq cents ?
3 Dans la production du gnie, Helvtius confond la cause occasionnelle avec la cause vritable : c'est qu'il confond l'tincelle avec la
force explosive. Donnez-moi la mre de Vaucanson, je ne ferai pas
le flteur automate. Envoyez-moi en exil, ou enfermez-moi la Bastille, je n'en sortirai pas le Paradis perdu la main. J'ai t plus amoureux que Corneille ; j'ai fait des vers pour celle que j'aimais ; mais je
n'ai jamais fait le Cid ou Rodogune. Un pareil hasard ne produirait de
pareils effets que sur des hommes organiss d'une certaine manire
Rousseau fit ce qu'il devait faire, parce qu'il tait lui J'aurais fait
toute autre chose, parce que j'aurais t moi.
4 Par l'ducation, on peut rendre les hommes bons ou mchants ;
on ne peut pas les rendre spirituels : Un pre peut contraindre son
fils une bonne action ; mais il serait une bte froce s'il lui disait :
Maroufle, fais donc de l'esprit.
Ce passage de Diderot ne va peut-tre pas tout fait dans le sens
de notre thse, comme les prcdents, car c'est par [496] l'intelligence
que les hommes sont spirituels : c'est par la sensibilit qu'ils sont bons
ou mchants. Diderot confond ici la nature avec la moralit. Sans
doute, c'est par l'ducation et l'habitude que les hommes deviennent
vertueux et vicieux : mais c'est en partie par la nature qu'ils sont bons
ou mchants. Un homme dou comme saint Franois de Sales ne deviendra jamais un tigre, si ce n'est par suite de maladie. Quant la part
de l'ducation dans la nature des sentiments, nous la reconnaissons ;
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
451
mais il en est de mme pour l'intelligence. Si l'ducation ne contribue
pas au gnie, pourquoi y a-t-il si peu de gnies sans instruction et sans
tude ?
5 La spcialit des instincts prouve leur innit. On ne peut faire
volont de celui-l mme qui a le gnie des arts un peintre, un sculpteur, un pote, un orateur ou un musicien. On citerait peine un seul
homme (Michel-Ange) capable de faire la fois un bon pome et un
beau tableau. Voici trois styles : celui-ci est simple sans figures, sans
mouvement, sans couleur ; c'est le style de D'Alembert ou du gomtre. Cet autre est large, majestueux, abondant, plein d'images ; c'est
celui de l'historien de la nature, de Buffon. Ce troisime est vhment : il trouble, il touche, il lve ou calme les passions : c'est celui
du moraliste ; c'est celui de Rousseau.
6 Point de gnie sans passion, dit Helvtius. Trs bien ; mais
la passion elle-mme est-elle le produit du hasard ? Cet loge des passions est vrai ; mais comment ne s'aperoit-on pas que l'on forge des
armes contre soi ? L'ducation rendrait-elle passionns des hommes
ns froids ? Vous aurez beau prcher celui qui ne sent rien : vous
soufflez sur des charbons teints. S'il y a une tincelle, votre souffle
pourra susciter de la flamme ; mais il faut que la premire tincelle y
soit.
Une autre cole a beaucoup contribu tablir la doctrine de
l'innit des penchants : c'est l'cole du docteur Gall, l'cole phrnologique. Je signalerai surtout l'ouvrage [497] de Spurzheim intitul : des
Dispositions innes de l'me et de l'esprit (Paris, 1811).
Voici les principaux arguments dvelopps dans cet ouvrage. Ils
sont tout fait semblables ceux de Diderot, quoique l'ouvrage de
Diderot ne ft pas connu cette poque. On remarquera en outre que
l'auteur mle aussi, comme Diderot, les instincts avec les talents et les
aptitudes intellectuelles.
1 L'auteur signale la spcialit des instincts dans les races animales. Pourquoi la poule n'apprend-elle pas roucouler comme le pigeon ? Pourquoi la femelle du rossignol n'apprend-elle pas chanter
comme le mle ? Si l'on rpond que cela vient de la diffrence des organismes, les phrnologues rpondent que c'est prcisment ce qu'ils
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
452
soutiennent eux-mmes, et que cela suffit pour prouver que nos facults ne dpendent pas exclusivement des circonstances extrieures. M.
Herbert Spencer a dit dans le mme sens : Si l'intelligence tait une
table rase, pourquoi le cheval n'apprendrait-il pas parler comme
l'homme ?
2 On cite des hommes sauvages perdus dans les bois et rduits
l'animalit. Mais l'existence inne de certaines facults n'empche pas
qu'elles n'aient besoin d'tre dveloppes par l'ducation.
3 Les accidents rvlent le gnie lui-mme, mais ne le produisent pas. On peut citer l'exemple de La Fontaine et de Corrge. Pour
l'un et l'autre, c'est une circonstance extrieure qui a rvl en eux le
sentiment de leur gnie. Et moi aussi je suis peintre ! Mais c'est
qu'ils l'taient dj ; seulement ils ont pris conscience d'eux-mmes
l'occasion d'un modle extrieur. On peut citer encore le fait de certaines aptitudes spciales en contradiction avec le milieu intellectuel,
par exemple le got bizarre de Louis XVI pour la serrurerie.
4 On dira que le gnie n'est qu'une exception ; mais si le gnie est
inn, pourquoi les facults dont il n'est que le plus haut degr ne le
seraient-elles pas ? Dira-t-on que la [498] faim et la soif ne sont pas
naturels, parce que tous les hommes ne sont pas ivrognes et gourmands ?
5 Spurzheim rpond prcisment comme Diderot sur le cas de
Vaucanson et de Corneille. Combien d'hommes ont vu des horloges
sans devenir mcaniciens comme Vaucanson ! Combien d'hommes
ont t amoureux sans devenir potes !
6 Les circonstances modifient nos facults ; elles peuvent. mme
les touffer ; elles ne peuvent les engendrer.
7 Si les circonstances font tout, pourquoi tous les animaux n'agissent-ils pas de mme dans toutes les circonstances ? Pourquoi la perdrix meurt-elle de froid dans nos climats, tandis que la caille va chercher des climats plus temprs ?
8 On explique la diffrence de talents par la diffrence d'attention
porte sur telle ou telle chose. Mais ce qui explique la diffrence d'attention, c'est la diffrence des dispositions et des penchants. L'enfant
porte son attention des jouets, le savant aux combinaisons d'ides.
L'enfant qui deviendra peintre portera son attention sur les formes et
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
453
sur les couleurs ; le futur musicien, comme Mozart, s'appliquera ds
l'enfance aux combinaisons musicales.
Tel est l'ensemble d'arguments par lesquels l'cole phrnologique,
aussi bien que Diderot, soutient l'innit des talents, et par consquent
des penchants. On peut trouver que cette critique est un peu superficielle, en ce qu'elle porte exclusivement sur les circonstances extrieures, tandis que notre recherche est plus profonde, puisqu'elle demande si le penchant n'est pas une habitude rsultant du plaisir prouv. Mais, au fond, la question est la mme. Pourquoi les hommes
prouvent-ils du plaisir, les uns pour une chose,. les autres pour une
autre ? Ne faut-il pas pour cela quelque prdisposition, et en gnral
tout plaisir ne suppose-t-il pas une tendance satisfaite ? C'est la raison
principale que nous avons fait valoir. Les exemples cits par Diderot
et par Spurzheim ne font que mettre en lumire par le dtail cette pense fondamentale.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
454
[499]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE DEUXIME
LES PASSIONS
Leon IV
CLASSIFICATION
DES MOTIONS
Retour la table des matires
Messieurs,
Aprs avoir tabli l'existence et l'innit des penchants, nous pouvons passer la question de leur classification.
Commenons par convenir que nous donnerons le nom d'motions
tous les faits de sensibilit, quelle qu'en soit la nature. Il y a, avonsnous dit, deux ordres de faits dans la sensibilit : les faits affectifs
proprement dits, plaisirs et douleurs ; et les faits que nous pouvons
appeler impulsifs et qui sont les mouvements de l'me. Les uns et les
autres peuvent tre appels des motions. Nul doute que le plaisir et la
douleur ne soient des motions : nul doute que les mouvements de
l'me (penchant, inclination, passion) ne soient aussi des motions.
L'usage du mot motions a t consacr par Descartes, qui appelle
toutes les passions des motions (Passions, 1. Ier, ch. XXVII). Il est
galement adopt par les psychologues modernes, comme on le voit
par le livre de M. Alex. Bain, motions et Volont.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
455
Nous avons donc nous occuper du classement des motions.
Nous ne remonterons pas jusqu' l'antiquit. Mais nous ne pouvons
ngliger la classification de la scolastique tablie par saint Thomas
d'Aquin, et qui a domin dans les coles depuis le moyen ge. Les
scolastiques reconnaissaient l'existence d'une facult gnrale qu'ils
appelaient apptit (appetitus) ; c'est peu prs ce que nous appelons
activit ou tendance vers un objet (appetere).
Maintenant ils distinguaient trois espces d'apptits. L'apptit
[500] naturel (naturalis), l'apptit sensitif (sensitivus), l'apptit rationnel (rationalis).
L'apptit naturel, c'est la tendance du sujet vers tout objet qui convient sa nature, mais sans conscience, sans plaisir et sans douleur ;
par exemple, l'apptit des plantes vers la lumire, l'apptit de la racine
vers le bas, de la tige vers le haut, etc. L'apptit sensitif, c'est l'apptit
naturel accompagn de sensation, c'est--dire de plaisir et de douleur ;
enfin l'apptit rationnel et intellectuel tait l'activit dirige par l'intelligence et la raison. L'apptit naturel appartenait la vitalit ; l'apptit
rationnel n'tait autre chose que la volont. Restait l'apptit sensitif,
qui seul correspondait ce que nous appelons la sensibilit.
C'est donc l'apptit sensitif qu'il s'agit d'analyser et de ramener
ses lments en les classant.
Les Scolastiques divisaient l'apptit sensitif en deux espces : l'apptit concupiscible et l'apptit irascible. quoi rpond cette nouvelle
division ?
La tendance de l'apptit vers son objet peut tre considre soit au
point de vue du bien et du mal, sub ratione boni et mali, soit au point
de vue de la difficult, sub ratione ardui. Le bien et le mal engendrent
le dsir, d'o le nom de concupiscible donn toutes les passions qui
ont rapport au dsir. La difficult ou l'obstacle provoque la colre,
d'o le nom d'irascible donn toutes les passions qui naissent du sentiment de la difficult.
De l deux groupes de passions ; et comme toute passion porte sur
le bien ou sur le mal, chacune de ces passions forme un couple, compos de deux passions contraires, ce qui nous donne le tableau suivant :
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
456
I. Apptit concupiscible : 1 l'amour et la haine ; 2 le dsir et
l'aversion ; 3 la joie et la tristesse. II. Apptit irascible : 1 l'audace et la crainte ; 2 l'esprance et le dsespoir ; et enfin 3 une dernire passion qui n'a pas de contraire, la colre. Tel est le tableau des
passions construit par saint Thomas, d'aprs Aristote, qui cependant
ne lui avait pas [501] donn une forme systmatique, que Bossuet exposait encore dans la Connaissance de Dieu et de soi-mme, et qui a
dur jusqu'aux Cartsiens.
Nous n'avons pas apprcier dans le dtail la thorie scolastique ;
car pour cela il faudrait entrer immdiatement dans la thorie des passions. Nous ferons seulement remarquer que dans toutes les thories
sur les tendances de l'me il y a deux choses considrer : 1 l'tat du
sujet ; 2 la nature de l'objet.
Or les Scolastiques ne s'occupent que de l'tat du sujet, et ils ne
font pas mention de l'objet, qui est cependant quelque chose d'important : car autre chose est l'apptit de la nourriture, autre chose l'amour
de la patrie. La thorie scolastique est donc exclusivement subjective
et laisse de ct toute une partie de la question.
Cette thorie a dur jusqu' Descartes, qui l'a profondment modifie ; nous n'insistons pas sur les modifications apportes par Descartes et son cole, parce que nous aurons amplement nous servir
dans la suite de cette thorie cartsienne, et que nous voulons viter de
nous rpter. Nous signalerons seulement comme particulirement
importante la distinction faite par Malebranche entre deux sortes
d'motions : 1 ce qu'il appelle les passions avec saint Thomas et Descartes, et 2 ce qu'il appelle les inclinations. Quelque importante que
soit cette distinction, nous n'y insisterons pas non plus quant prsent ; car, comme nous comptons la reprendre notre compte, nous
attendrons ce moment pour la bien expliquer. Pour la mme raison,
nous ne dirons rien de la thorie de Spinoza.
Cela dit, nous passons la division des cossais. Thomas Reid a
ramen les inclinations de l'me trois grandes classes : 1 les apptits ; 2 les dsirs ; 3 les affections. Les apptits sont les inclinations
relatives au corps. Les dsirs sont les inclinations qui tendent vers
quelque objet abstrait, qui n'est ni un corps ni une personne : par
exemple, le dsir du pouvoir, le dsir de l'estime, le dsir de la connaissance. [502] enfin les affections sont les inclinations qui nous por-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
457
tent vers une personne ou qui nous en loignent ; de l deux sortes
d'affections : les affections bienveillantes et les affections malveillantes. Nous n'avons pas plus apprcier cette division dans le dtail
que nous n'avons fait pour celle des Scolastiques : ce sera l'objet des
analyses ultrieures.
Nous ferons seulement une remarque gnrale, comme pour la division scolastique, mais en sens inverse. Tandis que les Scolastiques
ne considraient que le sujet, les cossais ne considrent que l'objet,
et divisent les inclinations d'aprs leurs objets ; mais les tats de l'me
par lesquels passent les diverses inclinations quand elles sont satisfaites ou contraries, il n'en est pas question dans Reid. Il y a bien un
chapitre intitul les Passions, qui semble devoir rpondre cette question ; mais il est tout fait gnral ; il ne contient que des observations
plus littraires que philosophiques sur les passions entendues dans le
sens vulgaire, c'est--dire comme mouvements violents et exagrs.
Ainsi deux classifications, l'une trop subjective, l'autre trop objective : voil ce que nous avons recueilli jusqu' prsent. De ces deux
classifications, c'est encore celle de la scolastique qui nous parat la
plus philosophique et la plus profonde : car la division par les objets
est plutt matrielle et extrieure ; la division par le sujet est plus intime, plus rationnelle ; mais nous reviendrons sur ce sujet.
Arrivons aux philosophes contemporains, et d'abord aux successeurs de Reid.
Deux d'entre eux, Thomas Brown et Hamilton, ont propos des
vues nouvelles sur la classification des motions.
Thomas Brown prend pour point de dpart de la division le point
de vue du temps. Comme il y a trois moments dans le temps, il y aura
trois classes d'inclinations suivant ces diffrents rapports : les inclinations qui ont rapport au prsent sont dites immdiates ; celles qui ont
rapport au pass sont dites rtrospectives, et au temps futur, prospectives. 1 Du premier genre sont la joie et la tristesse, l'tonnement,
[503] le sentiment du beau et du sublime, le sentiment moral, la sympathie, l'humilit. 2 Du second ordre sont la reconnaissance, le regret,
le remords et son oppos, la satisfaction morale. 3 Dans le troisime
genre, l'auteur compte : le plaisir de l'excellence, le plaisir de l'action,
le dsir de la socit, de la science, du pouvoir, des affections, l'amour
de la gloire, le bonheur des autres, le mal d'autrui, etc.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
458
On voit aisment combien cette division est artificielle. Les diffrences les plus importantes sont sacrifies des diffrences secondaires et tout extrieures. Toutes plus ou moins passent par le plaisir
possd, dsir ou regrett. L'lment du temps a sa valeur, mais elle
ne vient qu'en seconde ligne.
La division d'Hamilton est galement trs artificielle. Elle sort cependant d'une bonne distinction. Hamilton distingue, comme nous
l'avons fait, les tats de l'me et les mouvements de l'me. Seulement
il confond les tats de l'me avec les sensations, et les mouvements
avec les sentiments. Mais n'y a-t-il pas des tats de l'me (tels que la
joie et la tristesse) qui ne sont pas des sensations, et des mouvements
de l'me qui ne sont pas des sentiments, par exemple la faim et la soif,
l'instinct de reproduction, etc. ?
Hamilton distingue ensuite les inclinations en contemplatives et
pratiques. Les premires se rapportent l'intelligence, les secondes
la volont. Les sentiments contemplatifs se divisent comme les facults intellectuelles. Par exemple, il rapporte la conscience l'ennui et
ses opposs ; l'imagination, le plaisir de l'ordre et de la symtrie, le
got de l'unit dans les varits ; l'entendement, l'amour de la vrit et la disposition approprier les moyens aux fins.
Les sentiments pratiqus sont : l'instinct de conservation, l'instinct
de la reproduction de l'espce, la tendance la perfection, le sentiment
moral, etc.
Cette classification est confuse. Elle n'a ni la nettet de La division
scolastique, ni la nettet de celle de Reid. Les [504] sentiments les
plus htrognes sont mls ensemble, parce qu'ils sont en rapport
commun avec telle ou telle facult.
Passons aux psychologues contemporains, Bain et Spencer.
Bain, ayant fait un livre sur les motions, nous devait une classification particulirement claire et exacte de ces phnomnes ; mais c'est
prcisment le contraire. On ne peut rien voir de plus confus que ce
qu'il nous dit dans le chapitre intitul : Classification des motions. Il
reconnat onze ttes de classification (pourquoi onze ?), et il fait remarquer que les deux gants du groupe sont l'amour et la colre. Il
semble qu'il revienne la division scolastique ; mais si l'on suit l'ordre
des chapitres, on ne trouve rien de semblable. En ralit, ce sont onze
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
459
chapitres qui se suivent dans un ordre quelconque, et il n'y a pas de
classification du tout. Aussi Lon Dumont a-t-il dit avec raison : Il
ne nous semble pas possible de dmler sur quel principe repose une
telle division, qui offre moins le caractre d'une classification rgulire que d'une numration arbitraire. Voici du reste cette numration : 1 motions de relativit ; 2 motions idales ; 3 sympathies ;
4 motions tendres ; 5 motion de la terreur ; 6 motion de la colre ; 7 motion du pouvoir et motions du moi ; 8 motions de
l'intelligence ; 9 motions de l'action ; 10 motions esthtiques ; 11
motions thiques.
Passons la classification d'Herbert Spencer. Celle-ci est toute diffrente. Elle se prsente sous une forme systmatique et scientifique,
pour ne pas dire pdantesque. Elle repose sur l'analogie et la correspondance des oprations de l'intelligence et des phnomnes de la
sensibilit.
Il y a quatre classes de connaissances, et en mme temps quatre
classes de sentiment :
1 Les connaissances que Spencer appelle prsentatives,
lorsque la conscience localise une sensation dans l'organisme : par
exemple une coupure ;
2 Les connaissances prsentatives reprsentatives, lorsque la
conscience associe une sensation actuelle avec une autre [505]
qui l'a accompagne dj dans la conscience ; c'est ce qu'on appelle perception ; par exemple la sensation de couleur rappelle
les autres qualits ;
3 Les connaissances reprsentatives, savoir les souvenirs ;
4 Les connaissances doublement reprsentatives, ou rereprsentatives, par exemple les ides abstraites.
Tout cela signifie qu'il y a des sensations et des souvenirs. Les sensations sont divises en deux classes : 1 les sensations actuelles ; 2
les sensations associes aux souvenirs. Les souvenirs sont diviss galement en deux classes : l les souvenirs proprement dits ; 2 les ides
abstraites.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
460
ces quatre degrs de connaissances correspondent quatre degrs
de sentiments :
1 Les sentiments prsentatifs ou sensations, savoir plaisirs et
peines ;
2 Les sentiments prsentatifs reprsentatifs, lorsqu'une sensation
rveille un nombreux cortge de sensations passives (comme
l'motion de la terreur) ;
3 Les sentiments reprsentatifs, comme le regret ou le plaisir du
souvenir ;
4 Les sentiments rereprsentatifs, qui sont moins le rsultat des
sensations externes que celui de la rflexion, par exemple l'instinct de la proprit.
Examinons maintenant cette division. Sans doute, c'est une ide
juste que de nous montrer les sentiments coexistant avec les oprations de l'intelligence. Mais est-ce l un bon principe de classification ? Un mme sentiment ne peut-il pas passer par les diffrents
tats ? Le sentiment grandit avec l'ge, avec la civilisation, et devient
de plus en plus complexe avec les lments dont il s'enrichit en route.
Mais il serait difficile de rattacher avec prcision des classes de sentiments diffrents chacun des tages intellectuels signals par Herbert Spencer. Par exemple, l'instinct de la nourriture peut tre prsentatif au moment o nous jouissons de l'aliment ; prsentatif reprsentatif [506] quand, ce moment mme, nous joignons l'ide du plat qui
va suivre, ou le plaisir de boire au plaisir de manger ; il est reprsentatif quand nous songeons aux bons repas que nous avons faits ; et enfin
rereprsentatif lorsqu'il se confond d'une manire plus abstraite avec
le plaisir du bien-tre en gnral et contient avec ce plaisir l'ide
d'autres plaisirs que celui-l.
Ce qui prouve combien la classification de Spencer est artificielle,
c'est que lui-mme l'abandonne dans l'analyse particulire qu'il fait
des sentiments. Il laisse entirement de ct les trois premires classes
et ne s'occupe que de la quatrime : ce qui nous prouve qu'il n'a pas de
faits bien prcis et bien distincts pour ranger dans les trois premires
classes.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
461
Quant la quatrime classe, savoir celle des sentiments rereprsentatifs, il la subdivise ainsi : 1 les sentiments gostes ; 2 les sentiments ego altruistes ; 3 les sentiments altruistes ; 4 les sentiments
esthtiques. Mais la seconde classe (les ego altruistes) n'est que la
combinaison de la premire et de la troisime ; elle peut donc disparatre. Restent trois classes, qui correspondent prcisment celles
que nous avons l'habitude d'employer dans notre psychologie classique, savoir : inclinations personnelles, sociales, impersonnelles ou
suprieures ; et encore cette troisime classe est-elle incomplte et
insuffisante ; car il est inexact de la rduire aux inclinations esthtiques et de ngliger les inclinations intellectuelles, morales et religieuses. Malgr son apparence scientifique, la division de Spencer est
donc la fois confuse et incomplte.
Elle a, de plus, le dfaut, comme celle de Bain et d'Hamilton, de
confondre le point de vue subjectif et le point de vue objectif, qui
avaient t nettement distingus l'un de l'autre par les Scolastiques et
par les cossais.
En France, si nous laissons de ct la classification d'Ad. Garnier,
qui est celle que nous adopterons en grande partie nous-mmes, nous
ne trouvons signaler que celle de Lon [507] Dumont, qui est originale en ce que, comme nous l'avons vu dj, il a essay de sparer absolument le plaisir et la douleur des autres phnomnes de la sensibilit ; c'est--dire qu'il carte toutes les autres motions appeles inclinations, penchants, passions, etc. Elle n'est donc qu'une, classification
des plaisirs et des douleurs et une description de ces phnomnes ; en
cela elle est intressante, car on n'avait jamais aussi nettement distingu ces phnomnes simples et lmentaires de la sensibilit. Il admet
un principe de distinction qu'il n'est pas facile de suivre dans le dtail.
C'est la distinction du positif et du ngatif : peines ngatives et peines
positives ; plaisirs ngatifs et plaisirs positifs. Mais cette distinction
est subtile et obscure. Par exemple, la douleur des lsions (le mal de
dents), que l'auteur appelle une douleur ngative, ne semble-t-elle pas
au contraire tre trs positive ? L'effort est-il une peine positive ?
N'est-ce pas, au contraire, un mlange de peine et de plaisir ? N'est-ce
pas aussi un fait actif, de tout autre nature que le plaisir et la douleur ?
Mettra-t-on aussi la gaiet parmi les plaisirs ngatifs, et le farniente
parmi les plaisirs positifs ? Tout cela n'est-il pas bien artificiel ? Mais
le principal dfaut de cette classification, c'est qu'aprs avoir promis,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
462
ce qu'il semble, une classification toute subjective, l'auteur y fait sentir
en grande partie ce que j'appellerai le point de vue objectif, en donnant une place trs considrable la sensibilit esthtique et en y
comprenant l'esprit, le got, le beau, le sublime, etc. C'est toute une
esthtique introduite au cur de la sensibilit. Mais pourquoi n'en pas
faire autant pour la sensibilit morale, et par consquent pour tous
sentiments sociaux et mme religieux ? C'est, du reste, ce que l'auteur
fait en partie dans son chapitre sur les plaisirs du cur, qui est d'ailleurs court et assez superficiel et qui contient des faits appartenant
toute espce de sensibilit, et non pas seulement au cur. On voit, par
ce rapide rsum, que le livre de M. Lon Dumont, qui est trs intressant dans le dtail des descriptions, laisse beaucoup dsirer pour
l'exactitude et la prcision.
[508]
En Allemagne, nous ne trouvons mentionner, au moins dans les
temps modernes, que la classification de Herbart, plus ou moins perfectionne par Waitz. Voici les principes de cette classification, telle
qu'elle nous est rsume par M. Bain dans l'Appendice de son ouvrage
motions et volont.
Waitz divise les motions en deux classes : formelles et qualitatives. Les premires dpendent de la manire dont les objets se prsentent notre esprit ; les secondes tiennent aux caractres spciaux de
ces reprsentations. Cette distinction parat rpondre peu prs la
distinction que nous avons faite dj nous-mme et que nous utiliserons tout l'heure entre les phnomnes subjectifs et les phnomnes
objectifs de la sensibilit. Si, en effet, nous examinons, par exemple,
les motions que Waitz appelle qualitatives, nous y trouvons : 1 les
sentiments infrieurs, les motions des sens ; 2 les sentiments suprieurs (par exemple esthtiques, moraux, intellectuels et religieux). On
voit que cela rpond nos diffrentes inclinations, lesquelles sont dtermines par les objets. Quant aux motions formelles, les exemples
sont beaucoup moins clairs ; par exemple, oppression ou soulagement,
effort et aisance ; le plaisir de la recherche ou plaisir de la dcouverte ;
puissance ou faiblesse. On ne sait trop quoi rpond cette classe
d'motions. Devant une numration aussi confuse, la classification
scolastique simplifie et dveloppe la fois par le cartsianisme
(Descartes, Malebranche et Spinoza) prsente une supriorit manifeste. On est tonn de voir le plaisir de la dcouverte rang dans les
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
463
motions formelles, tandis qu'il se rattache videmment aux inclinations intellectuelles ranges dans les motions qualitatives. L'auteur a
raison ensuite de distinguer les motions prcdentes en simples et
complexes ; mais on ne voit pas pourquoi l'effort serait un sentiment
simple, et le dsir un sentiment complexe ; de plus, l'effort n'est-il
qu'un sentiment, et n'est-il pas le fond mme de la volont ? On remarque enfin que dans les motions qualitatives il n'est question que
d'objets idaux, tels qu'esthtiques, moraux, intellectuels et [509] religieux, et l'on nglige entirement les motions, si qualitatives cependant, qui comprennent les motions gostes et altruistes.
Ces divisions abstraites sont si confuses et si arbitraires que mieux
vaudrait encore s'en rapporter au sens commun ou la littrature, et
numrer les motions les plus communes et les plus familires, que
de classer au hasard des motions quelconques dans des groupes quelconques, sans qu'aucun fait prcis vienne lucider la division.
On trouvera dans l'Appendice de Bain le rsum des ides de
Wundt, de Shadworth, 52 de H. Ogson, de Mercier ; mais ne croyons
pas devoir nous y arrter, et nous arrivons l'exposition de nos
propres ides sur la question.
52
The Mind, juillet et octobre 1884 et janvier 1885.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
464
[449]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE DEUXIME
LES PASSIONS
Leon V
LES PASSIONS EN GNRAL
Retour la table des matires
Messieurs,
La sensibilit, d'aprs ce que nous avons dit au dbut de ce cours,
se rduit deux sortes de faits : 1 le plaisir ou la douleur ; 2 le dsir
ou l'amour (avec leurs contraires, qui vont vers le plaisir ou qui s'en
loignent). L'histoire de la sensibilit serait donc bien vite finie, si l'on
se contentait de constater ces deux ordres de faits, et si l'on n'y mlait
quelque autre chose, savoir des ides : 1 l'ide des objets qui provoquent le plaisir et la douleur ; 2 l'ide des circonstances qui facilitent ou retardent la possession de ces objets. En un mot, il y a deux
causes de diversit : 1 les causes objectives ; 2 les causes subjectives. Telle sera la base de notre classification emprunte Malebranche.
Diversifi par les causes objectives, l'amour se divise en espces.
Autant d'espces d'amour qu'il y a d'espces d'objets diffrents. C'est
ce que nous appellerons, d'aprs Malebranche, 53 les inclinations. Di53
Voir la Recherche de la vrit, V, I. Voir aussi Adolphe Garnier, Facults
de l'me.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
465
versifi par des causes subjectives , l'amour subit des modifications
qui en affectent la forme intrieure. Ces modes sont ce que nous appellerons, d'aprs la langue des Cartsiens, des passions.
Ainsi deux grandes divisions des motions : les inclinations et les
passions. Les passions sont les modes de l'amour ; les inclinations en
sont les espces.
Donnons des exemples : l'amour du pouvoir, l'amour du jeu,
l'amour des hommes, l'amour de la patrie, sont des [511] inclinations.
La crainte, l'esprance, la tristesse, le regret, sont des passions. Ce qui
distingue ces deux ordres de faits, c'est que : 1 chaque inclination est
susceptible de passer par toutes les passions ; 2 chaque passion se
rencontre dans toutes les inclinations. Par exemple l'avare peut
craindre pour son trsor, comme l'ambitieux peut craindre pour sa
place, comme la mre peut craindre pour ses enfants, le patriote pour
sa patrie, etc. Ainsi la mme passion, la crainte, se rencontre dans
toutes les inclinations. Rciproquement, une seule inclination, l'amour
du pouvoir, est susceptible de dsir, d'esprance, de crainte, de regret,
de repentir, et en un mot de toutes les passions.
Il est vrai que Malebranche donne quelquefois un autre fondement
la division des inclinations et des passions. Les unes, selon lui, savoir les passions, sont corporelles ; les autres, les inclinations, ne le
sont pas. En d'autres termes, Malebranche entend par passion
l'amour et la haine sensibles , et par inclination l'amour et la
haine spirituels . Dans cette seconde division, il oublie le principe de
la premire. Il avait dit qu'il ne distinguerait point les passions par leur
objet ; or l'amour sensible ne se distingue de l'amour spirituel que par
son objet. Cette distinction reviendrait donc la distinction bien connue entre la sensibilit physique et la sensibilit morale. Si cependant
nous considrons dans le fait la description que Malebranche donne
des inclinations et des passions, nous verrons qu'il ne se tient pas
ferme la distinction prcdente entre l'amour sensible et l'amour spirituel. Par exemple, il range dans les inclinations le penchant la conservation de notre propre tre ; mais dans la conservation de notre
tre, la conservation de l'tre, la conservation du corps entre ncessairement. De plus, parmi les inclinations qui nous portent vers nousmmes, il distingue deux espces : l'amour de l'tre et l'amour du bientre, c'est--dire l'amour du plaisir, et il dit que le plaisir en gnral
contient la fois et les plaisirs moraux et les plaisirs sensibles. En
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
466
outre, il range encore parmi les inclinations [512] l'amour des richesses ; et c'est l un penchant qui se rapporte au corps. Rciproquement, tout ce qu'il dit des passions peut s'appliquer aussi bien aux inclinations spirituelles qu'aux inclinations corporelles. Par exemple, il
ramne toutes les passions, comme Spinoza, au dsir, la joie et la
tristesse. Mais n'y a-t-il pas dsir, joie et tristesse dans toutes les inclinations, mme les plus hautes, par exemple l'amour de Dieu ? Il attribue les passions aux mouvements des esprits animaux. Mais n'y a-t-il
pas quelque mouvement des esprits animaux dans les inclinations
mme spirituelles ? Peut-il y avoir inclination sans motion ? Or, si
l'motion est le signe du mouvement des esprits, il y aura mouvement
des esprits jusque dans les inclinations.
Sans doute, il faut reconnatre la diffrence de l'amour et de la
haine sensibles avec l'amour et la haine spirituelles ; mais cette distinction a rapport l'objet et sera une subdivision des inclinations,
dont les unes se portent vers les choses corporelles, les autres vers les
choses spirituelles. Quant aux passions, elles sont les mmes dans
toutes les inclinations ; et leur diffrence vient, non de l'objet, mais
des circonstances qui les modifient.
Nous nous en tiendrons donc la division tablie plus haut, entre
les inclinations et les passions. la vrit, la passion dfinie la manire des Cartsiens parat contraire l'usage qui entend surtout par
passions des phnomnes anormaux, dsordonns et violents, que la
morale condamne et que la raison dsapprouve, tandis que ces passions, telles que l'entendent les Cartsiens, ne seraient que les modes
lmentaires et essentiels de la sensibilit. Il n'y a aucun homme qui
soit exempt de passions en ce sens, aucun moment de la vie o elles
n'interviennent. Impossible de se reprsenter une vie humaine quelconque et un moment quelconque de cette vie o ne se rencontrent
quelque degr l'amour, la haine, le dsir, l'esprance, la crainte, etc., et
ces sentiments ne peuvent pas tre condamns par la morale, puisque
la vie serait impossible sans eux.
[513]
Cette signification du mot passions semble donc contraire
l'usage, et de plus laisse de ct la partie la plus intressante de ces
phnomnes pour n'en conserver que la partie la plus banale et la plus
vulgaire. Quand on dit : J'aime un fruit ; je crains qu'il ne pleuve ;
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
467
j'espre bientt partir ; je suis au dsespoir d'avoir manqu votre visite ; qui peut croire que l'on ait affaire l des phnomnes passionns ? La peinture des passions dans les pomes dramatiques, dans
les romans, a pour objet des faits d'un tout autre ordre et d'un bien plus
puissant intrt. Qu'est-ce donc que la passion dans le sens que lui
donne l'usage, la morale, l'esthtique ? Ce sont des mouvements extrieurs et violents, qui emportent l'me hors d'elle-mme, qui ne lui
permettent plus de se possder et de se matriser, qui poursuivent leur
objet aux dpens mmes de la vie, et qui jouissent plus d'elles-mmes
que de la possession de cet objet.
Pascal, dans son Discours sur les passions de l'amour, a exprim
de la manire la plus admirable ce sens attribu au mot de passion :
L'homme est n pour penser ; mais les penses pures le fatiguent et
l'abattent ; il lui faut du remuement et de l'action, c'est--dire qu'il est
ncessaire qu'il soit quelquefois agit des passions dont il sent dans
son cur des sources si vives et si profondes Les passions qui sont
les plus convenables l'homme sont l'amour et l'ambition. Qu'une vie
est heureuse quand elle commence par l'amour et finit par l'ambition ?
Tant que l'on a du feu, l'on est aimable ; mais ce feu s'teint : il se
perd, alors que la place est belle et grande pour l'ambition ; la vie tumultueuse est agrable aux grands esprits ; ceux qui sont ns mdiocres n'y ont aucun plaisir ; ils sont machines partout.
Une seconde diffrence que l'usage met entre la signification qu'il
attribue au mot de passion et celle que nous avons adopte, c'est que,
pour le sens commun, la passion aussi bien que l'inclination a un objet
et n'est pas seulement un tat de l'me ; les passions se distinguent par
leur objet et non pas seulement par leurs modes. Ainsi l'on dit : la
[514] passion du jeu, la passion des honneurs, la passion de la gloire,
etc.
Ainsi, deux faits distinguent les deux sens du mot de passion : 1 la
passion, au sens ordinaire, est objective aussi bien que les inclinations ; 2 elle est un tat extrme et violent. Dans le sens que nous
adoptons, au contraire, la passion est surtout un tat subjectif de
l'me ; et, de plus, elle existe, mme l'tat le plus modr, aussitt
qu'il existe quelque motion dans l'me.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
468
Malgr ces observations, nous persistons dans notre mode de classification, considrant que c'est la plus commode pour prsenter les
faits d'une manire claire, intelligente et complte.
1 Pour ce qui est de l'usage de la langue, nous ferons remarquer
que si notre dfinition des passions n'est pas tout fait conforme
l'usage actuel, elle est au moins conforme la tradition et l'usage
classique, puisque c'est le sens qu'adoptaient Descartes, Malebranche
et Bossuet, qui ne passent pas pour de mauvais crivains. Ce sens tait
bien celui de leur temps, comme le prouve le petit trait du P. Senault : de l'Usage des passions, o le mot est pris dans le mme sens.
Nous venons de citer le discours de Pascal sur l'amour ; or le titre
exact donn ce discours par les amis de l'auteur tait celui-ci : Discours sur les passions de l'amour. Si l'on s'en rapportait l'usage actuel, on dirait : Discours sur la passion de l'amour. Le pluriel n'aurait
aucun sens dans la langue d'aujourd'hui ; mais il en a un trs clair dans
la langue du XVIIe sicle. Il signifie : les divers tats de passion par
lesquels passe cette inclination que nous appelons l'amour ; mme au
e
XVIII sicle, ce sens n'avait pas t compltement abandonn, comme
le prouve le premier titre de la premire traduction franaise de Werther : les Passions du jeune Werther.
2 Quant au fond des choses, les passions entendues dans le sens
littraire ne reprsentent pas, selon nous, un ordre de faits spciaux
distincts des autres et que l'on puisse tudier [515] sparment : ce ne
sont que des extrmits soit des inclinations, soit des passions proprement dites. Ce ne sont pas des choses distinctes ; ce sont des degrs. La passion du vin est l'extrmit de la passion de la soif ; la passion de la vengeance n'est que l'extrmit de la passion de la haine ; la
passion de l'amour n'est que l'extrmit de l'inclination qui porte les
doux sexes l'un vers l'autre. Tontes nos inclinations sont susceptibles
de passions, quoiqu'elles n'aient pas toujours dans ce cas le nom spcial ; mais l'amour de la patrie, l'amour maternel, l'amour de l'humanit, sont susceptibles (au sens vulgaire) de devenir des tats passionns,
lorsqu'elles passent une certaine mesure.
En outre, quel moment l'inclination devient-elle passionne ?
C'est quand les motions qui les accompagnent deviennent trs vives,
trs violentes, trs exclusives, trs tumultueuses, et se remplacent l'une
l'autre trs rapidement ; en d'autres termes, ce qui caractrise l'tat
passionn dans le sens vulgaire, ce sont les alternatives d'amour, de
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
469
haine, de dsir, d'esprance, de colre, par lesquelles passent les inclinations ; ainsi les passions, au sens littraire du mot, ne sont que les
exagrations des motions proprement dites, c'est--dire de ce que
nous appelons les passions. Si donc elles ne sont autre chose que les
exagrations, soit des inclinations, soit des passions, il faut tudier ces
deux classes de faits l'tat normal, avant de les tudier l'tat hypertrophique et drgl.
Malgr les observations prcdentes, on peut dire que la psychologie moderne a laiss tomber peu peu le sens cartsien et scientifique
du mot passion et s'est surtout applique au sens usuel et secondaire.
Ainsi, dans Reid il y a un chapitre entier sur les passions ; or il entend par l, comme le vulgaire, des mouvements extrmes et violents
de la sensibilit. Dans le Dictionnaire des sciences philosophiques,
l'article passion, trait du reste avec beaucoup de soin, est entendu
dans le mme sens. On y oppose la passion soit aux inclinations, soit
aux motions, et [516] on les caractrise en disant qu'elles vont contre
le but mme pour lequel elles sont faites. Dans le Manuel philosophique de M. Bnard, les passions sont des perturbations, des maladies de l'me. Dans le Cours de M. Rabier, les passions sont des inclinations perverties. Dans le Cours de psychologie applique l'ducation de M. Marion, les passions sont encore distingues des inclinations et des motions, et il est dit que la passion est une inclination
surexcite, exalte, la plupart du temps pervertie, qui est devenue tyrannique et dominante et qui a envahi l'me au dtriment des autres
inclinations.
Un seul philosophe de nos jours est rest fidle la division cartsienne et mme lui a donn un degr suprieur de prcision. C'est
Adolphe Garnier ; mais dans le dtail il nglige presque entirement
les passions pour ne s'occuper que des inclinations.
La prfrence, que la philosophie moderne a donne au sens secondaire et littraire du mot sur le sens traditionnel et classique, commun l'cole scolastique et l'cole cartsienne, a eu un grand inconvnient : c'est de faire abandonner et oublier les belles analyses que
les cartsiens avaient faites des passions dans le sens propre qu'ils
donnaient ce mot. Ainsi le beau livre de Descartes sur les Passions,
le de Affectibus de Spinoza, c'est--dire la troisime partie de
l'thique, qui est une merveille d'analyse et de profondeur, a t per-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
470
due pour la philosophie classique. Ce sont les physiologistes qui s'en
sont empars notre dtriment. C'est ainsi que, dans la Physiologie de
Muller, nous trouvons intercal tout entier le livre de Spinoza. Au lieu
de ses profondes analyses qui montaient jusqu'aux lments mmes de
nos tats affectifs et qui nous en montraient la composition et la complexit croissantes par l'intervention de tel ou tel lment intellectuel,
nous n'avons plus que des gnralits banales sur les passions relevant
plus de la morale que de la psychologie et dans lesquelles les philosophes luttent d'une manire trs ingale et avec un grand dsavantage
avec les littrateurs.
[517]
Disons cependant que, parmi les philosophes contemporains, il en
est un qui, tout en restant fidle la signification couramment adopte, a essay de lui donner un sens philosophique et prcis, et essay
de relier dans une thorie approfondie tout ce qui concerne les passions, tout en les distinguant absolument, comme d'un ordre tout htrogne, et des motions (c'est--dire des passions au sens cartsien) et
des inclinations proprement dites. C'est le sujet d'une thse que la facult des lettres a distingue parmi ses thses, et dont l'auteur est M.
Maillet, professeur au lyce Louis-le-Grand. Ce grand ouvrage a pour
titre de l'Essence des pussions.
Rsumons en quelques mots l'ide fondamentale de cet ouvrage. Il
peut se rduire aux propositions suivantes :
1 Les passions tant par dfinition les perturbations de l'me, les
maladies de l'me, l'tude des passions appartient non pas la psychologie normale, mais la psychologie morbide, la pathologie mentale.
2 Les passions sont un mode de l'activit, non de la sensibilit ;
elles doivent tre absolument spares des autres faits de la sensibilit,
avec lesquels on les confondait tort.
3 Les passions sont des phnomnes intermdiaires entre les maladies et la folie. Les maladies sont la perturbation des forces vitales et
organiques. La folie est la perturbation des forces mentales ; les passions sont les perturbations des instincts.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
471
4 Le caractre essentiel de ces perturbations, c'est d'tre des ruptures d'quilibre entre les diffrentes forces de l'me ; ces ruptures
d'quilibre sont accompagnes de rythme, c'est--dire d'une alternative
constante d'exaltation et d'abaissement.
5 La passion s'oppose la raison. Pour savoir ce que c'est que
l'tat des passions, il faut savoir ce que c'est que la raison. Or l'un et
l'autre tat s'explique par la loi de l'enveloppement des forces. D'aprs
cette loi, les forces infrieures sont absorbes par les suprieures ;
mais, en s'y [518] absorbant, elles continuent leur action. Elles sont
domptes, mais non supprimes. C'est ainsi que les forces physicochimiques subsistent sous les forces organiques, les forces organiques
et vitales sous les forces instinctives, et celles-ci sous les forces mentales, lesquelles sont leur tour gouvernes et ramenes l'unit par la
raison et le moi. Supposons que, par une circonstance quelconque, le
terme suprme vienne suspendre son action, le lien tabli par lui se
dissout, l'quilibre est rompu, et les forces infrieures font irruption
dans les forces suprieures. Cette irruption sera d'autant plus facile
que le lien sera plus lche, le systme moins rigoureux, l'unit du systme moins acheve. Or, cette rupture d'quilibre dans les forces vitales, ce sera la maladie ; dans les forces mentales, la folie ; dans les
forces instinctives, la passion.
6 Cet embotement des forces est le rsultat de l'volution, c'est-dire des acquisitions successives qui se font la suite du temps. Mais
l'addition des forces nouvelles ne fait pas disparatre les forces infrieures. Celles-ci demeurent comme tmoignage d'un tat pass.
L'irruption des passions est un phnomne d'atavisme ; c'est une reviviscence d'anciens tats de conscience, la rapparition du sauvage
dans l'homme.
Cette thorie contient des parties vraies et bien observes ; mais
dans son ensemble nous ne saurions l'accepter.
Nous contesterons, par exemple, tout d'abord l'ide fondamentale,
savoir que les passions, au sens de l'auteur, sont des phnomnes
pathologiques. On ne peut appeler pathologiques des phnomnes qui,
infrieurs ou non, font partie intgrante de la constitution humaine. Le
sommeil, par exemple, est un tat infrieur par rapport la veille ; on
peut mme, si l'on veut, l'appeler anormal en prenant pour type la vie
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
472
physiologique de la veille ; nanmoins le sommeil ne sera pas un phnomne pathologique, puisque, bien loin d'tre un dsordre dans l'organisation, il est au contraire la condition de l'ordre. C'est la privation
du sommeil, c'est l'insomnie [519] qui est un fait pathologique ; or le
contraire d'une maladie ne peut pas tre une maladie. Si nous appliquons cette ide la passion, nous verrons qu'elle est galement vraie.
C'est l'absence des passions, c'est l'apathie absolue qui serait pour
l'homme tel qu'il est un tat pathologique. Un homme absolument dnu de passions, sans aucun feu ni excitant intrieur, n'obissant qu'
la raison pure, un tel homme serait une abstraction, non un tre vivant.
la vrit, l'auteur de la thorie nous dira que l'absence de passions
n'est pas pour lui l'absence d'motions ; qu'il admet comme nous la
ncessit de ces mouvements de l'me et du cur que l'on appelle
tort des passions, mais qu'il faut rserver cette expression pour les cas
pathologiques, c'est--dire pour les perturbations drgles. Aussi a-til soin de rpter souvent que les passions sont des dpravations de
l'instinct, des dviations de l'instinct. Mais ce n'est plus alors ici
qu'une question de mots. Tout le monde admet qu'il y a des cas o les
instincts mme les plus naturels et les plus lgitimes deviennent drgls, draisonnables, dpassent le but et mme le contredisent, et font
irruption dans la vie raisonnable. Ce ne sera plus qu' ce dernier cas
que l'on rservera le sens du mot passion. Mais qu'avons-nous appris
par l, si ce n'est ce que nous savons dj, savoir qu'il y a un tat
morbide et pathologique de l'me et que c'est ce seul tat que l'on
rservera le nom de passion, en conservant celui d'motions ou de sentiments pour l'tat lgitime et naturel.
Mais en rservant ainsi le nom de passion pour l'tat pathologique
de l'me, non seulement on ne sera pas d'accord avec la tradition classique et cartsienne, mais on ne sera pas mme d'accord avec l'usage
littraire du mot ; car par passion on entend bien des mouvements extrmes et violents, mais non pas ncessairement des mouvements pathologiques. Lorsque Pascal s'crie : Qu'une vie serait belle qui
commencerait par l'amour et finirait par l'ambition ! un tel cri peut
ne pas tre conforme aux rgles morales, mais nul ne peut dire que
Pascal rve l un tat pathologique, [520] et dsire d'tre fou. Les
mouvements passionns du Cid et de Chimne ne sont pas des dpravations de l'instinct ; ce sont, au contraire, de nobles exaltations de
l'instinct. Or ces mouvements eux-mmes, on ne saurait dire quel
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
473
moment ils commencent devenir passionns, si l'on ne consent pas
appeler passions tout mouvement de l'me, quel qu'en soit le degr.
C'est surtout au point de vue de la morale que la considration pathologique est importante. Au point de vue purement psychologique, la
passion en elle-mme est un fait naturel qui ne devient morbide que
par accident.
Au reste, l'auteur se rpond lui-mme lorsque, dans une autre
partie de son travail, il affirme que la passion est le principe des
grandes penses et des grandes actions autant que des penses mauvaises et des dterminations funestes ; qu'elle se prsente sous deux
formes essentielles, dont l'une est bonne et progressive , l'autre
rgressive et mauvaise ; lorsqu'il dit que la passion n'est pas toujours une dfaillance, un garement, une abdication de l'amour de
l'me vers l'idal, mais qu'elle peut tre aussi un effort et un lan
extraordinaire vers cet amour ; lorsque, en faisant parler la passion
dans une prosopope assez loquente, il lui fait dire : Je suis une et
bonne ; mon vrai nom, c'est l'amour ; je suis tous les degrs, et sous
toutes les formes, le dsir du bien Si Dieu t'exauait, le monde retomberait dans l'inertie et dans la torpeur ; lorsqu'il affirme qu'une
perturbation n'est pas ncessairement mauvaise ; lorsque enfin il
rattache la passion la thorie du progrs dans la nature, et la notion
d'un effort de la nature vers la raison. Toutes ces vues nous paraissent
parfaitement justes ; mais elles sont en contradiction avec le principe
pos plus haut, savoir que les passions ne seraient qu'un phnomne
pathologique et tratologique. De plus, ces mmes vues contredisent
la distinction que l'auteur a voulu tablir entre ce qu'il appelle les
motions et les passions, et la prtention d'enlever la passion au domaine de la sensibilit, pour la rserver au domaine de l'activit.
[521]
La raison principale donne par l'auteur, c'est que l'motion, bien
loin d'tre le caractre essentiel de la passion, n'y joue au contraire
que le rle tout fait secondaire de cause excitatrice ou occasionnelle : elle est hors de proportion avec le dploiement d'nergie qui lui
succde, et par consquent n'aurait pu lui donner naissance, si cette
nergie n'avait t n quelque sorte toute prte : c'est au contraire la
passion qui, en se dchanant d'une manire spontane, communique
une force extraordinaire, une puissance exclusive l'ide ou l'motion qui l'accompagne. II est, dit-il encore, des motions dans
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
474
lesquelles le dploiement d'activit est le fait premier et essentiel. Ces
motions, o l'tat de conscience est l'instrument accessoire, tandis
que la modification de l'quilibre entre les forces est l'lment essentiel, doivent tre appeles des passions. Les passions ne sont cependant pas des habitudes permanentes de l'me (comme les vertus ou les
vices). Les passions occupent une place intermdiaire entre les motions et les habitudes permanentes : Entre les motions essentiellement fugitives et les habitudes permanentes souvent indestructibles, il
y a place pour des faits intermdiaires qui donnent l'me une vive
secousse, mais sans lui imprimer soit vers le bien, soit vers le mal, une
direction constante. Ce sont prcisment les faits passionns. Nos
motions tiennent ce que l'quilibre des forces dans notre nature
tend continuellement se modifier, mais d'une manire assez faible,
sous l'influence des circonstances extrieures, et souvent mme du
cours de nos facults. Nos habitudes et nos vices ont leur principe
dans une grave modification, une vritable rupture d'quilibre qui ne
peut plus tre rtabli sans de grands efforts. Les passions occupent une
place intermdiaire : ce sont des mouvements dsordonns et violents,
par lesquels les diverses forces qui coexistent en nous se heurtent les
unes contre les autres, et altrent sans la dtruire l'unit cre par la
raison.
En rsum, les passions, bien qu'elles se manifestent au premier
abord comme phnomnes sensibles, n'ont pourtant [522] pas pour
essence cette sensibilit, mais une activit tumultueuse et anormale,
extraordinairement dchane. Ce qui le prouve, c'est que le plaisir
attach la passion est souvent trs faible, trs peu de chose en proportion du dploiement considrable d'activit que la passion dchane. L'activit y dborde donc sur la sensibilit.
Il y a beaucoup de vraie psychologie dans cette analyse ; nous admettrons volontiers qu'il y a un certain tat que l'on appellera l'tat
passionn, et qui se caractriserait en effet par un dbordement d'activit en disproportion avec la cause sensible excitatrice, comme, par
exemple, la peur aveugle et subite, l'amour drgl, l'ambition dsordonne, o l'emportement est si grand et le plaisir si faible, o mme
la douleur est souvent plus grande que le dsir. Mais c'est plutt un
tat qu'une classe de faits particuliers. Ce seront les mmes inclinations, les mmes apptits, qui, en tant que ramens l'quilibre, produiront les motions, et, en tant qu'ils dpassent l'quilibre, les pas-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
475
sions. L'auteur cite comme exemple d'motion, la crainte lgitime d'un
gnral, et comme exemple de passion, la peur subite d'un enfant dans
les tnbres. Mais au fond, que le danger soit rel ou imaginaire, le
phnomne de la crainte n'est-il pas toujours le mme en substance ?
De mme, entre un amour maternel clair et lgitime et un amour
maternel inquiet, aveugle, prcipit, fatigant, comme celui de Mme de
Svign, on peut bien tablir une distinction et appeler le second une
passion : mais au fond n'est-ce pas toujours le mme sentiment ?
L'auteur lui-mme, lorsqu'il veut faire une classification des passions,
est bien oblig d'en revenir aux inclinations reconnues par tout le
monde. Il serait, en effet, impossible de trouver une classe de faits rpondant aux dfinitions prcdentes, et qui se distingueraient des
autres faits rangs sous le nom d'motions ou de sentiments. L'ambition, par exemple, la passion du jeu, l'amour, sont ou des inclinations
lgitimes, naturelles, essentielles la nature humaine, quand elles sont
modres, ou des passions quand elles dbordent : [523] la passion ne
sera donc qu'un tat par lequel peuvent passer nos inclinations, lorsqu'elles rompent l'quilibre ; ce ne sera pas un ordre de faits distincts
et spars.
On remarquera d'ailleurs que la thorie prcdente n'implique nullement que les passions soient toujours un tat pathologique : car la
rupture d'quilibre peut se faire tout aussi bien au profit du bien qu'au
profit du mal ; elle peut tre un coup d'audace qui fait avancer l'me
dans la voie du progrs, et non un dsordre, une chute, une abdication.
On peut appliquer tout aussi bien aux bonnes passions qu'aux mauvaises l'ide que l'activit y dborde sur la sensibilit : par exemple, le
dvouement qui va jusqu'au sacrifice de la vie ne peut s'expliquer par
aucun phnomne de sensibilit.
Cependant, mme en admettant avec ces rserves la thorie prcdente, il y aura toujours lieu de se demander s'il faut, comme le veut
M. Mallet, rserver le terme de passion cet tat particulier d'exaltation ou de dpression que nous venons de dcrire, et qui n'est que
l'tat extrme de nos inclinations, ou bien s'il ne vaut pas mieux de
conserver les traditions philosophiques d'Aristote, de Descartes, de
Spinoza, qui ne voient dans les passions que les diffrents modes ou
tats par lesquels passe l'apptit ou l'amour, c'est--dire la tendance
(ou les tendances) qui porte l'me vers certains objets et d'o sortent
ce que nous appelons les inclinations. Nous pensons qu'il vaut tou-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
476
jours mieux s'en tenir autant qu'on le peut la tradition en philosophie, tout en reconnaissant que l'tat passionn proprement dit trouve
dans la thorie prcdente un surcrot d'claircissement qui mrite de
lui faire sa place dans la psychologie.
Cela pos, nous admettons avec l'auteur le principe de l'enveloppement des forces, quoiqu'il ne nous paraisse pas aussi neuf qu'il le
semble l'auteur. Il nous dit qu'on a bien vu que les forces infrieures
contiennent en puissance les forces suprieures, mais non pas que les
forces suprieures contiennent galement elles-mmes en puissance
[524] les forces infrieures. Il ne nous semble pas que cette vue ait
chapp aux philosophes : car on sait bien que dans l'tre vivant les
forces physico-chimiques continuent exercer leur empire, et s'efforcent sans cesse de retourner l'indpendance ; que dans l'tre sensible
les proprits organiques subsistent et cherchent aussi exister pour
soi, et ainsi de suite jusqu' l'extrmit de l'chelle, o la raison ne
contient dans l'ordre les forces infrieures qu'en en ressentant perptuellement le contrecoup. Neuve ou non, cette vue est trs vraie, et il
est permis de dire que la passion est l'invasion, l'irruption, la rvolte
de ces forces infrieures contenues en bride dans l'tat normal. Mais il
ne faut pas oublier cependant que cette irruption se fait quelquefois au
profit du mieux, et qu'il y a des cas o ce sont plutt des forces suprieures mme l'tat rationnel, des facults en quelque sorte anticipes, qui font irruption dans notre tat d'quilibre pour le dpasser et
aller au del.
Pour cette raison nous ne voyons pas qu'il soit ncessaire de mler
la thorie de l'volution la thorie des passions. L'auteur prtend que
l'irruption de la passion est un phnomne atavique ; c'est le retour de
l'tat ancestral qui vient prendre sa revanche sur les tats suprieurs.
Mais cette hypothse est tout fait inutile. Il suffit, en effet, d'admettre qu'il y a dans chaque homme des facults plus ou moins leves, pour comprendre qu' un moment donn les infrieures viennent
dborder sur les suprieures. La question de l'origine de ces forces
reste tout fait en dehors. Il est d'ailleurs bizarre qu'un mme tat de
l'me soit ou ne soit pas ancestral suivant qu'il est plus ou moins violent. Par exemple, la crainte vient de mon pre ; la peur vient de mon
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
477
grand-pre. En outre, comme nous l'avons dit, ce sont quelquefois les
facults suprieures qui dbordent sur les infrieures, par exemple
dans le dvouement.
En rsum, il ne nous semble pas que la thorie prcdente doive
prvaloir sur la doctrine traditionnelle d'Aristote et de Descartes.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
478
[525]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE DEUXIME
LES PASSIONS
Leon VI
ANALYSE DES PASSIONS
Retour la table des matires
Messieurs,
Nous avons divis les laits de la sensibilit en deux classes : les inclinations et les passions. Pour ce qui concerne les inclinations, on en
trouvera le dveloppement dans tous les traits de philosophie, et notamment dans les cossais, dans le Trait des facults de l'me
d'Adolphe Garnier, et dans l'ouvrage de Bain, motions et Volont. 54
Nous laisserons donc de ct cette matire pour nous attacher surtout
la question des passions et reprendre, comme nous l'avons annonc,
le plus possible, les belles analyses de Descartes et des autres Cartsiens. Cette tude touche plus profondment la nature de la sensibilit : car, les inclinations se diversifiant par leurs objets, c'est une cause
de distinction plus extrieure, tandis que les passions sont les vritables lments de la sensibilit ; elles en expriment la vie interne, les
troubles fondamentaux, lesquels, comme nous l'avons dit, peuvent se
manifester dans toutes nos inclinations.
54
On trouvera le rsum de toutes ces tudes dans notre Trait lmentaire de
philosophie, partie I, section IV, chap. 1 et 2.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
479
Cela pos, pour entrer immdiatement en matire, demandonsnous avec Descartes quelle est la premire des passions. Ce serait,
suivant Descartes, l'tonnement ou l'admiration. (Passions, 2e partie,
531.)
Lorsque la premire rencontre d'un objet nous surprend, et que nous
le jugeons tre nouveau, cela fait que nous l'admirons et en sommes
tonns ; et pour ce que cela peut arriver avant que nous connaissions aucunement si cet objet [526] nous est convenable ou s'il ne l'est pas, il me
semble que l'admiration est la premire des passions.
Cette doctrine serait confirme si l'on admettait, avec M. de Hartmann, la dfinition suivante de la conscience, savoir : la stupfaction que la volont prouve quand elle se ddouble et revient sur ellemme . Il n'y a, en effet, rien de plus tonnant dans le monde que le
passage du nant l'tre. Mais on peut se demander si l'ide de la
nouveaut peut frapper celui qui n'a rien prouv encore. Nous transportons nos ides actuelles ce premier moment de notre vie ; nous
nous supposons tout coup passant du nant l'tre, et il nous semble
que nous avons d tre stupfaits de ce grand changement. Mais cet
tonnement rtrospectif n'en est un que pour nous et n'existe pas pour
le sujet lui-mme. Les faits nous apprennent au contraire que l'tonnement ne se produit qu'assez tard, la suite de nombreuses expriences. Le sauvage transport en pleine civilisation ne s'tonne pas et
n'admire rien. L'tonnement suppose toujours une facult de comparaison qui n'est pas la premire qui s'veille en nous. C'est donc une
doctrine plus thorique qu'exprimentale, qui fait commencer les passions par l'tonnement, plus forte raison par l'admiration au sens esthtique.
Bossuet a critiqu la doctrine de Descartes en essayant de ramener
l'tonnement aux passions antrieures : L'admiration ou l'tonnement, dit-il, comprennent en eux ou la joie d'avoir vu quelque chose
d'extraordinaire et le dsir d'en savoir les causes aussi bien que les
suites, ou la crainte que sous cet objet nouveau il n'y ait quelque pril
cach, et l'inquitude cause par la difficult de le connatre, ce qui
nous rend comme immobiles et sans action ; et c'est ce que nous appelons tre tonn Quelques-uns pourtant ont parl de l'admiration
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
480
comme de la premire des passions, parce qu'elle nat en nous la
premire surprise que nous cause un objet nouveau avant que de l'aimer ou de le har ; mais si cette surprise en demeure la simple admiration d'une chose qui parat nouvelle, elle ne fait en nous aucune
motion, [527] ni aucune passion par consquent ; que si elle nous
cause quelque motion, nous avons remarqu comme elle appartient
aux passions que nous avons expliques. (Connaissance de Dieu,
chap. I, 6.)
L'tonnement cart, la question est de savoir si la premire des
passions est l'amour, comme le veulent les Scolastiques, ou le dsir,
comme le prtend Spinoza. Mais les deux opinions sont facilement
conciliables.
Le dsir exprime une tendance ou un effort vers un objet absent
que l'on regarde comme un bien et dont on a dj joui ; il suppose
donc une passion antrieure, c'est--dire l'amour, qui est la passion par
laquelle nous nous unissons aux objets. D'un autre ct, nous avons vu
que le plaisir lui-mme suppose une inclination antrieure toute espce de plaisir, par exemple l'instinct de succion chez le nouveau-n.
Or cette inclination tendant vers un bien inconnu, par consquent absent, n'est-elle pas le dsir lui-mme, et l'amour ne nat-il pas de la
satisfaction du dsir ?
Spinoza lui-mme nous fournit la solution du problme, en disant
que le dsir n'est que l'apptit accompagn de conscience. Le fond de
toute passion est l'apptit, c'est--dire la tendance vers le bien, le besoin de s'unir un objet connu ou inconnu et que l'exprience nous
fera connatre comme agrable ou dsagrable. Or cette tendance est
la mme chose que ce que Bossuet appelle l'amour, c'est--dire la tendance s'unir quelque bien ; et, en tant que cet objet est absent, cette
tendance pourra s'appeler dsir aussi bien qu'amour.
Maintenant, si nous prenons le terme de dsir ou d'amour dans le
sens gnral et indtermin que nous venons de dire, l'amour et le dsir se confondent ; mais dans le sens prcis des mots, c'est--dire
comme mouvements accompagns de conscience, ces deux passions
ne nous paraissent tre ni l'une ni l'autre la passion primitive, et ce
rle peut tre plutt, comme le pense Malebranche, attribu la joie ;
car le premier effet de la satisfaction de l'instinct, c'est la joie, et c'est
de la joie que naissent l'amour et le dsir.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
481
[528]
Nous trouvons dans Thodore Jouffroy une analyse intressante de
ce premier mouvement de la sensibilit, analyse qui nous parat, dans
ce qu'elle a d'essentiel, pouvoir tre conserve en psychologie.
La sensibilit tant agrablement affecte commence par s'panouir
pour ainsi dire sous la sensation ; elle se dilate et se met au large, comme
pour absorber plus aisment et plus compltement l'action bienfaisante
qu'elle prouve ; c'est l le premier degr de son dveloppement. Bientt
ce premier mouvement se dtermine davantage et prend une direction. La
sensibilit se porte hors d'elle et se rpand vers la cause qui l'affecte
agrablement ; c'est le second degr. Enfin ce mouvement expansif finit
tt ou tard par en succder un troisime qui en est comme la suite et le
complment : non seulement la sensibilit se porte vers l'objet, mais elle
tend le ramener elle, se l'assimiler pour ainsi dire. Le mouvement
prcdent tait purement expansif ; celui-ci est attractif. Par le premier, la
sensibilit allait l'objet agrable ; par le second elle y va encore, mais
pour l'attirer et le rapporter elle : c'est le troisime et dernier degr de son
dveloppement.
La sensibilit dsagrablement affecte manifeste des mouvements
d'une nature tout fait contraire. Au lieu de s'panouir, elle se resserre ;
nous la sentons se contracter sous la douleur comme nous la sentions se
dilater sous le plaisir : la contraction est le premier mouvement qui suit la
sensation pnible. Mais ce premier mouvement ne tarde pas prendre un
caractre plus dcid : la sensibilit se resserre comme pour fermer passage la douleur ; elle fait plus : elle se dtourne et la fuit, et on la sent qui
se replie en elle-mme ; c'est la contraction oppose l'expansion. Puis,
bientt aprs et presque en mme temps, ce mouvement par lequel elle
semble se drober l'objet dsagrable se rattache un troisime et dernier
mouvement, le mouvement rpulsif, qui loigne et repousse cet objet et
qui correspond, en s'y opposant, au mouvement attractif.
[529]
Il est facile de reconnatre dans la dilatation et la contraction les deux
phnomnes opposs de la joie et de la tristesse, qui succdent immdiatement en nous au sentiment du plaisir et de la douleur ; dans l'expansion
et la contraction, les phnomnes galement opposs de l'amour et de la
haine ; dans le mouvement attractif, le dsir qui aspire la possession de
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
482
l'objet aim, et dans le mouvement rpulsif l'aversion, distincte de la
haine, en ce que la haine nous loigne de l'objet dsagrable, tandis que
l'aversion, ainsi que l'indique la force tymologique du mot, le dtourne et
le repousse. Joie et tristesse, amour et haine, dsir et aversion, tels sont les
mots populaires par lesquels on exprime les mouvements que nous avons
constats : dilatation et contraction, expansion et concentration, attraction
et rpulsion. 55
On peut sans doute dire que cette analyse n'est qu'une suite de mtaphores ; cependant sous ces mtaphores il y a des phnomnes psychologiques et physiologiques ; et Jouffroy les caractrise par les
symptmes qui les accompagnent dans nos organes. Il est certain que
la joie est accompagne d'un sentiment de dilatation au point de vue
physiologique. On respire plus librement ; on sent la poitrine s'ouvrir
et se dilater, au propre. C'est le contraire qui a lieu dans la tristesse :
c'est un phnomne contraction. On ne contestera pas non plus les
deux derniers termes : le dsir est attractif, l'aversion est rpulsive. En
effet, le dsir tend rapprocher l'objet de nous. En face d'un beau
fruit, nous sommes tents de le cueillir et de l'apporter nos lvres. Si
nous trouvons un objet dgotant, nous le rejetons avec horreur. Restent les deux nouveaux intermdiaires, l'expansion et la concentration.
Or l'expansion correspond ce que les Scolastiques appelaient la volont de s'unir son objet ; le terme de concentration n'est peut-tre
pas aussi heureux pour exprimer la haine. Mais en supposant qu'elle
soit quelque chose de plus, elle est au moins cela, savoir une concentration [530] sur elle-mme. L'me se resserre et rentre en ellemme devant l'objet ha.
En tout cas la doctrine de Jouffroy va se confondre avec celle des
Scolastiques, et les six mouvements primitifs de la sensibilit sont les
six passions primitives de saint Thomas : joie et tristesse, amour et
haine, dsir et aversion. Descartes n'admettait aussi, comme les Scolastiques, que six passions primitives ; seulement il y ajoutait l'admiration et en retirait l'aversion. Malebranche comme Spinoza n'admettent
que trois passions primitives : le dsir, la joie et la tristesse. Cela n'est
vrai que si l'on entend par dsir l'apptit en gnral ou penchant primitif et spontan de l'me vers les objets : mais, dans ce sens, le dsir
55
Mlanges philosophiques, p. 263.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
483
n'est pas une passion particulire ; il est la substance de toutes les passions. Que si au contraire on entend le dsir dans son sens propre,
comme tendance consciente vers le bien absent, il se distingue de
l'amour, et l'un et l'autre ont leurs contraires, aussi bien que la joie et
la tristesse : et si ce ne sont pas des passions absolument simples,
parce qu'il y entre un lment intellectuel, toujours est-il que ce sont
les premires de toutes les passions. tudions-les plus en dtail.
Et d'abord qu'est-ce que la joie et la tristesse ? Descartes dfinit la
joie de la manire suivante : 56
La joie est une agrable motion de l'me, en laquelle consiste la
jouissance qu'elle a du bien que les impressions du cerveau lui reprsentent comme sien Je dis les impressions du cerveau, afin de ne pas confondre cette joie qui est une passion, avec la joie purement intellectuelle
qui vient en l'me par la seule action de l'me Il est vrai que, pendant
que l'me est jointe au corps, cette joie intellectuelle ne peut gure manquer d'tre accompagne de celle qui est une passion
On voit que pour Descartes il y a deux espces de joie : la joie sensible qui vient des mouvements du cerveau, et la joie [531] intellectuelle qui vient de l'entendement et qui ne serait point une passion.
C'est ainsi que les Stociens distinguaient qui est une passion, de
l' ; qui n'en est pas une. Mais cette distinction peut avoir
lieu dans toutes les passions, et elle vient plutt de la diffrence des
objets que d'une diffrence vritablement subjective. Dans les sens
comme dans l'esprit, la joie est une motion agrable cause par la
jouissance du bien. Descartes ne veut donner le nom de passion qu' la
joie et la tristesse sensibles : ce n'est plus l qu'une question de mots.
Mais pourquoi ne pas donner le mme nom deux motions toutes
semblables, quoiqu'elles drivent de causes diffrentes ? et cela d'autant plus que, suivant Descartes, la joie intellectuelle ne va jamais sans
quelque joie sensible. Il en est de mme rciproquement pour la tristesse : Descartes donne pour exemple de joie le sentiment de gaiet
qu'on prouve quand on est en bonne sant ou par un temps serein. Il
distingue la joie du plaisir et la tristesse de la douleur : ce qui le
56
Voir Descartes, Trait des passions, II, 91-93.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
484
prouve, c'est qu'on peut souffrir des douleurs avec joie et des chatouillements qui dplaisent.
Spinoza entre plus avant dans l'essence de la joie et de la tristesse.
L'essence de toutes les passions est, nous l'avons dit, l'apptit ou effort
de l'me pour conserver et tendre son tre ; et il distingue deux sortes
de passions suivant que la puissance d'agir de l'me est augmente et
diminue , ou que l'me passe d'une perfection moindre une perfection plus grande . De l cette double dfinition de la joie et de la
tristesse : La joie est une passion par laquelle l'me passe une perfection plus grande, et la tristesse une passion par laquelle elle passe
une perfection moindre.
Passons l'amour et la haine.
Nous avons dit que l'amour, dans son sens le plus gnral, aussi
bien que le dsir, peut-tre considr comme la substance de toutes les
passions ; mais, pris au propre, il est lui-mme une passion particulire. Il est, comme dit Jouffroy, l'expansion de l'me vers ce qui lui
cause de la joie , l'acte par lequel l'me se complat dans son
objet , [532] conquiescentia in objecto, comme disaient les Scolastiques, en un mot l'abandon de soi-mme dans l'objet aim. Spinoza
dit que ce qui caractrise l'amour, c'est la joie accompagne de l'ide
de la cause externe . Pourquoi externe ? N'y a-t-il pas quelque autre
chose dans l'amour ? N'est-ce qu'une ide et n'est-ce pas aussi un
mouvement ? Et ce mouvement ne doit-il pas tre distingu de celui
qui accompagne le dsir ? On peut aimer sans dsirer, par exemple
aimer le bien sans en dsirer la possession. Il y a donc l un caractre
intrieur qui distingue l'amour du dsir. C'est ce que Jouffroy appelle
l'expansion. Spinoza reconnat que c'est un des caractres de l'amour
de vouloir s'unir son objet ; mais, dit-il, ce n'est, l qu'une proprit
de l'amour ; ce n'est pas son essence. Au contraire, il nous semble
que c'est l prcisment l'essence de l'amour, et que la dfinition de
Spinoza n'est qu'une dfinition nominale. On dira peut-tre que c'est l
le caractre de l'amour des personnes, et non de l'amour des choses ;
mais il nous semble au contraire que, quelle que soit la nature de
l'amour, il s'abandonne toujours dans son objet. Dans le jeu, le joueur
se livre la fortune ; l'avare se perd en quelque sorte dans son or, le
dbauch dans l'objet de ses dsirs.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
485
Descartes distingue trs bien l'amour du dsir : Au reste, par le
mot de volont (par lequel il a caractris l'amour) je n'entends pas
parler ici du dsir, qui est une question part qui se rapporte l'avenir, mais du consentement par lequel on se considre ds prsent
comme joint ce qu'on aime. 57
N'est-ce pas l prcisment ce que Jouffroy appelle l'expansion ?
Aimer, n'est-ce pas s'pancher vers l'objet aim et ne faire qu'un avec
lui, ce qui peut avoir lieu mme lorsque l'objet est prsent et est actuellement possd, ce qui le distingue du dsir ?
Il est plus facile de distinguer l'amour du dsir, que la [533] la
haine de l'aversion. Descartes, qui reconnat un contraire l'amour,
n'en reconnat pas au dsir ; il ne compte donc pas l'aversion parmi les
passions primitives, par cette raison que c'est un mme mouvement
qui porte la recherche du bien et la fuite du mal . Mais ne peut-on
en dire autant de la haine ? Car, comme le dit Bossuet, je ne hais la
maladie que parce que j'aime la sant . On peut dire, sans doute, que
les deux mouvements sont insparables ; mais cela est aussi vrai pour
la haine que pour l'aversion. La vraie question est donc de savoir si la
haine se distingue de l'aversion. Descartes lui-mme semble admettre
l'aversion sous le nom de dsir qui nat de l'horreur. Quant Spinoza,
il confond l'aversion avec l'antipathie (rpulsion sans cause connue) ;
ce n'est pas la mali fuga des Scolastiques. L'aversion n'est en ralit
qu'un degr de la haine, comme le dsir est un degr de l'amour ; c'est
l'effort de l'me pour s'loigner de l'objet ou loigner d'elle l'objet dont
elle est dj spare par la volont. Jouffroy explique assez bien ce
double mouvement par les termes de concentration et de rpulsion.
On pourrait peut-tre laisser ici de ct la distinction scolastique
de l'amour de bienveillance et l'amour de concupiscence, parce que
cette distinction porte plutt sur l'objet que sur le sujet, et se rapporte
plutt par consquent aux inclinations qu'aux passions ; mais elle tient
aussi l'essence de l'amour : elle rentre donc dans notre question.
Les Scolastiques distinguaient deux amours : l'amour par lequel on
veut faire du bien ce qu'on aime (amour de bienveillance), l'autre par
lequel on se veut du bien soi-mme par la possession de l'objet aim
(amour de concupiscence). Dans ces deux cas, l'me est unie son
57
Trait des passions, II, 79-80.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
486
objet. Mais dans le premier, c'est elle-mme qui s'unit l'objet ; dans
l'autre cas c'est l'objet qu'elle unit elle. Descartes rejette celle distinction, (II, 81.)
Il me semble, dit-il, que cette distinction regarde seulement les effets
de l'amour et non point son essence ; car sitt qu'on s'est joint de volont
quelque objet, de quelque [534] nature qu'il soit, on a pour lui de la bienveillance, c'est--dire qu'on joint aussi lui de volont les choses qu'on
croit lui tre convenables, ce qui est un des principaux effets de l'amour.
(II, 81.)
Nanmoins, Descartes lui-mme ne revient-il pas la distinction
conteste, lorsqu'il dit : Les premiers (l'avare, l'ambitieux, l'ivrogne,
le brutal) n'ont d'amour que pour la possession des objets auxquels se
rapporte leur passion, et n'en ont point pour les objets mmes ; car,
bien que l'amour qu'un bon pre a pour ses enfants soit si pur qu'il ne
dsire rien avoir d'eux, mais, les considrant comme d'autres luimme, il recherche leur bien comme le sien propre ? (II,82.)
N'est-ce pas l, en effet, revenir ce que disait dj Aristote, savoir que l'on ne veut pas du bien au vin en le buvant, ni l'or en le
mettant dans sa caisse ? Aussi n'appelle-t-il du nom de que
l'amour dsintress, et rserve-t-il l'autre le nom de . Or
c'est l ce que voulaient exprimer les Scolastiques dans leur distinction des deux amours.
Restent le dsir et l'aversion, dont la nature rsulte dj de tout ce
que nous avons dit. Descartes reconnat que le caractre propre du dsir se rapporte l'avenir ; mais par cela mme il se rapporte quelque
chose d'absent ; car l'avenir est toujours absent (mme lorsqu'on parle
de la conservation d'un bien prsent). Les Scolastiques avaient donc
raison de dire que le bien, dans le dsir, est considr sub ratione absentis.
On peut se demander avec Spinoza si c'est le bien qui fonde le dsir, ou le dsir qui fonde le bien.
C'est probablement la mme question que Molire a tourne en ridicule dans le Mariage forc, savoir : Le bien. rside-t-il dans
l'apptibilit ou dans la convenance ? En un sens, le dsir est ant-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
487
rieur ; en un autre sens, il est postrieur au bien. Le dsir conscient se
porte vers un bien jug tel, ignoti nulla cupido ; il est donc postrieur
au bien. Mais [535] le dsir inconscient, l'apptit, est antrieur ; et en
ce sens on peut dire que le bien, c'est ce qui satisfait au dsir. Mais
dans ce cas-l mme, faut-il dire que c'est le dsir qui fonde le bien ?
Sans doute il est antrieur la conscience du bien, mais non pas au
bien lui-mme. Car la raison du dsir, c'est la conservation de l'tre :
c'est cette conservation qui est le bien. C'est donc, suivant Spinoza luimme, en tant qu'une chose augmente notre tre que nous la dsirons,
et au fond le bien est non dans l'apptibilit, mais dans la convenance.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
488
[536]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE DEUXIME
LES PASSIONS
Leon VII
ANALYSE DES PASSIONS
(SUITE)
Retour la table des matires
Messieurs,
Nous avons tudi dans notre dernire leon les six passions fondamentales. Nous passons aujourd'hui aux passions drives.
Les deux premires qui se prsentent aprs le dsir et l'aversion
sont l'esprance et la crainte. Voici comment Descartes les dfinit
l'une et l'autre :
L'esprance est une disposition de l'me se persuader que ce qu'elle
dsire adviendra, laquelle est cause par un mouvement particulier des esprits, savoir par celui de la joie et du dsir mls ensemble. La crainte est
une autre disposition de l'me qui lui persuade qu'il n'adviendra pas ; et il
est remarquer que, quoique ces deux passions soient contraires, on les
peut nanmoins avoir toutes deux ensemble, savoir lorsqu'on se reprsente en mme temps diverses raisons dont les unes font juger que l'ac-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
489
complissement du dsir est facile, et les autres le font paratre difficile. 58
Descartes dit avec raison que l'esprance est un mlange de la joie
et du dsir. Ce n'est pas que dans le dsir mme il n'y ait dj quelque
joie, au point que le pote a pu dire : Dans la jouissance, je regrette
le dsir ; 59 mais la joie du dsir est douloureuse, parce qu'elle est
accompagne du sentiment vif de la privation de son objet ; mais lorsque, par l'imagination, on a cart l'ide de l'obstacle qui nous spare
du bien, et que l'on imagine l'objet possd au lieu de l'objet absent,
[537] il y a l une joie nouvelle et que ne connat pas le dsir tout seul,
si ce n'est que dans le dsir il y a toujours une certaine esprance, car
il est inconciliable avec le dsespoir : quand il n'y a plus rien esprer, on ne dsire plus.
Descartes dit que l'esprance peut s'unir la crainte ; il faut aller
plus loin et dire qu'il n'y a pas d'esprance sans quelque crainte ; car
l'esprance est toujours mle de quelque doute, autrement c'est la scurit. Aussi La Roche Foucauld a-t-il dit : L'esprance et la crainte
sont insparables ; il n'y a pas d'esprance sans crainte, ni de crainte
sans esprance.
Spinoza donne une dfinition de l'esprance analogue celle de
Descartes, mais plus concise : L'esprance est une joie mal assure
ne de l'image .d'une chose future ou passe, dont l'arrive est pour
nous incertaine. 60 Et rciproquement : La crainte est une tristesse
mal assure ne aussi de l'image d'une chose douteuse. 61
On voit que cette dfinition se distingue de celle de Descartes en ce
que Descartes fait entrer le dsir dans l'ide de l'esprance, tandis que
Spinoza n'y met que la joie. Il est vrai que l'esprance d'un bien en
suppose l'amour et, comme ce bien est absent, le dsir ; mais ce dsir
est en quelque sorte sous-entendu ; il se joint l'esprance, mais il
n'en fait pas partie. L'esprance en elle-mme n'est pas un dsir et ne
contient que de la joie ; on peut mme esprer un bien que l'on dsire
58
Trait des passions, CLXV.
Faust.
thique, 1. III, appendice XII.
61 Ibid., XIII.
59
60
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
490
peu, et dsirer vivement un bien que l'on n'espre pas, pourvu que,
bien entendu, l'on n'aille pas jusqu'au dsespoir.
En un mot, l'esprance est un amour portant, comme le dsir, sur
un bien absent, mais en y joignant, comme disaient les Scolastiques,
l'ide de la difficult (sub ralione ardui), ce qui la faisait joindre d'une
manire assez bizarre l'apptit irascible. Seulement l'ide de la difficult il faut joindre encore, non seulement, comme pour le dsir,
l'ide [538] de la possibilit, mais mme de la probabilit ; car s'il n'y
a pas plus de chance d'obtenir le bien dsir que de ne pas l'obtenir,
c'est plutt la crainte qui l'emporte que l'esprance.
De toutes nos passions, l'esprance est une des plus potiques et
sur lesquelles on a crit les choses les plus ingnieuses et les plus
agrables. Quelle jolie chose que l'esprance ! disait Mme de Svign. Il est certain que l'esprance est un des plus grands soulagements
de la vie : elle soulage les maux prsents, et console des maux passs ;
elle voile les maux futurs. Mais ces considrations tiennent plutt ce
que l'on appelle l'usage des passions qu' leur essence, et ce n'est qu'
leur essence que nous avons affaire prsent.
Nous avons vu que Descartes et Spinoza sont d'accord pour unir
l'une l'autre, comme on le fait dans la vie, l'esprance et la crainte.
Mais les Scolastiques, ayant besoin, dans leurs tableaux, d'une passion
qui s'oppost l'audace, avaient rserv cette place la crainte, et en
face de l'esprance ils plaaient comme oppos le dsespoir. C'tait l
une faute vidente. Le dsespoir accompagn toujours de certitude ne
peut s'opposer l'esprance qui est toujours mle d'incertitude. Le
dsespoir s'oppose la scurit et non l'esprance. Quant la
crainte, qui est le contraire de l'audace, c'est une autre espce de
crainte que celle qui s'unit l'esprance. Spinoza a raison de distinguer l'une de l'autre et de dsigner la seconde sous le nom de timor,
qui est un dsir d'viter par un moindre mal un mal plus grand que
nous redoutons . 62 L'autre crainte (metus) qui s'oppose l'esprance
est une tristesse mal assure ne de l'image d'une chose douteuse .
l'esprance et la crainte se rattache un sentiment que je ne vois
pas mentionn par nos auteurs, mais qui est cependant bien rel et
bien puissant. C'est ce que j'appelle le sentiment de l'attente. On peut
62
thique, liv. III, proposition xxx, scolie.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
491
dire que c'est un mlange d'esprance et de crainte ; mais c'est surtout
l'impatience du [539] temps, c'est--dire la souffrance d'tre oblig de
subir la loi du temps avant que tel vnement n'arrive. En gnral, ce
sentiment est douloureux. Qui ne se rappelle l'attente du mdecin prs
d'un enfant malade, l'attente du rveil de ce mme enfant, l'attente
d'un succs ncessaire la carrire pour l'ambitieux, l'attente de la
personne aime pour l'amant, l'attente de la carte dsire pour le
joueur. Il y a aussi une attente moins douloureuse, et qui souvent vaut
mieux que le bien lui-mme : c'est l'attente d'un bien certain, l'attente
d'un voyage dsir, l'attente d'un bal pour la jeune fille, ou des prix
pour le jeune enfant, etc. Tout cela est bien un mlange d'esprance et
de crainte, mais en y joignant le sentiment vif du temps.
Si maintenant de l'esprance et de la crainte nous retranchons le
doute, nous avons la scurit et le dsespoir. Les dfinitions de ces
deux passions sont un peu vagues dans Spinoza : Ce sont, dit-il, les
joies ou tristesses nes de l'image d'une chose qui nous ont inspir
crainte ou esprance. Celles de Descartes sont plus prcises :
Lorsque l'esprance est si forte qu'elle chasse entirement la crainte,
elle se nomme sincrit ou assurance ; tout de mme lorsque la crainte
est si extrme qu'elle te tout lieu l'esprance, elle se convertit en
dsespoir ; et ce dsespoir teint entirement le dsir. 63
Toutes les passions prcdentes se rapportent l'avenir ou au prsent. Considrons maintenant celles qui ont rapport au pass. Il n'y en
a gure qu'une qui ait reu un nom spcial : c'est le regret. Quant
son oppos, il n'a pas reu de nom spcial ; on pourrait l'appeler la joie
du souvenir. Le regret, comme le dsir, suppose l'absence du bien ;
mais c'est l'absence dans le pass, au lieu de l'absence dans l'avenir ;
c'est d'un bien dont nous avons joui, au lieu d'un bien dont nous voulons jouir. Descartes le dfinit ainsi :
Le regret est une espce particulire de tristesse, laquelle [540] a
une particulire amertume en ce qu'elle est toujours jointe quelque
dsespoir et la mmoire des plaisirs que nous a donns la jouissance ; car nous ne regrettons jamais que les biens dont nous avons
joui. 64 Ce dernier fait peut tre mis en doute. On peut regretter de
n'avoir pas joui d'un bien que l'on dsirait, aussi bien que l'on regrette
63
64
Passions, CL, t. VI.
Passions, CCIX.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
492
la perte du bien dont on a joui. C'est une sorte de dsir rtrospectif. 65
Par exemple, celui qui a eu une enfance malheureuse regrette les biens
dont il voit jouir autour de lui les enfants heureux. Le regret est donc
une sorte de dsir du pass. C'est aussi de cette manire que Spinoza
le dfinit : Le regret, dit-il, c'est le dsir ou l'apptit de la possession
d'une chose, lequel est entretenu par le souvenir de cette chose et en
mme temps empch par le souvenir d'autres choses qui excluent
l'existence de celle-l. 66
Voici comment Spinoza fait entrer le dsir dans le sentiment du regret. L'ide d'une chose rveille toujours en nous la mme passion que
lorsque cette chose est prsente. Par exemple, l'ide de la jeunesse ne
peut se prsenter nous sans exciter la joie cause par cet objet, et par
consquent une sorte de dsir ; mais en mme temps nous nous reprsentons toutes les causes qui excluent pour nous cet objet, savoir
l'ge et le cours inflexible du temps ; nous prouvons donc de la tristesse, et c'est cette tristesse que l'on appelle regret. Le mot desiderium
par lequel on exprime ce sentiment prouve bien l'affinit du dsir et du
regret. On peut dire que c'est un dsir empch.
Spinoza oppose aussi la tristesse qui nat de la pense des biens
passs, la joie que nous prouvons de la dlivrance des maux passs. 67
[541]
Indpendamment de ce plaisir de contentement et de scurit qui
rsulte du souvenir des maux passs, dont nous sommes actuellement
dlivrs, il y a un plaisir spcial qui s'attache au fait mme du souvenir. Quand nous pensons au pass, aussi bien mme aux maux qu'aux
biens, il y a un plaisir propre qui ne va pas sans tristesse ; car il s'y
joint toujours l'ide de quelque chose de disparu sans retour. C'est
pourquoi cette sorte de plaisir est appel mlancolique. Les potes ont
souvent chant cette amertume des souvenirs. Le Lac, la Tristesse
d'Olympio, sont des chants immortels pntrs d'une motion douloureuse. Cependant ce qui prouve que ce n'est pas l une pure tristesse,
65
Dans la Phdre de Racine :
Hlas ! du crime affreux dont la honte me suit
Jamais mon triste cur n'a recueilli le fruit.
66 thique, III, appendices XXXII.
67 Ibid., prop. XLVIII, scolie.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
493
c'est le plaisir que l'on prouve revoir les lieux o s'est coule notre
vie passe. Nous aimons retrouver les amis de notre enfance et de
notre jeunesse, et nous entretenir avec eux de tout ce qui a disparu.
Cette facult de revenir sur le pass et d'en jouir aprs coup est un des
effets de la culture intellectuelle. Les esprits simples y sont moins sensibles ; ils sont tout entiers au prsent.
On peut encore, parmi les passions qui se rapportent au pass,
compter le dsir de la vengeance, c'est--dire une colre excite par le
souvenir des maux que quelqu'un nous a faits ; mais cela rentre dans
la passion de la colre, dont nous parlerons plus loin.
Quant aux autres passions que le philosophe cossais Thomas
Brown appelle rtrospectives, il ne les obtient qu'en les mlant aux
inclinations : par exemple la reconnaissance, qui est un sentiment d'affection pour celui qui nous a fait du bien ; la satisfaction morale, le
remords, le repentir, sont des sentiments sui generis qui ont rapport au
bien moral et qui ne sont pas les modes des inclinations. Sans doute le
joueur et l'ambitieux peuvent se repentir ; mais ce n'est pas en tant que
joueurs ou ambitieux, c'est en tant qu'hommes, dous du sentiment
moral. Peut-tre cependant la reconnaissance pourrait-elle tre considre comme le contraire de la colre ; mais cela ne s'appliquerait pas
tous les cas.
[542]
Toutes les passions prcdentes s'expliquent par l'intervention des
ides qui viennent se joindre au fait du plaisir et de la douleur. Ce
sont : l'ide du bien et du mal, de la prsence ou de l'absence, du pass
et du futur, du facile et du difficile. Si nous ajoutons encore un lment, savoir l'ide de la nouveaut, nous avons la passion laquelle
Descartes attachait une si grande importance, savoir l'tonnement.
Spinoza rattache le sentiment de l'admiration ou de l'tonnement
l'association des ides, et c'est pourquoi il rattache l'admiration
l'intelligence et ne la compte pas au nombre des passions : c'est une
question examiner.
Sans doute il se mle l'tonnement beaucoup d'lments intellectuels. Cependant on ne peut nier qu'il n'y ait une certaine motion particulire attache l'apparition d'un objet nouveau, extraordinaire et
inattendu. On pourrait se demander si ce ne serait pas l une inclina-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
494
tion particulire, ou si c'est une passion dans le sens prcis que nous
avons attach ce mot. Il nous semble que oui, car l'tonnement a ce
caractre de pouvoir s'appliquer toutes nos inclinations : l'ambitieux
peut tre tonn des obstacles qu'il rencontre ; le joueur, de la mauvaise veine qui le poursuit ; l'amoureux, de la trahison de sa matresse,
etc. Toutefois, lorsque l'tonnement devient l'admiration, c'est--dire
le sentiment excit par la vue du beau et du sublime, il rentrera plutt
dans la catgorie des sentiments esthtiques, c'est--dire des inclinations.
On peut encore, avec Spinoza, distinguer l'tonnement en prsence
du bien et l'tonnement en prsence du mal. Dans ce second cas,
l'tonnement se joint la peur et devient un sentiment mixte que Spinoza dsigne sous le nom de consternation.
L'ide du difficile et celle de la nouveaut se transforment facilement en celle du danger. De l deux motions nouvelles : l'audace et
la peur.
Le danger est la menace d'un mal ; la prsence du mal veille en
nous la haine du mal, et avec cette haine le dsir [543] de le dtruire et
de faire qu'il n'existe pas. Or, on peut faire disparatre le mal de deux
manires, soit en allant au-devant pour l'anantir, soit en l'vitant.
Dans le premier cas, il est supprim par nous ; dans le second cas,
nous nous drobons lui. Le premier a lieu lorsque l'amour du bien
dsir est plus fort que la haine du mal : cet amour alors nous pousse
dtruire le mal qui s'oppose notre bien. C'est ce qu'on appelle l'audace. Lorsque, au contraire, nous avons plus de haine pour le mal que
d'amour pour le bien, nous cherchons nous soustraire au mal par la
fuite ; c'est ce qu'on appelle la peur, timor, pavor. Le mal en tant qu'il
nous menace s'appelle le pril. L'audace est donc la recherche du pril,
et la peur la fuite du pril.
On peut se demander si l'audace est une passion, ou si ce n'est pas
plutt une vertu qui a rapport au domaine de l'activit plus qu' celui
de la sensibilit. Mais l'audace n'est pas proprement parler une action ; c'est une impulsion qui pousse l'action ; elle n'appartient donc
pas au domaine de l'activit proprement dite. D'un autre ct, ce n'est
pas une vertu en tant qu'elle est une motion naturelle, mais seulement
lorsque la rflexion et la volont viennent s'y joindre. L'audace,
comme passion, fait partie du caractre. Il y a des hommes naturelle-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
495
ment audacieux avant toute ide de devoir et de vertu. Les enfants
sont audacieux parce qu'ils ne mesurent point le pril ; mais ils aiment
braver les obstacles.
Descartes dfinit l'audace d'une manire un peu vague ; mais il fait
justement remarquer que l'audace ne va pas sans quelque esprance. 68
Il distingue aussi le courage comme passion du courage comme vertu,
et enfin le courage comme inclination naturelle ; car, dit-il, dans la
passion il y a toujours quelque agitation des esprits ; mais qui prouve
que dans l'inclination naturelle elle-mme il n'y ait pas aussi quelque
agitation des esprits ? [544] Spinoza, avec raison, fait entrer dans la
dfinition de l'audace un lment nouveau, la comparaison.
En quoi maintenant la peur oppose l'audace (timor) se distinguet-elle de la crainte oppose l'esprance (metus), distinction, nous
l'avons vu, faite par Spinoza ?
La crainte est plutt une tristesse qu'un mouvement actif : par
exemple, la crainte de la mort. Mais la prsence d'un danger veille en
nous le dsir actif de l'viter. C'est la peur. On peut dire aussi, si l'on
veut, que c'est la mme chose deux points de vue diffrents : dans le
premier cas, au point de vue de l'ventualit et de la probabilit ; dans
le second cas, au point de vue du facile ou du difficile.
Quoique, en principe, l'audace ait pour raison d'tre la ncessit de
braver un pril pour conqurir un bien, par le fait elle se limite souvent au pril considr en lui-mme et tout seul. Tel est alors l'amour
du danger comme tel : c'est une sorte de lutte avec la fortune, l'amour
du risque touchant la passion du jeu. C'est aussi l'amour de l'activit,
l'une des inclinations, et peut-tre l'inclination fondamentale du moi
envers lui-mme ; et en ce sens l'audace serait plutt une inclination
proprement dite qu'une passion dans le sens que nous avons donn
ce mot. On voit qu'il ne faut pas prendre trop la lettre la classification que nous sommes oblig de faire pour la commodit de l'tude.
Il faut encore distinguer la peur de l'aversion : car l'une et l'autre
peuvent se dfinir la fuite du mal, fuga mali ; mais l'aversion n'a rapport qu'au mal en gnral, et la peur au difficile et au prilleux.
L'aversion peut se joindre l'audace. Elle se distingue donc de la peur.
68
Passions, CLXXI et CLXXIII.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
496
Descartes distingue la lchet de la peur. L'une est une langueur
et une froideur , tandis que l'autre est un trouble et un tonnement . 69 Mais la vraie diffrence est que l'une est un tat particulier
de l'me, l'autre est une habitude ; l'une est une passion, l'autre est un
vice. [545] Or les passions sont des mouvements naturels plus ou
moins ncessaires ; mais on peut y rsister. On dit que les plus braves
n'vitent pas la peur au dbut de toutes les batailles, mais ils en triomphent et n'en ont que plus de courage. La lchet est un consentement
la peur.
Descartes, qui trouve un but toutes les passions, n'en trouve pas
la peur : C'est un excs de lchet, d'tonnement et de crainte qui est
toujours vicieux. Cependant on peut dire que la peur est un avertissement donn par la nature de ne pas braver les dangers inutiles ou
exagrs : car l'audace peut dgnrer en tmrit. C'est au reste ce
que Descartes lui-mme dit de la lchet, qu'il semble considrer
comme un fait lgitime, tandis qu'elle est au contraire l'excs et le vice
de la peur.
La dernire des passions signales par les Scolastiques est la colre. Elle se rattache, comme celles qui prcdent, l'ide de la difficult, car tout ce qui fait obstacle nos dsirs veille la colre.
En gnral, la colre est, comme le dit Spinoza, une haine qui
porte faire du mal l'objet de notre haine ; et si c'est ceux qui nous
ont dj fait du mal nous-mmes, c'est la vengeance . Car nous ne
pouvons nous reprsenter la cause de notre mal sans quelque sentiment de tristesse, et par consquent sans haine. Mais celui qui se
reprsente la destruction de ce qu'il hait prouve de la joie . Il prouvera donc le dsir de le dtruire, c'est--dire en gnral de lui faire du
mal ; et c'est cet effort de faire du mal l'objet de notre haine que Spinoza appelle la colre. 70
On pourrait dire que la colre ne consiste pas toujours vouloir du
mal quelqu'un. Par exemple, un homme d'un caractre violent qui se
met en colre contre sa femme et ses enfants ne veut pas toujours leur
faire du mal ; et mme dans son plus violent accs, s'il tait assur que
sa colre leur fit effectivement du mal, il se calmerait aussitt. Sans
69
70
Passions, CLXIX, 5, 6.
thique, p. XI, scolie.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
497
[546] doute, rpondra-t-on, la colre est trs souvent disproportionne
au mal que l'on veut produire, et mme elle est quelquefois strile
dans ses effets ; et l'homme en colre le sait bien. C'est tout simplement une satisfaction qu'il donne ses esprits animaux, et il n'est pas
mme une cause d'effroi pour ceux qui y sont habitus. C'est qu'alors
la colre est devenue une habitude, et s'est spare de ses effets. Il n'en
est pas moins vrai qu'en principe la colre est un dsir de faire du mal
ce qui fait obstacle la satisfaction de nos dsirs, et que si elle n'est
pas arrte par quelque cause, elle tend faire du mal. Chez les gens
de guerre, dit Malebranche, les esprits animaux tendent sans cesse se
prcipiter dans les muscles qui font remuer le bras.
Descartes distingue avec raison deux espces de colre : l'une qui
porte trs particulirement ce nom, et l'autre qui s'appelle le ressentiment ou la rancune. 71
Spinoza dit galement que la vengeance (vindicta) est la passion
qui nous porte rendre le mal pour le mal.
Enfin la passion qui nous porte faire le mal soit des indiffrents,
soit ceux qui nous aiment, sans en avoir reu du mal, est ce qu'on
appelle cruaut. Mais c'est l plutt un vice et une dpravation qu'une
passion. Ce sentiment extrme n'est nullement commun tous les
hommes, et il ne se joint point ncessairement toutes nos inclinations.
71
Passions, CCI.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
498
[547]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE DEUXIME
LES PASSIONS
Leon VIII
LA MCANIQUE DES PASSIONS.
SPINOZA.
Retour la table des matires
Messieurs,
Nous avons, dans les leons prcdentes, numr, dfini et analys nos principales passions. Cette numration n'est pas complte, et
nous pourrions encore la poursuivre et la dvelopper. Mais nous
craindrions de fatiguer votre attention en prolongeant trop longtemps
cette analyse purement descriptive et qui ne porte que sur des faits
particuliers. Nous sommes impatients d'arriver des considrations
plus gnrales.
Pour l'tude des passions que nous n'avons pas suffisamment tudies, nous renverrons aux auteurs. Par exemple, nous n'avons dit que
quelques mots de la colre ; on en trouvera une belle analyse dans la
Rhtorique d'Aristote et dans les Passions de Descartes. Nous citerons
encore la jalousie et l'envie, dont Descartes et Spinoza donnent d'intressantes descriptions. Nous avons distingu, d'aprs Spinoza, la peur
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
499
de la crainte. On trouvera une belle tude sur la Peur dans le livre ainsi intitul du docteur Mosso. 72
Il ne faut pas oublier non plus que, parmi les passions tudies par
Descartes et Spinoza, il en est un certain nombre qui rentreraient plutt dans l'tude des inclinations, parce qu'elles ont rapport des objets
dtermins. Spinoza dit lui-mme de ces passions (ambition, luxure,
ivrognerie, avarice) qu'elles ne sont que le dsir et l'amour diversifis par leur objet. Enfin il faut dire aussi avec Spinoza qu'il n'est
pas ncessaire de montrer toutes les complications des passions ;
[548] car toutes peuvent se combiner de tant de manires diffrentes
qu'il est impossible d'en fixer le nombre (prop. 59, scolie, de Affectibus), et ailleurs qu'il y a plus de passions que de mots pour les exprimer.
Nous laisserons donc de ct l'analyse et la description des passions, pour en tudier les lois et les conditions gnrales.
Il semble au premier abord que la passion soit le monde du dsordre et du chaos, que ce qui la caractrise ce soit prcisment l'absence de lois. C'est le contraire cependant qui est la vrit. Ce sont
prcisment, parmi les phnomnes de l'me, les passions qui, par leur
ressemblance avec les phnomnes naturels, sont, malgr leur mobilit, leur diversit infinie, les plus faciles rduire des lois gnrales.
C'est en tant que chose passionne que l'me est une partie de la nature, au lieu de s'y montrer reine et matresse. Leibniz a dit que l'me
est un automate spirituel. Il entendait par l que l'me est soumise un
dterminisme aussi rigoureux, quoique tout interne, que les phnomnes du corps. Non seulement on a assimil le dterminisme interne
des passions celui des phnomnes externes ; mais on a cru trouver
des analogies plus frappantes encore et d'une nature toute spciale
entre les lois de ce dterminisme et les lois du mouvement dans la nature. En un mot, la psychologie des passions a pu tre considre
comme une partie de la mcanique.
En effet, comme l'a dit Bossuet, les passions sont des mouvements.
Ce sont les mouvements qui nous portent vers les objets, ou qui
nous en loignent . Ce ne sont pas seulement des mouvements, ce
sont des impulsions qui nous sollicitent au mouvement ; et par cons72
Voir Bibliothque de philosophie contemporaine.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
500
quent on peut les appeler des forces, comme tout ce qui produit du
mouvement. En tant que forces, elles agissent les unes sur les autres,
elles sont en accord ou en conflit, elles l'emportent ou elles succombent ; elles sont ainsi soumises des lois qui ont donc de l'analogie
avec ce que l'on appelle en physique et en mcanique lois du mouvement. L'tude de ces lois dans [549] la passion s'appellera la mcanique ou la dynamique des passions. Ce sera aujourd'hui l'objet de
notre tude.
Deux penseurs surtout nous paraissent avoir t proccups de ce
point de vue de la mcanique des passions. L'un est Spinoza, dans le
3e et le 4e livre de l'thique. L'autre, moins connu comme philosophe
que comme rformateur et utopiste, est le clbre Ch. Fourier, l'inventeur du phalanstre, qui, plus proccup en gnral de l'organisation
sociale que de l'tude de l'esprit humain, n'en a pas moins eu des vues
trs ingnieuses sur la psychologie des passions. La thorie de Spinoza est une mcanique au sens propre du mot, c'est--dire fonde exclusivement sur le principe des causes efficientes. L'autre est une dynamique et repose surtout sur le principe des causes finales. L'une est
analogue la thorie impulsioniste de Descartes, l'autre la thorie
attractionniste de Newton. La premire est plus philosophique ; la seconde est pleine de fantaisie, mais elle contient des dtails ingnieux
et intressants.
Commenons par la thorie de Spinoza.
La thorie mcanique des passions dans Spinoza est vraie en ellemme indpendamment de son systme, et elle peut tre introduite
tout entire dans la philosophie gnrale presque sans en changer les
termes. Ce philosophe distingue en effet deux tats dans l'homme :
l'tat de nature et l'tat de raison ; le premier est l'esclavage, le second
la libert. Dans le premier tat, l'homme n'est gouvern que par ses
passions ; dans le second, il subordonne les passions la raison. La
mcanique des passions ne concerne l'homme qu'en tant qu'il est une
partie de la nature, et non en tant qu'il est en rapport avec Dieu, c'est-dire avec la raison. Nous n'avons pas ici nous demander en quoi
consiste la libert, si elle rside dans la raison et non dans la volont,
ou mme s'il y a une libert. Mais, considrant l'homme comme un
agent naturel, comme un tre vivant et sensible, les mouvements qui
se produisent dans son me sont dtermins par le plus ou moins de
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
501
force des passions, et ce sont ces [550] degrs de force que Spinoza
s'efforce de dterminer et de mesurer.
Il pose d'abord pour principe l'axiome suivant (thique, IV,
axiome) :
Il n'existe dans la nature aucune chose particulire qui n'ait au-dessus
d'elle une autre chose plus puissante et plus forte. De sorte qu'une chose
particulire tant donne, une autre plus puissante est galement donne
qui peut dtruire la premire.
En vertu de ce principe, on peut dire que l'homme, tant une partie
de la nature, ne peut, ce titre, se considrer part des autres : c'est
pourquoi il est capable de ptir, c'est--dire, dans le sens propre du
mot, qu'il est capable de passions.
Sans doute les passions (nous l'avons vu) ne sont pas exclusivement passives ; elles ont leur fond dans notre propre tre et dans l'activit primordiale qui le constitue ; mais cette activit n'est pas absolue.
La force par laquelle l'me persvre dans l'existence, et mme tend
au dveloppement de son tre, cette force est limite. l'thique, IV, prop.
3.)
Elle est associe d'autres forces, d'autres puissances que la
sienne, c'est--dire la totalit des causes extrieures dont la puissance la surpasse infiniment. L'homme n'est donc pas un empire
dans un empire . La force dont il dispose passagrement en tant
qu'tre vivant et passionn n'est qu'une partie de l'activit universelle.
En tant que force, elle est active, et l'action est mme son essence ;
mais en tant qu'elle est une chose particulire, ce que Spinoza exprime
en disant : En tant qu'elle a des ides inadquates, elle est limite,
par consquent elle ptit ; et, ce point de vue, les passions [affectus)
sont, au sens propre, des passions [passiones).
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
502
Il suit de l que la force des passions se mesure, non seulement par
notre effort propre, mais par le rapport de cet effort avec celui des
causes extrieures.
La force et l'accroissement de telle passion, et le degr [551] o elle
persvre dans l'tre ne se mesure point par la puissance avec laquelle
nous faisons effort pour persvrer dans l'existence, mais par le rapport de
la puissance de telle ou telle cause extrieure avec notre puissance
propre. 73
La force des passions est donc toute relative. Deux lments s'y
mlent et s'y font sans cesse contrepoids : 1 d'une part l'essence intrieure de l'homme par laquelle il se dfend en quelque sorte contre
toute cause extrieure, et aspire durer et s'accrotre : c'est l'actif de
la passion ; 2 l'influence de toutes les forces avec lesquelles l'homme
est en rapport, commencer par son organisme : c'est le passif de la
passion.
De l il rsulte deux consquences :
1 Lorsque l'ensemble des causes extrieures qui dtermine
en nous une passion, l'emporte sur notre propre force, cette
passion s'attache lui d'une manire invincible et irrsistible. 74
2 Cette passion ne pourra tre vaincue et modifie que par
une passion plus forte. 75
Ainsi, dans le domaine de la nature, le seul principe dominant c'est
le principe de la force. Le mobile le moins fort cde infailliblement et
irrsistiblement au mobile le plus fort. L'homme est le jouet de la nature. Il ne s'appartient pas lui-mme.
73
74
thique, IV, prop. 5.
Ibid., prop. 6.
75 Ibid., prop. 7.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
503
Voyons maintenant quels sont les lments qui constituent la force
des passions. Voici les principaux thormes auxquels Spinoza ramne ce mcanisme.
1 L'objet prsent a plus de force que l'objet absent : 76
La passion dont on imagine la cause comme prsente est plus forte
que si on imaginait cette cause comme absente.
En effet, l'action d'une chose prsente est toujours (toutes choses
gales d'ailleurs) plus forte que l'action de la mme cause reprsente.
C'est ce qui a fait dire aux Anglais que [552] les sensations sont des
tats forts, et les images des tats faibles, l'image n'tant, disent-ils,
que la rptition du mouvement primitif dans l'absence de la cause.
Cependant la loi prcdente n'est pas toujours vraie ; et nous pouvons prouver quelquefois plus de plaisir la chose reprsente qu'
la chose relle. Aussi avons-nous dit : toutes choses gales d'ailleurs.
C'est ce qui peut arriver lorsque l'imagination a cart de certains objets les parties dplaisantes pour ne conserver que les parties
agrables, ou encore parce que nous associons l'ide dudit objet telle
autre ide qui ne lui est pas ncessairement jointe, et que la ralit
dment. Par exemple, nous nous reprsentons un site enchanteur que
nous avons vu dans notre jeunesse ; nous avons un ardent dsir de le
revoir ; et cependant, lorsque nous sommes arrivs satisfaire notre
dsir, la prsence de l'objet nous laisse froids. C'est que nous avons
oubli tels ou tels dtails qui nous gtent l'effet de l'ensemble, ou encore que nous avons li cet objet quelque sentiment qui n'en fait pas
partie, par exemple les moments heureux que nous y avons passs, ou
enfin parce que l'loignement mme prte aux choses un vague de
contours qui est par lui-mme quelque chose de sduisant, comme, par
exemple, les arrire-plans des montagnes ont un attrait que n'a pas
l'aspect immdiat de celles qui nous touchent de prs. Nanmoins il
n'est pas moins vrai, d'une manire gnrale, que la prsence des ob-
76
Ibid., prop. 9.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
504
jets dterminera une passion plus forte. De l ce conseil pratique :
pour gurir une passion, il faut s'loigner de l'objet qui la cause.
2 Loi du futur et du pass :
L'image d'une chose future ou passe tant (toutes choses gales
d'ailleurs) plus faible que l'image d'une chose prsente, toute passion qui a
pour objet une cause future passe est plus faible qu'une passion dont l'objet existe actuellement. 77
[553]
Par exemple, la passion qu'un homme de lettres peut prouver pour
une hrone passe, telle que celle de M. Cousin pour Mme de Longueville, ne sera jamais qu'un jeu ct d'une passion pour une personne
actuellement existante. De mme aussi l'image d'un mal futur ne peut
prvaloir contre la passion du moment.
3 Troisime loi : loi du futur prochain et du pass rcent.
Nous sommes plus affects d'une chose future que nous nous reprsentons comme prochaine, que si nous imaginions son existence comme
loigne ; et le souvenir d'une chose rcente nous affecte avec plus de
force que si nous imaginions qu'elle est disparue depuis longtemps. 78
Il y a des degrs dans le futur et dans le pass. Le futur immdiat a
beaucoup plus de force que le futur indtermin. Ainsi l'ide de la
mort, qui est quelque chose de certain, nous affecte peu et ne nous sert
pas beaucoup contenir nos passions ; mais la pense d'une mort immdiate et prochaine suffit pour oprer une conversion subite, et elle a
quelquefois assez de force pour que cette conversion subsiste lors
mme que la crainte de la mort a disparu. Telle fut, par exemple, la
77
78
Ethique, IV, scolie.
thique, IV, prop. 10.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
505
cause de la conversion de Ranc, fondateur de la Trappe au XVIIe
sicle ; on prtend que ce fut la mort subite d'une matresse qui le prcipita dans la vie religieuse. De mme aussi Pascal fut converti par
l'accident du pont de Neuilly. Il conduisait, dit-on, un carrosse
quatre chevaux ; les chevaux s'emportrent et menaaient de l'entraner dans la rivire, lorsque, par bonheur, les traits se rompirent et la
voiture fut violemment arrte. La mme loi a lieu pour le pass. C'est
ainsi que la reconnaissance pour le pass est en raison inverse du
temps o le bienfait a eu lieu.
4 Quatrime loi : loi du ncessaire et du contingent.
En gnral, et toutes choses gales d'ailleurs, la passion excite
par le ncessaire est plus forte que celle qui porte sur des objets contingents . 79 Ainsi, malgr les rserves prcdentes, [554] on peut
dire que la crainte de la mort est la plus forte de toutes les craintes, et
le dsespoir est la plus forte de toutes les passions.
Cependant il n'en est pas toujours ainsi, et il peut arriver que l'ide
du ncessaire calme prcisment la passion et produise la rsignation,
tandis que la possibilit et le contingent jettent l'me dans un trs
grand trouble. Mais peut-tre cela tient-il ce qu'il y a alors un combat de passions (joie ou tristesse), tandis que le ncessaire n'en provoque qu'une seule.
5 Cinquime loi : loi du possible et du contingent.
Selon Spinoza, notre passion est plus forte, toutes choses gales
d'ailleurs, pour un objet que nous considrons comme possible que
pour un objet contingent . 80
Par exemple, l'image d'une fortune possible, c'est--dire qui a des
chances plus ou moins prochaines et probables, est plus forte que
l'image d'une fortune en gnral qui est indtermine. Autant que je
79
80
Ibid., prop. 10.
thique, IV, prop. 11.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
506
comprends cette distinction, elle signifie que le possible est li certaines conditions dtermines qui existent actuellement, sans tre cependant ncessairement dtermines le produire : par exemple, un
grand hritage qui peut survenir si telle mort vient se produire ; mais
cette mort n'est pas ncessaire ; tandis que le contingent est seulement
ce qui est possible de soi et ce qui n'implique pas contradiction, c'est-dire les choses telles que nous ne trouvons rien en elles, ne considrer que leur essence, qui pose leur existence ou qui l'exclue . Par
exemple tre roi est une chose qui, pour un homme quelconque, n'implique pas contradiction et qui est donc la rigueur possible (puisque
cela est arriv Bernadotte), mais c'est ce qui n'arrive pas en gnral.
C'est ce que Spinoza appelle contingent. Mais pour un prince du sang
et surtout pour l'hritier prsomptif, la succession au trne est plus que
contingente ; elle est possible, puisque toutes les conditions dtermines [555] qui conduisent la possession du trne sont runies. Cependant elle n'est que possible sans tre certaine, car nous ignorons
si les causes qui doivent amener cet vnement doivent se produire : par exemple, si l'hritier ne viendra pas mourir avant le
possesseur actuel.
6 Sixime loi : loi du contingent compar au pass.
Notre passion pour une chose contingente est plus faible que pour
une chose passe. 81
En effet, le contingent n'implique en aucune faon l'existence,
quoiqu'elle ne l'exclue pas. Le pass, au contraire, implique l'existence ; car s'il n'est plus, du moins il a t. Or le souvenir de cet objet
suffit pour que nous nous le reprsentions comme prsent, et par consquent pour susciter en nous une passion plus vive que ne peut faire
un objet purement indtermin, dont nous ne pouvons savoir s'il sera
ou s'il ne sera pas. Par consquent, le souvenir d'une douleur passe
nous affectera plus que l'ide d'une douleur imaginaire, quoique non
81
thique, IV, prop. 13.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
507
impossible, mais n'ayant aucun rapport de possibilit directe avec
nous.
7 Septime loi : loi du dsir dans son rapport avec la joie et la
tristesse.
Le dsir qui nat de la joie est plus fort que le dsir qui nat de la tristesse. 82
En effet, l'homme en gnral a plus de force dans la joie que dans
la tristesse. Il faut plus de force pour carter le mal dont nous sommes
affects dans la tristesse que pour accrotre le bien qui cause notre
joie. L'homme est donc abattu par la tristesse et exalt par la joie.
Mais cela n'est vrai que toutes choses gales d'ailleurs ; car, par
exemple, la tristesse accompagne de haine peut inspirer un dsir de
vengeance beaucoup plus fort que l'amour de bienveillance caus par
la joie d'un bienfait. Mais c'est que nous introduisons ici un autre lment, savoir l'ide d'autrui et l'ide du bien et du [556] mal d'autrui,
qui veillent d'autres sentiments que le bien et le mal personnels. La
reconnaissance, en effet, consiste s'oublier, la vengeance se satisfaire ; or l'amour du bien personnel est plus fort que l'amour du bien
d'autrui.
l'aide du principe prcdent, Spinoza essaye de rsoudre le problme pos par Platon dans le Protagoras : comment l'homme peut-il
tre vaincu par lui-mme, infrieur lui-mme ? 83
Sans doute Spinoza reconnat que la raison peut vaincre les passions aussi bien qu'tre vaincue par elles : c'est ce qu'il appelle luimme l'tat de libert. Mais il s'agit d'abord de montrer l'impuissance
de l'homme avant de montrer sa puissance. La premire question relve de la psychologie, la seconde de la morale.
Le principe est que la connaissance du bien et du mal peut tre dtruite et empche par beaucoup d'autres dsirs qui naissent des pas82
83
Ibid., prop. 18.
Voir le Protagoras.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
508
sions dont notre me est agite. C'est ce qui est vrifi par l'exprience
et exprim par ce clbre aphorisme : Video meliora. Cet tat a t
merveilleusement dcrit par saint Augustin. 84
[557]
Cette impuissance de la raison s'explique, selon Spinoza, par le
principe suivant :
La vraie connaissance du bien et du mal, en tant que vraie, ne peut
empcher aucune passion ; elle ne le peut qu'en tant qu'on la considre
elle-mme comme une passion. 85
Cela tant, cette passion est soumise aux mmes lois que les
autres ; c'est--dire que la force se mesure par la puissance de l'me
compare la puissance des choses extrieures, laquelle puissance,
nous l'avons vu, surpasse infiniment la ntre. Il peut donc se faire que
d'autres dsirs naissant de ces causes extrieures l'emportent sur le
dsir du bien naissant de la raison. En somme, la solution donne par
Spinoza est, aprs tout, peu prs celle de tout le monde. C'est que le
84
Voir saint Augustin, Confessions :
Le poids du sicle, comme dans un songe, me pressait doucement, et les
penses par lesquelles je m'levais vers vous, mon Dieu, taient semblables
aux efforts des sens qui veulent se rveiller, mais qui, vaincus par la force du
sommeil, retombent dans l'assoupissement. Il n'est sans doute personne qui
voudrait toujours dormir ; et sans doute rien n'est plus difficile que de secouer
la langueur qui appesantit nos membres, et souvent, malgr nous, nous
sommes captivs par la douceur du sommeil, quoique l'heure du rveil soit arrive. De mme j'tais certain qu'il tait meilleur de m'abandonner votre
amour que de cder mes passions ; mais si j'tais d'un ct attir et convaincu, de l'autre j'tais sduit et enchan ; j'tais retenu par les frivoles plaisirs et
les folles vanits, mes anciennes amies, qui secouaient en quelque sorte les vtements de ma chair et murmuraient : Nous abandonnes-tu ? Et de ce moment ne serons-nous plus avec toi de toute l'ternit ? Encore un moment, et tu
ne pourras plus faire ceci ou cela, et pour l'ternit ! Ces voix, je ne les entendais plus qu' peine ; elles n'osaient plus venir en face me combattre ouvertement ; mais elles grondaient par derrire, me mordant furtivement ; elles me
retardaient cependant. J'hsitais m'arracher elles, secouer leur joug ; et
une imprieuse habitude me disait : Penses-tu pouvoir vivre sans elles ?
85 thique, IV, prop. 14.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
509
plaisir prsent l'emporte sur le plaisir futur, le plaisir rel et actuel sur
le plaisir idal et rationnel, et en gnral la passion sur la raison.
Telles sont les principales lois de la mcanique des passions, selon
Spinoza. On pourrait complter et enrichir ce tableau par un certain
nombre de lois analogues, telles que celles-ci :
1 La passion qui porte sur le bien individuel et personnel est plus
forte, toutes choses gales d'ailleurs, que celle qui porte sur le
bien d'autrui et sur le bien idal.
2 La passion provoque par une cause subite et inattendue est
plus forte que celle qui rsulte d'une cause longtemps prvue.
3 La passion excite par une chose difficile obtenir est plus
forte que la passion provoque par une chose facile.
4 La passion excite par une chose particulire et existant en acte
est plus forte que celle qui porte sur un objet en gnral ; par
exemple le plaisir l'emporte sur l'utilit.
Telles sont les lois de la passion livre elle-mme sans l'intervention de la raison et sans la rsistance de la libert ! [558] Cette thorie
de Spinoza est, avons-nous dit, analogue la thorie impulsioniste de
Descartes. Tout mouvement est dtermin par un mouvement antrieur, et le mouvement le plus fort l'emporte toujours sur le mouvement le plus faible. C'est ce dont on peut se convaincre en comparant
les lois du mouvement dans Descartes avec les lois des passions dans
Spinoza.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
510
[559]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE DEUXIME
LES PASSIONS
Leon IX
La mcanique des passions.
Charles Fourier
Retour la table des matires
Messieurs,
En passant de la thorie de Spinoza sur les passions celle de Ch.
Fourier, nous passons de la philosophie la fantaisie ; mais cette fantaisie est ingnieuse et contient des ides intressantes. C'est, en tout
cas, une curiosit historique et une diversion piquante nos tudes.
La thorie de Spinoza part de ce principe que l'homme est un agent
naturel et que, comme toutes les autres choses de la nature, il est
soumis aux lois du mouvement. D'o il suit que les passions l'entranent ou le dominent suivant que leur force impulsive est plus ou
moins grande. Fourier admet les mmes principes, mais il croit en
outre que le systme de l'me est un systme agenc et prpar par un
grand mcanicien, conformment au principe des causes finales. Les
passions ne sont pas seulement des forces brutales et dsordonnes
obissant la loi du plus fort ; elles forment un mcanisme sagement
conu par la Providence, et dont il appartient l'homme de dcouvrir
et d'appliquer les lois.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
511
De mme que, dans l'univers, la loi fondamentale est l'attraction,
de mme l'me est gouverne par une loi fondamentale, la loi de l'attraction passionnelle.
En effet, Fourier part d'un principe qu'il appelle l'conomie de
ressorts , qui n'est autre que le principe de Malebranche, le principe
de la simplicit des voies , et celui de Maupertuis, le principe de
la moindre action . Dieu tant le plus parfait des mcaniciens,
comme l'a dmontr Newton, il doit avoir appliqu le mme ressort
toutes les [560] cratures. Quel est ce ressort ? C'est l'attraction universelle. S'il y a unit de systme dans tout l'univers, le mme ressort
doit rgir la nature entire. L'attraction, voil donc le ressort cherch.
Mais quelle attraction ? Les astres n'ont besoin que d'tre guids dans
leurs mouvements, puisqu'ils n'ont ni intelligence ni sensibilit : l'attraction sera donc exclusivement mcanique. Mais les hommes sont
des tres sensibles, soumis aux passions. Dans l'homme, l'attraction
sera donc passionnelle : c'est--dire que les hommes, tout en suivant
les lois des passions et de la sensibilit, doivent arriver au plus grand
accord avec eux-mmes et avec leurs semblables ; et de mme que
l'harmonie de l'univers est le rsultat de deux forces, l'attraction et la
rpulsion, de mme l'harmonie passionnelle, comme l'harmonie musicale, doit rsulter de l'ensemble des accords et des discords.
Nier la possibilit d'un pareil systme (c'est--dire d'un systme qui
doit conduire au bonheur, tout en donnant toute libert aux passions),
ce serait dire que Dieu, qui a pu donner un code mcanique aux astres,
n'a pas pu donner un code social. C'est ce qui est d'ailleurs rfut par
les faits. Car Dieu a donn un tel code aux animaux, lesquels n'obissent qu'aux lois de l'attraction passionnelle. Seulement il y a cette diffrence entre l'homme et l'animal que celui-ci, rduit l'instinct, n'a
rien faire autre chose que de suivre ce code sans tre charg de le
dcouvrir, tandis que l'homme a reu au contraire la raison en partage,
en sus de l'instinct, prcisment pour dcouvrir ce code ; s'il n'a pas
encore t dcouvert, ce n'est pas la faute de Dieu, mais des philosophes et des moralistes.
Qu'ont imagin en effet les faux savants ? Ayant vu deux choses
dans l'homme, l'attraction et la raison, au lieu de supposer que ces
deux choses ont t faites l'une pour l'autre, et de partir du principe de
l'unit de ressort, qui les et conduits comprendre que la raison doit
marcher d'accord avec la passion, ils ont imagin une lutte entre l'une
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
512
et l'autre, comme si Dieu pouvait avoir cr un tre ainsi [561] compos de deux ressorts contradictoires. Ils ont donc imagin que Dieu
nous avait donn la raison pour rprimer nos passions. Quelle trange
ide se fait-on du Crateur ? Que penserait-on d'un pre qui commencerait par donner des vices son fils, et qui ensuite lui ferait de la morale ? d'un ducateur qui placerait son lve en face de toutes les tentations, et qui lui dirait ensuite : Triomphe de tous ces ennemis ?
Et si, aprs cette preuve, le pre ou le matre qui agirait ainsi condamnait mort celui dont ils auraient eux-mmes prpar la perte, ne
serait-ce pas l une abominable cruaut ? Telle est la conduite que les
moralistes prtent Dieu ; ils le rendent responsable d'une contradiction qui n'est que dans leur systme. Ce qu'on appelle le devoir vient
des hommes ; les passions seules viennent de Dieu. Le devoir varie
selon les temps et les lieux ; les passions sont immuables. Partout les
hommes aiment la vie, la puissance, la fortune ; mais la vertu n'est pas
de mme en Orient qu'en Occident ; la vertu grecque et romaine n'est
pas la mme que la vertu moderne. Ainsi, tandis que les philosophes
des autres coles ont l'habitude d'opposer prcisment la sensibilit
son caractre relatif et subjectif, et de rserver au devoir seul le caractre de l'absolu, Fourier, retournant l'objection, nous montre l'homme
physique partout semblable lui-mme, tandis que c'est l'homme moral qui varie.
Encore, poursuit-il, si ce moyen d'action que Dieu aurait mis en
nous pour combattre les passions, si ce moyen, c'est--dire la raison,
tait efficace ? Mais il n'en est rien. Pour que ce remde et une vritable action sur l'homme, il et fallu lui donner peu d'attraction et
beaucoup de raison. Au contraire, il nous a t donn beaucoup d'attraction et peu de raison. Les passions sont la raison dans la proportion de 12 1, puisqu'il y a douze passions et une seule raison. Aussi
la raison est-elle toujours impuissante ; et elle l'est autant chez ceux
qui la prchent que chez les autres. Les parents et les matres prchent
les enfants, qui valent mieux qu'eux. Les prdicateurs et les moralistes
ont prcisment [562] les mmes passions que les autres hommes.
Qu'arrive-t-il ? Que, les hommes voyant que la plupart de ceux qui
font mtier de morale s'abandonnent comme les autres leurs passions, chacun s'habitue en faire autant ; l'important n'est pas d'tre
vertueux, mais de le paratre ; la seule vertu, c'est l'hypocrisie.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
513
Les moralistes, pour concilier les contradictions qu'ils imputent
Dieu, nous renvoient la vie future. Mais si Dieu nous donne le bonheur dans un autre monde, pourquoi pas dans celui-ci ? Ce n'est pas
que Fourier soit oppos l'immortalit de l'me. Il la dfend au contraire, et il en a donn une dmonstration originale en l'appuyant sur
ce thorme : Les attractions sont proportionnelles aux destines.
Les dsirs de l'homme sont infinis ; donc sa destine doit l'tre aussi.
Mais c'est l une loi qui tient la nature des choses : ce n'est pas la
rparation des maux que nous subissons ici-bas. On remarquera d'ailleurs que l'argument de Fourier n'est autre que celui que Jouffroy a
dvelopp depuis dans le Cours de droit naturel, et qui a pass depuis
dans l'enseignement classique.
Il faut donc croire (si l'on admet qu'il y a un Dieu) qu'il a donn
l'homme un code naturel pour l'usage de ses passions. C'est ce code
qu'il s'agit de dcouvrir.
Ainsi l'attraction passionnelle suppose un mcanisme passionnel.
C'est ce mcanisme dont nous allons donner la thorie.
Et d'abord, qu'est-ce que les passions ? Ce sont les modes ou les
espces de l'attraction passionnelle. Ce sont les impulsions donnes
par la nature avant toute rflexion et qui persistent malgr toute rflexion. Autant il y a d'impulsions de ce genre, autant de passions
primitives. Fourier en compte douze, qu'il ramne trois principes ou,
comme il s'exprime, trois foyers d'attraction.
En premier lieu, l'homme est port au luxe. Fourier entend parla le
got du bien-tre intrieur et extrieur, beaut et richesses. Premier
foyer d'attraction ou de passion, le luxisme.
[563]
En second lieu, l'homme est port la socit ; il tend former des
groupes et des runions : second foyer d'attraction, le groupisme.
Jusqu'ici, rien de bien nouveau, rien qui n'ait t dit par tous les
philosophes. Mais voici le nud du systme et ce que Fourier considre comme sa grande dcouverte sociale : car pour lui le systme
passionnel et le systme social se confondent. Ce troisime principe et
ce troisime foyer d'attraction, c'est que l'homme n'est pas seulement
port former des groupes, mais encore des sries. Non seulement il
obit aux passions prcdentes, mais, ce que les philosophes n'ont pas
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
514
vu, c'est que, parmi nos passions, il en est prcisment qui ont pour
but et pour fonction d'tablir entre les autres la rgle et l'ordre et d'en
rendre possible le libre essor, en en dirigeant le mcanisme. Pour bien
comprendre notre auteur, revenons d'abord aux passions prcdentes,
celles des deux premires classes.
La premire classe a pour objet le bien-tre intrieur et extrieur.
Or, qu'est-ce qui nous assure le bien-tre ? C'est la satisfaction des
sens. Il y aura donc cinq passions donnes par la nature : ce sont les
cinq sens. Donc, passion du got, passion des odeurs, des couleurs, du
son et du tact. La satisfaction de ces cinq passions est le bien-tre, ou
bonheur physique, accompagn du bien-tre intrieur ou sant : voil
le luxisme.
En second lieu, la tendance de l'homme former des groupes
prend quatre formes principales : ou bien nous nous runissons librement ou par sympathie de caractres : c'est l'amiti ; ou bien par un
intrt commun et par similitude d'occupations : c'est l'esprit de corps,
ou corporatif, que Fourier confond avec l'ambition, parce que l'ambition consiste tre le premier dans un groupe ou le premier pour son
groupe. Elle est la fois collective et individuelle : on peut tre ambitieux pour son groupe ; de ce genre est l'ambition du clerg. Elle est
individuelle quand on cherche dominer dans son propre groupe, et
alors on peut demander [564] si elle se confond avec l'esprit de corps.
En troisime lieu, des groupes peuvent tre forms par l'attrait des
sexes. C'est la passion de l'amour. Mais de cette passion nat prcisment une quatrime espce de groupe, celui de la famille, laquelle
correspond une passion propre qui est le familisme. Le familisme se
distingue de l'amour parce qu'il comprend d'autres personnes, par
exemple les enfants, et que de plus l'amour peut exister en dehors de
la famille.
Il y aura donc quatre passions fondamentales, correspondant ce
que Fourier appelle le groupisme.
On remarquera que, parmi les passions fondamentales, Fourier ne
range pas le patriotisme. Sans qu'il s'explique sur ce point, on est autoris supposer qu'il considrait cette passion comme appartenant
l'ordre civilis et subversif. La nature humaine tant la mme partout,
il n'y a pas lieu la diviser en peuples diffrents. La patrie, dans le
systme de Fourier, c'est la commune socitaire, la phalange. L'amour
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
515
de la patrie sera donc l'amour de la phalange : il sera la rsultante naturelle de toutes les passions, la phalange tant le vrai milieu o elles
peuvent se satisfaire.
Nous avons jusqu'ici neuf passions fondamentales : cinq sensitives
et quatre affectives. Supposez que toutes ces passions trouvent leur
satisfaction, c'est ce que l'on appelle le bonheur.
Le bonheur, suivant Fourier, doit tre bicompos : 1 tre la fois
sensuel et spirituel ; 2 donner la fois au moins deux jouissances des
sens et deux jouissances de l'me. Fourier ne donne aucune explication sur cette seconde condition. Il dit seulement que c'est l un minimum : car l'homme est capable de plaisir puissanciel , c'est--dire
de plaisir accumul et s'levant une puissance de plus en plus
grande.
Suivant Fourier, Dieu nous doit le bonheur. Il et t un bien mauvais mcanicien s'il nous et donn le dsir du bonheur sans le moyen
de le satisfaire. Or, il semble qu'il y ait ici contradiction. Car, d'une
part le bonheur est dans la satisfaction des passions, ou, comme il
s'exprime, dans [565] l'essor intgral et continu des passions ; de
l'autre, dans l'tat actuel de la civilisation, les passions, du contraire,
sont des tigres dchans, des tres dmoniaques ; d'o l'on a conclu qu'il fallait les dtruire ou les rprimer. C'tait mal conclure : car
sont-ce bien nos passions qui sont nos ennemis ? Ne serait-ce pas plutt le milieu dans lequel elles se dplacent, savoir le milieu civilis ?
Au lieu de dtruire les passions, ce qui est impossible, ne vaudrait-il
pas mieux changer le milieu ? On voit comment, dans Fourier, le problme moral, savoir celui de la libert des passions, se lie au problme social.
Si les philosophes avaient mieux tudi l'homme, ils auraient trouv dans l'analyse mme des passions la loi de leur harmonie. Ils auraient vu qu'il y a prcisment en nous une troisime classe de passions qui tendent rgulariser le jeu des autres, et leur procurer sans
dsordre une libre satisfaction.
Le troisime groupe tend la formation, non plus de groupes, mais
de sries. C'est pourquoi Fourier les rassemblait sous le nom de sriisme. De plus, comme elles sont appeles rgulariser le mcanisme
et le jeu des autres passions, il les appelle mcanisantes, et aussi,
comme elles assurent chacune sa place, son ordre et son rle, il les
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
516
nomme encore distributives. Enfin, comme elles sont le pivot du systme, elles prennent aussi le nom de pivotales.
Quelles sont ces passions ? Elles sont au nombre de trois, qui, avec
les prcdentes, compltent le nombre des douze passions primitives.
Mais, puisqu'elles se ramnent toutes au sriisme, et qu'elles tendent former des sries, demandons-nous d'abord ce que c'est que la
srie dans la doctrine phalanstrienne.
Reprenons encore une fois le problme. Le voici : assurer toutes
nos passions le libre essor dans leur jeu interne et externe, c'est--dire
permettre chacun la satisfaction de toutes ses passions sans se nuire
soi-mme ni aux autres. [566] Tel est le problme dont la loi sriaire
ou le mcanisme sriaire donnent la solution.
La loi sriaire est une loi de la nature que le Crateur a lui-mme
employe dans la formation des tres. Les trois rgnes de la nature
sont en effet groups par sries. Ce sont ces groupes ou sries qui font
l'objet de la classification des naturalistes. Les animaux, par exemple,
sont rangs par divisions et sous-divisions, depuis les embranchements jusqu'aux espces et aux races, et ils forment aussi une hirarchie et une chelle. Ce que l'on appelle la mthode naturelle n'est
autre chose que le travail par lequel le naturaliste essaye de reproduire
dans ses cadres cet ordre et cette hirarchie. Si Dieu a appliqu cette
loi au rgne animal, pourquoi ne l'aurait-il pas aussi applique au
genre humain ? Comme il y a une srie animale, pourquoi n'y aurait-il
pas une srie passionnelle ? L'homme serait-il hors d'unit avec
l'univers ? Il y aurait donc duplicit de systme ? Ce serait contraire
au principe de l'conomie de ressort.
Comment donc se reprsenter la srie des passions ?
Voici d'abord la dfinition de la srie passionnelle :
La srie passionnelle est une ligue, une affiliation de diverses petites
corporations dont chacune exerce quelque espce d'une passion, qui devient passion de genre pour la srie entire. Par exemple, vingt groupes
cultivant vingt sortes de roses forment une srie de rosistes quant au genre,
et de blancs rosistes, de jaunes rosistes, de mousses rosistes quant aux espces.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
517
Maintenant, comment la loi sriaire est-elle un moyen d'tablir
l'accord et l'harmonie des passions, et par consquent d'assurer le bonheur ?
C'est que l'harmonie des passions possibles a deux conditions :
1 Que les passions soient nombreuses ;
2 Qu'elles soient gradues.
Cette seconde condition suppose la premire, car il n'est [567] pas
possible de graduer les passions si elles ne sont pas en grand nombre.
Supposez, en effet, un petit nombre de passions qui ne soient pas
divises en sous-passions, celles-ci tant leur tour subdivises en
nuances de plus en plus faibles : dans ce cas, nul accord possible entre
les deux extrmes ; point de transition et par consquent point de transaction. De l luttes et discordes allant jusqu' l'animosit. Supposons, dit Fourier, qui aime emprunter ses exemples la cuisine, supposons trois personnes dnant ensemble. L'une aime le pain trs sal,
l'autre demi-sal, le troisime point du tout sal. Nul accord possible
en supposant qu'il n'y ait qu'un seul pain partager. Supposons au
contraire trente personnes aimant le pain un degr de cuisson ou de
salaison diffrent : aussitt il s'tablira des groupes ou des sousgroupes qui se feront ncessairement contrepoids les uns aux autres,
qui lutteront les uns contre les autres, mais qui se soutiendront aussi :
nul ne se sentira isol ; chacun puisera sa force dans le groupe dont il
fait partie, et dans ce groupe il aura des allis et des rivaux qui se soutiendront et lui feront produire tous les efforts dont il est capable.
Cette division en groupes et sous-groupes est donne par la nature.
Elle se forme spontanment partout o il y a runion d'hommes. Dans
toutes les assembles publiques il y a un centre et des extrmits ; et
bientt mme ce centre et ces extrmits se subdivisent leur tour et
forment des groupes intermdiaires. C'est de mme galement que,
dans une arme, il y a un centre et deux ailes et des intermdiaires qui
tiennent ces trois groupes en communication.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
518
Appliquez cette loi aux passions, vous aurez la srie passionnelle.
Moins il y aura de passions intermdiaires, plus il y aura lutte. Plus, au
contraire, il y aura de passions intermdiaires, plus il sera facile de
temprer les discords par des accords, et de tout fondre dans une harmonie gnrale comme dans un orchestre. De l ce principe qui rsume tout le mcanisme sriaire :
[568]
Tous les gots sont bons, pourvu qu'on puisse composer une srie
rgulire, chelonne en ordre ascendant et descendant, et appuye aux
deux extrmits par des gots mixtes.
On doit donc se reprsenter la srie socitaire comme une arme
compose de corps diffrents ; chacun de ces corps se divise son
tour en corps subordonns, rgiments, bataillons, compagnies, ces armes tant consacres la production, la distribution et la consommation des produits, tous forms spontanment par l'attrait. On
demandera s'il y a des gots pour toutes les occupations. Fourier rpond par son thorme des attractions proportionnelles aux destines.
Tout ce que l'homme est appel faire par la nature, trouve dans la
nature mme un attrait qui l'y pousse et qui l'y maintient. Autrement
Dieu aurait fait une uvre contraire elle-mme.
Maintenant que nous connaissons la loi sriaire, nous sommes
mme de comprendre le mcanisme passionnel. Le problme tait de
mettre d'accord les passions avec elles-mmes. Or, ce problme se
confond avec celui de la plus grande production possible de l'activit
humaine et de la meilleure distribution des produits. Pourquoi les
hommes se hassent-ils ? C'est qu'il n'y a pas assez grande abondance
des produits qui doivent satisfaire leurs besoins et que ces produits
sont mal distribus.
Ainsi le problme de l'harmonie des passions est le mme que celui
de l'organisation du travail.
Or, ce problme, la nature l'a rsolu en nous donnant trois passions
qui ont pour objet de diriger et de rgler le mcanisme sriaire.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
519
Ce sont les passions distributives et mcanisantes que nous avons
dj signales, et qu'il nous reste dcrire et nommer : ce sont la
cabaliste, la papillonne et la composite.
La cabaliste est l'esprit de rivalit et d'intrigue si funeste dans l'tat
de civilisation, mais qui a sa raison d'tre dans les desseins de la Providence.
[569]
Pourquoi Dieu a-t-il rendu l'homme si enclin l'intrigue, et surtout la
femme ? C'est parce que, dans l'ordre socitaire, tout homme, femme, enfant, doit tre membre de trente, quarante, cinquante sries, y pouser
chaudement l'esprit de parti et les cabales. Une srie ne souffre pas de sectaire modr, elle a horreur de la modration. Qu'en arrive-t-il ? Que les
produits sont en harmonie avec la vhmence de ces passions.
La papillonne est le besoin de varits priodiques, sductions contrastes, changements de scne, incidents piquants, nouveauts propres
crer l'illusion, stimuler sens et me la fois.
Enfin la composite est la passion qui cherche la composition des
plaisirs, savoir l'union des plaisirs des sens et des plaisirs de l'me.
Maintenant ces trois passions ou ressorts agissent au moyen de
trois leviers, qui sont : L'chelle compacte, les courtes sances, l'exercice parcellaire.
L'chelle compacte consiste dans le rapprochement des varits cultives par des groupes contigus. Par exemple, les groupes qui cultiveraient
des poires trs diffrentes ne pourraient former une srie passionnelle. Ces
groupes n'auraient ni sympathie, ni antipathie, ni rivalit, ni mulations,
faute de rapprochement. La cabaliste n'y aurait pas son essor.
Le principe des courtes sances s'explique par lui-mme. Les plus
longues ne dpasseraient pas deux heures. Sans cette rgle, un individu ne pourrait pas s'engager dans une trentaine de sries, comme il est
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
520
ncessaire pour le jeu de la cabaliste. Le principe des courtes sances
rpond aussi la passion de la papillonne.
Enfin l'exercice parcellaire est la troisime condition, ou troisime
levier. D'aprs ce principe, le travail de chacun doit se borner telle
parcelle de fonction. C'est la division du travail pousse l'extrme.
Le troisime levier sert favoriser la passion de la composite, en permettant, grce [570] la facilit du travail, de cumuler les plaisirs matriels aux plaisirs de l'esprit.
Il est inutile d'insister sur ce qu'il y a de fantaisie et mme de purilit dans la conception de Ch. Fourier, conception que nous avons essay de prsenter sous la forme la plus raisonnable et en la dgageant
de toutes les excentricits et incohrences qui l'accompagnent dans le
texte, d'ailleurs illisible. Inutile de discuter en dtail une telle conception. Mais, sans parler de mille objections qui se prsentent d'abord
l'esprit et que le simple bon sens suffit suggrer, nous signalerons
surtout ce qui nous parat l'erreur fondamentale du systme au point
de vue psychologique.
C'est l'quivoque et la confusion perptuelle et singulire que Fourier tablit entre le got des consommateurs et le got des producteurs.
Il semble croire que la mme passion qui nous porte jouir nous portera produire. Il choisit, nous l'avons vu, l'exemple du pain, ou celui
des roses, des poires, et ce sont presque toujours les mmes exemples.
Il semble donc croire que, parce qu'il y a des gens qui aiment le pain
trs sal, les autres demi-sal, les autres point du tout sal, les mmes
gens auront du plaisir faire des pains trs sals et les autres point
sals du tout. Mais si la prsence ou l'absence du sel est importante
pour celui qui jouit, elle ne dit rien celui qui produit ; et si mettre du
sel est une fatigue de plus, je serais trs capable de me dispenser de
cette fatigue, au risque de manger mon pain non sal. C'est ce qui arrive tous les jours des gens qui aimeraient bien manger, mais qui
aiment encore mieux ne pas travailler, sauf ne pas manger comme
ils le voudraient. Ainsi, user d'une chose est trs diffrent de la produire. Faire la cuisine n'est pas la mme chose que la manger ; le plus
gourmand n'est pas ncessairement un bon ptissier ni un bon rtisseur. Fourier a tout simplement oubli cette observation psychologique, que dans l'acte de jouir il n'y a tenir compte que du plaisir,
tandis que dans l'acte de produire il y a quelque chose de plus, la difficult. Il y a [571] des gots pour lesquels on ne peut pas se satisfaire
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
521
soi-mme : par exemple, les beaux vers et les beaux tableaux : le got
du dilettante est une chose, le got de l'artiste en est une autre. Mme
la passion de produire, quand elle ne concide pas avec le talent, est
plutt une maladie qu'une passion utile.
Ainsi les deux sries de producteurs et de consommateurs ne se
correspondent pas ; et cependant Fourier choisit toujours pour
exemples les gots des consommateurs, parce que l il est plus facile
de trouver des sries gradues. Par exemple, on comprend qu'il y ait
une srie de gots pour les poires ou pour les roses : s'ensuit-il qu'il y
ait la mme srie de gots pour la production des poires ou des roses ?
Conoit-on bien qu'on ait le got de produire des roses jaunes plutt
que des roses blanches, et toutes les nuances intermdiaires ? De ce
que j'aime les confitures plus ou moins sucres ou plus ou moins
cuites, je demande aux mnagres quel plaisir elles peuvent avoir
faire des confitures demi-sucres ou demi-cuites ; et se reprsente-t-on
une srie de confitures correspondant tous ces degrs ? Je veux bien
que, dans la pratique, les choses se produisent peu prs ainsi, et que
le commerce cherche fournir tous les gots ; mais ce n'est pas
parce que le commerant prouve les mmes gots que le consommateur ; c'est parce que la concurrence lui fait chercher des moyens de
plaire qui n'ont pas encore t employs.
Ce qu'il et fallu prouver, ce n'est pas que tous les gots sont bons
et qu'il y a des gots pour toutes les jouissances, mais qu'il y a des
gots et des passions pour toutes les espces de subdivision du travail,
et que ces gots sont plus ou moins nombreux en raison de l'utilit et
la ncessit des travaux. Mais c'est ce qui n'est pas. Les ncessits de
l'industrie ont bien amen l'ouvrier n'avoir rien faire autre chose
que des ttes d'pingles ; mais cela ne prouve nullement qu'il y ait une
passion dans la nature qui porte exclusivement certaines personnes
faire des ttes d'pingles.
L'erreur fondamentale de Fourier a donc t de ne voir [572] dans
l'homme que le ct passif, la capacit de jouir. Il n'a pas vu le ct
actif, savoir la ncessit de lutter contre la nature pour arriver la
jouissance. Il n'a vu que le plaisir, et non l'effort. Or, cela seul suffit,
sans mme s'lever l'ide du devoir, pour que la passion ne puisse
pas tre livre elle-mme et pour qu'elle ne puisse elle seule diriger
sa conduite humaine.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
522
Inutile d'ailleurs de dire que, parmi les passions humaines, il en est
une qu'il est impossible de satisfaire en lui laissant toute sa libert.
C'est l'attrait des sexes. La cabaliste et la papillonne sont ici de tristes
remdes aux entranements et aux dangers de cette passion. Sans
doute Fourier a essay d'appliquer son systme mme cette passion ;
mais l prcisment il a t entran des conceptions si rpugnantes
et si ridicules que c'est par l surtout, beaucoup plus que par ses utopies sociales, que son systme a t entam et a fini par succomber.
Sans doute on peut appliquer aux passions le principe des causes
finales, et cette vue de Fourier est juste. On peut supposer que toutes
les passions ont leur but, qu'aucune, prise en soi, n'est inutile ni funeste. Le systme des rigoristes, stociens ou jansnistes, est exagr.
Mais il ne s'agit pas pour Fourier d'utiliser ses passions en les rglant
et les dirigeant par la raison. Il s'agit de trouver un mcanisme tel
qu'elles puissent se dvelopper sans limites. C'est ce mcanisme qui
est une chimre. Par exemple, comme nous l'ayons dit, le systme de
Fourier vient chouer devant la question des rapports des sexes. Si son
systme tait le vrai, cette passion, aussi bien que les autres, devrait
trouver sa satisfaction et son apaisement dans une libert sans limites.
Mais, en dehors mme de toute question morale, comment une passion si exclusive, si jalouse et si dominatrice, pourrait-elle tre abandonne elle-mme sans produire prcisment les luttes que l'on voudrait viter ?
Mais si le systme psychologique de Fourier est inadmissible, aussi
bien que son systme moral, il contient cependant [573] beaucoup de
dtails vrais et ingnieux : par exemple la thorie des trois passions
distributives ; la cabaliste, la papillonne et les composites correspondent trois lois trs relles de la passion : 1 la loi de rivalit et
d'mulation, qui fait que chacun veut faire et veut savoir plus que les
autres ; 2 la loi de relativit ou de changement, qui, en nous poussant
sans cesse au nouveau, nous prdestine au progrs ; 3 la loi de composition, qui multiplie les plaisirs en les associant.
Ces trois lois sont vritables et constituent une partie importante de
la thorie des passions.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
523
Nous retrouverons ces lois, avec beaucoup d'autres, dans l'tude
dtaille que nous allons instituer sur les lois des passions ; ce sera
l'objet de nos prochaines leons.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
524
[574]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE DEUXIME
LES PASSIONS
Leon X
LOIS DE RELATIVIT
ET DE CONTINUIT
Retour la table des matires
Messieurs,
Ce que nous avons appel la mcanique des passions comprend les
lois les plus gnrales qui prsident aux mouvements de l'me et qui
ont trait aux rapports les plus simples qui puissent exister entre elles.
Mais, de mme que dans la mcanique proprement dite il y a des lois
gnrales appeles lois du mouvement, qui sont les plus simples de
toutes, et au-dessous de ces lois gnrales des thormes plus particuliers qui sont encore des lois, mais des lois plus compliques tenant
des rapports plus complexes, de mme en psychologie, au-dessous des
lois gnrales de la passion, il y a des lois spciales drives des premires, mais qui sont plutt des thormes, en raison de la complexit
des rapports. Nous les appellerons des lois concrtes et relles, et nous
rserverons aux premires le nom de lois abstraites et formelles.
Nous signalerons tout d'abord deux lois fondamentales qui semblent en contradiction l'une avec l'autre, et qui sont lies l'une
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
525
l'autre : la premire, c'est que les passions dcroissent et s'affaiblissent
avec la jouissance ; la seconde, c'est qu'elles s'enracinent par l'habitude. Nous appellerons la premire, avec les Anglais, loi de relativit,
et la seconde loi de continuit.
Ces deux lois correspondent aux conditions essentielles de l'univers et de toute existence, savoir la coexistence ncessaire du repos
et du mouvement, de l'unit et del pluralit.
Commenons par la premire :
I. Loi de relativit. Cette loi, laquelle les psychologues anglais
attachent une grande importance, et dont ils font la [575] loi fondamentale de l'intelligence comme de la sensibilit, consiste dans cette
proposition que la condition essentielle de la conscience est la diffrence entre l'tat de conscience qui survient et celui qui prcde, et par
consquent la nouveaut.
Bain, dans son livre motions et Volont, a trs bien expliqu cette
proposition, d'ailleurs depuis longtemps connue. Il montre que le
changement est ncessaire la jouissance. Nous n'avons pas conscience d'impressions continues. Les animaux qui vivent constamment
l'air libre, et non comme nous renferms dans des demeures closes,
ne connaissent pas le plaisir de la respiration. Les poissons qui vivent
dans une temprature peu prs invariable ne connaissent point le
plaisir de la chaleur ; certains plaisirs supposent une souffrance, par
exemple le plaisir de la libert oppos la souffrance de la contrainte.
L'oiseau n en cage ne connat pas la souffrance d'tre enferm.
D'autres plaisirs deviennent plus vifs par cette opposition, par exemple
le plaisir de la sant aprs une longue maladie. mme le changement
dans les douleurs est une sorte de plaisir. Milton s'est tromp dans le
Paradis perdu lorsque, voulant peindre les souffrances des damns, il
les a prsentes comme alternant les unes avec les autres et passant
des lits de feu des lits de glace . Ces alternances seraient plus
propres allger la souffrance qu' l'aggraver.
Avant Bain, un psychologue franais d'un rare mrite, Jouffroy,
dans son Esthtique, avait aussi tudi l'influence de la nouveaut sur
nos plaisirs, et aussi en mme temps l'influence de l'habitude, ce qui
se rapporte plutt la loi suivante ; mais les deux choses sont inspa-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
526
rables et doivent tre tudies ensemble, sauf revenir tout l'heure
sparment sur les effets de l'habitude considre en elle-mme.
Jouffroy commence par faire remarquer que si le nouveau est une
cause de plaisir, il est aussi une cause de peine. Par exemple, l'Europen et l'Africain se dplaisent l'un l'autre parce qu'ils sont rciproquement nouveaux l'un pour l'autre.
Il y a ici deux lois qui semblent se contrarier : d'une part [576] les
objets les plus agrables finissent par nous agrer moins, ou mme par
nous dplaire, quand nous en usons sans changement et sans interruption ; d'autre part, ce qui change nos habitudes, ce qui nous drange,
nous dplat galement. Comment expliquer ces deux effets contradictoires ? On voit par l que ces deux lois, la loi de continuit et la loi de
relativit, doivent tre tudies ensemble pour en bien discerner et en
mesurer les effets.
La nouveaut nous plat d'abord parce qu'elle satisfait le besoin de
connatre, le besoin de savoir. La loi de relativit, selon M. Bain, est la
loi fondamentale de l'intelligence. Comprendre, c'est discerner. Mais il
ne peut y avoir discernement sans varit et sans nouveaut. Ainsi
l'essence mme de l'intelligence explique dj en partie le plaisir de la
nouveaut. Chaque objet nouveau est une dcouverte qui tend le
champ de notre esprit. Dcouvrir, dit Jouffroy, c'est se dvelopper.
Mais il y a remarquer qu'il y a plusieurs cas de nouveaut. Ce
n'est pas toujours l'intelligence qui atteint le nouveau. Tel objet peut
tre nouveau pour l'intelligence et n'avoir pas encore t senti. Il deviendra nouveau pour la sensibilit. Tel objet peut avoir t conu et
senti, et n'avoir pas t possd ; il sera nouveau pour l'ambition, pour
le dsir. Rciproquement, un objet peut avoir t possd sans tre ni
compris ni senti. C'est alors qu'il devient nouveau pour l'intelligence.
Par exemple : 1er cas, un beau tableau, une belle posie que nous
connaissons depuis longtemps sans les avoir jamais sentis ; 2 sentir
vivement le plaisir qu'il y aurait dans le pouvoir, dans la richesse, mais
en tre priv ; 3 cas, sentir la musique sans la comprendre ; 4 possder depuis longtemps un tableau de famille sans l'avoir ni compris ni
got.
Ainsi l'intelligence n'est pas la seule source de la nouveaut. Il peut
y avoir nouveaut pour la sensibilit, pour l'activit, pour toutes nos
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
527
facults. En rsum, selon Jouffroy, la nouveaut [577] est le propre
d'un objet qui affecte pour la premire fois l'un de nos besoins dtermins ou indtermins.
Indpendamment des sentiments de dveloppement et d'agrandissement de nos facults que nous donne la nouveaut, il y a encore une
autre source du plaisir qu'elle procure. C'est que nous faisons plus
d'attention un plaisir nouveau qu' un plaisir connu. Or le plaisir,
comme la douleur, se double par l'attention et la rflexion. On sait
qu'une vive attention porte sur un objet peut faire oublier une vive
douleur, comme l'attention une douleur faible peut en faire un tourment insupportable.
Maintenant, nous revenons la premire question : si la nouveaut
est une cause de plaisir, comment peut-elle tre en mme temps une
cause de peine ?
C'est, dit Jouffroy, qu'il y a des esprits paresseux, comme il y a des
esprits actifs, ou, d'une manire plus gnrale, il y a un besoin de repos comme il y a un besoin d'action. Il y a un besoin d'quilibre ct
d'un besoin de stimulation.
C'est ce besoin d'quilibre qui fait que, lorsqu'il y a un trop grand
cart entre le nouveau et l'accoutum, cette diffrence produit une
souffrance qui se manifeste par l'effroi ou par tout autre phnomne.
C'est ainsi que les phnomnes qui s'loignent tellement des lois ordinaires qu'ils nous paraissent surnaturels ont toujours caus une vritable terreur : par exemple les clipses, les comtes, les monstres, etc.
Cette proportion qui doit exister entre le nouveau et la nature primitive ou acquise de l'tre vivant pour que le nouveau soit une cause
de plaisir et non de peine, tient ce que l'on appelle la loi d'accommodation. L'tre vivant tant appel vivre dans des conditions trs variables et trs complexes, et tant de plus soumis la loi du dveloppement, doit, pour pouvoir se conserver, tre dou d'une certaine
flexibilit ou plasticit, de manire se mettre en harmonie avec le
milieu quand ce milieu vient changer. Il est, comme on dit, accommodable au milieu. Mais cette accommodation a certaines limites. Le
vivant peut passer du chaud au froid [578] ou du froid au chaud avec
une certaine latitude. Mais, pass cette limite, telle extrmit le tue,
par exemple l'extrme froid et l'extrme chaud. Avant d'arriver cette
limite, il est averti qu'il en approche par la douleur. Si la diffrence est
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
528
trop grande, la douleur finit par produire l'affaiblissement ou la paralysie des facults. Si l'cart n'est pas trop grand, la loi d'accommodation l'emporte. La douleur devient d'abord indiffrente ; elle peut
mme devenir un plaisir : par exemple les bains froids, le got du tabac, etc.
Ainsi, le fait que la nouveaut peut tre une cause de peine ne contredit pas la loi que la nouveaut est une cause de plaisir. Car c'est en
vertu de la loi d'accommodation que nous jouissons de nouveau, et
c'est en vertu de la mme loi que nous souffrons lorsque la limite de
l'accommodation est dpasse. Pour que le plaisir de la nouveaut soit
sans mlange, il faut qu'il y ait une certaine proportion entre l'tat pass et l'tat nouveau. C'est ce qui fait que les peuples les plus sensibles
aux plaisirs de la nouveaut se cabrent lorsqu'ils sont lancs hors de
leur voie et que l'on fait violence leurs habitudes et leurs traditions.
Maintenant il faut dire que cet cart entre le nouveau et l'ancien varie
suivant mille circonstances particulires, et l'on ne peut en donner une
formule. L'ge, les habitudes, les caractres, en dcident : le degr de
nouveaut qui plat vingt ans dplat cinquante, parce que la facult d'accommodation s'est affaiblie. Ce qui tonne un campagnard et le
blesse dans sa routine paratra tout simple un citadin habitu une
grande varit d'objets. Enfin cela dpend aussi de la nature particulire de chaque individu. Il y a, dit Jouffroy, des esprits paresseux et
des esprits actifs.
Maintenant, comment se peut-il qu'il y ait des esprits paresseux et
des esprits actifs ? C'est qu'il y a, suivant Jouffroy, une sorte d'antinomie dans la destine humaine. C'est que la vie humaine est une lutte
entre le repos et le mouvement. De l deux sortes d'esprits : ceux qui
prfrent le dveloppement [579] au prix de la lutte, et ceux qui prfrent le repos au prix du non-dveloppement.
On voit donc par ces explications comment la nouveaut peut tre
un principe de dplaisir en mme temps que de plaisir. Mais remarquez qu'il ne s'agit en ce cas que d'un certain degr de dveloppement
trop loign de l'tat primitif : car en gnral tout le monde aime le
nouveau quelque degr ; ou bien encore il s'agit de ce qui est nouveau pour certaines facults et non pas pour d'autres ; car celui qui est
immobile dans ses ides peut tre changeant dans ses gots. Il ne voudra rien changer chez lui aux vieilles murs, aux vieilles habitudes, et
il passera sa vie courir le monde, pour voir de nouveaux pays ; et
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
529
l'on peut en mme temps tre trs accessible aux ides nouvelles, et
trs attach ses inclinations et ses habitudes.
On voit par ce qui prcde que la loi de la relativit n'est pas la
seule loi qui rgisse nos sentiments, qu'il y a une sorte de loi d'inertie
qui lui fait contrepoids et que nous devons tudier de plus prs. C'est
ce que nous avons appel la loi de continuit.
II. Loi de continuit. Cette loi peut se formuler ainsi : Toute
passion, tout en dcroissant par l'usage au point de vue de la sensibilit proprement dite, se fortifie en mme temps par l'usage et tend se
transformer en besoin.
Nous venons de voir, en effet, qu' ct du plaisir de la nouveaut
il y en a un autre qui tient l'accommodation et l'accoutumance. Si,
d'un ct, l'tre vivant a une tendance varier et diversifier son action pour la sentir, de l'autre, il a une tendance conserver l'tat acquis. Toute acquisition tend se conserver et durer telle qu'elle est
acquise. C'est la loi de l'inertie en mcanique, la loi de la conservation
de la force, la loi de la moindre action et de la moindre rsistance.
Toutes ces lois expriment un mme fait, que Spinoza a dfini : l'effort de l'tre persvrer dans l'tre . De l, ct du plaisir de la
nouveaut, le plaisir propre l'habitude. Mme l'impression pnible
finit par [580] s'adoucir par l'accoutumance. La solitude fatigue et attriste celui qui n'y est pas habitu ; celui, au contraire, qui en a pris
l'habitude, ne peut plus s'en priver. Cella continuata dulcescit, dit
l'Imitation. Je sens, dit le Ren de Chateaubriand, que j'aime la monotonie du sentiment de la vie ; et si j'avais encore la folie de croire au
bonheur, je le chercherais dans l'habitude.
Le charme de l'habitude a un tout autre caractre que celui de la
nouveaut. Celui-ci saisit et surprend l'imagination ; celui-l s'insinue
en nous lentement, doucement, insensiblement. Il nous a lis et captivs avant que nous ayons commenc nous en apercevoir. mesure
que nous habitons le mme lieu, que nous faisons les mmes actions,
que nous voyons les mmes personnes, il s'tablit entre nous et ces
objets des liens dont nous ne sentons la force que quand il faut les
rompre. C'est ce qui explique que le nouveau lui-mme, quelque doux
qu'il soit, puisse nous devenir pnible. Pour qu'il plaise, il faut qu'il
soit le divertissement, non le renversement de nos habitudes. Par
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
530
exemple, il est agrable de parler de temps en temps une langue trangre, mais il est cruel de renoncer pour jamais la langue maternelle.
Il est doux de voyager, mais il est pnible de changer de domicile. Il
est agrable de faire de nouvelles connaissances, mais il est insupportable de changer d'amis. Ainsi l'habitude acquise permet des intermdes et des diversions, mais elle se rvolte contre un changement
absolu et contre l'invasion trop brusque d'une habitude nouvelle.
Le plaisir de l'habitude n'est pas le seul fait qui paraisse en contradiction avec la loi de relativit. Il y a des inclinations qui ne paraissent
pas dcrotre par la jouissance et par l'usage, et d'autres mmes qui
s'approfondissent et s'enracinent davantage avec le temps.
Par exemple, les apptits naturels, le plaisir du boire et du manger,
ne semblent pas soumis la loi de dcroissance qui s'impose en gnral nos inclinations. Tandis que le [581] plaisir des liqueurs fortes et
des narcotiques va toujours en 'accroissant et demande des excitations de plus en plus fortes, au contraire le plaisir d'un verre d'eau
frache en t quand on est altr est toujours le mme tous les ges
de la vie. Les gourmets se fatiguent des mets les plus pics ; mais
ceux qui ont un bon apptit conservent jusqu' la fin le mme plaisir
goter les mets les plus simples. Sans doute, l'apptit et la facult digestive s'affaiblissent avec le temps ; mais c'est l'affaiblissement des
organes ; ce n'est pas l'affaiblissement du plaisir comme plaisir, ainsi
que cela arrive pour les passions. On peut dire qu'il y a dans ce fait
une sorte de prvoyance de la nature. Comme le got est un adjuvant
des plus ncessaires la nutrition, et que la saveur des aliments est
dj un commencement de digestion, comme on sait qu'il est impossible de manger lorsque le got est momentanment suspendu, on peut
dire que la nature a donn aux nerfs gustatifs une plus grande vitalit,
une rsistance plus grande la paralysie, une facult de rviviscibilit
plus grande, afin qu'elle subsiste jusqu'aux derniers moments de la
vie. C'est de mme que l'homme garde avec l'ge la facult de voir,
d'entendre, de marcher, et qu'il ne perd jamais, si ce n'est au dernier
moment, la manducation, la digestion, l'absorption. La persistance de
nos apptits naturels signifie donc simplement que ce sont des facults
sensitives plus lentes s'affaiblir que les autres. Elles n'en sont pas
moins soumises dans une certaine mesure la loi de la relativit ; car
elles ont besoin, pour s'exercer, de rmission et de varit. L'interruption priodique de ces fonctions et le mlange des solides et des li-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
531
quides ainsi que des diffrentes sortes de nourritures rpondent cette
loi. Il n'en est pas moins vrai que les apptits naturels, relatifs la nutrition, sont plus susceptibles de conservation et de persistance que les
autres inclinations des sens.
Il y a d'autres cas encore o les inclinations et les passions, bien
loin de dcrotre avec le temps, vont au contraire en s'enracinant et en
s'accentuant de plus en plus.
[582]
Maine de Biran, dans son Mmoire sur l'habitude, a signal avec
profondeur plusieurs de ces faits :
Lorsque les motions, dit-il, sont provoques par les images des
sens, c'est--dire par des images prcises, arrtes, la loi de la sensibilit est alors la loi ordinaire de la relativit ; mais lorsque l'imagination
nous reprsente des images vagues, obscures, indtermines, de vritables fantmes, la passion qui en nat devient profonde, tenace, nergique, et elle ne fait que s'approfondir et s'assombrir avec le temps.
Telle est la passion de la superstition et du fanatisme, qui, au commencement, est plus ou moins combattue par d'autres images, mais
qui devient irrsistible et implacable.
Ds que les tableaux mystiques et tous les effets du dlire superstitieux commencent s'tablir dans l'imagination, ils la remplissent en ne
cessant de l'obsder, ne lui laissant plus de relche. Les mmes images, les
mmes sentiments, les mmes pratiques, loin de s'attidir par l'influence
ordinaire de l'habitude, prennent au contraire plus d'ascendant ; charme ou
tourment, c'est un besoin, et un besoin toujours plus pressant. Les fantmes inhrents la passion dont ils sont devenus les idoles semblent tre
pour son organe ce que sont les irritants artificiels pour les organes des
sensations : mme sensibilit, mme inquitude, mme besoin d'enregistrer des impressions auxquelles l'habitude a exclusivement li un sentiment de l'existence qui tend incessamment se raviver. 86
Biran explique de la mme manire comment certaines passions,
loin de s'affaiblir par l'habitude et par l'usage, deviennent de plus en
86
Maine de Biran, uvres (dit. Cousin), tome Ier, p. 148.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
532
plus opinitres, fatales, invtres ; par exemple, l'ambition, la passion
du jeu. C'est qu'elles sont constamment alimentes par les mmes
images et par des images qui, comme les ides superstitieuses, prsentent un miroir trompeur de tableaux indtermins qui ravivent constamment la passion.
[583]
Ce sont les perspectives vagues, illimites, les hasards, les chances
diverses de l'ambition et de la gloire ; c'est l'attrait idal des jouissances attaches un grand pouvoir, une grande force de situation, qui entranent
tant d'hommes dans cette carrire brillante et les y fixent ensuite par besoin, par habitude, malgr les dgots, l'insuccs. C'est encore ce vague du
dsir des craintes et des esprances, ces obstacles vaincre, ces ides de
puissance, qui alimentent l'amour du jeu, l'avarice, et les rendent insatiables.
L'habitude, dans tous ces cas, loin de fltrir l'imagination, lui rend au
contraire plus chers les mmes mobiles d'activit, la fixe opinitrement
dans la mme direction, et rive les fers qui l'y tiennent asservie ; mais c'est
que dans l'unit du but il y a une grande varit de moyens, dans un seul
genre d'excitations une foule de modes divers.
C'est peut-tre toujours la mme image qui poursuit le jeune homme
amoureux ; mais de combien d'accessoires variables son imagination se
plat la nuancer ! L'ambitieux contemple dans un poste lev, le conqurant voit dans la gloire, l'avare dans son or, la reprsentation d'une multitude de biens, d'avantages, de jouissances, qui se diversifient l'infini ; car
le monde imaginaire est sans bornes. Ainsi, enchan d'un ct par l'habitude, libre de l'autre dans ses excursions, l'imagination trouve dans ses
mobiles appropris tout ce qui peut flatter la fois deux penchants gnraux, dont le contraste fait harmonie dans le monde moral : l'un, principe
de mouvement qui donne l'tre actif un besoin perptuel de changer ;
l'autre, principe d'inertie qui retient l'tre faible et born dans le cercle
troit de ses habitudes.
Il est vrai que les passions, mesure qu'elles se satisfont davantage, causent de moins en moins de plaisir ; mais la passion ne s'teint
pas pour cela. Elle se transforme en besoin. Elle s'incorpore l'tre, et
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
533
revient l'tat de tendance primitive. On le voit, lorsque quelque accident vient rompre l'uniformit de la jouissance, on s'aperoit alors que
ce qui paraissait nous tre devenu tout fait indiffrent s'tait, au
[584] contraire, tellement assimil nous, que nous ne pouvons plus
nous en sparer. On n'a qu' s'interroger soi-mme et se demander si
l'on voudrait tre priv de ces biens qu'on possde, mais dont on ne
jouit plus. On sent alors de quelle ncessit ils sont pour nous. Quelquefois mme il semble que la satit soit alle si loin, que mme
l'imagination ne s'tonne plus de l'ide de la privation, et que l'on croit
n'avoir plus aucune attache. Mais que l'exprience soit faite, que la
rupture ait lieu malgr nous d'une manire inattendue, on sent bien,
par le vide que l'on prouve, que l'me tait, sans le savoir, remplie
par les liens dont elle se croyait dgote. Ainsi l'ambitieux qui est
arriv mpriser le pouvoir dont il jouit, qui en est las, et qui dit tout
le monde qu'il voudrait en tre dlivr, est capable de mourir si on le
prenait au mot.
C'est cette transformation de la passion en besoin qui fait que,
lorsque l'me est devenue insensible au plaisir, elle est encore sensible
la douleur. Combien d'hommes souffrent de la jalousie, quand ils
n'ont plus d'amour ! combien du moindre drangement physique, lorsqu'ils croient n'aimer plus la vie ! combien dsesprs lorsque le
moindre accident menace leur fortune, quoique depuis longtemps ils
se soient blass sur les plaisirs que donne la richesse !
Il faut encore, au point de vue de la continuit des sentiments, distinguer la passion et les affections. Les passions proprement dites, qui
donnent naissance des plaisirs trs vifs, trs violents, trs tumultueux, voient le plaisir disparatre rapidement ; et si, comme dans les
prcdents, elles se transforment en besoins, c'est toujours au dtriment du plaisir. Les affections, au contraire, qui sont des tats stables
( ), qui sont aussi ncessaires la vie morale que
les apptits naturels la vie physique, se ressentent trs peu de l'action
du temps et rsistent la loi de relativit et de variabilit. L'amour maternel s'affaiblit-il par le temps ? Au contraire, il semble devenir d'autant plus vif et exigeant. L'amour conjugal, quoiqu'il perde de sa fracheur [585] avec l'ge, s'enfonce au contraire de plus en plus dans
l'me, et la pense d'une sparation invitable lui cause de vritables
terreurs. On ne voit pas non plus que l'amour de la patrie, que le sentiment esthtique, diminuent avec l'ge. L'lment passionn qui est
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
534
ml ces affections peut sans doute se refroidir et s'amortir ; mais le
fond de l'affection continue subsister.
En un mot, pour appliquer une distinction emprunte Malebranche, on peut dire que la sensibilit se compose de deux choses :
l'amour de l'tre et l'amour du bien-tre. Or, le sentiment du bien-tre,
c'est--dire la sensibilit aux plaisirs, va toujours en s'affaiblissant ;
mais l'amour de l'tre subsiste. Chez les vieillards, l'amour de la vie
est trs nergique, tandis qu'ils sont de plus en plus insensibles aux
plaisirs. Le besoin de socit subsiste chez eux, mme lorsqu'ils sont
le plus grondeurs et le plus gnants pour ceux qui les entourent.
Nanmoins, quelque force que puisse conserver telle ou telle affection, il est vrai de dire en gnral que la sensibilit suit la loi de la vitalit, qu' mesure que les fonctions s'affaiblissent, la facult d'aimer
diminue. On ne saurait donc trop se prmunir d'avance contre les dtachements de l'ge. Il faut entretenir en soi le plus longtemps possible
la flamme de la vie, en essayant de prserver, par l'ide du devoir, les
plus grandes facults du cur humain.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
535
[586]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE DEUXIME
LES PASSIONS
Leon XI
LOIS DASSOCIATION
ET DE COALESCENCE
Retour la table des matires
Messieurs,
Il y a des objets qui sont immdiatement cause d'un plaisir rel et
incontestable : par exemple, la nourriture pour celui qui a faim, la
boisson pour celui qui a soif. Il n'y a pas chercher l'explication de
ces plaisirs et des passions qui en sont la source. Mais il y a des cas o
un objet qui nous est indiffrent par lui-mme nous devient cher, et est
l'objet d'une vive passion, parce qu'il se rattache un autre objet qui
nous est cher par lui-mme. Les passions ainsi veilles sont des passions par association, et en quelque sorte par accident. Elles ressemblent ce qu'on appelle dans l'intelligence des perceptions acquises,
rsultat de l'habitude, de l'exprience et de l'association. Il arrive aussi
que les passions se fondent les unes dans les autres, et forment par
leur assemblage des passions nouvelles et originales. De l deux nouvelles lois, voisines et distinctes l'une de l'autre : la loi d'association et
la loi de coalescence.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
536
I. Loi d'association.
Retour la table des matires
On sait quelle importance ont prise, dans la thorie de l'intelligence, les explications associationistes. On a essay d'appliquer la
sensibilit les mmes principes d'explication, et mme on peut dire
que c'est par la sensibilit que ce mode d'explication a commenc, et
qu'il a t de l transport l'intelligence.
Il y a environ huit ans, j'appris que M. Gay, qui vivait [587] alors,
assurait que tous nos plaisirs et toutes nos peines drivaient de l'association de nos ides ; cela m'engagea en examiner le pouvoir. Ce fut peu
prs dans ce mme temps que M. Gay donna au public ses penses sur ce
sujet, dans une dissertation sur le principe fondamental de la vertu, mise
la tte de la traduction de l'Origine du mal, de l'archevque King, faite par
M. l'archidiacre Law. Mes recherches sur la puissance de l'association me
conduisirent en examiner les consquences. 87
Mais, de part et d'autre, il faut distinguer les cas o cette explication est lgitime des cas o elle est hypothtique et mme arbitraire.
De ce que l'on n'admettrait pas en gnral que l'association est un
principe d'explication pour tous les cas, il ne s'ensuivrait pas qu'on ne
dt l'admettre pour aucun cas ; et rciproquement, de ce qu'on l'admet
pour certains cas, il ne s'ensuit nullement qu'on doive l'admettre pour
tous.
En outre, aussi bien pour l'intelligence que pour la sensibilit, si
l'on veut bien comprendre le mode d'explication dont nous parlons, il
faut prcisment distinguer les cas o il s'offre de lui-mme et o il est
facile de le mettre en vidence parce qu'il est caractris, des autres
cas simples et immdiats en apparence et qui paraissent rfractaires
celle explication.
87
Hartley, Observations sur l'homme, 1729, trad. en franais par l'abb Jurain
sous ce titre : Explication physique des sens, des ides et des mouvements,
1755.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
537
Considrons donc d'abord les faits particuliers parfaitement rels
auxquels la loi s'applique manifestement. Spinoza nous fournit la formule trs nette et trs exacte de cette loi :
Si l'me a t affecte la fois de deux passions, aussitt que dans la
suite elle sera affecte de l'une d'elles, elle sera aussi affecte de
l'autre. 88
Par exemple, si la joie que nous prouvons voir une certaine personne se trouve concider avec la douleur de la [588] perte d'une autre
personne qui nous est chre, la mme joie renouvellera la mme douleur.
Le mme fait peut se produire pour un objet qui nous est par luimme indiffrent. Une chambre o un ami est mort nous cause une
sensation douloureuse, quelque indiffrente qu'elle nous et t dans
une autre circonstance.
C'est encore ce que Spinoza exprime dans la proposition suivante :
Une chose quelconque peut causer par accident la joie, la tristesse et
le dsir.
Nous comprenons par ce qui prcde comment il peut arriver que
nous aimions ou que nous hassions certains objets sans aucune cause,
mais seulement, comme on dit, par l'effet de la sympathie et de l'antipathie. ce mme ordre de faits il faut rapporter la joie et la tristesse dont
nous sommes affects l'occasion de certains objets, cause de la ressemblance qu'ils ont avec ceux qui nous affectent de ces mmes passions. 89
Par cela seul que nous imaginons qu'une certaine chose est semblable par quelques endroits un objet qui d'ordinaire nous affecte de joie
et de tristesse, bien que le point de ressemblance ne soit pas la cause efficiente de ces passions, nous aimons pourtant cette chose ou nous la
hassons. (III, 16.) Quand une chose nous affecte habituellement d'une
impression de tristesse, si nous venons imaginer qu'elle a quelque res88
89
III, 14.
thique, III, prop. 13 et scolie.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
538
semblance avec un objet qui nous affecte ordinairement d'un sentiment de
joie de mme force, nous aurons par cette chose, en mme temps, de la
haine et de l'amour. (III, 17.)
En consquence, ces diffrentes lois nous expliquent les passions
qui nous agitent :
l Pour les objets indiffrents en eux-mmes, par exemple les objets ayant appartenu nos parents, nos amis, les reliques [589] des
saints, le souvenir des grands hommes, une pe, une couronne, un
manuscrit ;
2 Pour les personnes qui ont quelque ressemblance avec celles
que nous aimons : par exemple Descartes avait de la sympathie pour
les personnes louches, parce qu'il avait aim dans sa jeunesse une
jeune fille, nomme Francine, qui tait louche ; on explique encore
par l la haine contre les personnes dont nous ne partageons pas les
opinions ;
3 Les objets qui nous seraient peut-tre indiffrents par euxmmes, mais qui nous plaisent par le souvenir des motions qu'ils
nous ont fait prouver autrefois : c'est ainsi que La Bruyre nous parle
des vieillards qui admiraient dans dipe le souvenir de leur jeunesse . C'est ainsi que nous aimons non seulement ce qui nous a plu
tant jeune, mais encore ce qui a plu nos parents. De l l'amour des
souvenirs, des traditions de famille, des ftes domestiques.
Il peut encore arriver que nous prouvions des sentiments indfinissables et dont il nous est impossible de deviner l'origine, et qui se
rattachent des motions antrieures, des expriences oublies.
Herbert Spencer a dvelopp ce point de vue dans un morceau charmant, o l'on trouve plus d'motion qu'il n'en montre ordinairement
dans la philosophie.
Seules les rares personnes qui se sont livres l'analyse de leur
propre conscience savent que le croassement des corneilles leur est
agrable parce qu'il a t li jadis avec une multitude sans nombre de
leurs meilleurs plaisirs : avec la cueillette des fleurs sauvages dans
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
539
l'enfance, avec l'excursion du samedi soir, aux jours de cong, avec
les parties de campagne en plein t, quand on laissait l les livres et
qu'on remplaait la classe par les jeux et les aventures travers
champs, avec les matines fraches et ensoleilles de l'ge mr. Et
maintenant ce cri, quoiqu'il ne soit pas li d'une manire causale
tous ces plaisirs, mais simplement parce qu'il leur a t souvent associ, rveille une conscience obscure de ces plaisirs, comme la vue d'un
vieil ami [590] apparaissant chez nous l'improviste rveille soudain
un flot d'motions rsultant du souvenir de notre camaraderie passe.
Maintenant, de ce que l'association joue un rle important dans la
formation d'un bon nombre de nos sentiments, faut-il en conclure
qu'elle les explique tous ? Cette thorie est venue du besoin de rduire
le plus possible le nombre des motions lmentaires innes et de ramener tout l'exprience. Mais, de quelque manire que l'on s'y
prenne, il faudra toujours admettre un certain nombre d'motions lmentaires, et alors peu importe le nombre.
Par exemple, on admettra ; bien qu'au moins au point de vue physique, certaines sensations lmentaires sont irrductibles : par
exemple que la faim et la soif ne peuvent se rduire l'une l'autre. En
supposant mme que ces deux sensations aient une origine commune
confondue dans une organisation rudimentaire, toujours est-il que leur
sparation ou distinction ne tient aucun phnomne d'association. Il
en est de mme des plaisirs des sens. Le plaisir de la vue est irrductible au plaisir de l'oue et au plaisir de l'odorat ; et quand mme on
rduirait tous ces phnomnes au toucher, la dcomposition du plaisir
du toucher en plaisirs spcifiques de diffrente nature n'a rien voir
avec l'association : c'est un rsultat naturel et spontan du dveloppement de la nature ; ce n'est pas un fait de combinaison artificielle.
Au fond, la thorie associationiste des motions n'a pas tant pour
but de supprimer des faits positifs lmentaires, que de chercher expliquer les sentiments moraux par le moyen des sensations physiques.
Au lieu d'admettre qu'il peut y avoir des motions morales lmentaires, comme il y a des sensations physiques, on veut que toute motion ne soit l'origine qu'une sensation physique. C'est ainsi que M.
Bain, cherchant l'origine des motions tendres, la trouve dans le fait
de l'embrassement. C'est un plaisir naturel pour l'homme d'embrasser
ses semblables, et il ne parle ici que du fait du contact ; car, le phnomne de l'embrassement tant un phnomne complexe, [591] il se-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
540
rait tout aussi lgitime d'en faire la consquence que le principe des
motions tendres. Mais, suivant M. Bain, il y a un plaisir spcial dans
ce contact d'un tre vivant, en ce que l'on sent la chaleur rpondre la
chaleur, le mouvement rpondre au mouvement. Cela pos, par suite
de l'association, l'objet qui nous cause le plaisir du contact finit par
nous plaire par lui-mme indpendamment de tout contact : de l le
plaisir des motions tendres.
M. Bain n'a pas de peine, on le comprend, expliquer de cette manire l'amour des deux sexes l'un pour l'autre. Il est probable mme
que c'est l qu'il a puis l'ide de sa thorie. Il trouve encore un certain
appui pour sa thorie dans les rapports qui unissent la mre l'enfant.
On sait, en effet, que la mre a un vif plaisir et une tendance trs forte
embrasser son enfant : c'est le propre des mres tendres. De mme
les enfants affectueux sont en gnral clins ; ils aiment embrasser et
tre embrasss. Mais dans ce cas-l le plaisir de l'embrassement peut
tre tout aussi bien l'effet que la cause du sentiment affectueux. Il est
naturel qu'on cherche se rapprocher le plus possible de ce que l'on
aime ; et pourquoi le plaisir de l'embrassement ne serait-il pas la manifestation d'un sentiment inn d'affection et de sympathie ? Ainsi, l'hypothse n'est nullement prouve, mme pour ce cas qui, aprs l'amour
du sexe, est le cas le plus favorable.
Mais qui fera-t-on croire que l'amiti, pour les hommes, ne soit
que le plaisir de s'embrasser ? Remontera-t-on jusqu' une humanit
anthistorique, jusqu' l'origine de l'espce, o l'on peut supposer tout
ce qu'on veut ? Il ne s'agit plus alors de la loi d'association ; il y faut
joindre la loi d'volution et d'hrdit dont nous parlerons plus tard ;
mais, en attendant, aucun fait psychologique connu n'autorise confondre l'affection de l'homme pour l'homme avec le plaisir du contact.
M. Bain fait valoir le plaisir de la poigne de main, qui serait l'embrassement rduit son minimum. Mais la poigne de main n'est
qu'un signe ; et personne ne pensera qu'on affectionne un autre
homme pour avoir le plaisir de [592] lui donner la main : outre que ce
plaisir serait le mme quelle que ft la personne, et le caractre exclusif de l'amiti n'est nullement expliqu par l.
plus forte raison l'on n'expliquera pas par l le plaisir de la sympathie et de la piti. Nul n'prouve le dsir d'embrasser une personne
couverte d'ulcres, et l'on peut cependant avoir de la piti pour elle.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
541
D'ailleurs le plaisir du contact et de l'embrassement n'est pas le
seul plaisir des sens que les hommes nous fassent prouver. Nous
avons du plaisir les voir, les entendre, aussi bien qu' les toucher.
Pourquoi se borner au plaisir du contact ? Mais la question revient
toujours. Est-ce parce que nous avons du plaisir voir, entendre,
toucher les hommes, que nous les aimons ? N'est-ce pas plutt parce
que nous les aimons que nous avons du plaisir les voir, les entendre, les toucher ? En d'autres termes, sur quoi se fonde-t-on pour
ramener la sensibilit morale la sensibilit physique, lorsque l'on
peut tout aussi bien supposer que la sensibilit physique n'est que
l'introduction ou l'accompagnement de la sensibilit morale ?
II. Loi de coalescence.
Retour la table des matires
la loi d'association se rattache une autre loi qui la complte. C'est
ce que nous avons appel la loi de coalescence. Nous entendons par l
la fusion d'un grand nombre de sentiments diffrents qui par leur runion en forment un seul, lequel devient un sentiment original distinct
de tous ceux qui le composent, comme dans les combinaisons chimiques le compos a des proprits absolument diffrentes de celles
du composant. Parmi ces sentiments complexes, il en est deux surtout
que l'on peut signaler. Ce sont le patriotisme et l'amour proprement
dit, ou le penchant qui porte les deux sexes l'un vers l'autre.
Le patriotisme, tel qu'il est compris dans les pays civiliss, est essentiellement une passion complexe forme par l'agglutination [593]
de nombreux lments divers. Ces lments sont les suivants :
1 L'amour du sol natal, c'est--dire de la portion de territoire o
l'on est n, et qui a t parcourue par nos premiers pas ; c'est ce qu'on
appelle le pays. Ce premier sentiment est l'amour du clocher, et il est
lui-mme form par association. C'est le plaisir que nous font prouver les lieux auxquels se rattachent toutes nos habitudes et tous nos
souvenirs. Peu peu, ce premier territoire o s'est coule notre enfance se dveloppe et s'largit. Du village il s'tend au canton, la
province, et enfin jusqu' la surface entire du sol qui constitue la pa-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
542
trie. Mais il faut alors que d'autres sentiments viennent se mler
l'amour du sol. Car quelle passion particulire pourrait s'attacher un
vaste territoire que, la plupart du temps, nous ne connaissons que de
nom ?
2 Le second sentiment, qui se mle au prcdent, c'est l'amour de
nos concitoyens, c'est--dire de ceux qui habitent avec nous le mme
pays, le mme territoire, et plus particulirement ceux qui parlent la
mme langue.
3 L'amour du territoire et des sentiments communs qui composent
l'histoire d'un peuple. Lorsqu'on a t ml en commun de grands
vnements, il s'tablit entre tous les concitoyens d'un mme pays une
solidarit qui va jusqu' la fusion complte ; et c'est ainsi que se forment les peuples, les nations, etc.
4 L'unit des lois et du gouvernement.
Lorsque ces diffrents lments, sol, langue, drapeau et souvenirs
nationaux, lois communes, sont runis et mls ensemble, et qu'ils ont
dur un certain temps, on peut dire qu'il s'est form une patrie. Ce sentiment complexe peut subsister encore en partie lorsqu'il n'en subsiste
que des dbris, et mme lorsque le tout s'est dissous.
Ainsi des colons loigns de la mtropole, c'est--dire du sol natal,
retrouvent encore la patrie dans une langue commune, des murs et
des traditions communes. Le sol fait dfaut, mais le souvenir subsiste ;
dans d'autres cas, la nation [594] a perdu son indpendance, elle est
associe malgr elle aux destines d'un matre indiffrent ou ennemi,
comme la Pologne et l'Irlande. Il y a encore l cependant les vestiges
d'une patrie. Les peuples nomades transportent leur patrie avec eux.
Pour eux l'amour de la patrie n'est que l'amour de la tribu. Souvent les
petites patries se fondent dans une grande ; c'est ce qui est arriv pour
la France, dans laquelle les diverses provinces taient plus ou moins
des nations. C'est ce qui arrive aujourd'hui pour l'Allemagne, o les
petits tats ont disparu, noys dans la grande unit germanique. Ainsi
le temps fait et dfait des patries. Le sentiment qui y correspond est
donc un sentiment complexe, form d'lments variables, et cependant
ce sentiment a videmment une individualit et se distingue de ses
lments. Il n'est pas l'amour du clocher proprement dit, car il est sou-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
543
vent en contradiction avec lui. Ce n'est pas l'amour de la famille,
quoiqu'il y ait aussi son origine. Ce n'est pas le plaisir de parler une
langue commune, puisque cela peut avoir lieu pour des nationalits
diffrentes. Ce n'est pas d'avoir ml ses armes dans une guerre commune, puisque cela peut avoir lieu avec des allis. C'est tout cela, et
c'est autre chose : c'est un sentiment sui generis ; et ainsi le compos
peut tre essentiellement diffrent des composants.
On peut en dire autant de la passion de l'amour, telle qu'elle existe
dans les pays civiliss. C'est le mlange d'un grand nombre de sentiments divers qui se fondent avec le temps dans un sentiment unique
absolument original, d'une puissance extraordinaire, et qui se distingue profondment des lments qui le composent.
Comme la patrie, c'est d'abord un lien physique qui en est la base
et le substratum. Il repose sur la diffrence des sexes. Mais cet instinct
tout physique, qui est commun l'homme et l'animal, se distingue
profondment de ce que nous appelons l'amour. En effet, l'instinct du
sexe est indtermin : c'est une passion indfinie qui s'adresse au sexe
en gnral, et non tel ou tel individu. Il peut tre satisfait par [595]
quelque objet que ce soit ; tout au plus peut-il tre limit par l'ge ou
quelque dfaut extrieur ; mais, dans ces conditions, son champ est
illimit. Au contraire, le caractre propre de l'amour passion, c'est le
choix et l'exclusion. C'est une passion essentiellement lective et qui
se dtermine par un grand nombre de considrations diffrentes de
l'apptit du sexe, quoique cet instinct en soit la base. Ces lments
composants sont : l la beaut, ou, si l'on veut, l'attrait, car le sentiment de l'amour n'est pas la mme chose que le sentiment esthtique.
L'artiste pourra choisir pour modle telle personne dont il ne voudrait
pas pour amante, et rciproquement. Nanmoins, le beau, la grce, le
charme, en un mot un lment esthtique vient se mler l'instinct des
sens. Il s'y joint encore l'affection : car il peut y avoir amiti, affection
tendre entre des personnes de sexe diffrent. Il s'y joint aussi le commerce de l'esprit ; car, quoique l'attrait intellectuel ne soit pas toujours
ncessaire pour rattacher l'un l'autre deux personnes de sexe diffrent, on sait cependant que le mouvement de l'esprit et le charme de la
conversation sont un lment trs puissant de la passion de l'amour ; et
dans le monde, c'est ordinairement par l que les passions commencent. M. Herbert Spencer ajoute encore ces lments l'amour de
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
544
l'approbation et le sentiment de la libert. Mais c'est tendre beaucoup
le cercle de cette passion.
D'autres circonstances interviennent encore pour exciter, complter, exalter le sentiment de l'amour. Par exemple, les obstacles sont
une puissance irritante qui exasprent la passion. Souvent, au contraire, c'est la facilit de se voir et une intimit continue qui introduisent l'amour par le chemin de l'habitude. L'amour varie encore suivant
l'ge et selon qu'il est accompagn d'ignorance ou d'exprience. Il varie suivant la condition sociale, et il se teint volontiers des couleurs
propres l'imagination potique des peuples et des sicles. Enfin il se
complique avec les innombrables conflits qui naissent des lois sociales et des devoirs imposs par la morale. On voit qu'un tel sentiment est essentiellement une rsultante.
[596]
Un philosophe allemand, Schopenhauer, a donn de l'amour une
thorie qui a t fort admire, mais qui ne mrite pas, selon nous, cette
admiration. L'amour ne serait pour lui que l'instinct de l'espce qui
poursuit l'immortalit, et qui se sert des individus comme d'instruments pour atteindre ce but. Cette thorie explique bien ce qu'il y a
d'idal et d'infini dans la passion de l'amour : c'est qu'elle reprsente
l'infinit de l'espce. Mais autrement, l'explication est tout fait insuffisante. Car il s'agt d'expliquer le fait du choix : pourquoi le sentiment
indtermin de l'espce se circonscrit-il entre deux individus particuliers et devient-il lectif ? On dit que ce choix est l'uvre de l'inconscient qui croit pouvoir le mieux assurer ainsi la reproduction de l'espce. Mais c'est l une thse toute conjecturale. Il n'est pas prouv
que la passion de l'amour contribue, plus que l'instinct du sexe, proprement dit, la bonne perptuation de l'espce. On s'appuie sur des
proverbes de bonnes femmes, savoir que les enfants de l'amour sont
toujours beaux. Mais cela repose-t-il sur quelque fondement positif ?
Lorsque le pre de Frdric II voulait s'assurer de beaux soldats, il ne
s'en rapportait pas l'amour, mais il choisissait lui-mme les plus
beaux hommes pour les marier aux plus fortes paysannes, afin de perptuer une solide race de grenadiers. Il faudrait prouver aussi que les
unions par l'amour sont les plus fcondes ; ce qui n'a rien d'tabli. Les
paysans, qui ont peu de temps donner l'amour, ont de nombreuses
familles et de beaux enfants. Les citadins, chez lesquels la civilisation
a dvelopp ce sentiment un haut degr, ont des familles moins
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
545
nombreuses et moins vigoureuses. Il est vrai qu'il y a bien des lments considrer ; mais cela mme prouve que nous avons affaire
un sentiment compos, et non un sentiment simple comme serait
celui qui rsulterait d'un instinct inn de la nature.
Ce qui fait l'originalit et la force particulire du sentiment de
l'amour, c'est qu'il est la fusion intime d'affections toutes morales avec
un instinct tout physique. C'est ce mlange qui cause le trouble d'imagination et la vivacit d'motion [597] qui caractrise cette passion.
S'il n'y avait que la sympathie pour l'esprit, ou l'affection pour le caractre, nous n'aurions que l'amiti pure et simple sans les sentiments
tumultueux qui accompagnent l'amour. L'amiti est fade quand on a
connu l'amour, dit La Roche Foucauld. S'il n'y avait que le sentiment esthtique, nous n'aurions qu'un sentiment semblable celui que
nous prouvons en face d'un spectacle de la nature. S'il n'y avait que
l'instinct du sexe, ce serait une passion plus brlante sans doute, mais
non plus leve que celle du boire et du manger. Au contraire, c'est la
fusion de ces lments qui fait la force de l'amour. C'est le seul de nos
instincts moraux qui devient physique, le seul de nos instincts physiques qui devienne moral. Par exemple, l'instinct de la nourriture
reste toujours quelque degr un instinct animal ; il ne se relve que
par les raffinements de la cuisine, par le mlange des autres sens et par
quelque satisfaction esthtique donne par l'arrangement des festins,
et, dans les cas de fte, par le mlange des fleurs et des sons. Mais,
d'une part, ces accessoires sont trs limits, et de l'autre ils sont encore
et demeurent matriels. On peut, il est vrai, relever beaucoup le plaisir
de la nourriture par ceux de la conversation, de la famille, de l'amiti.
Mais ces deux sortes de plaisirs restent toujours distincts et ne vont
jamais jusqu' la fusion intime. Il n'y a pas, en effet, un sentiment
unique qui se compose la fois et des plaisirs du palais et des plaisirs
de la conversation et de l'amiti. Rciproquement, il n'y a gure d'instinct moral qui soit en mme temps un instinct physique. L'amour maternel est celui qui se rapprocherait le plus de cette ide, parce que
l'enfant fait partie du corps de la mre, qu'elle lui a donn sa nourriture ; mais ce lien vient bientt se rompre, et il n'en subsiste que de
lointains vestiges. En gnral, l'amiti, l'amour des hommes, mme
l'amour de la pairie, ne se composent d'lments physiques qu'en tant
que l'homme lui-mme ne peut tre li aux autres hommes que par
quelque rapport physique ; mais il n'y a pas l de sensation propre-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
546
ment dite ; ce qui se rapproche le plus de l'amour [598] sous ce rapport, ce sont les sentiments esthtiques, et surtout la musique, qui se
compose aussi, en effet, de sensations et de sentiments. Aussi ont-ils
quelque analogie avec l'amour et s'unissent-ils volontiers avec lui : ils
l'alimentent comme ils s'en alimentent. Mais l encore il y a des diffrences profondes, sur lesquelles il est inutile d'insister.
Il y a donc des sentiments drivs que l'analyse peut ramener
leurs composants et qui n'en sont pas moins originaux pour cela. De
ce que ces sentiments ne sont pas absolument primitifs (et qui prouve
mme qu'ils n'aient pas plus ou moins toujours exist sous une forme
quelconque ?) faut-il en conclure que ces sentiments ne sont pas des
sentiments naturels, au mme titre que les autres ? Je ne le crois pas.
Ils sont un dveloppement naturel des sentiments primitifs. Ils sont
surtout un agrandissement et un perfectionnement de ces sentiments.
Le dveloppement de l'instinct est un fait aussi naturel que l'instinct
lui-mme.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
547
[449]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE DEUXIME
LES PASSIONS
Leon XII
LOI DE CONTAGION
ET LOI DU RYTHME
Retour la table des matires
Messieurs,
Nous tudierons aujourd'hui deux lois bien connues : la loi de contagion et la loi du rythme : la premire, en vertu de laquelle les passions se communiquent d'homme homme spontanment et sans intervention de la volont ; la seconde, en vert
u de laquelle chaque passion est sujette des associations d'excitation et de rmission, et que l'on peut appeler aussi loi de fluctuation.
I. Loi de contagion.
Pour ce qui est de la premire loi, rien n'est plus connu que ce fait
de la contagion des passions. Les sentiments vifs prouvs par un
homme sont toujours susceptibles de se rpercuter dans l'me des
autres hommes ; et l'on sent toujours plus vivement ce qu'on sent en
commun.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
548
Ce fait est manifeste, par exemple, au thtre, o une salle vide
nous glace, tandis que si elle est remplie nous sommes plus disposs
rire ou pleurer, selon que la pice est gaie ou triste. C'est ce fait
qu'Adam Smith a si bien dcrit sous le nom de sympathie, et dont il a
fait le principe de sa morale. On connat les vers d'Horace : ut ridentibus arrident, ita flentibus afflent humani vultus. Cette communication
du sentiment est d'autant plus vive et plus nergique que le nombre
des personnes est plus grand. Dans une arme, il suffit que [600]
quelques-uns soient anims d'un courage hroque pour entraner les
autres ; et il en est malheureusement de mme pour la peur : de l ces
terribles paniques qui perdent les armes. De mme, dans une runion
d'coliers, quelques lves laborieux donnent aux autres le ton et imposent l'amour du travail ; de mme aussi, dans les rvoltes scolaires,
la discorde n'est jamais le fait de la foule, mais seulement de
quelques-uns qui entranent les autres. Le mme fait se reproduit sur
une plus vaste chelle dans des troubles politiques. Il suffit que
quelques-uns manifestent des sentiments violents pour que les autres
les suivent. C'est ce qu'on a appel la folie des foules. Il y a des pidmies morales comme des pidmies physiques. Les convulsionnaires de Saint Mdard, les trembleurs des Cvennes, les possdes de
Loudun, appartiennent par le fait aux deux classes. Il en est de mme
des spirites de nos jours. Il y a aussi des pidmies purement morales.
Le Werther de Gthe a dtermin une pidmie de suicide. On dit
aussi que les Brigands de Schiller avaient provoqu un certain nombre
de jeunes gens former des ligues et des socits antilgales. La terreur est aussi une des passions les plus facilement communicables ; il
en est de mme des passions rvolutionnaires et religieuses, et aussi
des vices et des vertus ; mais malheureusement bien plus des vices
que des vertus, parce que la contagion trouve une complicit puissante
dans les sensations naturelles du cur humain. C'est au nom de cette
loi de contagion que les ducateurs de tous les temps ont insist sur le
choix des socits, sur les exemples, sur les milieux dans lesquels les
enfants ou les jeunes gens doivent tre placs.
quoi lient ce phnomne remarquable de la contagion ? D'aprs
l'cole positiviste, qui tend introduire partout des phnomnes mcanistes et associationistes, il n'y aurait rien d'autre l qu'une simple
tendance la reproduction des signes extrieurs des passions : la reproduction de ces signes extrieurs suggrerait par voie d'association
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
549
les ides des phnomnes [601] intrieurs qui y correspondent, et enfin ces ides suggreraient leur tour les sentiments correspondants.
Ainsi la vue du rire provoquerait le phnomne du rire ; celui-ci amnerait sa suite l'ide de la joie, et cette ide de la joie serait alors suivie du sentiment de la joie. Telle est l'explication de M. Lon Dumont,
dans son livre intitul Thorie scientifique de la sensibilit.
Cette explication repose sur des faits rels. C'est, en effet, une des
lois les mieux connues de la psychologie que l'ide suggre les mouvements, et que les mouvements suggrent l'ide. L'ide seule du billement nous fait biller ; l'ide des nauses provoque la nause. Rciproquement, sachant que cette motion est lie tel signe extrieur, ce
signe rveille en nous l'ide de cette passion. Notre attention est provoque par l se porter sur elle et sur sa cause. Voyant quelqu'un
rire, nous sommes involontairement conduits rechercher pourquoi il
rit, tandis qu'autrement nous n'y aurions peut-tre point song. De
plus, nous sommes forcs de concentrer notre attention sur l'objet risible, tant que nous voyons cette personne rire, moins d'exercer un
vritable effort sur nous-mmes pour l'en dtourner. Il en rsulte que
nous sommes dtermins, dans la compagnie d'autres personnes, rire
plus souvent et plus longtemps que si nous tions seuls. On peut
mme affirmer que, dans ce cas-l, c'est celui dont le temprament est
le plus dispos rire qui provoque le plus longtemps et le plus vivement la contagion du rire chez les autres. Il en est de mme de la parole. Il suffit qu'un orateur donne sa voix un accent plus ou moins
triste pour faire prendre ses auditeurs une expression plus ou moins
triste de physionomie.
Ces faits sont confirms par des expriences inverses. M. Lon
Dumont cite ce qu'il appelle le fait de la contagion ngative. C'est, par
exemple, lorsque, jugeant que les sentiments d'une personne sont en
dsaccord avec la situation dans laquelle elle se trouve, nous prenons
en quelque sorte sa place et, nous mettant dans la situation o elle est,
nous manifestons [602] des sentiments contraires ceux qu'elle
prouve, mais conformes ceux qu'elle doit prouver.
Autre contre-preuve : il arrive quelquefois que, dans une assemble de rieurs, nous sommes les seuls qui ne rions pas ; et mme nous
sommes d'autant plus ports au srieux par les excs mmes d'une hilarit intemprante. Rien ne nous glace plus qu'un excs d'motions
que nous ne partageons pas. Il faut donc, pour qu'il y ait contagion,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
550
une certaine harmonie ou proportion entre l'tat de notre me et le milieu o nous nous trouvons. C'est l un fait de contagion ngative.
C'est parce que nous nous transportons par l'imagination dans l'tat o
le sujet devrait tre que tout ce qui dpasse cet tat produit en nous
l'tat contraire.
Tous ces faits sont vrais. Mais suffisent-ils expliquer le sentiment
de la sympathie ? Sans doute il faut bien qu'il y ait une expression externe des sentiments internes des autres hommes, pour que nous
soyons amens partager leurs sentiments : car il va de soi que si
nous ne savons pas ce qui se passe en eux, nous n'avons aucune raison
de nous mettre au mme ton qu'eux ; mais le signe extrieur n'est ici
qu'un intermdiaire, une cause occasionnelle. Il ne suffit pas de dire
que le signe rveille l'ide et que l'ide rveille le sentiment, car nous
pouvons bien avoir la pense d'une chose sans en avoir le sentiment.
Je puis trs bien penser la joie sans prouver de la joie ; et souvent
mme la pense de la joie d'autrui provoque en nous de la tristesse.
Mais on peut dire qu'en raison de la similitude de nature, la joie ou la
tristesse des autres hommes est pour moi une source de joie ou de tristesse. Si donc nous nous trouvons dans des circonstances qui par ellesmmes veillent la joie et la douleur, nous jouissons ou nous souffrons
doublement d'abord par l'objet lui-mme, et ensuite par la joie que
nous prouvons de voir les autres se rjouir et par la douleur de les
voir souffrir. N'est-il pas vident, par exemple, que nous prouvons du
plaisir dans la joie des enfants et dans le bonheur de la jeunesse, sans
tre nous-mmes ni enfants ni jeunes ? Mais le spectacle de [603] la
joie est par lui-mme un spectacle agrable ; et, de mme, quand nous
assistons une scne de deuil, nous souffrons de la douleur des autres.
En outre, nous pouvons trs bien sympathiser avec les motions
des autres hommes, sans reproduire les signes extrieurs de ces motions. Par exemple, quand nous voyons les enfants sauter de joie, nous
prouvons de la joie sans avoir besoin de sauter nous-mmes. La vue
de la fuite peut, nous inspirer de la crainte, mme lorsque nous restons
immobiles. Lorsque nous voyons un malade gmir ou crier, nous souffrons avec lui sans rpter ses cris ou ses gmissements. Ainsi la production de la sympathie n'a pas besoin de cet intermdiaire purement
machinal qui consisterait dans la reproduction des signes extrieurs. Il
faut donc se borner dire que la simple ide du sentiment rveille le
sentiment par voie d'association. Mais pourquoi n'admettrait-on pas
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
551
une cause encore plus directe ? Pourquoi les hommes, tant semblables, n'prouveraient-ils pas un certain plaisir dans le sentiment de
leur similitude ? C'est ce qu'on voit dans les reprsentations thtrales,
o nous jouissons des douleurs d'autrui. Ce n'est pas l une joie
goste et cruelle. C'est la joie de reconnatre en nous-mmes la source
des motions que l'on nous reprsente.
Il faut d'ailleurs distinguer deux phnomnes voisins l'un de
l'autre : l'imitation et la contagion. Cette distinction a t faite avec
sagacit par M. Marion dans son beau livre de la Solidarit morale.
Le mme auteur fait remarquer avec raison qu'il y a une contagion du
bien aussi bien qu'une contagion du mal, une contagion de la sant
aussi bien que de la maladie. Les bonnes motions se transmettent
comme les mauvaises. Au thtre, tout le monde sympathise avec la
victime et prouve de l'antipathie pour le tratre ou le tyran, quoiqu'il y
ait peut-tre dans la foule quelqu'un qui ait jou plus d'une fois le rle
de tyran ou de tratre.
Adolphe Garnier prtend que les passions sont contagieuses, et que
les inclinations ne le sont pas. Ainsi la joie et la tristesse, la terreur et
l'tonnement, la crainte et l'esprance, [604] sont trs contagieuses.
Au contraire, l'avarice, la passion du jeu, l'ambition, ne le seraient pas,
et quand elles paraissent l'tre, dit Garnier, c'est cause des passions
dont elles sont la source. Nous avons de la peine admettre cette thorie. Il est bien connu que les hommes se communiquent leurs inclinations aussi bien que leurs passions, surtout lorsqu'elles sont mauvaises. Autrement, pourquoi craindrait-on tant pour les jeunes gens les
mauvaises compagnies et les mauvais exemples ? Qui ne sait, par
exemple, que l'amour du jeu est trs contagieux ? Il en est de mme, et
plus encore, du libertinage.
Ce qu'il y a peut-tre de vrai dans l'analyse de Garnier, c'est que les
passions se communiquent immdiatement et en quelque sorte lectriquement d'homme homme (par exemple dans les paniques), tandis
que les inclinations demandent quelque temps pour se modifier par
l'exemple d'autrui. Un jeune homme chaste et timide ne prendra pas
got immdiatement au libertinage. Un homme modr dans ses gots
ne prendra pas got du premier coup l'agiotage ou aux jeux de
bourse. Mais dans un milieu o rgnent de telles inclinations, il y a
bien des chances pour qu'un individu prenne peu peu le pli et les
sentiments de ceux qui l'entourent. la vrit, cette contagion est
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
552
d'autant plus rapide que ces mmes gots prexistent en puissance
chez tous les hommes et n'attendent qu'une occasion d'clater. Cependant le contraire peut aussi se produire lorsqu'il y a trop d'cart entre
les inclinations des autres et les ntres, et alors l'antipathie largit encore l'opposition. Mais nous avons vu qu'il en est de mme pour les
passions :
Spinoza a connu la loi de contagion comme la loi d'association, et
il l'a rsume dans la proposition suivante :
Par cela seul que nous nous reprsentons un tre qui nous est semblable (et pour lequel nous n'avons aucune passion) comme affect luimme d'une certaine passion, nous ressentons une passion semblable la
sienne. (III, 17.)
Mais il y a une condition : c'est que notre semblable nous [605]
soit indiffrent ; car s'il tait l'objet de notre haine, nous serions affects d'une passion contraire la sienne. (III, 23.)
plus forte raison, s'il s'agit d'un objet aim. Celui qui se reprsente l'objet aim comme saisi de tristesse ou de joie prouve les
mmes affections, et chacune d'elles sera plus ou moins grande dans
celui qui aime, selon qu'elle est plus ou moins grande dans l'objet aim. (III, 21.)
Enfin il y a une autre sorte de contagion, signale par Ad. Garnier.
C'est la contagion, non point d'me me, mais de passion passion,
d'inclination inclination. Ainsi tous les plaisirs des sens s'attirent l'un
l'autre ; de mme toutes les inclinations s'attirent l'une l'autre suivant
leurs analogies et leurs affinits : L'amour du beau rveillera donc
l'amour du vrai ; les affections du cur se tiennent ensemble. Celui
qui a t tendre fils est tendre pre et ami de l'humanit. Il en est
aussi de mme, malheureusement, pour les vices et les mauvaises passions.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
553
II. Loi du rythme.
Retour la table des matires
Une autre loi vient se joindre aux prcdentes : c'est la loi du
rythme.
La psychologie cossaise avait signal comme le caractre propre
des apptits, c'est--dire des besoins corporels, la priodicit. Par
exemple, les apptits de la faim et de la soif naissent et s'apaisent
des poques fixes ; et il en est de mme du besoin de sommeil. Les
psychologues anglais les plus rcents ont gnralis ce caractre, et ils
en ont fait une des lois de la passion, et en gnral de la vie, et mme
enfin de l'univers. Ce n'est pas le lieu de signaler l'importance gnrale de la loi de priodicit : dans l'ordre physique, l'alternative des
saisons, l'alternative du jour et de la nuit, de la vie et de la mort ; en
physiologie, les maladies priodes, les gnrations alternantes, l'hrdit alternante, telles sont les manifestations principales de cette loi
gnrale. Il nous suffira de montrer [606] les applications aux passions. Sans doute on ne peut pas signaler une priodicit heure fixe
comme pour les apptits ; mais, d'une manire plus gnrale, et avec
moins de rgularit dans l'apparition et la disparition des phases, les
passions passent par des alternatives de force et de faiblesse, de haut
et de bas. Herbert Spencer a exprim cette loi dans une page trs intressante :
Tout le monde peut observer chez soi et chez les autres des ondulations dans le plaisir et la douleur. D'abord la douleur ayant son origine
dans un dsordre corporel manifeste presque toujours un rythme facile
reconnatre. Durant les heures o elle ne cesse jamais rellement, elle a ses
variations d'intensit, ses accs ou paroxysmes ; puis, aprs ces heures de
souffrance viennent des heures de bien-tre relatif. La douleur morale
nous prsente galement des ondes analogues, les unes plus grandes, les
autres plus petites. Un homme en proie une vive douleur ne pousse pas
continuellement des gmissements et ne verse pas toujours des larmes
avec le mme abandon. Aprs un temps durant lequel alternent les ondes
d'motions plus faibles et plus fortes, survient, comme si l'motion tait
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
554
assoupie, un temps de calme auquel succde un autre intervalle durant lequel elle se rveille et devient une douleur atroce avec des sries de paroxysmes. Il en est de mme pour un grand plaisir, surtout chez les enfants, qui ne sont pas aussi matres de leurs motions. On y voit des variations manifestes dans l'intensit des sentiments. Des clats de rire, des accs de danse, spars par des repos o les sourires et d'autres faibles signes
de plaisir suffisent donner issue une motion amoindrie. Il y a mme
des ondulations mentales qui prennent plus de temps que celles-ci et qui
demandent des semaines, des mois, des annes pour se complter. Bien
des personnes, sinon toutes, ont leurs priodes de vivacit ou d'abattement.
Il y a des temps d'ardeur au travail et des temps de paresse ; des temps
pendant lesquels on s'occupe avec zle de certains sujets et l'on s'abandonne certains gots, et des temps [607] pendant lesquels on nglige les
mmes ludes et les mmes gots. 90
Nous avons eu occasion nous-mmes de signaler cette loi lorsque
nous avons parl des lois des passions dans la littrature ; et nous
l'avons appele loi de fluctuation, loi du flux et du reflux. 91 Tout le
monde sait que lorsqu'on est boulevers par une passion, il sufft de
s'y abandonner un instant pour qu'il se produise instantanment un
mouvement en sens contraire, surtout s'il s'agit de lutter entre des passions diverses. Dans la jalousie, par exemple, la haine alterne avec
l'amour ; si c'est la haine qui l'emporte pour un moment avec le dsir
de la vengeance, aussitt l'amour prend le dessus, avec la sduction de
la personne aime, les souvenirs, le repentir, etc. ; mais peine la balance a-t-elle pench de ce ct, qu'elle se relve de l'autre. Nous
avons signal Racine comme le pote qui a le mieux connu celle loi
de bascule, et qui a le mieux su en faire usage.
Il est pass matre dans la peinture de ces contradictions. Il les
connat si bien, cette loi lui est si familire, qu'on pourrait presque dire
qu'il s'en est fait un procd. Quiconque comparera ses diffrents monologues en trouvera la coupe singulirement semblable ; c'est toujours le oui et le non se combattant l'un l'autre et se remplaant alternativement. Le hros ou l'hrone vont-ils prendre un parti, on est sr
que leur imagination va leur suggrer immdiatement le parti conHerbert Spencer, 2e partie, ch. x.
91 Voir notre livre sur les Passions dans la' littrature du dix-septime sicle.
90
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
555
traire ; s'abandonnent-ils celui-ci, le premier revient immdiatement,
jusqu' ce que ce va-et-vient s'arrte et qu'une circonstance dcisive
fasse pencher la balance une dernire fois.
Prenons pour exemple le monologue d'Hermione. Le trouble de
l'me est indiqu ds les premiers vers :
Ah ! ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais ?
[608]
Cependant il semble que la haine domine, car l'offense est toute rcente :
Le cruel ! de quel il il m'a congdie !
Et pourtant la tendresse combat pour lui :
Et, prte me venger, je lui fais dj grce.
Ce sentiment l'emportera-t-il ? Au contraire, il suffit d'y avoir cd
un instant pour que la colre reprenne tout son empire :
Non, ne rvoquons point l'arrt de mon courroux ;
Qu'il prisse !
Mais c'est prcisment cet arrt une fois prononc qui va rveiller
la clmence de l'amante en furie :
Eh quoi ! c'est donc moi qui l'ordonne ?
Elle va prononcer un sursis, attendre encore :
Ah ! devant qu'il expire,
lorsque Clone vient rallumer sa colre par la description du mariage
de Pyrrhus, faite avec des traits qui semblent choisis exprs pour
exasprer Hermione ; ds lors le sort en est jet :
Le perfide ! Il mourra.
L'impatience mme est telle qu'elle craint la faiblesse d'Oreste :
Quoi donc ! Oreste encore,
Oreste me trahit ?
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
556
Ainsi, on le voit, c'est au moment o Pyrrhus semble sur le point
d'chapper au supplice qu'Hermione le condamne sans piti. Heureux,
elle le veut mort ; mort, elle reporte sa haine sur le meurtrier ; toujours
en contradiction avec elle-mme, voulant ce qui n'est pas et ne voulant
pas ce qui est. Rien ne nous montre la passion plus prs de la folie ;
elle ne peut finir que par l ou par la mort. Tel est en effet le double
dnouement d'Andromaque : le suicide d'Hermione et les fureurs
d'Oreste. Une suite de secousses contradictoires ne peut que [609] briser la corde : c'est ce qui arrive ncessairement lorsque la passion est
seule et sans contrepoids.
Nous avons dit que Racine s'est laiss un peu entraner par la facilit de ce procd, et que le passage du pour au contre devient, dans la
plupart de ses monologues, une sorte de figure de rhtorique un peu
monotone, quoique souvent riche en effets puissants. Mme la forme
extrieure a son moule presque toujours le mme. D'abord le personnage commence par s'interroger lui-mme : O suis-je ? dit Hermione. Titus, que viens-tu faire ? se dit Titus dans Brnice.
Que faut-il que je fasse ? se dit Roxane. Tu ne le crois que
trop, se dit Mithridate. Que vais-je faire ? dit Agamemnon.
Puis les diffrentes phases de la dlibration sont marques par des
non, des oui et des mais qui se succdent alternativement, suivant des
lois fixes, comme la bascule d'une machine. Par exemple, Roxane
vient de dcouvrir l'amour d'Attalide et de Bajazet, et elle s'crie :
O Ciel ! cet affront m'auriez-vous condamne ?
Bientt la balance remonte : Mais peut-tre qu'aussi Puis elle
se tranquillise : Non, non, rassurons-nous. Enfin la bascule a lieu
en sens inverse : Mais, hlas ! de l'amour Voyez maintenant le
monologue de Mithridate. N'est-ce pas exactement le mme tour et le
mme mouvement ? Mais ne connais-je pas le perfide Pharnace ?
Non, ne l'en croyons point. Mais par o commencer ?
Oui, sans aller plus loin De mme Agamemnon dans Iphignie :
Mais ma fille en est-elle mes lois moins soumise ? Que disje ? que prtend ? Non, je ne puis, cdons Mais
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
557
quoi ! peu jaloux de ma gloire Cependant, si ces formes trop peu
varies peuvent tre critiques au point de vue littraire, elles sont
d'un grand intrt au point de vue psychologique : ainsi que les formes
d'une division scolastique, elles marquent avec prcision les diverses
nuances du dveloppement d'une passion ; elles en sparent nettement
les articulations distinctes et nous permettent de retrouver la loi qui se
[610] dissimule sous le dsordre apparent du phnomne. cet excs
de mthode, on reconnat un lve de Port-Royal.
III. Loi de diffusion.
Retour la table des matires
Cette loi, signale surtout par les psychologues anglais, a rapport
aux effets organiques des passions, et surtout leur rayonnement et
leurs contrecoups dans le systme nerveux. Il ne s'agit pas de la question, souvent dbattue par les physiologistes, du sige des passions
(cerveau, cur ou viscres ?). Il s'agit de leur effet gnral sur l'organisation entire. La thorie de la diffusion se rencontre donc avec celle
de l'expression. Car les mouvements nerveux qui sont les effets des
passions en deviennent l'expression. Seulement il faut distinguer, selon Herbert Spencer, deux sortes de dcharge nerveuse, l'une diffuse,
l'autre restreinte. C'est principalement la seconde qui constitue le langage spcial des motions : la premire n'est pas, proprement parler,
un langage : car elle ne se diversifie pas suivant les diverses motions.
Elle n'est que le signe de la passion en gnral, mais non de telle ou de
telle passion.
Tous les sentiments, dit Spencer, ont pour caractre commun de causer une action corporelle dont la violence est en proportion de leur intensit. Nous voyons le choc des dents, le renversement des traits, la contraction des poings, accompagner les douleurs corporelles aussi bien que la
rage ; les cheveux se dresser dans la colre aussi bien que dans le dsespoir ; on danse de joie, comme on pitine de colre ; on ne peut pas plus
rester en place dans la dtresse morale que dans l'excitation dlicieuse
Par la nature de ses mouvements dans le combat ou dans la course, nous
jugeons qu'un animal est sous l'empire d'un sentiment violent d'une espce
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
558
quelconque, que ce soit de la souffrance, de la colre ou de la terreur, ou
que ce soit, comme quand les mouvements sont des bonds superflus et des
courses circulaires, un sentiment de plaisir.
[611]
Parmi les muscles habituellement excits par des dcharges diffuses,
se trouvent ceux des organes vocaux, la fois les muscles respiratoires et
les muscles du larynx. De l ce fait que le sentiment en gnral, sans distinction de nature, est d'ordinaire indiqu par des sons d'autant plus forts
qu'il est plus violent. Les cris qui accompagnent la souffrance corporelle
ne peuvent tre distingus en eux-mmes de ceux qui accompagnent la
douleur de l'me, et il y a des cris d'angoisse comme des cris de volupt :
souvent les bruits que font les enfants dans leurs jeux laissent les parents
dans le doute si c'est le chagrin ou le plaisir qui en est la cause.
Si le trait le plus remarquable de la dcharge diffuse est qu'elle produit une contraction proportionne en force l'intensit du sentiment, il en
est un autre moins saillant, savoir que, toutes choses gales d'ailleurs,
elle affecte les muscles en raison inverse de leur importance et du poids
des parties auxquelles ils sont attachs. Supposez qu'une onde faite d'excitation nerveuse se propage uniformment dans le systme nerveux, la part
de cette onde qui se dchargera sur les muscles signalera davantage son effet l o la somme d'inertie vaincre sera le moins considrable. Les
muscles qui sont gras et qui ne peuvent manifester les tats d'excitation
qu'en faisant mouvoir les jambes ou d'autres masses pesantes ne fourniront
point de signes, tandis que les plus petits muscles et ceux qui peuvent se
mouvoir sans rsistance rpondront visiblement cette onde faible (par
exemple le mouvement de la queue chez le chien et chez le chat, le mouvement de l'oreille chez le cheval, le renversement des yeux, la contraction
des sourcils, le sourire, chez l'homme).
C'est une erreur de croire que les muscles de la face ont t spcialement destins l'expression. L'indication des tats spirituels est galement fournie par le mouvement des pieds et des mains. Battre le tambour
avec ses doigts sur la table est une marque d'impatience ; tirailler et dchirer quelque chose qu'on tient la main, un gant par exemple, trahit une
agitation qui n'est pas visible autrement. Faire claquer [612] ses doigts indique un esprit joyeux ; balancer le pied libre est une marque de bonne
humeur ou d'impatience. Dans tous ces cas on reconnat le mme principe,
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
559
savoir que les muscles qui rencontrent le moins de rsistance trahissent
les premiers l'excitation qui s'lve.
Cependant, dans les derniers faits cits, il y a dj quelque chose
de plus qu'une simple dcharge diffuse, c'est--dire une expansion indtermine du flux nerveux se produisant au hasard et se manifestant
en proportion du degr de rsistance ; il y a en outre l'expression : car
ce ne sont pas les mmes mouvements qui sont signes de la douleur
ou de la joie. Disons seulement que c'est un cas particulier de la diffusion.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
560
[449]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE DEUXIME
LES PASSIONS
Leon XIII
LA LOI DVOLUTION
Retour la table des matires
Messieurs,
la loi d'association que nous avons mentionne plus haut viennent se rattacher deux lois nouvelles auxquelles la philosophie moderne attache avec raison une grande importance, quoiqu'elle en exagre la porte. Ce sont : la loi d'volution et la loi d'hrdit.
La loi d'volution consiste tablir que les passions et les sentiments ne sont pas l'origine ce qu'ils deviennent avec le temps ; que,
sous l'influence des circonstances, de diverses associations, de l'habitude, du milieu, et enfin des ides ou des passions accessoires qui
viennent s'y mler, les sentiments primitifs vont toujours en se compliquant et finissent par prendre une forme entirement nouvelle.
La loi d'hrdit consiste dire que l'acquisition des passions et
des sentiments ainsi obtenus se fixent et se transmettent par l'hrdit,
et finissent par devenir une seconde nature ( , comme dit
Aristote), qui elle-mme son tour est susceptible d'volution et d'hrdit.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
561
Ces deux lois runies permettent d'expliquer, selon les nouveaux
empiristes, par l'exprience, l'habitude et l'association, les sentiments
qui nous paraissent les plus naturels et les plus inns.
Nous devons dire de la loi d'volution ce que nous avons dit de la
loi d'association, savoir que l'on peut bien mettre en doute que cette
loi soit la loi exclusive, unique et fatale, par laquelle s'expliqueraient
toutes nos inclinations et toutes nos passions ; mais ce que l'on ne peut
mettre en doute, c'est [614] qu'elle est une loi relle et vraie, et qu'elle
explique au moins un grand nombre de nos inclinations, sinon toutes,
et qu'elle en explique surtout les modes de manifestation et d'apparition.
Quant la loi d'hrdit, elle se rattache la loi d'volution ; mais,
comme nous le verrons, elle ne se confond pas avec elle. Elle a d'ailleurs aussi elle-mme sa part de vrit qu'il ne faut pas mconnatre,
lors mme qu'on n'admettrait pas qu'elle est toute la vrit.
Mais, pour apprcier le systme qui explique toutes nos inclinations par l'volution et l'hrdit, il faut d'abord se rendre compte des
cas o elle est incontestable.
Pour dmontrer la loi d'volution, il suffit de constater que les inclinations humaines n'ont pas toujours t les mmes toutes les
poques de l'histoire, et que dans un mme temps elles ne sont pas les
mmes aux diffrents degrs de civilisation que prsente simultanment l'esprit humain. Par exemple, il suffit de comparer le sentiment
de la pudeur et de l'instinct du sexe chez les sauvages, avec les mmes
sentiments chez les nations civilises, l'amour du clan et de la tribu
chez les peuples barbares, qui n'est que le dveloppement de l'amour
de la famille, avec l'amour de la patrie chez les nations modernes ; ou
encore les sentiments esthtiques des sauvages, borns au got des
ornements brillants, des couleurs vives et des objets sonores, ou encore une musique monotone qui se distingue peine des bruits de la
nature ; de les comparer, dis-je, au sentiment esthtique des nations
civilises, allant jusqu' produire le Parthnon, les Vierges de Raphal, le Don Juan de Mozart, Hamlet ou Athalie. Enfin, les sentiments de sociabilit ont pass galement par une volution semblable.
Le cannibalisme, les vendettas, les sacrifices humains, la torture, sont
les signes d'un tat psychologique o la sympathie tait bien moins
dveloppe qu'aujourd'hui. L'horreur du sang est un sentiment qui s'est
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
562
dvelopp avec le temps, mais qui existe peine dans les temps barbares.
Tous ces faits taient bien connus avant l'volutionnisme ; [615] ils
taient classs sous le nom de la doctrine du progrs. Quelle diffrence y a-t-il entre l'ide de progrs et l'ide d'volution ? De part et
d'autre il y a l'ide de dveloppement ; mais dans le progrs le dveloppement va dans le sens du mieux. Le progrs, c'est le perfectionnement. L'volution ne relient qu'une chose du progrs : c'est l'ide de
dveloppement et de transformation, sans y faire intervenir aucune
cause finale. En second lieu, l'volution suppose que le changement
s'opre par accumulation graduelle de faits nouveaux qui viennent
s'associer et se coaguler avec les prcdents. Encore cette ide d'un
dveloppement continu n'est-elle pas absolument ncessaire, puisqu'il
y a des partisans du transformisme brusque, qui laisse subsister des
intervalles entre les diffrentes phases du dveloppement.
Quoi qu'il en soit des diffrences qui peuvent exister entre la loi du
progrs et la loi d'volution, voici quelques-uns des faits qui s'expliquent par cette loi d'volution.
Par exemple, Herbert Spencer 92 a expliqu ainsi qu'il suit l'volution de la sympathie.
Il y a trois causes principales, dit-il, la sympathie : 1 celle qui
unit les membres d'une mme espce animale ; 2 celle qui unit le
mle et la femelle ; 3 celle qui unit les parents et les enfants. Or la
sympathie se dveloppe en proportion des dveloppements de ces
trois causes. L o la coopration de ces trois agents peut avoir lieu,
les effets de la sympathie sont plus sensibles. De plus, l'effet qu'elles
peuvent produire dpend du degr d'intelligence qui les accompagne :
car, comme nous l'avons vu du reste, l'aptitude la sympathie est lie
la capacit d'unir les ides de certains sentiments la vue des signes
extrieurs (sons ou mouvements) qui nous permettent de supposer
l'existence de ces sentiments chez d'autres hommes.
Ainsi les races les moins sympathiques seront celles o manque la
coopration des trois causes et aussi la condition [616] requise, savoir la facult de se reprsenter idalement les sentiments prouvs
par les autres hommes.
92
Principes de psychologie, 8mC ! partie, ch. v.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
563
Chez les habitants des les Adouran, il n'y a pas de mariage permanent ; une mre, aussitt aprs la naissance de son enfant, est abandonne
par le pre, qui ne l'aide en rien l'lever ; et ainsi font dfaut la fois la
culture de la sympathie qui rsulte des relations directes entre les parents,
et celle qui rsulte de l'intrt commun donn aux enfants. Dans les pays
o domine la polyandrie et o la paternit est incertaine, il n'y a pas non
plus une sympathie aussi vive des hommes pour les enfants que dans la
monogamie.
En outre, le peu de dveloppement de la sympathie est d la lenteur
de dveloppement de la facult reprsentative. Les chtiments gratuits
dont on trouve un si grand nombre dans le pass impliquent videmment
une faible reprsentation de la douleur chez ceux qui les infligent.
On pourrait ajouter un nouvel lment l'analyse de Spencer, savoir le degr de sensibilit du systme nerveux. On peut croire que le
systme nerveux n'est pas galement apte chez tous les hommes ressentir la sensation de douleur. Il y a des tempraments anesthsiques,
c'est--dire ferms la douleur. Or un temprament peut tre plus ou
moins anesthsique, plus ou moins sensible ; les diffrentes parties du
corps ne sont pas aussi sensibles les unes que les autres. On comprend
donc que chez les races primitives le systme nerveux soit relativement grossier par rapport au systme musculaire, et par consquent
trs peu apte ressentir la douleur. Cela peut tre vrai mme chez des
races civilises : par exemple les Chinois, que l'on nous reprsente
comme capables de supporter des tortures incroyables. Il est donc
probable que le dveloppement de la civilisation a amen un dveloppement ou raffinement du systme nerveux, et par consquent de la
sensibilit la douleur. Or, la sympathie tant en proportion de la sensibilit individuelle, on comprend qu'elle se soit dveloppe avec cette
sensibilit.
Herbert Spencer explique aussi par des raisons semblables [617]
comment la sympathie a pu se dvelopper dans un sens et s'amortir ou
rester amortie dans un autre sens :
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
564
La race humaine, bien que vivant en troupe, a t et est encore une
race prdatrice. La conservation de chaque socit a dpendu de deux
groupes de conditions qui, considres en gnral, paraissent antagoniques. D'un ct, les activits destructives, offensives et dfensives lui
ont servi se dfendre des interventions extrieures, et cela a exig que la
nature de ses membres reste telle que les activits destructives ne leur
soient pas douloureuses, et mme qu'elles leur soient agrables. En
somme, il faut que leurs sympathies pour les douleurs ne puissent les empcher d'en infliger d'autres. D'autre part, pour que la socit puisse progresser, un certain degr de sentiments affectueux est ncessaire. Si les
hommes d'une tribu ne se souciaient pas plus les uns des autres qu'ils ne se
soucient du salut de leurs ennemis, ils ne pourraient se prter les uns aux
autres cette confiance rciproque ncessaire au progrs.
En consquence, le sentiment affectueux a t continuellement rprim dans la direction o le salut social en rendait le mpris ncessaire,
tandis qu'il lui a t permis de crotre dans la direction o il a servi directement au bien de la socit.
Il y a donc ici une explication de ce fait que les hommes peuvent devenir cruels dans de certaines directions, et non dans les autres. Nous
comprenons par l comment il arrive que tirer un gibier ou forcer un renard sont un plaisir pour des hommes qui ne sont pas seulement tendres,
mais gnreux et justes un degr peu ordinaire dans leurs relations sociales. Et il cesse de paratre trange qu'un vieux soldat qui fait ses dlices
des souvenirs de ses combats n'en montre pas moins de bont pour ceux
qui l'entourent. De mme le chirurgien, en cessant d'tre sympathique pour
les douleurs physiques qu'il est tenu d'infliger ses patients, garde ou bien
acquiert une sympathie plus grande pour les malades l'endroit de leurs
souffrances gnrales.
[618]
Le mme philosophe explique de la mme manire d'autres inclinations qui paraissent tout fait naturelles, par exemple l'instinct de
proprit, la libert politique, l'amour du succs. Il insiste surtout sur
un sentiment trs complexe et d'une nature trs dlicate : c'est ce qu'il
appelle la volupt de la douleur, savoir le plaisir que l'on trouve dans
la souffrance elle-mme et cause de la souffrance.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
565
On explique en gnral ce sentiment par une sorte de piti que l'on
aurait pour soi-mme. Cette explication n'est pas fausse selon Spencer ; mais elle est incomplte. Il suppose que c'est que l'on considre
la douleur comme quelque chose d'immrit, et en mme temps qu'on
se considre soi-mme comme ayant mrit autre chose. On jouit
donc de son propre mrite en opposition avec la perscution dont on
est accabl, soit par les hommes, soit par la Divinit.
notre avis, ce sentiment peut se joindre accidentellement la
douleur et y apporter une sorte de compensation. Mais ce n'est pas, je
crois, l'explication la plus naturelle du fait en question, savoir la volupt de la douleur. Elle viendrait plutt de ce qu'il y aurait une sorte
de soulagement se livrer la douleur. Lorsqu'on prouve un grand
chagrin, et qu'on est forc de se taire, on souffre et de son chagrin et
de la contrarit qu'on s'impose. C'est dans ce sens que la Phdre de
Racine nous dit :
Et, sous un front serein dguisant mes alarmes,
Je devais bien souvent me priver de mes larmes.
Aussitt qu'on est devenu libre, et qu'on peut sans contrainte laisser
clater sa douleur, le soulagement commence.
Dans un sens plus raffin, et sous l'influence d'une civilisation plus
savante, la volupt de la douleur chez Ren, Werther, Childe Harold,
vient de ce qu'on se croit l'objet d'une distinction particulire, en
prouvant de grandes douleurs que les autres hommes ne connaissent
pas. Le succs de la philosophie pessimiste de nos jours n'a pas d'autre
origine. Ce ne sont pas les plus malheureux qui sont les plus pessimistes : [619] ce sont ceux qui croient l'tre. Il est distingu d're malheureux. Il y a quelque chose de bourgeois tre heureux. Necker a
crit quelques pages spirituelles sur le Bonheur des sots. Il aurait pu
aller plus loin et dire que le bonheur par lui-mme, s'il existe quelque
part, a quelque chose de sot. La douleur prouve la sensibilit, et la
sensibilit est une dlicatesse. C'est le signe d'une nature fine et nerveuse qui a de la race. Cela peut tre, en effet, vrai pour quelques-uns,
chez qui une rare puissance de souffrir peut tre une distinction de
nature ; chez d'autres, c'est imitation et habitude ; et l'on se fait pessi-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
566
miste sans se priver d'aucun des plaisirs de la vie. Enfin, d'une manire gnrale, la douleur prouve la vie, et la vie suppose toujours une
certaine puissance de raction ; or cela mme peut tre une cause de
plaisir.
Enfin on peut voir dans Herbert Spencer la part de l'volution dans
l'explication des sentiments altruistes et des sentiments esthtiques.
Il y a donc une part faire l'volution. Cette part peut tre trs
grande. Mais doit-on aller jusqu' dire que tous nos sentiments s'expliquent par l'volution ? C'est une autre question.
Remarquons d'abord qu'il ne faut pas confondre, comme on le fait
d'ordinaire, l'volution et l'hrdit. Il peut y avoir volution sans hrdit et hrdit sans volution.
I. Qu'il puisse y avoir volution sans hrdit, c'est ce que prouve
d'abord l'exemple de l'individu. Chez l'individu, en effet, la passion
subit une certaine volution par le fait seul de l'ge et du milieu. Or, si
l'on peut voir ainsi les passions se diversifier par ces deux causes,
pourquoi n'en serait-il pas de mme de l'espce, et pourquoi le simple
changement de situation sociale, et le dveloppement intellectuel par
voie d'ducation n'amneraient-ils pas des changements effectifs sans
qu'il soit besoin de recourir la loi d'hrdit ? Ainsi certains changements affectifs ayant eu lieu chez quelques-uns (par exemple un
commencement de piti, quelque respect de la femme, l'indpendance
personnelle), pourquoi ces changements [620] ne se communiqueraient-ils point par contagion, par sympathie, par imitation, aux autres
membres de la tribu, et de ceux-ci, par les mmes moyens, leurs enfants ? Ceux-ci, leur tour devenus adultes, ayant commenc goter
ces nouveaux tats de conscience, peuvent tre de plus en plus enclins
les rechercher, les rpandre, les communiquer. L'volution pourrait donc se faire sans aucune hrdit autre que l'hrdit spcifique
de la nature humaine.
Quoi qu'il en soit, la doctrine de l'volution, avec ou sans hrdit,
a pour objet de fortifier l'hypothse exprimentale qui choue lorsqu'il
n'est question que de l'individu seul. Cette hypothse reprendrait sa
force quand elle s'appuie sur l'espce. Voici comment on raisonne.
l'origine, il n'y aurait eu que des plaisirs et des douleurs avec les mou-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
567
vements lis ces deux phnomnes. Le mouvement associ au plaisir
tend se reproduire quand le plaisir reparat en nous litre de souvenir ; et cette association des plaisirs et des maux devient une habitude
que nous appelons dsir et amour. Cette habitude se fortifie par
l'exemple et par des expriences nouvelles chaque gnration. Si l'on
y joint l'hrdit, ce mouvement va plus vite encore. Ces habitudes se
fixent dans l'organisme et tendent reparatre non seulement sous le
plaisir et la douleur, mais mme avant l'apparition de ces phnomnes,
avant que les mouvements aient leur raison d'tre dans l'organisation
elle-mme. C'est ainsi que l'agneau tend se servir des cornes qu'il n'a
pas encore ; c'est ainsi que la petite fille a des instincts maternels et
des instincts de coquetterie dont elle ne comprend ni la raison ni la fin.
Cette hypothse volutionniste et hrditaire donne raison la fois
aux partisans de l'innit et aux partisans de l'empirisme. L'innisme a
raison en ce sens que nos inclinations, nos instincts, sont antrieurs
notre exprience individuelle. Ils prcdent le plaisir et la douleur, qui
ne sont plus que des effets, et non des causes. D'un autre ct, l'hypothse exprimentale aurait raison, au moins l'origine. Ce seraient
l'association et l'exprience qui auraient form des habitudes devenues
[621] plus tard des instincts. Primitivement, le plaisir et la douleur
seraient antrieurs au mouvement ; plus lard le mouvement a anticip
sur le plaisir et la douleur. Telle est l'hypothse volutionniste dans
son ensemble.
Sans la discuter dans son fond, car elle embrasse toute la philosophie, bornons-nous quelques observations qui se rapportent notre
sujet.
1 La loi d'volution ne porte pas ncessairement les consquences
que l'on en tire. L'volution n'est pas contraire l'innit. Leibniz a
fait remarquer que l'on peut trs bien soutenir que la gomtrie est inne, quoiqu'on soit forc d'apprendre la gomtrie. L'volution s'applique ces faits dont on ne peut mconnatre le caractre primitif et
irrductible. Par exemple, nul doute que le sens de la vue ne soit soumis la loi d'volution, au moins individuellement. On apprend
voir ; nul doute que l'artiste n'arrive saisir des nuances de couleur
que l'il inexpriment n'aperoit pas. De mme pour le sens de
l'oue. L'oreille du musicien est aussi loin de l'oreille vulgaire que la
sensibilit actuelle de celle du sauvage. Cependant la vision est bien
considre (au moins dans l'individu) comme un fait primitif et irr-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
568
ductible. On pourra essayer d'expliquer exprimentalement la perception des formes et des figures ; mais la sensation de couleur sera toujours une sensation sui generis. Il faut bien admettre (encore une fois
au moins dans l'individu) l'innit de la sensibilit optique ou acoustique ; et cependant elles sont sujettes l'volution. Si nous appliquons ces principes la sensibilit morale, nous trouverons de mme
que le sentiment peut prendre des formes diffrentes sans cesser d'tre
inn.
En un mot, on admet en psychologie des perceptions naturelles et
des perceptions acquises ; mais il y a deux sortes de perceptions acquises : il y a celles qui viennent du dveloppement et du perfectionnement des sens, et celles qui viennent de leur association avec
d'autres sens. Les premires comme les secondes sont soumises la
loi d'volution, et cependant elles sont innes. Le sens de la couleur
est inn ; car d'o viendrait [622] la sensation de couleur ? Et cependant ce sens se dveloppe et se modifie dans l'individu. Ainsi l'innit
n'est pas exclusive de l'volution. Sans doute un certain nombre de
nos sentiments s'expliquent peut-tre, comme nous l'avons vu, par la
voie de l'association et de l'habitude, mais il n'en est pas de mme ncessairement pour tous.
2 Aussi loin qu'on remonte dans les premiers ges de l'humanit,
soit par l'histoire, soit par l'tude des peuples sauvages, on rencontre
un certain nombre d'inclinations instinctives prexistantes. Elles sont
mme beaucoup plus fortes et plus vives que chez les nations civilises. Lorsqu'un sauvage de l'Amrique se heurte le pied contre une
pierre, il se met en fureur contre elle et la mord comme un chien. On
remarque chez les sauvages une disposition enfantine la joie, le sentiment de l'indpendance, l'impatience de l'autorit. Chez le froce
Fugien, le sentiment de l'amiti est trs dvelopp. On trouve encore
chez les sauvages l'amour de la parure, l'amour de la vengeance,
l'amour des enfants. Ainsi, la passion sous forme d'inclination se rencontre chez les peuples sauvages aussi bien que chez les civiliss. Elle
existe mme chez les animaux. Le point de dpart absolument primitif
est donc en dehors de toute exprience. Il est antrieur non seulement
toute psychologie humaine, mais toute psychologie animale.
Mme avant l'apparition de la conscience, dans les vgtaux par
exemple, on voit apparatre des inclinations, des instincts sympathiques. On ne sait jusqu'o il faudrait remonter pour trouver cet tat
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
569
idal de table rase que l'on ne rencontre nulle part et que personne n'a
jamais pu exprimenter.
3 Si l'on considre exclusivement l'esprit humain, on rencontre un
certain nombre d'inclinations premires et irrductibles : par exemple,
l'instinct de la nourriture ; l'instinct du sexe, qui doit se manifester
avant le plaisir dont il est la source ; l'instinct de conservation, car
on ne se reprsente pas une socit o l'homme n'ait pas fait effort
pour se conserver et pour fuir le danger ; l'instinct d'activit physique ; [623] chez les sauvages comme chez les civiliss, et plus encore, il y a un besoin de dpenser l'activit par le mouvement : les
danses, les jeux, les combats, sont les consquences de cet instinct ;
l'instinct de proprit, car il n'y a aucune socit o l'individu ne
tienne avoir quelque chose en propre ; l'instinct de supriorit ou
de domination, car il n'y a pas de race humaine o l'on ne trouve le
besoin de se distinguer, de se faire admirer et mme obir par les
autres hommes ; la sociabilit : tous les hommes ont toujours vcu
dans un tat de socit. On ne se reprsente pas l'homme vivant isol ;
pour que la sociabilit puisse s'expliquer par l'habitude, il faudrait
prouver que les hommes ont vcu primitivement isols, et que c'est
aprs s'tre rencontrs par hasard et avoir expriment l'utilit de leur
concours, qu'ils ont pris plaisir vivre ensemble ; et c'est ainsi que se
serait form l'instinct de sociabilit ; mais tout porte croire que si les
hommes n'avaient pas form une socit l'origine, il ne s'en serait
jamais form.
Tels sont les instincts qui nous paraissent essentiels toute socit
humaine au minimum. Quant aux sentiments esthtiques, moraux et
religieux, on pourrait croire aussi qu'il y a l une source d'motions
innes, et c'est notre opinion personnelle ; mais il nous suffit d'avoir
dmontr notre ide pour les instincts que nous avons mentionns.
L'hypothse de l'volution a l'avantage de se perdre dans la nuit
des temps, d'chapper toute vrification exprimentale. C'est, proprement parler, une hypothse mtaphysique. Tant que nous ne sortons pas des limites de la psychologie proprement dite, nous n'avons
affaire qu' une volution partielle et non une volution absolue. Il
restera donc toujours un certain nombre d'inclinations en dehors de
l'volution.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
570
[449]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE DEUXIME
LES PASSIONS
Leon XIV
LOI DHRDIT
Retour la table des matires
Messieurs,
Nous avons tudier aujourd'hui la loi que l'on appelle la loi d'hrdit.
Nous dirons de l'hrdit ce que nous avons dit de l'volution. C'est
videmment une loi incontestable ; mais est-ce la loi unique, exclusive, universelle ? C'est l la question.
Il est indubitable d'abord qu'il y a une hrdit physique. Le fait de
la ressemblance des parents aux enfants en est la preuve. Ce fait, qui
nous est si familier qu'on le suppose souvent mme o il n'existe pas,
n'en est pas moins un fait des plus tranges. Il semble que la force inconnue, la cause, quelle qu'elle soit, qui dessine les traits du visage, ait
sous les yeux un modle qu'elle suit dans la reproduction de son
image. Pour qu'un visage, en effet, soit semblable un autre, il faut
que les diverses molcules qui composent chaque partie de ce visage
viennent se placer ct les unes des autres, suivant une ligne qui
dessinera non seulement un nez ou une bouche en gnral, mais tel
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
571
nez et telle bouche absolument, semblables un nez ou une bouche
donns. Comment cette similitude se produit-elle sans modle, sans
conscience, par un art secret et invisible dont les rsultats cependant
sont visibles ? Comment du germe indistinct, homogne, indtermin,
qui constitue le premier commencement de l'tre, peuvent sortir des
diffrenciations qui ne se produiront peut-tre que vingt ans plus tard,
par exemple la couleur de la barbe ? On voit que lorsqu'on aura tout
expliqu par l'hrdit, il [625] restera expliquer l'hrdit ellemme, qui est un fait aussi mystrieux que pourrait l'tre l'innit.
Quoiqu'il en soit de la cause premire de l'hrdit, le fait physique
est incontestable, et il se manifeste mme dans les dtails les plus accidentels. Par exemple, chez les Romains plusieurs grandes familles
taient caractrises par certains traits du visage transmis hrditairement : les Nasones (grands nez), les Labiones (grosses lvres), les
Buccones (grandes bouches) ; les Capitones (grosses ttes).
La dure de la vie est aussi souvent un phnomne hrditaire. Les
Turgot, parat-il, mouraient vers cinquante ans ; et cela s'est vrifi par
le clbre ministre, qui est mort cinquante-trois ans. On cite aussi
des familles de centenaires. En Hongrie est mort, dit-on, en 1724, un
vieillard de cent quatre-vingt-cinq ans, qui laissait un fils de cent cinquante-trois ans. On cite encore, dans le mme ordre d'ides, la lvre
des Habsbourg et le nez des Bourbons. M. de Quatrefage, dans son
livre de l'Unit de l'espce humaine, cite l'exemple d'une famille d'Allemagne qui, pendant plusieurs gnrations, se composait de personnes ayant six doigts.
Les traits et les caractres de l'organisme tant transmissibles par
l'hrdit, il n'est pas tonnant que les maladies soient hrditaires.
Tout le monde sait que les maladies de poitrine, les affections du
cur, le rhumatisme, etc., se transmettent par l'hrdit. Cela est particulirement vrai pour les maladies qui touchent de plus prs au moral, par exemple les maladies nerveuses : ainsi l'pilepsie, la chore,
enfin la folie, ont un trs haut degr ce caractre. Quand on lit les
dossiers des alins, dans les asiles, il y en a bien peu chez lesquels on
ne trouve des traces d'hrdit ; et quand on n'en trouve pas, c'est plutt par dfaut de renseignements, ou dfaut de sincrit dans les renseignements, que par suite de faits contradictoires. Il en est encore de
mme pour les altrations des sens : par exemple la myopie, le daltonisme, le gauchisme, le strabisme, etc.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
572
Arrivons maintenant aux phnomnes moraux.
[626]
A priori, tant donne l'influence gnrale du physique sur le moral, du moment qu'on admet, ce qui n'est pas niable, que le caractre et
le moral dpendent plus ou moins de l'organisation physique, et que
les caractres de l'organisation se transmettent plus ou moins par l'hrdit, on doit conclure que le moral peut se transmettre aussi bien que
le physique.
C'est, suivant les hrditaristes, ce qui a lieu en effet. Et d'abord cela est vrai des inclinations qui touchent de plus prs aux apptits corporels, par exemple l'alcoolisme ou passion des liqueurs fortes, par
exemple encore la manie du suicide, le penchant au vol, le penchant
au meurtre, la passion du jeu, etc. Nous renvoyons pour les dtails et
les exemples au livre de M. Ribot. 93 Contentons-nous d'en rappeler
quelques-uns des plus remarquables.
Le jeu. Une dame avec laquelle j'ai t li, dite Gama Machado, jouissait d'une grande fortune, avait la passion du jeu et passait les
nuits jouer : elle mourut jeune, d'une maladie pulmonaire. Son fils
an, qui lui ressemblait parfaitement, galement passionn pour le
jeu, passait de mme ses nuits jouer ; il mourut de consomption
comme sa mre et au mme ge qu'elle. La fille, qui lui ressemblait
aussi, hrita des mmes gots et mourut jeune.
Le vol : la famille Chrtien. Jean Chrtien, souche commune,
a trois enfants : Pierre, Thomas et Jean-Baptiste.
Pierre a pour fils Jean-Franois, condamn aux travaux forcs
perptuit pour vol et assassinat. Thomas a eu Franois, condamn
aux travaux forcs pour assassinat ; Martin, condamn mort pour
assassinat. Le fils de Martin, condamn pour vol.
Jean-Baptiste a eu pour fils Jean-Franois, poux de Marie Taur
(d'une famille d'incendiaires). Ce Jean-Franois a eu sept enfants :
Jean-Franois, condamn pour plusieurs vols, mort en prison ; Benot
tombe du haut d'un toit qu'il escaladait et meurt ; X., dit Clain, condamn pour divers vols ; Marie-[627] Ren, enferm pour vol ; Marie-
93
Ribot, Hrdit psychologique.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
573
Rose, mme sort ; Victor, condamn pour vol ; Victorine, dont le fils
est condamn mort pour assassinat et pour vol.
Pour prouver l'hrdit des passions, M. Rihot se contente d'voquer les affinits de la passion et de la folie.
Il n'entre pas dans notre sujet de chercher jusqu' quel point la
passion a le caractre fatal de la folie ni quelles consquences pratiques dcouleraient de l. Nous avons voulu montrer seulement :
1 Que des passions qui restent inexplicables tant qu'on les considre dans l'individu isol s'expliquent ds qu'on les suit dans leurs
mtamorphoses travers les gnrations et qu'on les rattache la
grande loi de l'hrdit ;
2 Que la passion est si voisine de la folie que les deux formes
d'hrdit n'en font qu'une, de sorte que nous venons de donner par
avance un chapitre dtach de l'hrdit morbide.
Passons l'hrdit des facults intellectuelles. L'auteur du livre
sur l'Hrdit psychologique se contente ici de suivre l'Anglais Galton, qui a dress des listes d'hommes clbres en se plaant au point
de vue de l'hrdit. Ces listes comprennent des familles de musiciens,
de peintres, de potes, de savants, etc.
L'auteur fait une remarque que je crois trs juste, mais qui va plutt
contre sa propre thse. Il dit que les familles de potes sont plus rares
que les familles de musiciens et de peintres, et il en donne pour raison
que, dans la musique et la peinture, l'organisation matrielle a plus de
part que dans la posie. Cela ne tendrait-il pas prouver que plus l'on
s'loigne des conditions physiologiques, plus l'hrdit devient vague,
obscure, incertaine ? Une autre raison que l'auteur ne donne pas, parce
qu'elle va galement contre sa thse, c'est que la musique et la peinture exigent une ducation spciale et complique que n'exige pas la
posie. Il est trs naturel qu'un pre enseigne ses enfants ce qu'il sait,
la musique s'il est musicien, la peinture s'il est peintre. Il se formera
ainsi des [628] familles de musiciens et de peintres. Il n'en est pas de
mme pour le pote, parce qu'il n'est besoin, pour tre pote, que de
l'ducation gnrale. Le pre ne peut donc que peu de chose pour le
talent potique de son fils. L'hrdit agira toute seule ; aussi sera-t-
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
574
elle trs faible. Quoi qu'il en soit, voici les principales familles cites
par l'auteur.
La famille des Bach est peut-tre le plus beau cas d'hrdit mentale qu'on puisse trouver. Il est sorti de cette famille, dit Flis, pendant prs de deux cents ans, une foule d'artistes de premier ordre. Son
chef fut Bach, boulanger Presbourg, qui se dlassait de son travail
par le chant et la musique. Il avait deux fils, qui commencrent cette
suite non interrompue de musiciens du mme nom qui inondrent la
Thuringe, la Saxe, la Franconie. Tous furent organistes ou chantres de
paroisse. Lorsque, devenus trop nombreux pour vivre rapprochs, les
membres de cette famille se furent disperss, ils convinrent de se runir une fois chaque anne jour fixe, afin de conserver entre eux une
sorte de lien patriarcal. Cet usage se perptua jusqu'au milieu du XVIIIe
sicle, et plusieurs fois on vit jusqu' cent vingt personnes du nom de
Bach runies au mme endroit.
On compte dans cette famille vingt-neuf musiciens minents. Le
plus grand est Sbastien Bach.
Beethoven. Son pre, tnor de la chapelle de l'lecteur de Cologne.
Son grand-pre, matre de la mme chapelle.
Dussek, connu comme compositeur et excutant. Son frre Jean,
excellent organiste. Son frre Franois, bon violoniste. Sa fille Olivia
hrita du talent de son pre.
Mozart. Son pre, matre de chapelle Salzbourg. Sa sur annonait un talent remarquable qui ne s'est pas ralis. Son fils Charles cultiva la musique en amateur. Son autre fils Wolfgang, n quatre mois
aprs la mort de [629] son pre, montra de bonne heure d'heureuses
dispositions pour la. musique.
Caliari (Paul-Vronse). Son pre fut sculpteur. Son oncle, un des
premiers peintres de son temps. Son fils, plein de promesses, mort
vingt et un ans.
Carrache (Louis), fils de Paolo. Trois cousins germains, Agostino,
Annibal et Francesco. Son neveu Antoine, fils naturel d'Annibal.
Claude Lorrain. Son frre, graveur sur bois.
Titien. On trouve dans sa famille neuf peintres distingus.
Les deux Chnier.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
575
Lord Byron. Sa mre devint folle ; remarquable par ses talents mathmatiques. Son grand-pre, l'amiral Byron, navigateur. Sa fille, remarquable par ses talents mathmatiques. Son pre, dissolu.
Les deux Musset.
Les deux Racine.
Les deux Corneille.
L'auteur cite encore Burns et Schiller comme ayant reu de leur
mre une sensibilit extraordinaire.
Les Etienne.
Les Schlegel.
Les Snque.
Les Pline.
Mme de Stal et les Necker.
Les trois Boileau.
Mistress Trollope et son fils Antony.
Hrdit rare chez les philosophes, cause du clibat.
Les Ampre.
Les Bernouilli.
Les Cassini.
[630]
Les Cuvier.
Les Darwin.
Les G. Saint-Hilaire.
Nous n'avons pas l'intention de nier l'hrdit intellectuelle. Nous
l'admettons sans hsiter. Mais il s'agit surtout d'une question de mesure et de degr.
Nous ferons remarquer d'abord que la mthode de M. Ribot, dans
son numration des faits, surtout de ceux qui regardent l'intelligence,
manque un peu d'esprit critique. Il prend les faits grosso modo sans les
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
576
analyser, et souvent il confond l'hrdit des professions avec l'hrdit du gnie. Par exemple, Beethoven avait son pre tnor dans la chapelle de l'lecteur de Cologne, et son grand-pre chanteur dans la
mme chapelle. Il n'y a point l hritage de gnie, mais hritage de
profession. Mais, dira-t-on, pourquoi un gnie musical est-il n dans
une famille de musiciens ? Il est n l comme il serait n ailleurs ;
mais il a trouv l un milieu favorable pour se dvelopper. Peut-tre
sa vocation eut-elle t touffe dans un autre milieu. Voici encore
une famille de violonistes, Francesco Benda : ses trois frres, ses deux
fils et ses deux neveux. Il me semble que l'ducation et l'imitation suffisent expliquer la succession de violonistes dans une mme famille.
L'un ayant russi, les autres ont suivi la mme voie. Il en est de mme
pour Dussek, dont le frre, le fils et la fille ont eu des talents comme
excutants. Mme observation pour Mozart, dont le pre tait matre
de chapelle Salzbourg, et dont le fils cultiva la musique en amateur.
Mme arbitraire pour les peintres : Claude Lorrain, le peintre, a eu un
frre graveur ; le Tintoret, un fils et une fille peintres de portraits.
Parmi les potes, on nous cite les deux Corneille, les deux Racine,
sans se demander s'il y a hrdit de gnie dans ces deux cas, Thomas
Corneille et Louis Racine n'tant que des talents des plus mdiocres.
Enfin on peut reprocher M. Ribot de s'tre renferm exclusivement
dans la liste de M. Gallon. Il n'a rien ajout de son cru ; par exemple il
et pu citer, dans-la peinture, les trois Vernet, Joseph, Carle et Horace ; dans la littrature, [631] les deux Dumas. Ici, il y a manifestement succession de talent, et non seulement de profession ; on peut y
reconnatre de l'hrdit.
Pour nous rsumer sur celle premire critique, il et fallu chercher
des cas o l'on et pu isoler le fait de l'hrdit, en le sparant de celui
de l'ducation et de l'influence du milieu. On trouve, ce nous semble,
un cas semblable dans l'exemple du baron de Chantal, dont le portrait,
dcrit par Bussy-Rabutin, semble le portrait mme de Mme de Svign,
quoique celle-ci et peine connu son pre, puisqu'elle avait cinq ans
quand il est mort.
Voici le portrait.
Il tait extrmement enjou. Il avait un tour tout ce qu'il disait qui
rjouissait les gens ; mais ce n'tait pas seulement par l qu'il plaisait ;
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
577
c'tait encore par l'air et par la grce dont il disait les choses. Tout jouait
en lui.
Mais le plus beau cas d'hrdit que prsente la littrature est peuttre celui d'une femme clbre, d'un grand crivain de nos jours, Mme
Sand. L'hrdit joue un rle si considrable dans l'histoire de cette
illustre personne, qu'elle-mme l'a signal, et qu'elle semble presque
avoir crit ses Mmoires pour faire constater le rle de l'hrdit dans
sa personne. Elle semble donner entendre que sa vie elle a t le
rsultat de l'hrdit.
Donc le sang des rois se trouve ml dans mes veines au sang des
pauvres et des petits ; et comme ce qu'on appelle la fatalit, c'est le caractre de l'individu ; comme le caractre de l'individu, c'est son organisation ; comme l'organisation de chacun de nous est le rsultat d'un mlange
ou d'une puret de races, et la continuation toujours modifie d'une suite
de types s'enchanant les uns aux autres, j'ai toujours pens que l'hrdit
naturelle, celle du corps et de l'me, tablissait une solidarit assez importante entre chacun de nous et chacun de nos anctres.
J'ai expos la grande influence que j'attribue l'hrdit d'organisation Je n'ai pas conclu, et je me garderai bien de [632] conclure que
cette hrdit dut entraner une fatalit absolue ; mais elle a assez
d'influence sur nous pour empcher que cette libert soit absolue.
J'affirme donc que je ne pourrais pas raconter et expliquer ma vie
sans avoir racont et fait comprendre celle de mes parents.
Deux choses se font remarquer dans cette gnalogie de G. Sand :
l'originalit des personnages et l'irrgularit des murs. Il est permis
de faire cette remarque ; car l'auteur de l'Histoire de ma vie nous invite elle-mme la faire. Dans cette singulire histoire on rencontre
des rois, des grandes dames, des hros de gnie, des courtisanes et des
actrices, le tout ml des vnements romanesques et dramatiques,
un milieu hroque et lettr. On peut mme se demander si ces vnements romanesques, si ce milieu littraire, n'ont pas pu agir hrditairement et produire la longue le plus rare talent d'crire et un gnie
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
578
incontestablement romanesque. Mais reprenons par le dtail cette singulire histoire.
Elle commence comme un roman. Au commencement du XVIIIe
sicle, on trouva un matin dans le parc d'une grande princesse d'Allemagne un beau jeune homme assassin : on dit que c'tait la vengeance du mari. La princesse tait Sophie-Dorothe, lectrice du Hanovre ; le mari, Georges Ier, roi d'Angleterre ; le jeune homme, le chevalier de Knigsmark, l'arrire-grand-oncle de G. Sand.
Le chevalier avait une sur, belle comme le jour, qui s'appelait
Aurore. Elle vint la cour d'Auguste II, lecteur de Saxe et roi de Pologne, dont elle devint la favorite et la matresse. Remarquez ici les
noms romanesques auxquels ces noms se trouvent mls. Auguste II
avait eu pour adversaire le fameux Charles XII, un vrai hros de roman. On raconte mme qu'Aurore de Knigsmark demanda au roi de
Sude une entrevue pour traiter directement avec lui, dans l'esprance
de le sduire. Il refusa de la voir. Aurore s'arrangea pour le rencontrer
dans une promenade. Il la vit, la salua et lui tourna le dos. Auguste II
avait eu comme comptiteur le roi [633] Stanislas, autre hros de roman. Vaincu avec son protecteur Charles XII, il tait venu se rfugier
dans une petite ville d'Allemagne, Wissembourg, o il vivait avec sa
fille misrablement, et o on vint le chercher pour lui offrir la royaut
de Lorraine, et pour sa fille la couronne de France. On voit quels
singuliers vnements fut ml le trisaeul de G. Sand. Celui-ci eut
d'Aurore de Knigsmark un fils naturel, qui devint le marchal de
Saxe, aventurier clbre et le premier homme de guerre du XVIIIe
sicle. Celui-ci son tour eut, d'une danseuse de l'Opra, Mlle Verrires, une fille naturelle qui a t la grand'mre de G. Sand. Elle fut
reconnue comme fille naturelle du marchal de Saxe, et comme allie
la famille des Bourbons, ce qui faisait dire G. Sand que Charles X
tait son cousin : ce qui tait vrai. Cette personne (la grand'mre de G.
Sand) pousa en secondes noces M. Dupin de Francueil, connu par les
Confessions de Rousseau et les Mmoires de Mme d'pinay, et par l
nous entrons dans le milieu du XVIIIe sicle. Dupin de Francueil tait
le frre de M. Dupin, fermier gnral et connu sous le nom de Dupin
de Chenonceaux, auteur d'un commentaire sur l'Esprit des lois, qu'il a
dtruit lui-mme et dont il ne reste qu'un petit nombre d'exemplaires.
Sa femme, Mme Dupin, tait une des femmes spirituelles du sicle.
Elle recevait les crivains et les philosophes ; et, en particulier, J.-J.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
579
Rousseau fut secrtaire dans sa maison et travailla pour les matres de
la maison. On voit la rencontre de noms si intressante que nous offre
cette histoire. En outre, Rousseau tait li avec Francueil. La
grand'mre de G. Sand raconte, dans une note qu'elle a laisse, son
entrevue avec Rousseau. Elle ne trouva rien lui dire, et se contenta
de fondre en larmes. J.-J. Rousseau en fit autant. C'tait le got du
temps. Tout ce que nous voulons tirer de ces dtails, c'est que G. Sand
se rattache trs troitement par ses parents la socit philosophique
et littraire du XVIIIe sicle. L encore l'influence du milieu a pu se
transmettre par l'intermdiaire de l'imagination des parents. On sait
combien Rousseau a agi sur l'imagination des femmes [634] cette
poque. Mme Dupin, la grand'mre de G. Sand, qui tait cependant par
elle-mme trs peu romanesque, a d subir l'influence de ce milieu et
a pu la transmettre ses descendants. Cette dame, dans cette histoire,
reprsente la part de l'ordre rgulier et commun, la part du monde.
Trs bonne et trs dvoue, elle tait trs attache aux conventions
sociales et aux usages de la bonne socit. Elle eut un fils, Maurice
Dupin, pre de G. Sand. Ici nous avons l'hrdit directe. Elle se manifeste sous la forme du talent d'crire. Mme Sand a publi, dans le
premier volume de ses Mmoires, toute la correspondance de son
pre ; elle est charmante, d'un style naturel et qui, sans doute, appartient plutt la langue du XVIIIe sicle qu' celle du XIXe, mais qui n'en
est pas moins un excellent modle de la littrature pistolaire. Pour
terminer cette srie d'hrdits, il nous reste parler de la mre de G.
Sand. Ici les convenances ne nous permettent pas de faire autre chose
que de citer littralement les pages de l'illustre crivain.
Cette femme charmante que le jeune homme (M. Dupin) avait revue
Milan et conquise Assola, tait ma mre, Sophie-Victoire-Antoinette
Delaborde Sans doute ma grand'mre et prfr pour mon pre une
compagne de son rang ; mais elle ne se ft pas srieusement afflige pour
une msalliance Mais elle ne put qu' grand'peine accepter une bellefille dont la jeunesse avait t livre, par la force des choses, des hasards
effrayants. C'tait l le point difficile trancher Un jour vint o ma
grand'mre se rendit.
Je ne connais que trs imparfaitement l'histoire de ma mre avant
son mariage. Je dirai plus tard comment certaines personnes crurent agir
prudemment en me racontant des choses que j'aurais mieux fait d'ignorer
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
580
et dont rien ne m'a prouv l'authenticit. Mais, fussent-elles toutes vraies,
un fait subsiste devant Dieu, c'est qu'elle fut aime de mon pre Cet accident de quitter le sein de ma mre m'arriva Paris un mois juste aprs le
jour o mes parents s'engagrent l'un l'autre.
Il rsulte de ces passages, qui ne sont que trs peu voils, [635] que
la mre de Mme Sand a t une personne de murs lgres, et qu'en
outre, quoique la situation et t rgularise, elle est ne, ou du
moins elle a t conue hors mariage, comme son arrire-grand-pre
le marchal de Saxe, comme sa grand'mre Aurore Dupin. N'oublions
pas, d'ailleurs, qu'elle nous dit elle-mme qu'on ne peut comprendre sa
vie sans celle de ses parents. C'est mme cette occasion qu'elle expose sa thse de l'hrdit. Il est impossible de se mprendre sur le
sens de ces passages. Il semble bien que cette histoire ne soit qu'une
apologie personnelle fonde sur le principe de l'hrdit. Elle n'en fait
pas sans doute une fatalit irrsistible, et elle parat faire une part la
libert ; mais elle rclame des circonstances attnuantes qu'il est difficile de lui refuser. Reconnaissons que si elle a reu de ses anctres des
dispositions difficiles vaincre, elle en a reu aussi l'imagination et le
gnie.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
581
[636]
PRINCIPES DE MTAPHYSIQUE ET DE PSYCHOLOGIE.
Leons professes la Facult des Lettres de Paris 1888-1894
TOME PREMIER.
LIVRE DEUXIME
LES PASSIONS
Leon XV
LOI DHRDIT
(SUITE)
Retour la table des matires
Messieurs,
Des faits nous passons aux lois. Et d'abord, y a-t-il une loi de l'hrdit ? Il semble bien que, d'aprs les faits nombreux que nous avons
cits, cela ne peut faire question. Et cependant nous voyons d'une part
que les psychologues ne mentionnent pas cette loi et la considrent
comme non avenue. D'autre part, les physiologistes eux-mmes ne
sont pas d'accord ; les uns admettent, les autres rejettent l'existence de
cette loi.
D'abord pourquoi les psychologues n'admettent-ils pas la loi d'hrdit ?
C'est, selon M. Ribot, par la crainte des consquences, vraies ou
fausses d'ailleurs, qu'ils imputent cette doctrine. Mais cette crainte
n'est ni scientifique ni morale. Elle n'est pas scientifique, puisqu'elle
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
582
ne tient pas compte des faits ; elle n'est pas morale, puisqu'elle prfre
quelque chose la vrit.
On veut bien admettre l'hrdit pour les plantes et les animaux,
mais l'on veut en excepter les hommes. Mais il n'y a pas entre
l'homme et l'animal cet abme qu'avait creus Descartes. De l'animal
l'homme, il est vrai de dire que natura non facit saltum.
Ce ne sont pas d'ailleurs les seuls philosophes spiritualistes qui ont
contest la loi de l'hrdit. Ce sont aussi certains positivistes, par
exemple Buckle, l'auteur de la Civilisation en Angleterre. Voici le
passage o cette loi est mise en doute.
[637]
Nous entendons souvent parler de talents hrditaires, de vertus hrditaires, de vices hrditaires ; mais quiconque examinera srieusement
les faits trouvera qu'il n'y a nulle preuve de leur existence. La manire
dont on donne en gnral cette preuve est illogique au plus haut degr ; car
d'ordinaire voici comment procdent ceux qui ont crit sur ces matires :
ils runissent des exemples de quelque particularit mentale qu'on a rencontrs chez un pre et chez un fils, et ils infrent de l que cette particularit a t transmise. Avec un pareil mode de raisonnement, on peut dmontrer n'importe quelle proposition. En effet, partout o s'tendent nos recherches, il y a un nombre de concidences suffisant pour tayer d'un cas
plausible toute opinion qu'il plaira au premier venu de soutenir.
Mais ce n'est pas ainsi que l'on dcouvre la vrit. Il faut non seulement se demander combien il se prsente d'exemples de talents hrditaires, mais aussi combien il se prsente d'exemples de qualits qui ne sont
pas hrditaires. Tant qu'on ne fera pas une tentative de ce genre, il sera
impossible de rien savoir sur cette question.
Sans doute, rpond notre auteur, la loi d'hrdit a encore beaucoup faire pour tre tablie scientifiquement. Mais, prendre l'objection dans ce qu'elle a d'essentiel, il s'agit de savoir si les cas d'hrdit que l'on reconnat ne sont que des cas de concidence fortuite ; or
ces cas sont trop nombreux pour tre expliqus par le hasard. Maupertuis avait dj rpondu d'avance cette objection. Il s'agit du cas de
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
583
sexdigitisme qui s'tait produit dans une famille allemande. Voici
comment raisonne Maupertuis :
Je ne crois pas que personne prenne l'exemple du sexdigitisme pour
un effet de pur hasard ; mais au cas o on le voudrait, il faut voir quelle est
la probabilit que cette varit accidentelle dans les premiers parents ne se
rptera pas dans les descendants. Aprs une recherche que j'ai faite dans
une ville de cent mille habitants, j'ai trouv deux hommes qui avaient cette
singularit.
[638]
Supposons, ce qui est un peu difficile, que trois autres me soient
chapps et que sur vingt mille hommes on puisse compter un sexdigitaire ; la probabilit que le fils ou la fille ne natra pas avec le sexdigitisme
est de 20,000 1 ; et celle que son petit-fils ne sera pas sexdigitaire est de
20,000 fois 20,000. Enfin la probabilit que cette singularit ne se continuera pas pendant trois gnrations conscutives serait de
8,000,000,000,000 1, nombre si grand que la certitude des choses les
mieux dmontres en physique n'approche pas de ces probabilits.
Il est donc impossible de soutenir que les cas d'hrdit signals ne
sont que des cas de concidence fortuite.
De cette loi gnrale l'auteur passe des lois particulires, qui sont
les suivantes :
1 La loi de l'hrdit directe et immdiate : Les parents : ont une
tendance lguer leurs enfants leurs caractres physiques anciennement et nouvellement acquis.
En principe, l'hrdit dpend de deux facteurs, savoir les deux
parents. La rsultante devrait tre une moyenne entre les deux influences ; mais ce n'est l qu'une loi purement idale. On pourrait
mme dire que si elle se ralisait, on ne pourrait constater aucun cas
d'hrdit : car la moyenne entre un nez aquilin et un nez camus serait
un nez ordinaire, qui ne ressemblerait ni l'un ni l'autre. quoi
donc se reconnatrait l'hrdit ?
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
584
Aussi, dans le fait, il y a toujours prpondrance de l'un ou de
l'autre parent ; en cas de disproportion d'ge, c'est, parat-il, le plus
jeune qui l'emporte. Toutes les circonstances qui se prsentent au
moment de la conception (tat de sant ou de maladie, tat d'ivresse,
etc.) tendent faire prdominer l'influence de l'un ou de l'autre.
On a essay de donner plus de prcision cette premire loi gnrale en disant qu'il se fait un partage entre les qualits physiques et les
qualits morales. Schopenhauer disait qu'on tient de son pre son caractre, et de sa mre son intelligence. Aux objections qu'on faisait, il
rpondait : Pater [639] semper incertus. Mais la science est trop peu
avance pour pouvoir entrer dans ces prcisions.
2 Loi de prpondrance dans la transmission des caractres.
Est-ce bien l une seconde loi ? La premire n'tant qu'idale, la
consquence est invitablement la prpondrance de l'un ou l'autre
parent. On peut donc dire que cette seconde loi n'est que la premire
modifie suivant les conditions de la ralit.
La prpondrance peut avoir lieu de deux manires : tantt elle est
directe et tantt elle est croise ; tantt elle s'exerce d'un sexe sur le
sexe du mme nom, tantt d'un sexe sur un autre sexe. Dans le premier cas, le fils ressemble au pre, et la fille la mre ; dans le cas
contraire, c'est la fille qui ressemble au pre, et le fils la mre. On
trouvera les exemples dans le livre de M. Ribot.
3 Hrdit en retour ou mdiate. Atavisme : ressemblance
enfants aux grands-parents, aeul, bisaeul, etc.
des
4 Loi de l'hrdit collatrale, corollaire de l'atavisme.
5 Hrdit d'influence. Elle consiste dans la reproduction,
chez
les enfants d'un second-mariage, de quelques particularits propres au
premier poux. Ce cas est si rare, dit l'auteur, qu'il ne le mentionne
que pour mmoire. J'ajouterai qu'il me parat des plus douteux.
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
585
Gnralisant tous ces faits dans une formule finale, M. Ribot conclut ainsi : L'hrdit est la loi ; la non-hrdit est l'exception
En opposition cette conclusion, l'auteur d'un livre sur l'Hrdit
antrieur celui de M. Ribot, le docteur Prosper Lucas, s'appuyant
prcisment sur les exceptions si nombreuses dont nous allons parler
bientt, affirmait l'existence de deux lois opposes l'une l'autre : la
loi d'hrdit et la loi d'innit.
Chaque homme, en mme temps qu'il hrite de ses anctres, un
certain nombre de caractres communs, tient encore de sa nature
propre d'autres caractres diffrents des premiers et [640] qui constituent son individualit. C'est cette doctrine que nous voudrions soutenir contre celle de M. Ribot. Il y a, selon nous, comme selon le docteur Lucas, une loi d'innit, c'est--dire un principe rel d'individuation, l'individu ne pouvant tre absorb par l'espce. Ce sera encore
dfendre, un autre point de vue, la cause de l'indpendance de l'esprit.
Nous dirons donc, avec le docteur Lucas, qu'il y a deux lois dans la
nature : la loi du mme et la loi du divers. S'il n'y avait pas un fond
d'identit persistant sous tous les phnomnes de la nature, il n'y aurait
pas de lois dans l'univers ; il n'y aurait ni induction ni prvision :
l'avenir ne serait jamais semblable au pass ; non seulement la
science, mais la vie elle-mme serait impossible. Mais, rciproquement, si ( chaque tre tait absolument semblable tout tre, il n'y aurait jamais qu'un seul phnomne toujours le mme, et tout se reproduirait indfiniment de la mme manire ; nous ne pourrions rien distinguer, rien sparer ; la pense mme serait impossible, car, comme
disent les Anglais, penser, c'est discriminer. C'est l le principe leibnizien des indiscernables. Deux choses absolument identiques ne peuvent subsister et se confondent en une seule. Au reste, M. Ribot accepte le fait ; il reconnat l'existence du divers ; mais il ne veut y voir
qu'un fait, et non une loi ; car une loi a pour caractre essentiel l'uniformit et la constance. Une loi de la diversit (et par consquent une
loi de l'innit, qui en serait la consquence) impliquerait contradiction. On ne pourrait rien prvoir ; tout serait en proie au chaos, au dsordre, l'anarchie. Mais, selon nous, ce sont l des consquences
bien exagres. Elles ne seraient vraies que si les lois de diversit et
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
586
d'innit taient seules. Mais s'il y a une loi d'identit au fond de
toutes choses, une loi de permanence qui garantit la dure des espces,
en quoi la loi d'individualit et d'innit empcherait-elle de prvoir
pour la moyenne des cas ? On peut prvoir ce qui appartient l'espce ; on ne prvoit pas ce qui appartient l'individu. Mais n'est-ce
pas ce qui a lieu en effet ? Par exemple, nous prvoyons certainement
que Pierre mourra, [641] parce qu'il est homme ; mais nous ne prvoyons pas quand et comment il mourra, parce qu'il est Pierre. En dfinitive, que la diversit vienne d'une loi essentielle des choses, ou,
comme l'auteur le croit, des accidents et des circonstances, la consquence est absolument la mme quant aux prvisions. Il n'est pas
moins certain que dans l'un aussi bien que dans l'autre cas il y aura du
divers, et par consquent quelque chose qui ne peut pas tre prvu.
Maintenant, cela peut-il s'appeler une loi ? C'est une question de mots.
En tout cas, c'est un principe qu'il faut du divers pour qu'il y ait
quelque chose de rel, et ce principe n'est pas moins essentiel la nature des choses que le principe contraire. Une nature sans diversit est
aussi incomprhensible qu'une nature sans unit. C'est ce qui faisait
dire Platon que les choses se composent du mme et de l'autre,
, , ou encore de l'tre et du non-tre, ,
parce que l'autre indique ce qu'une chose n'est pas.
Une fois qu'il a t tabli comme rgle gnrale qu'il y a deux principes, le principe du mme et le principe du divers, quelle difficult y
a-t-il que cette mme rgle s'applique aux tres vivants, et que chacun
d'eux, considr au point initial de son existence, contienne la fois
du mme et du divers : du mme en tant qu'il fait partie d'une espce,
du divers en tant qu'il n'est pas tel autre tre, c'est--dire en tant qu'il
est un individu ? L'objection que nous ne pourrons rien prvoir a t
carte. Nous pouvons prvoir tout ce qui tient l'espce, et mme
jusqu' un certain point tout ce qui lient l'individu, quand cet individu nous est bien connu ; mais nous n'irons pas au del ; et c'est ce. qui
a lieu en effet.
Cependant nous devons tenir compte des explications donnes par
notre auteur. Il ne nie pas l'existence du divers ; mais il prtend qu'il
peut l'expliquer : 1 par l'hrdit elle-mme ; 2 par les variations qui
viennent du dehors et de l'action des milieux.
Par l'hrdit d'abord. En effet, dit M. Ribot, quand on oppose
l'hrdit ces prtendues exceptions, on oublie toujours [642] qu'il y a
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
587
deux facteurs : le pre et la mre. Dans le cas d'un quilibre absolu
entre l'influence de l'un et de l'autre de ces deux facteurs, le rsultat
devrait tre une moyenne entre les deux, par exemple une moyenne
entre les qualits du pre et celles de la mre, ou une fusion des deux
natures. Dans ce cas-l, l'individu nouveau ne ressemblera aucun de
ses parents. En outre, d'autres influences viennent se produire, par
exemple l'atavisme. Tel caractre des anctres traversera plusieurs
gnrations avant de se fixer sur un arrire-petit-fils, en passant pardessus la tte du pre et de la mre, peut-tre mme du grand-pre et
de la grand'mre. De l des traits nouveaux qui ne se trouvent pas dans
les parents. Et si la trace s'en est perdue, comme il arrive souvent dans
les familles bourgeoises, o l'on ne remonte gure au del du grandpre, on pourra croire que l'on est en prsence d'une individualit entirement nouvelle, tandis qu'en ralit on a devant soi l'preuve d'un
type antrieur oubli.
L'hrdit explique donc elle-mme ses propres exceptions. Mais il
y a encore une autre cause : c'est la variation, c'est--dire l'action exerce sur les individus par les causes extrieures. Les dfenseurs de l'hrdit, qui le sont en mme temps de l'volution, ne veulent pas abandonner le principe del mutabilit des espces, qu'une loi trop rigoureuse d'hrdit pourrait menacer. Ils doivent reconnatre que les
choses changent sans cesse, et par consquent qu'aucun individu n'est
absolument semblable ses anctres ; mais ils ne veulent pas que cela
tienne un principe interne d'individuation ; ils ne veulent y voir que
des actions de milieu. Par exemple, un enfant lev sur les bords de la
mer contractera des habitudes diffrentes de celles qu'il aurait eues sur
les montagnes ; et si ses parents n'ont pas vcu dans les mmes lieux,
il aura des habitudes et des dispositions contraires celles de ses parents.
Les deux explications prcdentes suffisent-elles rendre compte
de l'individualit et dmontrer qu'il n'y a pas un principe distinct
d'innit ? Regardons-y de plus prs. Je [643] prends d'abord l'explication par l'hrdit : soit, il y a l un principe d'explication. Chaque individu est la moyenne de toutes les influences hrditaires antrieures ; mais si nous remontons jusqu' l'origine, nous trouvons au
moins deux individus qui ne seraient pas le produit d'une hrdit antrieure : ce sont les deux premiers parents, le premier pre et la premire mre. Ces deux individus sont videmment diffrents, sans que
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
588
ces diffrences viennent de l'hrdit, puisqu'il n'y a rien avant eux. Je
ne parle pas seulement de la diffrence du sexe qui les spare, quoiqu'il y ait dj l un fait important contraire la loi de l'hrdit ; car,
d'aprs cette loi, les deux sexes devraient se fondre en une rsultante
commune qui amnerait la destruction des sexes, et par consquent de
l'espce. Pourquoi, dans ce cas, l'hrdit est-elle toujours relative et
unilatrale ? La loi semble donc ici se corriger elle-mme : car cela
n'indique-t-il pas que, dans ce cas, chaque germe nouveau rsiste
une hrdit croise et force l'influence hrditaire prendre l'une ou
l'autre ligne et donner toujours naissance un produit masculin ou
fminin ?
Mais laissons de ct le fait de la persistance des sexes, qui parat
contraire au principe de l'hrdit croise. Je dis que si l'on admet que
chaque espce a commenc par un couple, ce couple a d se composer
de deux individus distincts qui ne tiennent pas leur caractre de leurs
parents, parce qu'ils n'en ont pas. Or, s'il en a t ainsi l'origine,
pourquoi n'en serait-il pas de mme ultrieurement ? N'est-il pas rationnel de supposer qu'en vertu du mme principe qui distingue les
deux premiers parents, les enfants seront aussi distingus entre eux, et
de leurs pre et mre ? En un mot, ds qu'on a admis dans un cas le
principe de l'individualit, il n'y a aucune difficult l'admettre dans
tous.
Mais, dira-t-on, cette hypothse d'un premier couple est chimrique. Les sexes ont commenc comme tous les caractres organiques
et sont le produit de l'volution. La gnration a commenc par tre
asexuelle ; elle a t scissipare, gemmipare, avant d'tre ovipare, et a
fini par tre le produit des [644] sexes. Les sexes se sont d'abord produits dans le mme individu, comme sur les plantes ; puis ils se sont
spars, soit ; mais toujours est-il qu'il y a eu un moment o les sexes
taient encore runis, et un autre o ils taient spars. Eh bien ! le
premier individu qui a eu un sexe distinct n'a pas tenu cela de l'hrdit, et il a t un individu nouveau ayant quelque chose de propre. Enfin, avant l'apparition du sexe on ne peut faire appel la thorie de
l'hrdit croise ; il n'y a plus qu'une seule ligne hrditaire, et par
consquent il ne peut plus y avoir qu'une fixit absolue, une identit
persistante, et nulle individualit ; comment donc parviendra-t-elle
natre ? Sans doute il y a la variation, c'est--dire l'influence extrieure
du milieu, qui, ragissant sur des germes identiques, les diversifie et
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
589
amne ainsi la distinction des individus et la diversit des espces.
Tout l'effort de la thorie consiste donc transporter la diversit du
monde organique au monde inorganique. En principe, la loi du monde
organique est l'hrdit, et par consquent l'identit ; mais la diversit
vient du dehors. Cette doctrine est trs contraire ce que nous savons
des deux mondes. C'est videmment dans le monde organique qu'il y a
le plus de diversit, et c'est dans le monde inorganique qu'il y a le plus
d'identit, d'immobilit. Quoi de plus immobile que les roches, en
comparaison de l'extrme variabilit des espces vivantes ? Quoi de
moins individuel que les pierres, en comparaison de l'individualit des
vivants ? Et cependant on veut expliquer la diversit et le changement
dans les vivants par l'action de ce qu'il y a de plus inerte, de plus immobile, de moins individuel. N'y a-t-il pas l un renversement peu naturel et peu scientifique ? Et d'ailleurs, d'o viendrait la diversit dans
le monde inorganique lui-mme ? Admettra-t-on non seulement des
espces chimiques, mais encore des individualits chimiques ? car l
du moins on ne peut avoir recours l'hrdit. Mais si, dans le monde
inorganique, il y a des atomes individuellement et spcifiquement distincts, pourquoi n'en serait-il pas de mme dans le monde organique ?
Si l'on veut maintenir l'explication prtendante, [645] il faudra dire
que, mme dans le monde inorganique, la diversit s'explique par l'action du milieu. Mais la mme question revient toujours. Comment le
milieu peut-il exercer des actions diffrentes, s'il est compos de parties homognes ? On n'arrivera jamais la diversit. L'homogne ne
passera jamais l'htrogne, selon la formule d'Herbert Spencer. Si,
au contraire, vous admettez la diversit l'origine, pourquoi celle loi
du mme et du divers ne s'appliquerait-elle pas au monde des tres
vivants aussi bien qu'au monde inorganique ?
Poussons encore plus loin l'analyse, en remontant jusqu' l'origine
de l'tre vivant, et essayons de montrer que cet individu doit contenir
quelque chose qui le fait loi ct qui n'est pas hrditaire. Voici, par
exemple, un germe humain qui deviendra par la suite un homme ou
une femme. Ce germe, selon les partisans de l'hrdit, serait tout entier le produit de cette hrdit et ne contiendrait rien qui lui appartienne en propre. Sans doute, ds qu'il commence vivre, il subit l'action des causes extrieures par l'intermdiaire du sein maternel ; et l
commencent dj les diversits. Mais au moment prcis et indivisible
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
590
de la conception, il n'a encore reu aucune action externe ; il ne serait
donc alors que la rsultante d'une double hrdit.
Qu'entend-on par l ? Confond-on le fait de l'hrdit avec celui de
la gnration, c'est--dire avec le fait d'engendrer un autre tre semblable soi-mme ? Si on l'entend ainsi, il n'y a pas discuter ; nul
doute que l'hrdit ne soit la loi, et la seule loi ; car nul ne s'engendre
soi-mme. Il n'y a point de gnration spontane, du moins dans l'espce humaine. Tout individu a un pre et une mre. Il n'y a pas mme
lieu de dire que la non-hrdit est l'exception ; car il n'y a pas d'exception. Mais, en gnral, est-ce l ce qu'on entend par l'hrdit ?
L'hrdit se confond-elle avec la gnration mme ? Non. On entend
par l que, la substance de l'individu une fois produite par la gnration, il s'imprime dans cette substance une sorte de portrait du pre et
de la mre, soit au physique, soit au moral ; mais la substance est antrieure. Or [646] cette substance pourrait-elle prexister sans tre dj
par elle-mme quelque chose ? Rduisons, par hypothse, cette substance une cellule, puisque tout tre vivant se ramne des cellules ;
cette cellule, avant de devenir l'tre nouveau, faisait partie de l'organisme paternel ou maternel. Elle avait t labore par la loi gnrale
de la vie, et elle devait tre telle ou telle ; elle avait son individualit
propre aussi bien que les autres cellules du corps humain, puisque,
selon Cl. Bernard, tout corps organis est une collection de cellules
vivant chacune de leur vie propre et mourant l'une aprs l'autre. Est-ce
que le fait mme d'tre une cellule nouvelle qui n'existait pas auparavant ne constitue pas dj une vritable individualit ? La cellule a
dans le milieu sminal n'est-elle pas distincte de la cellule b et n'a-telle pas par l quelque chose d'inn, selon la doctrine du docteur Prosper Lucas ? Sans doute la substance de cette cellule est produite par
l'organisme paternel et maternel ; elle est donc engendre ; mais ce
n'est pas l de l'hrdit, car par la nutrition l'individu engendre continuellement des cellules nouvelles, qui deviennent siennes par l'assimilation. Dira-t-on qu'elles sont les hritires de l'organisme gnral ? Et
cependant on dit que la nutrition n'est qu'une gnration continue. La
confusion de la gnration et de l'hrdit est donc insoutenable. Car
si le fait de l'hrdit est de conserver ce qui est, le fait de la gnration est de crer ce qui n'est pas. L'hrdit suppose la gnration ; il
faut d'abord exister pour hriter. Or cette existence antrieure est prcisment le quid proprium de l'individu. Sans doute ce quid proprium
Paul Janet, Principes de mtaphysique et de psychologie Tome I. (1897)
591
sort de la substance paternelle ou maternelle ; mais, tout en faisant
partie de l'un ou de l'autre organisme, elle n'en est pas moins ellemme ; elle est une individualit virtuelle qui s'assimilera le gnie de
la famille, mais selon son moule propre. Il y a donc l une racine
l'individualit, abstraction faite de toutes les influences extrieures qui
peuvent s'y ajouter.
En un mot, si, pour qu'il y et individualit, il fallait que l'individu
naqut spontanment de lui-mme et sans gnration, [647] il est vident qu'une telle individualit n'existe pas. Si, par consquent, l'affirmation de la loi d'hrdit signifie tout simplement que tout individu a
des parents et nat d'un pre et d'une mre, cette loi serait un non-sens
et ne vaudrait pas mme la peine d'tre nonce. Si l'on veut dire, au
contraire, que tout individu, par cela seul qu'il a un pre et une mre,
ne peut tre que le portrait de son pre et de sa mre, on affirme ce qui
n'est nullement contenu dans la loi de la gnration : car toute cellule
nouvelle, par cela seul qu'elle est nouvelle et en vertu du principe des
indiscernables, est diffrente des autres cellules et a par consquent
quelque chose d'individuel et d'inn. Le portrait du pre ou de la mre,
ou la fusion des deux, pourra s'y ajouter ; mais l'originalit primordiale de la cellule interviendra pour sa part et concourra, avec l'action
des milieux externes et mme avec la loi de la transmission hrditaire, la formation de l'tre moral. Ce facteur individuel aura plus ou
moins de puissance suivant les individus. C'est l peut-tre qu'est la
source du gnie et de l'originalit en tout genre. En tous cas, chaque
individu n'est pas la reproduction strotype d'un modle prexistant,
ou la fusion indtermine de deux modles. Il a son unit, son centre,
et peut-tre son principe directeur.
FIN DU VOLUME I
You might also like
- Méthode Pour Étudier La Langue GrecqueDocument373 pagesMéthode Pour Étudier La Langue Grecquedomi347347No ratings yet
- Du Temps Et de L EterniteDocument362 pagesDu Temps Et de L Eternitedomi347347No ratings yet
- Principes de Metaphysique t2Document557 pagesPrincipes de Metaphysique t2domi347347No ratings yet
- Etudes Sur La Dialectique de Platon Et HegelDocument266 pagesEtudes Sur La Dialectique de Platon Et Hegeldomi347347No ratings yet
- Du Système de Dépopulation BabeufDocument194 pagesDu Système de Dépopulation Babeufdomi347347No ratings yet
- Arnaud Desjardins - en Relisant Les Evangiles (Bible - Jesus Christ - Esoterisme.meditation - Zen.bouddhisme)Document306 pagesArnaud Desjardins - en Relisant Les Evangiles (Bible - Jesus Christ - Esoterisme.meditation - Zen.bouddhisme)Sharklo Kipetrovitchi100% (1)
- Montaigne - Les Essais - Livre I PernonDocument491 pagesMontaigne - Les Essais - Livre I PernonValeriu GherghelNo ratings yet
- Grabovoi Livre D'imagesDocument198 pagesGrabovoi Livre D'imagesdomi347347100% (4)
- Les Ruines de La Monarchie Française 1Document640 pagesLes Ruines de La Monarchie Française 1domi347347100% (1)
- Les Ruines de La Monarchie Française 2Document771 pagesLes Ruines de La Monarchie Française 2domi347347100% (1)
- Béchamp Antoine - La Théorie Du Microzyma Et Le Système MicrobienDocument536 pagesBéchamp Antoine - La Théorie Du Microzyma Et Le Système Microbiendomi347347100% (3)
- 5652657la Tactique PDFDocument6 pages5652657la Tactique PDFMokrane TouaoulaNo ratings yet
- Rituel Appel Ange ServantDocument3 pagesRituel Appel Ange ServantLeava50% (2)
- Desjardins Arnaud - Zen Et VedantaDocument69 pagesDesjardins Arnaud - Zen Et Vedantasamir.95100% (1)
- L'adaptation Du Droit Civil Et Ses Limites Face Aux Phénomènes de Puissance ÉconomiqueDocument131 pagesL'adaptation Du Droit Civil Et Ses Limites Face Aux Phénomènes de Puissance ÉconomiqueMarlene Hij.No ratings yet
- Discours de La Méthode. Descartes. 1637. - PhiloLog PDFDocument29 pagesDiscours de La Méthode. Descartes. 1637. - PhiloLog PDFBrice BriceNo ratings yet
- Le Thème de L'enfermement Dans La Littérature MaghrébineDocument120 pagesLe Thème de L'enfermement Dans La Littérature MaghrébineARGYOU100% (4)
- Claude Payan - Une Foi IntelligenteDocument7 pagesClaude Payan - Une Foi IntelligenteLudovic Bourgeois50% (2)
- 1925-10-11 - La Loi SuprêmeDocument13 pages1925-10-11 - La Loi SuprêmeOpale CélesteNo ratings yet
- Diderot Droit NaturelDocument6 pagesDiderot Droit NaturelveraNo ratings yet
- Pouvoir de La Pensée InvincibleDocument9 pagesPouvoir de La Pensée InvincibleGabryska AzeliyahNo ratings yet
- Cours de Savoir VivreDocument32 pagesCours de Savoir VivreProméthée Hiambe Olembo LiamNo ratings yet
- Le Dieu de SpinozaDocument28 pagesLe Dieu de SpinozacadmiopdfNo ratings yet
- Le Bonheur IIDocument11 pagesLe Bonheur IInis bbNo ratings yet
- Perelman - Idéologie Ou Philosophie Des LumièresDocument223 pagesPerelman - Idéologie Ou Philosophie Des LumièresAndré MagnelliNo ratings yet
- Appel A L Unification Des Eglises Autour de Pierre IIDocument340 pagesAppel A L Unification Des Eglises Autour de Pierre IIBruno ThérèseNo ratings yet
- L¿amour en Plus - Histoire de La Maternité.Document0 pagesL¿amour en Plus - Histoire de La Maternité.Semiotista0118No ratings yet
- IRONIEDocument13 pagesIRONIErichardNo ratings yet
- Kant Critique Du JugementDocument228 pagesKant Critique Du JugementIsabelle PiconNo ratings yet
- Alain - Vigiles de L'espritDocument216 pagesAlain - Vigiles de L'espritkainomidNo ratings yet
- Du Beau Dans La Nature Le GénieDocument11 pagesDu Beau Dans La Nature Le GénieMamadou Moustapha SarrNo ratings yet
- Vassula Rydén, Les Raisons de L'eglise - François-Marie Dermine O.P. 1.2008Document52 pagesVassula Rydén, Les Raisons de L'eglise - François-Marie Dermine O.P. 1.2008jmlb0123No ratings yet
- PDF Résumé - Le Gai Savoir PDFDocument27 pagesPDF Résumé - Le Gai Savoir PDFOmar benhamidNo ratings yet
- Le Désir Peut-Il Se Satisfaire Du RéelDocument11 pagesLe Désir Peut-Il Se Satisfaire Du RéelFrance Culture86% (7)
- EMC SecondeDocument3 pagesEMC SecondeInes ENo ratings yet
- Montesquieu - de L Esprit Des Lois-365 PDFDocument268 pagesMontesquieu - de L Esprit Des Lois-365 PDFMouhamadou DiopNo ratings yet
- Weininger Otto Sexe Caractere (4 Chapitres)Document108 pagesWeininger Otto Sexe Caractere (4 Chapitres)Tartempion_ChocolatNo ratings yet
- Les 24 Heures de La Passion de JésusDocument165 pagesLes 24 Heures de La Passion de Jésusviagem_franca1059No ratings yet
- Bac 2019 Philo S 2Document2 pagesBac 2019 Philo S 2LETUDIANTNo ratings yet
- La Qintessence de La Science Contenue Dans Sourate L Etoile PDFDocument35 pagesLa Qintessence de La Science Contenue Dans Sourate L Etoile PDFBillel HelaliNo ratings yet