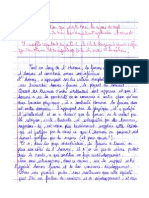Professional Documents
Culture Documents
SES Obl Lib 08 QSTP
SES Obl Lib 08 QSTP
Uploaded by
ricou0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views3 pagesCopyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views3 pagesSES Obl Lib 08 QSTP
SES Obl Lib 08 QSTP
Uploaded by
ricouCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 3
BECESSLI
Question de synthése étayée par un travail préparat
Mest demande au candidat :
1. de conduire le travail préparatoire qui fourit des éléments devant étre utilsés dans la synthése.
2. de répondre & fa question de synthése
“par une argumentation assortio dune réflexion critique, répondant la problématique donnée dans
inttulé,
- en faisant appel a ses connaissances personnelles,
en composant une introduction, un développement, une conclusion pour une longueur de ordre de trois
pages.
Ces deux parties sont d’égale importence pour Ia notation.
Ilsera tenu compte, dans la notation, de la clarté de rexpression et du soin apporté a la présentation,
THEME DU PROGRAMME
Enjeux et déterminants de la mobi
sociale
I- TRAVAIL PREPARATOIRE (10 points)
Vous répondrez a chacune des questions en une dizaine de lignes maximum.
1) D'aprés la table de destinée, quelle proportion des fils d'employés et quelle proportion des fils
d'ouvriers, ont connu une mobilité sociale ascendante. (document 1) (2 points)
2) Utiisez conjointement les deux données encadrées et précisez-en la signification.
(document 1) (2 points)
3) Expliquez la phrase soulignée. (document 2) (2 points)
4) Donnez un exemple, non évoqué dans le texte, de mesure favorisant légalité des chances.
(document 2) (1 point)
5) Que signifie « acculturation scolaire » ? (document 3) (1 point)
8) En quoi les différences culturelles selon les milieux dorigine et !'école sont-elles factour
diinégalité des chances ? (document 3) (2 points)
UESTION DE SYNTHESE (10 points)
Apras avoir caractérisé la mobilité sociale en France, vous montrerez que l'école joue un
réle dans ce phénoméne.
6/10
BECESSLIT
DOCUMENT 1
« Que sont devenus les fils de
Table de destinée des hommes de 40 a 59 ans en 2003 en %.
| Catégorie socioprofessionnelle du fils en 2003 (en %)
7 + ‘Aisan, | Cadre et ]
professionnelle| agicuteur | commercant | profession | Profession | gneve | Ensemble
dupare | exploitant | etchet | intellectuete | intermediaire | E™PIOv® | Ouier | (a)
dentreprise | supérieure |
Agricutour
ae 2 6 ° 7 8 37 18
‘Aisan, 7
commergant et 1 a 2 24 8 24 12
chet dentreprise
Cadre et
profession
intelectual 5 . 4 2 e H
supérieure |
eer 0 8 33 33 oe Hare "
Employé ° 7 2 28 wv 26 8
unter 1 8 10 23 12 46 43
aa ole
Ensemble (2) 4 9 2 1 34 +00
Thamp : hommes, acifs occupés ou anciens ayant eu un emploi, Agés de 40 4 69 ans, en mai 2003.
(1) Structure socioprofessionnelle dans la génération des pares.
(2) Structure socioprofessionnelle dans la génération des fils.
Remarque : les totaux en ligne sont égaux & 100.
Source : Enquéte FOP 2003. Données sociales INSEE, 2006.
DOCUMENT 2
Dans la mesure ol 'éducation scolaire a longtemps été réservée aux seules élites sociales, on a
pu considérer que la justice scolaire était d'abord définie comme une égalité d'acces a I’école. (...)
Au fil du XXéme siécle, notamment a partir des années 1960-1970, le principe de 'égalité d'accés
a sé place au principe de I'égalité des chances considérant que, tous les individus étant
fondamentalement égaux, ils avaient tous le méme droit & la réussite scolaire. S‘installe alors un
principe de justice méritocratique visant 4 produire des élites en fonction de la seule réussite
scolaire des individus, indépendamment de leur nalssance et des inéualilés sociales. C'est ce
principe de Justice qui a commandé la massification scolaire des quarante demiéres années et
justifié la gratuité des études, les systémes de bourses, la formation du collage unique... afin que
chacun échoue ou réussisse en fonction de son seul mérite. Il faut bien convenir que le modele de
Tégalité des chances reste central en France parce que nous attendons de I'école, plus que du
marché, qu'elle redistribue les cartes et finisse par établir une sorte de mobilité sociale pure dans
laquelle les individus ne devraient leur place qu’a leurs mérites scolaires.
Source : Frangois DUBET, « Justices soolaires »,
‘Sciences humaines N’ spéciai n°5 L’école en questions, 2006.
THO
8ECESSLI
DOCUMENT 3
Ces lycéens «de cilé » - surtout des garcons ~ tendent a résister aux différentes entreprises
d'acculturation scolaire dont ils sont objet. Par exemple, ils refusent souvent de se soumettre
entigrement a limposition d'un mode de lecture cultivée en vigueur au lycée et n’hésitent pas a
affirmer leur « quant @ soi » culturel. La culture qu'ils ont envie de défendre, c'est celle quills
connaissent, celle de leur quartier et de leur famille, véhiculée notamment par les médias, la
télévision, le cinéma américain, etc. Leurs « héros culturels » sont principalement des acteurs
icains ou des chanteurs de rap ou de rai ; leurs « émissions cultes », des séries de télévision
américaines, etc. Autant de choix qui inversent I'échelle des valeurs de la culture scolaire. Contre
la lecture désintéressée et érudite, ils revendiquent un rapport a la lecture « utilitaire »,
Source : Stéphane BEAUD, 80% au bac... et aprés ? Les enfants de la démocratisation scolaire,
La Découverte, 2003.
8/10
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Exemple de Bonne Copie Sur Une Question de Synthèse N°1Document5 pagesExemple de Bonne Copie Sur Une Question de Synthèse N°1ricou50% (2)
- Sujet Bac Es 2009 Ses Sciences Economiques Et Sociales Amerique Du NordDocument9 pagesSujet Bac Es 2009 Ses Sciences Economiques Et Sociales Amerique Du Nordricou100% (4)
- TD Introductif Au Thème 3 : "Voyage Dans Les Ghettos Du Gotha "Document2 pagesTD Introductif Au Thème 3 : "Voyage Dans Les Ghettos Du Gotha "ricouNo ratings yet
- TD N°5 Post Ou Néotaylorisme 08 09 ?Document3 pagesTD N°5 Post Ou Néotaylorisme 08 09 ?ricouNo ratings yet
- THEME 1 La FamilleDocument1 pageTHEME 1 La Famillericou100% (1)
- THEME 1 La FamilleDocument1 pageTHEME 1 La Famillericou100% (1)
- Programme Officiel Ses SecondeDocument5 pagesProgramme Officiel Ses Secondericou100% (1)