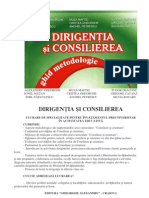Professional Documents
Culture Documents
Anca Magureanu - Semantique - Lexicale PDF
Anca Magureanu - Semantique - Lexicale PDF
Uploaded by
zina_calin0 ratings0% found this document useful (0 votes)
230 views67 pagesOriginal Title
Docfoc.com-Anca Magureanu_Semantique_lexicale.pdf.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
230 views67 pagesAnca Magureanu - Semantique - Lexicale PDF
Anca Magureanu - Semantique - Lexicale PDF
Uploaded by
zina_calinCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 67
ANCA MAGUREANU
LA SEMANTIQUE
LEXICALE
us
Cale Maple Rel p tel h
CHAPITRE |
OBJET ET METHODE DE LA SEMANTIQUE
Objet de la sémantique
0. Le sens en question(s)
Trait définitoire du monde humain et humanisé, le sens forme l'objet de
sciences ou disciplines diverses, et en particulier des sciences dites « humaines » :
anthropologie, ethnologie, psychologie, psychanalyse, logique, épistémologie,
linguistique, sociologie, philosophic, etc. C'est Ie but et le point de vue de la
recherche et, conséquemment, le modéle de description adopté qui vont en faire
autant d’objets de connaissance différents. Parmi ces disciplines, la linguistique
coccupe une place de choix puisqu’il est indéniable que Je sens apparait
premiérement en :apport avec la langue & I'intérieur d'une relation d’échange
communicatif.
Se proposent de décrire le sens, la sémantique s'est heurtée, dés sa
constitution, a la difficulté de définir son objet
Mais si la difinition du sens nous échappe, cela n’empche pas que nous ayons
Vv «expérience » du sens. L'acte méme de parler et de comprendre suppose que
le sens existe. (GENOUVRIER et PEYTARD, 1970, p. 218).
Pareillement, faire parler et faire comprendre, en un mot enseigner
une langue, c’est expliciter des mécanismes dont la visée ultime est la
production du sens.
0.1. Le sens en lingutstique
Si Vintérét pour le probleme du sens remonte aux philosophes de
TAntiquité, la sémantique recoit un nom grace A M. BREAL qui publie, en 1883,
dans I'Annuaire de Vassociation pour Uencouragement des études. grecques en France
Ww
article « Les lois intellectuelles du langage, fragments d’une sémantique » et en
1897 un « Essai de sémantique». Selon M. BREAL, cette discipline a pour objet
« Vétude de la signification et des lois qui président @ la transformation des sens »
Pourtant, le sens n’acquiert droit de cité en linguistique qu’avec la
constitution d’une conception systémique de Vobjet d’étude: une langue
naturelle et un systime d'entités linguistiques (signes) régi par des régles qui
indiquent/prescrivent comment on peut ou l'on doit utiliser des entités
conformément aux lois du systéme auquel elles appartiennent et dans une
situation de communication donnée afin d’obtenir un résultat visé (réaliser la
transmission d’un contenu). Cette conception comporte deux aspects
* les signes sont ses entités d'un systéme ; ils se définissent donc :
© en tant quentités
© en tant que paleurs résultant de leur position au sein du systéme ;
+ les signes, ainsi définis, sont utilisés selon certaines régles afin de
éaliser une intention communicative.
O.1.1. Le signe chez SAUSSURE. Le premier aspect a été envisagé par le
structuralisme de souche saussurienne : le signe est une entité biplane, constituée
par la réunion d'une forme ie Vexpression (signifiant) et d'une forme du contenu
(signifi). Pour FERDINAND DE SAUSSURE (1916/1968, p. 98):
Le signe linguistique unit non une chose et un nom, mais un concept et une image
‘acoustique. (nous soulignons)
Pour suggérer le lien intime entre les deux faces du signe, SAUSSURE
propose le schéma suivant (dans lequel nous remplacons concept par Sé et,
respectivement, image acoustique par Sa ):
Les deux « faces » du signe sont en dépendance réciproque, tels le recto et le
verso d'une feuille de papier (idem, p. 157). Le signe a une valeur au sein du
* Les éditeurs notent : « L'image acoustique est par excellence la représentation naturelle
du mot en tant que fait de langue virtuel, en dehors de toute rélisation par la parole » (ibid.,
‘nous soulignons).
18
systime, grice aux rapports syntagmatiques et paradigmatiques quill
contracte avec les autres unités. Aussi la seule description « positive » du
signe (ce qu’il est) ne vaut-elle que si on y ajoute une description « négative »
(ce que le signe n’est pas)?
A Finstar du signe, le systeme linguistique est constitué d’un rapport
d'implication réciproque entre un plan de Vexpression et un plan du contenu, Les
deux plans du systéme ont une structure isomorphe?.
La théorie opére une dissociation nécessaire dans Tindissociable
ontologique de I’Expression et du Contenu, assignant la sémantique linguistique
comme objet d’étude la forme du contenu d'une languet,
Une premitre définition du sens se précise :
Le sens ~ SIGNIFIE - est une entité constitutive de I'unité/du systéme
linguistique ; il a un caractére systémique et sera susceptible ’une description
structurale, analogue & celle des unités du plan de expression.
Toute unité linguistique est done douée d’un sens (SIGNIFIE) en vertu
des régles (conventions) du systéme auquel elle appartient.
Une sémantique reposant sur une telle conception du sens sera
prioritairement centrée sur l'étude descriptive du sens lexical (de Iunité
linguistique)
0.1.2. Le signe chez PEIRCE, Une seconde direction congoit le signe
comme le résultat de Iutilisation par un locuteur d'une unité linguistique douée
de sens, afin de référer & quelque chose, & un «objet» (une réalité extra-
linguistique ou un autre signe).
Selon CHL S. PEIRCE, le signe est
* Saussure (idem, p. 166) considérait que « dans la langue il n'y a que des différences sans
termes positifs|...] Mais dire que tout est négatif dans la langue, cela n’est vrai que du
signifié et du signifiant pris séparément : dés que ’on considére le signe dans sa totalité,
con se trouve en présence dune chose positive dans son ordre. »
» Lisomorphisme se définit comme « identité formelle de deux ou plusieurs structures
relevant de plans ou de niveaux différents reconnaissables du fait de I"homologation
possible des réseaux relationnels qui les constituent » (Greimas et Courtés, 1979, s. v.
Isomorphisme). Ainsi, a Varticulation du plan de Vexpression en phémes - phonémes, ill
correspond dans le plan du contenu articulation en sémes ~ sémemes. L‘isomorphisme
du plan de Yexpression et du plan du contenu, a été soutenu par le linguiste danois
Hjelmstev (1943).
‘les éléments des deux ordres se combinent ; cette combinaison produit une forme, non une
substance. » (idem, p.157)
19
Quelque chose qui tient li 7
; ui tient liew pour quelqu’un sous quelque rapport ou a quelque
lite I stadresse 8 quelqu'un, cest-dive il erée dans Fesprit Ue cette parconne
tn signe équivalent ou peatte un sige plus développé. Ce signe quil rte je
‘appelle Vinterprétant du premier signe. Ce signe tient lieu de son objet. (2.228)
Une expression (Representamen) mise en rapport dans et par le discours avec un
Objet envisagé sous un certain rapport (Fondement/Ground) produit chez
Finterlocuteur un effet (Interpretant: une idée (1.339), un signe équivalent
(2.228). Le signe est done une virtualité qui est actualisée dans le rapport a un
objet cette Setualisation Giant régie par une li, une convention, un habitus, Cest
‘acte méme de i is
face méme de cern au consttue la triade sémiotique, faisant que quelque
Par sémiosis jfentends [...] une action ou une infl
3 influence qui est ou implique la
coopération de trois sujets, tels qu'un signe, son objet et son interprétant. (5.484)
__L’acte de sémiose institue un rapport de représentation entre deux
Phénomanes: le signe et son objet, mais ce rapport n’acquiert vraiment un sens
que grace & linter-médation d'un tiers, qui est la loi, Vhal i
ae ene q loi, habitus, la convention
_ La conception de PEIRCE n/a pas joué un role immédiat dans la
constitution d'une science des signes ; elle a été diffusée, de fagon trés réductive,
gree 4 la représentation connue sous le nom de triangle d’OGDEN et
CHARDS, selon les premiers auteurs a pose résentati
yant proposé cet 6
(OGDEN et RICHARDS, 1923) r a “aten
1. signifié
2 Interpretant
3, référence
intension
5. signification
1. signifiant 1 réalité
2. Representamen 2. Objet
3. symbole 3.référent
. 4 extension
5. désignation
> Nous avons inscrit aux trois angles de la fi nologies proposées
aux trois lela figure les diverses terminologies proposé
par: 1. Saussure, 2, Peice, 3. Ogden et Richards 4. les logiciens 5. Mom
20
Cette conception est Ia base de Ia constitution de la sémiotique comme
science des signes, a savoir la science qui s’occupe des entités caractérisées par
la triple relation
¢ Sémantique : relation entre une entité et l'objet auquel elle se substitue
# Syntaxique: relation entre entités au sein du systéme auguel elles
appartiennent
+ Pragmatique : relation entre Ventité et celui qui utilise
La sémiotique comporte donc trois dimensions : la syntaxe, la sémantique et
la pragmatique, qui s‘attacheront & décrire ces trois types de relations.
0.1.3. Syntaxe, sémantique, pragmatique. Ces trois disciplines connaitront
une fortune diverse : si la syntaxe a depuis toujours constitué Vobjet d’étude dela
grammaire, la sémantique a été plus d’une fois reléguée au second plan, quant
celle n’a pas été carrément ignorée.
La description traditionnelle d'une langue assignait 4 la sémantique une
position marginale par rapport A la centralité de la grammaire, étude des formes,
morphologiques ou syntaxiques : le sens était un phénoméne qui échappait la
rigueur des régles linguistiques et dont la saisie exigeait le recours au non
linguistique informel et en transformation continuelle. Le sens était substance
(psychique), seule la forme s‘'accommodant d'une description systémique et
exhaustive. Ce qui expiique linterdit dont fut pendant longtemps frappée l'étude
du sens : si la nécessité de cette étude n‘a jamais été mise en cause, par contre la
possibilité d’en faire une science a été plus d'une fois mise en doute®, La
‘sémantique s’est constituée tard et, face aux autres disciplines linguistiques, elle
nn’est pas préte & définitivement abandonner le rdle de parente pauvre auquel de
nombreuses difficultés d’ordre théorique et pratique l'ont astreinte.
La syntaxe a depuis toujours eu la place de choix: cest l'étude des
structures (forme de lexpression) régies par des regles immanentes au systeme. La
sémantique linguistique, en tant que description de la forme du contenu du
systéme d'une langue naturelle s‘est développée relativement tard, dans les
années '60, adoptant le méme modéle que celui utilisé par la syntaxe, & savoir le
modéle structural (aussi bien en Europe que dans l'espace américain). Cette
sémantique linguistique est, 2 la lumiére des trois approches sémiotiques, une
description syntarique du sens. Les deux autres aspects du signe : le rapport @
Vobjet et le rapport A son utilisateur n’étaient nullement considérés.
«Bloomfield définissait encore le signe linguistique comme « une forme phonétique qui a un
sens», «un sens dont on ne peut rien savoir » (Bloomfield, 1935; apud Greimas, 1966, 7)
a
|
Et pourtant, déja JAKOBSON (1952/1963, p, 42), le méme qui se réjouissait
de pouvoir, grace a l'approche structurale, «incorporer les significations
Tinguistiques & Ja science du langage » , reconnaissa
Je pense que la réalité fondamentale a laquelle le linguiste a affaire, cest
interlocution (idem, p. 32, nous soulignons)
Or, dans V'interlocution on construit un sens en se référant au monde : les deux
autres dimensions sémiotiques n’étaient pas encore abordées.
La relation des mots aux choses a constitué la préoccupation majeure
pour les logiciens, qui, & la recherche de la valeur de vérité, posaient cette relation
comme crittre de validation. Une sémantique logique se développe qui étudie done
la représentation de la réalité par les signes linguistiques.
Le sens est toutefois produit par les usagers des signes - locuteur et
auditeur - qui, d’une part, représentent le monde au moyen des signes et, d’autre
Part, le font a l'intention de l'autre, I'interlocuteur censé reconstruire ce sens,
Une troisiéme acception du sens se fait jour : le sens visé par le locuteut,
celui qu'il veut transmettre a ou produire avec son interlocuteur.
La sémantique se voit ainsi écartelée entre d’une part le sens linguistique
(exical), sens inscrit dans le code et redevable d’une modélisation structurale et,
d’autre, le sens « intenté »du locuteur que seule une approche pragmatique
permet de décrire.
Remarque. BENVENISTE accorde une signification propre a la sémantique,
qu'il oppose au sémiotique
Le sémiotique désigne te mode de signifiance qui est propre au SIGNE
linguistique et qui le constitue comme unité [...] Avec le sémantique,
nous entrons dans le mode spécifique de signifiance qui est engendré
par le DISCOURS. [...] ce n’est pas une addition de signes qui produit le
sens, c'est au contraire le sens (U'« intenté »), congu globalement, qui se
réalise et se divise en «signes» particuliers, qui sont les MOTS.
(BENVENISTE, 1974, p. 64)
Le niveau sémantique est te niveau de la production du sens dans le
discours, par un locuteur s’adressant A un auditeur visant & modifier celui-ci en
quelque fagon que ce soit, conformément & une certaine intention. La
signification discursive est la signification produite par un locuteur qui
s‘approprie la langue conformément & une intention communicative. La notion
de (Sens) intenté, qui nous semble peu remarquée et discutée, se rapproche des
22
notions adoptées dans la pragmatique anglo-saxonne de speaker's meaning ou
utterer's meaning (GRICE, 1968/1989; DONNELLAN, 1978). Le terme
sémantique recouvre done plutét, chez BENVENISTE, le domaine de la
pragmatique.
Lloriginalité de cette conception se révéle lorsque BENVENISTE prend en
considération la saisie dia sens : aux deux modes de signifier correspondent aussi
deux modes d’appréhension du sens? :
Le sémictique doit ére RECONNU; le sémantique (le discours) doit étre
COMPRIS. La différence entre reconnaitre et comprendre renvoie & deux facultés
distinctes de Vesprit: celle de percevoir V'identité entre Vantérieur et V'actuel,
d'une part, et celle de percevoir la signification d'une énonciation nouvelle, de
Yautre. (BENVENISTE, 1974, p. 64-65)
Deux acceptions du sens sont, en conclusion, a envisager
— le sens lexical (le signifié du signe) se constitue grace aux relations
(eyntaxiques) entre les signes et sera étudié dans son autonomie face &
toute ingérence du non linguistique ;
= une seconde perspective sur le sens en fait un produit de Y'intention du
locuteur de référer 4 un objet, et cect a l'intention de l'interlocuteur.
0.2. Sens et signification
La seule connaissance des régles syntaxiques et sémantiques d’un
systéme linguistique qui associe & une unité linguistique un référent 4 travers le
sens (signifié) dont cette unité est conventionnellement douée n’explique pas le
contenu qu’un locuteur francais voudra exprimer en utilisant, par exemple, les
phrases suivantes :
() Deux petites pidces, dont l'une était mangée par le lit et autre par la table
et le buffet. (E. Triolet, apud LEXIS, s.v. table).
Q) Crest réussi!
@) _ Sile contréleur vient, je ne suis pas ta mre! (apud MARTIN, 1976, p. 120)
(4) I fait chaud ici.
7 Pour un commentaire plus ample du rapport de Benveniste au discours et & la
prgmatique (qu'il appelle « sémantique », dans la mesure ob le discours produit du sens)
cf. Magurearu (2006).
Lesens des mots composant la phrase (1) ne nous dit rien sur intention qu’a
eue le locuteur en prononcant cette phrase: a-til voulu décrire ou évaluer une
Situation, ou encore donner un exemple de l'emploi correct du mot « table » ? Pourtant
cette information est décisive pour Tinterprétation correcte de la phrase, si
interprétation signifie possibilité de réagir de maniére adéquate 4 une information.
____ Pour Vexemple suivant, le PETIT ROBERT, mais non le LEXIS, indique
«réussi, ie adj. (...] 3° Fam. (souvent iron.). Remarquable dans son genre» ;
«souvent iron. », suggérant la possibilité pour le locuteur d’utiliser cette phrase
pour référer 4 une situation évalude négativement; le choix entre le sens
«normal » et le sens ironique de expression dépend de la connaissance que les
locuteurs ont de la situation, ainsi que d'autres éléments para ou non verbaux de
fa communication (mimique, intonation, gestes, etc.)
En commentant l'exemple (3), R. Martin dit que cette phrase, dont le sens
est la négation de « étre la mire de... », prononcée dans un train par une mére
excédée par le comportement de son enfant, en vient a véhiculer le contenu de
«me pas prendre ta défense de...
Enfin, la seule saisie du sens de la phrase (4) n’explique pas pourquoi les
réponses possibles :
(8) Voulez-vous que ‘owore ia fenétre ?
(6) Oui, en effet, passons au salon,
seront ressenties comme « normales », alors que :
(2) Oui, en effet, i fait chaud.
8) Mais non, pas du tout.
apparaissent comme moins prévisibles, ou du moins empreintes d'une certaine
agressivité.
Les exemples ci-dessus montrent existence, outre un contenu véhiculé
Par les unités linguistiques en vertu des régles (sémantiques) du systéme, d'une
composante significative due a l'emploi des ces unités comme signes, dans un
discours, avec une intention et 8 l'intention de quelqu’un, dans une situation
donnée. La compréhension de cette composante significative, la
SIGNIFICATION, met en jeu des régles différentes de celles du systéme, des
regles gouvernant le fonctionnement du systéme et dont Yensemble forme la
compétence discursive des locuteurs.
La signification est due & la propriété qu’ont les unités linguistiques d’étre
utilisées par les locuteurs afin de réaliser leurs intentions communicatives et de
construire une certaine relation socio-communicative.
24
0.3. Dénotation vs connotation.
Cette dichotomie, de source logique, utilisée fréquemment en
linguistique, opére une dissociation de niveaux significatifs. Partiellement
recouverte par l'une ou autre des oppositions suivantes : sens central vs sens
périphérique, sens explicite vs sens implicite, sens objectif vs sens subjectif, sens
premier, littéral vs valeurs additionnelles, etc, elle ne s‘identifie & aucune d’entre
elles. La connotation a regu, selon le cadre théorique oi le terme a été utilisé, des
definitions différentes. En linguistique, la définition la plus précise et opératoire
nous semble étre celle proposée par HJELMSLEV (1943/1968, chap. 22), pour
lequel 1a connotation est un systéme de signification second, dont le plan de
expression est constitué par un premier systme dénotatif; sont dénotatifs Tes
systémes « dans lesquels aucun des deux plans n’est a lui seul un langage ».
Ona:
Dénotation EXPRESSION: _ [ CONTENU:
Connotation [ EXPRESSION:
‘CONTENU:
A chaque fois qu'un signe, doué d'un sens 1, est utilisé afin de véhiculer
tun sens, on dira qu’il a un sens connotatif; ainsi, utiliser le terme « bagnole »
est non seulement référer & un objet réel (une voiture) ~ sens dénotatif -, mais
aussi « connoter » un jugement de valeur [péjoration] sur Fobjet dénoté etfou un
certain type de relation sociale [familiarité} existant entre les interlocuteurs*.
Le caractére systémique de la connotation fait pourtant probleme ; voici
une énumération des diverses variétés de connotation (d’aprés C. KERBRAT-
ORECCHIONI, 1977) :
‘+ vaicurs connotatives issues dune exploitation des jeux phoniques (ex. :
«Femme boniche, femme potiche »); sur cette variété de connotation
repose la valeur de certains slogans publicitaires, des comptines, etc.
* Les valeurs connotatives ont été discutées par les grammairiens ou les rhetoriciens tres
tt; ainsi, A. Arnauld et P. Nicole dans La logique ou art de penser (1662/1970, p. 130)
affirment qu’ ail arrive souvent qu’un mot, outre Vidée principale que Yon regarde
‘comme la signification propre de ce mol, excite plusieurs autres idées qu'on peut appeler
accessoires aux quelles on ne prend pas garde, quoique lesprit en resoive Yimpression
[1 Les expressions figurées signifient, outre la chose principale, le mouvement et la
passion de celui qui parle et impriment Yune et Yautre idée dans Yesprit, alors que
Vexpression simple ne marque que la vérité toute nue». A son tour, Dumarsais (Des
Tropes ou des différents sens dans lesquels on peut prendre un miéme mot dans une méme langue,
1730) soutenait que « Le nom propre de Tidée accessoire est souvent plus présent &
imagination que le nom de ide principale ».
+ valeurs connotatives portant sur d’autres aspects de la communication :
© informations sur le locuteur, sur la situation ou le type de
discours :les mots peuvent étre marqués par des traits signalant
Vappartenance du locuteur 4 un groupe défini par des
caractéristiques de génération, de race, de sexe, idéologiques, etc. ;
© informations sur le type de relation communicative: les mots
appartenant aux divers registres de langue sont caractérisés par leur
emploi dans une situation de communication « familiéze » ,
«formelle», etc, définie par un certain type de relation entre
locuteurs ;
© valeurs reposant sur des associations sémantiques : un mot peut
évoquer des significations étrangéres & son sens par
— ses emplois antérieurs: le mot veux, de par son association
fréquente dans le syntagme veux piewx, connote la « dévotion » ;
— la culture du sujet: un Frangais (mais probablement pas un
Roumain) peut associer au mot loup le sens connotatif de
« injustice » en vertu de données culturellement acquises, dans ce
cas la fable bien connue de La Fontaine, Le loup et Vagneat) ;
— les qualités prétées aux objets a travers les référents
culturellement établis (en principe, tout Frangais associe au mot
chien Vidée de « fidélité »)
~ Texpérience plus ou moins particuligre du locuteur (le café au lait
peut connoter pour quelqu’un I'idée euphorique de « Venfance »).
Le sens connotatif peut donc étre plus ou moins socialisé, plus ou moins
systématique ; certaines valeurs connotatives, apparaissant dans toute situation de
communication, quels que soient le locuteur et son interlocuteur, s’objectivant
par rapport a Vintention de l'utilisateur, ont un caractére systémique : telle est la
situation des connotations «ruse» ou «endurance » pour les mots renard et
respectivement baruf, inscrites dans le systtme de la langue par le biais des
comparaisons figées rusé comme un renard, travailler comme un beeuf, ou encore les
valeurs connotatives ayant trait aux données de la situation, en particulier au
type de relation sociale existant entre les interlocuteurs et déterminant le choix
d'un certain sous-code (registre) de la langue, Ces valeurs connotatives
socialisées et conventionnelles (enregistrées par les régles sémantiques et
ingcrites dans les dictionnaires) peuvent et doivent faire objet d’étude en
sémantique. En revanche, les valeurs connotatives apparaissent dans une
situation communicative unique, dont Yexemple de choix est sans doute la
connotation poétique, échappent & une étude systématique et se réservent pour
une approche stylistique.
26
0.4, La sémantique — étude du sens
Le contenu _véhiculé par une unité linguistique (mot, syntagme, phrase)
utilisée par un locuteur doit, par conséquent, étre analysé a deux niveaux :
« le SENS de l'unité linguistique, régi par les regles (conventions) du
systéme, associant & une forme de f’expression une forme du contenu
donnée ; le sens est constant et apparait inscrit dans les définitions
lexicographiques ; la compréhension de ce niveau du sens dépend de
la seule compétence linguistique ;
« la SIGNIFICATION due a l'emploi de la méme unité par un
Jocuteur avec une certaine intention communicative et 4 l'intention
d’un interlocuteur précis, dans une situation de discours spécifique? ;
interprétation de ce contenu reléve des mécanismes pragmatiques du
discours.
On dira qu'une unité linguistique ayant un sens conventionnel est
utilisée par un locuteur avec intention de signifier quelque chose 4 son
interlocuteur, I n'y a jamais d’identité entre sens et signification.
La dissociation de ces deux niveaux de sens est une option a la fois
épistémologique et méthodologique.
Dans une langue naturelle, la signification dépend non seulement de la
elation expression-contenu-référent, mais également de la relation signe
référent-locuteur institude au cours du processus discursif. Ceci explique le fait
que la signification caractérise non pas, ou rarement, le signe minimal (le mot),
mais bien la phrase énoncée.
En schématisant, on obtient la représentation suivante
LANGUE (systéme)
forme de expression
uw _
forme du contenu
(SENS)
SITUATION
DISCOURS (processus)
SIGNIFICATION
+ Précisons que emploi des termes sens et signification n’est pas observé par tous les
Tinguistes de fagon analogue et que la tendance actuelle est de parler plutdt de la
signification linguistique et du sens pragmatique. La convention que nous propasons ict
se justifie principalement par la commodité de l'emploi du terme sens des mots, puisque
notre objet est réduit ce seul aspect du sens.
27
La plupart des approches du sens peuvent se g
Feposent sur l'une ou l'autre de ces défntons, en see “sen aves
a) approches conceptualistes, identifiant le sens au concey
7 -pt (SAUSSURE,
OGDEN et RICHARDS, partiellement PEIRCE) ;
b) approches référentielles (théorie de la dénomination) : le sens est objet
méme auquel il renvoie ;
©) approches fonctionnelies : le sens est I'usage : les mots n’ont pas de
sens en dehors de usage qu'on en fait (BLOOMFIELD, 1933;
WITTGENSTEIN, 1952/1961; AUSTIN (1961); GRICE (1957/
1971), ete.™),
ll est possible d’icentifier dans ces trois attitudes se voulant opposées
les trois perspectives : syntaxique, sémantique et pragmatique, selon lesquelles
la sémiotique définit et décrit tout phénoméne susceptible de fonctionner
comme signe.
La démarche sémiotique, acceptant d'une part la complémentarité du sens
et de la signification et, d’autre part, le caractére systémique du processus
disco et, partant, de la signification, reconnait deux paliers distincts du
phénoméne dit «sens» dont la saisie appelle des procé ipti
également distinctes. pals des procures de descpdon
La sémantique linguistique (de la langue), inscrite dans le i
; nguistique ) premier grou
d'approches, est appelée a décrire le sens (signifié) des unités linguistiques. ta
compréhension des énoncés par un locuteur exige une étude complémentaire de
la signification formant une sémantique discursive (discipline s'inscrivant dans la
perspective pragmatique).
Cet ouvrage porte principalement sur I'étude du sens lexical. Seules les
classes sémantiques & fonction représentative (ce que la sémantique traditionnelle
appelle des mots «pleins», opposés aux mots « grammaticaux», ou
« morphémes ») seront ici discutées,
1. Sens, référent, objet
1.1, Objet vs référent
existe des maniéres différentes de concevoir l'objet du si i
a tu signe,
préter 3 des confusions. Le signe peut renvoyer biel igne, ce qui peut
» La formule souvent citée de Wittgenstein (1952/1961, § 43): « La
, § 43): « La signification d'un mot
est son usage dans le langage » est sans doute paradigmatique pour cette approche,
28
1. une entité ou une classe dentités concrétes du monde réel : école, chien,
froid, écrire renvoient a des «objets » (étres, objets, phénoménes,
activités, etc.) dont existence peut étre percue par les sens ;
2. une entité ou une classe d’entités abstraites: qualités, actions,
événements, dont l'existence est persue par I'expérience ; ainsi, bonté
curiosité, angoisse renvoient & des sentiments, & des propriétés dont
nous avons tous Vexpérience ;
3. une entité (concréte ou abstraite) n’existant pas dans le monde « réel »,
mais & laquelle on peut référer de la méme fagon que dans le cas des
objets réels.
Selon PEIRCE, peut étre l'objet du signe
tout ce qui est présent & Vesprit sans considérer aucunement si cela correspond &
quelque chose de réel ox non (1.284)
Du point de vue de la compréhension du sens lexical, Videntité
ontologique de Vobjet du signe ne fait pas de différence. Ainsi, les phrases :
(9) _Lesirine charme les marins par sa voix. (apud REY-DEBOVE, 1976)
(10) La cantatrice charme le public par sa voix.
seront comprises par le Jocuteur/Vauditeur grace 4 la mise en ceuvre d’un méme
mécanisme référentiel"
Dvautres estiment que siréne, licarne, etc. ne renvoient pas a un objet réel et
wont pas de référent. Pourtant, le discours lttéraire, utilisant des signes qui ne
renvoient pas & des existants dans le monde réel, n'est pas pour autant dépourva
de sens ou de signification.
‘Une telle conception trahit une identification de la langue & un inventaire
d’étiquettes correspondant aux inventaires d’objets ou de phénomenes du monde
réel, La langue ne se réduit pourtant pas a cette fonction. Ce qu’on appelle
«objet » du signe est un objet construit par Ie locuteur au moyen de la langue;
cest Vobjet nommé a la suite d'une opération cognitive {aussi empirique
soit-elle)?. De ce point de vue, la distinction objet réel, concret ou abstrait, vs
» Pareillement, Karttunen (1969/1976) considére que les phrases Bill has a car et Bill saw
@ unicorn se comportent linguistiquement de fagon analogue, le SN indéfini
introduisant un nouveau référent discursif qui peut étre, dans les deux cas, repris par a
suite par un SN défini.
® La distinction entre objet réel et objet du signe linguistique recoupe la distinction que
propose Peirce entre objet dynamique et objet immédiat du signe, seul le dernier entrant
dans la relation de sémiose.
29
objet imaginaire n'est plus pertinente: le mécanisme référentiel et le type de
rapport sémantique rattachant un signe un objet ainsi construit est dans chaque
cas identique. Les signes son «produits sous la pression de Uexpérience du
monde » (ECO, 1980, p. 75). Nous proposons d’introduire le terme de référent
pour désigner I’ «objet» construit, tout en réservant le terme objet aux
phénomenes de la réalité, concréte, abstraite ou fictionnelle.
‘Une comparaison entre les langues révéle que si des usagers utilisant des
systdmes linguistiques différents se rapportent 4 un méme objet réel, ils peuvent
Ie faire de maniére différente. Ainsi, le locuteur roumain et le locuteur frangais
pourront identifier, en utilisant les énoneds
(11) 1. Am participat la 0 vindtoare de vulpi.
2. J'ai participé & une chasse au renard.
(12) 1. Fitatent, eo oulpe sireati !
2. Fais gaffe, c'est un fin renard !
la méme classe d’animaux auxquels ils assignent les mémes propriétés : animal +
mammifére carnivore + oreilles droites + museau pointu + ...+ (auquel on attribue
la propriété d’étre) rusé, reflétées par le sens du mot ; mais une expérience sociale
et culturelle différente explique la création en francais d’emplois ot le mot
acquiert des sens absents en roumain : renard [...} 4. Vx. Ouvrier non affilié & un
syndicat, qui refuse de faire la gréve (syn. JAUNE)[...] 6. Pop. et vx. piquer un
renard, vomir.// Pop. Tirer au renard, refuser d’avancer ; chercher & s'esquiver.
(apud LEXIS, s.v. renard). Un méme objet réel se trouve a la base de référents
distincts, traduisant des mentalités, opinions, points de vue, expériences divers.
Le référent du signe est donc une construction culturelie, un ensemble de
propriétés que les locuteurs attribuent aux objets. L'ensemble des référents forme
Vunivers sémantique (la substance du contenu) d'une langue; construire la
sémantique d’une langue naturelle touche de prés & la reconstruction de I'univers
culturel de la communauté linguistique respective et qui comporte des savoirs,
des croyances, des savoir-faire, des valeurs, etc. Le linguiste allemand Ch. TRIER,
précurseur du structuralisme sémantique, écrivait :
‘Chaque langue est un systéme qui opére une sélection au travers et au dépens de
la réalité objective. En fait, chaque langue crée une image de la réalité, complete,
qui se suffit 4 elle-méme. Chaque langue structure la réalité & sa propre fagon et,
par la méme, établit les éléments de la réalité qui sont particuliers a cette langue
donnée. (apud MOUNIN, 1963, p. 44).
Cette these explique également la formule de R. JAKOBSON (1963, p. 84) :
Les langues différent essentiellement par ce qu’elles doivent exprimer, et non par
ce quilles peuvent exprimer.
En effet, cest univers culturel, comme ensemble de référents, que les locuteurs
représentent au moyen des signes et cet univers culturel r’est jamais identique
d’une communauté socio-culturelle 4 Yautre.
1.2, Signifié, référent, concept
Pour les linguistes qui confondent signifié (sens) et concept, la distinction
referent vs objet (denotatum) correspond a la distinction logique intension vs
cxtension les logiciens définissent le concept soit par son extension, en
énumérant les objets qui appartiennent & une classe d‘objets auxquels s‘applique
le concept, soit par son intension, ou ensemble de propriétés essentielles,
nécessaires ot suffisantes pour reconnattre 'appartenance d'un objet & la classe
respective. .
Le logicien se propose de répondre a la question siI'énoncé
(13) Lobjet X est un A
est vrai ou faux, ou encore d’expliquer pourquoi I'énoncé
(14) Ast aretfou ae etfou as.
(ol A est nom de Yobjet et ay, a, te. indiquent des propriétés de Vobjet)
est toujours (analytiquement) vrai.
Le linguiste dott expliquer ce qu’un locuteur dit en énongant :
(15) It voyage toujours en voiture.
(16) Haacheté une bagnole.
(17) H ressemble @ son pére.
(18) Mon papa m’e fait cadeau d'un train électrique.
et, a cette fin, ajouter aux définitions conceptuelles « objet appartenant & une
sous-classe de la classe des véhicules caractérisée par...» ou «personne
appartenant & une sous-dasse de la classe des humains + mile + adulte,
caractérisée par... » des propriétés telles que « objet de luxe vs objet utilitaire »
cu, respectivement, « dans le langage des enfants vs dans Je langage standard »
31
ou encore « exprimant un rapport affectif du locuteur a Yobjet désigné »- Ces
Propriétés, qui ne caractérisent plus ‘objet, mais le rapport du locuteur a Vobjet
ou & son interlocuteur; appartiennent au réfrent du signe et non au concept et
encore moins a l'objet.
LQ. Signifié et réferent. Le signifié et le référent doivent étre retenus
comme des entités constitutives du signe linguistique, le concept et l'objet comme
des entités dont le rapport forme l'objet d’étude en logique®. On peut proposer le
schéma suivant :
SIGNIFIANT
concert. *~ [opjerreet |— reetrenr sIGNERE
Logique Linguistique (sémiotique)
Le référent est un ensemble non structuré de propriétés référentielles que
les locuteurs assignent aux objets ~ réels (conerets ou abstraits) ou imaginaires —
sur la base d’habitudes ou d‘expériences socio-culturelles partagées ou 4 I'issue
d’expériences individuelies non socialisées. Le référent est donc une
représentation, une « image » de l'objet qui peut étre plus ou moins différente
d'un locuteur & l'autre, Une base commune doit toutefois fonder la possibilité et
la condition de succes de l'intercompréhension.
Cette base commune, ou une partie de cet ensemble, une fois mise en
forme linguistique, exprimée par un signe appartenant au code linguistique,
constitue le signifié (sens lexical),
‘On peut se demander si voiture et bagnole, ou encore pére et papa, renvoient
respectivement des référents distincts. La réponse négative nous semble
simposer. La synonymie releve du systme linguistique qui introduit, &
Vintérieur de ensemble non organisé de propriétés référentielles (‘univers
» Au sujet de V'idéographie (langue artificielle) de Frege, F. Jacques (1985, p. 259)
remarquait : « Comme toutes les langues formulaires, elle est avant tout un langage non
‘marqué par rapport aux contraintes de T'interlocution. Elle est telle que « le signe renvoie
directement & la chose » . En quoi le régime de la référence y change du tout au tout par
rapport a la langue naturelle,
32
sémantique), une organisation qui Iui est propre; ainsi dans les exemples ci-
dessus un méme référent est en rapport avec des signifiés distincts ; dans une autre
langue, les distinctions peuvent ne pas étre pertinentes, cest-a-dire ne pas se
trouver A [a base d’une opposition lexicale : si les Francais savent que la neige
peut étre molle ou durcie, ou encore poudreuse, qu'elle tombe au sol, Jeur
experience sociale n’a pas imposé la lexicalisation de ces propriétés par des mots
différents, comme cest le cas dans la langue des Eskimos. Le signe est done
dépositaire d'un sens ~ signifi, résultat d'une structuration linguistique de
Yunivers sémantique des référents.
Un autre phénoméne témoigne de la méme distinction signifé vs referent
il est possible qu'un référent « pensable» (que l'on peut construire) ne soit pas
actualisé dans un systéme linguistique ; ce phénoméne est connu sous le nom de
lacunes lexicales (trous lexicaux, lexical gaps) ; si le frangais dispose du mot sitge
pour référer & tout objet (meuble) servant & stasseoir, tel n’est pas le cas en
roumain ; en revanche, les deux langues ne disposent pas, ni l'une ni autre,
d'un terme référant dla classe des objets « pour écrire », etc.
La distinction signifié vs référent reflete donc la distinction forme du content
‘vs substance du contenu". Et méme si Yon s‘en tient a la seule étude du systéme
Iinguistique, sans se préoccuper du fonctionnement discursif de ce systtme, il est
impossible & notre avis de décrire le systéme de signifiés (objet de la sémantique
du sens) en dehors de toute considération sur la substance du contenu
(ensemble des référents). HJELMSLEV remarquait déja que:
La description de la substance du contenu doit (...] consister avant tout en un
rapprochement de la langue aux autres institutions sociales, et constituer le point
de contact entre la linguistique et les autres branches de l'anthropologie sociale ».
(HJELMSLEV, 1957/1971, p. 118)
De 1a les nombreuses difficultés auxquelles se sont heurtés les chercheurs, les
échecs quiils ont essuyés et qui ont motivé le refus que beaucoup de linguistes
ont opposé a toute tentative de décrire (systématiquement) le sens.
1.2.2. Le référent: ECO, DUCROT, POTTIER. La conception du référent
du signe Jinguistique comme «image » sociale ou individuelle de Yobjet se
retrouve chez plusieurs auteurs, non sans de notables différences dues
principalement au cadre théorique dans lequel s‘inscrit leur réflexion.
+ Greimas (1966) parlait de niveau sémantique et de niveau sémiologique.
ECO rediscute, dans la perspective d'une sémiotique générale, les
Principes d’une analyse structurale du sens lexical (le modéle proposé par KATZ.
et POSTAL (1964) dans analyse du lexéme bachelor). Pour le sémioticien italien,
le référent est un « état du monde » (ECO, 1976/1982, p. 141) auquel renvoie le
Jexéme. Le sens du mot inclut les présuppositions sémantiques (qui peuvent étre
assimilées aux traits sémantiques) et correspond & une unité culturelle (idem, p.
150sq) ; ECO soutient que :
lest nécessaire que les circonstances objectives externes soient, en fait, soumises
4 un traitement et & une convention sémiotique. On peut considérer que les
irconstances externes font partic, & titre d'entités codifiées, duu spectre
componentiel du séméme (le sens lexical, n.n & condition que les objets et les
images ou Jes expériences soient placés dans le champ d’une théorie sémiotique.
(ECO, opcit, p. 153 ; nous traduisons)
ECO en vient ainsi a considérer que :
Pour un contemporain, « baleine » est probablement un séméme assez peu organisé,
it les propriétés d’étre poisson et d'étre mammifére coexistent, et le spectre
‘sémantique apparait comme un réseau ot des sens contradictoires ou au moins
incompatibles se superposent (idem, p. 155 ; nous soulignons)
et, sur cette base, @ proposer «une représentation sémantique sous forme
d’encyclopédie », susceptible de rendre compte de enchevétrement de toutes
les significations que les traditions biblique-médiévale, scientifique ou populaire
ont pu déposer dans le séméme baleine. Par ce concept de « séméme comme
encyclopédie », ECO annule toute différence entre signifié et référent et rend
impossible, & notre avis, une démarche descriptive systématique du sens lexical.
On peut évoquer, & ce sujet, 'évolution de la théorie de l'argumentativité
dans Je langage mise au point par DUCROT et ANSCOMBRE vers une
minimisation de la fonction informative (et représentative) de la langue au profit
de sa fonction argumentative. Dans le plan du sens lexical, les auteurs
introduisent le concept de topos, sorte d'idée socialement acceptée par la
communauté des locuteurs liée @ une expérience commune, et qui est associé a,
sinon inclus dans le sens lexical. Ainsi, DUCROT (1990, p.4) considére que :
Le mot loin, [...] représente la distance comme justifiant, & travers un certain
topos, lié directement ou indirectement & la signification linguistique de oe mot,
tune conclusion donnée. [...] cette argumentativité [..] constitue pour moi le sens
‘méme dui mot oin |...) (nous soulignons)
34
De méme, ANSCOMBRE (1989) soutient que :
Comprendre un mot de la langue, ce n’est pas savoir qu'il renvoie généralement
& un objet [...] ou & une propriété dont seraient ou non dotés certains objets, mais
tre capable de lui associer un fsceau de top et sa mise en ceuvre.
Nous considérons que le ou les topoi associés au sens lexical
appartiennent en fait au référent, puisque dans les exemples
(19) Loin des yeu, loin du coeur.
(20). Hest loin d’avoir compris ce qu'on tui reprocke.
{et les exemples pourraient étre multipliés), il faudrait dans chaque cas proposer
des topoi divers pour insérer I'énoneé dans un enchainement argumentatif®.
Dans une perspective plus proche d'un cognitivisme avant Ia lettre,
POTTIER’ place l’analyse du sens lexical dans le contexte communicatif qui
met en rapport Je locuteur, le monde et la langue : il jette ainsi les bases d’une
version «faible» du structuralisme. Les deux rapports référentiels dont
parlera GREIMAS, au monde et au sujet, proposent, avec des fortunes
différentes, des questionnements nouveaux, auxquels la linguistique sera
appelée a fournir des solutions.
La sémantique référentielle s'est polarisée entre identification du sens
aux propriétés référentielles (empirisme logique : MILNER”, 1982, KATZ, 1972)
et la dénégation du rapport référentiel comme « illusoire » chez GREIMAS*,
Refusant ces deux attitudes polarisées, POTTIER inscrit le rapport
référentiel dans le schéma commuinicatif*
Commentant l'exemple qu'il propose, Ducrot (1990 et 1993) introduit le topos « Plus un
lieu est éloigné, plus ilest pénible de s'y rendre & pied » (Ducrot, 1003, p. 246).
4 Nous avons développé une reconsidération de la modernité des théses avancées par
Pottier dans Magureanu (2005).
" A titre d’exemple, rappelons que le sens lexical est, pour JCI. Milner (1982)
«ensemble de conditions que doit satisfaire un segment de réalité pour pouvoir étre la
référence d'une séquence oi interviendrait crucialement I'unité lexicale en cause ».
™ Greimas et Courtés, 1979, p. 335.
© Pottier (1974, p. 63): « Toute signification est relative A des ensembles d’expérience
selon les circonstances de la communication. »; le schéma que nous proposons est une
mise en forme unique des deux schémas par lesquels Pottier représente les parcours
respectfs de I'émetteur et du récepteut (1974, p. 22). Notons que cette représentation du
processus de production/compréhension du sens connaitra une version affinge dans la
‘Sémantique générale de 1992 (chapitre I).
i
i
|
énonciation
WAR — conceptualisation + code (LN) — message
Col Cot mise en signe (lexémes)
‘+ compréhension —
(ol % désigne le monde de référence, Co la conceptualisation, les indices
marquent la non-coincidence parfaite des processus de production et de
compréhension du sens)
le schéma indique un rapport médiat des signes & la réalité (relation de
déromination) & la suite d'une opération de conceptualisation™ : le locuteur procéde
a une «saisie mentale » de la réalité, ou « réduction sélective de la référence s
(POTTIER, 1974, p.27): .
signe
Le signe dénomme un référent (réel ou imaginaire), et il a une signification
Gan ee, de Propriétés relatives 4 ensemble de signes dont il fait partie
(idem, p.28).
{Le concept Gtant un agglomérat sémique dintention (1974, p. 44) i
apparait comme Je médiateur entre Vobjet-référent et Je signe qui le
dénomme. Le concept est informe (let, il est done autonome par
rapport 4 la langue: «Selon les langues il va étre informé »
différemment, c’est-i-dire il prendra une forme contextuellement bien
formée. Ainsi, le concept EAU QUI TOMBE DU CIEL sera lexicalisé en
frangais comme pluie ou pleuowir selon la fonction (base ou prédicat
dans 'énoncé.
ee
® Pour plus de détails : sous le nom de conceptualisation, B. Pottier (1974, p. 21) décrit le
Processus de la constitution du concept: « Le stimulus est le monde de référence (réel ou
imaginaire). I est non fini et non discret. L’émetteur doit en faire une saisie mentale ‘pour
sélectionner un certain nombre d’éléments de la perception : tout ce qui est imaging ou
Percu n’est pas dit. C'est le phénoméne fondamental de la conceptualisation ou réduction
selective de la référence ® ;
Ry > conceptulisation
TI nait ainsi une structure d’entendement, trs lie
nature déliee des langues naturelles ». ™ Profende Hew dete connatance Pas
36
(ii) Le signe est, dans ce cadre, doublement déterminé : par la relation de
dénomination et par son appartenance 4 un ensemble lexical dont il
« tire sa signification » (1974, p. 28).
(iii) La lexe et le référentiel semblent redoubler, chez POTTIER, les paliers
du parcours monde - signes: la premiére est définie dans son
autonomie cognitive, le second dans son rapport au signe.
(iv) L’analyse du sens lexical suppose donc chez POTTIER une prise en
considération constante du « réiérentiel », sorte de signe-en-puissance,
de point d’ancrage du linguistique sur lextra-linguistique. Le
locuteur applique une sorte de « filtre prégnant » au monde, réel ou
imaginaire, pour en construire un référentiel, terrain d’entente ou, au
conti :, de mésentente communicative :
Dans ce cadre s‘expliquent les mauvaises interprétations de discours lorsque le
récépteur a adopté, consciemment ou non, un file sélectif (pouvant conduire &
la paranoia) (POTTIER, 1992, p. 62)
Le référentie! de B. POTTIER est proche de notre conception du référent ;
de plus, POTTIER suggére I'inexistence de toute solution de continuité entre
analyse (structurale) du sens et le cadre communicatif qui assure aux mots leur
force signifiante.
Lidentité strictement linguistique du sme évite d'assimiler sémes et
ropriétés réferentielles : en effet , dans ce que G.KLEIBER appelle le modéle des
conditions nécessaires et suffisantes - proprités intensionnelles qui définissent
en extension les catégories de référents et ou objets, modéle identifiable dans
Vanalyse componentielle (KATZ, FODOR, POSTAL) ou sémique (POTTIER,
GREIMAS), apparait un court-circuitage du linguistique au profit du référent, un
référent qui appartient & des catégories aux frontiéres nettes et aux membres a
statut homogéne. D’autre part, ce type d’identification du sens lexical au référent
(concept) au travers duquel il référe & un objet du monde annule l'arbitraire du
signe et en fait un analogon « cratylique » de lidée de Yobjet, qui, lui, s‘efface
définitivement,
Ainsi, le réflexion de POTTIER nous invite a considérer que seuls les
semes distinctifs sont en nombre fini et structurés par le systéme linguistique,
alors que les propriétés conceptuelles-référentielles semblent, du moins dans
certains cas, former une collection d’unités en nombre non fini.
Remarque. dans certains cas, POTTIER Tui-méme risque de basculer d’un
plan a Vautre, comme le montre le commentaire suivant
37
Personne ne pourra dire ce qui fait passer d'une brochure & un livre (ce n’est pas tel
nombre de pages), ou courir & galoper (ce n‘est pas telle vitesse). De méme quelle
altitude est nécessaire pour pouvoir employer le terme montagne (1974, p.72)
Or, dans le cas de ces exemples, il nous semble intuitivement plus
adéquat de considérer que cest I'application référentielle qui fait probléme, et
ion le sens des mots, De méme, Yexemple Les CRS épousent parfois les
automobilistes qu‘ils dépannent sur Ia route constitue un échantillon d'interprétation
Pragmatique du sens implicite: « CRS impliquant ‘méle’ dans la situation
francaise actuelle, cela implique que automobiliste, qui est indifférent au sexe,
‘éalise ici le seme‘ femelle’ » (idem, p. 74)
1.2.3. KLEIBER: le prototype. Si les unités lexicales ont pour fonction
premiere de désigner, représenter, la question qui se pose en premier lieu est de
savoir, soutient KLEIBER, « quels sont les criteres qui permettent d’utiliser, par
exemple, 1a dénomination chien pour un chien »(1990, p. 17). La réponse
implique Topération mentale de catégorisation, et la question devient alors de
savoir quels sont les critéres qui réunissent un certain nombre d’entités dans un
méme catégorie :
Le mot [...] désigne ainsi une catégorie (ou un concept) et stinterroger sur les
membres pour lesquels il peut étre employé revient a sinterroger sur les
‘membres qui font partie de la catégorie qu’il représonte, {(KLEIBER, 1990, p. 17)
approche de type structural (syntaxique) construit les catégories de
dénominations (lexémes) comme un ensemble de propriétés nécessaires et
suffisantes (modéle des CNS, pour KLEIBER). Un tel modéle, qui suppose
existence de catégories & limites clairement établies, 'appartenance (ou non) de
toute entité une certaine catégorie et I'identité de position de tous les membres
d'une méme catégorie, se place tout naturellement dans la lignée de la théorie
saussurienne de la langue comme systime de signes définis différentiellement,
Considérant, 4 la suite de psychologues, d’anthropotogues ou de
Philosophes du langage, que ces catégories n’ont pas de réalité cognitive,
KLEIBER propose une sémantique du prototype comme « alternative aux théories
Classiques du sens» (op.cit., p.18). Cette direction s‘inscrit, comme version
cognitiviste, dans l'approche référentielle de la sémantique.
Pour les tenants de la sémantique du prototype, les catégories n’ont pas
des limites nettes et les entités apparticnnent a la classe grace A une
«ressemblance de famille» (notion witlgensteinienne), les membres d'une
famille étant reliés transitivement, sans qu’ils partagent tous une méme
38
propriété. Ils occupent donc des places centrales, comme exemplaire
«prototypique », ou, au contraire, périphériques. De méme une hiérarchie
s’établit entre catégories : niveau de base, superordonné et niveau subordonné.
Ainsi par exemple (op. cit,, p. 83)
SUPERORDONNE animal fruit meuble
NIVEAU DE BASE chien —pomme chaise
NIVEAU SUBORDONNE boxer golden chaise pliante
Pour KLEIBER, la sémantique du prototype (dont il présente une version standard
amendée ensuite par une version étendue) a plusieurs avantages par rapport a la
sémantique d’inspiration structurale (op. cit., p. 18) oo
(i) elle réintégre dans le sens du mot les traits sémantiques
encyclopédiques (non différentielles) ; .
(ii) elle permet de décrire organisation interne d'une catég _
(ii) elle établit une hiérarchie de niveaux categories pouvant étre utilisée
ns la description de la hiérarchie lexicale.
la piace nest oe ici d'évaluer les avantages et les difficultés de ta
sémantique du prototype" : disons toutefois que, 4 notre avis, la sémantique du
prototype n’est pas une théorie sémantique du sens lexical, mais une théorie a
référent, des référents, comme le suggérent les nombreuses incursions dans la
psychologie et les mécanismes cognitifs. Pour ceux — dont nous sommes ~ qui
n‘acceptent pas d'identifier sens et référent et qui maintiennent la nécessité d’ ne
codification linguistique comme condition nécessaire, bien que non suffisante, de
compréhension, la sémantique du prototype est une approche complémentaire et
non une alternative de la sémantique lexicale.
Méthodes en sémantique
0, La démarche traditionnelle
Pendant longtemps étude du sens accepté comme un phénoméne
empirique, dont seule la modification est analysable, a autorsé une
méthodotogie visant & déctire les changements subis en diachronie par le sens
d’un mot considéré hors du (micro)systéme auquel il appartient. On étudiait les
> Analysant les avantages de la sémantique cognitive, Récanati (1999) souligne aussi que
le point faible de cette sémantique est sa théorie des classes sémantiques et que le concept
de ctégorie et mal defini estime quel taxied Potties (1974 ou encore ke domaine
de Coseriu sont des concepts mieux définis dans le contexte de la sémantique structural
39
causes et les types de changements ; le sens demeurait une entité inanalysable et
‘a possibilité d'une étude systématique de univers sémantique était exclue®,
1, Les approches structurales
La conception de la langue comme systéme, le double postulat du
caractére structural de ‘objet étudié et de Visomorphisme des plans de la langue
@ abouti 4 la constitution d'une sémantique structurale. Les représentants de
cette direction s‘€vertuent & décrire principalement le sens lexical, utilisant les
procédures mises 4 I'épreuve en phonologie et en morpho-syntaxe. La
sémantique structurale européenne, constituée dans les années ‘60,
principalement en France, développe un modele descriptif du lexique basé sur les
notions saussuriennes de valeur et de différence.
Dans le cadre de la grammaire générative, a partir du principe de la
description d’un nombre virtuellement infini d’unités au moyen d’un ensemble
fini de traits, il s'est constitué d’abord une sémantique interprétative s‘attachant A
décrire Ie mécanistme qui associe aux formes engendrées par la syntaxe une
interprétation sémantique. La grammaire comporte un dictionnaire assignant &
chaque élément lexical une ou plusieurs interprétations. Des régles d’insertion
lexicale prévoient Ja substitution des entrées Iexicales aux symboles des
indicateurs syntagmatiques engendrés par la syntaxe. C’est la sémantique
componentielie construite par KATZ, FODOR et POSTAL: elle est une variante
de approche structurale avec laquelle elle partage les principes et les outils
méthodologiques.
1.1. Le renouveau en sémantique, aprés le tournant structuraliste, a été
apporté par la sémantique générative™, dont les tenants nient la centralité de la
syntaxe, comme d’ailleurs la distinction syntaxe vs sémantique ; les mécanismes
génératifs engendrent des formes (structures sous-jacentes) contenant toutes les
instructions pour l'interprétation sémantique (des représentations sémantiques).
Le sens lexical est structuré de maniére analogue au sens phrastique et les mémes
contraintes générales président aux régles gouvemant la combinaison des
éléments du sens lexical et les régles syntaxiques™
» A consulter & ce sujet Guiraud (1969) et Ullmann (1965).
® Sur la sémantique génézative, on peut consulter Galmiche (1975),
+ Pour une excellente présentation analytique et critique de la sémantique dans le cadre
de la grammaire générative transformationnelle, v. Tujescu (1982).
40
1.2, Ala suite de H. PARRET (1976), nous présentons quelques aspects
qui rapprochent ou qui opposent les directions principales de la sémantique
contemporaine :
Approches structurales __Approche générative
«Sémantique structurale Sémantique générative
(analyse sémique, analyse
componentielle
+ Sémantique interprétative
sens, congu comme ensemble structuré d’unités minimales
descriptive explicative
niveau d’analyse : fe lexéme la phrase
- procédure de découverte: inductive civ
= role de la sémantique terprétatif générati
5 d’approche ne s’excluent pas mutuellement, ils sont
copisnenties par ie cho dy niveau de description de objet, Sinserivant
dans une méme conception « structurale» du sens; ils fournissent chacun des
procédures de découverte dont on doit tenir compte si l'on veut dépasser le
niveau lexical pour arriver & la compréhension des phrases ou des textes.
1,3, Léétude de la signification a suscité des difficultés considérées
pendant longtemps comme insurmontables ; envisagée comme un fait * Parole
non systématique et aesiente ila fala que soit dabord reconnue Vexistence
dune compétence et, par conséquent, des regies discursives pour que les inguis
se hasardent & avancer sur ce terrain de sables mouvants. L’étude du discours,
constitué d’actes de langage, dont la performance obéit aux régles an syste
dynamique prescivant Yemploi adéquat d'une unité linguistique dans ‘une
situation donnée et afin de réaliser une certaine intention communicative, a me
évidence des mécanismes dont la description exige le recours a des modéles et des
méthodes empruntées & des disciplines telle que la logique de Faction, les logiques
modales (épistémique, érothétique, déontique, etc.), la sociologie.
2. Langue-objet vs métalangage en sémantique
[A la suite de HJELMSLEV (1943/1968) on appelie un systéme second de
signification dont le plan du contenu est constitu par un autre langage
métalangage. Tel est le cas du métalangage scientifique permettant de décrire
tun objet lui-méme constitué en langage.
4
Langue-objet_ [EXPRESSION, | CONTENU,
Métalangage [ EXPRESSION,
CONTENU,
La question du rapport objet décrit vs discours descriptif polarise les démarches
sémantiques autour de deux attitudes qui semblent irréconciliables :
(i) Ia plupart des sémanticiens acceptent la nécessité d’un métalangage
descriptif et beaucoup tentent de forger une expression propre afin
d’éviter les confusions et imprécisions dues 4 "homonymie ; lexéme
du_métalangage - lextme de la langue naturelle (objet de la
description);
(ii) certains sémanticiens proposent, dans la tradition du modéle
définitionnel aristotélicien dont la civilisation européenne semble
profondément empreinte et dans le sillage de l'idée peircéenne de la
sémiose infinie (le sens d'un signe est un autre signe), une sémantique
« synonymique », fondée sur lidentité référentielle et rendant inutile
tout métalangage (REY-DEBOVE, 1976).
‘Tout en cherchant a éviter les barbarismes auxquels peut aboutir la tentative de
créer un métalangage, cest la premiére position qui a été adoptée dans la
rédaction de cet ouvrage.
Conclusions
+ Vobjet d’étude de la sémantique est le contenu (sens) véhiculé par les
unités linguistiques utilisées par les locuteurs dans une situation de
communication.
+ Une sémantique restreinte ~ la sémantique du systéme (du sens) ~ se
Propose de décrire le sens des unités linguistiques au sein du systéme
auquel elles appartiennent.
+ Le sens ~ signifié ~ des unités linguistiques en est un élément
constitutif ; il a un caractére systématique et relationnel.
+ Le sens permet a un locuteur d'utiliser lunité linguistique afin de
référer & une entité extra-linguistique : unité linguistique devient ainsi
signe d’autre chose.
® Outre le métalangage construit par les diverses variantes de la sémantique structurale,
citons Wierzbicka (1991) qui s'attache a construire un métalangage constitué de primitife
sémantiques qui permettent une description interculturelle des phénoménes langagiers
studiés,
2
Le référent du signe est une construction culturelle, résultat d’une
cexpérience sociale. ;
‘+ L’emploi des unités linguistiques comme signes dans un discours
‘engendre la signification, plus ou moins conventionnelle, constante ou
accidentelle. om &
‘© Une unité linguistique, douée d’un sens par les conventions du
systéme, est utilisée par le locuteur afin de signifier & son interlocuteur
quelque chose (avec une certaine signification) et de réaliser ainsi une
intention communicative donnée. .
* Léétude du sens implique par conséquent l'étude des conventions
(regles) qui associent A foute forme de expression une forme du
contenu.
+ Le caractére ouvert du lexique dune langue naturelle exclut la
prétention d'exhaustivité et astreint le sémanticien a l'étude des
mécanismes généraux qui engendrent le sens et/ou la signification,
ainsi qu’a une étude toujours partielle des microsystémes sémantiques
d’une langue donnée.
Cet ouvrage présente les résultats obtenus dans I’étude du sens lexical et
adopte, dans le cadre général d’une approche sémiotique, la mthodloge
adéquate & l'objet ainsi restrictivement délimité, notamment les procédures de
Stein il nous a semblé intéressant, et méme nécessaire, d’offrir au
lecteur une perspective élargie, en ptoposant des incursions dans Je contexte
interlocutif, la oit les mots-occurrences ont et font un sens.
43
en
CHAPITRE II
LA STRUCTURE DU SENS LEXICAL
L’analyse sémique
0. L'hypothése structurale
T’étude du sens repose sur un ensemble d’axiomes régissant la
description linguistique a tous ses niveaux :
(1) le caractére systémique des langues naturelles
Q) Janature biplane de 'unité linguistique
(3). Fisomorphisme structurel des deux plans (expression et contenu).
Accepter ces axiomes, c'est accepter :
a) la possibilité de viser 4 une description du plan du contenu
b) Ia possibilité d’utiliser & cette fin les mémes moyens utilisés dans la
description du plan de l'expression (phonologie, morpho-syntaxe) et
de jeter ainsi les bases d’une sémantique structurale.
0.1. Objections
Les objections & cette hypothése n’ont pas manqué : elles viennent de la
part des linguistes qui estiment que le sens etou {a signification relevent de la
parole (situation d’ usage), phénoméne individuel, irrépétable, non systémique et,
par conséquent, inanalysable (attitude adoptée par le distributionnalisme
américain); d’autre part, de nombreux linguistes qui acceptent le caractére
aystémique de la langue, refusent cet attribut au lexique, en invoquant son
caractere ouvert.
A ceci on peut répliquer que :
«Ie sens en langue n’est ni identique ni réductible a la signification
en usage;
45
+ Ja signification elle-méme est en grande partie régie par des
mécanismes réguliers, sans quoi le fait de parler et de se comprendre
serait inexplicable ;
+ Vinterdépendance d'un signifiant et d’un signifié & intérieur d'une
unité linguistique autorise a considérer le plan des signifiés susceptible
dune analyse systématique au méme degré que le plan des
signifiants ;
* le lexique s‘organise en micro-systémes sur la base (i) d'une
structuration ontologique ou logique de objet (v. par exemple les
ensembles lexématiques désignant les relations de parenté, les grades
militaires, les couleurs, etc, ensembles connus généralement sous le
fom de «terminologies »), soit (ii) de rapports exclusivement
sémantiques (relations d’identité, inclusion, d'intersection, de
disjonction) ou encore, souvent, (iii) de la complémentarité du critére
référentiel et du critére sémantique ;
+ la saisie synchronique caractérisant toute approche structurale limite le
nombre des unités a décrire 4 un ensemble sinon fini, du moins
déterminé, et exclut les changements diachroniques,
0.1.1. Toutefois la définition du référent comme construction culturelle et
de Y'univers sémantique comme ensemble des référents virtuellement nommables
dans une langue naturelle donnée, suggére les limites que la sémantique
structurale se doit d’assumer, sous peine de vouer a échee une promesse
dexhaustivité impossible a tenit, La co-extensivité de Yunivers sémantique d’une
langue a la culture qu’elle permet de véhiculer condamne le sémanticien & accepter
de limiter le principe structural d'une description de objet au moyen d'un
ensemble fini de traits distinctifs aux seules analyses des micro-systemes lexicaux.
Ainsi la grande illusion des années 1960 - qui croyait possible de doter la
linguistique des moyens nécessaires pour I'analyse exhaustive du Plan du contenu
des langues naturelles - a-telle dé étre abandonnée, car la linguistique s'était ainsi
‘engagée, sans toujours sen rendre bien compte, dans le projet extraordinaire dune
description compléte de ensemble des cultures, aux dimensions mémes de
Thumanité » (GREIMAS et COURTES, 1979, s.v. Sémantique, 32.7).
0.2. Buts et étapes d'une analyse structurale
La définition structurale du sens se fait jour & la croisée d’une définition
substantielle Je signe est la réunion d’une image acoustique et d'un concept
46
(SAUSSURE, 1916/1960, p. 98) et d’une saisie relationnelle ; le signe est valeur au
sein d’un systéme (SAUSSURE, idem, p.159 et passim). La sémantique structurale
svattachera & décrire le contenu dans ses rapports avec le pian de 'expression
(description « positive » ou qualificative du sens) ainsi qu’a surprendre les
relations de chaque unité avec les autres unités du systéme sémantique
(description « négative » ou fonctionnelle du sens).
Toute analyse structurale, postulant la nature systémique de l'objet, se
donne pour but de décrire, au moyen d'un ensemble fini de traits, organisation
systématique d’un nombre virtuellement infini d’unités. Pour ce faire, une
analyse structurale se propose :
(1) d’identifier les unités minimales ;
Q) de découvrir ies principes d’un classement (paradigmatique) de ces
unités ;
(B) de décrire Jes relations (syntagmatiques) que ces unités peuvent
contracter entre elles pour s'intégrer & des unités de rang supérieur,
1. Procédure de description
Elaborée & partir du modéle phonologique, l’analyse structurale du
sens (analyse sémique, de souche européenne, ou analyse componentielle
proposée d’abord dans le champ de I’anthropologie américaine et développée
par les générativistes) utilise une procédure fondée sur les opérations de
segmentation et de commutation déja mises 4 I’épreuve dans le plan de
Expression. La commutation consiste 8 opérer une modification dans I'unité
analysée pour étudier si cette modification en entraine une autre, équivalente
dans ie plan opposé. Ainsi, tout comme b et p sont des unités du plan de
Yexpression, car la substitution au trait [sonorité} du trait [surdité] entraine la
modification dans le plan du contenu de l'unité BAS en I'unité PAS, BAS
s‘oppose & HAUT sur la base des traits communs [spatialité], [dimensionalité],
Iverticalité], par la substitution du trait [supérativité] @ [non supérativité),
ce qui se refléte dans le plan de lexpression par le différence entre les unités
bas et haut.
N.B. La notation suivante sera adopiée :
~ lexémes (unités du plan de l'expression) : table, chaise, etc.
= sémémes (unités du plan du contenu) : TABLE, CHAISE, etc.
~ sémes (unités minimales du contenu) : [objet), [pour sasseoir], etc.
a7
ee
Comme dans le cas de analyse pratiquée dans le plan de I'Expression,
Vépreuve de la commutation implique le recours au plan opposé de la langue :
L’analyse des deux plans doit done étre menée, bien que par les mémes
méthodes, séparément (,..). La jonction du signifié et du signifiant, une fois
réalisée dans la communication, est done destinge a étre discutée das V'instant ois
Tron veut faite progresser tant soit peu lanalyse de l'un ou de Vautre plan du
langage. Ce qu'il faut en retenir est la possibilité et Ia nécessité de se servir du
signifié pour Vétude du signifiant et du signifiant pour celle du signifé
(GREIMAS, 1966, p. 30-31).
A chaque unité de expression, lexéme!, il correspond dans le plan du
contenu au moins une unité, appelée sémame. Le séméme est constitué d’un
ensemble organisé de traits distinctifs de contenu, nommés sémes (traits
sémiques). L‘identification des unités distinctives dans le plan du contenu se fait
au moyen de Ja procédure segmentation-commutation. [I y aura unité minimale
distinctive (séme) si la commutation de ce trait par un autre produit une
modification dans le plan opposé de l'expression.
1.1. Le modle POTTIER
Les premiéres analyses de POTTIER (1964, 1974) portent sur un ensemble
de lextmes « présentant un maximum daffinités », délimités par un « champ
d expérience », et formant ce qu'on appelle un champ sémantique, ou encore champ
conceptuel ou notionnel, A la’ suite de application des opérations de
segmentation et de commutation, il résulte un tableau ordonnant les traits
distinctifs de sens sur 'horizontale et la série lexématique sur la verticale,
1 Greimas (1966) attribue au lexéme un sens différent, en en faisant une unité du plan du
contenu : pour notre part, nous préférons nous en tenir & 'acception devenue classique
en linguistique, celle d'une classe d'unités minimales autonomes & double face (signe
minimal) qu'il est courant d'opposer au morphéme & caactere grammatical. Le lexéme est
défini par sa fonction représentative et référentielle, alors que les morphémes dits
«grammaticaux » ont pour fonction de constituer des unités de rang supérieur et/ou
dlarticuler les énoncés en discours.
> La notion de champ sémantique et les notions apparentées de champ assaciatf (Bally),
champ notionnel (Matoré), champ morpho-sémantique (Guiraud), champ lexical (Coseriu), ete,
se recouvrent partiellement, tout en défendant leur spécificité due aux cadres théoriques
dissemblables.
48
so = = 3% a a
[pour Jur | fpourune | (avec | [avec |{fen matiére
Lectmed\ | sasseoir| | pieds]_| personne] | dossier] | _bras]_|__rigide)
chaise + + + + = |
fauteuil + + + + : :
tabouret + + + = ‘
canapé + + ~ oi .
Peet : POTTIER, 1964
=
‘Semes ao 8 = ey =
{manifestation | {parie | (parle | [parla | [avec | (parun
Lexbmes sonore buccale] | chat] | chien) | poule] | décibels) | humain}
| aboyer + ~ + = = =
Crier + = - = ¢
glousser + = 2 = =
miauler + a
(oi ~ marque la non pertinence du s&me respectif pour la description ds sens du lexéme)
POTTIER utilise le terme séméme pour désigner un ensemble de semes
décomposables en un sous-ensemble de sémes spécifiques (sémanléme), un sous-
ensemble de stmes génériques (classime) et sous-ensemble de sémes connotatifs
(virtutmo),
marque, 2 imal de sens, alors qu'il
Romarque. our POTTIER le seme est un trait minimal 7
appara évident que la plupart des sémes dégagés pat ses analyses sont &
leur tour décomposables. Il semble préférable de parler de traits distinctfs,
sans avancer la prétention d’aboutir aux traits minimaux de sens.
‘ comparative du sens des lexémes appartenant A un micro-
opine, ote an ou lusicurs traits distinctifs communs (exemple : [objet pour
s'asseoir], {manifestation sonore buccale}) que l'on appellera archiséméme. Un
archisémeme peut @tre manifesté, mais ne Test pas toujours, par un
archilexéme: tel est le cas de [objet pour s‘asseoir], réalisé en francais par le
ene os est plutét rare : a archiséméme [manifestation sonore buccale], ou
encore objet pour écrire] de la série crayon, porte-mine, porte-plume, stylo &
bille, bic? il ne correspond en frangais aucun lexéme.
2 Faik, 1977, p. 16.
49
jo
1.2, Le modele GREIMAS
Se proposant de mener plus loin l'étude du sens lexical, de préciser le
statut des traits de sens, d’en étudier l’organisation au sein du séméme,
A. J. GREIMAS (1966) approfondit le sens du lexéme {éte. Pour ce faire, il
propose une procédure complémentaire a celle de POTTIER, il étudie notamment
ensemble de contextes (propositions, syntagmes discursifs ou figés) comportant
le mot téte recensés par le LITTRE.
1.2.1, Analyse due mot « téte ». A partir de la définition « réaliste » du mot:
« partie (du corps) unie au corps par le cou», Greimas procéde 4 une étude
détaillée des variations significatives de ce mot dans diverses sous-classes
contextuelles ; il obtient ainsi
a) partie du corps...
= recouverte par les cheveux : la téte nue, laver la téte, téte de fou ne
blanchit pas
~ non recouverte par les cheveux (visage) : faire une téte de circonstance,
tu en fais une téte
b) partie osseuse : fendre la téte de quelqu’un, se casser Ia téte, téte de mort
) organisme
— en tant qu’unité discréte : ce troupeau est composé de cent tétes,
‘vous aurez @ payer tant par téte
— @tre vivant ou vie : mettre la téte de quelqu’un a prix, it paya de sa téte
— personne humaine : une téte couronnée, se payer la téte de quelqu'un
GREIMAS remarque que dans tous ces contextes, le mot se caractérise par
un contenu invariant, « partie du corps ».
Une nouvelle série de contextes révéle un autre sens du mot caractérisé
par les traits [extrémité] + [supérativité] :
~ [extrémité] + [supérativité] + [verticalite]: la téte d’um arbre, étre& la téte
des affaires, avoir des dettes par-dessus latte
= [extrémité] + [antériorité] + [horizontalité] + (discontinuite] : fourgon
de téte,téte de cortige, prendre la téte
~ [extrémité] + [antériorité] + (horizontalité] + [continuits] : téte de nef,
{8te d'un canal, tte de ligne
Une troisiéme série de contextes fournissent le trait de sens [sphéroidité]
la téte d'une cométe, tte d'une épingle, de clou, ete., se casser Ia tte, avoir la téte dure, se
melire dans Ia téte, se creuser la téte. Remarquant Vapparition dans ces contextes du
50
GREIMAS affirme que ce sens repose également sur les
a emit) © si un ensemble de traits
traits: [extrémité] + (supérativité], qui forment ain:
sémiques commun a toutes les occurrences du mot téte.
4.2.2. Le séméme. Cette analyse permet de distinguer a V'intérieur du sens
des lexémes un ensemble de traits sémiques ou sémes commun 3 une ou a
plusieurs classes contextuelles, désigné par GREIMAS noyau sémique (ou
figure nucléaire) (Ns); chaque classe contextuelle se caractérise par des stmes
spécfiques, dus au contexte, appelés classémes (ou sémes contextuels) (Cs);
ides sdmes comme [solidité] dans se casser la tee, ou encore [contenant] dans se
mettre dans la tte, une téte bien remplie viennent s‘ajouter & {sphéroidité] suite &
Yemploi du terme dans des contextes différents. Ainsi, le séméme (sens, signifié
d'un lexéme) peut se représenter comme
Sm=Ns+Cs
Le séméme n’est donc pas uste unité autonome : il se constitue dans le contexte
linguistique. C'est l'une des idées fortes de la théorie de GREIMAS.
Le lexéme féte recouvre deux noyaux sémiques principaux :
(Noi = [extrémité] + [supérativité] + [sphéroidite]
Nee= [extrémite] + [supérativité] + (point]
qui, se combinant avec les divers simes contextuels, engendrent un certain,
nombre de sémémes :
[extrémité] + [supérativité] + {continuité]
Ns cs
Ia téte d’une comite, Ia téte d’épingle
{extrémité] + {supérativité] + [point] + [continuité}
Ns Cs
téte de ligne
———
é a méme objet de référence,
4 Précisons que les termes sens lexical, signifé, séméme, ayant un mér :
tahissent le point de vue de la recherche : au sens, donnée primitive dans la conception
hditionnelle, vient d’opposer le signifié, élément constitutif du signe; lanalogie
fonmelle phonéme, morphome, lexéme, sénéme met en évidence le caractére décomposable de
ces unités en traits distinetifs.
51
po
[extrémité] + (supérativité] + [continuité] + {solidité]
Ns Cs
se casser la téte
Enfin, on a remarqué qu'un méme séméme, disons: [extrémité] +
(supérativité] + (sphéroidité] (« partie du corps ») peut désigner soit la partie du
comps recouverte par les cheveu, soit celle recouverte par a peau, soit encore le
crane. A I'encontre de GREIMAS — qui utilise le terme comme synonyme de
séméme — nous désignerons ces variations contextuelles non distinctives (dans
tous ces exemples nous avons affaire 8 un méme sémeme) par effets de sens',
résultat de la réalisation dans le discours d'un trait latent non distinctif
(opposition [recouverte par les cheveux vs non recouverte par les cheveux] n'est
pas distinctive puisqu’elle ne permet pas de distinguer deux sémémes ou deux
noyaux sémiques) (v.infra, chap. IV, 3).
1.2.3. GREIMAS eifou POTTIER. Les deux types de procédures décrites ci-
dessus sont complémentaires. POTTIER part d’un contenu constant («champ
d’expérience ») censé tre structuré par les signifiés des divers termes qui
Vexpriment, et commute un trait de sens par un autre pour observer s'il y a, ow
non, modification dans le plan de l'expression.
GREIMAS se propose d’identifier les divers contenus véhiculés par une
unité de expression et modifie a cet effet le contexte - ce qui se raméne toujours
‘a une opération de commutation dans le plan du contenu.
L’analyse de GREIMAS a 'avantage d’éviter le risque qui
consiste& gliserimpercepsiblement de Tanase d’un champ sémantique & celle
d'un champ dexpérience (psychologique) pour aboutir finalement & Ja
description d'un champ de la réalité (physique) » (GREIMAS et COURTES, 1979,
sv. Sémique (analyse -), p. 347).
Les résultats sont également complémentaires : POTTIER arrive a préciser
les traits distinctifs au sein d’une série «(para)synonymique », GREIMAS
distingue les divers sens dont une seule expression se fait porteuse.
5 Greimas utilise ce terme comme synonyme de séméme, alors que nous en proposor
autre définition. ee ne es en repo ae
4.24. Le some. Les deux analyses présentées définissent le contenu du sens
lexical (sémime) comme un ensemble de traits linguistiquement distinetifs. Le
métalangage utilisé par les deux sémanticiens - chez POTTIER : (pour s‘asseoir),
[avec dossier), etc, chez GREIMAS -{extrémité], [continuité], etc. - semble refléter
des positions théoriques divergentes: la description du stme choisie par
POTTIER suggere que le stme représente une propriété de Yobjet (ou du
référent): une chaise désigne «un x qui est pour s‘asseoir», «un x qui a un
dossier »*; les nominalisations proposées par GREIMAS sont en apparence le
résultat d'une élaboration plus poussée d’un métalangage dont le vocabulaire
serait constitué de l'ensemble des traits de sens linguistiquement envisageables’
Nous croyons toutefois que cette formulation nominale des sémes est susceptible
de masquer la nature prédicative du sme: [extrémité] peut étre reformulé comme
{(un x) qui occupe une position extréme], [continuité] comme [(un x) qui est
continu], ete.
FREGE soulignait la nature prédicative du concept (qui peut étre ici
assimilé au séme) et il distinguait entre la «propriété »de Yobjet et la
«note » d'un concept:
Si Fobjet Fa les propriétés ©, X et ¥, je peux les rassembler en une seule, Q, de
sorte que dire que T a la propriété Q ou que I les propriétés © X et W, cest
dire la méme chose. (FREGE, 1892/1977, p. 300-301 ; nous traduisons)
(On croit découvrir dans ce texte d'une part la nature prédicative des traits de
sens (propriétés) et la parenté concept (sens) - objet (xéférent). La prédicativité du
concept frégéen rest rien d’autre qu'un attribut du concept d’@tre Ia signification
dune expression (linguistique) prédicative.
En effet, le séme a une nature prédicative : il représente des propriétés de
objet et, de ce point de vue, il est 1’équivalent d'une propriété référentielle
(constitutive du référent). Les sémes sont, dans notre conception, des propriétés
16férentielles sélectées par le processus de sémiotisation de I'objet au mayen e sa
désignation par un lextme du code linguistique. La parenté ontologique sens ~
ferent ot leur commune différence avec Vebjet désigneé est ainsi soulignée et elle
«Pour Pottier, le sbme « doit se dire avec autant de mots de la langue naturelle qu'il faut
pour bien mettre en relief le trait distinctfrelalif & Yensemble considéré », mais toutefois
‘ia dénomination du séme est un discours paraphrastique @ vocation métalinguistique »
(TAL, 1985, p. 73 ;nous soulignons)
7 En effet, Kleiber (1990, p. 41) remarque que « le courant structuraliste européen avait
précisément pour ambition de libérer les stmes de tout lien avec le référent pour ne
retenir que leur c6té opératoire, fonctionnel, cest-i-dire pleinement linguistique ».
53
expuque bon nombre de phénoménes interprét
iterprétatifs, te
figural par le recours au référent. Pesatls ls a consoucion du sens
1.3. Conclusions
. Tow comme le plan de Yexpression, le plan du contenu d'un systéme
\suistique est susceptible d’une description structurale,
+ Aue unité de expression — lexéme ~ il s'associe conventionnellement
une ou Pluses unités du contenu, sémémes.
. segmentation et I; i i i
las md reniaton et 's commutation permettent d’identifier le trait
+ Le sime est I été réforentieli
Le sine et Yespreson d ‘une propriété réfirentielie sélectée par le
* Le séméme est constitué d’un ensemble de s¢mes,
* L’ensemble de stmes commun @ plusieurs sémémes, associé & un ou
Plusieurs lexémes, forme un archiséméme, qui peut étre dans certains
cas manifesté dans le plan de expression par un archilexdme.
La structure du contenu
0. La structure élémentaire du contenu
L’étude du systéme phonol i
_ Létud logique fait ressortir la nature relationnelle d
traits distinctifs: seule Vexistence du trait {surdité] permet identifier un tit
[sonorité] ; ce qui distingue b et p cest existence d'un trait commun, a savoir la
Propriété conventionnellement désignée par [sonorité] et qui se manifeste dans
‘aque phonéme par sa présence ou, respectivement, par son absence,
ou ena rtilement, dans le plan du contenu, deux unité, soit BLANC et NOIR
ge cre GRAND et PETIT, acquiérent leur identité en vertu d’une relation
se
apres sur l'idée commune de [absence de couleur] et respectivement
Cest le phénoméne qui a fait dire a SAUSSURI
. énom E (1916/1968, p. 166)
dans la langue il n'y a que des différences », ou des oppositions! ? &
ee
* Rappelons qu’en linguist é
‘ ique le terme opposition sett & désigner une relat
entre deux entités caractérisées par au moins un aspect commun, mien onan
54
opposition, en tant que relation entre deux termes est constitutive d'une
structure élémentaire. Le terme opposition peut masquer la double nature ~
conjonctive et disjonctive ~ de cette relation ; par exemple, ‘opposition [sonore]
vs (sourd] est conventionnellement subsumée a la [sonorité}, tout comme [grandj
vs (petit] 8 (grandeur). «Ce qui est important ~ affirmait GREIMAS (1966, p. 21)
= cest Fexistence d’un point de vue unique, d’une dimension & V'intésieur de
laquelle se manifeste l'opposition.»*®,
0.1. La catégorie sémique
Les relations d’opposition introduisent au sein de I'univers sémantique
d'une langue donnée une structuration, dont le niveau inférieur sera la
catégorie sémique. Structure élémentaire du contenu, la catégorie sémique se
définit comme Ja relation unissant deux traits de sens (semes). Ii s'agit de fait d’un
contenu actualisable en deux termes, dont l'un apparait comme la négation,
Topposé ou encore I'inverse de l'autre.
Voici, par exemple, les verbes parler et aboyer: ils possédent en commun
les traits (activité), d’{émission] de {sons}, [au moyen de}, {appareil phonatoire]
et se distinguent par la modalité de manifestation de la catégorie classématique
de I'[animé] articulée en [humain] vs [animal].
De méme, patler «oppose & crier (dans le sens de « Parler fort, élever la voix
au cours d'une conversation, d'une discussion », apud Le PETIT ROBERT) par la
manifestation oppasée de la catégorie nucléaire de I'fintensité] :
(Q) Mparlait d’une voix douce et monotone.
(2) _ Il fut obligé de crier pour couworir le brouhaha.
Les contenus de parler vs s¢ taite sont comparables au niveau de l'ensemble de
traits : [activité], d’[émission} de [paroles], et se distinguent par une catégorie
modale: modalité ontologique [virtuel] vs [actuel], dans la mesure ot ge taire
i une des acceptions du mot grandeur renvoie & V'idée d’étendue en hauteur ou en
largeur ou en longueus, 1a plupart des emplois privilégient le péle « positif» (étendue
maximale) : la grandeur d'un appartement, d'un conquérant, d‘bme, d'une Epapée, d'un sacrifice,
etc. (apud le LEXIS).
+ [ est intéressant que dautres auteurs ont proposé d’utiliser dans la description du sens
lexical des « points de vue » (Granger, apud Germain, 1981, chap. V, 2) ou des dimensions
(Cogeriu, 1975).
35
Peut étre compris comme « ne pas actualiser la possi
des paroles » (cf, « s‘abstenir de parler » int LEXIS) :
@) UM parlait toute ta journée.
(4) Hse taisait toute la journée
La structure élémentaire peut étre représentée sous l'une des formes: a R
2, ou R (@b), ott a et b désignent les termes et R la relation ; on peut également la
représenter comme :
R R
oN
a 6 a é
ott la relation apparait comme le neud d’embranchement de deux termes.
Au sein de la catégorie sémique chacun des termes constitutifs implique la
relation constituante de niveau supérieur, une relation d‘epposition (contradiction,
contrariété) s’établissant au méme niveau :
R
a b
opposition
0.2. Catégories simples vs catégories complexes
Dans les deux plans de la langue, la structure élémentaire est binaire",
Pourtant Ja relation d'opposition peut se manifester soit comme une
contradiction : {ou a ou b), ou bien (ow @ ou non a), soit comme une contrariété : (ou
4 ou b ou [nia ni 5), ou bien (ou @ ou b ou [et a et bj) ; la contrariété est donc
caractérisée par la présence d'un terme intermédiaire : (ni a ni 8] ou fet a et b]
Ainsi, par exemple, les termes : MARIE vs CELIBATAIRE sont opposés en vertu
du trait [ayant contracté une relation dalliance maritale], présent dans MARIE et
absent dans CELIBATAIRE. Dans le contenu des deux lexémes, par ailleurs
XY Le inarisme semble caractériser le fonctionnement de lesprit humain, une longue
tradition logique et philosophique procédant de ce postulat épistémologique
56
i dans le cas des
blables, apparait une opposition du type (@ ou non a);
ceaemes GARCON vs FILLE, il existe une différence du type (ou @ ou b) : (sexe
in vs féminin), qui les distingue.
men Mais 3 cbt des termes ‘grand et petit, il existe le terme moyen ‘dont le
signifié contient le trait [ni a ni b] (trait newtre) ; le signifié du terme gazeux se
définit au moyen du trait complexe (et a et b], présent dans fluide, qui organise la
érie gazeux, solide, liquide. 7 .
(On dira qu’il y a dans ce cas une structure complexe, 'un des pdles de la
relation étant & son tour une relation (de rang inférieur). Ainsi :
[étendue]
>
[grand] {non grand]
MF
petit] {non petit] (= [moyen])
ol le terme intermédiaire [non petit] (= moyen), par rapport auquel s‘organise
opposition grand vs petit, se décrit comme {ni grand ni petit]. Dans
(état]
-o—_
[solidité] [fluidité]
[liquidite] ([gazéité]
Les oppositions [solide vs [liquide et/ou solide] vs [gazeux] sont rapportées & un
terme intermédiaire [fluide] [et liquide et gazeux].
La description correcte des oppositions fondées sur le rapport logique de
contrariété conduit vers une structure hiérarchique organisant une relation entre
deux catégories binaires, dont I'une est enchassée dans Vautre :
Re
o_o ——
~ bo(R)
a b
0.3, Le systzme sémique
____ Une telle structure complexe taxinomique, plagant plusieurs catégories
sémiques sous la dominance d’une méme catégorie de rang supérieur forme un
systéme sémique. Il s‘agit done de organisation d’une zone conceptuelle
homogéne, telle par exemple « la spatialité » décrite par GREIMAS (1966, P33):
[spatialité)
[dimensionalité] [non-dimensionalité)
horizontalit verticalit superficie volume
perspectivit lateralité
long/court Jargelétroit Pastel x Epais/mir
Le systéme sémique, tout comme le séme, la catégorie sémique ou le
seme, eprésente une construction abstrite, modéle de Vorganisation du plan
tu contenu d'une langue ; il esta supposer qu’une telle organisation relive d’une
sorte de « logique linguistique immanente » (ibidem, p, 32), & caractere universel,
pouvant servir de base & une analyse contrastive des systémes linguistiques.
Memaraee Il zessort clairement de la description du systtme sé
qu'il ne constitue pas une alternative aux concepts de cham i
champ notionnel, etc. clamp senantn
0.4, Le sémeme
Cette définition du stme comme unité constitutive d'une catégorie
sémique (un trait minimal distinctif) impose une modification corrélative de la
définition du séméme : cest un ensemble organisé de catégories sémiques,
chaque catégorie pouvant se manifester soit au niveau de la relation, soit a
niveau des termes, par l’un ou par I’autre des deux termes.
N.B. Dans un souci d’économie, on parlera indifféremment de catégories
sémiques ou de sémes, la oit la distinction ne sera pas importante.
En disant qu’un séméme contient te! ou tel séme, on comprendra
que dans la composition du séméme figure la catégorie sémique
dont ce séme est une spécification possible.
Prenons exemple des lextmes mourit et périt, contenant chacun les
catégories [événementialité], (objet animé), [objet vivant), [eausalité]; dans la
langue courante, les deux verbes se différencient au niveau de la catégorie
{causalité), présente dans mourie au niveau de la relation:
(5) Mourir de sa belle mort.
(6) Mourir dans un accident.
et dans périr au moyen du terme [causalité accidentelle}:
() _ Périr dans un accident.
(8) Périrde sa belle mort.
Ceci explique la possibilité de substituer, dans tous les contextes, au verbe
périr le verbe moutis, alors que ‘inverse r’est pas possible. Une seconde
opposition se manifeste dans les contextes oit les deux verbes sont synonymes,
pétir apparaissant comme synonyme littéraire de mouris.
(9) Lasécheresse a fait mourir toutes les plantes.
litt. périr
L’exemple du verbe mourir conduit vers la constatation suivante : &
Vintérieur du séméme viennent s‘articuler des catégories appartenant & des
systemes sémiques différents : Ja catégorie tres générale et non définissable
[continu] vs [discontinul (régissant, par exemple, opposition EVENEMENT
vs ETAT), le systéme de la [causalité], celui de la [temporalité} (qui permet,
au moyen de son articulation en (duratif vs non duratif] d’opposer
EVENEMENT a PROCES, ainsi que ACTION & ACTIVITE), la [transitivité)
relevant du syst#me de V’[agentivité}, dont l'une des articulations oppose
{sujet] & (objet), etc. A I'encontre du systéme sémique, qui est une structure
complexe homogene, Ie séméme apparait comme un ensemble hétérogéne de
categories sémiques".
1 Reppeions, a ce sujet, que Greimas (1966, p. 37) remarquait dans I'analyse de Pottier
«la convergence de deux systémes sémiques hétérognes : un systéme ‘spatio-visuel et un
champ de signification non déterminé, qui serait celui de la ‘fonctionnalté’».
59
1. La structure du séméme
11. Crité:res de structuration
A intérieur du sémeme il existe une Organisation qui repose sur deux
types de critéres:
(@ un critére fonctionnel (extrinséque), relatif au fonctionnement du
sémeéme dans les diverses classes de contextes oit il peut figurer ;
(il) un critére structure! {intrinséque): les relations logiques existant
entre les catégories sémiques constitutives.
1.1.1, Structuration fonctionnelle du séméme. L’analyse greimassienne a mis
en lumiére existence d’une premiére organisation du séméme en : noyau sémique
(Sémes nucléaires) et base classématique (semes contextuels ou classémes), notée :
Sm=N,+C,
due au fonctionnement du séméme dans les diverses classes de contextes.
Lrensemble des catégories sémiques (ou de sémes) commun & plusieurs classes.
de contextes constitue le noyau sémique, alors que la possibilité qua h-1u1).. de
figurer dans ces différentes classes contextuelles est assurée par I'existence de
certaines catégories (de stmes) ayant la propriété d’appartenir 3 au moins encore
une autre unité du contexte : ce sont les catégories classématiques, ou les classémes,
‘ou encore sémes contextuels.
Ce qui est commun aux emplois du verbe mourir dans les deux classes
contextes caractérisés respectivement par (animé] et [inanimé] c'est la catégorie
[événementialite] :
(10) Le malade peut mourir d’un jour a autre.
(11) Les civilisations pecvent mouri.
(apud LEXIS)
Les emplois du verbe mourir exemplifiés ci-dessus seposent sur le noyau
sémique commun: [événementialité], [état]: une (événementialité] du type
«a=snona » (qu’ion peut lexicaliser par cesser_de), I[état] du type
«existence » qui, combiné avec la catégorie [animé] dans mouriry, se lexicalise
par vie et avec [non animél, par existence :
mourns = cesser de vivre
moutir: = cesser d’exister.
{non animé] est encore présente dans le contexte
La catégorie sémique fanimé] v: ans le contest
‘au moins dans le nominal sujet (malade, civilisation), d’ot 'appel
contextuels. On obtient donc:
MOURIR: = [événementialité] + [état] + .. + [animé]
Ny Cs
MOURIRo= [événementialité] + [état] +... + inom animé]
Ns s
1.1.2. Siructuration logique du sémeme. Divers types de sans lgiques
nisent le séméme indépendamment de ses emplois contextuels: ee ‘
venoment se définissant comme un « changement d'état oui par ‘a objet oe
r é i it6] et [temporal
‘i » égories de [objet], {causalit e
seolianont el fevérementia, tout comme celle d’{état] impliquera celle
impliqueront™ celle a
[objet] :
[événementialité]
*
a {causalité] [temporalité]
‘
[état]
Texiste une organisation logique des catégories sémiques cefltant une
logique factuelle (référentielle) et/ou cognitive qui fait que te stmbme nest sl
somme des catégories composantes (comme le suggérait la formule:
Acst vrai, B
1 Ventité B (A -» B) si toutes les fois que ;
lemnent ja présence ne toujours
Kest égal Wet si Ast faux Best également fala pe cede cnt ne toujours
présence de B, alors que l'inverse n‘est pas , nis Is
vent Geile phrase il a plu implique la vérité de la phrase Le rote ats ent coe
relation d'implication enire phrases refit directement la cation dimpicaton facie
enire le phénoméne de Ia pluie ete fait que es tottoirs sont mouilés, Dante Par
Je m'assieds sur une chaise implique (que Yon puisse a avec la mame valeur de én)
rasseds sur un stg, la telation inverse w tant pas vraic.
uous phrases refléte la relation d'implication lexicale : chaise — sidge.
© On dira qu'une entité A impliqu
61
pour s‘asseoir + avec dossiey + sans bras + sur pi i
r+ avec + + sur pieds + pour une personne), mais un
ensemble hiérarchisé de carégories : des catégories de rang inférieur impliquent
les catégories de rang supérieur (et de niveau plus élevé de généralité). Chaise
recouvre le séméme :
[objet]
I
[fabriqué]
a
— ~materiau)
{strpctuze] {ciel
[+ sur pieds} ,
fea dossier] [pours‘asseoir]
[+ sans bras]
(On remarquera que:
~ certaines catégories en impliquent d'autres: [fabriqué] vs [non
fabriqué] implique 1a catégorie de I'fobjectualité], la [structure] ainsi
que ia [destination] impliquent [fabriqué] ;
~ la présence de la catégorie ffabriqué] entraine une structuration
spécifique des sens prédicatifs (sens des unités verbales, adjectivales
etc), Vidée de « fabrication » imposant une configuration de type [agent],
[matériau] et [structure] de objet, [instrument], [destination], etc. ;
~ par contre, la catégorie de la [structure] entraine une configuration
spécifique des unités nominales, un ensemble cumulatif, non
taxinomique, de catégories ([sur pieds], [avec dossier], etc.).
Notons que le critére fonctionnel organise les catégories sémiques en
catégories nucléaires et catégories classématiques, alors que le critdre structurel,
logico-sémantique conceme le noyau sémique.
2. Les matrices sémémiques
A la lumiére de I’hypothése de la structure interne du séméme, on peut
avancer une seconde hypothése: la configuration sémémique refldte/dépend de
Videntité ontologique du référent. La configuration sémémique peut étre décrite
62
‘comme un schéma structurel, que nous allons appeler matrice sémémique, et qui
‘se définit en fonction de plusieurs eritéres.
Dans le plan sémantico-éférentiel, un premier critére est Videntité
ontologique du référent: une entité (objet, individu), repérée spatialement, se
istingue d’une propriété, d'un événement, d'une action, ete. repérés dans
univers tempore!”
‘Un second critére, lié au premier est le statut autonome ou non autonome
de ces référents: si une entité peut @tre congue dans son autonomie, une
propriété ou une action exigent ia présence d’ arguments support role incombant
aux référents nominaux.
Dans le plan pragmatique de l'emploi des lextmes, les critéres référentiels
se retrouvent dans le fonctionnement référentiel ou prédicatif de ces expressions
Tinguistiques:: les unités nominales permettent de construire la référence en
saturant les places argumentales dune unité verbale. La prédication intégre la
référence a la représentation par un énoneé d'un état du monde ou d'un cours
d’événements.
Précisons quiil existe un décalage entre les classes sémantiques ainsi
détinies, Jos catégories morpho-syntaxiques de substantif, adjectif, verbe, et, et les
catégories syntaxiques de sujet et de prédicat. Ainsi, le sens adjectival (néférant 3
tune propriété) de blanc se retrouvera dans le sens du substanti blancheut, tout
‘comme Ie sens verbal de sorfir se retrouvera dans le sens du nom sortie
Dans ce qui suit, nous allons réduire Ia complexité de ces critéres au seul!
crittre sémantico-référentiel pour dissocier entre les matrices nominales et
respectivement es matrices prédicatives, auxquelles correspondent les classes
sémantiques nominale et respectivement verbale.
2.1. La matrice prédicative
Le caractére non autonome des unités appartenant & la classe morpho-
sémantique des verbes explique I'organisation syntaxique du sens de ces lextmes
sur le modéle syntaxique de la phrase. En effet, le verbe, qu'il agisse d'une
prédication d'état ou de procés, exige la présence d’arguments nominaux.
‘Comme le remarque WILLEMS (2007, p. 200), une typologie des procés
verbaux peut se faire A partir des propriétés syntaxiques (contextuelles) des
Iextmes verbaux, des caractéristiques sémantico-aspectuelles de ces lextmes
reflétant les divers types de procés, ou encore des propristés lexicales qui
\ Cette caractérisation éclairante est proposée par Léard et Pierrard, 2003.
Permettent de distinguer des ensembles lexicaux de verbes (verbes,
psychologiques, de mouvement, de jugement, etc.)
Deux positions complémentaires sont ainsi mises en place : considérer la
syntaxe comme déterminant le sens lexical ou, au contraire, attribuer au sens
lexical le réle de sélecteur du comportement syntaxique des verbes. C’est cette
deuxitme position qui est ici défendue.
Pour Vauteur cité, quatre sont les traits sémantiques permettant de
caractériser (et de classifier) le sémeme verbal : {aspect dynamique] (qui oppose
Vétat a Vévénement), \'fagentivité] (opposant, dans la classe des événements, les
actions aux processus), [aspect télique] (qui distingue dans la classe des actions
les activités et les achévements), la [causativité] qui ajoute au procés la dimension
lagentivité]"*. L’atticle cité soutient de fagon convaincante le rapport syntaxe —
sémantique, proposant de discemer entre trois catégories d’événements sur la
base du type de complémentation exigé par le verbe en question.
Si le cadre restreint de cet ouvrage ne permet pas de s‘attarder sur une
typologie des matrices prédicatives, et sur les divers sous-types, on se contentera
d'énoncer des principes généraux de description du sens verbal sur la base de
Vanalyse d'un exemple de séméme verbal. Le modéle utilisé suit les suggestions
de la sémantique générative qui a, pour nous, Yavantage de représenter les traits
syntaxiques dans la définition méme des arguments nominaux supports.
Le verbe remercier est défini par les dictionnaires comme :
temercier v.tr.1. Dire merci, témoigner quelque reconnaissance a
quelqu’un.
(Le PETIT ROBERT)
remercier v.tr. 1. Remercier quelqu'un de quelque chose, lui exprimer de la
Gratitude pour une chose qui nous a été utile ou
agréable.
(LEXIS)
! ce verbe apparaitra dans les contextes :
(a) remercier (quelqu’'un) —verbalement
* Pour la complexité de la problématique des types de procés, on peut consulter Fuchs
(6d), 1991
¥ Notons que dans la philosophie et Ia logique de action I'[agentivits} oppose Iaction et
activité aux événements et processus, alors que la catégorie aspectuelle de la {durativité]
oppose, & chaque niveau, V'action & Yactivité et, espectivement, 'événement au processus
64
par lettre
par un cudeau
d'un copieux pourboire
(b) remercier (quelqu’un) de son hospitalité
aétre venw
de ses bienfaits
des services (rendus)
()remercier (quelqu'un) pour un cadeau
pour un envoi
pour son hospitalité
pour son travail
Le sens du verbe contient les catégories sémiques :
[action] (« échange »)
OO
Ingentivie {causalité [instrumentalité]
lagent) feo-ogent) [eausé) feausant] [moyen] _ [instrument]
(destinateur) _ (destinataire)
[humain} —[humain]
[intentionnalite]
(On notera que ces catégories se retrouvent ailleurs dans le contexte :
V[agentivité] dans le nominal sujet et respectivement le complément d’objet
direct lexicalisant le destinataire ; 1a [causalité] dans le sens de la préposition
defpour, introduisant les contextes (b) et (c) et dans le flexif [perfectif] ;
V[instrumentalité} dans la préposition paride, présente dans les contextes (2),
ainsi que dans le flexif adverbial -ment; il s‘agit done dans tous ces cas de
an sas duvete remercier est spécifié par les traits nucléaires tels que:
[échange}, particuliérement le type d'action ; [expérimentateur], spécifiant
agent, ressenteur d'un sentiment de « gratitude » ou de « reconnaissance », 8
la suite d’une evaluation favorable («utile », «agréable») ; le co-agent est
également particularisé comme l'agent d'une action qui forme V'objet de cette
évaluation, action pouvant étre lexicalisée comme acte, qui, une fois évalué,
devient « service » ou comme don («cadeau », «envoi», ete.). Apparait ainsi
évidente Ia nature réciproque de la relation prédicative exprimée par
65
ce
sematcer” La personne qui joue le réle de destinateur (agent locuteur dans le
cas d'un « remerciement» verbal, ou agent dans le cas d'un remerciement par
autre moyen : leurs, cadeau, pourboire'?) a été successivement :
= Teepérimentteur(onéhicisie) un acted co-agent
~ Yexpérimentateur (bénéfactif) d’un jugement éval
expedient ge luatif porté sur un
Vexpérimentateur (ressenteur) d’u
i in sentiment envers le co-agent,
cours d'un segment actionnel (narratif): sen
1. B fait pA intention de A
2. A juge p utile, agréable
3. A ressent un sentiment favorable 8 ’égard de B
4. Adit a B qu'il ressent ce sentiment,
AL. Explicite et/ou implicite? Cette
c ite ? analyse nous a conduit d’une
définition apparemment simple vers un récit complexe, Peut-on dire que tout ce
contenu appartient - et si oui, au méme titre ~ au séméme recouvert
lexéme remercier? res parte
On découvre au niveau du sens lexic
_ On dé ical la présence d’un phénoméne
eeu jusqu’a présent surtout au niveau phrastique, & savoir Vexistence d’un
om inp rattaché par une relation quelconque au contenu explicite.
rout comme au niveau phrastique, il a été Yon.
(et on croit done vrai) que : meee semana que i on asserts
(12). p: Pierre conduit ses enfants a Vole,
on est tenu d’accepter également la vérité (et done l'assertabilité) de
(13): Pierre a des enfants.
‘On dit que p présuppose q.
¥ Létymologie du verbe appui i
puie ce sens, remercier provenant de I’. fr. érivé
merci, du lat. : sala ix gallosomat favours
mene du lat meseedem (accusai de merce: slate — prix -> gallo-omain: faveur >
" analyse a délibérément ignoré Jes distinctions entre les diverses acceptions du verbe,
ref en particulier Jo diversité des moyens uilisés pour rélser Téchange remerciet
din comme « dze mer» est selon Benveniste (1969) un verbe docu (iv d'une
ection et désotant tun acte de discours); dans ce cas, agent se décrit comme
«locuteur » et le moyen utilisé « ”
le moyen est une « locution » dont la valeur équivaut & celle de
66
Le verbe remercier exprime (pose, asserte) le niveau 4 du parcours narratif
décrit ci-dessus; il « implique »” les contenus 3, 2 et 1. Ceci peut expliquer les
antes existant entre des unités comme remercier, rendre service
relations é
sadeau (offrir un)”.
Remarque. La lexicalisation de cette structure sémémique dans les
divers systémes linguistiques peut témoigner d'une attitude différente
des locuteurs qui transparait au travers de la structure syntaxique de
surface caractérisant l'emploi du verbe ; ainsi, au frangais (remercier
quelqu'un) et anglais (to thank somebody), oit le co-agent est
lexicalisé comme un complément d'objet direct, s‘opposent les systémes
roumain (a multumi cuiva) et espagnol (dar Jas gracias a uno) ; on peut
supposer, & titre d'hypothése, que la relation actancielle agent vs co-
agent est atténuée par la relation syntaxique superficielle sujet vs
complément (objet est en général le non agent, le subissant) au profit
d'une insistance sur le « service», accentuant la nature d’échange de
Yacte de remercier ; le roumain et I'espagnol paraissent mettre en
dvidence la relation inter-actancielle (agent vs co-agent), effacant le
procés cauisant ;ceci pourrait expliquer l'emploi en espagnol de gracias
dans l'expression de gracias (= gratuitement).
2.1.2. Syntaxe sémémique et syntaxe phrastique, Le sens des unités lexicaies
verbales qui peuvent fonetionner en position de prédicat se caractérise donc par
tune structuration sémique particuliére, qui respecte la configuration logique des
participants au procés, & action, a ’événement ou a Vactivité.
‘Ces constatations rapprochent Ja description structurale (dans le sens
restreint d’analyse sémique proposée dans les cadres de la linguistique
structurale) - qui découvrait sans y insister Fexistence d'une syntaxe sémique -
‘du modale proposé par la sémantique générative.
GREIMAS (1966, p. 38) suggérait qu'll faut
—_—
© Nous utilisons ici le verbe « impliquer » dans le sens courant du terme, et non dans son
acception logique.
® Le lien unissant ces contenus apparait dans une description casuelle dans Ia position
dlexpérimentatcur que Vagent de Wacte de remercier occupe & tous les niveaux, bien que
remplissant des res diférents (bénéficiaire, bendfacit,ressenteur) (v. 8 ce sujet Cristea,
1976, Cunits, 1979).
a7
frvisager ls relations entre les sémes a ntreur dun lexéme comme dant de
méme nature que les relations entre les semes situés & l'intérieur d'unités de
communication plus larges,
et affirmera plus tard qu'un séméme, tel que celui du mot colére équivaut & un
« micro-récit qui condense le schéma narratif » (GREN A
» IMs é|
WEINREICH (1966) soutenait que me ASIPSS) Ate mime peau,
toute relation qui peut exister entr
t entre les composants d'une phi ‘it
Agalement entre les composants du sens 'uneunitéexicale.
P. POSTAL (1971) décrit le sens du verbe rappeler (remind) comme :
oo
wil a oo
Tt
oa oy GN
APPARATTR x (moi) SEMBLABL, ! !
sone Une autee direction de la sémantique générative propose de décrre le
prédicatif par une certaine structure casuelle, chaque argument du verbe
occupant un cas et/ou un réle casuel donné. Ainsi, pour
verbe blimer se décrit pata structure cauelle BELMORE G27, e
BLAMER
a ft
cas ~— But Objet
! ole |
wm, Accusateur —Défendant ose
i 2.2. La matrice nominale
pen os a classe des unités nominales, on remazquera une méme
‘ ce rattachant le sens d’une unité donnée au sens d'autres unités a
lesquelles elle peut virtuellement se combiner. Liexemple du lexome chaise
68
aémontre la dépendance du sens nominal de lidée verbale de [fabrication]. De
méme, on ne saurait décrire une unité de la classe des instruments en dehors des
rapports logiques existant entre le sens de ces unités et 'idée daction exécutée &
Vaide de cet instrument
COUTEAU = instrument (= objet fabriqué servant 8 exécuter une certaine opération)
qui sert a couper
des objets physiques
ayant une certaine forme
De méme, le sens d’une unité désignant un agent (noms de métiers, par
exemple) se définit en rapport avec Vactivité dont il est l'instigateur, POTTIER
(1976) démontre que la structure sémémique nominale comporte ~ tout comme
celle verbale — les valences actancielles des noms respectifs ; ainsi, le sens de
pont contient les traits [accusatif] (objet dune activité productrice) et [locatif]
(lieu de passage).
Une telle description tend & effacer la distinction que nous avons
proposée entre matrice nominale et matrice verbale suite @ une commune
dépendance réciproque, ce que la description méme du séméme comme ineluant
‘des sémes contextuels le laissait prévoir. A titre d’exemple, on peut citer la
description du sens du mot colére par GREIMAS (1983)".
‘On ne peut donc parler d’autonomie du séméme, chaque séméme étant
rattaché par un ensemble de rapports & des unités Iimpliquant ou qu’il implique,
la substance sémantique s’organisant ainsi en micro-systémes d’étendue plus ou
moins importante”.
Il existe un rapport étroit et relativement peu étudié entre la logique
factuelle, Ja structure sémantique et la structure syntactico-sémantique des
unités lexématiques et phrastiques, reposant sur la dépendance langue ~
pensée - monde.
2 Dans le registre poétique, on peut citer également la narrativisation du monde des
objets dans Le parti pris des choses de Francis Ponge.
2 Comme dans le cas des unités verbales, il existe une « syntaxe inteme » des sémémes
nominaux: en commentant la définition du lexéme blaiceau, Martin (1983, p. 67)
intuition de la possibilité de décrire la relation métonymique par le recours & un « cas
profond », et dans la seconde édition de rouvrage (1992, p. 79) iLxemarque « Vexistence
Tune structure syntaxique interne & la définition », qui nest pas suffisamment prise er
considération.
o
3. Le noyau sémique
3.1, S8mes distinctifs vs s2mes non distinctifs
Liinterférence entre la structuration
Vinter proprement linguistique du syst&me
sémantique d’une langue donnée et l'organisation de ‘univers référentiel de la
communauté humaine parlant cette langue se traduit par Vexistence dans le sens
lexical de certains traits de sens dont la fonction n’est plus distinctive (cest-d-dire
qui ne servent plus & opposer deux unités au sein du systéme
Ainsi, dans le sens de gril-de-beeuf : aos texico-Smantique),
fenétre
petite lucarne
pratiquée dans un mur
un comble
ronde ou ovale
(d’aprés Le PETIT ROBERT)
la catégorie [forme : rond vs non rond] ne perm listingu ité
lucarng (qui peut étre ronde ou ‘ae ni nutes utes va gwen frangai “7
a pas de lexéme manifestant le sens de: [fenétre], [petite], (prati se dan un
mur, wu comelel {non ronde (carrée)]. " " “en
micro-systéme des lexémes: bais, bow-window, fenétre, lucarne,
lunette, ceil-de-boeuf, oculus, désignant une [ouverture] [pratiquée dans un mur,
tune paroi, etc}, (pour laisser pénétrer V'air et fa umiére] (noyau sémique
‘commun actualisable par larchilextme baie) ‘organise en vertu des o sitions
articulées par les catégories [dimension], [forme], [position} : posers
BAIE
FENETRE,
Igrande dimension] {petite dimension}
BAIE: LUCARNE
aS
[forme arrondie] [forme non arrondie]
GIL-DE-BEEUF
OCULUS x
LUNETTE
(BAIE: note le sens de «ouverture pratiquée
A «ouv dans [...
fendire =; DATEs note sense «grande fete»), {et pou fe ne pone une
FENETRE:
70
Les distinctions organisant le micro-systeme ceil-de-boeuf, gculus, lunette
relevent éventuellement de la [position : dans un mur vs dans un toit, au sommet
d’une coupole, etc.]. Ainsi le trait [forme] n’a pas de valeur distinctive, mais il est
ensable a Vemploi «normal» (adéquat du point de vue de la relation
signe référent) du terme. I refléte une propriété du denofatum (objet), enregistrée
par le référent, et se rattache & Yunivers référentiel. Certains linguistes (ECO,
$080; FILLMORE, 1971 ; LAKOFE, 1971) ont parlé de traits encyclopédiques (pour
les distinguer des traits servant & opposer les unités linguistiques au sein du
systéme), aférents (RASTIER)® ou tout simplement connotatifs%, et ont souligné
Jeur importance dans la bonne formation (sémantique) des phrases dans une
langue naturelle, dans Ja compréhension des mots en usage, et par conséquent
dans la pédagogie du sens.
Contrairement aux catégories sémiques distinctives, le nombre de ces
traits de sens n’est pas limité, sinon par les nécessités du « mode d'emploi »
des termes ; d’autre part, ils forment un ‘ensemble non hiérarchisé de traits de
Sens. Ainsi, [forme], [position], etc. sont des catégories situées au méme
«niveau », et on peut y ajouter par exemple [style architectural]. FRADIN et
MARANDIN (1979) montrent que dans la définition du mot corbeau
s’accumulent des traits descriptifs comme « grand oiseau au plumage notr, au
bec fort et Iégérement recourbé, réputé charognard », dont la plupart n’ont
pas de fonction distinctive, mais qui constituent un crittre dans le jugement
ee normalité sémantique et, surtout, une aide dans l’identification de objet
Génoté. On peut sfattendre A ce que les traits de sens encyclopédiques
caractérisent surtout le sens des unités substantives ; ils se retrouvent en
particulier dans les ensembles lexématiques connus sous le nom de
terminologies, désignant un ensemble référentiel organisé (noms de meubles,
de diverses classes d’animaux, d'outils, etc.)®. La structuration linguistique
intervient dans ce cas au niveau des archilexémes. Voici, par exemple, une
comparaison entre divers systémes linguistiques: poisson ~ esp. pez vs
—_—_
2 Pour Rastier (1987, p. 44 59) les « stmes inhérents relovent du systéme fonctionnel de la
langue, et les sémes allérents, d'autres types de codification : normes eocialisées, voire
idioectales »
x Nous avons évité le terme de stmes connotatif, puisque, comme nous Favons vu (¥.
supra, Objel_de la sémantique, § 03), 1a connotation peut consister en trate
conventionnalisés qui, du point de vue linguistique, peuvent avoir une fonction
distinctive.
3 Invoquons & ce sujet une remarque de Saussure sur Vexistence de « noms commmurs »
{qui correspondent a des « objets définis» tels arbre, pierre, vache.« oi il y a un troisitme
Rament, incontestable, dans l'association psychologique du séme [a bre signifé), la
conscience qui s” applique & un étre extérieur assez defini en tul.méme pour échapper & la
foi générale du signe » (iefarbitraire] (Saussure, édition critique par Englet, apud
Bouquet, 1992, p. 86).
7m
pescado ; raisin ~ angl. grape vs raisin ; arbre ~ roum. arbore vs copac vs pom,
alors que l'ensemble des lexemes désignant des poisons, des fruits, des
arbres, etc., ne présentent pas une une structuration lexicale™,
La conception de POTTIER de ce type de traits sémantiques non
distinctifs nous semble éclairante, POTTIER définit le virtuéme comme :
ensemble de sémes non distinctifs, liés a la connaissance particuligre d'un
individu, d’un groupe, d'une série d’expériences [qui] apparait de temps & autre
‘dans les définitions. (1964, p. 125)
ou encore comme:
tout élément qui est latent de la mémoire associative du sujet parlant, et dont
actualisation est lige aux facteurs variables des circonstances de communication,
{[-] tr8s dépendant des acquis socio-culturels des interlocuteurs. (1974, p. 74)
Une question qui se pose au sujet du virtueme est la suivante: fait-il
partie du concept-référent, la lexe, selon POTTIER, & titre de propriété réferentille,
ou bien s'agit-il d'un séme (trait linguistique) ?
Le texte de POTTIER n’indique pas une réponse claire, car Yauteur
introduit dans cette classe des faits assez hétéroclites : expression d’une attitude
évaluative du locuteur & légard de objet, lactivation dans le contexte précis
d'une propriété socio-culturelle ; ainsi, dans I'exemple :
Les CRS épousent parfois les automobilistes qu ‘ils dépannent sur la route
(POTTIER, 1974, p. 74)
le wait [male] impliqué par les CRS dépend « de la situation francaise actuelle »
et fait que dans le sens de automobiliste la catégorie [sexe] soit spécifide par
[femelle] ; certains semes virtuels sont idiosynerasiques, d’autres appartiennent
au savoir partagé par la communauté socio-linguistique . En tout cas, leur
emplacement dans la mémoire associative des sujets parlants semble confirmer et
soutenir "hypothése de la nature ontologiquement commune des sémes et des
propriétés référentielles. Cette nature commune permet d’expliquer
Vinterprétation du sens figural par le recours aux traits référentiels qui se
substituent aux sémes pour construire le sens tropique.
% Ces ensembles non organisés linguistiquement sont en large partie responsables du
refus que certains ont opposé & I'idée dune approche systémique du sens. Pour nous, ils
‘constituent un argument a contvario en faveur de ia structuration linguistique du champ
lexico-sémantique.
72
j
!
i
{
Notons également que le caractére linguistiquement distinctif des
simes par comparaison au traits référentiels se retrouve dans la distinction
séméme vs prototype.
3.2, Semes centraux vs szmes périphériques
Les rapports implicatifs taxinomiques) structurant le noyau sémique ont
pu faire parler, au: moyen d'une métaphore spatiale, de catégories sémiques
centrales vs périphériques, selon la position qu’occupe une catégorie dans la
taxinomie sémémique. On pourra dire que la distinction synonymique vibration
vs trépidation apparait au niveau dun trait sémique « périphérique » articulant
la catégorie [grande vitesse] en [trés grande vitesse)”.
MOUVEMENT
ms itude
oscillation _[oscillatoire] [vitesse] Gimp 7
{petite vs grande] {faible vs grande
a
ion trépi
En revanche, vibration (ou irépidation) se distingue du terme plus général
oscillation par une série de catégories « centrales », telles [vitesse], [amplitude],
qui ne sont pas spécifiées dans le sens de ce dernier terme.
que. it vi les categories sémiques
Remarque. Hl apparait évident que categories sé
«encyclopédiques » occupent généralement une position périphérique.
3.3. Sens abstrait vs sens concret™
Selon KLEIBER :
Test plus facile d’utiliser la notion de nom abstrait / nom concret que de la définir.
(KLEIBER, 1997, p. 48)
» Comme dans beaucoup d’autres cas, la langue naturelle est déficitaire quant aux
lités de fonctionner comme métalangage. ; ;
F pour des raisons qu! tiennent prindpalement dela volonté de préserver une certaine
simplicité de la présentation, seule la classe sémantique du nom est ici envisagée.
2B
En effet, plusieurs t
plusieurs types de critéres ont été proposés, comme l’accessibilité
ou anon acest aux sens, matériel vs immatériel, l’autonomie du référent,
ique (noms vs ivés f é
moron s noms dérivés de verbes ou d’adjectifs), degré de
KLEIBER attire Yattention sur la i
! confusion entre d’une
sémantique caractére abstrait vs concret du sens - signifié intenson du ener
~ du nom (ex. 14) et, d'autre part le pl: : " éric i
cianiam 8) al Part le plan discursif : emploi générique vs emploi
(14.1) Le chiem est le meilleur ami de homme.
(14.2) La linguistique est une science humaine.
(15.1) Le chien est le meilleur ami de Vhoneme.
(15.2) Ce chien est mon meilleur anti. :
forme (isis un nom conere selon a premitre dimension, en emploi générique
forme ns tage nominal abstrait, en rapport avec la dimension catégorielle
re au syntagme nominal, de méme qu'un nom abstrai
4 ea *
fonctionner en emploi spécifique et apparaitre plus, cone metre
(16.1) Lahaine est une passion dévorante,
(16.2) La haine qui le dévorait reste pour moi incompréhensible.
seats mse Perspective de la sémantique lexical, la discussion se limite & la
aul imension, qui est étroitement lige au statut ontologi
référents” auxquels l’entité linguistique est susceptible de renvoyer. steeiane des
Selon KLEIBER, la distinction concret vs abstrait refléte la distinction ”
«référent percu comme étant matériel été
. ent : » vs «référent congu comme étant
imate ros soulignons) la propristé de matéralité se définissant per a
tologique matiére ~ forme - temps » (op.cit ite dépendan
we mati .cit, p. 59), En étroite
ona tunsecond tre accessibilit aux Sens vs inaccssbilité aux —_
fin, d'un point de vue strictement structural et en qui
id . a
perspective rach substan pevent te cracls een place
3 Nos sulvon il discussion propose sur ce aut par KLBIBER, 1997,
1s datnction que nous avons defendue objet vs fren are ic ‘encore nécessis
‘omme le remarque Kleiber (op. cit, p. 62), la déj ence
| Comme . p. 62), la dépendance rest pas &
puis out ret mate! et ase am en a eepoque est pas wi
sis den noms si come rn cron consid conme accesible ah en
un réfren ;
soot ap accessible (a rondeur d'un bras) ou non accessible (larondeur
74
quills occupent dans les hiérarchies lexicales du type hyper! hyponomique »
(op. cits, p. 55 q)-
‘A ce point de vue, il est facile de mettre en correspondance le degré
dlabstraction d'un terme (en fait du «concept » désigné par ce terme) avec le
critéte quantitatif du nombre de sémes constituifs du séméme en question.
Comparons par exemple chaise et sidge. On constate que le séméme du terme
désignant la classe des objets ayant une certaine propriété commune (en Yespéce
une fonctionnalité commune) contient moins de semes (et sera par conséquent
jnclus dans) que le séméme du terme chaise, renvoyant 8 un objet de cette classe,
objet coneret,existant dans le monde matériel. Le degré abstraction apparait en
igénéral en proportion inverse du nombre de séanes entrant dans la composition
dun séméme, phénoméne désigné par densité sémique (GREIMAS et
COURTES, 1979, s.v. densité sémique, p. 89}:
concrets dans un dictionnaire idéal nécessiterait
La définition parfaite des mots
p, 1970, p. 101).
Yinventaire de nos connaissances sur le référent » (GROUPE
Les archisémémes désignant des entités abstraites (4énomination d’objets type
diune classe, résultat d'une opération logique de classification) sont tous
caractérisés par un degré d’abstraction plus élevé que les sémémes dont ils
représentent le noyau commun. Un bon exemple est le texte suivant off R
Queneau obtient un effet parodique en substituant aux termes concrets exigés
par Yunivers référentiel formant le théme du discours, les termes abstraits
corrélatifs :
(17) «1 reprit son chemin et, songeusemsent quant 2 la tél, d’ur pas net quant
‘aux pieds, il termine sans beoures son itinéraire. Des radis Vattendaient, et
le chat qui miaula espérant des sardines, et Amélia qui craignait une
combustion trop accentuée dy fricot. Le maitre de maison grignote les
cégétaux, caresse Vanimal et répond a Vétre humain qui lui demande
comment sont les nouvelles aujourd'hui:
~ Pas fameuses.»
(QUENEAU, apud GROUPE 4, 1970, p. 103).
La densité sémique est & mettre en rapport avec T'extension des termes :
plus le sens d'un terme est rche de sémes, plus le nombre des entités auxquelies
i renvoie est limité; un séméme pauvre en semes correspond 8 un concept Plus
général et renvoie donc & un nombze plus élevé d’unités, La densité sémique
Bétermine done le niveau de généralité (extension plus ou moins large) et & ce
point de vue on opposera les termes généraux aux termes spécfques, distinction
75
Senn SSNS
(On retrouve dans les nominaux seau et potle, occupant la place du locatif
ablatif le trait {contenant}, de méme que charbon (Vobjel) est caractérisé par
[objet], Jinanimé], {concret], [contenu].
4.2. Fonctions des classmes
Ces exemples démontrent une premiere fonction des stmes contextuels :
Ja fonction syntagmatique ou discursive. Les classémes construisent le texte,
assurant la compatibilité sémantique entre les unités co-présentes dans la chaine
syntagmatique'; deux ou plusieurs noyaux sémiques peuvent se combiner s‘iis
contiennent au moins un séme contextuel commun (s'il existe une base
classématique commune),
__ Les stines contextuels se chargent d’autre part d'une seconde fonction, &
savoir la classification paradigmatique des unités lexico-sémantiques. Ils
constmuisent ainsi «le cadre paradigmatique général de la classification de Punivers
signifiaat » (GREIMAS, 1966, p. 85) : plusieurs unités lexico-sémantiques forment
un paradigme s‘is possédent en commun au moins un classéme.
4.3. Classification des s2mes contextuels
Une description approximative du domaine sémantique recouvert par les
classémes expliquera pourquoi et comment ce t
: type de stmes peuvent assumer
cette double fonction : syntagmatique et paradigmatique.
43.1. Les dassémes grammaticaux. Une premiére sous-classe de sémes
contextuels est formée par les stmes dits « grammaticaux », formant le sens des
categories « morphologiques » et «syntaxiques »; il s'agit de ce que ia
Brammaire structurale appelle « les traits inhérents et contextuels » présents dans
kes diverses catégories (nominale, verbale, etc). La nature sémantique de ces
traits a été soutenue par divers linguistes qui signalent des phénoménes tels que :
- be Gistretion en categories nominale, verbale et verbo-nominale ne
‘Pas & une analyse plus poussée; par exemple, la catégorie
nominale du « cas» se retrouve dans la description du sens verbal le
sens de tont verbe se définissant par une structure casuelle spécifique ;
de méme, MOUNIN (apud GERMAIN, 1981, p. 55-56) avance lidée
que des catégories estimées purement verbales se manifestent dans le
Sens nominal ; ainsi, des unités telles que semence, blé mir, veau de
78
lait nouveau-né fiancé, nouvelle mariée, etc. contiendraient des traits
sémiques aspectuels, tout comme les unités futur gendre, gendre,
future maman, maman porteraient des marques temporelles ;
les dérivés & partir d'une méme hase contiennent un noyau sémique
commun et se distinguent en premier liew par des semes contextuels
assurant leur fonctionnement « grammatical » ; POTTIER (1976) donne
Vexemple des unités jeune, jeunesse, raiemnir se partageant le noyau
[humain], [age faible] (conventionnellement noté JEUN-) ;
— le caractére purement grammatical (morphologique ou syntaxique) de
ces stmes contextuels ne saurait expliquer des modifications qu'une
incompatibilité - de quelle nature, sinon sémantique ~ entre certains
traits produit dans le sens lexical: Mincompatibilité entre la
[durativité}, exprimée par la désinence de Vimparfait, et I'finchoativité]
manifestée dans le sens lexical d'tn verbe comme s'envoler entraine la
modification de la « valeur » aspectuelle de Vimparfait, qui arrive
cexprimer I'[itérativité], comme dans :
(21) Il s‘envolait (souvent, chaque semaine) pour Paris
4.3.2. Les classimes génériques. Une seconde sous-classe de smes
contextuels est constituée de sémes de trés haut niveru de généralité, corrélatifs & des
concepts primitifs, tels que [relation vs terme], [action vs état], [spatial vs
temporel], etc, ainsi que des simes génériques organisant, dans chaque culture, les
classes de référents [animé vs inanimé], [animal vs végetal], [male vs femelle].
Selon F. RASTIER (1987, p. 49 sq) il existe trois types de stmes génériques
qui déterminent appartenance du séméme A un certain niveau de structuration
de univers sémantique: le taxéme (le niveau de base), o¥ les sémemes (taxes,
selon le terme proposé par POTTIER) sont définis principalement par leur semes
nnucléaires et par un séme générique de faible généralité ; le domaine, qui regroupe
des taxémes en fonction d'un séme générique de généralité moyenne, et la
dimension, o& Yon retrouve des traits de généralité supérieure, tels [animé],
{humain], [animal], etc. Cette conception développe & notre avis le concept de
systime sémique, utilisant donc les propriétés classématiques des sémémes.
4.3.3. Les classimes connotatifs. Une autre catégorie classématique a trait au
jugement que le locuteur peut formuler ~ par le biais da systtme linguistique —
sur le référent ou sur la situation de communication ; il s‘agit de classémes
connotatifs, marquant dans le sens lexical :
. (a) un jugement sur le référent, exprimé par les catégories sémiques
{valuation : mélioration vs péjoration] ou [atectivite. positive ve negative) les
unités roux, carotte, queue de vache référent 4 une méme couleur des cheveux,
mais carotte et surtout queue de vache expriment en méme temps une évaluation
Péjorative absente dans roux. Pareillement, on désignera une personne attachée &
tone autre personne ou aux idées de celle-ci tant6t par partisan, tantét par suppét.
Le contexte ou la situation de discours peuvent souvent polariser le sens
es unités lexicales ayant trait & l'idéologie : ainsi les prolos, les bourgeois, le
patron, camarade (ainsi que d’autres appellatifs) peuvent avoir un sens mélioratif
Ou paoratif selon celui qui les utilise. Le terme bureaucrate (= employé d
bureau), dépourvu de toute connotation dans onpone oe
(2) «Plus d’un poéte fut un excellent bureaucrate »
(VALERY,
recoit tne connotation péjorative dans : mtx)
(23) « Is menaient existence monotone et morne des bureaucrates »
(MAUPASSANT)
(®) un jugement sur la situation discursive
i (sur le statut
locuteurs) organisé par les oppositions : ‘ * mae Gee
familiarité vs distance
intimité vs premiére rencontre
ation informelle vs situation formelle.
catégories organisent les sous-codes (regi (un systéme
Ss gistres) d’un 5
linguistique, le choix d’un registre ou d’un autre (populaire, femilier,
«standard », soutenu, etc.) témoignant de la perception qu’a le locuteur de sa
position au sein de la situation de discours,
L’énoneé
(28) « Quand cest pas Vheure, c'est pas 'heure | La baraka, quoi !»
(DANINOS, Le Pyjama)
ne peut s‘adresser qu’a des intimes, il est caractérisé és
, par la présence de lextmes
tels que baraka (synonyme familier de chance), par des traits morphologiques
———___
» Les conditions de cette synonymie sont explicité
~xplicitées dans la phrase: « I 1 baraka, disent
de ui ses amis, toujours effars de voir le ‘i P
poisson mordre dbs qu'il lance sa ligne. » (L'
1° 1637, 26 nov. 1982 ; nous soulignons) meinen ane = CEPRESS,
(absence d’un formant de la négation) et une syntaxe peu soignée caractérisant le
langage familier.
Remarque. Un rapport s‘établit souvent entre les deux catégories de
classtmes connotatifs: un méme formant peut manifester tantét une
valeur évaluative, tantét un jugement sur la situation discursive ; les
diminutifs connotant souvent l'affectivité se rencontrent le plus souvent
dans le registre familier ; d’autre part, dans un méme énoneé peuvent
apparaitre des traits relevant des deux aspects ; il existe un systéme de
compatibilités préférentielies, telles que :
[péjoration} vs fmélioration] et [familiarite],
comme le montre le trait [affectivité] qui pourrait subsumer aussi
bien un jugement sur le référent qu’un jugement sur Ja situation,
traduisant I’attitude du Jocuteur emvers le monde et envers son
interlocuteur.
Dans:
(25) «Crest fou ce que ga turlupine les gens, l'argent. »
(DANINOS, op. cit.)
le trait [familiarité], décelable au niveau lexical, morphologique et
syntaxique, fait ressortir le trait [pgjoration], latent dans le sens collectif
du lexéme gens.
Les sémes connotatifs constituent des catégories classématiques, vu
que l'apparition d’un tel trait & un point de la chaine syntagmatique entraine
sa réitération, au niveau lexical ou grammatical ou encore prosodique. Ainsi,
le verbe souhaiter (verbe affectif désidératif) dont le sens est « désirer, powr soi
ou pour autrui, a possession, la présence de, la réalisation d'un événement » (Le
PETIT ROBERT) contient Je trait connotatif feuphorique]*; ce trait doit se
manifester également dans le nominal complément ; le verbe se construit en
général avec :
28 Dans un contexte tel que : Je souhaite qu'il omnaisse lui aussi le malheur, Vincompatibiité
entre le trait (dysphorique] contenu par le sens du lexéme malheur et le sens de souhaiter
est résolue par la suspension du trait [dysphorique] sous la dominance du stme contraire
présent dans V'unité verbale (le malheur de I'autre devient source de sentiment
euphorique) ; ce type de modifications que peut subir le séméme sous l'influence du.
contexte sera étudié au chap. IV, §3).
81
souhaiter (a quelqu’un) | la santé
toutes sortes de prospérités
une vieiliesse heureuse
la réussite / qu'il réussisse, etc,
Cestadire des nominaux évalués comme « source d'un sentiment euphorique ».
De méme, dans exemple :
(26) «Marre d’étre commandés, marre dé
e ballottés, marre d’étre pris pour
des poires ~ nous étions tous les trois montés. »
(DANINOS, Le Pyjama)
{e trait [familiarité] se retrouve au niveau lexical (avoir marze, (étre) ballotté
Poire, étre monte) ainsi qu’au niveau morphol
ue (ellipse du verbe copulatif
dans avoir marre) et syntaxique (ordre syntaxique).
Conclusions
Le plan du contenu dune langue naturelle est structuré de maniére
analogue (isomorphe) au plan de Fexpression.
Vapplication de la description structurale au plan du contenu (analyse
sémique) permet d’identifier les unités minimales de sens, les sémes.
Les sémes sont des entités relationnelles dont existence n’est assurée
4qu‘au sein de la structure minimale de sens, la catégorie sémigue.
La catégorie sémique peut étre simple (relation entre deux sémes) ou
complexe (Van au moins des termes de la catégorie est & son tour une
catégorie de rang inférieur).
Chaque terme de la catégorie implique la relation constitutive et s‘oppose
au second terme.
Le sens d'une unité de expression, le séméme, est constitué d’un
ensemble organisé de catégories sémiques.
Une catégorie sémique peut figurer dans un sémeme soit par la
relation soit par un de ses termes.
Le fonctionnement du séméme dans le discours isole une classe de
sémes (catégories sémiques) contextuels ou classémes, commune a
plusieurs unités du contexte, et des sémes nucléaires, spécifiques de
Tunité respective. Le séméme s‘organise ainsi en noyau sémique ou base
classématique.
grammaticaux génériques jugement sur
Une relation d'implication logique introduit au sein du séméme une
structure taxinomique, mettant de Yordre dans T'ensemble de
catégories sémiques constituantes.
Cette structuration sémémique est le reflet d’une logique du monde
naturel; il en résulte une structure-type (matrice) des unités
« substantives » et des unités « adjectives (ou prédicatives) ».
Le noyau sémique peut comporter, outre des catégories sémiques
(semes) distinctives, redevables de organisation du systéme
Tinguistique, des catégories sémiques non distinctives (encyclopédiques)
ressortissant & la connaissance de l'univers référentiel et dont Ja
spécification est indispensable pour un emploi correct des unités
linguistiques. _
Le vocabulaire d'une langue peut étre classifié, selon le critére
sémantique de la densité sémique (nombre de catégories sémiques
constitutive du séméme)} en vocabulaire abstrait et vocabulaire concret
(lexémes de sens général vs lexems de sens spécifique).
Les classémes sont des sémes :
© d'un haut degré d’abstraction et de généralité
© ayant de ce fait un caractére récurrent ;
© assurant d’une part la compatibilité sémémique et la cohérence
syntagmatique et, d’autre part, la classification paradigmatique des
unités lexicales,
Selon leur contenu on peut les classifier en :
classémes
dinctat’Stnot fs
a—™
a
jugement sur
le référent lasituation
discursive
CHAPITRE Ill
LES RELATIONS SEMANTIQUES
Introduction
La description substantive du sens, visant a saisir Je sens lexical dans son
identité, doit étre complétée par une description relationnelle qui précise les
rapporis de I'unité ainsi identifide avec les autres unités du systéme. La saisie
«positive » (substantive) dépend en fait d'une saisie « négative » (relationnelle).
‘Une unité est quelque chose que les autres unités ne sont pas, elle a « sa valeur par
som opposition avec tous les autres termes » (SAUSSURE, 1916/1968, p. 126). Cest
ensemble de ces rapports qui organise le plan du contenu d'une langue donnée
et, conséquemment, son lexique, manifestant ainsi une structuration que les
locuteurs de cette langue introduisent dans fa réalité environnante. Las deux axes
constitutifs de tout syste, syntagmatique et paradigmatique, sous-tendent un
réseau complexe de rapports, 'unité lexicale - & la fois point d’arrivée et point de
départ —n’étant qu'un nocud d’embranchement.
[Le présent chapitre, consacré & la description de ces rapports dans le plan
sémantique, envisage d’abord les divers types de relations paradigmatiques pour
sattarder dans la suite sur les rapports syntagmatiques, pour en préciser la
nature, le mécanisme et les résultats.
Une relation apparait comme le résultat d'une opération cognitive
Gtablissant «de maniére concomitante et Videntité et Valtérité de deux ou plusieurs
_grandeurs » (GREIMAS et COURTES, 1979, s.v. Relation). Elle est constitutive de
la structure minimale (de sens) ainsi que de la structure du systeme dans son
ensemble, A Yaxe des combinaisons syntagmatiques (relation de type et... ef...)
‘oppose I'axe des oppositions paradigmatiques (relations de type ou... ou...). Dans
le plan du contenu les rapports paradigmatiques organisent le contenu en zones
cognitives, fournissont le matériau aux combinaisons syntagmatiques,
responsables de Ja cohérence et de Ja « normalité » du discours.
a, Repérable dans la Constitution de tout systéme, les rapports
Syntagmatiques et peradigmatiques ont une méme nature abstraite. T
‘uit qu’il ne faut pas confondre les relations syntagmatiques abstraites,
~ atemporelies et aspatiales - avec les relations de contiguité (linéarité)
organisant ’étendue — spatiale ou temporelle ~ de la manifestation
discursive. On a coutume d’assimiler 4 opposition paradigmatique vs
syntagmatique Yopposition virluel vs actuel et d’en déduire que les
rapports syntagmatiques, actuels, relevent de la parole ; cette opposition
dot aire rservée au systeme et on lui ajoutera le niveau du réalisé, de la
ones cn coneréte de ces rapports dans la chaine écrite ou parlée (v.
. a ‘étude des relations sémantiques ne saurait se faire sans le recours au
apport existant entre les deux plans de lexpression et du contenu; on
istinguera dans te plan du content i ‘
1a ent i i
tiers ire le niveau sémique et le niveau
Plan] Contenu |
Niveatt “Pression.
sémique | semes Texémes,
sémémique | sémemes Iexies
Les relations Pparadigmatiques
O. Définition
name Une propre commune: ta possi de substitution mutuelle dans le
ee co tutive de classes (paradigmes) d’unités
spécificité est assurée par les relations d'opposition’ distinctive de type o ee
qu’elles contractent au sein de ces paradigmes, Pete Oe
Les relations paradigmatiqu 6 it
. tes, fondées sur Vinvariance de I:
classématique concernent en i i cl elles easurent
classématig Premier lieu ie noyau sémique, auquel elles assurent
ie ime grron an is utilisé dans une acception large, celle de relation
i we en général, et dans un sens restreis iésigner i é
penis on ata restreint pour désigner la relation appelée
86
0.1. Lieu dela relation sémantique
La catégorie sémique, structure minimale de sens, comportant et
organisant a la fois le réseau de relations, paradigmatiques comme d’ailleurs
syntagmatiques, est Ie lieu out ces relations peuvent étre identifiges.
Rappelons que la catégorie sémique représente une structure oi des
termes situés dans le méme plan contractent une quelconque relation
d’opposition, alors qu’entre le terme et la relation Varticulant il s’établit une
relation taxinomique d'implication :
base commune R
‘opposition ZO.
différentielle a
Cest cotte propriété commune ¢'impliquer un méme terme (relation) de
rang supérieur qui fonde la base sur laquelle s'établissent les différences.
‘La méme configuration organise les rapporis séniémiques : en tant quunités
différenticlles, les sémes régissent toute relation sémémique, en assurant la base
‘commune et la distinction constitutive de la relation.
Le rapport décrit dans le plan et au niveau sémémique se refléte dans le
plan lexical par une organisation analogue, mais non identique. Il est
parfaitement possible de construire, sur la base des rapports logiques d’identité
ou d’opposition sémique, des sémémes (unités abstraites), similaires ou opposés ;
en revanche, il n’est pas toujours possible de les actualiser en discours par un
lexéme. Ainsi, eu égard a:
(1) CLAQUER _[fermer une porte]
[avec un bruit sec}
‘on peut construire un séméme :
@ x [fermer une porte]
[sans bruit]
auquel pourtant il ne correspond en francais aucun lexéme?
2 Cest le phénoméne des lacunes lexicales, mentionné & plusieurs reprises dans cet
ouvrage, résultat d’une part d'une loi générale de la constitution des systimes
linguistiques, le principe d’économie et, d‘autre part, des besoins langagiers caractérisant
la communauté linguistique respective ; v. également infra, méme chapitre, § 23.
87
0.2. Classification des relations paradigmatic
ast le Tapports conaitutfs de la catégorie sémique président & le
Clasifcation des relations sémantiques paradigmatiques. Ains, ajoutant au
crite exerne du rapport enee Ie plan de expression et celui du comer le
° n lu type de relation logique, on obtient la suivante classification
les relations sémantiques paradigmatiques :
(@) les relations contractées par les sémé:
tea cations con P smes recouverts par un seul et
* lapolysémie
(2) les relations contractées par les
les elatons cont par les sém&mes recouverts par des
+ l'kyponymie, qui repose sur la relation logique d’impli
ie, que d'implication ;
+ lasynonymie, relation de double implication, vee
+ lantonymie, relation d’ opposition.
1, La polysémie
1.1. D&fnition
__Traditionnellement, la polysémie se décrit comme une relati
Signin et signifiés, notamment comme l'état d’un signifiant (« mot texte)
auquel il correspond plusieurs signifiés. Sont dites monosémiques (plus
exactement mono-sémémiques") les unités lexématiques recouvrant un eu
séméme; il s‘agit de lexémes appartenant aux vocabulaires spécialisés, tels :
(Chimie) alun, (Techn.) électrophone, (Méd.) spasmophilie, etc a
La plupart des unités lexématiques son ’ i
elles peuvent manifester des sémees plas ou minivan
8) alvéole: 1, cellule d’une abeille
2 (Anat) cavité des os maxillaires dans |:
enchassée une dent ale et
3. (Géomorphol,) petite dépression trouvée dans une roche
(apud LEXIS)
A
tine 8 niveau sémémique, la polysémie se traduit par une relation
rsection entre les ensembles sémiques manifestés par un lexéme; cette
2V. Greimas et Courtés, 1979, s.v. Polysémémie, p. 284.
88
intersection représente un noyat sémtique commun, sur lequel repose intuition
du sujet parlant quant & la parenté de sens qui rattache ces diverses acceptions
d’un mot, Dans (1) les sémémes cortélatifs & alvéole sont composés des
catégories sémiques
51 [espace contenant]
52 (dans un corps solide]
5s [susceptible de recevoir un contenu]
s« {naturel vs fabriqué]
ss [objet contenu...}
Le noyau sémique Ns (s1 + s+ s) forme la base de 'opposition se situant au
niveau de la spécification des autres catégories sémiques.
Si, par contr, il nest pas possible de déceler un noyau sémique commun,
on estime qu’il agit de deux sémémes accidentellement recouverts par un méme
formantet on parle d’homonymie.
1.2, Mécanisme(s) de la polysémie
En diachronie, un méme type de mécanisme explique :
(1) Fenrichissement du sens des lextmes (polysémisation)
(2) Féclatement d'une unité polysémique en plusieurs unités
homonymes.
‘Le mécanisme est enclenché par l'emploi individuel d'un lextme dans un
nouveau type de contexte, ce qui entraine des modifications sémémiques*; s'il y
‘socialisation (acceptation par la communauté linguistique) de cet emploi, le
nouveau séméme, ainsi produit, forme objet d'une conventionnalisation, étant
fixé par une régle sémantique du code :
Phénoméne individuel — socialisation — Phénoméne social
usage norme
performance compétence
+ Rappelons que le séméme étantconstitué d'un noyau sémique et d'une base classématique,
tout changement dans le base classématique entraine une modification du sémeme.
89
Ainsi, sur le modéle de assainir_le climat politique, déja
conventionnalisé, un journaliste a pu dire? aseptiger Ie climat politique. Le
noyau sémique [faire que disparaisse tout genre infectieux], fonctionnant dans
le contexte [concret], devient - dans le contexte [abstrait]: FAIRE QUE
DISPARAISSE TOUT PHENOMENE SUSCEPTIBLE DE CORROMPRE. Cette
création, tout récemment conventionnalisée et enregistrée par les
dictionnaires, a toutes les chances de se généraliser et méme de faire
aujourd'hui concurrence au plus ancien assainit*.
Si la liaison avec Je séméme initial n’est plus ressentie par les sujets
parlants, la rupture ainsi produite est a origine de Vapparition d’unités
homonymes, Tel fut le cas des exemples souvent cités des lexémes grave, balle,
voler, etc. L’évolution divergente des sens aboutit ici 4 un ensemble
‘intersection vide. On peut représenter cette évolution de la monosémie (idéale)
vers homonymie, & travers la polysémie, par ia figure suivante :
Cy —
Os ~
ey, la
ey,
Monosémie —_Polysémie Homonymie
En synchronie, Ia relation de polysémie peut se décrire comme un
enrichissement ou un appauvrissement du séméme au moyen d’addition ou
defacement d’un ou de plusieurs sémes; dans d’autres cas il se passe une
modification du séméme a Ja suite d’une translation métaphorique ou
métonymique’. Le type de changement modifiant le séméme constitue un critére
de classification des relations de polysémie.
5 Exemple emprunté & J. Bastuj, 1974
« A propos de la télévision francaise, une ex-speakerine affirmait: « Elle est tellement
aseptisée qu'elle va perdre le contact avec le public » (Le Figaro Magazine, 27 nov., 1982) ;
tun débat électoral est qualifié de « équilibré, sérieux, laborieux (...] Au point de paraitre
aseptisé. » (Le Monde, jeudi 4 mai 1991). Ce n’est que dans l'édition de 1993 du Petit
Robert qu’on voit apparaitre ce sens, attesté depuis 1967, alors que le Petit Larousse ne
Tenregistre pas encore dans son édition de 2004.
7 Wilson (2006) considére, non sans fondement, que ces phénoménes (élacgissement,
spécification et extension métaphorique ) sont de nature pragmatique et produisent une
modification au niveau du contenu de l'énoncé, des hypothéses ot des implications
90
1.3. Classification des relations de polysémie
existence d'une zone étendue occupée par
Le schéma précédent suggere tendueocupte Pat
la polysémisation et laisse prévoir [a difficulté établir des
Pe ea utes proposer, ala suite de R. MARTIN la distinction entre
= une polysémie étroite
— une polysémie lache,
it deux extrémités de cette zone. . ;
siuees Sila relation de polysémie se définit comme une relation aan
sémésmique, une intersection (noyau sémique commun) constituge d'un
Jevé de catagories détemine une polysémie drat; un nombre rédult de categories
‘émiques (@ la rigueut, une seule) communes reléchera le rapport qui aura toutes les
‘chances de disparattre, laissant la place a des lextmes homonymes.
1.3.1. La polysémie droite, Considérons les exemples suivants
(4) femme — FEMME: st toni]
‘2 [humain]
ete]
wininy
FEMME: ss Oy le, relation
FEMME, (VFEMME> =(S). 83183144), 08 [note Vintersection
(S)convoi_ CONVOh sot
5 (fabrigué]
CONVO ‘5; (structure) s4 (destination) ss [objet contenu}
1
[contenant]
s; [mobilité}
VEHICULE ‘5 [autonomic]
»[pluralité]
‘contextuelles, Nous considérons qu’en fait l'interpzétation détermine les modifications
ques survenant au niveau sémantique .
ee yamgape de Feit
R_ MARTIN (1968), en particulier dans son chapitre « Relations logiques entre
“La polysémie » (p. 63-82) auquel nous empruntons également les exemp!
o1
(6) minute — MINUTE: 4, [temporalité]
aN
2 [darée)
ss [oréve >.
i
MINUTE: se (6gal a 1/60 hew
MINUTE, MINUTE, = (51,5345) a
(7) calfater CALFATER:
5; [fermer une ouverture}
rt
salvoyen] stb]
CALFATER: 4 [xétou js
carraren, catraren, honey el
on Dans le cas de ces exemples, la base classématique est préservée, il existe
tn noyaus sémique & densité sémique élevée, le distinctions se situant au niveat
dune catégoni ruclsire (périphérique). On peut parler (si Yon envisage une
rdre reflétant une modification diachroni i
1 do ique) ou, au contraire, de
généaisation du sens, Le métalangage lexicographique a adopté les formules
Par restriction» et respectivement «par extension » qui concement les
modifications corrélatives subies par la classe référentielle.
1.3.2. La polysémie lache. Au pole opposé, considérons les exemples:
(8) plateau PLATEAU: 1 fobjet)
t
2 [fabriqué}
8 or a so (oat
[eforme plates] [transport]
PLATEAU: sifobjet}
t
‘2 [naturel (géogr.))
ss|caractéristiques) sé [spatialité]
t
Iverticalité]
t
[supérativite]
[assez planes] [«dominant les environs»]
‘oli seul un séme périphérique est commun (« forme plate », « assez plane »); les
deux sémémes se distinguent également quant a la base classématique : Csi (objet
fabriqué], Cee [objet naturel} le lien sémantique est ténu et Von peut se demander
sil persiste encore dans la conscience des locuteurs ou si les deux sémémes sont
considérés comme deux unités homonymes.
1.3.3, La polysémie moyenne. Dans la zone intermédiaire de rappor’s
polysémiques, on a pu distinguer traditionneliement la relation métonymique de
ta relation « métaphorique » (dans les dictionnaires: méton., p. anal. fi):
(9) blaireau
BLAIREAU: = (anise
«1 |mammifere]
1°
ss [camivore] s[propriétés ss [mode de vie]
morphologiques]
1
s [couvert de poils)
BLAIREAU2 ss (objet)
t
si[fabriqué]
——_
ss[structure] s+[matériau) s+ {destination}
{« poils de blaireau »]
On interpréte généralement le rapport entre les deux sémemes comme un
rapport d'inclusion: Ie Sm jouerait dans son ensemble la fonction de trait
sémique dans Sma. A notre avis, cette description n’est pas exacte, puisque
{blaireaul ( séme) ne coincide pas avec le séméme BLATREAT, mais se réduit &
[animal + couvert de poils] - seuls traits sémiques pertinents dans BLAIREAU:
La relation sémémique est done toujours d'intersection, un nombre assez réduit
de games tant communs ; A remarquer également la distinetion classématique :
[animé] vs {inanimé}
93
(10) cuiragse
CUIRASSE; 1 [objet]
s i
8: [fabriqué)
t
[structure] [destination] s[abje é
[objet prote,
eet protégé] s«Dyphysique]
x se produise] :
[«protéger] [partie du corps} {«blessuren}
5 (comportement)
{attitude morale
CUIRASSE:
t
Ss[modalite] se [bud] 55 (objet proté i
‘ erque foblet protégé] ss Expsychique]
se rods} Ipoyhiqu] [clessure morale »]
. ger dab
ine analogie de type « tout comme » entre les deux référents (la CUIRASSE: sert
sert
a se protéger des blessures morales,
to
ieee des bless meas, ot ‘comme la CUIRASSE: sert a se protéger
Pour nous, ces distinction | métonymiqt
ns : i
concement le mécanisme qui a fa pa
figurativisation, v. chap. IV, § 3)
nier la justesse, nous les considéro
ici adoptée,
jue, métaphorique
produ la polysémisation (dans ce cae, la
et non le rapport sémémique ; aussi, sans en
idérons comme non pertinentes pour la Perspective
134. be ‘mmigue. Ue
sémemes 4 tn eae nan olysémique, L’étude des rapports existant entre les
thei a ae aa tn 8 cen
lans un espace continu, en fonction
du
nombre et de la nature — nucléaire ou classématique —
n Iéaire é
; ° des sémes constituant
ar généralisation) ;
~ 4 Topposé, la polysémie liche :
sémes nucléaires différents, a I
_ base classématique et la plupart des
‘exception dune catégorie sémique, on
général périphérique ; il s‘agit d’unités que beaucoup considerent
comme homonymes ;
= une zone intermédiaire, de la polysémie « moyenne » : rapports établis
sur la base d'un ensemble plus ou moins large de stmes ~ nucléaires
et/ou classématiques — communs; en font partie la polysémie
métonymique et métaphorique.
Etudiant la polysémie dans la classe verbale, WILLEMS (2003) propose le
concept de chaine polysémique pout désigner les modifications successives que
peut subir le sens d’un lexéme. Ainsi, le verbe glisser (dans ses emplois en régime
tri-argumental) parcourt Ia chaine [transfert] (glisser un objet dans un coin),
[donation] (glisser un billet & son voisin), [dire] (glisser un mot & son voisin),
[demande] (glisser & som voisin qu'il parte), od 'on remarque la présence de sens
conventionnalisés et de sens strictement contextuels (le demier exemple). Ceci
peut suggérer V'existence d’un continuum de sens découpé (ou non) par le
systéme de la langue.
1.4, Polysémie vs homonymie
La frontiére lexéme polysémique / lexémes homonymes n’est pas facile &
tracer & Vintérieur d’un méme état de langue. Le critére sémantique : l'existence
d’un noyau sémique commun apparait par trop dépendant de analyse et,
surtout, de la perception commune hésitante ; le locuteur moyen pergoit-il encore
Je rapport existant entre les divers sémémes recouverts par alvéole ?
Un second critere, morpho-syntaxique, a été proposé pour pallier le
subjectivisme du critére sémantique, & savoir l'ensemble ~ identique ou divergent
— de rapports lexicaux et sémantiques qui caractérisent un lexéme/séméme : la
série dérivationnelle et les rapports sémantiques d’hyponymie, de synonymie
et/ou d’antonymie). Le lexéme poli est la source de deux séries dérivationnelles
divergentes :
(11) palin: Cs finanimé] — polir, dépolir, polissage
HYP. Sm-= [causation], [sensation tactile]
SYN. lisse, brillant
ANT. mat, rugueux
polis: Cs [humain] —+ impoli,politesse
HYP, Sm = [comportement social, [ritualisé]
SYN. civil, courtois
ANT. grossier, impoli
95
(12) ombrage:: Cs [végétal] ~»+ ombre, ombrager, omabreux
YP. (2) Sm = {collectifl, [causation],
[sensation tactile et vis
SYN. feuillage svete
ANT.
ombrager: (Cs [animé]) -+ ombrageux
HYP. Sm = [sentiment], [causé]
SYN. méfiance, soupcon
ANT. confiance
aman. a pratique lexicographique témoigne de cette difficulté,
Fn :, dans le choix des solutions, de la mé: on, sinon
partis davbitate, Aine & compart le PETIT ROBERT ete LUXS on
constate:
; PetitRobert Lexis
poli 2unités 2unités
ombrage Lunité unités
1.5, Polysémie et discours
La polysémie, ainsi que les autres relati iques paradigm:
jons sémantiques paradi
spin sn ese qn gu vuitton
pe ‘économie qui régit la constitution des langues naturelles.
coment + plysémie est levée par 'actualisation du séméme en discours, le
texte sélectionnant parmi les virtualités sémantiques du lexeme le sémén
compatible avec les autres sémémes actualisés dans Vénoncé. Dans
(13) Cette crofte est excellente.
mesial (evaluation Positive] caractérisant le séméme EXCELLENT exclut
ion de crofte « is i
everett fit comme «mauvais tableau» et conduit vers le sens
Dans:
(14) 1. Passe-mot vite I
Lien ‘appareil, le panorama est superbe, je voudrais Vavoir
2. Passe-moi l'appareil, je veux lui parler !
a chaque occurrence du Jexéme appareil il correspond un sémbme unique,
identifié par le contexte ou la situation’.
Tlexiste des cas oii I’'ambiguité persiste, soit parce que le contexte n’arrive
pas 4 désambiguiser, comme dans :
(15) Je me suis payé le luxe d’une cuisiniere, je mange miewx maintenant.
soit parce quelle est due & Vintention du locuteur de produire plusieurs
interprétations (lectures, isotopies) : dans ce cas, la polysémie fonde une stratégie
discursive que les locuteurs mettent en ceuvre & des fins diverses et dans des
genres de discours tels que le discourslttéraire, publicitaire ou dans les blagues.
La multiplicité des sens d'un lextme fonde la figure connue sous le nom
de syllepse. Fontanier, qui consacre un chapitre de son ouvrage Les figures du
discours (1821/1977 ) & cette figure, la définit comme un trope mixte « par Jequel
‘un méme mot est compris & la fois dans deux sens différents : le sens primitif, ou
considéré comme tel, mais toujours [...] propre et l'autre figuré » ; Fontanier, et
ceci confirme la description de la polysémie que nous venons de présenter,
ajoute quill existe des syllepses:
~ par métonymie :
Rome enfin se découvre & ses regards cruels,
Rome, jadis son temple et Y’effroi des mortels,
Rome, dont le destin, dans la paix, dans la guerre,
Est d’étre en tous les temps maitresse de la guerre:
(VOLTAIRE, La Henriade)
— par synecdoque :
Un pére en punissant, madame, est toujours pére.
(RACINE, Phédre)
~ par métaphore :
° Dans son exposé fait au Colloque International Représentations du sens linguistique
(Bucarest, 2001), Kieiber discute le sens du lexéme couteau et considére qu'un énoncé tel
Ty a wn couteau sur la table est susceptible d'une lecture spécifique (hyponymique): le
couteau comme COUVERT, pour quelqu'un qui est en train de mettre le couvert, ou
d'une lecture générale (hyperonymique) : OBJET COUPANT, pour une mére qui veille &
protéger son enfant, Cette variation interprétative est présentée comme une variété de
polysémie. Nous croyons que dans un tel cas, la variation interprétative est d’ordre
purement pragmatique et ne produit pas une modification sémémique, mais des effets de
sens, Dans ce méme sens, Bianchi (2001) distingue entre la polysémie conventionnalisée,
qui reléve du plan sémantique, du sens occasionnel produit dans chaque circonstance
particuliére de discours.
7
Je souffre tous les maux que j'ai faits devant Troie [...]
Brlé de plus de feux que je n’en allumai,
(RACINE, Andromague)®
Mais, exploitation stratégique de la polysémie n’est pas réservée au seul
discours postique. Elle apparait également comme stratégie diégétique dans le
genre romanesque: Gide en fait un usage intéressant lorsqu'il construit un
moment crucial de la diégése dans L'Ecole des femmes comme une méprise fondée
sur la polysémie des mots. Ainsi, dans t'échange beau-pére ~ gendre (Robert),
Propos d'un systéme de classement des fiches que le jeune homme utilisait:
a)
(16) « Alors c'est vous qui avez trowvé cela ?[.
— Oui... en cherchant, jai trou.
Robert utilise la polysémie des verbes chercher (s'efforcer de découvrir 1, par un
effort physique ; 2. par un effort de Vesprit) et trouver (1. rencontrer alow gare
cherche ; 2. découvrir par un effort de Vesprit) afin de dissimuler le « vrai rene
de son énoncé («en cherchant les envelopes que j‘avais commandées, j'ai
rencontré ce systime de classement»), que sa jeune épouse avait interonété
comme « en faisant des efforts de V'esprit, ai découvert. » et dont le sene eorect
ne se révélera qu’aprés vingt ans de mésentente conjugale"
ese, ce pe 2 ote discus ‘se rencontre souvent dans le discours de
press, En vo mple, extrait d’un article consaeré & un artiste méconnu,
(17) «Les gravures ne supportent pas d'étre leissées en permanence a la lumibre.
Ces fragiles beautés sont condaranées @ Uobscurité absolue des cartons des
cabinets d’estampes [...] Autant dire a Vobscurité tout court»,
(LIEXPRESS, n° 1654, 25 mars 1983)
Le slogan publicitaire fait souvent usa
l blict ige de cet effet qui permet d’enrichi
signification d’un énoncé caractérisé par sa concision ; Tetlogen met Genser
(18) L'Air du Temps se porte comme un espoir (publ \e marque
(publicité pour une mari
" Fontanier distingue également la lysémie
° 5 syllepse, fondée sur ta impli
Vantanaclese, « tépétition du méme mot pris dans un sens titer, on ce
tours pie distinction ql ae pas pent vin ie et
"A. Gide, L’Ecole des femmes, in Romans. Récite et sotes, CEvores lyri
« Bibliothéquie de la Pléiade », 1966, p. 1282. “ acres lrg, Galina
98
L
accompagnant la photo d'une jeune femme qui tient déticatement au creux de ses
‘mains jointes un flacon de parfum, joue (entre autres) sur la polysémie du verbe
se porter (I. tre, devoir étre porté, soutenu j 2. étre & la mode)
1.6. Conclusions
La polysémie est un phénoméne qui caractérise la structure de tout
systéme linguistique, relevant du principe d’économie.
* Etudiée au niveau sémémique, la polysémie apparait comme un
rapport dintersection entre les ensembles de smes.
‘© Envisagée dans la perspective du rapport Expression - Contenu, la
polysémie se décrit comme la manifestation de plusieurs sémémes par un
méme formant.
‘© La polysémie n’empitte pas, en général, sur la communication ; le
contexte se charge, par sa fonction identificatrice, de lever l'ambiguité
issue d’un rapport polysémique.
« La polysémie peut étre utilisée intentionnellement dans le discours,
étant le lien d’articulation de plusieurs lectures (isotopies).
2. L’hyponymie
La relation sémantique d’hyponymie / hyperonymie, bien que référant &
des rapports lexico-sémantiques souvent discutés (ainsi le rapport existant entre
chaise et sidge, entre chat et animal) a regu son nom, par analogie la
«synonymie » eta’ « antonymie » & une date relativement plus récente. Il s’agit
toutefois d'une relation @ vocation structurante, dont importance explique
attention dont elle a fait Yobjet depuis son identification. En effet, elle permet de
«saisir la dimension hiérarchique propre & Vorganisation du lexique des
langues » (KLEIBER et TAMBA, 1990, p. 7) et se retrouve dans la description des
autres deux relations mentionnées.
2.1. Définition
‘Une premitre difficulté que pose la définition de ce type de relation
sémantique est la confusion des plans lexical, sémantique et référentiel
|
atta
Envisagée au niveau des lextmes, I'hyponymie est une relation
dimplication™ entre le lexéme hyponyme et son hyperonyme. En vertu de cette
relation, la vérité de la proposition :
(19) Ceci est une chaise.
implique la vérité de ta proposition
(20) Ceci est un siege.
La relation dimplication étant transitive mais non symétrique, on obtient :
(21.1) Ceci est une chaise -+ Ceci est un sidge — Ceci est un meuble, et
@1.2) Ceci est une chaise —+ Ceci est un meuble.
(21.3) * Ceci est un meuble + Ceci est une chaise.
Dans le plan sémantique, I'hyponymie se définit comme un rapport
d'inclusion entre deux sémémes (en tant qu’ensembles de sémes) dont l'un,
Vhyponyme, inclut le sémeme hyperonyme.
A la relation hyponymique entre sémémes, il correspond, dans le plan
référentiel, une relation d’inclusion inverse d’une classe d’entités — référent(s) du
terme hyponyme & une autre classe a laquelle référe le terme hyperonyme. Ainsi,
dans la série chaise, fautewil, canapé etc. :
shaise — sige (plan lexical)
CHAISE ~ si[objet] + so{pour s‘asseoir] + ssfavec dossier] > SIEGE = 5: + se
(plan sénhymantique)
« chaises » < «sidges » (plan référentiel)
{oa > marque inclusion sémémique ou référentielle, + implication
Jexématique et les mots entre guillemets notent les classes référentielles)
2.2, Lieu de la relation hyponymique
‘L’hyponymie sémémique repose sur la relation dimplication constitutive de
!a catégorie sémique (hyponymie sémique) ; au sein d'une catégorie sémique’>:
4 jBm logique, & Ia relation d'inclusion entre ensembles it correspond la relation
implication entre unités.
* Greimas, 1966, p. 29 : « Nous dirons qu’a cété de la relation ant te (disjonction et
conjonction) entre les sémes d'une méme catégorie la structure éémentaire de la
signification se définit, en plus, par la relation Ayponymique entre chacun des sémes pris
individuellement et la catégorie sémique entiére »
100
1 ZN,
s1> Ret sr R, quel que soit le type de rapport entre si et sz
Ainsi, dans:
[spatialité]
———_
[dimensionalité] __ [non dimensionalité]
[dimensionalité] est un stme hyponyme de la catégorie [spatialité], comme lest
également [non dimensionalité]. On dira que les s8mes qui s’articulent dans une
catégorie sémique sont co-hyponymes. ;
Idéalement, hyponymie sémique organise Ja substance sémantique en
une structure taxinomique de type arborescent :
Lo™N,
oN
™.,
ols chaque entité de rang inférieur implique une unité de rang immédiatement
supérieur ; la relation d'implication étant transitive, on a:
Sur sear et su s21,etc.
La relation c'implication hyponymique permet & Greimas (v. supra) de
décrire le champ de la [spatialité] sous cette forme arborescente oi:
[perspectivité] -> {horizontalité]
[horizontalité] + [dimensionalité]
[perspectivité] + [dimensionalité]
101
Remarque. Plusieurs sémanticiens'* ont souligné 1a difficulté 4 définir la
relation d’hypo / hyperonymie comme une relation d’inclusion ou
implication. Une premiére précision est le domaine d'action de cette
relation qui, par sa vocation taxinomique est liée aux opérations
cognitives de dénomination et de catégorisation. Elle conceme
Principalement Ja classe morpho-sémantique des noms dont la
categorisation est exprimée au moyen du type de phrase Hiérarchie-étre
(KLEIBER et TAMBA, 1990) : Le / les / un NJ est un / des N2. Les auteurs
‘mentionnés, se situant dans la perspective cognitiviste de la sémantique
du prototype, argumentent contre la description de I’hypo / hyperonymie
comme relation entre sémémes, et transférent cette relation dans le plan
des classes référentielles. L’hypo / hyperonymie reléve d'une double
rocédure hiérarchisante: la généralisation ascendante et la spécifcation
descendante, qui serait mieux adaptée a définir cette relation que la
simple implication. Afin de faire accepter leur thése dans le traitement
une relation sémantique, les auteurs plaident pour la nature sémantique
de la relation d‘inclusion référenticlle. Ceci nous semble correct, vu que,
comme nous l'avons soutenu, les traits référentiels et les sémes sont
ontologiquement équivatents; la difficulté n’est pas pour autant résolue,
car, & notre avis, il faudrait proposer un modiele susceptible de décrive de
facon homogine Fensemble de la classe des relations sémantiques
paradigmatiques.
Diautre part, les auteurs cités refusent de situer "hypo /
hyperonymie au niveau sémémique, comme inclusion entre ensembles de
stmes vu que, d'une part le séméme OISEAU tvest pas inclas dans sa
totalité dans le séméme AUTRUCHE (qui ne comporte pas le trait {qui
Peut voler] et d’autre part, les définitions lexicographiques, proposent,
Par exemple, pour godasse Vexplication chaussure, ce qui correspond,
un point de vue référentiel, a une équivalence synonymique,
Une premiere objection & la position extensionnelle proposée par
KLEIBER et TAMBA est ia description non homogine des noms (qui se
conforment & une taxinomie référentielle) et des verbes ou adjectifs,
décrits plut6t dans le plan lexical.
Mais Vobjection principale — lige d’ailleurs a la premiére ~ est fondée
Sur Ta nature des unités décrites priortairement, et ceci par la plupart des
auteurs s‘étant occupé de ce domaine: il s‘agit de séries de termes qui
ee
Nous renvoyons, en particulier, & Cruse (1986) et aux articles publiés dans la revue
Langages, n° 98, 1990, numéro consacré a cette problématique
102
constituent des terminologies ou (des) vocebulaires!, qui recouvrent, & net
avis, une zone marginale du lexique d'une langue naturelle, et dont
structuration refléte une taxinomie préalablement établie sur la base de
critéres propres d un champ d’expérience scientifique ou technique.
Ce type de démarche dénie au langage sa fonction orgarstrice a
champ notionnel lui réservant Ja simple fonction de représenter un champ
“oe ain notre option, déterminée principalement par la volonté a ‘un
traitement homogéne des phénoménes qui nous semblent tenir du camp
linguistique, seza de continues a décrire rhypo / hyperonymie au niveau une
relation entre sémémes, sans nier pour autant Vintérét d'un tement
référentiel (utile par ailleurs également dans la discussion des anes rel nn
sémantiques), mais que nous avons évité par souci de préserver l’homog
du modéle choisi.
2.3. Hyponymie sémémique
‘Au niveau sémémique, Vhyponymie apparait comme le rapport
hiérarchique entre deux sémémes contenant les mémes catégories sériques, mais
différant par le degré de spécification d'une catégorie sémique: le s nie
hyponyme est équivalent & Yunité hyperonyme & laquelle on ajou
spécification d’un terme de la catégorie sémique de rang inférieur:
hyponyme = hyperonyme + séme spécificateur de catégorie
Exemples :
(22.1) ECARLATE = [ROUGE] + [éclatant]*
% Une terminologie «est un ensemble structuré de notions scientifiques ou
tec ques (Lerat 1990, p. 79); les ‘ocabulsites cont «des reper res de mots {..]
crdonnés selon un sstéme notonne extaslangeger» (Colin, 1950, p67) tie qe
% Kleiber et Tamba critiquent l'inclusion ROUGE © ECARLATE puisque a me
rouge dit contenit un tat général qui indique la possibile de plsie ues de
rouge Ce tate peut évidemment se erouver dans le ers eva, pul ft
plus que dune ruance vive deci couleur» Or derive, comme nous le propesons, a
"elation hypo /hyperonymie comme une spcifcation ou une gédralisation grace 3 1s
manifestation d'une catfgorisémique — présente gare deux srtes en cussion =
catégorie ou au niveau des sémes 7
Gel atime ince ROUGE, Cont la ctogone {naances] (ur mous see pat
103
ieee ecemmansmemmmetinenn
(22.2) ENDOSSER = [METTRE UN HABIT] + (sur son dos]
3. SOULEVER = [LEVER] + [objet lourd]
Cette équivalence explique pourquoi le lextme hyponyme peut, dans certains
contextes peu marqués, étre remplacé par son hyperonyme (suite a une
neutralisation sémique) :
(23.1) Mavanga une chaise et elle put s‘asseoir,
(23.2) Havanca un siége et elle put s‘asseoir.
La substitution devient anomale si la cohérence contextuelle (les rapports
sémiques syntagmatiques) exige l'explicitation du seme différenciateur :
4.1) Elle s‘appuya contre le dossier de la chaise.
? Elle s‘appuya contre le dossier du sidge
(24.2) U souleva a grand-peine le fauteuil et le déplage.
? Il souleva @ grand-peine le sidge et le déplaca.
L’hypo / hyperonymie est la manifestation du « principe d'emboitement
que l'on retrouve énoncé dans toutes les descriptions relatives au phénoméne de
Vhyponymie » (GALMICHE, 1990, p. 38).
2.4, Hyponymie lexicale
L'hyponymie apparait également comme un principe organisateur du
lexique. Si état actuel des études en sémantique permet de présumer qu'il serait
possible de décrire la substance sémantique au moyen de ce rapport, au niveau
lexématique la structure est, de loin, moins rigoureuse :
— le signe linguistique est une entité conventionnellement arbitraire, il
existe pas de correspondance biunivoque entre Ie plan du contenu et
le plan de expression ;
~ par conséquent, Visomorphisme des plans doit étre envisagé comme
une analogie formelle ;
~ le principe d’économie gouvernant Ja construction lexicale (dont
Vaboutissement est Ja polysémie) accentue Ia disparité entre
Vorganisation sémantique et organisation lexicale.
Le lexique d’une langue contient de nombreuses lacuries lexicales (« lexical
gaps», LYONS, 1977), noeuds de la structure sémantique sans correspondance dans
|e plan lexical. Ajoutons aux exemples dé cités (v. supra, § 0.2), d’autres exemples :
104
v4) existe un lexéme manifestant le séméme ROUGE, hyperonyme de la série
‘ ni ion, écarlate, pourpre ete, il r‘existe pas de lexéme manifestant 'ayperonyme
de rouse, ‘vu que Yadjectifcoloné ne peut occuper cette place: les co-hyponymes de
rouge sont vert, noir, lang etc. et coloré n’est pas hyperonyme de blanc. le rapport
ius le degré de généralité de la catégorie sémique visée par le rappo
hyponymique s/accroit et
crrcaation des hyperonymes (v. également supra, Chap. TL
Prenons Vexemple suivant :
il existe de ressources lexématiques pour la
‘moins il exist vote soni 81).
” VOIE DE COMMUNICATION
terrestre] {non terrestre]
la’marche {pour les
tp eds| véhicules}
t :
{dimension}
t
[latéralité)
chemin | sentier | auoroute
mas chemin de fer
On constate que la lexicalisation (par des lexémes spécifiques) apparait dans les
zones périphériques du tableau.
2.5, Hyponymie et discours
i jfestant la relation d’inclusion
La formule Une chaise est un sidge , manil 1
sémémique n’appartient pas au discours courant ; 4 notre avis, Cest une formule
du métalangage descriptif. Une tlle formule peut toutefols apparattre, coma
les formules tautologiques, avec des effets interlocutifs variables, comme dans =
105
(26). Une chaise est wn side, ce n'est pas fait pour monter dessus !
1 La relation hyponymique peut servir dans diverses structures discursives,
telles que:
(i) la structure définitionnelle : A est une sorte de B”
27) 1. Cloche = (sorte d’hinstrument creux, évasé, en métal sonore dont on tire
des vibrations |.--|(gpud le PETIT ROBERT)
2. Epigramme = (sorte de) petit poéme satirique (ibid.)
(ii) ja structure énumérative : A ou/et (d'autres B
(28) Hy avait sur som établi des raboteuses, des scies, des fraises et autres outils
de menuisier
Gi) la structure d’exemplification :
~B, par exemple/notamment At, Ar...
(29) existe em Italie des volcans en activité; exemple : le Vésuve
(apud le PETIT ROBER’
~BiAL A: ”
(30) Les cultures alimentaires : coton, tabac, café...
~ As, un des B
(31) Lelait en poudre, une des meilleures protéines...
Ces Inécaismes sémantiques, a 'ceuvre dans la pratique discursive scientifique
Hidactique, peuvent agir dans un discours di i i
gow aiecaue le type différent, en en facilitant
2) «Quand [...] Prométhée ext bien éprowoé que les chaines, tenons,
camisoles, parapets et autres scrupules [...] Vankylosaient...» .
(GIDE, Le Prométinée mal enchainé)
Dans un tel exemple, s'il est évident que sémantiquement il ne s‘agit
Pes d'une série hyponymique, la structure discursive propre a la
manifestation de cette relation oblige le lecteur a interpréter chaines, tenons,
etc, comme des hyponymes de scrupules et leur assigner en conséquence un
vA Propos des formules genre, sorte, type, Lyons (1977, p. 292; nous traduisons) soutient
ques Bog ‘général lorsqu'il existe une relation d’hyponymie entre les noms, [en frangais i
cst possible dels inser dare des expressions syntaxques appropri, ala place de xety
formule suivante “x est un genre de y’, oitx est un hyponyme de y|...] dans des
conditions moins restrictive, sorte et type peuvent se substtuer a genre dans le francais
courant », Une analyse plus poussée de la relation sorte-de, dans Levrat et Sabah (1990).
106
ies modifications sémiques qui s‘imposent). Le méme
sens figural (issu di x
fe du titre de roman Eloge du mariage, de engagement et
procédé est & la bas
autres folies, publié en 2000 par C. Singer.
Remarque. L’hyponymie ne doit pas étre confondue avec Ia relation
drimplication synecdochique (partie - tout) entre deux lextmes: la
propriété de transitivité de implication hyponymique est source
’énoneés aberrants si elle est appliquée a un couple synecdochique :
(33). le bouton de la porte
la porte de ta maison
* Te bouton de la maison
= pareillement, Vintroduction de ces lexémes dans une structure
discursive typique de Vhyponymie produit des énonoés anomaux:
(G4) *laroue est une sorte de bicyclette
* rowe, guidon et autres bicycleties
fa bicyclette, notamment la roue, le guidon
2.6. Conclusions
+ La relation hyponymique repose sur une relation d’implication
sémique.
° Cest une
sémantique.
© L’hyponymie intéresse en égale mesure Ja pratique iexicographique et
la pratique didactique, en particulier par ses conséquences sur la
structuration lexicale.
relation taxinomique organisatrice de la substance
3. La synonymie
3.1. Définition
Connue généralement comme identité de sens entre lexemes différents, fa
synonymie assure la possibilité de substituer & une unité du contexte dautres
‘unités similaires!. On a également toujours souligné qu’en fait il ne peut y avoir
—_—
WA titre d’exemple, citons la définition proposée par Duchdéek (1979) « Nous ap]
ités lexicales de sens identique ou presque identique ou du moins aussi
les sont interchangeables dans certains contextes »
ypelons
synonymes les unit
proches de sens qu’el
107
identité, que la synonymie n’est jamais totale, et que par conséquent il existe
des degrés de synonymie.
Cette correction trahit une confusion de plans d’analyse, & savoir entre le
plan sémantique et le plan de Yexpression. Il n’existe pas d’identité en langue:
méme dans le cas des lexémes monosémiques des vocabulaires spécialisés, il
rexiste que rarement identité de sens : ainsi, dans les exemples souvent cités :
(85) (Ling.) ¢ caduc, e muet, e instable
(Techn,) électrophone, tourne-disque, pick-up
(Méd,) stimutateur cardiaque, pacemaker
Videntité extensionnelle (dénotative) ne masque pas les _différences
intensionnelles (propriétés assignées aux objets), ou encore la différence
connotative de registre, porteuse d’une signification relative au statut
socioprofessionnel du locuteur, L’existence de la synonymie en langue naturelle
trahit la subjectivité du locuteur manifestée dans et par le langage.
Dans le plan sémémique, la synonymie apparait comme un rapport
identité, résultat d'une neutralisation” dans le conterte des stmes
differenciateurs, contextuellement non pertinents. La neutralisation repose sur un
rapport d’identité extensionnelle percue au niveau des objets dénotés, mais elle
West possible que dans des contextes appropriés.
Au niveau des lexémes, la synonymie est une équivalence fonctionnelle
assurée par I'identification sémémique. La substitution entre lexémes synonymes
est possible & condition que soit préservée la valeur de vérité de la proposition.
3.2. Lieu de la relation synonymique
Pour rendre compte de ce phénomene, il est nécessaire d’étudier :
(1) Ielieu de la synonymie
) les conditions dans lesquelles 1a substitution contextuelle peut
avoir lieu.
% La neutralisation est, en sémantique, la suppression des sémes différenciateurs,
nucléaires ou contextuels connotatifs, Y'invariance de la base classématique dénotative
étant exigée,
108
3.2.1. Synonymie et hyponymie. Selon Lyons (1977, p. 292) la synonymie est
‘une hyponymie bilatérale ou symétrique : si x est un hyponyme de y et y est un
hyponyme de x, alors x et y sont synonymes.
Dans le méme sens, nous définissons les synonymes comme des uns
sémémiques co-hyponymes, caractérisées par une position équivalente au sein de
ce rapport
hyperonyme
—
hyponyme A hyponyme B
ensemble de variables
imilari ible de variables
similarité ensemble tyeonyertquee
hyponymiques
—_—_———>
opposition
itue la base de la similarité
ibilité d'inclure un méme hyperonyme constitue Ia si
ovary, les différences se situant dans le degré de spécification des
catégories sémiques :
a favorable] +
CRAINDRE = si [état] + s[affectif] + [source défav ;
“6 + sa[non désidératif] + ss[non intentionnel] + se[intensité non marquée]
REDOUTER = st + se+ 53+ 54+ 55+ 5s intensif”
ie sémique [intensité] n’est pas spécifiée,
Alors que dans CRAINDRE la catégorie sémique [intensit :
aie test par son terme positif dans REDOUTER. La synonymie contextuelle
repose sur la neutralisation de cette différence.
3.2.2. Exemples :
(87) avoir peur, craindre, redouter, appréhender
dont la structuration sémémique peut étre décrite comme :
2 La description sémique suit Costceanu, 1981,
109
[état psychique]
i laffectif]
[non désidératif]
événement avoir peur =x
[source : action de } 1
inluence
de
Ba [défavorable} voir peur
ee [modatité : probable ~ possible] craindre | ~appréhender
an redouter
fintensité] avoir peur | ~ redouter
craindre
maa uindre
: tect our feces avoir peur = frac
appréhender
Dans cet exemple, les distinctions de it
ke contenu se situent dans la zone des
Pour une étude approfondie de ces moyens, nous renvoyons & Youvrage de Cunits, 1980.
113
b. un jugement porté sur le signifiant (appartenance du lexéme & un registre
quelconque de la langue), reflet d’un jugement porté sur la relation —
sociale, affective ou autre - existant entre les participants 4 la
communication,
_ Ala base de ces oppositions se trouve la catégorie abstraite de [symétrie],
caractérisant ce type de relations discursives, Traditionnellement, on distingue
entre: langue courante, langue familiére, langue populaire, langue soutenu
langue officielle (formelle), langue postique. " :
Exemples
(49) (cour.) chaussures ~ (fam.) godasses
(cour.} avoir peur = (fam.) avoir Ia trouille
(cour) trace ~ (soutenu) vestige
(cour.) cambriolage ~ (pop.) fric-frac
Remarque. Les rapports existant entre les divers types de classémes
expliquent les affinités rattachant les deux types de synonymie
classématique ayant en commun Vexpression d’une évaluation: la
Péjoration apparait plus fréquemment dans une situation discursive peu
formelle ; ainsi, la plupart des lexémes marqués [péjoratif] sont é
marqués [familier]. sen Genera
3.4. Synonymie et discours
La synonymie semble étre moins productive en di i
a 0 iscours, puisque la
Projection sur 'axe syntagmatique de deux ou plusi
rejection sur iq Plusieurs synonymes conduit vers
Le réle du contexte dans la réduction de la synonymi ligné
ie est soull
Gadamer (1972/1998, p. 118 ; nous traduisons) : yon sonore Par
En demier recours, ia valeur de Vanalyse structurale sémantique est fondée sur la
dissolution de Vapparence (de Yunivocité des signes], apparence que crée le
symbole isolé et ceci se produit de plusieurs facons, soit dans la forme grice &
® Une précision est ici nécessaire : notre opti i
précis option pour les limites du sens lexical élimine de
‘rite discussion des fits que d'autres sémanticiens integrent au champ de la synonymie:
il existe ainsi une synonymie syntaxique, au niveau de la phrase, une synonymie au
niveau des syntagmes (les expression périphrasti a iscout
1 iques) et, dans le mé
<éfinitionnel est en fait un cas de synonymie. me sens Glee
m4
tune prise de conscience de la synonymie, soit dans image beaucoup plus
chargée de significations, ce qui conduit & idée que chaque expression verbale
cst intraduisible et non substituable. Je souligne ce trait comme étant Je plus
important, puisqu'il repose sur le fondement méme de la synonymie {...] moins
tun symbole est isolé et plus la signification de Vexpression s‘individualise. La
notion de synonymie se dissout progressivement. Et on finit par obtenir un idéal
sémantique qui, dans un contexte donné, reconnait comme adéquate tne seule
expression.
Toutefois, la syronymie est & la base de plusieurs phénoménes discursifs :
= elle est susceptible d’assurer la cohésion textuelle (HALLIDAY et
HASAN, 1976) : en effet, la reprise anaphorique par synonyme(s)
est un procédé cohésif
= elle assure la précision et la justesse de l'emploi dénominatif
Yoption synonymique permet au locuteur, dans les conditions de
Vinvariance du denotatum, de construire le référent discursif
(REY-DEBOVE, 1976) ;
= elle assure une fonction « stylistique», permettant au locuteur
d éviter la répétition génante d'un terme.
En fait, exploitation discursive de la synonymie repose paradoxalement
non sur Iidentification contextuelle des sens concernés, mais au contraire sur
eur différenciation. L’existence méme des synonymes traduit un besoin du
locuteur d’exprimer son attitude relativement @ la réalité représentée par ses
mots, de trouver les mots « justes » pour exprimer sa position et il n’est pas rare
que, & la recherche du mot juste, Ie locuteur utilise plusieurs mots, quitte &
risquer de paraitre redondant ou méme prolixe. En termes gricéens, le locuteur
sacrifie la maxime de la maniére au profit des maximes de qualité ou de
pertinence. I nest pas rare qu'une volonté d’insistance ou I'expression d'une
émotion soit & lorigine de l'utilisation des synonymes. Ainsi, pour clamer son
innocence, quelqu’un dira :
(60) Jfassure, fattest, je certifie je jure que le fait est faux (apud FONTANTER)
Mais le terrain privilégié de manifestation discursive de la synonymie
reste le discours littéraire. La synonymie se trouve & la base de tropes comme la
métabole (ou tout simplement la synonymie) ou la gradation.
Selon FONTANIER, la métabole consiste dans «I'accumulation de
plusieurs expressions synonymes dans le but de décrire avec plus de force la
méme idée, ou une méme chose». Ainsi:
(81) Muse, préte ad ma bouche une voix plus sauvage
Pour chanter le dépit, la colére, la rage. (BOILEAU, Le Lutrin)
(52) O rage, a désespoir ! (CORNEILLE, Le Cid)
Les synonymes intensifs se trouvent a la base de la gradation qui consiste &
Présenter une suite d’idées ou de sentiments par ordre croissant ou décroissant
importance, d'intensité, etc. FONTANIER fournit plusieurs exemples extraits
de textes de BOILEAU:
(53) Marchez, courez, volez oi 'honneur vous appelle.
(54) Je ne vois rien en vous qu’un lache, un imposteut,
Un traitre, un scélérat, un perfide, un menteur [...]
GARDES-TAMINE (2005) se demande si la syrionymie est impliquée dans
a métaphorisation, puisque ce trope - qu'il s agisse de métaphores in praesentia ou
de métaphores in absentia - semble proposer une substitution qui orée une
équivalence sémantique et conclut sur une possible description de la métaphore
‘comme une synonymie non codifiée, subjective, constraite par le discours.
3.5. Conclusions
* La synonymie est un rapport d'identité sémémique, résultat de la
neutralisation contextuelle des diftérences sémiques.
+ la condition de identification sémémique est existence d'un noyau
sémique commun, la différence étant placée au niveau de Varticulation
d'une catégorie sémique périphérique .
* la synonymie représente un principe constitutif du fonctionnement
sémiotique : le sens d’un signe peut toujours étre explicité par un autre
signe de sens équivalent, de méme niveau (lexéme-lexéme) ou de
niveaux différents (lexéme-lexie, lexeme-énoncé définitionnel).
4, Lantonymie
4.1. Définttion
Envisagée au niveau lexématique, l'antonymie est connue comme le
‘rapport établi entre les mots qui « par leur sens, s‘opposent directement & un autre » (Le
PETIT ROBERT); la question est de comprendre en quoi consiste cette
« opposition directe », quel est le lieu de sa manifestation.
16
4.2, Liew de la relation antonymique
Comme dans Je cas des autres relations sémantiques, Tanvonymie se
décrit au niveau de la catégorie sémique. C’est la manifestation, ge des
lexémes différents, des termes polaires d'une catégorie sémique, fans te
conditions de Yexistence d’un noyau sémique commun aux sémémes
LN,
opposition
antonymique
recouverts par ces lexémes :
Les sémémes antonymes occupent une position symétriqquement inverse
dans une structure hyponymique. Soit les exemples :
(55) 1. feamest célibataire / Jean est marié
2. Jean sort en ce moment / Jean reste pour le moment
3. Crest une condition acceptable | inacceptable
4. Jean est le mari d’Anne | Anne est la ferme de Jean
5, Jeans sort de ta chambre | Jean entre dans Ia chambre
6
Jean entre
Jean marche
Jean sort
Dans (55) 1, eélibataire sf oppose & marié parla négation d'un terme de la
catégorie sémique {rapport de parenté par alliance, premier degré]
CELIBATAIRE = s1 [humain] + s2 [adulte] + ss [sexué] + ~ s« [rapport de parenté...]
MARIE = si + s2 +53 + 54
Les deux sémémes ont pour hyperonyme commun
Smesitsts,
‘i ‘ati ‘que en fra
i, par ailleurs, ne connait pas de réalisation lexématique en frangais.
se Paes lexdmes mar et femme recouvrent des sémémesdiftérenciés par:
MARI = si + 82+ ss [masc] + 5+ + $s [direction du rapport x, y]
FEMME = si + 52 + 53 [fem] +s« + 6s [direction du rapport y, x]
u7
Lhyperonyme commun est réalisé en frangais, dans certains contextes, par
Varchilexeme époux (Ex. : L’époux infidéte est puni par la loi).
Les lexémes sortir et rester sont opposés par la négation de la catégorie
[mouvement], alors que sortir spécifie la catégorie (directionalité] par le terme
polaire inverse celui actualisé dans entrer : entrer et sortir s‘opposent a marcher
par la négation de la catégorie [directionalité}
4.3, Classification des rapports d’antonymie
Rappelons qu'il existe des catégories sémiques simples :
R R
ZN (ZN,
acceptable inacceptable mari ferme
et des catégories complexes, oi1 I'un au moins des termes est A son tour une
catégorie ; ceci explique le fait que l opposition binaire s‘articule en rapport avec
un troisiéme terme, intermédiaire :
Exemple :
(56) x
—™
[mouvement] [non mouvement] sortir ~ rester
aN
[direction] [non direction] sortir ~ marcher
—™
iablatif] —fallatis] sortir ~ entrer
us
Dans ce cadre, la nature du rapport articulant 1a. catégorie sémique
détermine une classification des rapports antonymiques. Les sémes d'une
catégorie peuvent étre opposés par
tne relation de contradiction [ou @ ou b}
— une relation d'incompatibilité [ou a ou b ou (ni @ ni b})
— une relation de contrariété [ou a ou b ou (eta et b)]
4.3.1, La catégorie produit, par la négation d’un de ses termes, des
‘oppositions que la langue lexicalise :
a) comme absence de la propriété dénotée par la catégorie concernée : dans
(48) 3. la catégorie [possibilité d’étre accepté] (ou [acceptabilité]), manifestée par
son terme négatif, est percue comme absence de cette propriété, Les oppositions
de ce type sont dites privatives : elles sont lexicalisées le plus souvent au
moyen de la dérivation préfixale® ;
b} comme présence de la propriété contradictoire (opposition
équipollente). Soit comme exemples :
(67) singulier | pluriel
statique / dynamique
Ces oppositions trouvent leur lexicalisation par des moyens lexématiques.
Remarque. Un méme lexéme peut figurer dans les deux variantes de
structures lexématiques :
(58) modération / immodération
‘modération / abus, excés
4.3.2. L’incompatibilité sémique donne naissance a des antonymes
converses: les lexémes recouvrent des sémbmes contenant chacun un séme
distinct de la catégorie, mais il existe la possibilité (théorique) d’avoir un séméme
contenant le terme neutre (ni ani b).
Exemples
(69) mari 1 ferume (opposés & célibataire)
sortir /entrer __(opposés a rester)
acheter / vendre —_(opposés & posséder)
% Nous renvoyons ici encore & Cunifs, 1980.
19
Les couples antonymiques de ce type ont en commun Ia propriété de
contenir une catégorie désignant une relation d’ordre.
Exemple
(60) MARI= si fhumain] FEMME= si
2 [adulte] 8
5s [sexué] s
s« [rapport dalliance...) 5
ss (directionalité] 3
xy yox
Il est possible d’appliquer & ce type d’antonymes lopération d’inversion ; R.
MARTIN (1976) indique une série de lextmes antonymiques appartenant a la
catégorie qu’il appelie « antonymie lexicale d’inversion » :
~ inversion de position (spatiale, temporelle ou logique) : en haut /.en
bas, hors de / dans, proche de / Join de, avant / aprés, début / fin, cause
/ conséquence, ete. ;
— inversion de direction de mouvement (concret ou abstrait) : monter /
descendre, s'approcher / s‘éloigner, sympathie / aversion, pour /
contre.
4.3.3. Lorsque plusieurs couples antonymiques s‘articulent sur une méme
catégorie supra-ordonnée, ‘on obtient une échelle intensive, dont les termes
désignent une propriété gradable. La catégorie sémique est organisée dans ce cas
par un rapport de contrariété, admettant la présence du terme intermédiaire
complexe (et a et b). Exemple:
a solide (fluide
liquide gareux
Les exemples ott le terme intermédiaire soit également actualisable sont
rares. Ainsi, la plupart des adjectifs désignant une propriété graduée s‘articulent
binairement sur une échelle intensive autour d'un point de repére
conventionnetlement établi et non lexicalisé :
120
title <—> fedis
chaud <———___—» froid
brilant. <—___———_+ glacial
Certains auteurs (LYONS, 1977) réservent Je terme d’antonymie cette
seule classe de rapports dopposition.
4.4, Antonymie et contexte
Comme pour les autres relations sémantiques, les lextmes antonymes
= sont ramenés a une catégorie sémique
= dans les conditions d'une base classématique constante.
‘Ainsi, en commutant un seul trait sémique, I'échelle de la température
svarticule en plusieurs couples antonymiques :
2)
[température]
{intensité maximale] } chaud ~ froid
(directionalité]
{température}
fintensité moyenne] tide ~ frais
[directionalité]
Par conséquent, les termes chaud et fraig ne constituent pas une opposition
antonymique.
De méme, la condition de I'invariance classématique ~ dénotative et
connotative ~ doit étre satisfaite. En changeant le contexte, de nouveaux couples
antonymiques peuvent naitre: la propriété gradable évaluée sur Yéchelle de
grandeur prend des valeurs différentes selon le nom qualifié :
11
(63) (vent, air) Héde ~ frais frisquet
(café tide ~ chaud
refroidi ~ brilant
tibde
(eau du bain) | Odi | bon bain »
(On dira done:
(64) 1. Le café est trop chaud pour qu‘on puisse le boire.
2. Liair est frais pour cette époque de Vannée.
1 faut également veiller & ce que les changements de registre linguistique
soient bien marqués, car: 4 un discours critique s‘oppose un discours élogieux, et
non (litt) thuriféraire ; une personne est bien ou mal élevée, mais 4 un chic type
s‘oppose un ploue.
4.5, Antonymie et discours
Les rapports logiques qui sous-tendent I’antonymie lexicale sont
également la base de certains mécanismes discursifs producteurs de
signification :
a) un premier effet discursif de lopposition sémique est la polarisation
positive ; la neutralisation d'une opposition sémique se fait, le plus souvent, en
faveur du terme positif(ANSCOMBRE et DUCROT, 1981); Yactualisation en
discours de la valeur positive sélectionne par conséquent le lexéme positif du
couple antonymique :
(65) 1. Hest grand, ton appartement ?
2. lest bon, ce professeur ?
Ces questions sont «normales» et «neutres» par rapport aux intentions
(argumentatives) du locuteur.
Les questions :
(66) 1. lest petit, ton appartement ?
2. Mest méchans, ce professeur ?
laissent entendre que le locuteur passéde des éléments (croyance, évidence) pour
attendre une certaine réponse. Les questions (65) admettent les réponses oui ou
12
non, alors que la demande d'information devient demande de confirmation dans
(66) ; ony répondra par:
(67) 1. Oui, en effet / Non, pourquoi ? (= pourquoi le penses-tu 2)
2. I n'est pas du tout petit
3. 1 west pas méchant due tout
4. Absolument pas, etc.
) l'interprétation en langue naturelle de la relation logique de contrarigté
comme relation de contradiction explique implication conversationnelle de :
(68) Le thé n'est pas mauuais —» Le thé est bon
alors que logiquement pas mauvais n'implique pas bon. Si le locuteur veut
expliciter la relation de contrariété, il est tenu a utiliser des moyens
supplémentaires :
(69) Le thé n‘est pas mauvais, mais il n'est pas bon non plus.
Ce méme effet discursif produit une variante de litote :
(70) Il nest pas sot (= ilest plus intelligent que je ne le croyais, il est
(méme) intelligent)
©) la langue naturelle admet, dans son fonctionnement expressif, la
gradation de deux termes en relation de contradiction :
(71) Hest plus mort que vif.
d) Ia relation d'antonymie est & Ja base de la construction syntagmatique
nommée dans la théorie des tropes oxymoron, et définie comme la combinaison
sur l'axe syntagmatique de deux lexémes en rapport de contradiction. L’exemple
prototypique est ie comélien :
(72) Cette obscure clarté qui tombe des étoiles.
‘On peut rencontrer de tels syntagmes dans le discours quotidien, ott le
trope est quasi-lexicalisé :
(73) _ un silence éloquent (apud LEXIS, s.v. Eloquent)
123
4.6, Conclusions
‘+ Antonymie et synonymie apparaissent au niveau sémique comme des
relations complémentaires : elles se partagent le champ d’une catégorie
sémique ~ et par conséquent une zone notionnelle en tant que rapports
établis entre les termes de la catégorie.
* Elles se définissent hiérarchiquement par le rapport hyponymique
terme-catéporie.
+ L’antonymie recouvre plusieurs classes d’oppositions qui connaissent
une distribution préférentielle en rapport avec les especes de mot (la
contradiction apparait de préférence dans lespéce nominale, la
contrariété dans I'espéce adjectivale et adverbiale),
5. Structure paradigmatique du lexique
(les « champs sémantiques »)
5.1. Les champs lexico-sémantiques
Les relations paradigmatiques forment des réseaux de relations
rassemblant un certain nombre d’unités lexicales; puisque les relations
sémantiques, en général, trouvent leur source au niveau de la catégorie sémique,
le choix d'une catégorie ou d’une autre aboutit & organisation du lexique en
micro-systémes lexicaux se partageant une méme zone de signification ou champ
dexpérience ; ils seront ici nommés champs lexico-sémantiques.
5.1.1. L'existence d'une organisation lexicale a éé remarquée depuis
VAntiquité” ; elle a hanté la pensée philosophique de Leibniz, Husserl, Cassirer,
Humbold, qui fondent en large mesure leurs considérations philosophiques sur
le rapport entre le langage et la pensée ; en linguistique cst a J. TRIER que on
doit une premiére tentative d’approche structurale du phénoméne des champs
lexicaux saisis en diachronie, Pour TRIER le lexique d'une langue se présente
‘comme un ensemble hiérarchisé de groupements de mots recouvrant chacun un
domaine notionnel délimité. Analysant le vocabulaire allemand de la
«connaissance » aux XIU et XIV« siécles*, TRIER fournit une preuve en faveur
» Dionysos de Thrace invoquait les relations entre nuit et jour, entre mort et vie, entre
pore et fils.
% J. Trier, Der deutsche Wortschatz. im Sinnbezirk des Verstandes, Heidelberg, 1931.
124
de la thése structuraliste du sens lexical congu comme valeur ; une unité lexicale
Ya de sens que par opposition aux autres unités d’une méme zone.
5.2. Difficultés de lentreprise
Tenter de décrire les champs lexico-sémantiques est une entreprise
hardie, comportant des risques dont il faut étre conscient et qu'il faut assumer
délibérément, L’éeueil majeur est de se voir glisser de étude de
Yorganisation lexicale (ou lexico-sémantique) vers I’étude de lorganisation
(extra-linguistique) de 'expérience référentielle, de la langue vers la pensée
Ainsi, il nest pas aisé de prouver que le champ lexical du mot sige étudié
par POTTIER est une étude des sens lexicaux ou d’un ensemble référentiel
empiriquement délimité®. Théoriquement on vise & décrire non pas
Yorganisation de la substance du contenu (J'univers référentiel), mais celle du
plan de la forme du contenu, et ceci dans ses rapports avec une organisation
(forme) du plan de I'Expression ; non pas organisation conceptuelle, ni
méme tout simplement celle sémémique, mais la structuration des sémémes
en tant que parties constitutives du signe (dans leur rapport avec un
signifiant)*. Ceci explique les difficultés de l'entreprise.
5.2.1. Une premiére difficulté surgit dés que l'on se propose de définir les
unités lexicales, compte tenu de l'existence, & cdté des « mots simples », de « mots
composés », syntagmes plus ou moins automatisés (v. infra Chap. Ill, Relations
syntagmatiques, § 5.1). Ainsi, comment traiter des unités appartenant
formellement & une méme classe : chaise de bureau, fauteuil de bureau, chaise de
jardin, chaise de bébé, sidge de bébé, chaise électrique, siege éjectable, ete.” ?
5.2.2. La difficulté majeure est créée par la nature méme du signe, A savoir
par l'atbitraire de la relation signe-référent®, engendrant le phénoméne de la
polysémie et, partiellement, de 'homonymie,
® Voir & ce sujet la critique que Greimas adresse & l'étude de Potties, citée ci-dessus au
Chap. I, L’analyse sémique, § 1.2.
» Ceci explique notre choix terminologique de champ lexico-sémantique.
3 Nous avons emprunté les exemples 3 Cl. Germain, 1981, 77.
% Dans la discussion autour de la question de 'arbitraire du signe, nous faisons notre la
solution de Benveniste (1966).
125
Ainsi, chaque sens (séméme) recouvert par un lexéme polysémique peut
donner naissance a une série d’oppositions constituant un microsysteme lexico-
sémantique distinct. Cl. GERMAIN (1981, 79) donne I'exemple du mot canapé et
construit le schéma que nous reproduisons en simplifiant :
tréne
4
fauteuil TITRES
PLATS MEUBLES
«hors d’oeuvre ¢—canapé —» chaise
|
aN
établi ass
‘OUTHS GEOLOGIE
Un méme lexéme peut migrer d'un champ a l'autre, ce qui, pour beaucoup
représente un argument contze la description taxinomique du lexique.
5.2.3, Le phénoméne des Iacunes lexicales fait que, si dans le plan
sémémique organisation peut étre rigoureuse, dans le plan lexical le systéme est
de loin moins complet.
5.24, Une autre difficulté se rattache a la délimitation méme du champ,
se faisant le plus souvent & partir d’un critére arbitraire, empirique ou emprunté
Aune autre discipline.
La plupart des études dans ce domaine portent sur un concept, exprimé
linguistiquement par un ensemble synonymique: les termes désignant
Ychabitation », la « beauté », les « animaux domestiques », etc. L’organisation
rigoureuse de ces ensembles est rendue d’autant plus difficile que les traits
sémiques qui les opposent sont souvent « encyclopédiques » (v. supra, Chap.II, §
2.0): a l'intérieur du champ décrit par POTTIER, chaque trait sémique erée des
oppositions qui lui sont spécifiques, mais dont ensemble ne conduit pas vers
tune organisation réelle. Par exemple :
126
+ [dossier} 7 T chaise, canapé, fauteuil vs tabouret, pout
+ [bras] —_| fauteuil, canapé vs chaise, tabouret
“E[pour une personne] | > | chaise fauteuil tabouret, pouf vs canapé
+ [sur pied(s)] —> | chaise vs tabouret, pouf (le trait ne nous semble
pas pertinent pour canapé ou fauteuil)
4 [en matiere rigide]_|—> | tabouret vs pouf (méme remarque)
U apparait ainsi que ce champ présente une structuration bien moins rigoureuse
que le tableau établi par Pottier ne fe laissait supposer. L'explication se trouve
dans le fait que nous avons affaire, dans de tels cas, a des terminologies ot,
comme nous avons dit, fonctionnent des traits sémiques encyclopédiques
(référentiels), la structuration linguistique s‘imposant au niveau des
archilexémes.
5.3. Hypothése de travail
Sans prétendre offrir une solution définitive, encore moins la meilleure
solution, nous discuterons Ja solution qui semble cadrer le mieux avec les
principes qui sous-tendent la présentation d’ensemble du sens lexical dans cet
ouvrage. Dans cette perspective, une structuration paradigmatique du lexique
prend sa source au niveau profond de la catégorie sémique, 1a oit sétablissent les
rapports d’ opposition paradigmatiques entre sémémes.
L/opposition binaire constitutive de la catégorie sémique, simple ou
complexe, permettra d’organiser de manitre hiérarchique des micro-systémes
sémémiques de complexité toujours accrue, selon que Yon fait jouer un nombre
accra de catégories sémiques. En admettant V'idée que le séméme est un
‘ensemble de catégories sémiques relevant de champs d'expérience divers (et
partant de systémes sémiques différents), on devra assumer qu’un méme lextme
puisse et doive figurer dans divers micro-systémes, selon que Yune ou l'autre des
catégories composantes est prise en considération.
5.3.1. On partira ainsi des systémes sémiques (relevant du seul plan du
contenu), organisés par des rapports d’ opposition et d’implication, pour étudier
— par un recours constant au plan des formants - la structuration lexico-
‘sémantique des nicro-systémes sémémiques de plus en plus complexes. A examiner
Ie systeme sémique de la « spatialité » décrit par GREIMAS (1966, p. 33) comme:
127
oe
{spatialité]
NN
[dimen Ao [non dimensionalité]
aN oN
[horiz6ntalité] [verticalité] [superficie] [volume]
oN
{perspectivité] _[latéralité]
long /court large /étroit haut/bas vaste /x Spais /mince
on remarquera que le recours & la lexicalisation oblige & prendre en considération
d’autres catégories sémiques, ce qui fait jouer de nouveaux rapports,
synonymiques et/ou antonymiques, et neutralise d'autres oppositions.
GREIMAS (1966, p. 35) remarque que I'introduction de la catégorie
[quantité] - appartenant par ailleurs 3 un autre systéme sémique que celui de la
spatialité - «permet la suspension de ‘opposition sémique verticalité vs
horizontalité », et donne l'exemple :
(74) court sur pattes ~ haut de taille.
L’accroissement du degré de complexité d'un champ lexico-sémantique
suite & Yintroduction de nouvelles catégories peut étre illustré par quelques
exemples :
Sm = {non dimensionalité] < [position] :
7)
4 [concret] _plafond haut ~ bas
une céte basse ~ abruy
Jes hautes | branches ~ les branches basses.
dlevées.
Je bas bout de la table ~ le haut bout de la table
Ia place d'honneur
+ [intensité] voix basse ~ & haute voix
parler bas ~ parler fort
note haute ~ | basse
aigué grave
128
courants @ haute ~ | basse fréquence
forte | faible
température basse ~ élevée
haut rendement ~ faible
[quantité] haut prix ~ bas
slevé modéré, modique
[abstrait] unedme | haute —~ une ame | basse
noble élevée ignoble, vile
un haut fonctionnaire ~ un petit fonctionnaire
de la basse littérature ~ de la bonne littérature
D’autre part, si Fon s‘en tient au seul systéme sémique de la spatialité,
Yajout de lexemes appartenant & d’autres espéces de mots que l'adjectif ou
Vadverbe aurait également pour effet une complexification du systéme lexico-
sémantique.
5.3.2. Une étude plus poussée en la matiére appartient & COSERIU (1975)
qui se propose dl'établir une typologie des champs lexico-sémantiques, sur la
base d'un certain nombre de critéres, dont nous citons ceux qui peuvent nous
intéresser :
= les types d'oppositions constitutives de la catégorie sémique
(privatives, équipollentes, graduelles, antonymiques®)
~ le nombre des catégories sémiques considérées.
COSERIU parle de champs unidimensionnels, fondés sur une seule catégorie
sémique, et donne I'exemple de :
— champs antonymiques : bas / haut, court / long, etc. ;
~ champs graduels : les adjectifs désignant la température.
A notre avis, seuls les systemes sémiques peuvent étre unidimensionnels,
alors qu'un champ lexical, méme & un faible niveau de complexité, implique des
catégories hétérogénes, Dans le champ des adjectifs désignant la température il
existe déja trois catégories :
~ lacatégorie de la {température}
— Ja catégorie de 'fintensité], appartenant au systeme de la [quantité]
3 Nous mentionnons que l'acception ici donnée & ces termes ne concorde pas tout & fait
avec celle de Coseriu ; le type d’approche est pourtant le méme (soulignons par exemple
Yanalogie « catégorie sémique » ~ « dimension »)
129
= la catégorie de la [disectionalité], que 'on peut envisager comme
appartenant au systéme de la [spatialité abstraite]. Ces trois catégories
permettant d’ organiser les oppositions binaires sur une échelle graduée :
<—o—0—0-——0——0—>
frais <——> tiede
froid. <—_______——» chaud
Pour étre utile, Ia description doit pourtant prendre en considération des
catégories classématiques, telles que (abstrait], etc.
glacial
roid
(v. également supra, § 4.3).
(76) accueil ~ chaleurewx
Si Yon renonce done a l'idée des champs unidimensionnels, on pourra
accepter le critere des types d’ opposition, combiné avec la corrélation qui s’établit
entre ces dimensions (catégories sémiques). Il existe ainsi, selon auteur cité, des,
jimensionnels
aN
corrélatifs non correlatifs
facile / difficl couleur / — noncouleur
leger /lourd
demander / rouge vert bleu _ blanc /non blans
répondre etc. gris (noir
pluri-dimensionnels
te sélectifs
corrélatif
porter = J mner_ “3B”
apporter/emporter _ amener / emmener
rapporter /xemporter ramener / remmener
130
Comme on le voit, la classification - et d’ailleurs ensemble de la
discussion menée par COSERIU - s‘en tient 4 des micro-structures lexico-
sémantiques de portée réduite, dont l'analyse ne semble pas exiger de moyens
autres que ceux qui ont été utilisés dans la description des relations sémantiques
paradigmatiques.
Tl reste de toutes ces tentatives la démarche onomasiologique
implicitement utilisée par POTTIER et, & sa suite, par de nombreux chercheurs, et
dont le principal acquis est la description minutieuse de diverses séries
synonymiques. On est encore loin d'une visée de plus haute portée, qui mette en
jeu le réseau complexe de relations susceptibles d/aboutir @ une description
rigoureuse de zones plus amples du vocabulaire d’une langue naturelle
5.4, Conclusions
+ Les champs lexico-sémantiques sont des micro-systémes lexicaux
recouvrant une zone commune d’expérience .
+ Leur description met 2 Yeuvre le réseau des rapports
paradigmatiques .
+ Dans le plan sémantique, on peut déceler des systémes sémiques
homogenes, organisés et organisables comme des structures
hyponymiques arborescentes .
La polysémie lexématique d'une part, la non homogénéité sémémique
©". se part, engendrent un degré de complexité qui fait reculer le
succes de cette tentative.
Les relations syntagmatiques
0. Définition.
Décrites comme des relations de combinaison entre sémémes co-présents
dans une méme (partie de) phrase, les relations syntagmatiques, du type et...
et..., reposent ~ comme toute relation ~ sur existence d'un élément commun,
assurant la possibilité de combinaison d’unités distinctes.
Dans lexemple :
(7) «Lesalon d’Angéle était déja plein de monde ».
(GIDE, Paludes)
131
a combinaison des lexémes est assurée par la présence dans le sens des divers
lexémes de certains sémes communs (classémes) :
salon: pice partie d’un appartement [...] d'une certaine superficie...)
destinée a recevoir les visiteurs
(apud LEXIS)
est caractérisé par les catégories sémiques :
[spatialité] + [fonctionnalité}
[contenant] [contenu]
(humain) [inanimé|
[asage domestique]
Dans plein («se dit d’une chose qui contient tout ce qu’elle peut
contenir ») on retrouve les traits: [spatialité], [contenant], ainsi que le trait
[quantitatif]; monde, lextme qui occupe la place de «objet contenu», est
également caractérisé par les traits (humain], (quantitatif]. Ainsi & partir de salon
plein de... on peut s‘attendre &
salon plein de: | monde
personnes
visiteurs
hommes, femmes, etc.
ou encore:
salon plein de: | objets (meubles)
liores
tableaux
instruments de musique, etc.
‘Sila combinaison :
2 salon plein de chiens, de chats
semble bizarre, mais possible, vu le trait (domesticité] contenu par les sémémes
respectifs, les syntagmes :
132
27 salon plein de vaches, de moutons
apparaissent carrément bizarres (sans qu'ils soient totalement impossibles), alors
que les groupements :
salon plein de: | ides,
esprit,
silence,
a premiére vue impossibles, exigent un mécanisme de déchiffrement différent (v.
infra, Chap. 1V, §4) enfin, les groupements :
* salon plein de: | éléphants
trains
apparaissent comme impossibles {anomaus).
1. La relation de compatibilité
Ii doit donc exister entre les sémémes recouverts par des lextmes
combinés & V'intérieur des syntagmes une compatibilité assurée par la présence
de s8mes communs, constituant la base classématique du syntagme ou de la phrase
respective.
1.1. Remarques préliminaires
a) La combinaison sémantique est orientée par le sens grammatical (le sens
de la structure syntaxique) +
= lesens des classes syntaxiques (nom, verbe, adjectif, ete.)
— Je sens des rapports syntaxiques (sujet de, verbe de, instrument
de, etc);
ainsi, dans Je syntagme salon plein de monde, de marque la relation [contenant vs
contenu] introduisant le « contenu » et le syntagme plein de monde, occupant la
place de déterminant, indique une propriété du nominal sujet.
La dépendance du sens syntagmatique du sens grammatical fait que la
combinaison des sens lexicaux suit un parcours hiérarchiquement organisé pat la
structure syntaxique de la phrase.
Ceci explique, par ailleurs, le fait que le sens, ainsi combiné, ne représente
pas la simple addition des ensembles sémémiques ; deux syntagmes constitués
Ges mémes éléments ont un sens différent si leur structure syntaxique est
différente. Dans :
133,
(78) 1. Une femme professeur entre dans la salle,
2. Un professeur femme entre dans la salle.
‘out les deux lexémes femme et professeur changent de position syntaxique
(Gément référentiel, élément qualifiant), on constate des modifications dans le
sens lexématique : professeur et respectivement femme en position d’élément
qualificatif voient leur sens limité a un trait sémique qui décrit une propriété
[profession], {sexe}). Les deux phrases, bien que pouvant référer 4 une méme
réalité, sont énoncées avec des intentions communicatives différentes,
b) Il peut y avoir compatibitité entre deux unités entre lesquelles il existe une
relation :
9
(® de simple conjonction
(79) «La nuit était calme et chaude. »
(MAURIAC, Le Neeud de vipéres)
(il) d'implication (si p alors 9)
(80) « Ne pouoant dormir, je me suis rhabillé, »
(MAURIAG, op. cit.)
(iii) de double implication (si p alors q, sig alors p)
(81) « Ces grandes jambes de Robert, ce buste court comme est le mien, cette
téte dans tes épaules je les exdere, »
(MAURIAG, op. cit.)
Ces trois types de relations peuvent se retrouver, comme nous I’avons
constaté, au sein du séméme oit certaines catégories sémiques en impliquaient
lune autre qui & son tour pouvait les impliquer, alors que d’autres catégories se
combinaient conjointement avec d’autres. Elles régissent également Ia
combinaison des sémémes a l'intérieur des syntagmes de rang supérieur.
1.2, Description
La relation de compatibilité logique dépend des rapports factuels dont
la compatibilité linguistique (sémantique) n’est qu’un reflet. On définit la
compatibilité (linguistique) comme la possibilité qu’ont deux unités de contracter une
% Hijemstev (1943/1968) nommait ces rapports combinaison, sélection et respectivement
solidarité
134
relation, d'étre présentes ensemble dans une unité higrarchiquement supérieure ou en
position de contiguité sur Uaxe syntagmatique. Sur le plan sémantique, il y a
compatibilité & condition que les deux sémémes en rapport de coprésence ne
contiennent pas chacun un terme opposé d'une méme catégorie sémique. Ainsi, la
combinaison des éléments linguistiques dépend de leur possibilité de se
‘combiner avec certains éléments seulement, a Vexclusion d’autres combinaisons
jugées incompatibles.
1.2.1, Il apporait évident que le jugement de compatibilité, de bonne
formation ou de «normalité » sémantique repose en tout premier lieu sur le
savoir que les locuteurs possédent du monde réel et/ou de I'univers culturel dans
lequel ils vivent. Ainsi, la phrase
(82) Lalicorne écrit.
est inacceptable, vu que le référent ‘licorne’ est caractérisé par le trait [animal],
alors que ‘écrire‘ contient le trait [humain].
1.2.2. Pourtant, la langue n’étant pas une liste d’étiquettes inventoriant le
monde réel, mais un ensemble de signes dont le propre est d’étre arbitraires par
rapport a leurs référents, au systéme de compatibilités sémantiques — déterminées
par des rapports référentiels ~ il se superpose un systéme de compatibilités
Jexématiques, purement linguistiques, relatives aux possibilités combinatoires
dont chaque lexéme est doté en vertu des régles du systéme. Ainsi, si Yon dit en
francais:
(83) faire, accomplir une bonne action
on dira :
(64) commetire une mauonise action (méfuit, crime, erreur)
Le recours 4 la comparaison des systémes linguistiques fait davantage
ressortir le r6le des compatibilités lexématiques dans la construction de la
syntagmatique discursive ; on dit en francais et respectivement en anglais aller
cheval et aller & bicyclette, to ride a horse, to ride a bicycle, pout ce qui en roumain
recoit une lexicalisation différente: a ciléri, a merge pe biciclett; la factit
exprimée en frangais par deux structures en dépendance contextuelle : faire que
quelqu’un soit heureux et rendre heurewx (quelqu'un), s‘exprime en roumain par un
méme moyen : a face pe cineva si fie fericit ; a face pe cineva fericit.
135
ee —_
2. Classification des relations syntagmatiques
On peut distinguer parmi les relations syntagmatiques, selon leur niveau
d’incidence, entre les relations :
— intra-syntagmatiques, qui rattachent deux ou plusieurs unités a
Vintérieur d'une unité de rang supérieur correspondant aux syntagimes
constituants de phrases ;
~ inter-syntogmatiques, combinant des syntagmes de ce niveau pour
former des phrases ou des unités supérieures 8 la phrase.
Notre attention porte en priorité sur les relations intra-syntagmatiques
qui concernent de maniére plus directe le niveau lexical.
3. Liamalgame sémique
3.1, Lieu de Ja relation syntagmatique
Il ressort de la définition proposée ci-dessus que la compatibilité
sémantique, quelle qu’en soit Vorigine (référentielle ou lexématique), plonge ses
racines jusqu'au niveau le plus profond de Ia structuration sémémique, la
catégorie sémique. Ainsi, dans Yexemple cité :
(85) La licorne écrit.
le sujet et le prédicat contiennent chacun le terme oppos¢ de la catégorie
Animé
—_——
Humain Animal
(86) Le salon était plein d‘idées,
est la catégorie [abstrait] vs [concret] qui est mise en cause, vu que salon exige
un adnominal (concret].
3.2. Mécanisme de lamalgame
Comme nous Yavons déji vu, la combinaison des sémémes, ou
Yamaigame sémique, nest pas - sauf de rares cas ~ la simple addition des deux
136
ensembles sémiques ; il s‘agit d’un processus modifiant la structure interne de chaque
séméme constitutif. afin de produire le sens global du syntagme ainsi construit.
3.2.1, Ce mécanisme comporte deux étapes :
(1) L’établissement de la base classématique unique, par
~ Ie maintien du classéme commun aux unités en cause :
(87) Jean est un vrai médecin.
(humain] —_fhumain]
~ la suppression des classémes incompatibles, comme dans :
(88) Jean est un vrai cheval,
[humain] {animal
oit Vincompatibilité est résolue en faveur du centre syntagmnatique (le nom sujet)
et conformément a une vision anthropomorphisante de l'univers propre a notre
civilisation.
Parfois, le rétablissement de la compatibilité sémantique exige que les
classdmes des unités en combinaison soient supprimés et remplacés par une base
classématique différente :
(69) « Dans ce climat inquiet, la panique pouoait éclater & tout instant. »
(LEXIS, sv. climat)
les deux sémémes CLIMAT et INQUIET perdent leurs classémes respectifs de
[météorologique] et [humain] pour se combiner sur la base classématique
commune [abstrait].
(2) L’expansion nueléaire, par une fusion des noyaux sémiques, avec ~ ou,
rarement, sans ~ modification, sous I'influence des processus déja survenus dans
la base classématique.
‘Ainsi, Ye séméme CHEVAL dans (88) se modifie complétement, pour ne
gerder que le sme nucléaire (connotatif) {endurance}, De méme dans :
(90) La lumiére donne dans la vue.
a réduction de lincompatibilité classématique en faveur de Ifinanimé] entraine
la modification nucléaire
DONNER: = [animé] + [transfert], [non réciprocité), [transitivité]
DONNER: = [inanimé] + [déplacement], fintransitivite}, {intensif].
137
a ar
3.2.2. Ce mécanisme permet au locuteur de créer de nouvelles
combinaisons, d’innover, en juxtaposant des unités, quitte a enfreindre les lois
sémantiques du systéme: le décodage est rendu possible par la connaissance
qu’ont les Jocuteurs et Jes interlocuteurs de ce mécanisme. Recensant des
innovations lexicales dans la presse francaise, BASTUJI (1974) donne les
exemples suivants :
(91) «A quoi servent les centres commerciaux ? Leur mise en orbite ne se fait
pes du jour au lendemain. »
ou mettre en orbite, caractérisé par un classéme {dynamique} apparait
incompatible avec centre commercial ; l'adoption du classéme [statique] améne
un appauvrissement du noyau sémique devenu : « faice fonctionner 2 partir d’un
centre de lancement et de contréle
(92) « Mettre en auvre des réformes qu'exigeait un hexagone fatigué et lucide »
‘of Vincompatibilité classématique [animé] vs [inanimé] fait interpréter hexagone_
sous la pression du classtme [spatialité] comme « étendue ayant la forme d’un
hexagone », ensuite comme « étendue habitée par des humains », ensuite enfin,
sous la pression de la base classématique {humain] présente dans EXIGER,
FATIGUE, LUCIDE, comme « humains habitant cette étendue » (les Francais).
3.2.3. Le mécanisme de l'amalgame sémique peut étre représenté de
maniére simplifige par:
(Ws, +Cs,) v(0e, +€5,)— (Ns) +654’) cs,
oi: Cs, peut étre Cs, ou Cs, ; Ns‘ note la modification du noyau sémique.
4. Possibilités combinatoires des lexémes
Les unités lexicales se répartissent, selon leur capacité de se combiner
avec un ensemble plus ou moins large d’autres unités, en trois classes :
(1) Les unités qui peuvent se combiner avec un trés grand nombre
dV’autres unités ; font partie de cette classe des unités dont le sens est peu spécifié
@ faible densité sémique), dont extension est par conséquent trés large ; dans la
classe verbale : étre, avoir, faire, arriver, mettre, avancer, pouvoir, devoir, etc. ;
138,
dans la classe nominale: chose, étre, homme, plante, couleur, ete.; parmi les
adjectifs : grand, petit, bon, mauvais, etc.
‘On remarquera qu'il s‘agit en général d’archilexémes, qu’il est toujours
possible de remplacer par des unités de sens plus spécifique, adéquates au contexte :
(93) unt homme vance lentement > marche.
une voiture roule
sun bateau navigue
un serpent rampe
(94) mettre deVeau dans un verre + —_verser...
un objet sur un autre > poser
un objet @ sa place ranger
un tapis sur le parquet > étendre
(2) A Vopposé se situent les lexémes dont les possibilités combinatoires
sont limitées & un seul contexte; ainsi, la liste bien connue des adjectifs :
alezar: (cheval), aguilin (nez), crasse (ignorance), circonflexe (accent), grégeois
(feu), saur (hareng), salant (marais), philosophale (pierre), pote (main), trémiére
(rose), cockére (porte), etc. ; de méme les verbes hocher (la téte), cligner (les/des
yeux, de loeil), etc.
Une relation d'implication rattache ces unités & I'unité sans laquelle elles
ne peuvent figurer dans le discours.
@) Une classe trés large d’unités prend place entre ces deux extrém
Coté dunités a possibilités combinatoires réduites ~ grige (soie, couleur), canine
(dent, race), follet (feu, esprit), pantois (laisser, rester) ~ il existe toute la gamme
des lextmes aux possibilités combinatoires plus ou moins larges. C'est le cas des
archilexémes dominant des séries limitées d’u eu (ou tout autre adjectif de
couleur) - combinable avec les nominaux renvoyant a des objets pouvant étre
bleus, du ciel & la peur, par exemple -, rond, etc. ; pareillement, beaucoup d’objets,
et méme un humain, peuvent étre rompus, ou se rompre. Souvent, un noyau
sémique s‘associe 4 des formants divers en fonction du contexte (ou, plus
exactement, de la base classématique qui caractérise le contexte). Ces Jextmes ont
donc un usage limité & certains types de contextes :
(95) ALTERATION | + Cso {denrée périssable] > altéré
(un plat, un médicament, un matériau)
+ Csr [corps gras] > ance (huile, beurre)
+ Cs [liquide} > tourné (vin, lait)
+ Cos [fruit, legume] > gate passé
+Cs« [patisserie] > sassis (pain, brioche)
139
Les possibilités combinatoires* des unités lexicales dépendent done :
(de la base classématique des sémémes (seules deux unités ayant ia
méme base classématique peuvent se combiner), reflet des rapports
référentiels ;
(ii) de la densité sémique du noyau ;
(iii) des conventions linguistiques, qui associent @ un contenu divers
formants selon la base classématique.
Remarque. Les possibilités combinatoires limitées de certains lexemes se
trouvent a la base d’un procédé d’enrichissement du sens lexical (création
de nouveaux sémémes), connu sous le nom de « dérivation impropre » ou
de « conversion ».
Dans les syntagmes de structure Déterminé’Déterminant, 1a ot le
Déterminant accompagne toujours ou le plus scuvent un méme
Déterminé, le lextme Déterminant finit par recouvrir un nouveau
sémeme constitué syntagmatiquement par Iamalgame des deux
sémemes, Tel a été le cas pour : un alezan (+ un cheval alezan), du vélin
(papier), un follet, le métro. Le procédé continue étre productif: un
‘marginal (homme, cest-i-dire personne qui vit en marge de Ia société et
en rejette les normes), les (élections) présidentielies, législatives, la (police)
judiciaire*, une (voiture) commerciale, une (voiture) Renault, etc. Le procédé
agit parfois au sein d’un syntagme de type Verbe”Complément
conduire (une voiture), il boit beaucoup (de alcool). Deux conditions
doivent étre satisfaites pour que la conversion puisse se produire :
= une condition sémantique : la faible densité sémique du séméme
déterminé ;
- une condition pragmatique : I'usage fréquent du syntagme, suite &
des circonstances socio-historiques ou politiques particuliéres.
5. La combinatoire syntagmatique
5.1. Introduction
Les possibilités combinatoires des lextmes assurent leur capacité de
figurer dans un nombre plus ou moins élevé d’unités syntagmatiques. Décrire le
sens d’un lextme c'est aussi décrire l'ensemble syntagmatique dans lequel il peut
% Dans le cadre de la sémantique générative interprétative, on parle des restrictions de
sélection, ou de restrictions sélectives.
» Exemples empruntés & Cunit, 1980, p. 217.
140
figurer. Le sens de 'adjectf blond comporte par exemple Vidée qu'il s'agit d'une
couleur spécifique des cheveux dune personne” de méme que alezan renvoie &
tune certaine couleur du poil des chevaux.
‘Au point de vue sémantique les unités syntagmatiques peuvent étre
classifiées en fonction de la cokésion sémigue existant entre les sémémes
constitutifs, La cohésion, degré d'amalgame des unités sémantiques, peut tre plus ou
moins élevée, & partir d'une valeur minimale, dans le cas des syntagmes oit les
unités constitutives préservent leur autonomie jusqu’a sa valeur maximale, dans
Te cas des syntagmes ois les éléments constitutifs ont fusionné pour produire une
unité sémantique unique. Entre ces valeurs, on retrouve des syntagmes plus ou
moins soudés. ;
Léétude des types de syntagmes se place a la croisée de la sémantique et
de la lexicologie ; seule nous intéressera ici la cohésion sémantique de ces unités,
sans insister sur l'origine de ces unités, sur leur structure syntaxique sous-jacente,
sur leurs caractéristiques lexicologiques™.
5.2. Types de syntagmes
5.21. Les syntagmes A faible cohésion sémantique, syntagmes de
discours, sont constitués par une combinaison de lexémes aussi libre que le
permet la logique factuelle.
Prenons Yexemple :
(96) « Dans tes intervaltes de silence, j‘entendais la respiration un peu courte
a'Fsa, un craquement dallumette, Pas un souffe n'émorconit les ormeaux
noirs. » (MAURIAC, Le Ned de vipéres)
dans lequel la combinaison des éléments lexicaux dépend, dans les limites de la
normalité référentielle, du libre choix du locuteur ; ainsi, les syntagmes :
la respiration d(e) Isa
Ia respiration d'Isa™ un pen courte
enitendre™ ta respiration un peu courte d'isa
un craquement” d(e) “allumette
émouvoir” les ormeaux, etc.
2 Un emploi tel que « Des beignets de fleurs trempés dans le mie blond » (Appollinaire, apud
LEXIS) apparait comme un trope.
5% Pour la présentation de cette question, v. Cunita, 1980.
141
sont librement construits par le locuteur, compte tenut des restrictions :
respiration x [animé]
entendze ” y [manifestation sonore]
craquement “ z [solidité]
émouvoir (= mouvoit) © w [mobilité]
Les créations métaphoriques : infervalles de silence et ormeaux noirs, tout en
prouvant une liberté que le locuteur assume jusqu’a passer outre les restrictions
sélectives, sont toutefois faciles a interpréter par le récepteur qui en rétablit ta
normalité au moyen du savoir qu'il posséde sur les possibilités combinatoires des
lexémes respects et sur le mécanisme général de l’amalgame sémique :
INTERVALLE : [temporalité}, [contenant] “ x {temporalité]
DE:: [relation] ” x [espéce] : intervalle de 2 heures
ou
[contenu] : intervalle (de 2 heures) de silence
ORMEAU - [végétal], {couleur} ° x {vert]
ou
y [absence de couleur}
Lrincompatibilité entre élément sémique conforme A la représentation
culturelle que nous avons de objet est facile a résoudre par un enchainement
logique : noir — absence de couleur due & l'obscurité de la nuit.
Le sens de ces syntagmes est obtenu par un amalgame qui n'empiéte pas
sur Yautonomie de chaque séméme constituant ; de méme, l'extension de ces
syntagmes est constituée par V'intersection des extensions de chaque unité
constitutive. Exemple : pour la respiration d'tsa : classe des référents « respiration »
1 classe (a terme unique) des référents « Isa »
5.2.2, A l'opposé se trouvent les syntagmes automatisés (figés), unités
codées, présentant un haut degré de cohésion di la fusion sémémique
réduisant le sens syntagmatique & un séméme complexe unique, & extension
également unique, et oi les unités constitutives ne sont plus reconnaissables.
Plu: irs sous-classes sont a identifier, en fonction de leur provenance, de
leur structure syntaxique sous-jacente, de leurs caractéristiques formantielles.
Ainsi, ony retrouvera :
— les structures phrastigues, appelées par Benveniste conglomérés,
résultant d’une agglutination des constituants figés dans une
forme invariable par un usage répété et socialisé: un m’as-lu-vu, un
va-nu-pieds,
142
le qu’en-dita-t-on, le quant-d-soi, un jusqu’au-boutiste, un je-m'en-fickiste,
un je-ne-sais-quoij
= les syntagmes lexicaux composés® («mots composés », « lexies »,
«paralexémes »): portefeuille, portemanteau, porte-parole, porte-queue,
porte-objet, bien-portant, dla quewe leu leu, en porte d faux .
Ces deux sous-ensembles syntagmatiques présentent, en dépit des
differences génératives et structurelles, des traits sémantiques communs
— Ianon autonomie des sémémes constitutifs (fusion sémémique)
= Yunicité référentielle.
Ainsi, un m‘as-tu-vu se décrit comme :
Sm= Cs +. [Evaluation : euphorique vs disphorique]
(humain] (« vaniteuse qui a bonne opinion »)
(« personne ») [réflexivité vs transitivité] (« d’elle »)
[manifestation vs immanence}'®
{sans motifs valables] _(d’aprés LEXIS)
et renvoie aux entités d’une classe homogene de référents. Ni l'intension, ni
extension des formes pronominales je tu ou du verbe voir ne sont plus
reconnaissables dans cette nouvelle structure sémantique.
En dépit de ces traits sémantiques et syntaxiques communs, les
syntagmes de ce type sont pourtant loin de présenter une homogénéité totale ;
ainsi, le sens de jusqu’au-boutiste ou de je-m‘en-fichiste est encore facile &
déduire & partir des unités agglutinées, peu de locuteurs pourraient déduire le
sens de en porte 4 faux par le méme mécanisme.
5.2.3. Une classe bien moins nettement délimitée est formée par les
syntagmes demi-automatisés: ce sont des unités lexico-sémantiques
complexes, dont les locutions verbales, par exemple : donner lieu &, donner sa
parole, ne_pas donner un sou de, donner de Ja téte dans, etc, ainsi que des
syntagmes nominaux : film d’animation, machine a écrire, grande école, etc, des
locutions adjectivales (mi figue, mi raisin) ou adverbiales (du jour au lendemain).
Une relation d’implication unit les éléments constitutifs du syntagme de ce
type (ANIMATION — FILM, A ECRIRE -- MACHINE, LIEU -» DONNER, ete),
ce qui se traduit par le fait que seuls certains constituants sont bloqués, alors que
d’autres sont encore libres’.
» On peut consulter sur ce sujet Pottier, 1974, -
# Le premier terme de la catégorie est celui qui figure dans le séméme analysé.
4 V, Cristea, 1974/1979, p. 263.9.
143
Pouttant La distinction syntagmes automatisés vs syntagmes demi-automatisés
rest pas aisée. Il est facile de différencier entre :
(97) Des ronds de cuir étaient posés sur les chaises.
(98) Des ronds-de-cuir étaient assis sur les chaises.
vu que dans (97) le syntagme rond de cuir, caractérisé par le classéme [non
animé], présent également dans l’unité verbale poser, a pour sens le résultat de
Yamalgame sémique, orienté par le sens grammatical de I'élément de (relation
objet-matériau) :
rond: ROND [objetf, [forme ronde], [fonctionnalité : «se pose sur les
chaises en matériau dur »]
cuir: CUIR [matériaul, forigine animale], [fonctionnalité: «sert a
confectionner divers objets d’usage domestique »]
alors que dans (98) le classéme [humain}, présent dans le verbe s’asseoir, entraine
une modification totale de Vensemble sémique et produit ainsi un séméme
complétement nouveau :
Sm=
manifesté également par employé(de bureau), dont rond-de-cuir est le
synonyme péjoratif.
Ul est également possible de séparer dans rond_de cuir les unités
constitutives par l'insertion d'autres éléments : des ronds énormes de cuir, de trés
aids ronds de cuir, de cuir usé(s) ; c'est une opération impossible dans
le second cas.
La distinction se fait bien moins aisément dans le cas des syntagmes
automatisés et demi-automatisés ; prenons l'exemple des unités rond de main,
rond de jambe, rond de bras :
tre humain], [utilisant], [objet « rond de cuir >]
(99). saluer avec un rond de bras
(100) « Dans te métier d’avocat, il faut savoir faire des ronds de bras. »
(PARIS MATCH)
dans (99) rond de bras désigne un « mouvement circulaire fait avec le bras » (le
classtme [mobilité] caractérisant les composants rond et bras) ; a ce sens, il se
superpose ou se substitue dans (100) la signification «avoir une attitude
‘obséquieuse, afficher une politesse exagérée»; si dans (99) Jes sémémes
constitutifs conservent encore une certaine autonomie (ils sont encore
144
reconnaissables), quel est le statut des mémes sémémes dans (100)? Deux
solutions se présentent :
() considérer dans les deux exemples cond de bras comme une unité
demi-automatisée et accepter conséquemment qu’aut sens de (99) il se
stiperpose dans (100) une signification contextuelle ;
(i) considérer qu'il s‘agit dans (99) d'un syntagme demi-automatisé (et
existence du syntagme rond de jambe en serait une preuve) qui se
bloque en un syntagme automatisé dans (100).
Deux types de crittres semblent offrir une base, quoique non définitive,
de classification
(un critére sémantico-référentiel:
— la fusion sémémique (non autonomie des sémémes constituants) ;
= Yunité référentielle.
(i) un crittre morpho-syntaxique : la capacité du syntagme & admettre
Vinsertion d’autres éléments ou la substitution d’un élément
constitutif par une autre unité.
Prenons un second exemple :
(101) (A) panier d’osier ; (B) panier & bouteilles; (C) panier @ salade (2)
panier @ ouvrage panier percé
panier @ provisions panier de crabes
panier & salade (1)
— le noyau sémique commun aux exemples (A) et (B): [objet fabriqué en
matiére rigide, d'une certaine forme, destiné & contenit des objets]
garde son autonomie, tout en spécifiant contextuellement selon la
combinaison avec les sémémes des unités déterminantes, caractérisées
par le trait [matiére rigide] ou [contenu] ; dans les exemples (C) ce
noyau se modifie profondément, se réduisant A [objet fabriqué
contenant] dans panier & salade(2), et devient complttement différent
dans les deux autres exemples sous la pression d’une nouvelle base
classématique {+animé] ;
= seules les unités (B) et (C) renvoient & des classes référentielles
homogenes : « un panier & bouteilles » fait partie de la classe des objets
destinés & transporter des bouteilles, un « panier & salade » (2) est une
« voiture cellulaire » ; par contre, panier d’osier renvoie a ‘intersection
de deux classes référentielles, notamment celle des « paniers » et celle
des « objets en osier » ;
side nouvelles unités peuvent étre librement insérées =
145
MINE) © 4" paniter tres jolt d‘oster
2. un panier en osier tresse,
ou substituées 4 un élément du syntagme :
(103) 1. panier de treillis métallique
2. panier de matiore plastique,
il rest plus possible d. ‘
a Ma Pp lans le cas des syntagmes (B) qu’ajouter une détermination
(104) 1. un solide panier @ bouteiltes
2. un gros panier a provisions ;
dans les syntag je i ‘
impossible. 'gmes de type (C) tout jeu de substitution ou d’insertion devient
La comparaison des trois classes d’
_La comparai ‘exemples permet de dédui
caractéristiques distinctives suivantes, présentées dans tes tableau iedessous s
Critére | Logique | Référentiel | Sémantique |Morpho-syntaxe] Degré de
(Relation (homogénéite (autonomie |(séparabilité des| cohésion
logique entre |référentielle)| sémémique) | constituants)
constituants)
‘combinaison | — + =
implication + 2 i eae
automatisés | double + _
implication forte
On y remarquera la position hésitante occupée par les syntagmes demi:
-
eutomatisés, formant une classe assez peu homogine, ordonnée sur une échelle
Pe gene,
5.2.4. D'une importance toute particuliére pour 1' i '
langue étangére apparat re une sous close de contrite syne ses
se trouvant 4 la frontiére des syntagmes de discours et des syntay mee dem
automatisés ; il s'agit des associations syntactico-sémantiques creées pat un
usage préférentiel et réitéré de certains groupements, que Yon pourrait appeer
des associations préférentielles. Ainsi, un tefus est le plus souvent
146
catégorique, et on oppose un refus (catégorique), quelque chose gveille ou suscite
des souvenirs inoubliables ou ineffacables, on attache une importance (toute)
particuliére & un événement, on apporte, on fournit ou on invoque des
arguments _sotides, irréfutables ou encore inattaquables; une douleur, un
souvenir ou un regret peuvent étre lancinants, mais Je remords cuisant ; on
dégage des conclusions ou les grand: ‘ samme, etc. Ce sont des
construction de cohésion moyenne, a 'intérieur desquelles les lextmes/sémémes
constitutifs gardent leur autonomie, et qui se trouvent & la base dassociations
mémorielles dont l'ensemble se constitue en un répertoire appartenant a la
compétence idéologique et/ou discursive des locuteurs®.
Certains types de discours privilégient tout spécialement ce genre
d'associations, tels le discours publicitaire ou le discours de presse. Ainsi, dans le
slogan publicitaire pour le parfum L’Air du Temps de Nina Ricci :
(105) L'Air du Temps se porte comme un espoir
ssociation se_porter comme un espoir - se porter comme un charme peut
entichir le halo sémantique dgja mis en place par les signes iconiques de la page
publicitaire grace a la polysémie duu mot charme.
Dans le texte suivant, dont le but est de présenter l'activité du Centre de
Linguistique Appliquée de Besangon (CLAB), les associations préférentielles
smettent en place, autour de certains lexémes, une espace sémantique au contour
flou, faisant surgir en surimpression un niveau significatif implicite venant
doubler le sens explicite :
(106) « L’équipe des professeurs s'est aussi lancée dans la bataille. D.L,
responsable de la section de francais [...] s‘est fait représentant de
‘commerce pour exporter la langue et la culture francaise. Il rapporte
d'une mission au Nigéria un contrat de formation, en décroche un
autre avec le Vietnam [...] Des « missionnaires » bardés de diplémes
{qui pergoivent un salaire de 6.000 & 7.000 Frs et assument a tour de
role des fonctions de gestion. »
(LExpress, n° 1654, 25 mars 1983)
travail d’ |équipe décrocher [un prix
esprit d’ june récompense
faire (avec qqn.) bardé de diplémes, de décorations
[SOLIDARITE] (MERITE]
© V. Cristea, 1982
147
tla
la
ila
assumer | une fonction
des responsabilités
{RESPONSABILITE]
Le texte se voit ainsi sous-tendu par un sous-texte qui vient renforcer le jugement
de valeur que I'auteur s‘efforce d'induire dans lesprit du lecteur et, sans doute,
séussit-il mieux 4 l'obtenir que s'il avait exprimé un tel jugement de valeur.
6. Lisotopie
Bien que dépassant les limites volontairement assumées par cet ouvrage,
il a été question — plus ou moins explicitement ~ A plusieurs reprises d’un
phénoméne sémantique de la plus haute importance, a savoir 'isotopie®. Décrite
3 lorigine par GREIMAS (1966) comme résultat de la propriété définitoire des
classémes, notamment leur caractire itératif le long de la chaine syntagmatique,
Yisotopie s’est révélée étre constitutive de la cohérence textuelle. On désignera
par isotopie litérativité, le long de la chaine syntagmatique (du discours) d'un ensemble
de traits de sens, nucléaires etfou classématiques, assurant l'homogénéite discursive
et la possibilité de Y'interprétation du sens.
On pourra donc parler, sur Ia base de la méme classification des sémes
dgja utilisée pour la synonymie, de :
dénotative
nuciéaire
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Gheorghe Aradavoaice - Teste Psihologice de AutoevaluareDocument108 pagesGheorghe Aradavoaice - Teste Psihologice de Autoevaluarebiutzaaa93% (42)
- Ghid Pentru o Viata Implinita - William B. Irvine PDFDocument8 pagesGhid Pentru o Viata Implinita - William B. Irvine PDFzina_calin0% (2)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Grammaire en Dialogues Niveau AvanceDocument133 pagesGrammaire en Dialogues Niveau AvanceStephanie Australie94% (32)
- Tehnici de ComunicareDocument114 pagesTehnici de Comunicarehorica1234100% (51)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- O Teza de Doctorat La Dumnezeu PDFDocument21 pagesO Teza de Doctorat La Dumnezeu PDFzina_calin100% (1)
- Reinventarea Stimei de Sine Jurnalul Unui Psihoterapeut PDFDocument31 pagesReinventarea Stimei de Sine Jurnalul Unui Psihoterapeut PDFzina_calinNo ratings yet
- Horst Siewert - Teste de PersonalitateDocument111 pagesHorst Siewert - Teste de PersonalitateTaniusha Aleks92% (13)
- Bohumil Hrabal - L-Am Servit Pe Regele Angliei PDFDocument293 pagesBohumil Hrabal - L-Am Servit Pe Regele Angliei PDFzina_calin100% (1)
- DIRIGENTIEDocument168 pagesDIRIGENTIESUSANU TATIANA92% (13)
- Gramatica Practica A Limbii FrancezeDocument519 pagesGramatica Practica A Limbii Francezemona_ingeras97% (32)
- Le Recit Fantastique PDFDocument10 pagesLe Recit Fantastique PDFzina_calin100% (1)
- NR 13, 2013 - FINAL - 25.04.2014 PDFDocument425 pagesNR 13, 2013 - FINAL - 25.04.2014 PDFzina_calinNo ratings yet