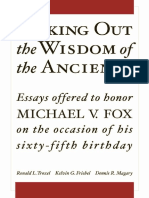Professional Documents
Culture Documents
2009633
2009633
Uploaded by
Alexandru V. Cuccu0 ratings0% found this document useful (0 votes)
12 views18 pagesg
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this Documentg
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
12 views18 pages2009633
2009633
Uploaded by
Alexandru V. Cuccug
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 18
LE MYSTERE DES «APPARENCES»
DANS LA JURISPRUDENCE
DE LA COUR EUROPEENNE
DES DROITS DE L’HOMME (*)
PAR
Frédéric SUDRE
Professeur @ VUniversité Montpellier 1,
Directeur de UInstitut
de droit européen des droits de Uhomme
Résumé
La «théorie des apparences», que la Cour européenne serait cen-
sée utiliser. demeure largement méconnue. Le recours aux
«apparences», qui ne se borne pas au seul domaine du procés équi
table, cache des pratiques jurisprudentielles diverses. Dans un jeu
ambivalent, le juge européen instrumentalise les «apparences»,
selon qu'il les dépasse ou, au contraire s'y arréte, ayant pour seule
fin la recherche de 'effectivité du droit protégé.
1. Réglons d’emblée une question terminologique, pour dire que
«apparence», au singulier, n'est a priori pas de mise, s’agissant du
corpus jurisprudentiel européen. La Cour européenne des droits de
Vhomme a toujours évoqué «les apparences», au pluriel, et seuls des
auteurs peu avertis ont pu entretenir la confusion avec la théorie de
Vapparence (1). Ainsi, dans son arrét Delcourt c. Belgique, du 17 jan-
vier 1970, oit, pour la premiére fois, elle en fait mention apres avoir
cité le célébre aphorisme de Lord Chief Justice Hewart ~ «Justice
must not only be done, it must be seen to be done» (§31) (2) ~, ainsi
(Ce texte est issu d'une communication présentée au colloque «Juge et
apparences» (TACIP, Université Toulouse I, 4-5 mai 2009) et est publié avee l'accord
du professeur Jacquinot, organisatrice de ce colloque.
(1) D. Cuapanot, «Théorie de lapparence ou apparence de théories, A.J.D.A.,
2002, p. 9
(2)¢La justice ne doit pas seulement étre rendue, mais il doit étre visible qu'elle
est rendues (Chambre des Lords, 1924, R. c. Sussex Justices, ex P. MeCarthy)
[rah eu]
634 Rev. trim, dr. h. (79/2009)
(Haheu) encore dans son fameux arrét Kress c. France, du 7 juin 2001 (3),
oil elle se référe a «la théorie des apparences»
2. Qu’en est-il de ces «apparences», qu’en sait-on? A vrai dire peu
de choses, des clichés — «la tyrannie des apparences» (4) —, que l'on
répéte a envi sans s'interroger sur leur bien fondé, et l'on ne peut
que constater, avec surprise, l'absence d’analyse doctrinale en la
matiére. Aucune étude spécifique — article de fond, these — n'est, &
notre connaissance, consacrée aux «apparences» dans la jurispru-
dence de la Cour européenne des droits de homme (du moins, en
langue frangaise). Plus étonnant encore, nulle entrée n’est réservée
aux capparences» dans les ouvrages des juristes de la Cour euro-
péenne relatifs a sa jurisprudence (5). Si cette lacune ne peut étre
reprochée aux ouvrages universitaires de référence en la matiére,
ceux-ci ne livrent pas pour autant des développements approfondis
a la question des «apparences».
La Cour européenne elle-méme ne nous renseigne guére plus. Son
[naheu) arrét Borgers c. Belgique, du 30 octobre 1991 (6), que l'on présente
dordinaire comme fondateur de la «théorie des apparences», se
borne a souligner «importance attribuée aux apparences ct a la
sensibilité accrue du public aux garanties d’une bonne justice» (§24)
mais n’énonce nullement une quelconque ¢théorie» et, si Varrét
Kress c. France du 7 juin 2001 fait bien mention de «la théorie des
apparencesy (§81), il se garde bien de l’énoncer (7), se contentant de
renvoyer & Borgers (préc.).
@)GATA., 16" éd., 2007, n° 110; AJD.A., 2001, n® 7-8, p. 675 , note
F. Roux; D., 2001, n° 32, chron, p. 261, J. ANDRIANTSIMBAZOVINA; ibid, jur..
p.2919, note R. Draco; J.C.P., 2001, n® 31-35, TI, 10578, note F. Supre
RF.D.A., 2001 n° 5, p. 991, obs. B. Genevors; ibid, p. 1000, obs. J.-L. Avrin et
F.Supre: R.7.D.B., 2001, p. 727, obs. F. Brnorr-Roumer; R.D.P., 2001, n° 4,
p. 983, obs X. Préror; L.P.A., 2001 n° 197, p. 17, note J.-F. FLauss; Rev. trim. dr.
h., 2002, n° 49, p, 223, note L. Sermer: A.J.D.A.. 2002, p. 9, obs. D. CHaBaxon
Gaz. Pal.. 5 octobre 2002, note G. Cou THAN
(4) P. Marrens, «La tyrannie de l'apparence», obs. sur Cour eur. dr. h.. 22 février
1996, Bulut c, Autriche, Rev. trim. dr. h., 1996, p. 627.
(5) V. BrRcER, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de Uhomme, Sirey
2007, 10° éd.; M. bE Sauvia, Compendium de la CEDH, Engel, 1998.
(6) Cour eur. dr. h., Borgers c. Belgique, 30 octobre 1991, in F, Supre, J.-P. Mar
avn, J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, A. GourreNomE, M. Leviner, Les Grands
arréts de la Cour européenne des droits de Vhomme, P.U.F., «Thémis», 5° éd., 2009.
cité G.A.C.B.D.H., n° 29.
(7) Voy., de méme, Cour eur. dr. h., Martinie c. France, Gde Ch., 12 avril 2006,
§03.
Frédéric Supre 635
3. Le mystére des capparences» semble done entier et, dans ces
conditions, on ne peut d’emblée poser comme postulat que les
«apparences» ont en droit européen une fonction protectrice, dés
lors que l’on ne sait pas vraiment ce que recouvre cette notion. Il
convient d’abord de partir la recherche des «apparences» dans la
jurisprudence européenne afin d’apprécier la place qu’elles y tien-
nent, le réle qu’elles y jouent. Partant des arréts précités, la recher-
che conduit naturellement, dans un premier temps, vers l'article 6,
§1*, et le droit a un proces équitable, mais il apparait rapidement
qu’elle ne saurait s’y limiter. Le domaine des «apparences» ne se
réduit pas, contrairement & une idée regue, au droit a un proces
équitable (8) et la diversité parait caractériser l'usage qu’effectue la
Cour de la mention des «apparences» dans ces arréts
Si l'on prend comme critére premier d’analyse les modalités du
recours par le juge européen a la mention des apparences, la matiére
peut étre ordonnée, sans prétendre 4 une quelconque exhaustivité,
autour de deux lignes directrices, selon que la Cour européenne
mentionne les apparences pour les dépasser ou pour s’y arréter.
Dans l'un et l'autre cas — dépassement des apparences, arrét sur les
apparences -, il conviendra de s’interroger sur les finalités poursui-
vies.
I. — Le dépassement des «apparences»
4. C’est la, a vrai dire, ’'usage principal que la Cour fait de la
notion d’«apparences», y ayant recours pour signifier qu’elle ne s'y
arréte pas. Ceci, au nom de l’exigence d’effectivité des droits — «la
Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou
illusoires, mais concrets et effectifs»(9) — qui commande la démar-
che du juge européen, soucieux de donner tout son effet utile aux
dispositions normatives de la Convention. Trés tét, dans l'un de ses
premiers arréts, Delcourt c. Belgique (préc.), la Cour affirme la néces-
sité de regarder «au-dela des apparences» afin de vérifier si «aucune
réalité» n’est contraire au droit garanti — en l’espéce le droit 4 un
procés équitable. Cette volonté de dépasser les apparences apparait
alors comme un leitmotiv qui parcourt l'ensemble de la jurispru-
dence européenne. D'une maniére générale, «la Cour s’estime tenue
de regarder au-dela des apparences et d’analyser les réalités de la
(8)Ceci_ nous a conduit a élargir 'intitulé initial de cette contribution
«Apparences et procés équitable»
(9) Cour eur. dr. h., Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, G.A.C.E.D.H., n° 2
ridh.ew
636 Rev. trim. dr. h, (79/2009)
situation litigieuse» (10). Le juge européen emprunte ainsi une
démarche réaliste et pragmatique, visant a l’effectivité du droit
garanti, et ancre sa jurisprudence a un principe de réalité. Se gar-
dant de juger in abstracto, le juge européen s’attache aux circons-
tances conerétes de la situation litigieuse «pour fonder son raison-
nement sur la réalité factuelle existante» (11).
Obéissant & ce principe de réalité, le dépassement des
«apparences» vise & élargir le champ d’application du droit garanti
et & approfondir le contenu de celui-ci.
A. ~ Blargir le champ d’application
du droit garanti
5. La volonté de ne pas s’arréter aux capparences» afin de favo-
riser 'applicabilité du droit garanti par la Convention est au cour
méme de la technique des «notions autonomes», qui a puissamment
contribué a réduire les zones d’inapplicabilité de la norme conven-
tionnelle et, partant, a renforcer 'effectivité des droits concernés,
principalement le droit & un procés équitable, le principe de la léga-
lité de délits et des peines, le droit de propriété. Il s’agit, pour la
Cour européenne, de retenir la définition qui lui semble la plus com-
patible avec «l’objet et le but de la Convention», afin de donner tout
leur effet utile aux notions en cause. Pour ce faire, le juge européen
opte pour une généreuse acception «matérielle», et non formelle, de
la dite notion, qui lui permet de dépasser le sens habituel que celle-
ci revét en droit national et de lui conférer une signification exten-
sive.
6. Si le lien entre le principe de réalité et l’interprétation
«autonome» est implicite dans les arréts fondateurs, Bngel (12) et
Kénig (13) — dans le premier la Cour reléve que Vindication fournit
par le droit interne quant a la qualification de infraction «n’a qu’une
valeur formelle et relatives et constitue un «simple point de départ»
(§82), dans le second elle note que «c'est en effet au regard non de la
qualification juridique mais du contenu matériel et des effets que lui
confére le droit interne de I’Etat en cause, qu’un droit doit étre con-
(10)Cour eur. dr. h., Sporrong et Lonnroth ¢. Suéde, 23 septembre 1982. §63,
G.A.C.B.D.H., 0° 65.
(11) P. Muzxy. La technique de proportionnalité et le juge de la Convention euro-
péenne des droits de Vhomme — Essai sur un instrument nécessaire dans une société
démocratique, P.U-AM., 2005, p. 511
(12)Cour eur. dr. h., Bngel c, Pays-Bas, 8 juin 1976, @.4.C.B.D.H., n° 4
(13) Cour eur. dr. h., Kénig c. R.F.A., 28 juin 1978, @.4.C.B.D.H. n° 4
Frédéric SuDRE 637
sidéré ou non comme étant de caractére civil au sens de cette expres-
sion dans la Convention» (§89) -, il est ensuite expressément revendi-
qué par la jurisprudence européenne. Plusicurs exemples significatifs
peuvent en étre donnés, que ce soit au titre du droit & un proces équi-
table ou du principe de la légalité des délits et des peines. S’agissant
de la notion d’«accusation» visée a l'article 6, §1°, la Cour affirme
dans son arrét Deweer c. Belgique, du 27 février 1980, que «la place
éminente que le droit 4 un procés équitable oceupe dans une société
démocratique» la conduit «a opter pour une conception ‘matérielle’, et
non ‘formelle’, de I’‘accusation’ (et) lui commande de regarder au-dela
des apparences et d’analyser les réalités de la procédure en litige»
(§44). En matiére de répression disciplinaire pénitentiaire, la Cour, en
formation solennelle, s’attache «par-dela les apparences et le vocabu-
laire employé [...] cerner la réalité», pour qualifier de «pénale» une
condamnation a des jours de détention supplémentaires (14). Confé-
rant a la notion de «peine» de l'article de la Convention une «portée
autonome» — est en cause un ordonnance de confiscation —, l'arrét
Welch c. Royaume-Uni, du 9 février 1995, est particuliérement net :
«Pour rendre efficace la protection offerte par l'article 7, la Cour doit
demeurer libre d’aller au-dela des apparences et d’apprécier elle-
méme si une mesure particuliére s’analyse au fond en une ‘peine’ au
sens de cette clause» (§27) (15).
7. Il parait superflu de préciser que le juge interne, qu'il soit judi-
ciaire ou administratif, s'est rallié 4 Vinterprétation «au sens de» la
Convention européenne des droits de 'homme délivrée par le juge
européen et a accepté de dépasser les «apparences» de son droit
interne pour réaliser l'extension du champ de protection de la
norme conventionnelle. La jurisprudence administrative d’applica-
tion de Varticle 6 en fournit un éloquent témoignage
B. — Approfondir le contenu
du droit garanti
8. Inhérente a l'ensemble de la jurisprudence de la Cour, la
démarche qui consiste a dépasser les apparences gouverne l’appré-
ciation portée par le juge européen sur la réalité des effets produits
par la décision ou la mesure incriminée afin d’établir si l’atteinte au
droit garanti est ou non compatible avec la Convention. Comme le
(14) Cour eur. dr. h., Heh et Connors c. Royaume-Uni, Gde Ch., 9 octobre 2003,
JC.P., G, 2004, 1, 107, n° 4, chron. F. SuDRE.
(15) Cour eur. dr. h., Jamil c. France. 8 juin 1995, §30; Coéme c. Belgique, 22 juin
2000, §145.
‘rtdh.ew
rtdh.eu)
638 Rey. trim. dr. h. (79/2009)
rappelle la Cour, elle «est appelée & vérifier si la maniére dont le
droit interne est interprété et appliqué produit des effets conformes
aux principes de la Convention» (16).
9. C’est, nous semble t-il, sur le terrain des garanties du proces
équitable que la Cour a, dans un premier temps, fait explicitement
mention de la nécessité d’aller au-dela des apparences. Dans son
arrét Delcourt (préc.), ayant & se prononcer sur le grief tiré de la
rupture de l’égalité des armes du fait de la participation du minis-
tére public au délibéré de la Cour de cassation en Belgique, le juge
européen, sans sous-estimer l’importance des apparences, décide de
rechercher «au-dela des apparences» quelle est la «réalité» de l’inter-
vention du ministére public et si celle-ci n’est pas «contraire» au
droit & un procés équitable ($31). La Cour choisit ainsi de privilégier
une analyse matérielle de l’intervention du ministére public, qui
met I’accent sur son «réle réel». I] convient ici de citer la motivation
de principe de l’arrét Vermeulen, reprise ensuite systématiquement
dans les arréts ultérieurs et, notamment, dans l’arrét Kress, du
7 juin 2001: «a Cour estime toutefois devoir attacher une grande
importance au réle réellement assumé dans la procédure par les
membres du ministére public et plus particuliérement au contenu et
aux effets de leurs conclusions. Elles renferment un avis qui
on autorité a celle du ministére public lui méme. Objectif
en droit, ledit avis n’en est pas moins destiné a conseiller
et, partant, influencer, la Cour de cassation. A cet égard, le Gou-
vernement souligne l'importance de la contribution du parquet
général au maintien de l'unité de la jurisprudence de la haute
juridiction» (§31) (17). Le eritére d’analyse décisif, pour le juge euro-
péen, de la compatibilité de ’intervention du ministére public avec
article 6, §1°", est un critére matériel déduit du «rdle réel» du
inistére public et du «poids» de ses conclusions. C'est cette
«réalité» qui conduit la Cour, dans son arrét Kress (§§74-76), a juger
que les conclusions du commissaire du gouvernement ne se situent
pas hors de la phase contradictoire du procés et doivent étre sou-
mises a la contradiction. La solution de la Cour relative a la com-
patibilité avec l'article 6, §1°", de la non communication préalable
(16) Par exemple, Cour eur. dr. h., Beyeler ¢. Italie, 5 janvier 2000.
(17) Cour eur. dr. h.. Vermeulen ¢. Belgique. 20 février 1996, R-D.I.D.C., 1996.3,
p. 235, obs. F. Dumox, R. Cuartes et E. Krixes; Rev, trim. dr. h., 1996, p. 621
obs, P. Lamnerr; J.C.P., @, 1997, 1. 4000, n° 19, chron, F, Supre: Lobo Machado
c. Porlugal. 20 février 1996, §29, R.T.D.L., 1997, p. 373, note F. Benoir-RouERr:
Van Orshoven c. Belgique, 25 juin 1997, §39; K.D.B c, Pays-Bas, 27 mars 1998, §43;
Kress c. France, préc.. §71.
Frédéric SupRE 639
des conclusions du commissaire du gouvernement n'est donc aucu-
nement fondée sur les «apparences), contrairement 4 ce que certains
commentaires approximatifs laissent croire.
10. Ce principe de réalité s'est finalement imposé au Conseil
@Etat frangais et a pris la forme, d’abord, de la codification de la
pratique de la note en délibéré (article R.731-5 du Code de justice
administrative) (18), ensuite de la nouvelle figure du rapporteur
public, dont les conclusions sont soumises au contradictoire. Désor-
mais, en effet, le sens des conclusions doit étre communiqué aux
parties avant la tenue de l’audience (articles R.711-3 et R.112-1 du
Code de justice administrative) et les avocats au Conseil peuvent
présenter de bréves observations orales aprés le prononcé des con-
clusions (art. R. 733-1 du Code de justice administrative) (19).
11. Le dépassement des «apparences» est également de mise sur
le terrain des droits substantiels. La Cour en fait mention expresse
s’agissant, par exemple, du droit a la liberté et a la siireté ou du
droit de propriété. Au titre de l'article 5, §1°", la Cour considére que
Vappréciation de la «régularité» d’une détention implique qu’il faut,
«par dela les apparences et le vocabulaire employé, s’attacher a cer-
ner la réalité» (20), ce qui la conduit juger que, en droit anglais,
la peine perpétuelle obligatoire ne constitue pas une «sanction a
perpétuité» répondant aux exigences de l'article 5, §1°. En matiére
de droit de propriété, la méme volonté de «regarder au-dela des
apparences et d’analyser les réalités de la situation litigieuse» per-
met, en l'absence méme de transfert de propriété ou de réglementa-
tion de l'usage des biens, de contréler les atteintes «a la substance
du droit de propriété», lorsque le droit de propriété, quoique juridi-
quement intact, est rendu précaire par les limitations apportées et
est en quelque sorte, en raison de l’incertitude permanente affectant
la situation juridique du bien, vidé de son contenu (21). Cette cons-
(18) Voy. F. Sure, «Vers la normalisation des relations entre le Conseil d’Etat
et la Cour européenne des droits de "homme. Le décret du 19 décembre 2005 modi-
fiant la partie réglementaire du code de justice administrative, R.F.D.A., 2006-2,
286,
(19) Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridic-
tions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, Voir.
B. Pacteav, «Du commissaire au rapporteur, suite... et & suivre!», R.F.D.A., 2009-
1, 67; P. Inovx, «Vers un redéploiement de la contradiction en droit administratif
frangais», A.J.D.A., 2009, 637.
(20) Cour eur. dr. h.. Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, §38: Stafford c.
Royaume-Uni, Gde Ch., 28 mai 2002, §64, J.C.P., @, 2002, 1, 157, n° 7, obs. F. SupRe.
(21) Cour eur, dr. h., Sporrong et Lonnroth c. Suede, 23 septembre 1982, §63,
GAC.B.D.H., n° 65.
640 Rev. trim, dr. h. (79/2009)
truction prétorienne permet, notamment, de sanctionner I'expro-
priation de fait qui, en l’'absence d’une expropriation formelle, prive
néanmoins les biens de toute disponibilité (22). Le juge interne, &
notre connaissance, ne parait pas avoir repris 4 son compte cette
notion d’atteinte «a la substance du droit de propriété».
12. La démarche conduisant a aller cau-dela des apparences»
nest toutefois pas systématique et la Cour européenne peut parfois
s'arréter aux apparences, nourrissant alors des critiques virulentes
sur sa propension & céder a «la tyrannie de l'apparence», pour
reprendre une formule imagée ~ mais fort excessive, selon nous (23)
Il. —- L’arrét sur les apparences
13. Si la jurisprudence européenne obéit & un principe de réalité,
étroitement lié a la notion d’effectivité des droits garantis, elle obéit
aussi a un principe d’équité, qui se combine au précédent. «Equité»,
du latin aequitas, signifie tout & la fois égalité, esprit de justice,
équilibre, pondération. L’équité parait s’opposer au droit strict, a la
lettre du droit et véhiculer la conception d’une justice qui n’est pas
inspirée par les régles du droit positif, faisant appel au sentiment
naturel du juste et de l'injuste. L’équité vient compléter, corriger,
harmoniser les régles de droit et, comme le dit Portalis, «{I/'équité
est le retour a la loi naturelle dans le silence, opposition ou l’obs-
curité des lois positives».
14. Ainsi entendue comme ce qui est juste et équilibré, l’équité
est 4 l'euvre, nous semble-t-il, — au moins implicitement ~ lorsque
le juge européen choisit de s’en tenir aux apparences et de fonder
sa décision de maniére déterminante sur les «apparences». I] appa-
rait naturel que le terrain de prédilection de cette maniére de faire
soit celui des conditions d’exercice du droit garanti, dés lors que,
dune maniére générale, le juge européen apprécie si «un juste
équilibre» a été ménagé entre les exigences de Vintérét général et la
sauvegarde des intéréts individuels. Mais le recours aux
«apparences» peut également jouer, quoique de maniére implicite,
aux fins de l'applicabilité du droit.
(22) Cour eur. dr. h., Papamichalopoulos c. Gréce, 24 juin 1993, §§41 et 43. J.C.P.,
1994, I, 3742, n° 35, obs. F. SUDRE
(23) P. Martens, op. cit
Frédéric SupRE 641
A. = Le recours implicite aux apparences
aux fing de Vextension de Vapplicabilité du droit
15. Deux domaines ~ le droit au respect de la vie familiale (arti-
cle 8 de la Convention), le droit de propriété (article 1°" du Premier
Protocole) — permettront d’illustrer cette hypothése.
Selon une jurisprudence bien établie, la notion de vie familiale est
entendue comme un lien de parenté auquel s’ajoute une relation
effective (24). Liarrét X, Y et Z c. Royaume-Uni, du 22 avril
1997 (25), marque un élargissement sensible du champ d’ application
de la «vie familiale», consacrant la reconnaissance sous ce titre de
relations de facto, en dehors de tout lien de parenté. La Cour euro-
péenne qualifie en effet de «liens familiaux de facto» les liens unis-
sant un transsexuel né de sexe féminin, sa compagne, et l'enfant de
cette derniére né par insémination artificielle par tiers donneur, se
fondant a la fois sur l'effectivité des relations et sur les
«apparences», qui semblent suppléer l’absence de parenté : sans faire
mention expresse des «apparences», la Cour note que X «méne une
vie sociale d’homme», assume «aux yeux de tous» le rdle de parte-
naire masculin, «se comporte a tous égards comme le ‘pére’ de Z»
(§§35-36). De la méme eau est larrét Wagner et J.M.W.L. c.
Luxembourg, du 28 juin 2007 (26), qui confirme que l’absence de lien
juridique ne fait pas obstacle a la «vie familiales, au sens de
larticle 8. Etait en cause le refus des juridictions luxembourgeoises
@aceorder lexequatur d’un jugement péruvien de 1996 pronongant
Yadoption pléniére par M™ Wagner d’une petite fille péruvienne, au
motif, conformément aux régles luxembourgeoises de conflits de
lois, que le jugement péruvien était contraire a l'article 367 du code
civil selon lequel une femme célibataire ne peut adopter pléniére-
ment. La Cour constate que M™ Wagner se «comporte a tous
égards comme la mére de la mineure depuis 1996» (§117) pour
reconnaitre l’existence de liens familiaux de facto. «Apparences» et
réalité sont ici en étroite osmose et commandent de ne pas faire pré-
valoir une application stricte de la régle de droit. Invoquant la pri-
mauté de l'intérét supérieur de l'enfant, la Cour reproche au juge
national d’avoir ignoré la «réalité sociale» de la situation des per-
sonnes concernées et considére qu’il ne pouvait «raisonnablement
refuser la reconnaissance des liens familiaux qui préexistaient de
facto entre les requérantes» (§135).
(24) Cour eur. dr. h., Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, @.4.C.B.D.H., n° 49.
(25) D., 1997, 582, note 8. GraraLour.
(26) J.C.P., G, 2007, I, 182, n? 9, obs. F. SupRE,
|rtdh.eu}
642 Rev. trim. dr. h. (79/2009)
16. En admettant que le «droit au respect de ses biens» peut étre
invoqué en l'absence d’un quelconque titre juridique, le juge euro-
péen retient une acception trés large du droit de propriété, a
laquelle participent les «apparences». Rappelant que la notion de
«biens» a une portée autonome et est «indépendante par rapport
aux qualifications formelles du droit interne», la Cour européenne
juge en effet, par son arrét de Grande Chambre Oneryildiz c. Tur-
quie, du 30 novembre 2004 (27), qu'une habitation de fortune cons-
truite en toute illégalité dans un bidonville a proximité d'une
décharge d’ordures et le fait d’y demeurer avec sa famille représen-
taient «un intérét économique substantiel» constituant en un «bien»
au sens de l'article 1°" du Premier Protocole. Pour ce faire, la Cour
semble analyser la tolérance implicite des autorités, qui a nourri
Yespérance du requérant «que la situation demeurat ainsi pour lui
et sa famille», comme une reconnaissance de facto de l'intérét patri-
monial du requérant tenant a son habitation de fortune ($127) (28).
17. Si l'on considére qu’il y a bien la un usage implicite des appa-
rences par le juge européen, il convient alors de se demander si cet
usage ne se situe pas aux confins de la théorie de Papparence, qui
fait produire des effets juridiques a I’égard des tiers a une situation
apparente contraire a la réalité juridique (29)... a cette différence
prés que, selon cette théorie prétorienne, lapparence fait naitre
directement des droits subjectifs au profit des tiers alors que, dans
le cadre de la Convention européenne des droits de homme, si elle
produit bien des effets 4 'égard des tiers, elle parait surtout jouer
a rebours en permettant a l'intéressé de se prévaloir lui-méme de la
situation apparente — de parent apparent (30), de propriétaire appa-
rent, dans les exemples précités — pour bénéficier de la protection
d'un droit garanti par la Convention. Mais, 4 l’instar de l’'apparence
trompeuse du droit interne, l'apparence de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de homme est bien «moyen d’adoucir
les effets rigoureux des normes juridiques, procédé d’adaptation du
droit aux réalités matérielles, facteur d’équité» (31).
(27) GAC.B.D.H., n° 64.
(28) Voy. aussi Cour eur. dr. h., Osman c. Bulgarie, 16 février 2006.
(29) Selon le Doyen Conv, «la seule apparence suffit @ produire des effets &
Végard des tiers qui. par suite d'une erreur légitime, ont ignoré la réalité» (Vocabu-
Inire juridique, P.U.F., 8° éd., 2000).
(30) Toutefois, dans les arréts X., Y., Z. et Wagner e.a., la situation de «parent
apparent produit également des effets juridiques au bénéfice de l'enfant
(31) M-N. Jonarp-BacueLiier, «Apparences, in Dictionnaire de la culture juridi-
que (dir. D. ALLAND et 8. Rusts), P.ULF., 1 éd., 2003.
Frédéric Supre 643
18. L’usage des apparences A cette fin par la Cour européenne est
patent pour l'appréciation des conditions d’exercice du droit.
B. -— L'utilisation expresse des apparences
aux fins d’une application «juste» du droit
9. Mettant l'accent sur «la confiance que les tribunaux d’une
société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable» (32), la
Cour européenne s’est montrée réceptive & l'adage Justice must not
only be done, it must be seen to be done», quelle cite expressément,
pour la premiére fois semble-t-il, dans son arrét Delcourt de 1970 stdh.eu)
(prée., §31) (33), pour apprécier le respect des garanties du proces
équitable. Mais, a vrai dire, le juge européen fait un usage limité de
cette «théorie des apparences». Soit qu'il procéde & une pondération
des apparences, soit qu'il n’utilise les apparences que par défaut.
1. Les apparences pondérées
20. Terres d'origine de la théorie des apparences, I’indépendance
et l'impartialité du tribunal sont le siége principal du recours aux
apparences dans la jurisprudence européenne. L’exigence d’une jus-
tice «qui se donne a voir» est ici essentielle. La jurisprudence euro-
péenne est bien établie et l'on peut, briévement, systématiser la
démarche de la Cour, similaire en matiére d'indépendance et
d'impartialité — les deux notions étant «étroitement liées» aux yeux
du juge européen (34) ~, autour de trois propositions (35) :
—au-dela des garanties statutaires, les apparences ont de l'impor-
tance et il convient de savoir s'il y a ou non apparence d’indépen-
dance ou d’impartialité du tribunal;
~ pour ce faire, le point de vue subjectif de lintéressé entre en ligne
de compte mais ne joue pas un réle décisif;
(82) Parmi d'autres, Cour eur. dr. h., Remli c, France, 23 avril 1996, §48, Rev. se
crim., 1997, 473, obs. R. Korrina-Jouuin.
(33) Pour un autre exemple, Cour eur. dr. h., Campbell et Fell c. Royaume-Uni,
28 juin 1984, §81
(34) Voy. Cour eur. dr. h., Findlay ¢. Royaume-Uni, 25 fevrier 1997, §73.
(35) Pour des développements plus conséquents, le lecteur peut se reporter a notre
ouvrage, Droit européen et international des droits de Uhomme, P.U.F., «Droit
fondamental», P.U.F., 9° éd., 2008, n® 214.
644 Rev. trim. dr. h. (79/2009)
— «élément déterminant consiste 4 savoir si les appréhensions de
Vintéressé peuvent passer pour objectivement justifiées» (36).
Ainsi entendue, la théorie des apparences ne fait pas prévaloir,
contrairement & une opinion qui pour étre communément répandue
n’en est pas moins sommaire, «la subjectivité des individus sur la
régle de droit telle qu’elle est écrite et mise en cuvre» (37) mais
prend soin de pondérer l'impression subjective du justiciable par
des «faits vérifiables» qui autorisent a suspecter l'indépendance ou
Vimpartialité du juge (38).
21. Se dégagent ainsi de la jurisprudence européenne, pour nous
en tenir l’essentiel, deux lignes de force.
D’une part, les justiciables peuvent nourrir des doutes objective-
ment fondées sur l'indépendance du tribunal lorsque celui-ci compte
parmi ses membres un juge «se trouvant dans un état de subordina-
tion de fonctions et de services par rapport & l'une des parties» (39)
ou ayant des «relations étroites», sans étre pour autant de subordi-
nation hiérarchique, avec l'une des parties au litige (40). C'est ainsi
que, sur le fondement des «apparences», la Cour européenne constate
le défaut d’indépendance de la section du contentieux du Conseil
d’Etat frangais du fait que l'un de ses membres, ayant siégé lors du
délibéré d’un arrét rendu dans le cadre d’une procédure dirigée con-
tre le ministére de l'économie et des finances, a été nommé un mois
plus tard secrétaire général de ce ministére (41).
D’autre part, la conception coneréte de l'impartialité objective
adoptée par le juge européen conduit ce dernier a ne pas prohiber
par principe le cumul de fonctions successives par un magistrat —
cumul de fonctions juridictionnelles, cumul de fonctions consultati-
ves et juridictionnelles ~, sous réserve du caractére plus ou moins
approfondi des investigations menées par le juge avant le jugement,
en bref, sous réserve qu’il ne se soit pas forgé un «préjugé». Ainsi,
;6) Par exemple, Cour eur. dr. h., Incal c. Turquie, 9 juin 1998, §71
(indépendance); Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, G.A.C.E.D.H., n° 30, §48
(impartialité),
(37)S. Ganpreau, «La théorie de lapparence en droit administratif : vertus et ris
ques de importation dune tradition de Common law», R.D.P., 2005, p. 347.
(38) Cour eur. dr. h., Hausehildt, préc., $48.
(39) Cour eur. dr. h., Sramek, préc., §42
(40) Par exemple, Cour eur. dr. h., Langborger c, Suéde, 22 juin 1989; Thaler c.
Autriche, 3 février 2005.
(41) CE. (fr.), Sacilor-Lormines ¢. France, 9 novembre 2006, §68, R.F.D.A., 2007,
342, obs. J.-L, AvrIN et F. SuDRE.
Frédéric Supre 645
dans affaire Sacilor-Lormines (arrét précité), la dualité des fone-
tions consultatives et juridictionnelles du Conseil d’Etat est jugée
compatible avec l’exigence d’impartialité dés lors que l'objet de
Vavis consultatif et de la décision contentieuse ne concernent pas la
«méme décision», la «méme affairen ou des «questions analogues»
mais portent sur une «question distincte», notion entendue au
demeurant souplement (§§73-74).
Constatons alors que la jurisprudence interne s'est montrée par-
ticuliérement réceptive & cette pondération des apparences et que,
tant en matiére d’indépendance que d’impartialité, la Cour de cas-
sation comme le Conseil d’Etat reprennent a leur compte la concep-
tion européenne de l'apparence d’indépendance et d’impartia-
lité (42).
22. C'est également cette méthode de la pondération des appa
rences qui est a l'euvre, selon nous, & propos d’une autre garantie
du procés équitable, le droit 4 un tribunal, et, plus précisément
droit d’obtenir une décision de justice motivée, qui en est un é
ment. Sila Cour, dans son arrét Taxquet c. Belgique du 13 janvier
2009 (43), juge incompatible avec l'article 6, §1"", absence de moti-
vation des arréts d’assises, e’est parce que «l’impression d’une jus-
tice arbitraire et peu transparente» donnée a l’accusé par une déci-
sion non motivée est objectivement confirmée par limpossibilité, de
fait, de connaitre «les raisons conerétes» justifiant le verdict de cul-
pabilité ou d’innocence, en raison des «réponses laconiques» du jury
4 des «questions formulées de maniére vague et générale» ($48).
23. I reste & évoquer les apparences «qui fachent», celles qui con-
duisent a juger que la participation du commissaire du gouverne-
ment au délibéré du Conseil d’Etat enfreint le principe d’égalité des
armes.
2. Les apparences par défaut
24. Il est des domaines, mais dont on notera qu’ils sont étrangers
a la terre d’élection de la théorie des apparences ~ indépendance et
impartialité du tribunal -, ou la Cour européenne fonde de maniére
décisive son appréciation de l’atteinte alléguée au droit garanti sur
le sentiment subjectif du requérant. Les apparences nourrissent ici
une présomption d’inconventionnalité que I’Etat défendeur ne par-
(42) Voy. Ia jurisprudence citée in F. SupRE, op. cit., n° 214-4.
(43) J.C.P., G, 2009, act. 200, obs. M.-L. Rassat; D., 2009, 1058, note
J.-F, Renucet
[rtdh.eu
[rtdh.ew
646 Rev. trim. dr. h. (79/2009)
vient pas & renverser, faute de «faits vérifiables» permettant d’éta-
blir que le droit en cause n'est pas méconnu. C’est donc par défaut
que les apparences déterminent la décision du juge européen
25. a) C’est dans cette perspective, nous semble t-il, qu’il convient
Wapprécier la logique du recours a la «théorie des apparences» dans
la jurisprudence Kress (44). La Cour européenne condamne pour vio-
lation de l’égalité des armes la participation (et la présence) du com-
missaire du gouvernement au délibéré sur le fondement d’une analyse
matérielle qui, on I'a vu (supra, n° 9), s’attache «au réle réellement
assumé dans la procédure par le commissaire du Gouvernement et
plus particuliérement au contenu et aux effets de ses conclusions»
(Kress, §71). Das lors que les informations sur la réalité du fonction-
nement du délibéré, et notamment sur le réle réel qu’y tient le com-
missaire du gouvernement, sont «invérifiables» (45), le critére matériel
conduit la Cour, pour apprécier la participation du commissaire du
gouvernement au délibéré, & mobiliser la «théorie des apparences» et
4 retenir une conception du procés équitable marquée par
«importance accordée aux apparences et a la sensibilité accrue du
public aux garanties d’une bonne justice», issue de son arrét
Borgers (46). Ayant publiquement pris parti sur le rejet ou l'accepta-
tion des moyens présentés par les parties, le commissaire du gouver-
nement apparait comme «/'allié ou Padversaire objectify de l'une des
parties ct sa présence au délibéré, en lui offrant «fat-ce en apparence,
une occasion supplémentaire d’appuyer ses conclusions [...] a ’'abri de
la contradiction», peut faire naitre un «sentiment d’inégalité» chez le
plaideur quand le commissaire du gouvernement a conclu dans un
sens défavorable & ses prétentions (§§81-82).
26. Le recours aux «apparences» trouve ainsi sa source dans
Vincertitude attachée au réle réel joué par le commissaire du gou-
vernement dans le délibéré et il faut convenir que les explications
variables fournis a ce sujet par les membres de la juridiction admi-
nistrative ne pouvaient qu’entretenir le doute. La position officielle
selon laquelle le commissaire du gouvernement n’intervient qu’avec
«une grande modération» dans le délibéré (47) est quelque peu con-
(44) Sur le fond, nous renvoyons & nos observations critiques. citées note 3.
(45) F. Rona. op. cit., p. 681
(46) Cour eur. dr. h.. Borgers c. Belgique, 30 octobre 1991, G@.4.C.B.D.H., n° 28.
(47) L’analyse du Président Openr («Le commissaire du Gouvernement assiste au
délibéré; il peut y intervenir, il est d’usage qu'il le fasse avec modération», Cours de
contentieux administratif, Les Cours du droit, 1982, p. 1231) est constamment reprise
(par exemple, R. Apranam et J.-Cl. Bontcuor, op. cit.; B. Genevors, «La situation
au Conseil d’Etat», op. cit., p. 195)
Frédéric SupRE 647
tredite par affirmation, émanant d’un membre du Conseil d’Etat,
qu’il y a cun droit de parole du commissaire du gouvernement au
délibéré», que sa participation «est inversement proportionnelle & la
formation de jugement», et que devant les tribunaux administratifs
la pratique est «certainement celle d’une participation active du
commissaire au délibéré» (48). De méme, la note du président de la
Section du contentieux du 23 novembre 2001 cultivait l'ambigiiité
en ce qwelle précisait que, si le commissaire du gouvernement ne
devait pas «prendre Vinitiative de demander la parole», il pouvait
néanmoins répondre a des demandes de précisions. En disposant
que, «sauf demande contraire d’une partie, le commissaire du gou-
vernement assiste au délibéré [et] n'y prend pas part», le nouvel
article R 733-3 du Code de Justice administrative, issu du décret du
I aot 2006 modifiant la partie réglementaire du Code, fournit,
selon nous, au juge européen les assurances qui faisaient défaut
quant au rdle réel du commissaire du gouvernement lors du délibéré
et, levant toute incertitude sur ce réle, ne laisse plus place aux
éapparences».
27. Au bout du compte, se dévoile le malentendu qui entoure la
«théorie des apparences»: les uns attendent que la Cour fasse la
démonstration rigoureuse que les défauts apparents attribués @ un
systéme juridictionnel national sont contraires aux principes du
procés équitable; le juge européen attend que I’Etat partie fasse la
démonstration que ces défauts apparents n’existent pas en réalité et
que celle-ci est compatible avec les principes du proces équitable.
Mais il reste que la logique du recours aux «apparences» ainsi établie
est trés formaliste et aboutit 4 une solution éminemment critiqua-
ble, reposant sur une conception univoque de l’équité du proc
envisagée selon la seule perception du justiciable, dont on n’est pas
certain qu'elle contribue & «une bonne administration de la justice»
mais dont on est sir qu’elle malméne le principe de subsidiarité en
sanctionnant des institutions solidement ancrées dans une tradition
juridique nationale — ministére public prés la Cour de cassation,
commissaire du gouvernement prés le Conseil d’Etat — qui du seul
fait de leur caractére insolite ne s’écartaient pas pour autant du
standard commun du procés équitable.
28. b) La «théorie des apparences» remplit done, selon nous, la
fonction d’une présomption simple d’inconventionnalité. Cette ana-
(8) R. Apranay, in 1. Pree et F. SupRE (dir.), Le ministére public et les exi-
gences du proces équitable, Bruylant-Nemesis, coll, «Droit et justice», 2003, n° 44.
pp. 223-224
[rtdh.ou|
648, Rev. trim. dr. h. (79/2009)
lyse trouve une confirmation inattendue ~ car se situant hors du
droit & un procés équitable -, dans les développements récents de
la jurisprudence européenne relative au droit @ la non-discrimina-
tion.
Ayant & connaitre, dans son arrét Baczkowski e.a. c. Pologne, du
3 mai 2007 (49), du refus des autorités municipales de Varsovie
dautoriser une manifestation favorable l’homosexualité, la Cour
européenne, raisonnant par analogie, mobilise audacieusement la
«théorie des apparences». Considérant que les apparences peuvent
avoir une certaine importance dans les procédures administratives
oi les autorités exécutives prennent des décisions concernant la
liberté de réunion et d’association, la Cour juge «qu'il est raisonna-
ble de supposer que opinion du maire a eu une influence sur le pro-
cessus décisionnel et a en conséquence porté atteinte au droit des
requérants A la liberté de réunion d’une maniére discriminatoire»
(§109) (50).
29. Le recours exprés aux «apparences» conduit ainsi la Cour a
abandonner le critére classique de la preuve «au-dela de tout doute
raisonnable», selon lequel il appartient en principe au requérant
alléguant une discrimination de prouver l’existence d'une différence
de traitement et au gouvernement défendeur d’en démontrer la jus-
tification, et a opérer un transfert de la charge de la preuve. Cette
décision s’inscrit 4 l’évidence dans une nouvelle ligne jurispruden-
tielle, qui voit le juge européen, en matiére de discriminations
«directes», recourir 4 une présomption de discrimination, fondée
implicitement sur les «apparences», qu'il incombe a I'Etat de ren-
verser. Cette solution, retenue en premier lieu lorsque des autorités
administratives, policiéres ou judiciaires ont eu une «attitude globa-
lement discriminatoire», révélée par des commentaires ou déclara-
tions tendancieux a caractére raciste (51), est généralisée par larré
E.B c. France, du 22 janvier 2008, rendu en Grande Chambre, ot
la Cour reléve que I’Etat défendeur n’a pas été en mesure de pro-
duire des informations statistiques permettant d’établir que le motif
tiré de l'absence de référent paternel justifiant le refus d’agrément
(49),7.6.P., @, 2007, I, 182, n° 13, obs. F. Supre.
(50) Dans des déclarations antérieures, le maire de Varsovie avait estimé que
«faire de la propagande au sujet de I’homosexualité ne revenait pas a exercer le droit
4 la liberté de réunion».
(51) Cour eur. dr. h., Timishev c, Russ
26 juillet 2007; Petropoulou-Tskiris c. G
, 13 décembre 2005; Cobzaru c. Rowmanie,
6 décembre 2007.
Frédéric Supre 649
& l’'adoption opposé & une homosexuelle n’est pas discriminatoire
(§74) (52).
30. Se situe la, dans la fonction d’une présomption simple d’une
inconventionnalité — particuliérement en matiére de droit a la non
discrimination — les potentialités d’un usage dynamique, pour l’ave-
nir, de la théorie des apparences par le juge européen.
31. Au terme de cette mise a plat, pour ne pas dire de cette
démystification, des «apparences», nous serions tentés de dire qu'il
ne faut pas... céder aux apparences
La fameuse «théorie des apparences» ne gouverne pas la jurispru-
dence européenne et, a vrai dire, nous ne trouvons pas trace dans
le corpus jurisprudentiel d’une quelconque «théorie» des apparences.
Nulle construction intellectuelle, nulle élaboration doctrinale ou
réflexion systématique du juge européen en la matiére. Les appa-
rences ne tiennent, somme toute, qu’une place modeste dans la
jurisprudence de la Cour européenne et il nous semble qu’il faut
moins parler de la théorie que de la technique des apparences. La
technique des apparences est un instrument, parmi d’autres, mais
avec un champ d’application réduit, de linterprétation finaliste pri-
vilégiée par la Cour européenne des droits de homme. Ayant pour
seule fin la recherche de leffectivité du droit protégé par la Con-
vention, le juge européen instrumentalise les «apparences» dans un
jeu ambivalent. Ainsi qu’on I’a vu, l’extension du champ d’applica-
tion d’un droit garanti comme le renforcement des conditions
d’exercice de ce droit sont réalisés aussi bien par le dépassement des
apparences que par le recours aux apparences.
32. Sans doute faudrait-il aller plus avant, ce que n’autorise pas
le volume limité de cet article, ct s’interroger sur le réle des appa-
rences dans la motivation des arréts de la Cour (53). Si l'on consi-
dére, suivant Perelman (54), que la motivation de la décision de jus-
tice remplit une fonction de légitimation, tout a la fois du juge et
de sa décision, il apparait assez clair que la mention des
«apparences» ~ que ce soit pour les dépasser ou s'y arréter — permet
(52) Gour eur, dr. h., £.B. ¢. France, Gde Ch., 22 janvier 2008, J.C.P.
II, 10071, note A, Gourrenome et F, Supre.
(53) F. Supre, «La motivation des décisions de la Cour européenne des droits de
Vhomme», in H. Rurz-Fawrt et J.-M. Soret (dir.), La motivation des décisions des
juridictions internationales, Pedone, 2008, p. 171
(54)C. Perteman et P. Forters (dir.). La motivation des décisions de justice,
Bruylant, 1978; C. Peretman, Logique juridique, Nouvelle rhétorique, Dalloz 1999,
n® 81-82
1008,
650 Rev. trim. dr. h. (79/2009)
au juge européen, en faisant état dans son raisonnement de consi-
dérations non strictement juridiques — réalité sociale, équité, dimen-
sion subjective — non seulement de justifier in concreto sa décision,
mais aussi, plus largement, de susciter l'adhésion des individus
bénéficiaires de la protection de la Convention et de réaliser
Vancrage de la Cour européenne dans la «société démocratique»
européenne
L’usage des «apparences» par la Cour européenne des droits de
homme donne, paradoxalement, raison 4 l'un de ses contempteurs
les plus sévéres, le Doyen Carbonnier, dont on détournera le
propos: le droit de la Convention européenne des droits de homme
«est trop humain pour prétendre a l'absolu de la ligne droite» (55)...
axa
BONNIER, Flexible droit, L.G.DJ., 8° 6
. 1995, p. 12
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- States of Exception Law History Theory 2020Document229 pagesStates of Exception Law History Theory 2020Alexandru V. CuccuNo ratings yet
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Moral Discourse and Practice Some Philosophical ApproachesDocument536 pagesMoral Discourse and Practice Some Philosophical ApproachesAlexandru V. Cuccu100% (1)
- Loyalty Nomos LivDocument311 pagesLoyalty Nomos LivAlexandru V. Cuccu100% (3)
- African Oral Epic Poetry Praising The Deeds of A Mythic Hero PDFDocument323 pagesAfrican Oral Epic Poetry Praising The Deeds of A Mythic Hero PDFAlexandru V. Cuccu100% (2)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- Bourgeois Nightmares Suburbia 1870 1930Document273 pagesBourgeois Nightmares Suburbia 1870 1930Alexandru V. Cuccu100% (1)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5811)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- (Carl Newell Jackson Lectures 1974.) Romilly, Jacqueline de - Magic and Rhetoric in Ancient Greece (1975, Harvard University Press) PDFDocument116 pages(Carl Newell Jackson Lectures 1974.) Romilly, Jacqueline de - Magic and Rhetoric in Ancient Greece (1975, Harvard University Press) PDFAlexandru V. CuccuNo ratings yet
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Secular Bodies, Affects and Emo - Monique ScheerDocument273 pagesSecular Bodies, Affects and Emo - Monique ScheerAlexandru V. CuccuNo ratings yet
- The First German Philosopher: Cecilia MuratoriDocument351 pagesThe First German Philosopher: Cecilia MuratoriAlexandru V. Cuccu100% (2)
- Tom Lutz - Crying - The Natural and Cultural History of Tears (1999, W.W. Norton & Company)Document175 pagesTom Lutz - Crying - The Natural and Cultural History of Tears (1999, W.W. Norton & Company)Alexandru V. Cuccu100% (1)
- Wayne State University Press Discourse: This Content Downloaded From 128.250.144.144 On Fri, 23 Sep 2016 02:34:20 UTCDocument31 pagesWayne State University Press Discourse: This Content Downloaded From 128.250.144.144 On Fri, 23 Sep 2016 02:34:20 UTCAlexandru V. CuccuNo ratings yet
- Summers 1976Document53 pagesSummers 1976Alexandru V. CuccuNo ratings yet
- Adrian Rezus WT Projects 20180620Document5 pagesAdrian Rezus WT Projects 20180620Alexandru V. CuccuNo ratings yet
- Dr. Josef Schächter Auth. Prolegomena To A Critical GrammarDocument180 pagesDr. Josef Schächter Auth. Prolegomena To A Critical GrammarAlexandru V. CuccuNo ratings yet
- Bator 1963Document89 pagesBator 1963Alexandru V. CuccuNo ratings yet
- Anuar Odobleja 2012-2013 PDFDocument296 pagesAnuar Odobleja 2012-2013 PDFAlexandru V. CuccuNo ratings yet
- Lequyer's Hornbeam LeafDocument5 pagesLequyer's Hornbeam LeafAlexandru V. CuccuNo ratings yet