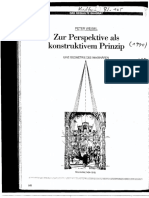Professional Documents
Culture Documents
Weibel - ARNULF RAINER
Weibel - ARNULF RAINER
Uploaded by
JL Ursum0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views4 pagesWeibel - ARNULF RAINER
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentWeibel - ARNULF RAINER
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views4 pagesWeibel - ARNULF RAINER
Weibel - ARNULF RAINER
Uploaded by
JL UrsumWeibel - ARNULF RAINER
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 4
ADVbEY- I», Gulure Stavls Cr.)
Pasty
Arnulf Raine , Facefaress, od pres
ARNULF RAINER
FACEFARCES, BODYPOSES 1968-1975
(1997)
oles Feifenaayaben
15 MAI—7 JUIN 1975
GALERIE STADLER
75006 PARIS, 51, RUE DE SEINE, TEL. 32691-10
Oo
O
Selon un théoréme trouvé dans [histoire du style des mouvements humains,
attitude d'une personne est l'expression de mouvements qui lui ont &é inculqués ;
done une position de base donne en quelque sorte la clef de tout un systéme gym-
nique, de méme que les premiéres « actions de photoreprésentation » (1955) d’Arnulf
Rainer révélent certaines étapes et certaines dimensions de I'évolution de son couvre
qui gravite autour de la psychophysique, c'est-a-dire de I'évolution de. son auto-
communication. Celle-ci est en méme temps une autocommunication de la peinture
elle-méme qui, par conséquent, dévolle, derrlére sa ‘subjectivité, des enchainements
objectifs. Ces photos montrent Rainer dans la pose d'un homme raide mort et sont
en partie recouvertes de couleur noire comme par un nuage sombre. Elles contiennent
done en essence sa période informelle, ses « peintures-écrans ~ et « peintures-
masques » qui l'occupent depuis 1952, ainsi que ses « peintures corporelles » et ses
« autopeintures » des expériences qu'il réalisa de 1967 & 1968 mais que, mécontent,
il abandonna rapidement. Elles anticipent sur son évolution ultérieure ol 'expressivité
picturale (dite abstraite) fait place & l'expressivité corporelle (dite coneréte), qu'il
pratique depuis 1969 dans ses jeux physiognonomiques de photomaton, ses Face-
Farces, ses « actions représentatives de corps photographiés » et soulignés par des
accents graphiques.
‘Ainsi, aprés une longue période od le corps avait été effacé et recouvert de
peinture — obscurcissement de l'image —, il ressurgit sur la toile et on assiste donc &
tune transformation décisive de l'idée de tableau. En effet, Rainer ne se contente
pas Individuellement de déclarer la fin de la peinture figurative comme dans ses
« peintures-écrans », mais, en incorporant un nouveau systéme linguistique (le corps)
au systéme linguistique (encien) de image, il met en relation réciproque deux sys-
témes de signes différents : le langage de l'image et le langage du corps. II peut se
le permettre parce que les deux systémes sont tout d'abord rattachés l'un & l'autre
par la main et ses facultés gestuelles, par la main, qul agit comme un opérateur entre
le monde conceptuel de 'image et le monde behavioriste du corps.
Le trait, résultat @ deux dimensions d'un acte gestuel @ quatre dimensions, le
trait, dont la surcharge exagérée arrivait autrefois € masquer une toile jusqu'é en
faire une surface la plupart du temps uniformément noire, ce trait est maintenant
transposé dans un autre cadre de références qui est plus grand que la tolle et dane
lequel la gestualité du corps peut devenir visible. Or, avant de s'étendre au corps
tout entier, cette gestualité était limitée au visage et a sa mimique. Par un autre
médium, la photographie, elle s'est ensulte replacée & nouveau dans un cadre de
références @ deux dimensions. Le remaniement graphique raméne finalement cet art
corporel au médium de la peinture,
Cette médiatisation de la peinture par le corps et la photographie transforme
par conséquent la peinture en une « métapeinture » qui supprime T'illusion de Ia totle
vide grace a laquelle la peinture figurative pouvait prendre la nature comme toile
O
©
(et comme exemple). Usons d'une métaphore : la peinture figurative cachalt que c'est
"homme qui dort sous la surface peinte, couvert par cette surface. (II dort m&me sous
{a tolle vide.) Tandis que ia métapeinture, en « reproduisant » les mécanismes de
reproduction, dévolle, derriére tous ses produits, la souffrance de l'homme en train
de «reproduire ». Ces transformations d'un médium en un autre, qui permettent &
tune Photo de servir de toile, font que le corps, pour parler approximativement,
devient objet de mystification (un métacorps 7) ; ou encore en langage mathématique,
un symbole, c'est-é-dire une variable, dont le champ de valeurs englobe virtuellement
tous les corps et tous les mouvements expressifs de l'évolution humaine.
Les signes graphiques sur la toile ne sont en effet que des images de I'expres-
sion, qu'on interpréte done uniquement comme des signes d'une expressivité définie +
Par exemple, des tachismes exécutés avec minutie et lenteur peuvent étre interprétés
comme une expression de spontanéité et de rapidité, les signes corporels, au
contraire, comme nous lindique déjé allusion étymologique contenue dans le mot
« émotion », sont les mouvements expressifs eux-mémes : un geste rapide de la main
Par exemple ne peut, en aucun cas, étre interprété comme une expression de lenteur
On passe donc de l'image représentée a l'action représentative elle-méme.
Si Rainer a pu convertir les principes de sa peinture et de son graphisme en
mouvements expressifs du corps, si la peinture @ pour ainsi dire été noyée dans le
langage corporel, ce n'est que parce que le langage corporel est le fondement de la
création plastique et que l'art graphique a son origine dans le geste. Cette interpré-
tation peut s‘appuyer sur I'hypothése que la conception rainerienne de la peinture :
| peinture est une forme visuelle d'une conscience intellectuelle » (1952), ne peut
Stra formulée que dans un contexte identique celui ol e'édifie linterpretation que
Je viens de définir mais également sur le fait que Rainer ne trevaille presque jamais
directement avec son corps devant un public, comme les autres artistes de l'art
corporel
Dans sa recherche plastique sur l'origine de l'art plastique et dans son effort
Pour continuer & développer les langages de 'expression, Rainer rencontre, par
Vintermédiaire du langage corporel, le langage animal comme une étape et une
condition préalable au langage humain. De méme que, derriére la pelnture, se démas.
Guait le geste, de méme, derriére l'histoire de la culture de homme, surgit celle de
2 nature. Sur ces bases, Rainer développe, @ partir de la grammaire finle du corps,
Je vocabulaire infini de la communication corporelle.
Les primitif se peignent le corps et les animaux utilisent des exagérations
mimiques pour parvenir & souligner et a différencier leurs mouvements d'expression
ainsi que leur maniére de se comporter. Ainsi dans les surcharges graphiques de
Ses actions de photoreprésentation — accentuations et différenciations — Rainer
urilise dee techniques de rritualisation analogues, qui incluent, outre ea fagon de
YL
)
souligner un mouvement par des couleurs et des traits, de prendre des mouvements
‘en modifiant leur orientation et en les transposant aussi bien dans le langage animal
que dane le langage de la plastique corporelle qui lui est propre. Ces techniques
révélent la fonction symbolique de l'expressivité, @ laquelle il faut ramener aussi le
grand nombre de mouvements intentionnels, c’est-a-dire des séquences de mouve-
ments non menés @ leur achévement, et le grand nombre de mouvements sans
objet qui font partie du répertoire de Rainer. N'y aurait-il pas par haserd, dans le
déroulement de mouvements dirigés vers un but, un autre: développement de la
gestualité rainerienne ?
En établissant une connexion enire Ie langage de l'image et le langage du corps,
Rainer a attoint le but qu'il s’était fixé en 1952, en proclamant qu'il voulait « par
exemple de la peinture, quitter ce monde et sa culture, et dévoiler la peinture par
elle-méme ». Ains| ouvre-t-il un discours qui vise & élargir les possibilités plastiques
et créatrices de homme. N’est-il pas alors présomptueux de crier au scandale, quand
‘on introduit en fraude, dans les expositions tachistes, des ceuvres peintes par des
singes ?
Traduit de |I'allemand par H. FEHDI.
Peter WEIBLE, Vienne 1978.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Weibel - KUNST ALS KRIMINDocument16 pagesWeibel - KUNST ALS KRIMINJL UrsumNo ratings yet
- Weibel - ZUR GESCHICHTE TEIL3Document9 pagesWeibel - ZUR GESCHICHTE TEIL3JL UrsumNo ratings yet
- Weibel ZUR PERSPEKTIVEDocument12 pagesWeibel ZUR PERSPEKTIVEJL UrsumNo ratings yet
- Weibel ZUR PERSPEKTIVEDocument12 pagesWeibel ZUR PERSPEKTIVEJL UrsumNo ratings yet
- Weibel - ZUR GESCHICHTE TEIL3Document6 pagesWeibel - ZUR GESCHICHTE TEIL3JL UrsumNo ratings yet
- Weibel - KUNST AUS DERDocument2 pagesWeibel - KUNST AUS DERJL UrsumNo ratings yet