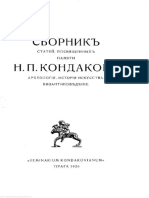Professional Documents
Culture Documents
Vasiliev 41
Vasiliev 41
Uploaded by
Homo Byzantinus0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views10 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views10 pagesVasiliev 41
Vasiliev 41
Uploaded by
Homo ByzantinusCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 10
mas‘ipt 41
raconté que les Riim avaient représenté dans certaines de leurs églises
dix Musulmans célébres par leur vaillance, leur héroisme, leurs
exploits guerriers chez les Chrétiens et leur stratagémes. Parmi
eux était homme que Mu‘awiya envoya pour s‘emparer par ruse
d'un patrice 4 Constantinople et qui le ramena prisonnier ; aprés
quoi Mu‘awiya frappa le patrice en vertu de la loi de talion (1)
et le renvoya & Constantinople. Les autres Musulmans représentés
sont ‘Abdallah al-Battal (*), ‘Amr b. ‘Ubaid Allah, ‘All b. Yahya
al-Armani, al-"Irbid (*) b. Bakkar, Ahmad b. Abi Qutaifa (Qati‘a),
Carbéas le Paulicien (Qarbiyas al-Bailagini), maitre de la ville
d’Abriq (Téfriké-Divrigi) | , aujourd'hui aux Rim, patrice des
Pauliciens et mort en 249 (24 févr. 863 - 12 févr. 864) (4), Chry-
socheir (HL. r. s. har. s) (fils de la) sceur de Carbéas, l'eunuque Yiza-
man a la téte de son cortége avec ses hommes autour de lui, et
Abi'l-Qisim b. ‘Abd al-Baqi (®). Nous avons décrit ailleurs la
doctrine et les croyances des Pauliciens ; c'est une doctrine inter-
médiaire entre celle des Chrétiens et celle des Zoroastriens. Ils sont
aujourd'hui, en 332 (4 sept. 931-23 aodt 944) rentrés dans le
sein de I'Eglise grecque. Nous avons raconté en détail leur histoire
dans notre livre des « Annales historiques ».
VIII, 146.
Cette année 1a (281 : 13 mars 894 - 1 mars 895) Tugg b. Subaib
bib) (*) pére de I'Ihid qui est actuellement, en 332 (4 sept.
943 - 23 ait 944) souverain d’lgypte, partit de Damas a la tete
d'une armée nombreuse et entra a Tarse pour faire de 1& une expé-
(2) Pour venger un outrage qu'il avait fait subir & un prisounier musulman,
Voir le récit dans Mas'ddt, VIII, p. 75 saa.
(2) Célebre héros d’expéditions de I’époque umayyade, mort en 122/710
(Tabarl, 11, 1716). cf. M. Canard, Les expéditions des Arabes contre Constantino
ple, JA, 1926, CCVILL, p. 86, 105, 116; El, I, 698; F. Gabriell, 11 Califatto di
Hisham, Alexandrle, 1935 (Mém. de la Soc. roy. d’arch. a’Alexandrie), p.88 sq.
et pour le Battal légendaire, M. Canard, Dethemuna, épopée des querres istamo-
byzantines. (en préparation) od I'on trouvera 1a bibliographie du sujet.
(8) Forme conjecturale en face du texte. ‘.ril ou. ‘r.b.l. ‘Irbld signifie ser~
pent.
(4) Cf. Vasttley, 1, 256.
(5) Sans aucun doute, de la méme famille que Aba “Umair “Adi b. Ahmad
b. "Abd al-Baql, qui accompagna les ambassadeurs en 305. Cf. p. 32.
(6) Tug est dit ordinairement fils de Gut.
P.
cy
p. 197
p. 198
42 Mas‘ipi
dition, I] conquit M. 1. w. riya ) dans le voisinage de Burgat et
Darb al-Rahib.
VIII, 177-178.,
En 283 (19 févr. 896 - 7 févr, 897) eut lieu I’échange des prison-
niers de guerre entre les Musulmans et les Rim. I! commenga en
Sa'ban (13 sept. - 11 oct. 896), un mardi.
VIII, 196-198.
En 288 (26 déc. 900-15 déc. 901.), Mu'tadid entra dans la
marche syrienne A la poursuite de eunuque Waelf |. Il lui envoya
un message par Raiiq connu sous le nom de al-Huzdmi; Wasif
al-Bektimari et d’autres officiers et compagnons de Wasif se sou-
mirent & Mu'tadid. L’eunuque Wasif, quand la plupart de ses
partisans furent prisonniers, voulut passer en territoire byzantin
et s‘établir fortement dans la région des défilés. Mais Mu'tadid
était venu de Bagdad en toute hate et dans le plus grand secret.
Wasif, malgré sa vigilance et ses efforts pour étre informé, n’avait
rien su de sa marche avant que Mu‘tadid edt passé 'Euphrate et
fat arrivé en Syrie. Mais Mu'tadid était épuisé par les étapes rapides
qu'il avait fournies et ses forces le trahirent. Quand il fut au mi-
lieu de la marche frontiére de Syrie, il laissa les bagages a al-Kanisat
al-Sauda’ et détacha ses généraux & la poursuite de Wasif. Aprés
Yavoir poursuivi sur une distance de 15 milles, les cavaliers d’avant
garde, commandés par Eaqin al-Muflihi, Wasif Maskir, Ali
Karah et autres officiers latteignirent | et lui livrérent combat
en un lieu connu sous Ie nom de Défilé du puits (Darb al-Gubb).
Quand Mu'tadid arriva, Wasif, abandonné par tous ses compagnons,
et fait prisonnier, fut amené a Mu'tadid qui le remit A l'eunuque
Mu’nis. Il fit grace a la plupart de ses partisans et n’excepta qu'un
petit nombre de gens qui étaient venus se joindre a lui de la marche
frontiére de Syrie et d'autres régions.
Mu‘tadid fit incendier la flotte de guerre et emmena de Tarse
Abii Ishaq, imam de la mosquée, Abii ‘Umair ‘Adi b. Abmad
b. ‘Abd al-Baqi (*), gouverneur d’Adana, cité de la marche fron-
tire et d’autres personnages pris parmi les marins de Tarse, comme
al-Bagil et son fils.
(1) Var. Lariya, Dans Aba ‘1!
lodiya, dans Tabarl : M. 1. w. riya.
(2) Ct. lan, 1 de la p. 37.
dhdsin: Mawurlya; dans Ibn al-Atir: B,
MASU'DI 43
VIII, 224-295.
«Le rachat de la trahison» eut lieu en da ‘I-qa‘da de l'année
292 (4 sept. - 3 oct. 905), sur le Lamis. Aprés qu'un certain nombre
de Musulmans et de Rim eurent été échangés, les Riim rompirent
le pacte.
Lréchange définitif eut lieu sur le Lamis en Sawwal 295 (4 juillet -
1 aodt 908), et il fut complet. L'eunuque qui présida fut Rustam,
qui commandait la marche syrienne.
Le nombre des Musulmans rachetés lors de l’échange d’Ibn Tugan,
en 283 (19 févr. 896-7 févr. 897), comme nous I’avons dit précé-
demment, fut de 2495, tant hommes que femmes. Lors du rachat
de la trahison, furent rachetés 1154 Musulmsns, et lors de l’échange
définitif 2842 ().
VIET, 281-282.
Cette année 1a (287 : 20 sept. 909-8 sept. 910), Faris, commandant
de la flotte grecque et chef des expéditions maritimes, pénétra sur
le littoral de la Syrie et s'empara de la forteresse d’al-Qubba (*)
aprés de longues luttes, les Musulmans n’ayant pas été secourus.
Il s’empara aussi de la ville de Laodicée | oi il fit un grand nombre
de prisonniers...
En 299, (29 avril 911 - 7 avril 912, Damiana, chef des expéditions
maritimes musulmanes en Méditerranée fit une incursion dans I'fle
de Chypre dont les habitants avaient violé le traité conclu au
début de V'islim et stipulant qu’ils n’assisteraient pas les Rim
contre les Musulmans, ni les Musulmans contre les Rim, et que
Vimpot serait payé moitié aux Rim, moitié aux Musulmans.
Damiana resta dans cette fle pendant quatre mois & faire des prison-
niers, incendier et conquérir les places oi les habitants s’étaient
fortifiés ().
(A) Sur cet échange, ef. p. 12.
(2) Barbier de Meynard pense que c’est peut-étre Vépithéte de la forteresse
de Sabydn, le chateau de Sadne des Croisés, qui gardait la route Laodicée-An-
tloche.
(8) Texte : ol il se fortiia. Mais il vaut mieux supposer, comme I'a fait Ro-
sen, suivi par Vasiliev, que le mot « ahluhd est tombé. Sure traité de Chypre,
ct. Balapori, 153,
VI
KINDI
(mort en 961)
Liauteur du Kitab tasmiyat wulat Misr (éd. H. Guest, G. M. S.
XIX, 1912; ef. vol. I, p. 393-394), qui a conduit son Histoire des
gouverneurs del'Egypte jusqu’a 335/946, date de la mort de
Muhammad b. Tugg al-Ibsid, (le texte imprimé a la suite et allant
jusqu’a I'avénement des Fitimides en 362/972 étant d'un autre
auteur, peut-étre Ibn Zalaq) (), est contemporain de la période
dont nous nous occupons. Bien que, & cette époque, les souverains
d’Egypte aient cu souvent la marche frontiére syrienne sous leur
autorité, et que I'Egypte ait été plusieurs fois en relations guerriére
ou diplomatiques avec Byzance, soit sous les Tiliinides, soit sous
les Th8idides, Kindi a complétement négligé cette question, alors
que pour les époques précédentes, il fournit des renseignements
intéressants sur les rapports entre I'Egypte et I'Empire. On notera
seulement les faits suivants (2) :
(En racontant la menace d’invasion que fit peser en 263/877 sur
Ahmad b. Tilin, gouverneur d'Egypte & partir de ramadin 254
(sept. 868), le régent du califat Muwatfaq, Kindi cite les vers sati-
riques du podte Muhammad b. Da’ad, qui insinue que Ahmad ne
songeait guére & combattre les Grecs)
Ila des vaisseaux ancrés sur le Nil, oi! 'on ne voit que bois et
Ce n’est pas qu’il comptait faire la guerre aux Grees, mais il
les a fait construire un jour de frayeur, pour prendre Ia fuite..,
(éd. Guest, p. 281-219)
(Ahmad b. Tilliin recut le gouvernement de la marche frontiére
syrienne, du calife Mu'tamid, en 258/872. Mais il n'y eut pas de
() Selon Hasan Ibrahim Hasan, al-afimiyyau Jt Misr, Le Calre, 1932, p.
5, n. 6, contre Guest, p. 12.
(2) Sur Kindi, voir, outre Vintroduction de I'éd. Guest, BRockELMANS, T
149 et Suppl. I, 229; EI, Il, 1079; G, Wier, Kind? et Mugrizi, BIFAO, XI,
1916, p. 61-73.
RINDI 45
gouverneur effectif avant Tabai b. B.l.b.rd., qui s'y rendit en
gumada I 264 (janv. 878). Quand il put, aprés la mort d’Amagar,
gouverneur califien de Syrie, prendre possession de cette province
la méme année, puis enlever Antioche & Sima al-Tawil au début
de 265 (sept. 878), il se rendit dans la Marche.)
Abmad b. Talin partit pour Tarse a la téte de ses troupes ;
mais (par suite de la présence de I'armée) les prix ayant monté,
les Tarsiotes s'émurent, lui firent une violente opposition et il
dut entrer en guerre contre eux. Puis il ordonna a ses soldats de
se retirer devant les Tarsiotes, afin que l'empereur (litt. le tyran,
roi des Rim), ayant appris cela, sit que les armées d'Ibn Tiliin
n’avaient pu tenir contre les Tarsiotes. (1) Ses troupes se retirérent
donc. Ahmad b. Tiliin quitta les Tarsiotes et leur donna comme
gouverneur Tabai b. B.l.b.r.d. Il avait eu I'intention de rester dans
la Marche, mais il recut des nouvelles d’E-gypte, lui annongant que
son fils al Abbi (2) s'était révolté contre lui... (éd. Guest, p, 220) (8).
(1) Hl faut comprendre : et qu’ll congdt une haute idée de la valeur des Tar-
slotes et appréhendat de les attaquer. Le texte d’Ibn al-Attr, VIL 220, est
plus clair & cet égard. Voir aussi Zeky Mohammed Hassan, Les Tulunides,
P. 66. Voir ausst Ibn Sa Id, infra p. 160-161.
(2) Il Yavait laissé & In téte du gouvernement de IBgypte en son absence.
(8) On notera également que Kindf nous fournit le nom exact d'un person~
nage qui a jou un rile dans la guerre byzantine et connu sous le nom de +» Gu-
Kim Zurlias (Tabarl, U1, 2250). I s‘appelle Rasta al-Warddmt, (Kindt, p.
245).
Vil
HAMZA AL-ISFAHANI
(mort en 360/970)
Hamza al-Isfahani, né en 280/893 & Ispahan, vécut surtout dans
son pays natal, mais fit plusieurs voyages d'études, en particulier
a Bagdad, notamment en 323/935, afin d’y rassembler des ma-
tériaux pour une édition du poéte Abii Niwas. I] s‘occupa surtout
de travaux philologiques, composa un recueil de proverbes copié
plus tard par Maidani, des études sur les mots persans passés en
arabe, etc. Mais, ila composé aussi un ouvrage historique, des An-
nales intitulées Tawarig sint mulak al-ard wa'l-anbiya’, Dates des
années des rois de la terre et des prophétes, qu'il termina en 350/961,
éditées avec une traduction latine par Gottwaldt, Hamzae Ispa-
hanensis Annalium libri X, t. 1. texte ar., t. 2, trad. lat., Leipzig,
1844-1848 ; une autre édition a paru ensuite dans I’Inde, et une
autre, plus récente, a Berlin (Kaviani), 1340 H. Une traduction
anglaise par U. M. Daudrota a été publiée 4 Bombay en 1932 ().
Dans cette hsitoire, dont le dernier chapitre est consacré aux
souverains musulmans, Hamza s'occupe avec prédilection de tout
ce qui est persan, comme dans ses autres ouvrages, bien qu'il ne
soit pas A proprement parler un représentant du nationalisme
littéraire des Su‘dbites. Il traite en particulier d'une maniere détail-
lée des gouverneurs du Hurdsan et du Tabaristan ; il enregistre aussi
soigneusement les nombreux soulévements de troupes A Bagdad.
Mais sur ’histoire des relations arabo-byzantines A son époque,
il n’a noté que le fait suivant :
«(En 315), les Rim firent une expédition contre la place fron-
tiére de Sim8at. Ils égorgérent les gens dans la mosquée, devant la
«qibla» (niche qui indique la direction de la Mekke). Is firent main
basse sur tout ce qu’ils trouvérent, et emmenérent en captivité
la totalité de la population. Is incendiérent (aussi) le faubourg de
la ville de Malatya. » (éd. Gottwaldt, p. 205 ; éd. de 1350, p. 131) @).
(1) Sur Hamza, voir les travaux indiqués dans rocketman, I, 145, Suppl.
1, 221, et EI. I, 271-2.
(2) Dans les autres historfens, ces deux événements sont racontés, un sous
315 (SimSAf, mais avec 1a variante Sumaisat), l'autre sous 314 (Malatya).
HAMZA AL-ISFAHANS 47
D'autre part, dans la liste des empereurs byzantins (éd. Gort
WwALpr, p. 76-79), il dit pour I"époque qui nous intéresse, p. 78-79 :
«Ensuite, empire passa des mains des gens de cette maison
(= la dynastie amorienne) A celles des Slaves. Basile le Slave le
recut a ]'époque d’al-Mu‘tazz en 253. Il régna 20 ans; puis Léon
fils de Basile régna & I'époque d’al-Mu'tamid en 273. Ensuite,
vint Alexandre fils de Basile a l’époque d’al-Muqtadir en 293. Aprés
avoir régné 1 an et 2 mois, il mourut d'un ulcére suppurant (du-
baila). Puis régna Constantin fils de Léon, agé de douze ans:
mais il fut évineé du pouvoir par Constantin fils de Andro[ni}qus
dont le fils () était a Bagdad, s‘enfuit aprés la mort de son pére et
retourna en territoire byzantin ; quand il eut usurpé le pouvoir et
se fut installé dans le Palais impérial (Dar al-Balaf), il fut assailli
par les compagnons de Constantin fils de Léon qui le tuérent. Et
Constantin fils de Léon prit le pouvoir en 301.
(2) Entendre : le tils d’Andronic (Doucas). La tentative de Constantin Dou-
cas eut lieu la premiére année du régne de Constantin VII (volr Vasiliev, éd.
russe, IT, p. 197-198 et 164 et Mas‘Qdt, Tandth, 175). Il semble que Hamza V’a
confondu avec Romain Lécapene. La source de Hamza est un ouvrage com-
posé par un q di de Bagdad appelé Waki‘ (Hamza, p. 70 et 79), qu'll soupgonne
ailleurs p. 79 d’avoir mal lu ses autorités, Wak est sans doute Ihistorien
mort vers 330, mentionné par le Fihrist, 114 (et. Brockelmann, Suppl, I,
225).
VILL
‘ARIB
(ConriNuaTEUR DE TanaRi)
(mort dans la 2¢ moitié du x° siecle) (4)
(Arib, Tabari continuatus, quem edidit, indicibus et glossario
instruzit M, H. pe Gorse, Lugduni Batavorum apud E, J. Brill,
1897).
De Goeje, qui n'avait pu réaliser son projet primitif d’éditer
le texte de I'Histoire dArib, continuateur des Annales de Tabari,
en méme temps que le texte de ce dernier, sous forme de supplé-
ment, a donné, en 1897, une édition séparée d”Arib(?), Les informa-
tions d"Arib sur I'histoire de Espagne et de l'Afrique du Nord
avaient été depuis longtemps publiées par Dozy, en méme temps
que le texte d'Ibn ‘Idart; elles n’ont done pas été reproduites par
de Goeje, dont I’édition ne comprend que Jes renseignement fournis
par “Arib sur I'histoire des “Abbasides de 291 & 320 (903/4-932).
Cette partie de l'histoire d”Arib nous intéresse du point de vue
byzantin parce qu'elle expose, pour l’époque indiquée, les rencontres
entre les Arabes et les Grecs, et a pour nous I'importance d’une
source contemporaine,
L’AUTEUR DE LA CONTINUATION DES ANNALES DE Tapani.
Plusieurs pages manquant au début de Ms de Gotha ne 261 dans
lequel se trouve I'Histoire d”Arib, le nom de l’auteur n'apparait
pas dans le manuscrit et il a fallu beaucoup de temps et de peine pour
démontrer qu'il s’appelait ‘Arib b. Sa'd de Cordoue.
(4) Dans la 1* édition, Vasiliev avait donné sur ‘Arfb une notice trés longue
(p. 43-53), qui, a cette époque, l’édition du texte étant récente, était d’actualité,
Elle a été justement signalée dans £1, & l'article “Arlb, I, 438.Une bonne par-
tie des renseignements qui s'y trouvent, empruntés & Dozy, n’ayant plus qu’un
intérét rétrospectif, nous avons abrégé cette notice tout en la complétant sur
certains points.
(2) Cf. De Gorse, Arid, Tabari continuatus, Lugd. Bat., 1897, praefatio, p.
vit; Annales quos scripsit... at-Tubari cum aliis ed. de Goeje, introductio,
Lugd. Bat., 1901, p. xxix.
“ani 49
Le Ms fut d'abord attribué 4 Mas‘idi, Mais dés 1826, Méller,
dans son catalogue des Mss de Gotha, émettait un doute a ce sujet(t).
Deux ans aprés, Kosegarten, ayant inséré dans sa Chrestomathie
arabe le récit du Ms de Gotha sur I'expédition de Mu’nis contre
Bagdad en 320 (*), regardait le texte dle ce Ms comme un ouvrage
authentique de Mas‘idi, différent des Prairies d'or, le Abbar al-
Zaman (Histoire du Temps). De Sacy, auquel Kosegarten avait
envoyé un fragment relatif aux Qarmates, exprima l'avis que, si
le Ms était effectivement de Mas‘idi, comme il ne pouvait s'agir
des Praires d'Or, dont le récit était beaucoup plus bref sur ce point,
était une portion du Kitab ahbar al-Zaman (3),
Mais Yorientaliste anglais Nicholson, ayant publié en 1840,
sur la base du Ms sus-mentionné, un récit en traduction anglaise
relatif & I'établissement de la dynastie ftimite en Afrique du Nord,
considéra la maniére de voir de Kosegarten et de Silvestre de Sacy
comme insoutenable. A son avis, il fallait voir dans auteur du Ms
un Espagnol, pour expliquer ordre qu'il suit dans sa Chronique.
En racontant les événement de chaque année, il parle tout d’abord
de ce qui s'est passé en Espagne, ensuite il raconte histoire du
califat de Bagdad, et en dernier lieu, l'histoire de l'Afrique du Nord.
Un pareil procédé peut seulement s'expliquer par le fait que 'au-
teur est espagnol (#). A son avis, l'auteur avait vécu un peu aprés
CML (29 mai 952-17 mai 953) (%). Comme uous le verrons, cette
déduction de Nicholson devait étre entiérement confirmée dans la
suite,
En 184, de Slane voulut voir dans le manuscrit de Gotha une
(A) Mouuaen, Gululogus Librorum (am manuseriptorum quam iupressorum,
qui... in Bibliotheca Gothana asservantur, t. 1, Gothae, 1926, p. 75, n° 261.
Il note: « Codex, initio mutilus, negligenter exarutus, anno 627 H. 1229 Chr.
absolutus, ab alia manu, false, ut puto, inscriptus : pars altera annalium Masu-
di. — Continet historiam praecipue Hispaniae et Africae, ab anno 271-320 H.
884-932 Chr.»
(2) Koszoanran, Chreslomuthia arabica, Lipsiue, 1829, p. 105 sq.
(8) Id. ibid, p. xv-rv1.
(4) Nrcwouson J. An account on the estublishment of the Falemite Dynasty
in Africa beings the annals of that province from the year 290 of the hegira
to the year 300, extracted from an ancient arabie Ms. aseribed to el-Masudi,
belonging to the Ducal Library of Saxe-Gothu with an introduetion and notes,
‘YObingen and Bristol, 1840, p. 39-41,
8) Id. ibid, pe 43,
50 “ARIB
partie de louvrage historique du célébre médecin et historien Abi
Ga‘far Abmad ibn al-Gazzar, né a Cairouan, qui écrivit une histoire
de l'Afrique du Nord au temps de la décadence des Aglabides et
de I'établissement des Fatimides (1). Weil, qui, dans le tome second
de son Histoire des Califes, s'est servi du Ms de Gotha, pensant que
Youvrage n’était pas achevé, I'attribuait & un auteur beaucoup
plus tardif (*).
Le principal mérite d’avoir mis en lumiére la personnalité de
Yauteur revient & Dozy (*). Prenant pour base les formules arabes
habituelles de glorification qui suivent le nom des califes, il démon-
tra que l'auteur du Ms avait vécu sous Je régne d’al-Hakam II
(350-360 / 961-970), et confirma I'opinion de Nicholson sur V’ori-
gine espagnole de I'auteur (). Tout d’abord, en s'appuyant sur
un passage de ’historien du xi° siécle Ibn “Igari, de Marra-
kech (8), et en comparant ce passage avec le Ms de Gotha, il arriva
4 la conviction que l'auteur du Ms était Ibn al-Kattan, dont le
nom était resté jusqu’alors inconnu des orientalistes européens.
Ibn ‘Idari donnait aussi le titre du livre d’Ibn al-Kattan, Nazm al-
Guman (le rang de perles) (*). Mais Dozy comprit vite que cette
conclusion était erronée, Ibn al-Kattdn, dans le passage cité
par Ibn ‘Idari, ayant tout simplement copié un auteur plus ancien,
(1) M.G. pe Suanc, Lelire dM. Hase, JA, IV* série, 184, t. IV, p. 346-347.
Sur cet auteur voir BRockELMANN, I, 238 et Suppl., I, 424.
(2) Wen, Gesch. der Chalifen, 11, Mannheim, 1848, Vorrede, p. x-x1. Ci.
la communication de Weil sur le méme t. II de I"Hist. des Cal. dans les Heidel-
berger Jahrbiicher, 1848, p. 93-94.
(8) Voir De Gorse, Biographie de Reinhardt Dozy, tr. du holl. par V. CHau-
win, Leide 1883, p. 40 et suiv.
(4) Dozy, Notices sur quelques manuscrits arabes, Leyde, 1847-1851: Quel
est auteur et le titre du manuscrit de Gotha n° 261 ete. p. 2.
(6) Le nom de cet historien, sur la vie duquel nous n’avons aucun renseigne-
ment a été fixé par Dozy dans son Histoire de (Afrique et de U Espagne, intitulée
al-Bayano-'l-Mogrié, par Ibn-Adhari (de Maroc), Leyde, 1848-1851, vol. I,
Intr. p. 77-79. Cf. Amant, Biblioteca arabo-sicula, Vers. it, ‘Torino € Roma, vol.
I, 1880, p. LIV. Il faut lire Ibn ‘IGart ; ef. Wastenreuv, Die Geschichischrei-
ber der Arater und ihre Werke, Gottingen, 1882, n° 373, p. 151; Brock. I, 337
et Suppl, I, 577; El, I, 412; LevieProvencat, Ibn "Idarl_al-Marrdkusl,
Al-Bayan al-Mugrib, t. II, Paris, 1930.
(8) Dozy, Notices... p. 3-4. Sur Ibn al-Kattin, voir Pons-Borours, Ensayo
bio-bibliogralico,.. Madrid, 1898, p.275; FAONAN, Hist. de UAjr, et de VEsp.
int. al-Layano... trad. Alger, 1904, 11, p. 8. Il est mort & Sigiimasa en 628,
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Herodotus BookDocument139 pagesHerodotus BookHomo ByzantinusNo ratings yet
- Андреева М.А. Очерки по культуре византийского двора в XIII в.Document105 pagesАндреева М.А. Очерки по культуре византийского двора в XIII в.Homo ByzantinusNo ratings yet
- Шестаков, Сергей Петрович - О происхождении и составе Хроники Георгия Монаха (Амартола) (1891) PDFDocument179 pagesШестаков, Сергей Петрович - О происхождении и составе Хроники Георгия Монаха (Амартола) (1891) PDFHomo ByzantinusNo ratings yet
- Herodotus IntroductionDocument13 pagesHerodotus IntroductionHomo ByzantinusNo ratings yet
- Herodotus IntroDocument3 pagesHerodotus IntroHomo ByzantinusNo ratings yet
- Medvedev I.P. L'égalité Comme Principe de Justice Sociale Chez Les ByzantinsDocument16 pagesMedvedev I.P. L'égalité Comme Principe de Justice Sociale Chez Les ByzantinsHomo ByzantinusNo ratings yet
- Leeds 2019 Sessione614 PDFDocument3 pagesLeeds 2019 Sessione614 PDFHomo ByzantinusNo ratings yet
- Slovary XVII XVIIIDocument83 pagesSlovary XVII XVIIIHomo ByzantinusNo ratings yet
- Андреева M.А. Прием татарских послов при никейском двореDocument15 pagesАндреева M.А. Прием татарских послов при никейском двореHomo ByzantinusNo ratings yet
- Malamut E. Cacouros M. L'image Des Serbes Dans La Rhétorique Byzantine de La Seconde Moitié Du XIIe S.Document19 pagesMalamut E. Cacouros M. L'image Des Serbes Dans La Rhétorique Byzantine de La Seconde Moitié Du XIIe S.Homo ByzantinusNo ratings yet
- Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV-XVDocument170 pagesМедведев И.П. Византийский гуманизм XIV-XVHomo ByzantinusNo ratings yet
- Pingree - A Greek Ephemeris For 796Document4 pagesPingree - A Greek Ephemeris For 796Homo ByzantinusNo ratings yet
- The Late Antique Kosmos of Power: International Ornament and Royal Identity in The Sixth and Seventh CenturiesDocument23 pagesThe Late Antique Kosmos of Power: International Ornament and Royal Identity in The Sixth and Seventh CenturiesHomo ByzantinusNo ratings yet
- Emotions Colloquium ProgramDocument4 pagesEmotions Colloquium ProgramHomo ByzantinusNo ratings yet
- DZ 01 Sen 03 Alg 10 MathDocument1 pageDZ 01 Sen 03 Alg 10 MathHomo ByzantinusNo ratings yet
- HSE TeachersDocument306 pagesHSE TeachersHomo ByzantinusNo ratings yet
- P-V Claverie TOMAR PDFDocument25 pagesP-V Claverie TOMAR PDFHomo ByzantinusNo ratings yet
- Childhood IntroDocument42 pagesChildhood IntroHomo ByzantinusNo ratings yet
- Biblio TempliersDocument9 pagesBiblio TempliersHomo ByzantinusNo ratings yet
- Neville 1 PDFDocument17 pagesNeville 1 PDFHomo ByzantinusNo ratings yet
- 21st International Congress of Byzantine Studies, London, 2006Document14 pages21st International Congress of Byzantine Studies, London, 2006Homo ByzantinusNo ratings yet
- Institute Working Paper 8 (February 1995), 2: WWW - Sussex.ac - Uk/seiDocument31 pagesInstitute Working Paper 8 (February 1995), 2: WWW - Sussex.ac - Uk/seiHomo ByzantinusNo ratings yet
- Dagron L'ombre D'un DouteDocument11 pagesDagron L'ombre D'un DouteHomo ByzantinusNo ratings yet