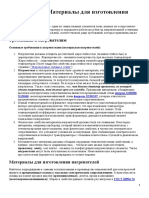Professional Documents
Culture Documents
Electronique Pratique 2006-11 PDF
Electronique Pratique 2006-11 PDF
Uploaded by
batka20 ratings0% found this document useful (0 votes)
609 views55 pagesOriginal Title
Electronique Pratique 2006-11.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
609 views55 pagesElectronique Pratique 2006-11 PDF
Electronique Pratique 2006-11 PDF
Uploaded by
batka2Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 55
Amplificateur
PR tw Tile
écoute au casque >
Mosaique
Oey
rm Cs
aE TH ae
@ Infos/Nouveautés
Initiation
Internet pratique
Savoir compter en binaire
Réalisez vous-méme
Micro/Robot/Domotique
Riceaue 4 écrans pour vidéo-surveillance
Veilleuse multicolore
Régulateurs de température : refroidisse-
_ ment ou chauffage
Chenillard musical
40 Interface GPIB/USB
Audio
Et si on parlait tubes (cours n°28)
Amplificateur pour 6coute au casque
Fendatew :Jesn Pee VENTLLARD - TRANSOCEANIG SAS a captal de 574600 € 8 bulova No, T2018 Pars Tl 1 4 65 0 60- Fax 0144 656090,
bret: pti elcronaueraqve con - Président: Pet VERCHER - Drecteur dela publeaton:Pabick VERCHER -Rédacter en cht: arard DAL
‘Secreta de redaction: Ese SEPLLVEDA - Couverture: OorniqueDUMAS- Mutations: Alan BOUTEVELLE SANDERS
Photo: sabes GAFIGOU - Ave a parton de FE. Bat, Cadhot, Gaba. R Ker, Lebrun, P Mein -L Vandoren, 0. Vara
Li Pitcton Becroncue rate cine fut esponsabitéquat axons fares desis ares, cal gage! qe us eeu
DIFFUSION/VENTES AL CONSEIL PRESSE Tl 01 6468160 -PUBLICIE A rv, oa pubepa@toeanacom
SSN. c243 4011-N" GCommlason pare: 0509 1 £5322 -Ditbution : MLP -Impeimé en France/Prnted in France
Imprimerie ACTIS MAULDE & RENOU 02420 GAUGHY - DEPOT LEGAL : NOVEMBRE 2008 - Copyright © 2008 - TRANSOCEANIC
124 que a Mare - 75164 Pars Cade 19TH 01 464 8 1-Fax:01 4200 £69, rear sur erloppe » Saves Azores
Aen 5 stesso i tires nate cert ore ira fue Sooners baer eee eran os haan yB
rnements USA - Cenade : Contac Express Mag
"IARI AU NUMERO : Fran Matrooltaine
_Bebique 580 € Ena 50 € + Grice 5.6 +
LE PRocHAI wuMénOD'€LCTROMUEPRATQUE SERA EN KIOSQUE Le 2 DECEMBRE 2006
Une sélection d’ouvrages
DUNOD/ETSF
Les antennes
@ développement des antonnes stant opéré, au du temps, dans le
domaine dal technologie, Roger Charlee Hourd a actualisé son ourage t
as atennes dont la & edition du tome 1 = Fondamertaux » vent de paraive
aux éditions Dunod. Totalement refondue, cette édition est a jour des progrés ms eal
cétiterrt mato de TN technique OFDM, tléphonia mobi, ruméretion
des services do recndifison et de reciocomrmunications ratique et pedago-
siqve, Pouvrage propose une description technique precise des antonnes de
Stscfiston ot dovecleifslon aps un bret expose dee prncipespysiues
de base (atuie dele propepation deo ondes EM, ancves du cipble raya
Inprésente notamment les notions fondamentle et envronnement
fectmigue, es antennes co television etfs antennes pour transmissions en
andes courts. Une référence pout ls raoaraters, les technicians et los
ingeneure specialises.
Roger-Charles Houzé, Les antennes, tome 1 « Fondamentaux », Editions
Dunod, coll. EEA, Série Technologie électronique, 3 édition, 2006. 366 pages
Tout pour construire soi-méme sa lunette astronomique
ui n’a pas révé, en contemplant la sphére céleste, de plonger son
constauvisez | Q
regard vers 'infiniment grand ?
VOVRE LUNEVYE — vetsuesheures ce racage, de decoupage et d'assemblage dans votre
tial, vous pourez donner fare & vrs ve en ua pes pas Fou
ASTROROMIAVE | race -e Micrel Dumont Constuise votre luneteasronomque et obsor-
Ty OBSERVER LE €IFh... | Yez/6iel.. Nonégigeant 8 aucun moment ies appotstnéoriques néces-
sales Al fabrication, auteur nous guide par une ogique progressive et
étichirrent le constuction
application représentée en figure 2
est une division de fréquence.
Reprenions l'exemple du paragraphe
« Transformer une notation décimale
fen notation binaire » appliqué au
nombre 817. En observant le tableau
utilisé pour la conversion et en atfec-
tant les colonnes aux sorties Q1 a
@12 du compteur, on note que pour
la position particuliere correspondant
‘au nombre décimal 817 (1100110001,
fen notation binaire), toutes les
cathodes des cing diodes sont simul-
tanément en relation avec un état
‘haut ». Ilen résulte un état « haut »
sur le point commun des anodes. La
bbascule monostable formée par les
deux portes NOR est alors active. I
fen découle deux conséquences :
= Papparition d'un bref état « haut »
sur la sortie de la bascule (sept mili
secondes dans l'exemple traité)
«la remise & zéro du compteur
En défintive, on recueile ainsi un état
« haut » toutes les 817 impulsions
élementaires de comptage. II s'agit
done bien d'une division par 817 de |
la frequence présentée a Ventrée du
compteur
{aide de diodes placées en regard
des sorties appropriées, ce compteur
peut ainsi diviser la fréquence des
signaux d'entrée par ‘imports quel
nombre compris entre 2 et 2%, soit
4096.
Comment obtenir des tempo-
risations importantes
Dans certaines applications, il peut
atre nécessaire de disposer de
durées importantes de temporisation.
Le recours au seul dispositf tradition
nel du type bascule ou oscillateur
ont la durée est basée sur la charge
ou la décharge d'une capacité dans
tune résistance ne résout générale-
‘ment pas le probléme. Il est alors per-
tinent de mettre en ceuvre un oscilla
fe TO eww. oloctroniquepratique.cex
tour générant un nombre trés impor-
tant de périodes que l'on peut
| décompter pour aboutir & une addi-
tion de durées élémentaires et pro-
dire ainsi une durée de temporisa-
tion sutfisamment grande.
Le circuit intégré CD 4060 comporte
un oscillatour intégré suivi d'une suite
de quatorze bascules bistables mon-
| tees en cascade. La figure 3 iluste
une maniére simple permettant
d'aboutir & une temporisation longue
‘durée, Tant que entrée Reset resto
soumise & un état « haut » par linter-
médiaie de la résistance de 10 KO, le
| compteur est bloqué et toutes ses
sortios présentont un état « bas ».
En revanche, ds que l'on ferme Iin-
terrupteur | le compteur de la tempo-
‘isation prend son départ.
Surla roche n® 9, on reléve alors des
créneaux de forme carrée caractér-
| 865 par une période définie par la
relation :T = 2,2 RC.
| Pour qu’un état « haut » apparaisse
sur la sortie Q14, les sorties du
ompteur occuperont une contigure-
tion binaire telle que les sorties Qt &
13 sont & état « bas »
Le lecteur établira sans peine que le
nombre nécessaire de périodes élé-
mentaires correspond a la notation
binaire 1 suivi de treze z6r0s, soit 2°,
soit 8192 en notation décimale. La
bascule monostable délvre alors une
breve impulsion positive matériaisant
| afin dela temporisation.
Sila valeur de la résistance R est de
470 kO, celle de la capacité C de
2.2 UF la durée totale de la tempori-
sation obtenue est de
2,2 x 47 x 10*x 2,2 x 10% x 8192
18635 secondes
soit 5 h 10 min et 35 s.
Le systeme BCD
lexiste des compteurs binaires com-
Portant quatre bascules bistables
montées en cascade et munis de
quatre sorties Q1 a Q4, mais dont la
valeur maximale est volontairement
limitée & 9 (1001 en notation binaire).
Une fois cette valeur atteinte, le
compteur revient sur la position z6r0
pour démarrer un nouveau cycle de
comptage. Un tel systéme, assez
hhybride & vrai dire, porte le nom de
BCD, Binary Coded Decimal, ce qui
peut se traduire par « Systéme déci
‘mal codé binaire »
Le tableau 5 reprend le fonctionne-
‘ment du compteur BCD.
Un tel compteur est utilisé dans les,
‘cas ol le systéme de comptage doit
rester décimal. C’est, par exemple, le
cas lorsque 'on a recours & un affi-
cchage sept segments,
La figure 4 fait état d'un tel montage
en utilisant un circuit intégré CD 4518
comportant deux compteurs BCD
dont les sorties sont reliées aux
entrées de deux décodeurs BCD > 7
segments et qui sont des CD 4511.
sw
ey aye
Lyte:
chee [EE temporisateur «tongue durée »
ym ELECTRONGUE PRATIQUE
]
=e er) |||
19. | Affichage
Topo poporo
| Fe peter erate | segments
i popotrpot | DTT TIT11a
+ poporiyiys |
spor pepo a] v
a fotryfotiy 3) Jf]... 7 JJ df fo
sport pet ey | |
afer tore eww eee see
apo to poe cous I cov
peers :
Tableau 5 ih cE 7" ae) a Ty I
Epilogue |
Dénombrer des objets, les quantifier, | |S) el melee
mesurer, autant de problémes aux- - Sa a |
quels I'homme a été confronté ds ae |
les premiers temps de "humane, |
Ses nets ont oh Os one | etait
min a été parcouru entre le boulier et ale
la calculatrice scientifique. Des nota- a Sa
tions antiques telles que les chiffres _ ciens par exemple. Il est en effet pos- | D'ailleurs, en vous inspirant des prin-
romains se prétaient fort mal aux cal- sible d'imaginer un comptage dans cipes développés au début de cet
culs et le recours aux chiffres arabes _n’importe quelle base. L'adoption de article, il peut étre tout & fait amusant
constitu un progrés marquant, | la base 2 est simplement le résultat | de créer par exemple un systéme de
‘Mais il existait dans le passé d'autres d'une nécessité Imposée par les lols | comptage de base 3.
bases comme la base 12 des phéni- | physiques de électronique. R. KNOERR
WW
ICIBS =|
I Distribution
Retour sur Paris 12°!
OUVERTURE AU PUBLIC
D’UN NOUVEAU MAGASIN
FIN NOVEMBRE 2006
Composants électroniques
Appareils de mesure
Connectiques...
Une visite s‘impose
VENEZ NOMBREUX !
Lundi au Vendredi : 9h00 - 18h00
1.C. DISTRIBUTION
etcetera 3, rue Mousset-Robert 75012 Paris
aot Tél. :01 41 72.08.50
Métro : Bel Air ou Picpus
www. PCB-POOL. com fou toute formation: ncocbotam
Avec l’avénement de la
TNT, de nouveaux équipe-
ments audiovisuels sont
amenés a compléter une
panoplie d’appareils aux
multiples branchements.
L’évolution du matériel ou
son renouvellement sera
progressif pour chacun et
ce répartiteur péritélévi
sion permettra de raccor-
der la sortie d’un adapta-
teur TNT ordinaire vers
divers appareils péritélévi-
sion : magnétoscope, gra-
veur de DVD, transmetteur
sans fil, ordinateur, etc.
© répartiteur_péritélevi-
mM sion est équipé, d'une
Part, de deux embases
péritel prévues pour
maintenir la liaison téléviseur/adapta-
tour TNT et, d'autre part, de deux
séries de trois embases RCA corres-
pondant & deux sorties audio/vidéo
supplémentaires destinées, par
exemple, au raccordement avec un
ou deux enregistreurs (magnétosco-
pe ou graveur de DVD) ou avec un
‘transmetteur de image et du son
our une liaison sans fil de la piéce
principale vers des pidces équipées
d'un télévisour secondaire,
Le schéma de ce répartiteur péritélé-
vision (figure 1) repose sur un circuit
spécialisé dans le transfert de
signaux vidéo, le TEAS114, circuit
vidéo populaire de STMicroelectro-
nics, d’origine SGS-Thomson.
Ce circuit intégré de 16 broches, dont
"application typique est la commuta-
tion des signaux vidéo RVB, contient
trois amplifcateurs vidéo de 6 dB ot
lune porte OU logique. La figure 2
présente le brochage et la structure
de ce composant. La réparttion des
signaux audio est confige & un
double amplificateur opérationnel,
associé A des étages tampons & tran-
sistors. Une alimentation secteur
compacte complete le montage.
Le signal vidéo composite issu de
adaptateur TNT est appliqué a la
résistance Ré de 75 Q, laquelle réall-
‘se adaptation dimpédance.
amplitude du signal vidéo composi-
te est ainsi divisée par deux et sa
valeur typique est alors de 1 Voc.
Ce signal parvient au travers des
condensateurs C1, 02 et C8 d'isole-
ment des composantes. continues,
aux entrées des trois ampliicateurs
Vidéo du TEAS114 dont Iimpédance
drentrée est trés supérieure aux 75 2
de Ré, ce qui permet leur mise en
paralldle,
impédance Interne de sortie des
amplificateurs vidéo du TEAS114 est
denviron 10 Q, valeur ramenée a
environ 75 © grace aux résistances
séries Rt, R2 et R3.
Trois sources vidéo sont ainsi dispo-
niles. Lune permet de maintenir la
liaison péritel avec le téléviseur et les
deux autres seront dirigées vers des
r
ES
z
Fr)
}
3
6
a
péritélévision reposant sur le TEAS114
|
F
ra
ft
jwoma mov M4001
autoa
—
‘Tevcew Gu Sori
P
Rao
Rtonoxa ST
sons
emer area Ty
ra 1
ania 3
; co
ae 0 7210
9
co re
A700 474,
2
a
cr
re
or Our
‘otagnatzecone ou
‘gaveu DVD)
8 TO. nw olectroniquepratique.com ELEGTRONQUE PRATIQUE
Domotique
appari auxliires raccordés aux |
embases RCA, Ces signaux vidso
eames set os ais
signaux audio stéréophoniques, dé
vrés par l'adaptateur TNT sur les |
broches 2 et 6 de embase pri Kt
|
Les signaux audio |
Deux amplfcateurs. opérationnets, |
contenus dans un classique LM358, |
amplfent de maniére identique les |
signaux aucio de gauche et de droite, |
lesquels sont ensuite réparts vers les
eo |
tampons a transistors. Normalemert,
ae
ona audlo plus fables. Gate di-
persion de niveau peut étre génante_
11 tea coset satan a est
a unauve. En Santis cavalrs S01
| et Sw, Tampitcation en tension
| sor lors pis ios
| | Latigure 8 rappel calcul du gain
| tun amplitcateur opéretione! iiss
|| Sater
We ola dieagutian da est
|| tances.
| | L’alimentation du LM358 n’étant pas
|} smaecue, seo psnta tt
nue doit étre ajoutée au signal audio.
Geet le role dt pont de réistances
| | Ferme, lequel polarise a § V Ventre
| peceinateoutie sialigtattednss
| Gpsratonels en aisant par dau a
| tension taimentation. Grace 8 la
prbecace diedinssenninst Ti
| ment C5 et C6 en série avec les résis-
tances centre RE et F, seule les
verietons des sgnaix audio seront
| amples
En sortie des amplificateurs opéra-
il nest pas nécessaire de corriger
amplitude des signaux audio. Une
faible amplification en tension est
donc établie par défaut avec la pré-
‘sence sur la carte des cavaliers SW1 |
‘et SW2. La résistance de contre réac-
tion, dont dépend le gain des ampiii- |
ccateurs, résuite de la mise en parallé- |
le de deux résistances RS avec R10
‘et R11 avec R12, La valeur résultante
‘est ainsi plus faible et le gain en ten-
sion de ces amplificateurs audio sera |
minimal avec la présence des cava-
liers SW1 et Swe.
Cependant, certains appareils peu-
ine TO www ctectroniquepratique.com ELECTRONIQUE PRATIOUE
Domotique
tionnels, un étage tampon a transis-
tor monté en collecteur commun isole
chaque sortie audio. Ainsi, la stabilté
du niveau audio est garantie a I'en-
trée de chaque appareil raccordé au
répartiteur et un éventuel court-circuit
sur l'une des sorties n’aura aucune
conséquence pour les autres. Un
transistor utilisé en collecteur com-
mun permet d'obtenir un gain en
courant important et un gain en ten- | |
sion unitaire, d’ou sa fonction de sul- | |
veur de tension,
La figure 4 présente les trois mon-
tages fondamentaux d'un transistor
bipolaire.
Valimentation
Comielealon wedges
soranes gu TEASTI4 une aleart| |
Conmasinale ge 10¥ ant noosne_| |
Cae at club ave in ogc
deterion oC, un TIO on ote
Toe20
La fond otha at sas ||
Siryecttienta ose owas ||
rent soon
Att ale ROR SSE coca ||
reteset Di ot O2 amr in
Peres nanaceraca
Ca mead oc wert let pate
convertor Cr
Teen eee tances
parle conderate 8
|
Réalisation |
|
Le coftret |
|
Les dimensions du circuit imprimé
correspondent au format d'une cas-
sette vidéo. Vous pourrez ainsi éco-
omiquement placer le montage &
Vintérieur d'un boitier de cassette
vidéo.
Le circuit imprimé
‘Afin quo le montage prenne place
dans un coftret de cassette, la carte
est équipée d'un transformateur z
extra-platsurmoulé, Le madele utilisé
our la maquette présentée, est de Schatiner 3 VA (TES1063} Les embases péritel sont normale-
marque Myra de la série 45000, La taille assez importante des pistes | ment normalisées. Par contr, il exis~
d'origine Selectronic. et des pastilles permet d'envisager | te différents modales d’embases
Des modéles Schatiner pourraient une fabrication artisanale du circuit | RCA. Le mod@le retenu est au cata-
également convenir. imprimé. Une zone délicate est néan- | logue Selectronic sous la référence
Letracé des pistes proposé est prévu moins a verifier soigneusement. | 60.9205. Pour d'autres modéles,
Pour recevoir indifféremment un | II s‘agit du passage des pistes entre | vous serez amené & modifier le typon
modéle Myra 6 VA (45027) ou | les pastilles du LM3S8. proposé en figure 5,
in 310 eww electroniqueprntique.com ELEGTRONIQUE PRATIOUS
Domotique
ee" | Nomenclature
Pee baa nmecisracue Résistances,
scoooeiecarmin ——oucnecatosteacin oe) RY, R2, RO: 680 (eu, i, no)
4’ 75.0 (volt, vert, no)
5, RB : 4,7 kQ Gaune, volt, rouge)
7-4 RIB : 10 kO (marron, not, orange)
1g a R24 : 2.2 kA (rouge, rouge, rouge)
R25 & RAO : 860 0 (ver, bleu, marron)
R31, R247 kA aune, violet, orange)
Condensateurs
G1, 62, C3, C4, C10: 100 nF
| | ff 05.c6, cri acre: 470m
7: 220 pF/25 V
(C8: 220 nF
69:10 p25 v
Semiconductors
fer || [EE mee,
F || Diiste- ose, acser
Gs Teastia
Ste: Lesa
i: rguatur 10,7010
Divers
Ki, K2 : embase péritel
3: borer deux plots
| Bf <4: suppor al tus 5 x 20
KS a K10 : embase ROA
1 : fusible 100 mA retardé
‘TRI :transformateur extra-plat Myra
230 V2 x 12-6 VA
(et Selactronic 60.9228)
4
TeLeMsEUR AM)
implantation
des composants
La réalisation d'ensemble ne pose
pas de probléme particulier.
Vous débuterez |'implantation des
composants de la figure 6 par les
straps.
Une réalisation soignée de ces straps
sera obtenue avec du fil de cuive
argenté ou avec du fil de laiton, préa-
lablement étiré & l'aide de deux
pinces plates avant leur mise en.
forme.
Aprés avoir soudé l'ensemble de ces
straps, vous poursuivrez la realisation
avec implantation des résistances,
aera Entrée vidéo composite ou luminance is des diodes et circuits intégrés,
Sotelo conte sure ena ie don Se
= ems oscromsnes Ente comsater mate || ous teminere par os composanis
Masse composnt vidéo rouge Eh abeperap ad ese a les plus épais: connectours, embases,
anon wececmess || Vartomaa
Masso composarte vio von
Enelsorie compasante teu
Masse composes vio bleu
Sati audo woo gauche
Sart audio woe crt
Entre commute re
Entee ado mice | | Mise en service et tests
Cette opération vous permettra & la
fois de valder le bon fonctionnement
| | général de votre réalsation, mais
| | aussi le bon état ou le bon cablage de
_____| | vos cordons. Si vous ates amené &
ine IO www. siectroniquepratique.com ELECTRONQUE PRATIQUE
Domotique
réaliser vos propres cordons, vous | 30 et 60 cm de longueur, raccordez | doivent & nouveau étre présents de
ourrez vous reporter ala descr Vadaptateur TNT ou autre source | maniére identique.
de la prise péritel de la figure 7 éga- | vidéo principale a lentrée péritel du | Effectuez le méme essai avec l'autre
lement appelée prise SCART | répartiteur et branchez la sortie 1 | sortie RCA
(Syndicat des constructeurs d'appa- | (périte) a l'entrée péritel AVI du télé- | Dés lors, votre répartiteur péritélévi-
reils radiorécepteurs et téléviseurs). | viseur. Le comportement de 'appa- | sion est testé dans son ensemble et
Les figures 8a et 8b indiquent le | reil vidéo, en l'occurrence l'adapta- | vous pourrez procéder au raccorde-
cAblage des cordons péritel et RCA | teur TNT, ne doit pas avoir chang. | ment définitif de l'ensemble de votre
nécessaires aux divers raccorde- | Débranchez la sortie péritel du répar- | équipement audiovisuel
ments. Avec des cordons péritel croi- | titeur et branchez a la place l'une des
és ou cordons SCART universels de | deux sorties RCA. Limage et le son H. CADINOT
Plus que
seulement P
numérique.
HM1508 CombiScope®
1GSa/s d’échantillonnage
temps réel,
10 GSa/s d’échantillonnage
temps équivalent
Passez vos commandes
i s sur notre site:
1 MPts de mémoire par voie vwrww.arquie.tr
avec HAMEG Memory Zoom enact lcls
pour GATALOGUE papier FRANCE GRATUIT 28.ser fe 08
| voce PFENOM:
www.hameg.com :
HANES
Mosaique
4 ecrans
Cnoir et blanc)
Le présent montage
permet de visualiser sur
un seul écran les images
provenant de quatre |
sources vidéo. est plus
particuliérement prévu
pour des applications de |
vidéo-surveillance. |
© montage est consttué par |
la superposition de deux |
cartes aux fonctions is-
tinctes: la carte vidéo char-
966 de commander le moniteur de
sorts et la carte dacquiston qui
cftfectue la numérsetion des signaux
vidéo provenant des quatre entrées.
Chaque carte est sous le contrdle
d'un microcontréleur PIC. 16F628,
108 pourra carte d'acquistion et C17
pour la carte vidéo. Comme on peut
le voir sures photos, les deux cartes
s'assemblent grace @ l'usage de
‘connecteurs HE14.
Caractéristiques
du montage
La résolution est de 256 points sur
512 lignes pour tout I"écran, soit 128,
points sur 256 lignes pour chaque
pearcelle de la mosaique. C'est sutti-
sant pour un téléviseur de 25 35 cm
environ. Le taux de rafraichissement
est d’un peu plus de quatre images
par voie et par seconde en moyenne,
La réalisation ne fait appel qu’a des
circuits courants d’approvisionne-
ment aisé.
Principe
de fonctionnement
En régime normal, les deux cartes
fonctionnent de fagon parfaitement
indépendante. La carte vidéo génére
un signal de type PAL et atfiche sur le
moniteur le contenu de sa mémoire
écran 114,
Pour sa part, la carte d'acquisition
chantilonne tour & tour les quatre
voies d'entrées et stocke dans sa
mémoire de travail IC4 les images
qu'elle numérise.
és que les quatre voies ont été pas-
30s “en revue", le mode associé au
transfert de données entre les deux
cartes est activé et le contenu de G4
‘est entiérement recopié dans IC14,
puis les deux cartes retournent a leur
activité de routine.
Les explications suivantes supposent
ue vous ayez quelques bases & pro-
pos de la constitution d'un signal
vidéo (trames, demi-trames et interti-
gnages, signaux de synchronisation).
Un article sur ce sujet a 6t8 publis
dans le numéro 288 de novembre
2004.
fe a1 ww electroniquepretique.com ELECTRONIOUE PRATIQUE
Hers
Et mT
ER PE BREET ETT Pr
C18
[TR
ine 1D www.ntoctroniquepratique.com ELECTRONQUE PRATIQUE
La carte d’acquisition
(figure 1)
Cette carte est de loin la plus impor-
tante (13 circuits intégrés). Elle est
‘sous le contrdle du pic 16F628 (\C8),
adeno par une horioge externe
construite autour de loscillateur
ICI1:D dont le signal de sortie, fort
dissymétrique, est remis en forme et
voit sa fréquence divisée par deux par
le compteur IC9:B.
Au final, la fréquence de cette horloge
est de ordre de 2,5 MHz, ce qui est
plutot lent.
Les signaux vidéo issus des quatre
entrées sont acheminés jusqu’au
commutateur analogique IC13. qui
permet de sélectionner la voie qui
doit étre échantilonnée. Cette der-
nigre est déterminge par le PIC par
Vintermédiaire des deux lignes
RBO/RB1 dont W'état logique servira
tout au long du processus de digital
sation & identifier la voie active. On
récupére en sortie du commutateur
IC13 le signal choisi, distribué sur
deux sorties distinctes : la premiére,
notée X, est connectée au convertis-
sseur analogique/numérique vidéo IC1
(TDA 8708) et la seconde, notée Y,
est relige au circuit IC10 extracteur
des signaux de synchronisation hori-
zontale et verticale.
Le PIC analyse ces signaux de la
fagon suivante :
HW attend le passage a l'état bas de la
sortie synchronisation verticale reliée
RAG, ce qui lui indique quill est en
présence du commencement d'une
nouvelle demitrame. A partir de cet
instant, il lu faut compter les signaux
de synchronisation horizontale (sortie
1 du LM1881) pour déterminer le
‘moment oi il faudra lancer la numé-
‘sation (environ 30 lignes a compter
avant le début de la zone image).
Cependant, ces signaux sont trop
courts (4,7 1's) pour que le PIC puisse
les appréhender directement du fat
de sa faible fréquence d’horloge,
aussi a-t-on placé un petit disposi
construit autour de IC3:A entre le
M1881 et le PIC afin de compter ces
lignes de fagon fable,
Pour ce faire, en début de demi-
‘trame, le comptour IG3:A est remis &
zér0 par le passage & l'état bas du
signal de synchronisation vertical,
dont "état logique est inversé par T1
(car le RAZ du L398 est actif a état
haut).
Dés Ia fin de ce signal, le compteur
est incrémenté & chaque impulsion
“iigne” présente en sortie de IC10 et
C'est alors le nombre de ces impul-
sions divisé par quatre que le PIC
compte par V'interméciaire de la sor-
tie Qt du compteur reliée & RAS. Ce
faisant, le PIC examine un toisiéme
signal disponible en sortie de IC10
{ui indique sila demi-trame en cours
est une demi-trame paire ou impair.
Si elle est paire, alors il a rejette et
attend le prochain signal de synchro-
nisation verticale (qui sera celui d'une
ddomi-trame impaire).
Si alle est impair, il poursult la pro-
cédure qui mene & la numérisation
(Remarque : on aurat pu ne lire que
les demi-trames paires ot rejetor les
impaires, important est qu'elles
soient toutes de méme type, car sion
ne les diférenciat pas, image aurat
des “a coups” verticaux du fait du
écalage d'une ligne qui existe entre
‘ces deux dem-trames.
Cela est cependant pénalsant pour
le rythme de rafreichissement des
images. La suite de la procédure
Consiste mettre a 2610 les comp-
teurs d'adresse mémoire ICS et ICS
‘en mettantbriévement a état bas les
lignes RBS et RBS du PIC.
Le comptour ICS sert & adresser les
points de image numérisée, soit 128
par ligne (Q0 a Q6 sont utilisés). Le
compteur ICS sert & adresser les
lignes numérisées de image, sot
.w 10 wow. electroniquepratique.com
286 lignes. Une trame content en fait
287,5 lignes d'image, 31,5 sont done
ignorées. En tout, une image oocupe
32 koctets, soit le quart de la mémoi-
re IC4. Les lignes RBO et RB1 reliées
également a IC4 permettent d'attri-
buer une adresse précise & image
numérisée de chaque voie.
On remarquera que certains signaux
‘de commande passent par un multi-
plexeur (1C7), ceci ayant son impor-
tance au moment du transfert de
données.
Dans le cas présent, la sortie RB2 cu
PIC, placée au niveau bas, force
toutes les entrées marquées A vers
les sorties correspondantes notées ¥.
Le rythme de “venue” des lignes de
image étant sutfisamment lent, le
‘compteur ICB peut etre directement
incrémenté par le PIC. par sa sortie
RBS.
La commande de IC5 est par contre
plus délicate : il est incrémenté par
les fronts montants de I'horloge
‘générés par 1C11:D/IC8:8.
Cependant, ce comptage ne peut
avoir lieu que lorsque la broche
“Count Enable" (ockken) est a ['état
bas et c’est & aide de celle-ci que le
PIC ordonnera le début et la fin du
‘comptage des points de l'image : i
faut bien noter que cela n'est pos-
sible que parce que le compteur et le
PIC sont commandés par le méme
signal d'horioge et sont donc parfai-
tement synchrones.
Ds que le moment de la numérisa-
tion est venu et juste aprés un dernier
top de synchronisation, la procédure
répétée pour chaque ligne numérisée
‘commence.
Le PIC met a état haut la ligne RBS
ce qui a pour effet de bloquerI'oscil-
lateur IC11:0,
Le montage est alors & arr jusqu’a
avenue du top suivant quitait passer
la sortie de IC11:A a l'état haut et
débloque l'oscilateur.
Le PIC est alors synchronisé avec
image a recevoir et fait repasser &
Vétat bas sa ligne RB, puis met
simultanément RAO a 'état bas (auto-
rise le comptage pour ICS), RAI &
Vétat haut (autorise lenregistrement
par le transfert des signaux o'horloge
vers WR par lintermédiaire de
1011:0) et ceci durant 81 ys, a la tré-
quence de 2,5 MHz, soit quasiment
-CTRONIQUE PRATIQUE
128 échantillons. La. numérisation
opérée par le convertisseur IC1, qui |
est ui aussi sous le contrBle de hor-
loge IC11:D, se déroule de la fagon
suivante : le signal vidéo en sortie du
commutateur IC13 est acheming jus-
Qu’a entrée In2 de 101 oi i est trai-
18 par un amplificateur vidéo de gain
variable destin & préparer le signal &
Ja conversion en stabilisant son
niveau moyen et son amplitude maxi-
male.
Pour ce faire, deux impulsions. do
vent 6tre générées_extérieurement,
indiquant & 1C1 le palier bas du top
de synchronisation ligne (Gated) et le
palier de noir (GateB), ce qui est exé-
cuté par le microcontréieur 1G12 qui
est un simple PIC 12C508A qui ana- |
lyse le signal de synchronisation en
sortie de 1010 (LM1881) sur son
| Une fois cela accom
entrée GP2 et commande les deux |
entrées GateA et GateB par GPO et
Pt.
Une fois mis en forme par ce premier
étage, le signal vidéo ressort du
TDAS708 pour @tre fitré par Ien-
semble R9, L1, R10, 019, C20 qui
est un filtre anti-aliasing réduit @ sa
plus simple expression et est amené
‘aU convertisseur 8 bits proprement
dit par la broche ADC In.
Aprés chaque front montant de Ihor-
loge en sortie de IC9:8, la valeur
binaire correspondant au signal vidéo
‘convert est disponible sur les sorties
DO/D7 qui sont reliées au bus DO/D7
de la mémoire IC4 par lintermédiaire
de I'étage tampon IC2 dont les sor-
ties sont actives dans le mode acqui-
sition.
La commande d'enregistrement (WR)
de la mémoire IC4, active a état bas,
regoit un signal dhorloge inversé par
crt.
Ainsi, es données DO/D7 sont rafrat-
chies au début de ce palier bas (qui
comespond au front montant d'horlo-
{92 pour IC1), on est ainsi certain que
durant les demigres 70 ns de ce
niveau bas de WR, les données ne
cchangeront plus et la mémorisation
sera fable.
Il faut également pour cela que
adresse mémoire pointée par les
‘compteurs IC5 et IC6 ne se modifi
pas durant ce niveau bas de WR.
Pour IC6, aucun risque car il n'est
lnerémenté qu'au début de chaque
10. www slectroniquepratique.com ELECTRONIQUE PRA
nouvelle ligne & numériser. Pour IC5,
le délai introduit par IC11:C entre
"horioge IC9:B et la broche WR est
ccompensé par la porte IC11:8 et par
le muttiplexeur, ainsi que par le délai
interne introduit par les compteurs
feux-mémes, aussi adresse restera-
trelle pariaitement stable durant la
phase crtique.
Une fois toute la ligne numérisée, los
sorties RAO et RAT repassent respec
tivement a l'état haut (comptage de
1C5 inactive) et a 'état bas (enregis-
trement inact). Le PIC incrémente
le compteur ligne ICB par RBM, remet
1C5 a zéro par RBG et se resynchroni-
se sur le signal vidéo grace & RBS. Le
cycle recommence ainsi durant 256
lignes de la demi-trame.
le PIC Ic8
commence la procédure de numéri-
sation d'une demi-trame de la voie
suivante en mettant son adresse sur
les lignes RBO/RB1 qui commandent
le commutateur analogique IC13 et la
mémoite ICA et le cycle recommence,
On remarquera que chaque voie pos-
side son propre condensateur de
blocage de la composante continue
dientrée, cela afin de gagner du
temps.
En effet, es signaux vidéo 'entrées
comportent toujours une composan-
te continue qui difére selon les appa-
rails dont is sont issu
Les charges et décharges d'un
ondensateur unique auralent pour
conséquence de perturber I'extrac-
tion des signaux de synchronisation
par le LM1881 et produiraient de
fausses indications au PIC mais per-
turberaient également le convertis-
seur en faisant apparaitre des zones
brilantes ou sombres sur image.
La seule parade serait alors de difé-
rer étude du signal c'entrée durant
un ceriain temps aprés chaque chan-
gement de voie, ce qui ferait perdre
beaucoup de temps.
Malgré cola, il peut ariver partois
qu'une voie ait une tres legére
influence sur la suivante lorsque
Vimage de cette demiére est trés
sombre, le plus souvent lorsque leurs
tensions continues de repos sont trés
différentes. Dans ce cas, intervertr
les deux voies peut résoudhre le pro-
bleme.
Une demi-rame (impaire) est ainsi
numérisée sur chaque voie et une fois
cela accompli, le PIC IC8 a terminé la
procédure d'acquisition et débute la
procédure de transfert en faisant pas-
ser & l'état haut la sortie RB2 signa-
lant quill est prét @ transtérer le
contenu de la mémoire IC4 vers la
mémoire de la carte vidéo.
Nous allons maintenant étudier le
fonctionnement de cette seconde
carte avant de décrire la procédure
de transfert.
La carte vidéo
(figure 2)
En absence de transfer, Ie fonction-
nement de cette carte est le suivant
Voscillateur & quartz IC20:C et D
génare une fréquence fixe de 5 MHz
destinge au PIC IC17, au compteur
de points IC15 et au convertisseur
Numérique/Analogique vidéo C18.
Tout comme dans la carte d’acquisi-
tion, le compteur de points IC15 est
remis zéro au début de chaque
ligne & afficher par le PIC (ligne RBS),
puis son comptage est autorisé
durant 51 us par la ligne RA1 reliée &
entrée “CCLKEN” de ce compteur.
Ala fréquence de 5 MHz, cela donne
256 points. En méme temps, les sor-
ties de la mémoire IC14 sont validées
par le passage a l'état bas de la ligne
RAO.
Ainsi, aprés chaque front montant de
Vhorloge, V'adresse mémoire étant
stabilisée, un nouvel échantilon stoc-
ké en mémoire est disponible sur le
bus de sortie DO/D7 de C14 et est
pris en compte par le convertisseur
seulement lors du retour a l'état bas
de ce signal d’horloge, encore pour
das raisons de stabilte.
Durant la phase d’atfichage, les sor-
ties du circuit tampon 1019 sont inac-
tivées par I'état haut présent sur la
ligne RA du PIC IC17.
Durant la phase obscure (les 13 der-
niéres microsecondes de a ligne, ou
bien durant la phase d’extinction du
‘spot lors du retour écran), les sorties
de la mémoire sont invalidées par le
passage 8 'état haut de RAO de IC17,
alors que celles de IC19 sont validées
parle passage a l'état bas de RAB.
La valeur présentée alors sur le bus
de données, qui est 64, est ue en
permanence & chaque cycle d'horlo-
1620 7206 | |, 16208
oyl tome. | log, | [sume
7asco —“rasoo | “ras
2 ta care vidéo
{ge par le convertisseur IC18 et cor- | sant aux signaux de synchronisation | alors que son comptage sera remis &
respond a la valeur du palier de“noir” | ligne et trame, méme si cette fonc- | zéro pour la demi-trame suivante par
lors des phases d'extinction du spot | tionnalité n’est pas exploitée dans ce | 'intermédiaire de la ligne RB7.
écran. montage. ‘Afin d’obtenir une résolution maxima
Cette valeur est en fait celle qu’attri- | Tout comme dans le cas de la carte | le, les demitrames paires et impaires
bbue par defaut le convertisseur IC1 | d'acquisition, le PIC IC17 est chargé sont différenciées par la ligne RB4
de la carte d'acquisition au niveau | d'incrémenter le compteur de lignes _reliée & IC14 et 'on obtient ainsi une
minimum correspondant au “noir” de | IC16 a chaque nouvelle ligne affichée résolution verticale de 2 x 256 = 512
image, les valeurs comprises entre | de la demi-trame en cours grace au | lignes par trame.
et 64 étant réservées par ce compo- | passage 4 'état haut de la ligne RBS, | Le signal “image” en sortie du
fe 310. wns electroniquepranque.camn ELECTEONIQUE PRATIOUE
convertisseur numérique/analogique
IC18 passe d’abord par un premier
fire construit autour de R18, 023,
L2, C24 et R19 destiné a lisser les
effets de l'échantillonnage, puis
aboutit a un étage ampiificateur &
base commune bati autour du tran-
sistor T2, le réle de cet étage étant
principalement de mixer & ce signal
image, les signaux de synchronisa-
tion “ligne” et “trame” générés par le
PIC IC17 et disponibles sur sa sortie
IBS. L'ajustable RV2 sert a régler leur
amplitude alors que lajustable RVS
détermine le niveau du signal “image”
en sort
Enfin, le signal “composite” ainsi
‘généré passe par un adaptateur dim-
pédance formé par T3, R24 et R25
pour étre disponible sur la prise RCA
de sortie vidéo permettant de relier le
montage & un moniteur de télévision.
Le transfert
Son principe est le suivant : au
moment d'atficher une nouvelle
‘ame (done une suite de deux demi-
trames), la carte vidéo va lire et aff-
cher le contenu de la mémoireIG4 en
lieu et place de colui de IC14 qu'elle
litnormalement.
Ce falsant, les données de IC4 étant
sur le bus, elles seront mémorisées
“au vol" par IC14 et une fois la
mémoire IC4 entiérement lue_par la
carte vidéo, son contenu, en plus
diavoir ét6 affiché pour la premiére
fois @ lécran, aura été mémorisé
dans la mémoire écran 1C14 qui rede-
viendra és ors la mémoire de travail
de la carte vidéo, les deux cartes
reprenant leurs activités séparées.
Lors du transfert, les données transi-
tent par la jonction Jt et le tampon
163 qui est activé en mame temps
ue les sorties de la mémoire IC4 par
la sortie RAS du PIC 1017, alors que
12 et IC14 voient leurs sorties inacti-
ves par la ligne RA2 ot RAO de IC17.
‘Au démarrage, les résistances Rt,
2, R12, R13 maintiennent un état
hhaut durant le reset interme des PICs,
Inactivant toutes les sorties des com-
posants du bus de données.
Comme nous avons vu, "initilisa-
tion du transfert est rélisée par le Enfin, le passage &
passage a I'état haut de la ligne RB2
du PIC IC8 de la carte d'acquisttion.
Cet état haut est aussi retransmis au | sur le bus DO/D7 en provenance de
PIC IGt7 de l'autre carte par son | 1C4 parla mémoire C14 de fagon &
ceirée BO par le bias de la jonction | atficher continuellement cette nouvel-
inter-cartes 13 le mosaique lorsque la carte daca
Il sert également de commande au | sition cessera le transfert. ci encore,
‘multiplexeur IG7, sélectionnant tes | la présence de la porte IC20:B sert &
voles marquées B pour étre drigées | compenser le retard généré par la
vers leurs sorties Y respectives. présence de IC20:A et garantir la far
‘Ansi, le compteur de point ICB voit | bilté de 'enregistrement.
‘son horloge devenir calle de la carte
vido 1020:0 et D (par J) et son
autorsation de comptage passe sous | Valimentation
le contréle du PIC IC17 de cette | (figure 3)
méme carte par Vintermédiaie de sa
sortie RAS.
Par contre, la remise & zéro de 105
reste sous le contrble de IC8, il doit
‘done y avoir communication entre les
deux PICs pour synchroniser ces dit | tension positive nécessaire au fonc-
cece sone, tionnement des circuits logiques IC1
este but du signal issu da sortie | 4 1G20 et aux ampliicateurs a transis-
RAZ de IC17 qui passe 4 'état haut | tors, mais également une tension
‘chaque part afichée d'une ligne (51 | negative destinée au seul commuta-
bs). Un second signal issu également | tau iG13 quia réclame afin de linga-
de 1017 par RB2 et connecté &'en- | riser sa caractéristique de transfert ot
ltée RAS de IC7 passe a état haut | Grapaisser sa résistance interne
‘durant tout le temps du transfert (SUr | assez élevée autrement. Deux jonc-
deux demi-trames donc) et son Pas- | tions aménent I'alimentation a la
sage a l'état bas indique 4 IC8 qu'il | carte vidéo : J5 pour lalimentation
peut reprondre son activité courante | Sos crcutte analogues et J pour
d'acquistion dimage. les circuits numériques.
Le compteur ligne IG8 reste entiére-
ment sous le contréle du PIC IC8,
seule sa sortie QO est déconnectée | Le calcul de
de 'adressage mémoire et remplacée | fa durée d’un cycle
‘au niveau de IC7 par le signal indica-
teur de demi-trame provenant de la | I reste & estimer la durée d'un cycle
sortle RBS de 1017 (par J2). complet comprenant I'échantillonna-
‘Ansi, les données correspondant aux | ge des 4 voies vidéo d'entrées et le
adresses paires dela mémoire seront | transfert de la mosaique complete
mémorisées dans la zone associée & | dans la mémoire “éoran’ IC14. En
la demi-trame paire de 'image géné- | fat, les signaux vidéo présents en
16e par la carte vidéo et les adresses | entrées. ne sont pas synchronisés
impaires seront pour leur part, asso- | entre eux, ni avec celui de la carte
ciées a la demi-trame impaire. On | vidéo. Tout aussi important, cette
respecte ainsi Tinterignage propre | désynchronisation Muctue sans cesse
‘aux téléviseurs afin d'obtenir la réso- | du fait des infimes mais signifiantes
lution veticale de $12 lignes annon- | différences de leurs bases de temps
cée. Le demir signal d'importance, | (méme & quart).
lors du transfert, consiste a substituer | Aussi, chaque cycle, ces désyn-
‘aux poids faibles des numéros | chronisations vont étre a lorigine de
<'orans (FBO de C8), le signal issu | retards divers, lorsque le programme
‘de RAS de IC17 de facon & changer | attend Ia venue d'une demi-trame
Vécran lu en mémoire lorsque l'on | impaire.
passe de la partie gauche la partie | Ans la durée du cycle évoluera entre
‘droite de image durant fe transfert. | deux extr8mes, soit environ de trois
‘tat haut de la | images par seconde dans le cas lo
Le montage est alimenté par un
transformateur de 2 x 9 V de puissan-
ce 10 VA minimum. Le redressement
est effectué directement sur la carte
Tacquisition de fagon a obtenir une
| sortie RA2 du PIC IC17 autorise 'en- | plus défavorable & environ sept
registrement des données circulant | images par seconde dans le cas le
ine 10 wwnvetectroniquepratique,com ELECTRONQUE PRATIQUE
Ts 00m | 100m tow Te
“sv
Fkcw Seen son seco Hace Seon
owe | wove Toa | oer aay | Hone
Ea ia
— en
Lalimentation fait Seo en one
appel é de nombreux [i ane
régulateurs = me
plus favorable. La moyenne s'établit | de quatre images par seconde. ralisation et aux différents régiages.
done cinq mais en pratique la | Le mois prochain, nous terminerons | A trés bient6t.
‘cadence observée est plutét proche | ce montage en nous attaquant a sa ©. VIACAVA
AS ELECTRONIQUE
L'UNIVERS ELECTRONIQUE
Catalogue Général
OSelectronic (| Selectronic
ES
Cori
Coupon 4 retourner &: Selectronic B.P 10050 + 59891 LILLE Cedex 9
UL, je désire recevoir le Catalogue Général 2007 Selectronic [iM
& adresse suivante (cijoint 10 timbres-poste au tarif “lettre” en vigueur ou 5,50€ par chéque):
Mr. / Mme
Code postal
“Conformément ao informatique et ibertésn* 78.17 du 6 jonvier 1978, Vous caposer
‘Tun drt sobs et de retention aux données vous concarsan™
Domotique
Veilleuse
multicolore
* Cette réalisation tres
simple exploite un
nouveau modéle de diode
électroluminescente un
peu particuliére. Mise
sous tension, celle-ci
présente automatique-
ment une succession de
couleurs différentes, sans
aucune intervention de |
|
notre part!
ete diode intégre un
systéme électronique
innovant, permetiant & |
la led de parcourir cyoli-
quement chaque couleur aprés un
délai non réglable et avec un fondu-
enchainé du plus bel effet. Le cycle
est Immuable : rouge, blanc, bleu,
vert, jaune, violet. La tension d'ali-
‘mentation requise est de 3 volts, pour |
Un encombrement identique & celui
d'une led de § mm environ.
Nous allons mettre en ceuvre deux de
ces nouvelles leds dans un petit bor
tier contenant initialement une
veillouse néon, pllotée par une cellule
photorésistante. Le fonctionnement
de notre maquette sera identique,
mais l'éclairage en couleurs chan-
geantes sera bien plus agréable a
Veil | Pour accentuer encore effet |
magique de cette led, nous associe-
rons deux circuits de commande
indépendants, présentant un petit
décalage trés bénéfique a la succes-
sion des couleurs.
Schéma électronique
West donné en figure 1. I! comporte
lune section d'alimentation un. peu
originale et deux fois le meme sché-
HE Pricive de fonctionnement deta veillouse
ECTRONAQUE PRAT:
ma de commande (aux tolérances
prés). En raison de la trés faible
‘consommation de notre disposi, il
ne sera pas nécessaire de faire appel
un transformateur, toujours lourd,
encombrant et codteux. II nous suffit
d'exploiter la réactance d'un conden-
sateur présentant une tension d'iso-
loment suffisante sur le secteur.
Un modéle 400 volts minimum est
conseillé, voire 630 volts si dispo-
nile. Il s'agit de C1 sur le schéma
‘Sous une tension alternative, un &ié-
ment diélectrique se laisse traverser
Par un courant, ce qui provoque a ses
bornes une chute de tension grace
(oa cause) de son impédance notée
Z.Laperte o'énergie, contrairement &
colle d'une résistance chutrice clas-
sique, est pratiquement nulle en rai-
son du déphasage de 90° que l'on
constate entre tension et courant.
L’échauftement de C1 est done nul!
Son impédance se calcule par la rela-
tion suivante
Zo=4/2n-1-C
(freprésente la fréquence en Hertz ot
C la capacité en Farad)
LLintensité disponible reste faible et
se détermine une fois de plus grace &
la loi d'Ohm
[2UZe=U-2nt-C
et finalement : C = V2 xf U
Pour une consommation estimée &
50 milliamperes et avec un secteur de
230 volts & 50 Hz, on prendra
0,050/2 x - 60 - 230 = 692 nF
Nous avons choisi un modale 1 pF
isolé & 400 volts,
Attention ! Nous attirons dés a pré-
sent votre attention surle danger li &
ce schéma particulier dont une
connexion est directement reliée au
secteur ! En outre, aprés la mise hors
service, il subsiste une charge dange-
reuse dans le condensateur C1 que
l'on décharge trés rapidement a l'aide
de la résistance RI de forte valour.
Le redressement est assuré par les
diodes D1 et 02, tandis que la zener
3 (valeur 10 volts) assure une stabi-
lisation suffisante. Le fitrage de cette
tension unidirectionnelle est assuré
par les éléments C2 et surtout C3 de
forte valeur.
Pour la mise sous tension de la led L1
ou L2, un transistor NPN est mis &
contribution,
La cellule photorésistante LDR2
forme avec la résistance R3 un véri-
table pont diviseur.
En pleine lumisre, la cellule présente
une résistance trés faible, polarisant
la baBe du transistor T1 en négatif.
Le transistor est donc bloqué, par
conséquent la led RVB/L1 reste
éteinte. On pourra d'ailleurs monter
Un élément ajustable en lieu et place
des résistances R2 et RS.
Dans 'obscurité, la cellule offre une
résistance ohmique trés importante
et la base du transistor est reliée au
pole positif a travers R3 et RA.
La led L1 sillumine et débute son
cycle dallumage préprogramme.
Les leds et les cellules LOR sont
Intérieur du boitier d'origine conte-
‘nant une veilleuse néon et une cellu-
Je photorésistante
Nomenclature
Semi-conducteurs
D1, 02: 1N 4007
0 zn 10 volts
11, 12: 2N 2222, boiler TO 92
1! L2: lode le a att VE (Conrad)
Résistances
(toutes valeurs 1/4 de watt)
Ri: 1 Ma
2, RS: 100 ko.
4, AB 1 KO
6, A: 270.0.
Condensateurs
C1 1 UF, isolement 400 V minimum
c2:470nF
63: 470 pF/ 25
Divers
Boitier Teko
Prise de balisage secteur
2 collles LOR cyrincriques (8 récupéres)
Fils soupes
Le méme fonctionnement est valable
ben entendu sur la led L2. Aucun
réglage ne sera nécessaire et vous
serez vite fasciné par la succession
tres lente des diverses couleurs et le
mélange des deux circuits iden-
tiques.
Réalisation
On trouve facilement dans tous les
supermarchés, au rayon bricolage ou
articles électriques, de minuscules
prises lumineuses idéales pour loger
notre application (voir photos)
nous importe de conserver la prise
secteur @ deux broches et le cabo-
Domotique
Le module est enfermé dans un bot-
tier Teko
cchon translucide. Avec un peu de
soin et de patience, on parvient & dis-
socier les deux éléments et a leur
adjoindre un petit bottier isolant, Teko
our notre prototype. Le circuit impri-
mé d'une taille trés rédulte comporte
tous les composants du schéma, les
deux leds ot les deux cellules LOR
étant installées c6té cuivre pour
apparaitre juste sous le cabochon
translucide (figures 2 et 3).
Velez & bien isoler les éléments
avant la fermeture du boftier qui pour-
ra s'enficher dans une prise 2P stan-
dard, pour un fonctionnement immé-
iat.
G. ISABEL
fe 210 ww.electroniquepratique.com ELECTRONIQUE PRATIOUE
Micro/Robot
Réegulateurs
de température
Ilexiste de nombreux cas | Schéma
cer are aes Nos deux réalistions utilsent un
souhaitable de réguler ——_capteur de temperature pour déter-
activement la température | miner le point de fonctionnement
S i csi
de fonctionnement d'un | ous avons sélectionné un captour
montage électronique. trés répandu qui est encore distribué
Parfois, il est impératif dans un boitier non CMS (boitier
= i 7092, dans notre cas). I s'agit du
évacuer les calories sore tmasee
lissipées par les compo- | (es capteurs LM135 ou LM235 |
sants (c’est le cas de la __conviennent également, mais ils sont
ae 4 | Sénéralement un peu plus codtoux.
majorité des micropro- Le LM335z se caractérise par une |
cesseurs de nos PC tension nominale & ses bornes qui est
modernes). Au contraire,
proportionnelle a la température
absolue de son boitier (température
exprimée en °4),
Il est calibré pour développer une
tension de 10 mV/°K, dans une plage
d'utilisation alant de -40 °C (233,15 °K)
& #100 °C (373,15 °K). Rappelons
ue le zéro de la température absolue
(exprimée sur une échelle dynamique
fu absolue dont |'unité est le degré
Kelvin) est décalé de -273,15 degrés
ar rapport @ notre échelle usuelle
des températures (échelle Celsius)
Le passage d'une échelle a autre se
fait facilement a l'aide de la relation
suivante : T(°0) = T(*K) +273,15.
il faut réchautfer artificiel- | EWM controie de température par ventilation
lement la température de
fonctionnement d'un sys- |,
téme pour augmenter la swoon
stabilité de certainesde
ses caractéristiques (la
fréquence d’un oscillateur
a quartz, par exemple).
ous vous proposons de
réaliser deux montages
‘és. simples qui vous |
aideront & résoudre effi |
cacementles deux problémes de tm |
perature que nous venons 'évocuer. |
ne BID www.electroniquepratique.com ELECTRONIQUE PRATIQUE
Micro/Robot
EEA conirate to température par résistance chautfante
SSil'on applique cette relation la ten
sion de sortie de notre capteur de
température, on obtient
V)= 2,7315 4(T x 10 mvc)
avec V exprimé en volts et Ten
Par exemple, lorsque la température
ambiante du boitier du capteur est &
+25 °C, la tension présente & ses
bores est de lordre de 2,98 V.
La proportionnalité de la tension de
sortie par rapport & la température
absolue du boitier rend le capteur
M3362 trés simple & utiliser, comme
vous pouver le constater par vous-
méme sur les schémas reproduits en
figures 1 et 2
Le schéma de la figure 1 représente
un petit systéme de contréle de tem-
pérature par ventilation, tandis que la
figure 2 roproduit un petit systéme
de controle de température par résis-
tances chauffantes. Comme vous
powver le constater, les deux sché-
mas sont quasiment identiques, & la
polarité de détection pres.
Dans le cas du schéma de la figure 1,
la tension développée par le capteur
de température (03) est comparée
par le circuit Ut via sa broche positi-
ve @) & une tension de référence
appliquée & sa broche négative (3)
Lorsqu'une tension aux bores du
capteur de température dépasse la
tension de référence (c'est-a-dire
lorsque la température du capteur
augments), la sortie du comparateur
Ut passe a l'état « haut », ce qui
polarise le transistor MOS (T1) dans
un mode saturé. Cela déclenche le
ventilateur qui est raccordé au
‘connecteur CN2,
Notez que le transistor retenu pour ce
montage permet de commuter un
‘courant pouvant monter jusqu’a 3,
‘ce qui est largement surdimensionné
pour piloter la plupart des ventila-
teurs alimentés en 12 V auxquels
notre montage est destiné,
Notez qu'avec notre schéma, la limi-
tation de la puissance du ventilateur
est plutot dictée par les possibites
de la diode D1 (ne dépassez pas 1A
avec cette diode). Ceci dit, revenons,
& notre explication principale,
Sous |'effet du ventilateur (libre a
vous de positionner ventilateur et
capteur & proximité du systéme dont
vvous souhaitez réguler la températu-
re), la température du capteur D3 va
baisser, entrainant du méme coup
une diminution de la tension dévelop-
pée a ses bornes.
Si le ventilateur est correctement
dimensionné, la température du cap-
teur descend en dessous du seuil
pour lequel la tension & ses bornes
fet inférieure & la tension de référen-
ce. Dés lors, la sortie du comparateur
Ut retombe a zéro entrainant du
méme coup le blocage de Tt et 'ar-
rét du ventilateur, Sous effet de la
chaleur dissipée par les systémes
‘environnants, la température du cap-
teur a vite fait d'augmenter & nou-
vveau, entratnant un nouveau cycle de
refroidissement.
ne HO wanvelectronquepratique.com ELEC
aeaa
‘Au final, la température oscille sensi-
blement autour du seuil pour lequel le
ventilateur est mis en fonctionne-
ment, ce qui assure une régulation
convenable de la température des
systémes placés & proximité du ven-
tilateur (sous réserve d'un bon
dimensionnement du systéme de
ventilation vis-a-vis des calories a
évacuer)
Le montage est concu pour fonction-
ner de 9 V 8 12.V, via une alimentation
raccordée & CN1. La tension d'ali-
‘mentation n’a pas besoin d'étre régu-
I6e, mais elle doit étre correctement
filt’ée. Un petit bloc d'alimentation
‘capable de fournir le courant néces-
saire au ventilateur, avec une surchar-
ge de 50 mA, sufft argement.
La diode D1 protege le montage en
cas d’inversion du connecteur d’ali-
‘mentation, tandis que la diode zener
D2 permet de maintenir une tension
de référence relativement insensible
aux variations de I'alimentation (en
revanche, ce n'est pas le cas de la
vitesse de rotation du ventitateur)
La résistance variable P1 permet de
fixer le seuil de référence, ce qui
détermine la température désirée. Le
condensateur C2 filtr les oscillations,
parasites du montage, sachant que le
comparateur est monté ici sans hys-
terésis,
Lhystérésis naturel du comparateur
suffit& notre application, sachant que
la stabllité de notre boucle de réguia-
tion dépend essentieliement des pro-
RONIQUE PRATIOUS
Micro/Robot
°o ® pa °
-
|e
n
THT
° foo] an ©
| 3 | CI du contréle de température par ventilation Ea Insertion des composants
cartamclatal ment inversée par rapport au monta- | confinement thermique au strict mini-
aS ge de la figure 1. Cette fois, le monta- | mum. Vous serez donc certainement
ondensateurs ge ne pilote plus un ventilateur mais | amenés & déportr les résistances et
Ch ean te des résistances chautfantes de 33 9 | le capteur.
o (RB & RQ) destinges & élever la tem- | Pour vous offrr un peu plus de latitu-
ihdeishanste | pérature ambiante du systéme dans | de dans le choix des résistances Ré &
RY :1,B KO 14 W 5% lequel ce montage sera placé. RR9 (en fonction du volume quil faut
(Marron, Gris, Rouge) La tension de référence et la tension | réchautfer), nous avons changé la
F256 KO V4 W5 % du capteur de température ont chan- | diode D1 pour ce montage.
(a, Bi, Faun 16 dentrée sur le comparatet Ai 12, k
Ce ae ane er 9 parateur, ce | Ainsi, sous 12 V, vous pourrez « pilo-
Giaune, Vell, Rouges Qui inverse le sens de asservisse- | ter» des résistances aiant de 33.2 (4 W)
RAS. KR 14 W 5 9 ment. Le transistor T1 est maintenant | jusqu’a 22 © (6,5 W), ce qui devrait
(Orange, Blanc, Rouge) passant tant que la température du | suffire & bien des applications (au
RS 110 ka. 14 WS 96 aptour est inférieure au seuilmposé | total, cela fat tout de méme 4x 6,5 W
(Maron, Nov, Orange)
par la position de la résistance ajus- | dissipés, sans méme parler des
ouside? table P1. Sous leffet de la puissance | pertes dans T1).
“T1:IRF890 ou équivalent cissipée par les résistances RE 4 R9, | Nous attirons votre attention sur les,
Urs LMat1P la température ambiante va monter | risques de brolure encourus avec ce
Di: 1Na001 | jusqu’a ce que la tension développée | deuxiéme montage, si jamais la
(Giode de recressement 1 A/100 V)
ghar acest yt par le capteur soit suffisante, consigne est régiée en position maxi-
a : LMag62 (ou LM95/L M236) Ge mode de régulation de la tempé- | mum. De plus, en cas de défailance
rature est couramment employé pour | du montage (par exemple, en cas de
Divers garantir une trés grande stabilité sur | court circuit sur T1 ou bien sila résis-
Nt, CNB: Bomier avis 2 contacts | des oscilateurs & quartz. Le point de | tance Pt est ouverte), la température
Sern fonctionnement se choisit générale- | atteinte par l'ensemble du systéme
ment quelques degrés au-dessus de | pourrait entrainer un risque d’incen-
priétés du capteur de température et | la température ambiante maximum. | die (selon les dimensions globales du
des performances du syst8me de | Quelque 40 °C 850°C peuvent suffi- | systéme, la résistance thermique et la
ventilation. | re en région tempérée, mais 60 °C | nature des matériaux employés, 'en-
‘Ajoutons, pourterminerla description | 70 °C sont préférables pour une | vironnement dans lequel le systéme
du schéma de la figure 1, que la sor- | meilleure marge de fonctionnement | est utilisé, et). Evitez donc a tout
tie du comparateur U1 est une sortie | dans des environnements diffciles, | prix de surdimensionner les résis-
A collecteur ouvert, d’oi la présence | tels que derriére le pare brise d'un | tances chauffantes par rapport au
de la résistance RS pour polariser | véhiculestationné en plein sole volume que vous devez chauter et
correctement le transistor MOS (T1) | Il va de soi que les résistances R6 @ | refusez d'utilser un tel montage dans
lorsque le comparateur passe & état | RO et le capteur D3 doivent étre | des locaux non surveillés
«haut » confinés avec le systéme dont il faut | Pour estimer les risques d'un surd
Passons maintenant au schéma de la | réguler la température. La mise en | mensionnement dangereux du syst
figure 2 qui est trés proche du précé- | coffret est généralement un peu plus | me, vous pouvez simuler les effets
dent, mais dont la finalité est totale- | délicate et il est fréquent de limiter le | d'une panne d'asservissement sur le
ne 310 www olectraniqueprenque.com ELECTRONIOUE PRATIC
Micro/Robot
Ro
Re
RT
=a
Cox
=
@ fe
- |
[Gay isertion des composants
°
my du contre de température par résistance
chauffante
En ce qui concerne les borniers & vis,
la diode 1N4001 et les transistors
MOS, il faut repercer les pastilles
systéme final (dans son environne.
ment de travail rée!) en retirant la
résistance ajustable P1 du montage.
ccelui-ci avec les doigts permet de
faire évoluer rapidement sa tempéra-
ture et de dépasser le seul)
En mesurant la température interne
du systéme pendant un temps sufti-
sant, vous pourrez déterminer
asymptote de votre systéme en
boucie ouverte et juger s'il existe un
risque incendie du systéme (en
fonction des matériaux employés) en
cas de défallance du montage de
‘commande. Les lecteurs sont encou-
ragés @ la plus grande prudence
quant aux conditions de mise en
ceuvre et au dimensionnement de ce
montage qui reste de leur seule res-
ponsabilte
Réalisation
Le dessin du circuit imprimé du
contréleur de température par venti-
lation est en figure 3. L'implantation
est reproduite en figure 4. Le dessin
du circuit imprimé du contréleur de
température par résistances chauf-
fantes est reproduit en figure 5 et
implantation en figure 6.
Les pastilles des circuits imprimés
sont percées a l'aide d'un foret de
0,8 mm de diamdtre pour la plupart.
avec un foret de 1 mm de diamétre.
Pour la diode MBR7S1, utiliser un
foret de 1,5 mm de diamatre.
Enfin, n’oubliez pas de percer le trou
de passage pour la vis de fixation du
transistor MOS (trou de 3,6 mm de
diamétre) pour pouvoir plaquer le
transistor sur un dissipateur ayant
une résistance thermique inférieure &
18 °CWV.
Avant de graver le circuit imprimé, il
est préférable de se procurer les |
‘composants pour s'assurer qu'ils
s‘implantent correctement. Cette
remarque conceme particuliérement
les borniers a vis et les résistances de
puissance. |
LLors de la premiere mise en service |
des montages, vous pourrez régler la |
résistance ajustable P1 pour que la
tension de référence appliquée au
comparateur soit de 3 V environ, ce
qui correspond & une consigne de
26,85 °C (voir la formule indiquée en
début d'article). Cela vous permettra
de les tester & partir d'une position
connue oi il est facile d'agir sur le
capteur (le simple fait de toucher
P. MORIN
Nomenclature
Condensateurs
G1: 220 uF/25 V
2: 10nF
Résistances
FI: 1.8kQ 1/45 %
(Marron, Gris, Rouge)
PO: 58kD 1/4W5.%
(Vert, Bleu, Rouge)
RO: 47 KO 1/4 W5 9%
(Gaune, Violet, Rouge)
Ra: 39k 1/4 W596
(range, Blanc, Rouge)
RS: 10 ka 1/4 W5 %
(Marron, Noi, Orange)
6, R7, RB, AO:33.0 4 WS %
Semi-conducteurs
TH :IRFB30 ou équivalent
ut: Latte
1 : Diode MBRTS! (3 A)
12: Diode Zener 5,6 V (1/4 W)
3 : LMS352 (ou LM135/LM235)
Divers
CNT : Bomier& vis 2 cont
(au pas de 5:08 mm)
PI: Ajustable 10 KO
Ce chenillard est destiné
& commander une rampe
de 10 spots. Le nombre
important de voies n'est
pas le seul atout de ce
jeu de lumiére, puisqu'il
allie a la fois le principe
du chenillard et du
gradateur.
1 effet, d'une part la lumi-
nosité de la lampe qui
défile successivement de
voie en voie est réglable
paar \interédiaire d'un potentiométre
place en fagade de l'appareil, d'autre
part la vitesse du défilement est fone-
tion de I'intensité sonore captée par
lun microphone. De plus, une sélec-
tion est prévue pour commander le
defilement partir d'un signal a'hor-
loge externe.
La figure 1 présente le schéma de
principe de ce jeu de lumiére. Il se
compose des sous-ensembles sui-
vants : V'alimentation, le gradatour, le
préampiificateur, le convertisseur de
niveau sonore, le VCO et le che-
nila.
Un transformateur de faible puissan-
ce abaisse la tension secteur et assu-
re un isolement galvanique entre le
réseau et I'alimentation basse tension
du montage. La tension alternative
50 Hz/12 Veff du secondaire est
redressée par un pont de Graétz
Constitué des quatre diodes D1 a D4.
Dans un premier temps, ce pont est
chargé par le diviseur de tension
RA/R2. Par ailleurs, la diode DS char-
ge le condensateur de lissage C1.
La tension continue qui en résulte est
ensuite régulée par un classique
7808, stabiisé par le condensateur
de découplage C2.
Le pont de résistances R1/R2 polari-
se le transistor T1 dont le collecteur
‘est chargé par la résistance R3. Ce
transistor est ainsi conducteur pen-
dant la quasi totalité d'une alternance
secteur, bloquant la jonction base-
4metteur de T2 qui ne peut alors
cconduire
Par contre, & chaque transition d'al-
temance secteur, la tension redres-
‘sée passe par ce que l'on appelle
‘couramment le zéro secteur. La base
du transistor T1 étant A cet instant a
0V, ce demier est bloqus.
La base de T2 est alors libérée et la
résistance RS sature le transistor T2.
Pendant la durée du zéro secteur, la
‘saturation du transistor T2 entraine la
décharge du condensateur C3 dans
la résistance 6. La constante de
temps RE-C3 étant trés faible par rap-
ror eremteet)
Teal Bogue
Vee Vain va RL
Masse
|
port & une alternance secteur, la |
décharge du condensateur C3 est |
quasi instantanée, Cette phase cor-
respond au front raide, descendant
de la dent de scie évoluant aux
bores du condensateur C3,
Par contre, dés que le transistor T2
est bloqué, le condensateur C3 com-
mence & se charger & courant
‘constant car le transistor T3 est pola-
fsb en oénrateu de courant. |
L’évolution de la tension aux bornes
du condensateur C3 est ainsi linéaire.
En effet, le potentiel de la base du |
i] Aim + étage te srt
Cotecteur du LM311 est
[Bl] caoncesvove —constitué d'un
transistor de
puissance &
Collecteur ouvert
o-
vor 2
©
BS || vores
Halo cares ere
Gear —O
La réalisation |
Bien que la carte soit d'un format |
imposant (igure 4), la réalisation de
ce jeu de lumigre demeure assez |
simple |
De plus, la mise au point est sécuri- |
266 par l'utilisation d'optotriacs qui
assurent une isolation galvanique
parfaite entre le réseau secteur et la
fn B10 wwnvelectroniquepratique.com,
parte basse tension ogique et ana-
logique)
Dans un premiar temps, la self L1 rest
pas montée sur la carte (figure 5).
Ans, "étage de puissance no sera
as Sous tension pour les premiers
fessais. Cette self est un mode anti
parasite pour trac ou thyristor, mais
est conseils, pour cette application,
de réaliser un bobinage sur un tore
Nomenclature
Résistances
FR, R2, RB, R10, RIG 4,7 KO.
{Gaune, violet, rouge)
4 : 470 0 (lune, violet, marron)
5:22 ka (rouge, rouge, rouge)
RB: 100 0 (marron, noi, marron)
FRY, RB, R17, R22, R23 : 22 KD
((ouge, rouge, orange)
9, R15, F20, R23: 10 ke.
(marron, nor, orange)
Rit, R14, R16, R18 : 220 KO
((ouge, rouge, jaune)
2, RI: 1 KO (marron, nor, rouge)
21: 100 kA _ou alustable de 220 ka.
(marron, jaune, jaune)
ad: 47 kG (aun, violet, orange)
RDS : 1 MO ou ajustable de 1 22,2 MO
(marron, not, vert)
26 : 1,8 kA (marron, gris, rouge)
R27 : 100 kA (marron, noir, jaune)
26 a ROT: 15 KO
(rmarron, ver, orange)
R38 a RAT : 390 02
(orange, blanc, marron) ou 270 9 si
M3020 au lieu de MOCS021
R46 a RST : 390 0
(orange, biane, marron)
ANN: 4,7 KO.
Pt, P2:47 kA ou 100 ka.
Condensatours
61: 200 pF/I6V
(©2, 05, C12, C15, O16 : 100 nF
63, 08, 611: 470 nF
G4: 47 prIBV
65,07 10 yFI6 V
(63: 220 nF
C10: 1 prABV
(C13: 47 pRAOV
(614: 100 nF/400 V
Semiconducteurs
D1 ADS: 1N4OOT .. 4007
DB : Led rouge 03
D7: 1Nataa
Tt, 72: 80548, 86297, BCS47
Ta: BCS58, BCS87
T4aT19 : 80398, BC337, BCSAB
Qt aio: BT137-F
trae 4 48 4/400 & 600 V
Ct: 78L08, 7808
12: Lastt
is: Laz
Cid: NESSS, LM555, TS555,
Gis: 4017
Gi6 @ C115 : Moos021, Moos020
Divers
IM: microphone & électret
Lt: sei antiparasite 5 A pour triac
TRI :transformateur 220 Vi12 V
-2Va
Ft : fusible rapide 1,6 A, 6 x 20
SW! A S11: 11 borniers 2 plots
pour Cl
1 support de fusible 5 x20 pour Cl
magnétique avec un nombre de | Vous pouvez également obtenir le | sortie. Placez le potentiomatre P1 &
spires Important, la section du fil réglage de Alt approximativement en | mi-course et le potentiométre P2 en
étant alors adaptée a la charge maxi-_ recherchant la plus grande sensibiité | butée & gauche (volume minimal).
‘male par vole. de la gradation obtenue avec le | Dés la mise sous tension du secteur,
Avant la mise sous tension, vous véri- | potentiométre P' la led D6 doit étre allumée et une
fierez le bon sens d'implantation des Ensuite, vous procéderez a 'étalon- | lampe doit écairer avec une brilance
condensateurs polarisés, des diodes, | nage de R25. En l'absence de micro- | moyenne. Agissez alors sur P1 pour
des transistors et surtout des circuits | phone, vous devez relever sur la sor- | régler la luminosité de cette lame.
intégrés, tie (1) de Gi8 une tension legerement | Si ce test est satisfaisant, vous
Placez le curseur de la résistance | inférieure a colle relevée aux bores | n‘avez plus qu'a augmenter le volu-
ajustable Aj1 a mi-course, ainsi que | de la résistance R26, broche (5) de | me a l'aide du potentiométre P2 pour
celui des résistances ajustables R21 | Cl4, soit environ 1,9 V. ‘observer le défilement d'un spot dont
et R25, si vous avez opté pour des En présence d'un fond sonore, vous | la luminosité est régiée par le poten-
modeles alustables (verticaux ou pouvez conclure cette premiére | tiométre Pt
miniatures) phase d'essais en observant les | Sinon, débranchez votre montage et
Si vous possédez un osciloscope, variations de tension en sortie (1) du | procédez & de nouvelles verifications.
‘observer le signal triangulaire présent LMS24, en fonction de lintensité | Pour des lampes d'une puissance
sur la broche (3) du LM311. Réglez sonore et du réglage du potentio- | supérieure a 300 W, les triacs doivent
alors Aj1 pour que la dent de scie soit matre P2 @tre équipés d'un radiateur. Une
pointue avec une amplitude maximale. Dans un second temps, vous procé- chute de t6le en aluminium de 2 mm
‘Sinon, vous pouver effectuerlerégla-_derer a l'essai de I'étage de puissan- | d'épaisseur,fixée au bottle du trac &
ge de Aj1 A l'aide d'un muitimétre ce et ainsi de l'ensemble du monta- | l'aide d'un boulon MS et d'une ron-
numérique. Sur le calibre 20 Voc, ge. Pour ce faire, a self L1 prendra delle évental, est une solution.
‘yous devez lire une tension d'environ place sur le circuit imprimé et une
3V aux bornes du condensateur C3. | lampe 220 V sera placée sur chaque H. CADINOT.
TRIODES
TETRODES Et st vous réalisiez
votre ampli a tubes...
Une sélection de 9 amplificateurs
de puissances 9 Weff a 65 Weff
4 base des tubes
triodes, tétrodes ou pentodes
Des montages 4 la portée de tous
en suivant pas a pas nos explications
= = = = = aes fe ef a >g
Je désire recevoir le CD-Rom (fichiers PDF) « Et si vous réalisiez votre ampli a tubes.
France :30€ Union européenne : 30 € + 2 € frais de port Autres pays : nous consulter
Nom
Ne
Code Postal Ville-Pays
Prénom :
4Je vous joins mon réglement par : C.chéque 1 mandat
Arretourner accompagné de votre réglement a: TRANSOCEANIC 3, boulevard Ney 75018 Paris Tél. : 01 44 65 80 80
ee Aart
Une interface
GPIB/USB
largement le bus GPIB. II existe on
fait deux standards, identiques dans
leur fonctionnement, mals différents
sure plan de la connectique : Ie stan-
dard américain IEEE488 et le stan-
dard international IEC 625. Le pre-
‘mier utlise un connecteur de type
‘« Micro Ribbon » & 24 broches, alors
que le second utilise un connecteur
de type SUB-D a 25 broches. Il exis-
te, heureusement, des adaptateurs
permettant de passer d'une connec-
tique a l'autre. II est A noter que le
standard IEC 625, avec son connec-
teur SUB-D, comporte un risque de
confusion avec par exemple les
anciens ports RS232 a 25 broches et
qu'une erreur de branchement peut
Les appareils de mesure | constructeur notoire «appareils de | entrainer des dommages d'un coté,
mesure, qui, vers le milieu des | de lautre, ou des deux ! Notre inter-
ce aud corre années 60, a 6té aorigine de ce bus | face utilise la connectique de la
Possédent souvent une | instrumentation portant alors le | norme IEEE-488. La liaison entre les
option « GPIB », ou ‘nom de HPIB (pour Hewlett-Packard | appareils et le contréleur (qui est
y 88 Interface Bus). Cette invention ne | généralement ordinateur) comporte
ouocre SEE date donc pas d'hier, mais elle est | 5 fils de contrdle du bus, 3 fils de
permettant leur toujours d'actualité et, méme si de | gestion dela communication et 8 fis
fonctionnement nouveaux systémes d'instrumenta- | de données, les autres fils étant
tion a base a'Ethomet sont apparus | connectés ala masse
en mode télécommandé ‘sur le marché, le parc actuel des | Le tableau dela figure 4 liste le bro-
‘appareils de mesure utilise encore | chage du connecteur IEEE-488, les
's peuvent ainsi étre commandés
et interogés A distance, ce qui
ouvte la possibilté de réaiser | (EJ) Signaux et brochage du connecteur IEEE-488
des bancs de mesure automa-
tiques pilotés a aide d'un ordinateur
Encore faut-il, pour tirer profit de Nom de signal Sseriiation Numer de roche
cette option, disposer d'une interface Diot Dataingt out 1 (0 4
adéquate, d'ou objet de cette réal- es ata ged xt 28 2
ae 103 Data input ouput 3 (bt) 3
Dios ‘eta ingut ouput (3) 4
BIOs Data ingut put 5 (bt) 3
D108 Data 6 (ot) 1
Tour horizon cic | int ata 7 t) ‘
du bus GPIB D108 Data input out 8 ft) 16
E01 End or ier 5
IIn'est peut-étre pas inutile de rappe- AV ota vai 6
ler, tts succinctement, en quoi nee | Wetent dt z
consiste le bus GPIB. Ce sigle est le on Not sooo 2
raccourci de “General Purpose ae ae =
Instrumentation Bus" et répond a la ai aaa fi
rnorme IEEE-488, Cette norme a vu le Rene able
jour dans les années 70, mais c’est la Grove
société Hewlett-Packard, a 'époque
ine TO www.stectroniquepratique.com ELECTRONQUE FRATIQUE
Micro/Robot
noms des signaux et leur signification | passer dans son mode de comman- | Le protocole de communication du
anglo-saxonne. de @ distance. Dans ce mode, en | bus IEEE-488 est au format TTL, en
‘Voyons plus précisément quelle est la | général, une led s’allume surla face | logique négative. Ainsi, un niveau
fonction de chacun de ces signaux: | avant de l'appareil et les com- | logique 1 correspond un niveau de
=DIO1 @ DIOB : ce sont les huit | _mandes locales deviennent inac- | tension inférieur a +0,8 V, tandis qu'un
lignes permettant le transfert des | tives. Dés que cette ligne repasse | niveau logique 0 correspond a un
‘octets du contréleur vers les appa- | au niveau logique 0, l'appareil | niveau de tension supérieur & +2 V.
reils connectés sur le bus, ou des | retourne dans son mode de fonc- | Le chronogramme de la figure 2
apparels vers le contrOleur. tionnement local. représente ['évolution des niveaux
|i s'agit donc d'une transmission & 8 | Chaque appareil peut étre adressé en | électriques présents sur les lignes
bits paralléles, bidirectionnelie parleur ou en écouteur sur le bus | DAV, NRFD et NDAG, lors d'un
Pesca cet operas mi | PEEI26, ansansGarakel pe: | dcrage aa meade
ries suai fale tive Cap|l eminem eee aud pare, [rel pated arcane Reatioa
Fatal rego une sine cont | comme cerae captors cus | Las lgneo DIOS @t DA oi le
CRolavarrdoned tee ta | Gaeus, comme be pian | tes parle pate ‘ands Glee
seat desiiopaaabirrtar| cu iesmarieon" ao: commuter; | lignes KER et DAC i pectiped
alse scaly os tat da | Pldeurwapparas el tur po. | Mecodee: A Meta TOR
aca cc ana | [rar nec ocsen esata toa | ae Toa sper
Lae ceeaimsbarl ae | ymusinandpantanaan pateisl | Doi aussi pe O50 BRE
cate une amvsune aaetonton: | labo ESE part de weer | Yak at tax (Soe 5 at
Soprersaaral sa og (a | almaieraalappua eoerata et esata desire
variances aun a ea HTN, | maa d's appre dort ove | NEFD Oot Pama For Daa) a at
Combi pau ext un poling | ma sous tron, Grew appaut | wal (one @.0 0) A Theta i
SUATASs iver ona | pain pareraiine saeae careron | recousucracia iD Asa
ena rl ae arceeall cleanin ed | leszae Fearne ena
spa ones ta cas a Son Sasa adap [e paeega Tose Pee
ppecettees ieee ntet | co rare seracos jeter (acre prea Aas toe
DAW MRED ot NDAG : es to | te etl ort tie | DN yoru dour 0
Saree pratt conte de | Settee ae tapas pour ow | Tote pac aur eines BD
warn cm ott sno | Tf apart fs spice | et aio, Db oe Pour com-
Fon peut traduire par « poigrae de | Part du setup » accessible depuis | mence acquisition de octet. A ins-
Ton pi ae p= pote de | an ‘Aoutons aoe | aT, fa tn tacston Go
ra Soar esnd te sv eves | et ena
(i astra Shntacommonons ete sopares | NOAC (Net Daa ACoeped) & Sat
I. te Hae cua le pase | Tent nce 20 mite toa | fax. Le pater meta a Tore
aeau eau | a comme in| occur ure aon ene ser | DAY 8 Ft ax pour sgl ue
rae bs of provooue retour | Stat no put enced 2 rte. | Voce et pi va. La ee s0
oe | posnncst atarcing cats om | oncneaa ROSA ginroc
_ ot seeps aco | soars FOn' Spe 8 couse | Tunis corerponde aun caste
coe ee poe eee rs eer oa eee ome
quelque chose a dire », par
exemple qu'une mesure est dispo- | FI processus dun échange de données
ible, ou Bien qu est on eeur, ou
soon da aaitits ac | |
regue ne fait pas partie de son | ioe ——| [eet
iccsnd i
30)
Cette erreur survient si une comman-
de contient une adresse de valeur
supérieure & 30.
- Erré (timeout)
Le délai maximum a été dépassé.
= Err5 (réglage timeout)
Ce message survient si vous tentez
de définir un timeout inférieur & 1, ou
supérieur & 60.
- Err6 (r6glage adresse de Vinterface)
Ge message est identique l'Err,
mais conceme adresse de la carte
GPIB,
~ Enr7 (la carte ne peut pas s’adresser
elle-méme !)
Cette erreur se produit sion envole
tune commande (comme OUTPUT ou
ENTER) avec comme adresse celle
de la carte GPIB.
Le fonctionnement de la carte peut
{tre testé & l'aide d' Hyperterminal de
Windows. 1! faut alors paramétrer la
‘communication en 115 200 bauds, 8
bits de données, 1 bit de stop et pas
de contréle de flux.
Pour un controle plus confortable et
plus approfondi, on peut lancer le
logiciel TEST_GPIB.EXE, dont un
éoran est présenté en figure 8. Ce
|
| ER ceompie crécran du togiciel Test gpib
atoll
Commandos de Mnteriace ot du bus
[feos seting. Be 4
[strecogetnintace 0
eter late
Lace aPunersia |
[stwceresting -vraeaancnera ||
roar)
‘ -
Ee see Ties bine
[Reseda [25 macau acetic
mye eae hg oe ela cae GA
cevtaciecte cen cee Change io
Tacit bs tee:
oe ‘Device ceo C1
Race Et) cael me el
Tosa) | Aww$0C] | San Tae [Cas emene ss SS
(Date GF ei coc alba
sno IO wane etectroniquimpratique, com ELEGTRONIQUE PRATIOUE
Micro/Robot
logiciel a ét6 testé sous Windows
2000 et Windows XP.
Lorsquiil est lancé, le logiciel détecte
automatiquement la carte GPIB et
recherche ensuite les adresses occu-
ppées par des instruments éventuelle-
ment présents sur le bus, avant de
rendre la main a lutlsateur.
La fenétre de gauche affiche les infor-
mations en provenance des appareils
‘commandés, tandis que celle de droi-
te conoerne plus particuliérement la
carte et les lignes de commande du
bus.
Il gere les éventuelies erreurs regues
de la carte et permet de s'atfranchir
des « OUTPUT », « ENTER » et autres
caractéres de fin de ligne.
Dans le champ « Envoyer vers I'ins-
trument », il suffit done de saisir une
chaine de caractéres conforme & la
syntaxe préconisée par le construc
teur de l'appareil sollcité, aprés en
avoir renseigné l'adresse dans le
champ « Adresse d'instrument », puis
de cliquer sur « Valider (Qutput) »
FEA veux anparets sont ici rac-
cordés 4 l'interface
Si la chaine envoyée déclenche une
réponse de l'appareil (elle contient
alors, en général, un point dinterro-
gation), il faut ensuite cliquer sur la
touche « Recevoir (Enter) » pour voir
s'afficher la réponse de l'appareil
Si la ligne SRQ est activée par un
appareil, la pseudo-led, en bas &
droite, s‘allume en rouge et la touche
« Status » s'affiche en ver.
| ll faut dans ce cas cliquer sur cette
| touche, ce qui a pour effet d'atficher
| Foctet d'état émis par l'appareil, de
désactiver la ligne SRQ et d’éteindre
la pseudo-led.
Les messages retournés par un
‘appareil sont présentés dans un for-
mat particulier au fabricant de cet
appareil
exemple présenté affiche une chai-
ne de caractéres (fenétre de gauche)
regue d'un analyseur audio Sound
Technology type 9200.
Cette chaine signifie que le niveau
audio mesuré vaut 748 mV efficaces
ft que la fréquence du signal est de
30,673 kHz
Comme on le voit, il sera nécessaire
qu'une application bien faite, dans le
cadre d'un relevé de tests automa-
tique, manipule quelque peu cette
chaine de caractéres pour obtenir
lune présentation des mesures plus
| acceptable !
8. LEBRUN
£t st vous réalisiez
votre chaine hi-fi a tubes...
8 amplis de putssances 44120 Weff
4 préamplis haut et bas niveau
1 filtre actif deux votes
Des montages a la portée de tous
en suivant pas a pas nos explications
‘Je désire recevoir le CD-Rom (fichiers PDF) « Et si vous réalisiez votre chaine hi-fi a tubes.
><)
France :30€ Union européenne : 30 € +2 € frais de port
Nom Prénom
Ne Rue
Code Postal Vile-Pays
Bon & retourner accompagné de votre réglement
Transocéanic - 3, boulevard Ney 75018 Paris Tal. : 01 44 65 80 80
t:« tubes »
i}
re
i]
oF
¢
0
ic)
od
Ww
28° PARTIE
DE LA THEORIE A LA PRATIQUE
LA CONTRE-REACTION
(SUITE)
La contre-réaction est cer-
tainement, en audio,
cuit le plus difficile a bien
utiliser. Dans notre dernier
nous vous avons
exposé les _principes de
base de la réaction et de
réaction_négative_(contre-
réaction ou CR) en simpli-
fiant,_a l'extréme, un_phé-
noméne bougrement ci
plexe ! Pour aller plus en
avant, il_vous faut_bien
comprendre ce qui fait que
cela fonctionne ou... provo-
que _une catastrophe | Et
tout d’abord.
Ly a contre-réaction lorsque le
signal réinjecté & l'entrée est en
opposition de phase avec le signal
dlentrée, Avec un seul étage ampl-
ficateur, aucun probleme (igure 1). Sion
couple avec un atténuateur ad hoc la
tension de sortie récupérée sur la
plaque d'un tube ampiiicateur et qu'on
réinjecte une fraction de cette tension
sur la grile de ce méme tube, oppost
tion de phase est parfaite care tube est
Inverseur (ire nos précédents cours). En
théorie du moins, car différents facteurs
parasites peuvent intervenir !
Tout d'abord, les capacités parasites
(cl. cours précédents). Elles se trouvent
en paralléle sur ce circu archi simple et
ameénent des rotations de phase aux
fréquences élevées. Liinversion de
phase n’est plus parfaite et le systéme
ppeut entrer en oscillation & tres haute
{fréquence ! Les condensateurs C et Ck
(en série avec le signal) vont, eux, faire
tourner la phase aux trés basses fré-
‘quences. Accrochage trés basse fré-
quence, trés désagréable.
Avec un seul étage contre-réactionné,
vous ne risquez pas grand-chose. Mais,
plus le nombre d'étages augmente,
plus V’effet des capacités parasites et
des condensateurs de liaisons et de
découplages se fait sentir, Mais cont
nuons avec des circuits parfaits (!)
hyper simples et abordons le cas de
deux étages (figure 2)
Inutile de songer la contre-réaction
ramenée sur la grille car la tension de
sortie se retrouve en phase avec la ten-
sion d’entrée (180° + 180° = 360°)
Vous avez fabriqué un vrai oscillateur
qui se nomme un «muttvibrateur » !
Déphasage de 180"
Figure ta : Un tube est inverseur. Figure tb : Application de Ia contre-réaction
ZalglH
fs =[]
sur un simple
fy a1 ww cloctroniquepranque.com 50 E
-CTRONIGUE PRATIQUE
L’AMPLIFICATION
OF contre
Figure 4
‘Comment appliquer
la contro-réaction (CR)
sur un systéme & deux stages.
Ft beaucoup plus grand que Ra
'R2 beaucoup plus petit que Rk
a
Fe 2
Si vous réinjectez une fraction de la ten-
sion de C vers &, le systime oscil
‘Vous avez oréé une réaction
(enultivibrateur)
Ce sera toujours le cas lorsque la
bboucle de contre-réaction englobera un
nombre pair d’étages.
Avec trols étages, le probléme ne se
pose pas (figure 3). Le signal de sortie
fen D est bien en opposition de phase
avec le signal d'entrée en A,
Vous pouvez cependant, dans le cas
(frequent) de deux étages dans les pré-
‘amplificateurs, oll est important que le
signal de sortie soit rigoureusement en
phase avec le signal d'entrée (phase
absolue), appliquer une contre-réaction
‘sur la cathode du premier tube (figure 4).
Appliquer une tension positive sur la
cathode revient, en effet, a réduire la
tension entre grille et cathode, donc
I'équivalent d'une fraction négative de
tension sur la grille de commande.
Deux autres méthodes sont employées
‘couramment, elles sont extraites de
deux célebres fabrications
- Ampii de ligne par Ampex. Utilise, sur
deux étages, une contre-réaction ite
ine 310 waw.electroniqueprotique corn SH ELECTRONIGUE PRATIGUE
LA CONTRE-REACTION (SUITE)
+50
sav
s20Ka.
aay
Figure 5 : Contre-réaction plaque & plaque (schéma Ampex)
Figure 6 : Contre-réaction cathode & cathode (schéma Mc Intosh).
‘Attention : ce montage est inverseur
025 ur aa
‘eauTIEccE
‘ussNT
1310
Tube
aaxrrecces
69 Sortie
«plaque & plaque » (figure 5).
= Ampli de ligne par Mc Intosh (C20 et
(©22), Contre-réaction dite « cathode a
cathode » (figure 6).
Je vous recommande de mettre en pra-
tique ces deux schémas, vous serez
‘surpris par le résuttat |
Vous remarquerez, sur ces schémas,
que les résistances de cathodes ne
‘sont pas découplées par un condensa-
tour Ceci améne une contre-réaction
supplémentaire dite, selon certains
auteurs, « contre-réaction dintensité »,
ccar ces résistances de cathodes sont
pparcourues par le courant traversant le
tube.
En réalits, d'autres auteurs affirment (ot
Je suis tenté de les croire... par expé-
rience) quill s'agit d'une contre-réaction
de tension, car acissant directement sur
la variation de potentiel grile/plaque. Au
bout de soixante-dix ans, le débat n'est
‘toujours pas clos !
‘Toujours est-il que le gain de étage est
diminué, mais que son taux de distor-
sion peut étra considéré comme nul !
Crest extra et c'est ce qu'l faut faire |
ET LES ETAGES
DE PUISSANCE ?
Nous avons vu que chaque étage
fengendre, en théorie, une rotation de
phase de 180°. Mais en raison des
capacités parasites des condensateurs
de liaisons et d'autres facteurs (induc-
tances, transformateurs, etc.) il est évi-
dent quien réalité chaque étage va
introduire une rotation de phase « para-
site » en dehors du déphasage normal.
Prenons le cas de trois étages.
Normalement le déphasage global
devrait tre de :
180" x 3 = 540"
En fonction de la fréquence, les effets
parasites vont se faire sentir, parfois sur
tune seule fréquence du signal musical.
Si, A une fréquence déterminée, les liai~
‘sons par condensateurs de grilles intro-
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Welding Filler Metal: We Are ManufacturingDocument2 pagesWelding Filler Metal: We Are Manufacturingbatka2No ratings yet
- Wiring Diagram: - ISO 3731 (24S) and ISO 1185 (24N) Power SupplyDocument1 pageWiring Diagram: - ISO 3731 (24S) and ISO 1185 (24N) Power Supplybatka2No ratings yet
- Goran Petrovi Tomislav Kili Ozren Bego PDFDocument18 pagesGoran Petrovi Tomislav Kili Ozren Bego PDFbatka2No ratings yet
- Electronique Pratique 2006-11 PDFDocument55 pagesElectronique Pratique 2006-11 PDFbatka2No ratings yet
- Electronique Pratique 2006-10 PDFDocument52 pagesElectronique Pratique 2006-10 PDFbatka2No ratings yet
- Electronique Pratique 2006-09Document61 pagesElectronique Pratique 2006-09batka20% (1)
- Electronique Pratique 2006-05 PDFDocument64 pagesElectronique Pratique 2006-05 PDFbatka2100% (1)
- Electronique Pratique 2006-07,08Document67 pagesElectronique Pratique 2006-07,08batka2No ratings yet
- Electronique Pratique 2006-06 PDFDocument66 pagesElectronique Pratique 2006-06 PDFbatka2No ratings yet
- Нагрузочный стенд полная версияDocument8 pagesНагрузочный стенд полная версияbatka2No ratings yet
- Blue Box Power Electronics Control ModuDocument198 pagesBlue Box Power Electronics Control Modubatka2No ratings yet
- Нагреватели PDFDocument24 pagesНагреватели PDFbatka2No ratings yet
- Electronique Pratique 2006-03Document63 pagesElectronique Pratique 2006-03batka2No ratings yet