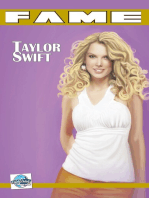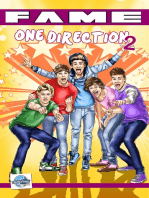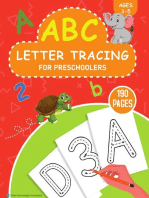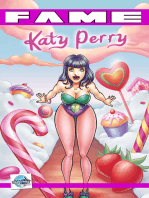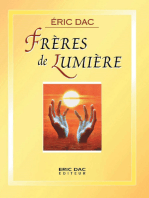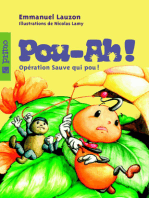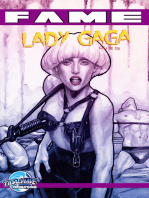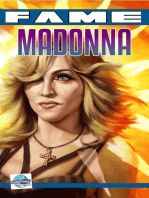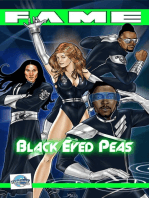Professional Documents
Culture Documents
(Assimil Language Courses) Assimil - Le Grec Ancien (Ancient Greek For French Speakers) - Assimil (2002) PDF
(Assimil Language Courses) Assimil - Le Grec Ancien (Ancient Greek For French Speakers) - Assimil (2002) PDF
Uploaded by
lramos_3112120 ratings0% found this document useful (0 votes)
16 views353 pagesOriginal Title
(Assimil Language Courses) Assimil - Le Grec Ancien (Ancient Greek for French Speakers)-Assimil (2002).pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
16 views353 pages(Assimil Language Courses) Assimil - Le Grec Ancien (Ancient Greek For French Speakers) - Assimil (2002) PDF
(Assimil Language Courses) Assimil - Le Grec Ancien (Ancient Greek For French Speakers) - Assimil (2002) PDF
Uploaded by
lramos_311212Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 353
méthode quotidienne
ZE
Le Grec ancien
Collection Sans Peine
par Jean-Pierre GUGLIELMI
Illustrations de J.-L. Goussé
AES
BP. 25
94431 Chenneviéres-sur-Marne Cedex
FRANCE
© ASSIMIL 2003 ISBN 2-7005-0310-4
metnodes ZEST
Volumes reliés, abondamment illutrés
et enregisirés sur cassettes ou compact discs
Suns Peine”
‘Le nouvel allemand sans peine
[Lamericin sans peine
anglais
[Carabe sans peine (tome)
[Carabe sans peine(tome2)
Darménien sans peine
Le brsilien sans eine
Le bulgate sans peine
Ce chino sans pine (tome!)
Le chinois sans pene (tome2)
Vecritre chinotse
‘re corgen sans peine
Le danois sans pine
Le nouvel espagnol sans peine
‘Cespéranto sans peine
Le finns sins pene
[re nouveau gre sans peine
Le grec ancien
Tebreu sans pen (tome)
[habreu sans pene (tme2)
Le bindi sans peine
[Le hongris sans eine
[Dindonésien sans peine
LLe‘nouve talen sins peine
TT japonais sans pene (ome!)
[Le japonais sans pene (tome?)
Le japonais Péeriture kant
Ce latin sins pene
[Ce nouveanerlandais sans peine
[Le norvegien sans peine
Lepersan
Le polonais
{Le euvest portagas sans peine
‘Ce roumain sans pine
‘Le nowvea russe sans pine
Le serboreroate sans pine
[Ce sos sn eine (mel)
Te suddos sans peine (tome?)
Ce swab sane peine
Te tamoul sas pine
Ve tehigue sans pene
Inoduetion au that
Le tare sans pene
le vetnamin ss pine
-Perfeetionnement”
Perfetionnement allemand
Perfectonnement angie
Perfetionnement espagnol
Perfectonnementialien
La pratique du néerandais
“Langues régionates”
LDalbacien sans peine
Le basque uni (intition)
[Ce corse sans peine
Le erote sans peine
initiation au breton sans pine
Lebreton sans peine (tome!)
{Ee breton sans peine (tome?)
[Coecitan sans peine
“astures”
[Le nouvel anglais des affaires
espagnol des affaires
“Civitisatons”
Apprenez Amérique { (Langue et
ciusation)
Assimil “?
Langlais par Phumour
“Diingues” (1 lvee+ cassettes)
Pour mieux connate Varabe
“Loins”
La guitare sans peine (cours en 2
casettes et 24 fiche)
Te salfge sans peine (cours en 3
cassettes et un vee)
“Expression
Plus anglais que ga
Pls espagnol que ga
lomatiques”
Sommaire
Avant-propos
Introduction
alphabet et Ia prononeiation
Legons de 1 4.101
1 Premigre legon
2 Deuxitme logon
3. Xaipe Sain!
4 Bara ada, Ba Boi, BA
5 ‘Obvaveis Liysse
6 Modipnns OBvoaeis Uivsse aus mile ses
8 To nporov ypappa La premigre lewre
9. To Gararov ypapwa La demiere lettre
10 Xadewbv ore Ces difille
U1 ‘Heahaiorpa La paiesire
12. “Hrem@Amnal 8 Sp6uos La hut ot la couse
13 ‘Oxahds nai dyaBés “I. homme idéal
14 Révision
15 To &Aaov £ fuile
16 (0 dpiaddos re facn
17 [Q.yabbe Spon 1 on comin
is v Ala Par Zeus !
1) GeGoduat nv wads Fe per de ate
20. "Oayiv La competition
21 Révision
22. To Bédnos La chaleur du soleil
23 ‘0 didonovibraros Le plus vaillan!
24 "Empeheio®e Appligues-vous !
25. “Hpeonpbpia Mi
26 upd nai xdyve J'ai soifet je sus fatigul
27 "Hemé L’ombre
28 Revision
29 0 Bpopos La course
30. ‘Oeréhavos La couronne
31 OaUAes Laulos
32 'Havamavers La pawe
33 "Oogos Le bruit
34 Aavév 1 Quelque chove de teribie
vit
x
“XIV
Vv
Rien
Ma gpovride Ne Finguiete pas !
"Qytsben nev nian errr ies joes
Oijor radas Pawire de moi !
Ta Badaveioy Le bain
Mayor wégou Ne me bléme pas?
"EEnwaprov J'ai eu tort
Revision
‘H masBeia Buxaia La juste éducation
Tlepi ris watpios La patrie .
0 bpxos Le serment enee eo esas
Ocpameve 16 re a6 pa xa Thy juxty (2)
Prends soin de ton corp et de ton de (1)
Oepameve 76 re Gp eal Thy Yuxty
Prends soin de ton corps et de tom ome (2)
i dexpayanor Les osselets
Révision «-
Av ayopas 4 ravers Magora «.
“0 ris ayopas 8xhos La foule de PAgora
Erout reveal iepa Porrigues ct sanctuaires
Oicor 4 fa maison
‘OKadNias mdouret Callas es riche «
TlaiSiov Kpdreva Ma petite
Revision
‘Homovi La libation
“Ev 79 psyeapedy Dans la cuisine
Or vahoopave Les ie
0 Noxevos La Lampe dite
“Axovaare Ecoute:! :
EvBagy BON A aide d'une céldbre ruse «
Revision
MoceSav rovropéBuv Poseidon rot de fa mer
‘Hav Kuehdmrav yi La terre des Cyelopes «
Beata vaods 1 Une ile sire
To Svrpov Lantre
“O Monvgnwios Potyphome ......
Obbeis reves wou Jem appelle Personne
Revision coe
To gudv gov Mon présent
H axa La ruse
179
187
193,
197
203
209
215
ni
29
235
2ai
24s
251
257
263
273
279
285
291
297
303
309
317
323
329
30
81
22
89
90
2
93
94
95
96
98
“Anodvijoxw dnd OdSevbs
Gest Persone aime we
Odvaceds SmoBudpevos ind 19 xpd
Use aac sous fe lier a
'08s re Kai dps Haine et collre
"0 yehutononds Le pine
Révision
Zxohaonnds 15 - Ado Sino
Un parasite - Deve jumecnas
Ta neh 1d addy - Ev xoupeig - ‘Oinwos
Le bon miel- Chez le barbier = Le cheval
Tlarepos raAnOA Néyet : Npooxedahatov
oxAnpSrepov Lequel des dews dit la verte ?
_Gingoisin op ar
‘O naqos Le diversisement
0 rav xadav Enawvos
[-éloge des bean: garcons
‘Ey 8 Zoontpov einy.
“Je voudrais re ton miroir.
Révision
‘0 otvos (a') Le vin (1)
(8 avs) Le vin 2)
“H yf peAawa mives ~ “Orav & Banyos 20)
Ears ai “Quand erive Bach
‘aipover BiaAeyopevon
Le plaisir de la conversation
Tepi ris 109 KadNiou aoghias
Lesage ae Calla
“Apyupiow dyeoqtoy Eloge de argent
Mevias eynapioy Blaze de la pauireté
‘Onsipou éyrousov Hoge d'Homére
Kaddous éyeaqtoy Eloze de la beaute
"Adnfods whourou ¢yxapioy (a?)
loge de a vraievichesse (1)
"AXnBods modrou éyropiov (B})
loge de la vraie richesse (2)
"AXnBods wAodrou éyedqiov (y’)
Eloge de la vraie richesse (3)
Révision
409
413
47
23
29
437
4a
447
453
459
463
469
475
479
491
495
501
505
315
521
327
33
337
543
549
99 "Adnfods nhobrou eyrciptov (6)
Bloge de la vraie rchesse (4)
100 “W700 ousmociow kardhuons
Lafin du banquet... -
101 “Odveccias 7 apooipioy Odrssée » Prélude
Appendice grammatical
Index grammatical
Annexes
Recatte de Chrysippe de Tyane
Poésie anacréontique
Tableau chronologique
Carte de la Gréee ancienne
Plan de I’Agora
Bibliograpie sommaire
Lexique gree-frangais
3st
561
567
516
632
os
536
638
640
641
642
648
slot 8 HBoval
wanpal ce Moy:
‘eptivby ani,
Iya de nombrews plalsirs dans
lavie, les Jongues causeries et le
femps libre, aimable vice,
(Euxinpe, Hippolyte, 384)
Avant-propos
Force est de constaterI'amenuisement de la place fiite au grec a
cien dans l'enscignement secondaire. Or, parallélement, P'intérét
Pour IAntiquité ne faiblit pas dans le grand public. Certains,
onscients du profit intellectuel, et plus largement humain, qu’ils
retireraient de I’étude du grec, y consacreraient volontiers une par
tie de leurs loisirs. Malheureusement, faute de pouvoir suivre des
cours avec un professeu, ils y renoncent. Stel est votre cas, Le Gree
ancien dans la collection Assimil sans peine, congu pour Vautodi-
dacte, vous est desti
Soyons clair : notre propos n'est pas de vous amener & parler coue
‘amment et sans accent la langue de Platon pour Iutilser dans la vie
e tous les jours. Pratiquer aujourd'hui le gree ancien, c'est lire les
textes qui nous ont éé transmis depuis 'Antiquité, c'est done étudier
une langue litéraie, Vous guider vrs la lecture des euvres classique
en vous faciltan les premiers pa, tel est 'objectif de ce manuel,
Noublions pas cependant que le grec ancien a bel et bien été une
langue vivante en son temps, Il est done intéressant de I'étudier
selon les principes qui ont fait le succés de la méthode Assimil. En
rocédant comme si vous appreniez l'anglais, e ruse ov... e gree
modeme, vous commencerez par assimiler intuitivement le voca
bulaire et les constructions du grec ancien, avant de les aborder
‘théoriquement. L’importance accordée a oral dans cet apprentis-
sage nous a fait choisir la prononciation restituée, la plus a méme,
selon nous, de rendre au gree ancien ses couleurs sonores. Lal
ture & haute voix des ceuvres poétiques et thédtrales ne peut qu’y
vu
agner. Par ailleurs, cette prononciation a Pavantage d’étre indé-
pendante des pratiques nationales et tend a s"imposer dans V'ensei-
jgnement comme une référence, Elle contribue aussi a réduire, &
PPéerit, les confusions orthographiques que la prononciation “a la
frangaise” du gree peut occasionner. Enfin exemple ées latinistes
ui ont adopté depuis plusieurs décennies la prononciation resti-
tuge du latin devrait encourager les hellénistes ase lancer dans cette
petite révolution.
[Nous avons voulu faire de cette initiation au gree ancien un pat-
‘cours agréable, propre & satisfaire les simples curieux et & donner
‘aux plus motivés les bases qui leur permettront par la suite de re-
courir aux ouvrages spécialisés. C'est pourquoi nous avons temu &
limiter exposé grammatical & ce qu'un débutant peut raisonna-
blement “absorber” en cing mois d°étude quotidienne. Il est moins
regrettable qu'un lecteur autodidacte n’ait pas vu au bout de ce
‘emps tous les détails de la morphologie grecque qu’il ne le serait
apprendre qu'il a cédé en chemin au découragement.
Ce manuel doit beaucoup aux lecteurs avisés qui, tout au long de
la rédaction, ont consenti & nous faire part de leurs remarques et
suggestions. Qu’lls trouvent ici le émoignage de notre sincére gra-
titude, Nous remercions tout particuligrement le Professeur Patrice
‘Cauderlier de "Université de Bourgogne, qui a formé des généra-
tions d'helignistes a Ecole normale supérieure (Paris), d’avoir ac-
‘cepté avec dévouement la Liche ardue de relire et corriger les
preuves. Nous sommes également trés reconnaissant & Philippe
Brunet, professeur a PUniversité de Rouen et directeur du Theatre
Démodacos (Paris), pour son aide et ses encouragements constants
ds les premiers mois du projet. Tout aussi préciewx a été le concours
de Stefan Hagel, chercheur& l'Université de Vienne (Autriche), qui
‘nous fait hénéficier de sa connaissance et de sa pratique de la mu-
sigue greeque antique. Merei encore a Karin Zeleny et Angelica
Cathariou d’avoir mis leur talent au service du gree ancien lors des
enregistrements. Nous savons gré également & Jan Jordan,
“Administrateur a Ecole américaine d’ études clasiques & Athénes,
‘@-avoir aimablement autorisé la reprodvetion des eroguis et dessins
dde J Travlos et W. B, Dinsmoor, Jr. Enfin la redaction de cet ou-
vrage nett pas été possible sans la participation de mon épouse
Chantal et I'infinie patience de nos enfants ! Nul plus queux, sans
doute, ne mérisit la dédicace de ce modeste travail,
vu
Introduction
Pourquoi étudier le gree ancien ?
Ayer pr cn et ne sma te nt
civilisation. Les Romains, les cleres du Moyen Age, les humanistes
losophie, de la science et de la littérature grecques. A I"époque mo-
lela anes pee ene
sige nem eee gra cae onan ee
Saree eae aan eee
se oot (reser Dees hen
eee eens
ee pie cece es
Qurest-ce que le gree ancien ?
‘Le gre fait partie, comme les langues germaniques, slaves, ramanes
et indo-iraniennes, de la famille des langues indo-européennes, I!
x
té depuis le x1V* sidcle avant J.-C. par éeritue erétoise dite
Lingaire B (Gcriture syllabique de 87 signes). Les Grecs ont par la
suite, comme nous le verrans, emprunté le systéme de l’alphabet
‘aux Phéniciens pour noter leur langue, Celle-ci a continué d'évo-
Tuer jusqu’é nos jours, puisque le gree modeme en est naturelle-
meni issu: quoique la phonologie, la grammaire et dans une moindre
mesure, le lexique, aient subi des modifications, c'est au fond la
meme langue.
Dans I Antiquité il existait plusieurs dislectes grecs correspondant
aux différents peuples venus s'installer dans les régions qui bor-
dent la mer Egée. La prépondérance politique et culturelled’Athenes
(région de l'Attique) au v" siécle av. J-C. a permis au dialecte
ionien-attique de devenir le plus important, C’est lui qui a servi de
‘modéle aux auteurs des siécles suivants. Ce qu’on nomme le “grec
classique” ou “grec ancien” correspond done a la langue des éeri-
vvains athéniens de cette période (v1 siécles av. 1-C.) C’esteelle
{que nous vous proposons d’apprendre dans ce manuel,
Le Gree ancien sans peine : mode demploi
Le grec ancien, c'est d’abord le plaisir du texte,
Les phrases des legons et des exercices ont été ¢tablies sur la base
de passages authentiques et adaptées pour les besoin de la pro-
gression. A mesure que vous avancerez, V'adaptation se fera plus
‘are pour disparaitre presque entiérement dans les dernieres legons.
Le commentaire grammatical de chaque legon ne vise qu’ éclai-
ret les textes propasés.
Méthode i suivre
Dans un premier temps, qui constitue la “premiére vague” de votre
étude, il s'agira simplement pour vous de lire, de comprendre et de
répéier des phrases grecques. C’est ce que nous appelons la phase
“passive” durant laquelle vous allez vous imprégner de cette langue
sans chercher & fabriquer de phrases vous-méme.
1) N'apprenez sien par coeur. Commencez par lire & haute voix le
texte grec de chaque legon en vous aidant de la prononciation
figurée. Ecoutez I'entegistrement si vous le possédez
2) Reportez-vous la traduction ltérae frangaise. Ce "mot a mot”
‘vous aidera 4 vous repérer dans Ta construction des phrases
agreeques. Lisez ensuite la traduction frangaise “élaborée”.
3), Passez aux notes signalées dans le texte gree par des numéros
ct lsez-ls atentivement. Files vous donneront les informations
nécessaires pour la comprehension des formes grammaticals,
4), Revenez au texte gree. Ecoutez 'enregistrement et lise 8 haute
voix chaque phrase, en essayant de la répéter immédiatement,
sans rogarder le texte
'5)_ Ecoutez une nouvelle fois Venregistrement
6) Passez aux exercices.
A partir de la 50" legon, lorsque vous serez dj bien familarsé avec
le grec, commencera la phase “active”, oi 'on vous demandera de
traduire Ie texte frangais de chaque legon en grec, Cette “deuxieme
ster. reprendre de Fagon active la premigte legon, puis
eet ainsi de suite, tout en continuant en paraléle votre
tude passive quotidienne, Ne vous inguigter pas: la méthode a suivre
‘vous sera réexpliguée en détail Ja fin de la logon 49.
La prononciation figurée
Elle accompagne ie texte grec de la legon pour vous aider & pro-
rnoncer les mots grees, surtout si vous ne disposer. pas des entegis-
trements. Nous la donnons dans les premigres legons pour
ensemble du texte; par la suite elle se limitera & certains mots
puis disparatra quand vous ne deveiez plus en avoir besoin
Les particularités de cette transription phonétique vous seront ex:
pliquées au chapitre initulé“L’alphabet et la prononciation”.
La traduction littérale
La traduction irae figure en italique sous la traduction “slaborée”
Pour vous aider, nous avons mise systématiquement jusqu'a la legon
50. Ensuite, nous I'avons gardée pour les passages jugés un pew dif
files, Elle reproduit idelement ordre des mots grees. Le trait ' union
entre deux ou plusieurs mots francais signifie que ces mots sont
Péquivalent Pun seul mot grec. Les crochets entourant un ou ple
sieurs mots francais indiquent que ees mots ne se trouvent pas dans
le texte grec, mals sont nécessaires dans la traduction frangise,
Le vocabulaire de base
Nous récapitulons sous ce ttre le vocabulaire essentie! de la legon,
particulier les mots nouveaux. Ce vocabulaire sélectionné est
consttué de mos fréquemment uilisés en grec et qui seront réem-
ployés dans les textes ultéreurs.
Les exercices
Dans chaque legon figurent deux exercices, qui vous aideront a fixer
ddans votre mémoire les formes grammaticales. Le premier est consti-
tué de petites phrases de version, présentant le vocabulaire et les
tourmures vus dans la legon. Le deusiéme est un exercice “a trous”
dans lequel il vous faudra retrouver les mots grees manguants,
‘chaque point comptant pour une let.
Durant les premidres semaines, vous aurez Neceasion d’apprendre
également & trace les lettres grecques en suivant un modéle, Vous
pourtez ainsi recopier, si vous le voulez, les mots nouveau de la
legon. Ne dit-on pas qu'écrie, c'est lire deux fois ?
Les lecons de révision
‘Toutes le sept legons, nous ferons une mise au point grammaticale
en passant en revue les acquis de la semaine. Ce sera une remise
cen ordre des notions, le “ciment” en quelque sorte de la mossique.
“L'étymologie sans peine”
‘Chague nouvelle legon vous donnera un apergu de la richesse du
vocabulaire grec, mais également de celui du frangais qui lui doit
beaucoup. Dans cette rubrique, vous découvrirez l'étymologie de
‘nombreux mots que notre langue a empruniés au grec ancien ou
forgés & partir des fameuses “racines precques".
Plus généralement, a travers les mots grees, e’est la vie des
Aiéniens de I'époue classique qui se dévoilera a nous. Nous ter-
‘minerons aussi souvent que possible nos lecons par des notes de
civilisation, en rapport avec le texte de base. Ces commentaires,
pour étre succinets, n’en seront pas moins, nous Vespérons, plai-
sants a Tire
En fin de volume, un appendice grammatical, un index gram-
‘matical et un lexique vous aideront & “naviguer” facilement dans
Pouvrage. Nous ¥ avons joint une bibliographie qui vous permet-
tra, si vous le désirez, de poursuivre vos lectures en grec et d’ap-
profondir les thémes de civilisation abordés,
Les enregistrements
Les enfegistrements reprennent le texte des legons et du premior
cexercice. Dans les 14 premieres legons, les textes sont lus Pabord
XI
Jentement, puis uné deuaiéme fois normalement. Les locuteurs ui-
isent la prononciation restituée du grec ancien, que nous vous ex-
pliquetons dans le prochain chapitre. Les textes poétiques (en vers)
seront dits ou chantés avec un accompagnement musical (instru-
‘ments antiques reconstitués).
“Aprts tout ce que nous vous avons dit, vous étes srement impa-
tient de découvrir P’alphabet grec et de vous lancer dans vos pre-
‘mires lectures. Pour que votre enthousiasme ne s'émousse pas,
‘nous avons faite sorte que chaque legon ne vous demande qu'une
twentaine de minutes environ par jour. Rappelez-vous que la régu-
larité et la persévérance sont les elds de la réussite. Si un jour vous
disposez de irés peu de temps, elisez une legon passée, mais ne
“sautez” pas votre petit rendez-vous avec le Grec ancien sans peine.
Centaines legons pourront vous sembler plus difficiles : ne vous
achamez pas et surtout ne vous découragez pas. Vous serez.heu-
reusement surpris de constater, en abordant Ia “deuxieme vagus
{que les constructions ou les formes qui vous avaient paru compli-
‘quées au début, vous sont devenues families & force davoir été
repéiées,
xm
L’alphabet et la prononciation
Lalphabet grec, toujours en usage en Gréce aujourd'hui, est attesté
depuis le vi sigele avant J-C, Au cours des premiéres legons, nous
voquerons quelques aspects de histoire de cette écriture
La prononeiation du gree quanta elle a varié selon les dalectes et
les époques. Les progtés de la phonétique historique, les nutes d'or-
thographe retrouvées dans des inscriptions, I'adaptation de T'al-
phabet grec pour noter d'autres langues et bien d'autres raisons
‘encore ont permis de restituer la prononciation du grec parlé &
Athénes aux viv" sicles av. JC. Ce sont les résultats de ces tra-
‘vax, notamment ceux de W, Sidney Allen (voir fa bibliographie),
qui ont servi de base & la prononciation resttuée que nous avons
adoptée dans ce manvel
Nous allons done maintenant découvrir les lettres de alphabet et
les sons du grec ancien. Un petit exercive de lecture, enfin de cha
pltre, vous aidera a vous familiariser avec les caractétes grees. Vous
allez voir, 'est tres facile a apprendre. D'aillers, ily a moins de
lettres dans alphabet grec que dans notre propre alphabet (alpha-
bet latin).
xiv
eties [Son | Remarques
A a _|iat_ | peat re lng comme part ox bref comme pat
BB B.6] 6). | B-en debut de mot et-€-a Vinricur
Fy isi | gdurde gare ou bague
Ad ic) | decide
Ec {ial | é toujours bot de ae
ZL tea) | sd de mazdéiome
Hn [lear | ede créme, toujours tong
© 6 |) | esuivi d'un expe (comme pour embuer un
miroir en exprant Pir conten dans ia bouche)
Tati) | peutetre tong comme ile ou bref comme it |
Kix ji | ketene
AR |i | tee sot
Mop Jin) | mde main
Nov Jint | nde mous
EE fia | xd mai
10 Jc} | o fermé de mot toujours bref
Tow [ipl | pdepere
Pp [inh | rroulé comme en italien ou en espagnol
EZ @.s||ss1_| ss dur de safe ov ¢ de ga enfin de mot o
Sécrits
t2\ | e se prononce 2 de zone devant Gy 8 cts
Tor fis | eaetere
Yu Jiut | peut ete tong comme June ou bref comme
© | tpt | psuivi un mexpiré (oir ©)
Xx |) | sesivi oun hexpié (voir ©)
YY Jost | ps de psaume
2&0} | o ouver de por, toujours long
xv
La longueur des voyelles (1 longue = 2 bréves)
La voyelle longue (i ong) équivaut peu prés& deux fos ia durée
une breve ( [il bre), Récapitulons:
(0, € sont toujours bréves (ol, (61;
1, @ sont toujours Tongues » = (88],.0= [ool ;
a. «et v peuvent éire braves ou longues.
Les principales combinaisons de lettres
~ Les diphtongues sont presque toujours longues
a) ‘comme dans rail
av [20u] comme dans miaow
(86) comme dans préétabli
ev {é0u) comme dans Séou!
[oll comme dans cayores
ov —[fovoul comme le 2* ou de fowiours
Remarque : eet ou sont en fait de fausses diphtongues.
~ Lota (« ) placé sous une voyelle se prononce faiblement
@ laail, 9 (88, @ [ool
= La présence d'un 4 ou d'un v aprés une voyelle n’entraine pas,
A la différence de ce qui se produit en frangais, de nasalisation :
av [ann] comme panne
ev [enn] comme Vénus
av [enn] comme peine
wy finn) comme fini
vy funn] comme prunea
ev [ona] comme fonneau
ey [oonn} comme Eile est Bonne.
—Y suivi d'un y, «, § ou x se prononce comme v, exemples
‘ayy se prononce [arog] aye se prononee [ani-k)
VV se prononce [énr-g]_ ty se prononce [inne]
{YK se prononce fink] yx se prononce [onn-kHl
—e suivi d'un, y, 8 ou p se prononce comme [2] de zone :
6
oy
= [2b]
ica)
xv
Les esprits et les accents
‘La plupart des mots grecs portent un ou deux petits signes au-
dessus de certaines lettres. On classe ces signes en deux catego.
1) Lesprit (litératement « souffle ») peut étre doux (") ou rude
(*). Site premier n’entraine aucune modification de la prononela,
tion, le second marque une légére expiration (comme pour embuer
lun miroit) que nous noterons dans la prononciation figurée par an
(Hi. Exemples
a= i [hal
ee él He]
b= Io} {Ho}
ot= [oi] (Hoi, ete,
2) Les accents frappent une voyelle ou une diphtongue. On en
compte trois
~ Liaccent aigu (" ) indique que le ton s*élave sur la syllabe,
Dans la prononciation figurée, la voyelle portant le ton sera
notée en gras, légérement surtlevée
=i ej ay = [ann]
Dans une diphtongue ou une voyelle longue, le ton s‘éléve
sur la deuxitme partie
A= lee) ai = (ai) 6 =[09)
eb = [g0u) ‘Gv = (oon)
~~ Lraccent grave (*) signale absence ou I'atténuation du ton
ascendant;
~ L’accenteirconflexe (~ ou” selon latypographie) signale ue
Mntorson et dabord aig i (") ulsgrave (") sue
méme voyelle ou sur une diphiongue. Cette premigre patie
tonique de la voyelle ou de la diphtongue sera notée légere-
ment surélevée dans la prononciation figurée =
XVIL
Vous vous familiariserez peu & peu avec ces différents types d'ac-
cents. Nous vous donnerons les principales régles de I'accentua-
tion & la fin de la méthode (legon 98), mais nous laisserons cette
question de c6té pour le moment.
Exercice de lecture.
Entrainons-nous a lire le nom des lettres grecques
Gres
aga
Bara
youn,
Batra
Eypdsv
Sra
Prononsiation
AipHa
beta
deka
é psilonn
zdtita
ea
wHeeta
iPota
keppa
lambda
© milronn
pi
TH®0
slgma
ou
Uy psitonn,
ki
© méga
‘Traduction
alpha
beta
‘gamma
deta
cpeilon
ta
ra
theta
iota
appa
lambda
i
rho
sigma
‘au
spsilon
phi
‘hi
Pai
omega
Voici une liste de mots qu'il ne s'agit pas «apprendre par coeur,
mais de lire facilement.
XVIIL
Gres
‘Eddnnss
yeornane
Aefucov
“ABivar
“Oupos
ghdhoves
Frojohoyia
iorve’s
span
ovora
SpBoypadia
Sn6eas
Aiyuntos
“Artur
Tapvacods
“Odupmos
Halters
gremmatixae
igsikonn
athena
Homeéross
oH!ogoss
tumologtae
éxootikess
saraxtéér
sUstéima
ortbograpHiae
Hupettéssiss
alguptoss
ative’
rate
d€ipHo!
Slumposs
‘Traduction
hellénigue
grammaire
(livre de) mots, lexique
Athénes
Homere
qui aime les lenres
sens véritable, étymologie
extérieur exotique
signe gravé, marque,
caraciére
ensemble, composition,
(plus tard systdme)
éeriture correcte,
orthographe
base, principe, hypothése
Egpte
Attique
Crete
Mycines
Delphes
Parnasse
Olympe (le mont)
"Nous arrivons au terme de cette introduction, mais avant d’aller
plus foin, relisez encore une fois la liste de mots en masquant la
prononciation, Et maintenant.
"Aya toxn
Jagathéai tukHeei)
Bonne chance !
XIX
Avant de commencer, il est absolument nécessaire de lire
Viintroduction qui précéde, méme si vous étes faux débutant.
a’ Mp&tov paenpa
proton marHeéma
Le grec posséde quelques sons inconnus du frangais. Nous
allons consacrer les dews premiéres lecons @ des exercices
de lecture et & la prononciation. Si vous avez les enregistre~
‘ments, notez bien Vintonation des syllabes accentuées, 1a
longueur des diphtongues et de certaines voyelles. Chague
@ wai peut signifier, selon le contexte et, aussi ou méme,
® yaipe satura tof! ou tout simplement salut ! ou bienvenue Fest
tun verbe signifiantlittéralement réjouis-t0i! xaipere salut &
vous ! Le ttoiement est la regle au singulier, cat le “vous” de
politesse n'existe pas en attique, Saint Lue, dans PEvangile (1,
28), utilise le grec Xape “Je re salue” pour traduire la parole
e Pange Gabriel qui, au moment de I'Annonciation, sadressa
lla Vierge. A ce Xatpe correspond, en latin, “Ave”, que des
‘centaines de chefs-d’ceuvre de la peinture et de la musique ont
célbré
burt 8
Vocabulaire de base
doxioas exercices
&:BdoxaNos (4) maitre d’école
ai et
Reyer il, elle dit
mais (6) enfant
salut & toi ! salut d vous !
&
“Aoxsgeig (exercices)
Exercice 1 ~ Traduisez
© Xaipe, Aéyer 6 dvOparres. © Xaipere, Adyar 6
prjrop. ©'0 arippxai oi maiSes. O'0 S:Sdcxahos.
© 2 iddcxare.
xaipe, xaipere
Exercice 2~ Complétez (Chaque point représente une lettre)
© (e) Zeus et ”)Athéna.
Zeis nai. “AOnva.
@ Le dieu, du dieu.
Beds, 808.
© Salut @ vous)! dit le pere,
Xaipere, 6 warip.
© Satu! (0) mat.
1 & BiBdoxade,
Exercice d’éeriture
ira — kdmma — AdpOBa — po
on. ‘ t -
WTA recrra AapOTa pro
Corrigé de Pexercice 1
© Salut! dit "homme. @ Salut (@ vous) dit Morateur. © Le pére
et les enfants. @ Le maitre (d'école). @ (O) Maitre!
Corrigé de lexer
00-4 00-05 -
~ Xaiges
2— Mots manquants
dye — OXaige ~ O- BiBionrhos
‘O araenip xed of mraiidke.
Béxa +10
4
Les lenres grecques n'ont pas seulement servi Gori des mots, mais
également des nombres. Jusgu’é’époque alexandrine, le systéme
uilisé essemblait un pew d celui des chiffes romains (I =1, IT 2,
1-3, 11-5, 4-10, H=100..). Puis, d partir du it siécle av.
TC, les Grecs ont adopié un auire systéme en uilisant toutes les
lettres de alphabet pour noter les nombres: a'=1, B=2, ¥=3, 84
oh wou F~6, £7, 98, 89, 10 puis ta’=lI, 12. Trois
‘aractéres de Valphabetprimitf qu ne servaient plus dans la langue
Classique (¥" ~ 1” siécles av. J-C.), ont été ilisés pour noter trois
hrombres : le “digamma’” £” (noté aussi =’) pour fe 6, le “koppa’
pour 90 de faire suivre, dans les notes ou fe vocabulaire de base, les formes
contractes de la forme non-contracte : épwr@ (-d2:), Encore un
mot au sujet de ce verbe ; notez bien, qu’a la différence du
frangais, par se construt en gree avec Paccusatif (complé-
‘ment d’objet direct) : par (+ ace.) i, elle demande fi
® Nous avons rencontré dans ce texte les trois formes : 6 iANos
de} Philis, sujet dans la phrase 5, rv @idAev (le) Philos,
complément d'objet direct dans la phrase 3 et IME
PPhillos ! qui est la forme de apostrophe dans la phrase 6
Ti prow Sever 8 reeds 5
Bio kai zpudxovra + 32
“AoKkhoeig
Exercice 1 — Traduisez
@'0 maripp épura °7i pavBdva 5 mais ;@ Mavdver
x ypapev 6 mais, © Th Seixvuow h Ediys:
© Ed ypader 4 GiMRos. © Td Sedrepov ypappa
Baird éonv.
Exercice 2 — Complétez
© Philippe lt le Hive.
{0 dimes avayryvaoxer 7 .
© Les enfants, vous ceriver es lotres,
*0 naiBes, 1a ypappara,
© car vous apprenez 8 cre
pavOdvere ypadev.
© (Le) Diew est alpha et omega. :
“0 beds 10 Aga 10 péya.
© auesice que Poméea?
gon 7d peya:
Exercice d’écriture
MavOavoucwy of aides 7d ypadetv.
MaceBatvouery 0 -reides B grenpew-
33+ npeis wal rpedxovra
Corrigé de Vexercice 1
{@ Le pére demande :qu’apprend mon enfant (nant) 6 enfant
apprenda (le fit écrte. Que montre le Sphinx ?*> Phillos Gort
correctement (bien). La deuxiéme let, c'est béta (beta es).
Corrigé de Vexercice 2 — Mots manquants
GiBdiov © — ypgere ~ © — fap co - @ - tow.
1a dGjd 78 wGBnwa Jetuce, la science ou la chose que l'on
Ladjectif @xoverixév gui concerne |oule, a Vorigine de notre
[ Les particules, dont noire collection s'enrichit chague jour. sont
Gsoeron ee ieapea aeons arene
points essentiels du message. Vous vous familiariserez petit a
{foment
rérrapes kai rpuiKovra +34
“Evatov pa6npa
Te dotatov ypapya
La tablette de cire du jeune Cottalos est en bien mauvais
état. Il faut dire que sa mere Ia retrouvée ce matin dans ta
chambre de son fils, encore coineée entre son lt et le mur:
1 ‘0 &S4doxahos gpurd viv tov
Kérradoy.
2 ‘08% Kérraos of - cahas
yryvaone ra ypappara.
3 -Obros , eimé pou, 14 éort 7d Goratov
yeappa . an
‘0.8 ev dmopig ® Sv own. Kai
réhos heyer 7aB€ *
Prononciation
Enatonn matHéma, to Hlstatonn gr@Mma 1 Ho didAskaloss
éroot@ai nun tonn KOttalona, 2 Ho.dé KOttaloss
oui. sapHoss gigno®skéé ta gr@Mmata, 3 HOUoutoss
fp. mor th és to HUstatonn g@Mma ? 4 Ho_d én aporiaal
‘ona sioapaai, kai flor Iegés 18Ke,
Notes
4) 8& mais. Dans cette succession de phrases, BE ne marque plus
Ja contnuité, mais une opposition
® ob ne. pas. Exemples : pyvisoner If coma; ob yeyvioa-
weevil ne connat pas, 8'Gert of devant un mot commengant
par une voyele et od s cette voyelle porte esprit rude ("),
Equivalent done a ua TH) expiné: ob ory) (i. elle) n'est
pas 08, Bros pas ui, pas cel
35+ mivre kal rpidxovra
Neuviéme lecon 9
La derniére lettre
(la derniére lettre)
1 Le maitre interroge maintenant Cottalos,
(fe maitre interroge maintenant le Cottaios)
2 mais Cottalos ne connait pas bien les lettres.
(le mais Contalos ne-pas d'une-maniere-s
connait les lettres)
. dis-moi, quelle est la derniére lettre ?
(toi-la, dis-moi, quoi est la derniére lettre ?)
4 Celui-ci ne sait que répondre et dit finalement
(lui et dans embarras étant se-tait, et enfin alt ceci ;)
6 (CO 'Odbacels Hpas ton.)
x
08705 celui-ci : ¢’est son sens courant, Dans un dialogue, avec
‘ou sans pronom personnel (a% fo/), il peut servir a apostro-
plier: ofros ou obros ob 101d "Ouch tl!
4 dmopia l'incertitude, la perplexité,I'embarras ~ voire
Tope = a sje de quelgue chose, Note, av passage Te
verbe de la méme famille dtropa [-eu] je suis dans l"embar-
rab Jene as pas comment fate
8 xai rpidxovra + 36
5 —"O pou...
6 -Eé Sees, &Korrare. TO5 eon 7d
boratov.
5 00 moi, 6 €ou Iegééss ©o KOttalg, to O0_ dtl to HUstatonn,
Notes
5) Les accents permettent de distinguer plusieurs
=& [00] 6 méga et aussi le "6" de Papostrophe (ex. 6 matte) ;
& [09] oh / onnement ou plainte) phrase 5.
Exercice d’éeriture
‘0 &Sdcxakos épwrG tov PiAdov.
t aN A
©O Sidcorayos Zura ev Pippov.
“AoKhoeis
Exercice 1 — Traduisez
© 0 EAny ypadet 7 Spa, 4 SF BapEapos ob
yeyvaocner 73 ypappa. 2 ‘0 pév SiBdoxados
épura [-de1] vav tov @iNov. 2 ‘0 BE mais Neyer
6 1 cagds yryvdoxer. & ‘O OSucceis pws
éoriv. »'H 700 dvOpdmou puxh,
37+ ra wai spidnovra
5-— Oh! Lala
(oh ! [pauvre de] me
6— Crest juste, Cottalos ! L'6 (méga) est la demiére.
(bien tu-dis, 6 Cottalos, le 6 est le dernier)
Vocabulaire de base
Rappel : les verbes ayant une forme contracte, son présentés avec
des dewt graphies : contraete [no1-contracte] raduction.
Amopia (i) désarroi (&v érogie dans
Vembarras)
be et (continuité) ou mais
(opposition)
cine po dis-moi
epord (-4e1] il elle interroge
vov maintenant
otros celui-ci, il
(apostrophe “é tor")
cadis précisémont, clairement
ow [-4e1 i, elle se ait, garde le silence
+éN05 (78) ‘fin (adv. enfin)
dorarov dernier (adj. neut. de Borar03)
#
Corrigé de Pexercice 1
Le Gree écrit alpha, mais le barbare ne connait pas cette (a)
lettre. © Le maitre interroge maintenant (le) Phillos. © L'enfant dit
ce qu'il sait avec certitude. & Ulysse est un héros. © Lame de
homme.
derd kal tptdKovra + 38
10
Exercice 2 - Compléter,
@ Dis.moi, qu’estice que le crocodile ?
Hot, .. gory d xpoKdBethos ;
@ Le crocodile est un animal.
0 xpoxdSedos Loov ,
© Ulysse est res sé.
‘0 'OSueceis tony,
@ L’homme interroge le dieu,
‘0 dv8pwmos ov Beov.
© Eh toi! que dis-tu?
pti eyes :
al
V Aékatov pé@nua
XaAendév gon
La méthode d’apprentissage de la lecture chez les Grecs
‘nous parait aujourd ul bien laborieuse. Les fragments de
“manuels scolaires” (tessons de poterie, papyrus, etc.) nous
montrent un choix de mots assez diffciles & prononcer.
Essayons de revivre (sans peine !) cet instant.
1 “OBe 6 &iSdoxados ypappanorhs
gon,
2 ArBdoxe yap ros naiBas 78 ypdppara.
Prononciation
dSkatonn matHééma, kHalépONN_écti 1 HOdé Ho_did@skaloz
grammatstas, 60. 2 did@skéd gar ououss paidass ta gr@Mmata
39+ vvéa kal sprdKovra
Corrigé de Vexercice 2 ~ Mots manquants
tymologic sans peine : La racine yvw- du verbe
EF yeyosoxe il conait appara dans un grand nombre de noms
het de verbes composé. Le gree nous a Iaissé quelques mots
sVants comme diagnostic, lorsqu'ilsagit de reconnaitre une maladie
arice & ses symptémes et pronostic pour connaitre un événement
avance grice ides indices. L'agnostique ne nie pas Vexistence de
Dieucomme athe, mais soutient que nous ne pouvons rien connaitre
de ce qui est inaccessible aux sens et la raison, Le latin, qui parta-
ait avec Te grec la méme racine -(g)n0-, a donne, entre autes, aut
frangais “ignorer,“connaire” (lat. “cognosco”), “notable” (bien corm)
ec notion’ (connaissance élémentare). allemand *kennen” conmaitre
cet Panglais “to know” savoir ont la méme origine ointaine
Laporie (amopia de &(v)- sans et de wopos passage) désigne en
Philosophie (logique) une fmpusse intellectuelle, une contradiction
sans issue dans un raisonnement
Dixiéme lecon 10
Crest difficile
(difficile est)
1 Ce maitre est grammatiste.
(ce le maitre grammatiste est)
2 Tlapprend aux enfants a lire et a écrire
(il-enseigne en-effer [a] les-enfants les lettres)
Notes
8 ypannanoris le grammarisie ou le maire chargé de Ven-
seignement des leties 74 ypappara, Le terme ra ypappara.
<ésigne I'éeriure et aussi fa lecture, en un mot, la culture ite:
raire. Les enfants apprenaient également la musique chez le ci-
thariste et la gymnastique chez. le pédotribe, comme nous le
verrons plus loin
‘rerrapéxovra + 40
10
10
3 Xadeni 4 EdAnvich dav, dove
To pavOdverv ) xaherrdv elvar.
4 Toryaposv xahenras,
avayiyvacxouowy of waides.
5 —MaAmere , & rraibes, radra
6 MAierpov, Ediyé...
7 iro dA BiBsone 5 ypanpaniarhs
robs raiSas ra ypappara.
3) kHalgpad Hed Héll@énik@s pHoondd Ho®sté to
manntH@ngéan kHaléponn @énai 4 toigarOounn kHalépOoss
anagigno®skouaussinn Hol pAidéss. 5 mélpété Oo paidéss
outa, 6 pleektronn spHiNNx 7 Hovdttoo dée didaskéé
Ho.grammatstééss tououss p@idass ta gi@™Mmata
Notes
@ 4 uv désigne A la fois fa voi ot la langue (parlée.
® pavedvery apprendre. En francais, apprendre est ambivalent
(Gapprends a lire et fe tu! apprends lire). Le gree fait bien la
difference : pavBaveev apprendre ; BiBonery enseigner.
Notez la terminaison ~ws de I'averbe, Sur a base de Padjee-
tifaden-6v dificil (neut.sing.), on forme adverb xaRert
sg dificilement, avec dificulté | de méme obtos, celu-ci et
oir) ainsi, de cette facon- gorr ov).
© av & dons lequel, oi; est la forme que prend le pronom re~
latf 8s (mase.) ou 8 (aeutre) gui au cas datf, ue nous expli-
@ Comparez yupvafouow ils entrainent (quelgu'un) &
youvatovras is sentrainent (eux-mémes)
ual mevréxovea + 56
13,
3 ‘O yap nards nai dyabds gxer del
oridos Nrapov
4 xpdra Aapmpdv kal dpous peyddous.
5 Torotrois © obv Abyous weipatar
meiBeiv ©) ros veous &BANTas. a
3 Ho_gar kaloss kai agattioss &kHé6 a6é st®étHoss liparonn
4 kota lampronn kai oPrmououz_még@lauauss, 5 toiauOUtoies
n tououz_néouss aathidetaess,
Notes
® evios Newapdy /une)poitrine robust I nexst pas dar
ticle inden anne, des) on ree, Ladjctif Newapy neue
sing.) a phsieurs sens vigourens, opulent, riche, mais Suale=
rent gras sant. Le nom 78 a808 fa potrine et neue
mnalaré sa terminaison en -o5 4 Paccsati.I apparient une
déctinason que nous verrons ps tard (Legon 49).
® rorodros tel est un adjectif démonstratif répondant a la ques-
tion de quelle nature?
ria (+ ac.) je persuade, je comaincs; weBopa (+ dat.)
Fobcs é Exeniple: 8 wais weiBeras 7@ Bibaandhe len
ant obeit on aire.
ig
"Aoknoeig
Exercice 1 — Traduisez
® Aéyer xadous Abyous. @ Xadendv ro rele
rotoiitors Adyors. © Eimé por, 7i dvayryvoaxeis ;
© idos gor! por. © Tédos 8: Be 8 Aviip Kade
Let] robs Beous, mropel [-é21] yap
57+ era kai wevtéxovra
Car "homme “comme il faut” doit avoir une
poitrine robuste,
(le en-effer beau et bon posséde towours pottrine
robuste)
4 un teint brillant [de santé] et de larges épautes.
(teint brillant et épaules grandes)
"est avec de telles paroles, en tout cas, qu'il
essaie de convaincre les jeunes athletes.
(par-de-telles done paroles i-tente [de] convainere
les jeunes athletes)
(Phrase 3 et 4, d'aprés AnisroPHane, Les Nuées)
Vocabulaire de base
aya8is bon, honnéte
ack toujours
Kahds beau, bon
Réyos (6) discours, raisonnement
mraiBorpiGns (6) édotribe, entraineur, maitre
de gymnastique
roANanis, souvent
meipairat [4 il, elle tente
meiBev persuader
corps (plur.)
odpara (78)
is
Corrigé de Pexercice 1
© Il fait ci) de beaux discours. ® I [st difficile de eonvainere
{par de] tlles paroles. © Dis-moi, que lis-tu 7 J'ai un ami (ami
demo). © Finalement, et homme invoque (appelle) les deux,
cari a des diffcultés (est dans embarras)
Snr nal mevréxovra + 58
13
Exercice 2~ Complétez
© Cet enfant est beau
6 mais dort nadés.
@ Le bel athléte a des épaules larges.
0 AOAnrIS exer Spous :
© ine persuade pas les enfants par de telles paroles.
Torodtors ob reiBer Tous
© Elle essaie d'apprendee une langue difficile
Neiparas [-4era] xaAeriv
duviv,
© Le cultivateur soigne (ravaile avec sin) la tere
0 Sramovel [-ée1] thy...
Liexpression courante dans la langue attique 6 sag xa dyabg
résume, d elle seule, 'idéal d'une éducation. Alors que les héros
d'Homére (ens: vur siécle ax. J-C) louaient la bravoure, Vastuce
et la fdelité, les aristocrates de I'Athénes classique (V-n* sidcles
ax. JC) recherchaient l'équilibre, la tempérance, Vengagement
politique et social... les eonguétes amoureuses. L'adjectif wah
eau se réfere & la Beauté physique que la frequentation des
g@mnases permettait d'acquérir. Quant & V'adjectif €yx06g bon, if
‘raduit avant tout une qualité morale, we certaine noblesse de
Vesprit. Pour reprendre les termes de Hl Marrou (voir la
bibliographic), cet idéal est celui “d'un esprit pleinement épanou
dans un corps superbement développé”, en un mot. la
“perfection” ! Pour varier la traduction, on peut tantét parler
honnéte homme (au sens du XVI siécle) ow d'homme bien né
tantét de quelqu’un de bien ov encore d'une personne de bonne
‘mine... sefon le contexte
59+ évviéa kai mevréKovra
Corrigé de lexercice 2 - Mots manquants 13
= wag — weryihous ~ hoy c
Exercice d’écriture
0 yewpyds Siamovel thy yav.
0 gener Fiecrovel tv gv
&
‘Nous progressons lentement, mais sirement. II n'est pas néces-
saire de passer beaucoup de temps sur chayue legon.L 'essentiel,
c'est la régularité et la persévérance. Lisez a haute voix en es-
sayiant de répéter chague phrase aprés V'avoir lue. Pour vous aider
a repérer et mémoriser les vovelles a, «et v longues, nous vous
conseillons de tracer vous-méme aucdessus un petit trait (ex.:|
Beixvdov). En ce qui concerne I'éeriture, nous avons vu foutes les
Ina eer variant, us pone crc ecpr ant mt
petit carnet quelques phrases que vous relivez lorsque vous nau-
reas Le manuel sous la main. |
Ehcovra + 60
18 Tétaptov kai dékaTov paenpa
tétartonn kai d&katonn matHésme
Révision
Cotte dewriéme semaine d'étude va nous permetire de compléter
les tableaux de noire précédente legon de révision. Nous
introduirons pas plus de grammaire qu'il n'est nécessaire &
notre progression. Nous avons eu recours aux tableaux de
ddéclinaisons, car ils ont Vavantage d'or une vision synthétique
et on peut s'y reporter aisément. It va sans dire qu'il nest pas
nécessaire de Tes apprendre par cau.
1 La lecture et ’écriture
Voici quelques petits rappels: quand vous prononcez @ [tl pensez
4 faire sentir le [H] expiré pour faire Ia distinction entre + [t] et @
[tH]. De méme pour ¢ [pH] et enfin pour x (kH] qui different des
simples [p] et (k). Evitez pour av. ev. tv, ev, uv... les nasales
2 Les genres
La terminaison des substantifs aide assez souvent & reconnaitre le
‘genre. Nous avons deja repéré certains grands groupes, ceux des
‘noms terminés au nominaif singulier en
8) -05 (6 &vBpumos / homme, 6 Beds le dieu, 8 BiBAoKahos le
maitre) ; ce groupe contient principalement des. substantifs
smasculins
b) une meilleure prise aux lutteurs, absorbait la sueur et protézeait,
Ia peau des coups de soleil
2 ra inde (neut plur) éer(v) (sing). Notez emploi du vere
au singulier avec le sujet neutre pluriel, Nous reviendrons
pilus tard sur la régle.
5 ei surest suivi soit de Paceusatif, ily a mouvement je pose
sur le tabouret, soit du génitif, s'il n'y a-pas de mouvement
habit est sur le tabouret
eBoptnovra + 70
15
Vocabulaire de base
Sdeiovras ils, elles enduisent (d'huite)
Bidpos (6) tabouret (et aussi le char tiré
~ par des chevaux)
Aarov (76) uate
indna (26) habits
peor pleine
peMover(v) ils, elles s ‘apprétent &
mi8éaou(v) ils, elles posent
“AoKioeis
Exercice | — Traduisez
© Td &Sackareidv gon peotdv maiSuv.
© Oi xpoxdderhoi ciow ev 1H Alyémrre. | Aéye
. © O marip eyes Tots matai
xuBapifery. G MoAAdxis eb Aéyer Tov maiBa
Exercice 2 — Complétez
© certain enfants des enfants quelque-sns) jose dela citar.
Tay xiBapifovaw.
© ery a pas de tabouret dans I'éole,
Oix Zon Bigpos év7G -... _
© Le maitre iterroge les enfants.
0 epwrd [-4e1] rods nai8as.
© Je pose le plete sur le taboure.
TiOqn .. wAfetpov av Bidpov,
© Jets ta quinsitme logon
10 méuntoy Béxarov
Hd Onna.
Ths ds nai Boptnovra
O manip Adve wig masa! xSupiCe.
Corrigé de exercice 1
Liécole est remplic d’enfants. © Les crocodiles sont en Faypt.
Lis (dis) le live (@ haute voix). Le pe dt ses (aus) enfants
de jouer de la cithare. © I dit souvent du bien (parle en-bien) de
{son] enfant
Corrigé de exercice 2 ~ Mots manquants
aida Sacztiely «~ BBdaxzhos ~~
“Avarreyvboxs
tymologie sans peine: Comparezle gree 79 Zhatov
(huile) au latin “oleum” ('huile) ; eda (Folive ov
olivier) “oliva” (olive). Le latin a caprunté ces mots
En ofan olivier la vill d’Athénes, Athena devit la pro-
tecirice de la cite. olivier était e symbole dela déesseet del AUique
(Cégiond Athénes), dont il eonstituit une des principales ressources
Economiques. Les ennemis des Athéniens en savaient le prix et br-
Jnientparfois les plantations. Onseservait de rameaux d' olivier pour
tresset les couronnes des vaingueurs Olympic. On s‘enduisait le
comps d'hule olive avant a pratique sportve et apes le bain (uile
parfumée) L’huile tat un bien précieux pour les Grees ; on s'en
Servait méme pour Méclairage (6 Noxvos Ja lampe). Note que nos
temps modemes ont aussi leur hile précieuse exrate de a roche (h
séxpa): 70 mexpéAauov (grec médiéval) ou “petroleum”, ces
dire file de roche ou petvle.
Bio nai Soninovra +72
15
“Extov kai dékaTov paenpa
“O Gpu6addog >
Tupvds ® ination Sv ®,
patter 6 “Apiotinnos Somep of
&AAor véor &OAnrai
mpGrov ev xéet Ehaiov emi xeipas
eira 8’ pyetar «76 cOpa eAaiw
AAcigav,
kai katariOnor ® tov apubadrov
xapate 6
a Bw NB
Prononciation
Héktonn kai dékatonn mathadma, Ho.arlballoss 1 gumnoss
Himatlovau 09M 2 praattée Ho_arstppass HoOspér Ho allo
roi aatHiaetal 3 proton ménn kHeSsi lion pi kHEbrase
14 6ita daigétai to soma daloo’alé€pHoan 5 kai kath
‘oan ariballonn kHom@ardé
Notes
@ & apoGaddos “V'aryballe” est & orgine une sorte de petite
bourse en cut Pour les gymnasts, c'est avant tout un acon
spécial pour hile. C'est parce qui essemblait 4 ne bourse
qu'on a donné au petit po hulle le méme nom (voit p 484).
@ yyopvos nu suvi du geniifsignife: débarrassé de
® by ctan este parcipe présent(mase., nom.) de eon i
elle est. Le patcipe présent saccade, comme un adjectif, en
re, en nombre et en cas aver le nom augue il 3 rapport
expression commencer (3 faire quelque chose) se consiuit avec
Ia forme moyenne du verbe &pxe je commence suivi du parti-
cipe: Gpyerar Myo il commence d parler. Notez la termi
naison ~av du partieipe présent (masc.).
73+ spats Kai eBoy ynovra
Seiziéme lecon 16
Le flacon (a huile)
fle flacon-i-huile)
1 Débarrassé de [son] vétement,
(iu de-vétement éiant)
2 Aristippe fait comme les autres jeunes athletes ;
(agit Aristippe comme les autres jeunes athletes)
3 il verse d’abord de ’huile sur ses mains
(premizrement d'une-part il verse huile sur mains)
4 puis commence & se frictionner le corps.
(ensuite d'auare-pari commence le corps avec-hulle
frietionnant)
5 Ilpose ensuite son flacon a huile pat terre.
(et dépose le flacon a-terre)
/ Mim i
|
A
> © xOnorilpose, du ver appartenant ay groupe ent; HOM
je pose. En ajoutnt la preposition nara de hau en bas, en des-
cendat, on obsient le verbe composé xaraiOnye je depose.
© Lesuffixe Le signale qu'il amouvement en direction de, ver.
Exemples: yaya ¢ frre (adverbe sans mouvement), xayate
4 (vers) terre (averbe avec mouvement), "ABiivat Aihenes
(lriel en grec), "ABAvale & (vers) Ashones.
rérrapes wai 50piqovra + 74
16
Vocabulaire de base
Mo. ‘autres
Sexo Je commence et aussi je commande
Gpxerar (moy.) “i elle commence (a faire quelque chose)
yunvés, mu
parte Je fais, j'agis
xée il, elle verse
GSonep comme
“Ackhoeic
Exercice 1 — Traduisez
© 0 “Apionmmos év 19 madaiorpe Sv, xéer
Aarov. NpSrov pev &pxerai 7d capa adelov.
eira 88 yonvatera, ‘0 dveyos dpyerar xéov
ra pUDAa yapate. ‘0 véos A6Anriis karariOno
14 indnia én Sidpov. © MeAme por Thy G84y.
Exercice 2 - Complétez
© Cottalos ne pose pas son (l) Macon sur un tabouret,
‘O Kérrados of rev dpiGaddov
Eni Bigpov,
® ais il [le] dépose sur le sol.
xaraviOna xapate
© Le maitre interroge l'enfant,
‘0 BiBdoxahos époré [-4e1] ,
75 + wévre rai &€Bopixovra
ey Vétymotoie sans pine: Nous von de coir deus
¥ termes differents pour désigner la tee: yapae 2 tere
# <= (avec mouvement) et 4 yA la ferre. Ce demier est le plus
en seon du vont oentfigue compose ve aie
10) : 8 yewypédpos, le géographe (dont les éerits concement la
rte) ; 4 yewperpla, fa géometrie (la mesure de fa terre) sans
slr Cebeay re ps rons cag conse
‘naw foyon) den tees 8 yeupyos leur Nee
vt promi tens et un aves om pt an ma ee
inate a nomi "yaya tre. New fl vers a conor
"Dyaneipov pone quposes meme ero) etlecamelon
(Simpanion 1 on ql rampo Now etowvne ce cine
«thot apron dan ture anges do urperne
ana enna anne
vie et tus dees finn humble)
Corrigé de Pexercice 1
AAristippe, étant dans la palestre, verse (répand) de Vile
Tout d'abord il commence & se fictionet (ee frctionnant) le
comps [avec de Pile, pus il s’enraine, © Le vent commence &
sépandre les feuilles sur le sol. Le jeune alte dépose ses (les)
‘étements su [un tabouret,® Chante-moi (2 mo) le chant
‘mais celui-ci est dans INembatra,
aropei [-Ee1]
Tous les hommes n'ont pas de best wétements
ix gxoucr ot ipdna
ahd.
Corrigé de exercice 2 — Mots manquants
© - aod O ~ vay nahn” 4 3E
8 nai Bopipovra + 76
16
1% “E@Sopov Kai Séxatov paenpa
“0 dyabdc Spopets
Aides toni 6 DidNos ob xaipav 7
7@ yunvatecBat.
*Ayabos yoov Spopeds ok Zor
nai 61d ToGo of GAAot maides
rrodQaxis Taifouer : mpads avrov.
*Edatov toivuv odxén tuyxdvouaty 4
Exovres GiANos te kai KorraAos,
aR ON BR
Prononeiation
Hbdomonn kai d&katonn mathaéma, Ho_agatHoz dromeowss
dEEless éstinn Ho_pHilloss quou kHalroong 100i
qumnazdéstHal. 2 agattioz, go'oun droméouss ououk Est 3 ka
dia tOUoute Hoi. Allo’ pidéss poll@kss palzdououssi pross aou-
2M, 4 Elaionn toinunn ououkéti tuankH@nouaussinn
SkHonntéss pHlloss.1é kal KOrtaloss
Notes
©) Bajos (mase) clair; evident. Cette expression BANS éor(v)
(Cart) if es lar que... 0st impersonaelle en frangais. En ree,
elle est personnele et 'adjectits'accorde avec le sujet: Philo,
‘manifestemenn, ‘aime pas s'entrainer. Exemple: 84)0l elon
pavOvovres of maiBes il ext evident que les enfants ap-
retment.
® yaipwy (masc.) se réjouissant; xaipwo (+ ds, je me réjouie
e quelque chose. Vous vous souvenez de xaipe salut! (lit. ré=
Jouis-ti 1,
® raitovon(y) ils jouent. Appareoté& wats enfant, le verbe maitio
peut signer, selon le contexte, jouer (itéralement fae l'enfant)
(use moguer aller. Il se construtaorsavee mp8 (+ ae)
77+ énra kai &Boninovre
Dix-septi¢me Iegon 17
Le bon coureur
(le bon coureur)
1 Tlestévident que Phillos n’aime pas Pentrainement.
(clair il-est le Phillos ne-pas se-réjouissant de
sventrainer)
2 En tout cas, il n’est pas bon coureur,
(bon en-tour-cas coureur ne-pas il-est)
3° etc’est pourquoi les autres enfants se moquent
souvent de lui,
(et d-cause-de cela se-moquent souvent les autres
enfants envers lui)
4 Phillos et Cottalos se trouvent ne plus avoir
huile,
(hile et-voilé-que ne-plus se-trouvent-par-hasard
‘ayant Philos et Cottalos)
Tare of maides xaipover
wi aie.
> ® ob ruyxdvouew gxovres il seaouve (par hasard) quills mont
‘pas. &xovres (mase. plu) ayant. Remarquez la construction
Tuyxaveo (* part. prés.) je me trouve par hasard en train de
il se trouve par hasard que fe. Exemple: 6 mais Teyxaver
dxobey enfant écoue par hasard ou Venfant se trouve en
train d'écouter.
Suri Kal &Bopsxovra + 78
5 xaiairodc: rov ras8orpiGny rod
@haiou SNiyov ao
5 kai ait©Uoussi tonn paidotiibéénn tou elalouou ollgonn
Notes
® abrodou) [-Zovory)l ils demandent (quelque chose) &ne pas
confondre avec épari [-4] je demande au sens de j interroge
Les verbes dont le radical se termine par ~d, -€ ou -6 présen:
tent habituellement une forme eontratée des terminaisons du
présent: aiv:-oveu(v) devient air oly); épwr -w devient
por. Nous expliquerons, dans la prochaine legon de rév¥i
sion, dans quels cas il convient d’ utiliser une ou Pautre forme.
‘Comme il sagit, dans un premier temps, de vous familariser
aves cette forme dite contract, Ia double notation (contracte
[non-contracte})figurera encore quelque temps dans les notes
et les exercices.
ig
"AoKrozis
Exercice 1 — Traduisez
@ ‘0 Mos waif mpds tov Kérrahov
Gropobvra [-eovra). Mavres of nai8es xaipouct
39 naifav. Epard [-40] rhv parépa vi gon.
roir0; * Aire [-£a] rhy unrépa Tov apadov.
@'0 warp rov rrai8a emi tous Gpous TOnowv.
79+ evvéa nai €Bopimovra
et en demandent un peu au maitre de
gymnastique.
(et ils-demandent [a] le-mattre de-l'huile un-peu)
Vocabulaire de base
dyads bon
airodeuv) [-ove1)] is, elles demandent
yoiv en tout cas
Bahos, clair, évident
Bpopeds (6) coureur
éNyov (un) pew
obKer ne plus
raitovedy) ils elles joven, (+ x99 il elles
se moguent
ils, elles se trouvent (par hasard
en train de faire)
ruyxavoust(v)
isl
Corrigé de Pexercice 1
® Phillos se moque de Cottalos qui est (érant) dans embarras.
© Tous les enfants aiment (se réouissent de) s'amuser. ° Je
demande & (interroge) ma (la) mere: qu'est-ce que ceci 2°) Je
‘demande & ma (2a) mere le flacon dhuile. © Le pére pose enfant
sur [ses] (les) épaules.
byBorKovra + 80
17
17
Exercice 2 - Complétez,
@ Cottalos se trouve par hasard dans ce lieu.
‘O Karrados dv ev robT@
rong.
© Cet orateur qui a (ayant) un vétement brillant (de blancheur)
comimence a paler
Oros 8 prop Aap mpav ipdriov
© est évident que cet homme est (ct un herbare
tony 88 3 BapGapos dv.
@ est evident que ces hommes sont (tant) des barbares.
ciow of8e of v8pes BapCapa
© Le pére porte (i/-a) l'enfant sur [ses] épaules.
0 rev naiba én’ Gyov
_grecque est beaucoup plus libre qu’en franals, vous vous en étes|
‘apercu. Certaines habitudes font cependant qu'on mettra pludt
Jen te les “mots importants”, ceux gui portent 'idé sur laquelle]
‘on veut attirer Vattention ; puis, au milieu de la phrase, on trou
vera le verbe, encadré par son sujet et ses compléments. Mals tout
cela ne sawrait constituer une rogle absolue. C'est d force de lire
ler ce répéter es textes des legons que vous enregisirerez sans méme|
vous en rendre compte les schémas de construction de la phrase’
lgrecque : c'est bien wn point ou Iexpérience vaut miewc que la
théorie,
(Sion excepie Te cas des particles Speieaan |
81 + els kal dyBormovra,
Corrigé de Pexercice 2 - Mots manquants
~sypives — 06 ~ 0 ~ Ear — Bpzera. ~ © ~ Ap ~ dvg —
9 Aap — dees @ — mache ~ Eye
SAB Vetymologic sans peine: Outre les sens de “noble”,
“brave”, “bon”, eyaBbs a aussi celui de “favorable”. La
5 ville méditereanéenne d'Agde Hérault) doit son nom aux
cafons grees qui Pappelérent “Ayah Toxm La Bonne Fortune,
“pone” voulant dire ie “propice” (voir p. XIX expression &2 0%
5yy Bonne chance |). Le prénom Agathe ne signite pas “la brave
fille", mais celle qui ade la chance. Mais attention ! est un autre
mot, 8 &xérms (cu nom du fleuve Achatés de Sicile) qui donne
agate (sans i), pierre semi-précieuse, dans laquelle on taille desi
belles bles pour nos enfants
LLorsque es enfants grecs (sraiBes) feisalent dela gymnastigue ls
iaient diigés par un maxBoxpiGns (“pédowribe") maitre de gom-
rnastique dont le nom est, & lui seul, tout un programme: wau8=
‘enfant + rpiGes frotter, user (au sens propre o¥ figuré), “user” par
Texercice, di entrainer. Le pédoteibe se servait dun long baton
Pour diriger... et corriger les jeunes athletes dans leurs exercices
Centraincur d’enfanis avait done pour tiche de préparer les jeunes
gens aux épreuves d'athltisme, Ses competences et son rdle dé-
passtient d'ailleurs le seul entrainement, carl avait également des
connaissances médicales: physiologic, hyeine de vie et distétique,
Parmi es expstiences de physique amusant, ily acelle qui consiste
4 protter (xpiGerv) une reple en matire plastique pour attirer,grice
4 Pélectricité statique produite, de petits moreeaux de papicr. La
science a donné un nom savant a ce phénoméne la triboelecricité
{es fabricants de sous-vétements pour iver utlisent les proprigtés
de la riboclectrcité de certaines fibres pour conserver la chaleur
corporelle pendant a saison foie.
Bio Kai dySofovra + 82
17
in’ “Oydoov kai SéKaTov Haenua
Na Tov Aia
1 ‘Oodv Kérrados Nyet 79 wasSorpibn
1aBe 0" -
2 —"Edatov ipiv odk éveorv - ev 79
ApuGadre,
3 Bid Tobr0 aitodpey ae'? SNyov 108
Aaiou, warSorpiga ®.
4-Tophapedrdv pdbere, vi tov Aia
Prononciation
‘gdoonn kei dBkatonn mathééma, néé ton dla 1 Ho Youn
KOttalaz [gee 1001 paidotrlbéss 1446 2 €lsionn HeSminn
ououk Enéstinn ean t@oi aruballoci 3 ia t©Youto
StOUoumenN sé oligonn t2Uou élaiovou ®o paidotba, 4 to
mee améléénn matHeté nee tonn dia,
Notes
G1 r48e (neu. plur) ces pour ces chases-ci celles que 'on va dire,
@ dvean (ev - der dans - st) il se trouve (dans). Notez
pression de la possession: Atv (dat.)+ éert nous avons, lil
Talement “if ext di nous (quelque chose)". Le pronom person=
nel ot un nom au datif + étre sert a traduire le verbe
avoir: tardy dort por j'ai de Vhuile ; + wardi torw
&psBados enfant posséde wn flacon thule
3 airodpév(-écuév] oe Aatov {nous te demandons fle jue
faire (je demande est suivi de deux accusatits: celui de la
pessonne & qui on demande et celui de la chose demandée.
@ 3 war8orpiGa 6 malire ! (6 pédotribe) remarquez.cette forme
fen -a.quon utilise pour interpeller quelqu’ un, il s‘agit du vo-
calif de 6 warBorpiéns.
83+ speis xai dySoxeovra
Dix-huitiéme legon 18
Par Zeus !
(par le Zeus !)
1 Cottalos s’adresse au maitre de gymnastique en
ces termes:
(le done Cottalos dit au pédotribe cevi)
Nous n’avons plus dhuile dans notre flacon,
(huile d-nous ne-pas est-dans dans le flacon)
3 c’est pourquoi nous t’en demandons un peu,
maitre.
(pour cela nous-demandons [A] toi un-peu de
Vhuile, 6 pédotribe)
4— Apprenez donc & ne pas étre négligents, par Zeus !
(le-fait-de ne-pas négliger apprenes, par le Zeus !)
O prirwp Aecrovel miv aowtv.
> © Queda [La (+ gen.) je néglige ; 1 (neut) dedeiv [err]
(int, le ait de) négliger: Nous avions deja vu ecte construc-
tion: article défini neutre + infinitf dans 10 wavOdvery Le fai
d apprendre ou lapprentissage. Ceci rappelie ta tournure
frangaise: le boire et lemanger. Notez que devant Vint, la
négation ode) est remplacée par la négation ne. pas.
vi Bia (ou vai rv Aia) par Zeus! ou, dans une réponse,
certes, oui par Zeus !; pour la négation on wrouvera: of wat
‘rev Mia non, par Zeus !
rérrapes nai dySoiyovra + 84
18
5 “Ap’ dps 78 Bipiov roir0 ;
6 -Narov “HparAéa, 6p.
7 —Evraiba con 73 hperepov Kowvov
Aaiov.
B “Ayere 8h, raxéus AdGere ®. a
5 ar Hor®ais to th¥rionn tOlouto.? 6 Néé tonn Hédraklaa
Foro. 7 énnt@outh® iti to. Heémétéroan koinonn aon
B ages dee taxtoor IAbite
Notes
D rd dprov (newt, la petite porte ; Wipe (Kém.) la porte. Les
substantifsterminés par le suffixe diminutif-vov sont de genre
neutre : 6 mais (masc.) lenfant, x wauBiov (neut.) le petit
enfant
® Notez les impératts NAGere prenez, wABere apprenes, ainsi
que dryere alle ! (inter). Nous reviendrons ultérieurement sur
la difference de radical entre pavOsév-ere vous apprenez et
atvere apprene: !
al
"AoKhoeis
Exercice 1 - Traduisez
© Afdbs éorw 6 ‘Apiorimmos gidos ait Sv.
© O piv marhp éporg [-4e1] tov waiba’ Spas
Lastc] 78 Biprov roGr0 ; © ‘0 Be mais’ Spo [-40]
Ti ofv todr’ gonwv, & martep ; ) Kai 6 mara
roG7 dont 7d SiBacKadeiov 1d Ayerepov.
© 0 pyrop Siarovel [-£21] hy Goviy.
85 + mévre nai dySo%Kovra
5 Tuvois cette petite port
(est-ce-que tu-vois la petite-porte celle-ci ?)
6— Oui par Heracles, je la vois.
(par le Héracles, je-vois)
7— Iya la notre huile commune
i est huile notre commune)
8 Allez et servez-vous rapidement !
(allez donc ! vite prenez[-en] !)
Vocabulaire de base
alrodpey [-éou2¥] nous demandons
apedety (4c) négliger
apa: est-ce que ? (&g' devant voyelle)
fcon(v) ily a Vintériew, il existe
uiv a nous (dat.)
@iprov (76) petite porte, poterne (diminutit
de ¥ 59x la porte)
xowov commun
daGere prenez !
HA eee
6p [-40] je vois
bpd [-dezc} ‘iu vois
al
Corrigé de exereice 1
1 Il est évident qu’Aristippe est son ami (ami d-lui étant). @ Le
pére demande son (le) enfant: vois-tu cette petite porte ? © E
Pentant (dit): je (la) vois. Qu’est-ce donc, pére ? @ Et le pare
(répond): c'est notte sole, @ Lrorateur travaille (exerce
{ntensément) sa voix (D'apeés PLUTAROUF).
& wai dyBornovra + 86
19
Exercice 2 - Complétez
@ Nous avons de Phuile, lui n’en a pas.
pév don . adr 8 ob
© Je nremtends pas ce que dit Moraes
Odx 8 m1 Reyer 6 prop.
© Nous apprenons toujours
pavOdvopey,
© Les gens de bien ne négigont pas les dieu.
i xahoi Kdya8oi ok &peAodar [-ovst]
© Estce que tu essayes de lite ?
mreipg [-iy] avayeyveooxety ;
10° “Evatov kai dékatov pa6npa
o600pai TAY NéAnv
L 0 Piddos Badia: pera to0 Kortadou
mmpds To eharoBearov
Prononeiation
Enatonn kai dfkatonn matHéma, pHobOoumai téénn palin
1 Ho pilloz badizdée méta tou Kott@louou pross to
abiot€ssionn
87 + dard kal dyBomnovra
Corrigé de Wexereice 2 — Mots manquants
“Hy wv dob — Ae =
7 Bea
Létymologie sans peine: Le nom gree du “matte du
ciel", Zeds Zeus [zdéouss], a la méme origine indo-
ropécnne quc les mots fatins “deus” [déouss] dieu,
ns [diwouss] divin t “ies” [ess] jour (de la racine indo-
curopéenne tdi ou Ydeiwo sinifant rill cel lumincw). La dé-
linason est iéguliére en gee, dant base tant sur=deu tnt sur
‘i: Zeb (nom), Ai (ace), Auds (gen), Axi (dat). Ce Zeus, qua
Ti souvent de “pire des dieu, pete des hommes et du cil lumi-
roux", st rapprocher du Jupiter des Romains: Zebs mari (Zeus
le per); Jupiter: *Diowpiter, vew pater, pee du jour. Tous deux
sont es eux souverain, mazes des phénoménes atmospheriques
{a foudre, le tonnerre, Morage. Al'époque classique, le plus elebre
sanctus de Zeus était celui "Olympic. Dans e temple rebiti au
Vv sideleav-J-C. se dresat la statu colossale du dieu, euvre du
seulpteur Phdias, si impressionnante quelle fu mise plus tard au
nombre des Sept Merveilles du monde.
Dix-nenviéme legon 19
ai peur de la lutte
(je-redoute la lutte)
1 Phillos se dirige, accompagné de Cottalos, vers
le dépat @Phuile.
(le Phillos marche avec le Cottatos vers le dépot
hue)
bnri) kai byBorKovra * 88
19
19
2 Taxis 88 BaBifovres Sradéyovras
mpos dAAmAous tepl THs wahns”
3 — Afpios cl od Boudspevos
yupvatea®at
4 —Maha yap oGodpar tov dyva ®.
i Kai coi ob tas exer 9):
5 —"Eporye ®, droxpivera: 6 Kétrahos,
6 rbv Be waiBorpiény HadAov ©
oGodpar 4 Thy aAny. o
2 takiséooz.dé badladonntéz cialégonntat pross al®lovouss
péri 1885s. palééss, 3 dBéloss #2 vou bououlOménor
gummnAzdéstiai ? & mAa gar pHob@4oumai tenn ag@ona
ouou kei soi HOMoutass Ectss 7 5 Emoigé apokrfnétal
Ho Kettaloss 6 tonn dé paidotibéénn m@alionn pHobeoumal
ae denn paleenn
Notes
© -mepi (+ gén.) au swiet de, d propos de. Avec le méme sens, nous
trouvons également wept (* ace.) concernant quelque chose, &
Pégard de — wepi vis meds au sujet (4 propos) de ta lutte
ou ra epi rhv maAny ce (les choses) qui concerne la lute
Les deux tournures (ace, ou gén.) sont trés voisines. On n’en
distingue bien les nuances qu’a usage
sav ayiiva (acc,) de 8 &yév (nom.) le concows, le combat
{a compériion es un nom masculin. Voir la note de civilisation
pour Ie sens.
@ obrws dxe1 001 il est ainsi pour tol (Exes ila). Le verbe avoir,
aecompagné d'un adverbe, a le méme sens que le verbe étre
suivi de Padjcctif eorrespondant: éx j'ai (- adv,)~ eip je
suis (+ adj): eb Exe je suis bien, je vais bien wanes fx fe
‘suis mal, je vais mal ; obtws xe (ra mp yara) ains! sont
Tes choses, ilen va ainsi, la situation est ainsi.
spoeye (dat) = e1ot (@-moi) + ye (particule d'msistace)
Ryoye (= ays + ye ) au nominatif, Gquivant dans les réponses. >
89+ dvvéa kai dyBoxKovra
Go€ospa [-Zop22]
vutent 19
‘Marchant d’un pas rapide, ils
ensemble a propos de la lutte:
(rapidement marchant ils-conversent V'un-avec-
Vautre au-sujet de-la lutte)
— Tur’as pas Pair de vouloir Ventrainer.
ne-pas voulant t'entrainer)
‘ai tres peur des concours de combat.
(beaucoup en-effet je-redoute le combat. ne-pas et
pour-toi ainsi a ?)
5— Moi aussi, répond Cottalos,
(@emot-oui, répond le Cottalos)
cependant je crains davantage le maitre que la
lutte.
(le mais pédotribe davantage je-redoute que la lutte)
> & Guant & moi) oui certes !Nous verrons prochainement les
cas des pronoms personnels (2ya je, &poi d-moi).
8) paDov... fj. plus (davantage)... que
Vocabulaire de base
BaBiLouenv) ils, elles marchent
BodAopar je veus
Sradéyovrat ils, elles discutent
smepi (+ gén.) cau sujet de
pada trés, tout a fait
pBaMov plus, davantage
yay (8) concours, compétition
Amoxpiverat i, elle répond
Je crains, je redoute, je suis
effrayé
evevixovra + 90
19
“AoKroeis
Exercice 1 — Traduisez
© Aoi eiaw of meipdpevor [-x6uev01). OGror
oi &vSpes woAAdKis StaXgyovrar mepl Tis
grrocopias. Td wardiov po€eirar [-fera]
rodro 75 tGov. OW pavov mardia dAAA Kal
mavres of dvBpes do€odvras [-Lovrat] tobs
kpoxoBeiAous. AtSdcxet odv rots avOpdrous
6 mparos Abyos, 571 Beds Zon eis.
Exercice 2 — Complétez
@ Vorateur marche rapidement vers le marché (I'agora).
°0 pirup taxéws Badifer .... Thy dyopav.
© Tu vos le corps, mais tune vois pas ime
“Opas ders] 78 dpa, thy
ox ops [-4ercl.
© Je demande de Phuile au cultivate
oxi
Aira [-t0] Aaiou.
© Maintenant, je vais bien.
Nov 8¢ «3 .
@ Mis veulent marcher.
Bovdovrat . .
91 + ds eal éveviwovra
Corrigé de Pexercice 1
Mest évident qu'lsn'essayent pas (ils son elairs ne pas essavant).
Ces hommes diseutent souvent de philosophie. Le petit enfant
1 peur (eraint) de cet animal. ° Ce ne sont pas que les petits enfants,
mais tous les hommes, qui eraignent les crocodiles. © La premigre
parole [divine] (= commandement) enseigne done aux hommes que
Dieu est un,
Corrigé de Pexercice 2
= pig - pay ~ 88 —
alter a
Le got de I'émulation, le désir de se surpasser soi-méme, de lais-
ser son nom dans la mémoire des hommes, tout en sachant que ce
sont les diewx qui donnent la victoire, constituent lesprit de I'agO
(6 dep le combat, le concours) : ¢ est un aspect essentiel de la
culture grecque aristocratique. Chague cité organisait des concours
athlétiques, manifestations publigues en Ihonneur de ses dew. Les
Grecs appréciaient particuligrement les grandes fetes panhellé
nnigues périodiques, qui étaient aussi l'occasion de tréves ene les
cités beligérantes. On en comptait quatre: tous les deux ans, on
aassistat aux Jews Isthmiques de Corinthe et aux Jews Néméens
a Argolide ; tous les quatre ans avaient lieu les Jeu Pythiques de
Delphes et, les plus prestigies de tous, les Jeux Olympiques, or-
_ganisés & Olympie (Péloponnése). Pour ces deniers, une foe i
‘mense affluat de toute la Gréce en juillet pour assister aucx compé:
tions (course, pugila. pancrace ~ mélange de lute et de pugilat
‘course de chevans, pentathion et course armée). I faut imaginer
un campement comparable & nos grandes kermesses — bigarré et
briyant, peuple de marchands en tout genre avee leurs stands, On
\y voyait des artistes, des philosophes, des curieus et bien sir des
athletes.
~ tov yeopyov — > - Ew
Bio Kai éveviovra +92
19
«’ Eixoorév paenua
‘0 ayav
1 'O Kérrados vopifer rev naSorpiény
paMov © dobepay civat rod ayavos
kai Réyeu
2 —Kai piv » vopite ® ye av ayava
paAAov émxivBuvov dlvat tod
otpatespatos
3 —Mas 84ra >;
4 —Oirives yap cis tos yon vixods
ayavas doxober
Prononciation
ékostonn matHeEma, Ho_ago8MM 1 Ho Kettalox nomizdéé tenn
paidatrledénn matonn pHobéonn énai tou ag®onoss kal
I€g86. 2kal_mbénn nomizdoo.g& tonn agona mBallonn
iduunonn énai tOUou siratéUmatoss. 3 poz deta 7
inéz_gar &s.tououz_gumnikououss agOonass askOUOUs!
Notes
® pAdey plus (davantage) sert construire le comparatit:
Go€eps effrayant > waddov pobepes plus effravant
real y.. ye or (mais) de plus, en oure.. Ces partcules com-
binges Servent &ajouter & ce qu vient d'éite di.
@ Notez a consirution de vopio (ie pense) Suivi d'un ageusa-
{iter d'un infiniti: vopite rev &yava (acc.) dvas (nf, je
pense que la compéttion est (mos @ mot Je pense ta compelt-
tion ee.)
® paddov émxivBuvov 100 exparcparos plus dangereux
‘que lexpédition militaire, le complément du comparati est au
anit, Autre exemple: waARov dobepdv 105 dyGvos plus
efirayant que la competition,
98 + speis Kai évevixovra
Vingtiéme lecon 20
La compétition
(le combat-compétition)
1 Cottalos pense que le maitre de gymnastique est
plus redoutable encore que la compétition et dit:
le Cottalos pense le pédotribe plus effrayant étre
Laue} le concours et il-dit)
2— De plus, je pense que la compétition est plus
dangereuse qu'une expédition militaire,
(et-de-plus je-pense la compétition plus dangereuse
tre [que] V'expédition-militaire)
3— Comment done ?
(comment done ?)
4— Eneflet, ceux qui s’exercent pour les concours
gymniques
(Ceux-qui en-effet pour les gymniques concours
svexercent)
eV
'O dyaw don emmadidbves.
» © Bfira donc, certs est une particule synonyme de oBv donc
mais plus insistante et réservée aux toumnures: mrs 8¥jra ; com-
‘ment done, comment ca? & 08 Bfjra certes non !
8) oxodor(v) [Louver] ils, elles pratiguent du verbe Goxd
[el] je pratique, je m exerce a ; Aan Bpopov je pratique (ie
m'exerce di) fa course,
-rérrapes wai éveviixovra + 94
20
5 mov mAclw mpaypata Kai
yorendrepa exovow
6 joi otpandrar paxopevor > kad
yi fj eavé Bédarrav.
7 Toradra yap rodNinas Neyer 8 warhp.
5 poly plo pratgmsta ki hHalépootéra khouousion 6
Fotstratecil mokHomeno’ kata geen kata thletann
Tieisoute gar pola epee to pater
Notes
D mpaypara dye j'ai des ennuis ; 78 mpaypa (gn, 700
mpayparos) la chose, Maffaire ; au pluriel ra mpaypara,
Tes affaires et aussi les ennus. Le terme peut sre sous-eatendu
comme dans otras Exe ainsi vont (afaires, choses), il en est
‘ainsi ou comme dans 74 xowvé les (faire, choses) communes,
ce qui est en commun, les affaires publiques
al
Vocabulaire de base
ayév (8) combat, lutte (en compétition)
Aoxodouv) [-eovr)] ils, elles s'exercent
émivBuvos dangerewx, risqué
ar (a travers), en face de, le
long de
kara (+ acc.)
otrives enue qui (mase. nom.)
oN) meio beaucoup plus
paypara (r4) affaires, ennuis (lttéralement
choses") (neut. plur.)
expédition (militaire)
soldats
effrayant (mase.)
corpareupa (r6)
‘erpanidras (oi)
oGepos
95 + mévte wai évevfxovra
5 font face a des ennuis bien plus nombreux et
plus séveres
(beaucoup davantage ennuis et plus-pénibles ont)
6 que les soldats qui combattent sur terre ou sur mer.
(que les soldats combattant sur terre ou sur mer)
7 C’est ce que dit souvent mon pére.
(ielles en-effet [choses] souvent dit le pere)
(Phrases 4 et 5, d'aprés XENOPHON,
Le Commandant de la cavaterie)
» 8) yanemiirepa plus fies le suffi -repos, a, ov srt ég3-
Tement & construire le compaatit. Nous y Teviendeons dans la
prochaine epon.
axénevos, n, ov patcipe présent de paxoqan (+ dat) fe
Combats cone ; waxeran xara OGarrav I! combat sur mer
(ilscombar par mer)
étymologie sans peine: Lradjectit $oCepés effayant
et dérivé du substantif 6 460s fa rainte qui a donné
en frangais un élément tes product: phobe, -phobie.
Exemiples: xénophobe (6 &évos létranger), celui qui eraint les
xangers; iydrophiobe (18 GBup l'eau), qui a teriblement peur
de eau. Ceux gui naiment pas les lcux clos souffren,dit-on, de
claustrophobie et, & "inverse, ceux d'entre nous qui éprouvent un
sentiment de malaise dans un lieu trop ouvert ou trop spacieux
comme une place publique (# ayopé ia place du marché) sont
eux, agoraphobes, Puisque nous en sommes au chapitre des
tends, citons Ia racine indo-européenne *ste ou *stra- qui
évoqueI'étendue ou ce qui serépand. Cette racine a donné en grec
8 oxparnyés (le général, derpandrns (le soldat), 73
arxpareupa (expidtion) ~ dot te fangs stratége,siratagéme
= et “strata”, la grand route en latin, “street” rue en anglais et
“Strasse” rue en allemand ainsi que “strand” rivage, commun a ces
deux langues. Voila une racine qui s'est bien éteadue 1
nai evevimovra + 96
20
20
“AoKnioers
Exereice 1 ~ Traduisez
© BotAopar éyetv repi TOV re orpaTiwTSv Kai
100 orpareipatos. @ Tov mporov ayava pada
o€oivras[-éovea1] dei. © Ti 8¢ Conwy eruxivbuvoy ;
© 0 ayav éonw emuivduvos, — Oiror of
orpanidrat paxovrat Kai kara yAV kai kata
@dAarray.
Exereice 2 ~ Complétez,
© ett répod is, ees répondent
amoxpiverat :
@ Je ne veux pas néaliger les dieux.
8 dpedeiv [-
] tev Oedv.
© Qu'est-ce que les enfants apprennent ?
Ti oi maiSes ;
© iis apprennent a rie (les fers) & ecole
pay 7@ BiBackadei pavOdvouor 14
© ts exercent tur (es) cops ata paleste
Ey .. tH ‘yupvalouct ra
odpara.
97 + été wai éveviovra
Corrigé de Vexercice 1
le veux parler des soldats et de 'expédition, @ Ils ont toujours
peur du premier combat. @ Qu’est-ce qui est dangereux ?
L.a competition est dangereuse. © Ces soldats combattent sur
tere ainsi que sur mer.
Corrigé de Pexercice
dronglvorae © ~ fr
‘yoluuara @ - 88
‘Mots manquants
house ~ © — wavévovey ~ @ Ey
aloe —
Snr) kal évevifeovra * 98
20
ka’ “Ev kai cikooTov paenpya
Henn kai éékostonn math
Révision
Nous allons revoir et expliguer certains fats rencontrés au cours
de la semaine passée. Il ne s'agit pas d’apprende par carur des
‘gles de grammaire, mais de bien comprendre les mécanismes de
base grace & un pets classement méthodique. Rappetons le prin-
cipe: beaucoup de pratique et un pew de théorie. C'est Vassiduité
et a régularité qui vous aideront & retenir les éléments de cette
théorie, Procédons par analogie: lorsque vous vous installez dans
tne ville que vous ne connaisse= pas, vous n'apprenez pas le plan
par coeur C'est la fréquence de vos déplacements gui vous permet
dde vous représenter les itinéraires habituels jusqu’ou jour ol vous
‘pouvez les dessiner sans vous romper et méme aider quelgu un qui
‘cherche son chemin, C'est exactement le but de cette méthode. Cette
{econ vous paratira un peu longue sans doute. Cependant, considé-
la davantage comme une visite guidée que comme un “mara
thon". Alors, suivez le guide !
1 La lecture et Pécriture
‘ous avez sans douteremarqué que certains mots ne potaient pas
<’accent tonique (’"*). Ces mots lorsquils ne sont pas accentués,
se prononcent alos d'une seule voix avec les mots qui les suivent
(@ le $4,100 les jai les ot, 08 ne pas; comme) ow qui les
précident (re ot; 9€ 10; Tou certs; eipt je suis; Cory) il ou
elle ext). Les régles de base de l'accentuation sont exposes & la
Tegon de révision 98 (p. $52).
2 Les cas et les déclin:
ons
4) Par commodité, les grammairiens ont classé les types de
déelinaisons en trois grandes eatégories. Nous dizons que les noms
féminins dont la déclinaison suit les modéles 4 fyrépa. fe jour;
eda a Ge; Badarras la mer: ainsi que les noms masculins
comme 6 rai8orpiGns le maitre de gynnastique, appartiennent
a la I* déctinaison.
99+ évvéa wai évevicovra,
Vingt et uniéme legon 21
\oietjustement la déctinaison compléte du modele masculin en -ns:
5 mardorpiéns
voc. (8) radorgié-a (8) maBorpiG-a gt
Ss en ane
') Les noms (essentiellement masculins) qui se déclinent comme
& gidos ami et les noms neutres qui se déclinent comme 7
Bi€Niov le livre appartiennent & la 2 déctinaison.
Nous parlerons plus tard des noms de la 3¢ déclinaison. La
connaissance conjointe du nominatif et du génitit singuliers
permet de déterminer le type de déclinaison. Désormais, les
substantifs serontcités avec la terminaison du génitif singulier
} marborpiGns, ou le maitre de gymnastique.
3 Les prépositions
Revoyons les prépositions et les cas qu’ellesrégissent:
fveu (+ én) sans
Bid ace.) canse de
Gm (+ ace.) sur (déplacement)
(6 an.) sur (position)
ee (ou & devant une voyelle) (+ én.) (issu) de (marque
Porigine)
Herd Chen.) avec, accompagné de
werd ace.) apres
rmepi "gen. ou ace.) au sujet de, concernant
epi (aee.) autour de, aur environs de
éxarév + 100
2
Fxemples:
= Bid ray aia di cause de l'enfant (ou mon enfant)
te maiBos depuis Venfance (depuis lige de lenfan)
— pera 108 waiB5s avec l'enfant (ou mon enfant)
= -nepi rod maxB55 au sujet de l'enfant (ou mon enfant)
= ven paxns sans fuer (sans lute).
4 Les pronoms personnels
[Nous avons renconité quelques pronoms personnels. Rappelons
{que le pronom personnel sujet (nominatif) ne s"emploie que si l'on
veut insister. Voiei un récapitulatif des deux premigtes personnes:
je rows
mom ive et fuss
me Bue ye oe oe as
fin Guod pou 00 gov ov
Gat Suet poe got gor yw
aya neyo
‘moi, je dis (quant & moi, je parle)
‘Nous verrons plus tard les régles d'emplois des pronoms accentués
‘et non-accentuss, Retenons dis & présent le modéle
Je tinerroge
03 a8 Spur, 2004 xiv maa
ce n'est pas toi (insistance) que jinterroge, mais l'enfant
5 Liinterrogation
Liinterogation directe est construte a ade Pun mot interrogatif et.
«un point einterogation (; . Voici quelques mots interrogatis
Hk que, quoi?
tis: gui?
pa... &ip" devant voyelle)est-ce que. ?
Exemples
Ti Reyer 6 BiBdoxados : Que dit le maitre ?
101 + els nai &eardv
Tis weBapite ; Oui joue de la cithare ?
“Apa yayvdonss roiro +8 ypdwna Bare que tm
6 Lés adjectifs (formation du comparatif)
Nous avons vu que les adjectifss'aecordaient en genre, en nombre
ten cas avec les noms auxquels ils se rapportent. Désormais, ils
seront.présentés avec es terminaisons du nominatif' singulier
masculin, feminin et nevire (notation des dictionnaires): Kass.
4. 8y beau, belle
Nous avons rencontré
expression du comparaif avec l'adverbe
HaMov plus, davantage:
gobeebs effrayant (positit)
HaMov gabe eds plus efrayant(comparatif)
Plus couramment, et pour la plupart des adjectifs, le comparatif se
forme a Taide du suffixe -repos, a, ov.
ceffrayant (positit)
plus effayant (comparatif)
Notez.I'allongement de -0- en -w- qui se produit parfois.
‘Le complément du comparatif'se construit de deux fagons, et vous
pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre de ces tournures:
) il se met au génitit quel que soit le cas du premier teeme
(0 xndoreib ys gobegacepus ris naANS.
Le maitre de gymmastique (nom, fest] plus terrible (nom.)
que} la lute (a)
Nouiter vov rasBorpl6ny elvae gobepdxepoy vfs wads.
I pense (que) le maitre de gym_aee.) fest] plus terrible (ace)
que] la lute (én.
Bio wai dxarév + 102
pT
au
b) précédé de la conjonetion
premier terme
+ il se met au méme eas que le
— \ naiBorpiGns dotepsrepos f | man,
Le maitre de gym. (nom. [es] plus terrible (nom, que la ute
(wom,
— Nopite:
any.
1 pense (que) le maitre de gym. (ae) [est] plus terrible (ace)
Fue] la lute (ace).
raiSorpiGny dvar gobepirepov A
‘¢ Remarque ; le comparatif sans complément o€epdrepes. a.
fv pourra se traduire aussi par «<> effrayant ou sr efravant.
7 Les verbes
8) est temps de parler des formes contracts, Pourquoi paves
tu vois donne-t-il dp&s et poێ-opar je crains Cae
oGoGpas ? Lorsque le radical du verbe (la partie invariable du
Iho es terminé pare vayelle comme 00 (6p. oe
BX les désiences(erminaisons variables) se combinen vee
cette voyell- Cela concerne le present de Pindcatif et Pimpartit
gue nous verrons por la suite. On appee cette fasion une
onwaction On distingue trois catégries de formes contrctes
orrespondant aux trois voyelles finales, -£ ou 2, suxquels
iennent s'ajouter fs désinences que nous avons vues (gon 14,
5) pour le verbe Ady je dis: =u, es, eh, “ope “re, -ov0WY).
Réaptulos les formes contracts
bp [-40) Box [-t0] Bq Ad 40)
Jevois je semble ve monte
Box tu) dy 60)
Bonds (ders) xpos -der
Bord Lee] Byicot [-éer]
Box-oopev Bni-oOpev (-ouev]
Bonaire C4 Byjcodre [bere]
tp-Gouy) dove) Box-obauy) (eave) Sy-obeul) [ore]
103 + spets nai éxardv
1) Outre la voix active (le suet fait Paction), i existe en gree une
‘ix moyenne (le suo ft ation pour lui-méme ot dans son int)
elle correspond assez souvent ala forme pronominale en fransais
«tune voix passive (le sujet subitIaction). Vous eonsaterez que,
stoi, certsins verbes acts en fangais ont une forme moyenne en
rec. On emploie souvent le terme de moyen-passif (ou médio-
si, ear les terminaisons de ees deus voix sont souvent communes.
‘Nous vertons pls tar les temps oi elles sont dsintes.Récaptulons
done les formes du présent de 'indicatf du moyen-passf
pooopa.
Jeredoute
goG-oGnar (Eons) yan
Searno ted
pobre Cerra a
Sof-oiyeba Fetueha) Spada
gob-io8e — [co0c] “eae
faikovres —— SoB-abvra eave) “Sera
(*) Les deux terminaisons -7 et - 16. Leur déclinaison est différente de celle des masculins en
os. Nous verrons cela plus tard, NotezI'expression adverbiale
réhos 8¢ enfin, finalement
is (+ ace.) dans, en signale qu'il y a mouvement ; &v (* dat.)
dans, en indique une situation sans mouvement (note 1).
poxeavés. fy 5y (a) fais: puxpds. &. bv (nd) fold
Burd eal dardy + 108
22
5 —Xhs8pa ye, dmoxpiverat 5 Erepos
nais
6 BoUdcrat 8 obv 6 Kérrados
xdoda ev ong
7 padAov ¥ spexerv ev Bepiv ” BdAmeL.
5 spHOdra.gé apokriingtal Ho Hééross - 6 KeéstHai énn_skidai
=7 - wékHigénn énn_tHerin®oi HAlpéé,
Notes
© Erepos.a, ov (mase.) fl Jaure (de dew) ; BNRos, m, 0 autre
® La conjugaison da verbe xeteBau (inf) tre dtendu, couché ou
dau repos differe de celle des autres verbes en -eBax
eipeBa
elas je suis étendu
D Bepuvés, Hv (a. de Et est dérivé du substan xd Bépos
(encore un neutre en -0s) ee
gl
“AoKHoEIG
Exercice 1 — Traduisez
© Evraiba BovAopar xeioBar, Zon yp ond. &
Oi maiSes orrdow [-dovarv] eis 78 SiBaoKaheiov.
© Oras of BovAerat Neyer. 'H Ediyg epord
[-Set] tov &vBpa. © ’Amopav [-2ov] 8° 6 1 xph
drroxpiveaBat, cwwmd. © Mada yap émxivbuvev
Eon pi capas amoxpivesbar TH Zryyi.
109 + évvéa kai éxarév
Absolument ! répond autre,
(out-é-faitcertes, répond Vautre enfant)
6 — Cottalos préfére s’allonger 4 l'ombre
(désire donc le Cottalos s allonger dans ombre)
7 plutét que courir dans la chaleur de 'ét
(plutét que courir dans estivale chaleur-du-soleil)
Vocabulaire de base
| partir de cette lecon nous donnerons ~ sauf exception ~ le
ocabulaire selon la présentation des dictionnaires (substantif au
vwominailf siagulier et au génitf singuller, verbes a la 1* personne
| singuller du présent de Vindicatp.
droxpivopat Je réponds
Babito Je marche
Bragaive je traverse
Enerra ensuite
G4 Amos (76) chaleur (du soleil d’été)
HaMov... 4 plutée que
e708. as (A) portique
ond, as (A) ombre
spexo Je cours
a
Corrigé de lexercice 1
Je veux m’étendre li, car ily a de lombre, © Les enfants
fréquentent (ans) Iécole. «Ine veut pas parler ainsi,“ Le Sphinx
interroge homme. © Mais [eelui-ci), ne sachant que répondre
(embarrassé ce qu'il faut répondre), garde le silence (se fait).
Crest, en effet, trés dangereus de ne pas répondre avec précision,
au Sphinx,
Béxa wai éeardy + 110
22 Exercice 2 - Complitez
@ Fraime beaucoup (beaucoup je me réfouis du fait de) m’allonger
A ["Jombee,
Maha 1@ KeioBar ev
@ 11 se moque souvent de [son] ami,
MlodAdvas pds ov $idov.
© Je traverse le marché.
Thy ayopav.
© Les animaux (neut. plur) courent (sing. en grec).
Ta toa .
© Est-ce que tu négliges l’entrainement ?
Ap’ apedeis yuuvateo@ar :
111+ évBexa wai éeardy
Corrigé de Vexercice 2 - Mots manquants
yaign ~ ok O ~ raiker ~ © Aabaive ~ @
étymologie sans peine: Ceraines prépostions servent
de préfine a des verbes ou a des substantifs pour les
-venrichir et en modifier le sens: Bua-Gaives (Bud i travers
“Baive je marche) je traverse ; éu-Caives (év-. &y- dans, &
(imérieur + Baives je marche) jentre:avee la préposition & (x)
iors de, en dehors, on forme éxGaives je sors de. Vows n’aurez
nucun mal & deduire le sens de ém€aive @mGaive je monte su:
‘embarque). Powvez-vous deviner le sens de mapa (wap,
iuprés de + elu jo sls) ? wépeuue je suis présert fe suis aupres
le assist. Ces préfixes sont tes products et leur connaissance
comstitue une clé trés pratique pour la comprehension du
‘vocabulaire savant. Essayons de deviner le sens de quelques
composés (apparemment diffciles): qu'est-ce qu'une germination
“pigée (yA terre) en botanique ? D'ol vennent les 6poux dans les
tidus exogames (yépios mariage) ?
Is
Pour vous aider: épigée (la surface du sol); exogame (le conjoint
est choisi en dehors du clan),
BéBexa kal eardv + 112
22
ky’ Tpitov kai cikooTév paenpa
*O pihonovesratos &
1 Oi maiBes yupvatovrar ind 106
masSorpigou
2 Nov youv dpxovrat ? rev doxhocov
kai rovodet,
3 Sidor 8 ciciv od mavres prASrrovor
bytes.
4 ‘0 ’Apiorimmos évror od povov
gudorovisrepos r00 idou daiverat
ove
Prononciation
fonn kai éékostonn m@tHésma, Ho. pHiloponoStatoss
2-ArkHonntal tona _aske@sséoonn OUoussi
3 ouou_paMMéss ~ 4 Arlsippoz_méNMa ~ pHilopono%téross
pHainétar oonn
Notes
2) giXsmoves, 05, ov adjoctif composé de Ia racine duho- gut
dime, qui est en faveur de et de waves, ov (8) la pein, le tra-
vail, la fatigue, Le suffixe -raros, n, ov set former le super
Inti absolu tres vaillant. En faisant préeéder celuici de I'ar-
ticle nous obtenons le superlatif ela 6 grhomovibraros fe
plus vaillant. Notez que pour la plupart des edjecifs composés,
tes terminaisons du mase. et du fem. sont identiques.
® yopvatovras id 109 maiSorpiGou est une constuction au
passif(passif + 0nd + gén) : warBeGonar dnd Too
BiSacndAou je suis éugué par le maitre. La présence du com-
plément agent introduit par Gmé permet de distinguer le pas-
Sif maiBedopa je suis édugu’ du moyen waBedopat j'é-
dague pour moi, je fais éduquer.
) Epxovrar (moy:) ils elles commencent. Le verbe &pxowa je
commence est suivi soit d'un complément au génitf, soit d'un
113 + spels kai Béxa wai éxarov
Vingt-troisigme lecon 23
Le plus vaillant
fle plus-vaillany)
1 Les enfants s’entrainent sous la direction du maitre,
(les enyants sont entrainés par le pédotribe)
2 Maintenant ils commencent les exercices et se
donnent de la peine,
(maintenant en-tout-cas ils-commencent les
exercices et se-donnent-du-mal)
3 mais il est évident que tous ne sont pas vaillants.
(clairs mais is-sone ne-pas tous vaillants étant)
4 Cependant, Aristippe est visiblement non
seulement plus vaillant que Phillos,
(Aristippe cependant pas seulement plus-vaillant
[que] le Phillos est-manifestement étant)
35°
ear ty 8
Sh 6
ak :
"O dursmonairacres
» vet au paricipe, exemple: pyopas 700 ASyau (eén) je
commence le dscours; &pxoyat Nye (part. Je commence
6 parler Noterau passage Fate Sens Courant de Ape (~ en.)
jeconmande, je gouverne
‘aivoyat + par slsmamfesementestsynonyine de BAA‘s
ads part) if ext clair que je suis (je sul ear) il et évidemt
qe: gudéroves paiverat Sv = Bmpds Zon gudsroves Sv
if est manfestement vaillat il est clair qu et val.
rérrapes wai Béxa wai &arév + 114
23
5 ad xai fidomovérates © wavtwv
Tay raidov
6 rav © dv rf adaiorpg Tabry.
6 1onn énn_t22i palalstraei taOutee
Notes
© Contrairement & ce qu'on attendrat, le superatf relat eho
movoraros n'est pas prévédé de article 6 parce qu'il est ici
tn fonction d’atibut du sujet. En grec classique, on ne met pas
Particle devant lattribut du sujet.
© ray naiSav ray tv... Note la répétition de l'article rv,
Reprenons la construction mot & mot au nominatif: of waiBes
ol by 7A waAaiorpq les enfants (ceux) qui sont dans ta
‘palesire. Nous ferons le point sur article lors de la prochaine
Tegon de révision.
"AoKnoeis
Exercice 1 — Traduisez
© ‘0 piv Kérrahos éhavov Exwy ob tuyxdver.
© To BE maSorpiby dei on Aarov. 9 Aire
[-eée1] obv 6 mais oAiyov eAaiou rv maBorpiCny.
00 dvip Scixvucr tav tomo ev } Zor To
xoivdy ehavov. © 'O raiSozpiGns voniter tov
Kérradov apedeiv [-éerv] 00 &yGvos eatov ob
gxovra.
115+ mevrexaiSera kat éxaréy
5 mais [il est visiblement] aussi le plus vaillant
de tous les enfants
(mais et le-plus-vaillant de-tous les enfants)
6 — quise trouvent dans cette palestre.
(des dans la palestre celle-ci)
Vocabulaire de base
pxopat je commence
pévro ccependant
nova [-£u] je me donne du mal, je souffre
mévos, ou (8) peine, fatigue
gaive je montre
daivopar Je parais, j"apparais (comme)
Je suis manifestement
vaillant, brave, intrépide
(mase. et fm, identiques)
guXémroves, 05, ov
ig)
Corrigé de Pexercice 1
2 se trouve que Cottalos n'a plus dhuile (avant ne se rome
as). © Le pédotribe a toujours de Vile. @ Lenfant en] demande
one un peu (d hue) au pédouibe. Uhomme montze le lew 0
(dns eu wou es) hleconmane. 9 Le pai pee
que Cottalos néslige le concours parce qu'il n'a pas ("apart pas)
gue Co in parce qu'll n'a pas (‘ayant pas)
dxnaiBexa nal éxardv + 116
23. Exercice 2 - Complétez
© Lrenfant a (@ enfant est) un acon hue
Te gory apibadros.
© Leécole cst pleine d’enfants.
To SiSacxadcibv gon peordv :
© Labletes'enraine nu :
‘0 aPAnris yunves.
© Les athletes discutent les uns avec Tes autres de a lute
Oi Bradéyovrat GAAAAots Tepi
ris :
© Je ds cei sans vouloe (ne vowant pas) me moquer de hi.
Toro Neyo ob maile mpos
117 + éwraxaiBexa wai a&carév
Corrigé de Pexercice 2— Mots manquants
= naiBi ~ @ ~ nalBav @ — yuunileras — @ — aBhyeai -
dng © ~ Boudduevos = abséy
13g 'étymologie sans peine: Intéressons-nous @ la famille
étymologigues. Le nom phénoméne vient du partiipe pré-
Git ubstantve de ce verbo, ra arvSpeva les choses qu appa
caissent. Ce terme dastronomie S'appliqusit dans I'Antiquité aux
‘phénoménes eélestes; designe dans notre langue un fait ou une
petsonne surprenante, voire menstrueuse “phénoméne de faite"),
rar analogie avec ces événements considérés comme extraordinaires
tue sont apparition d'une cométe ou le passage d'un météore
Dans le vocabulaire dela seience et de la philosophic, phénoméne
sert a nommer plus généralement tout ce qui se manifest & note
conscience. Revenons &Iastronomie: le lever dun asie se disait
tn gree f ders. Nous parions toujours des phases dela Lune pour
et les apparences gue nous lui voyons prendre, mais Pidée
“periodicté” ou de “succession «'éats" Va emporté sur celle
“apparition” pour le autres sens de phase. Appartenant la méme
famille, voici Padjectif diaphane (Biadavy}s qui laisse passer fa,
‘tuniére) ou le nom phanére (davepés visible) qui désigne “woutes
Jes productions épidermigues appurentes des vetébrés(ongles, pols,
éeailles..)". Noublions pas la cellophane, marque déposée dune
sorte de pellicle rransparente uilisée pour Iemballage. Dans un
registre moins savant, citons encore le nom fataisi jusqu'au XVI"
Siecle il signfiait “vision, imagination”, sens qu'avat le mot gree
4 bavracia : ce cui est fantatigue au sens premier nexiste que
dans notre imagination, Au xx° sitele, la psyehanalyse a popul-
vise le famtasme, calqué sur 4 aveaepa apparition, vision,
specire,wais depuis longtemps ce mot gree hantait notre vocab
Jaire sous la forme un peu altérée de “fant6me”.
bxroxaiBexa kai éxardy + 118
23
«d’ Téraptov kai cikootév paOnya
“EmpeAciobe
1 YeAnpas 1 Svn warSeber
8 natBorpiéys robs waiSas.
2 AiBdoxe yap maiBas vas
3
14 oxfpata 14 mpds rv dyoviay.
Aéyer 86 raiBwv nwvi
4 — Xxore 84 1a émrarropeva ®
madaiav ,
Prononciation
tStartonn kai éékostOnn —épimél@ésthé 4 skeérOoss 109i nM
2 id®sk6e ~ pdasstinass ta sktHéémata ~ agooniaann
4 SkOpéé di ta EpitattOména palaloonn
Notes
3) émpedeioBe prenez soin !impéraif du verbe émpeAodar
EEouael wen.) je prends soin de, je m'applique a: WAND
Empeddirar 100 waudiou la mere prend soin de [son] petit
enfant.
® savas (ace. plur) et rave (dat. sing.) sont les formes dSclinges
du pronom-adjectifindéfini masculin ws quelque, quelque
un certain. Celui-ci peut aussi traduire le pronom indéfini
frangais on ou note article indéfini. Exemples: wats 11s wt
enfant (un certain enfant), waiBwv vs un des enfants ([parmi
les] enfants uncertain), Neyer t4s on dit (quelgu un, une
certaine personne dt ou parle), Nous en verrons la déclinaison
dans une des prochaines legons de révision,
119+ dwveaxaiBcxa nai éxarov
Vingt-quatriéme lecon 24
Appliquez-vous !
(appliquez-vous)
1 C’est réellement avec sévérité que le maitre de
gymnastique éduque les enfants.
(sévérementréellement édugue le pédotribe les enfants)
2 Iimontre certains les mouvements nécessaires
la compétition.
(i-enscigne en effet [a] enfants certains les geste les
cen-vuecde la compétition)
3° Idita Pun d’eux:
(iledit et des-enfants dl'un)
4— Fais bien attention aux gestes que je te
recommande quand tu luttes,
observe eh-bien les choses-recommandées en-uttant)
2) a dmrarrépeva les (choses) recommandées drive du verbe
Emadree j enjoins, ordonne, impose
rmaAaies (+ dat) je ute (contre): madaiw +
Contre Vanna
je lute
cixoos wai éxatev + 120
24
5 EL dé ps, mAnyas en mAcious © Aj
8 MerilSl rasta dnoéhenes ee
4 waiSorpiéms mpds ray “Apionmmov
7 85> pederG pera rv ANKov
dxovrifew Te kai Togevelv.
5 ~ pléegaass i pléfouss ledpsttt, 6 méta_ dé toute —
7 Woz. mélt8ai méta tonn Hédlitoonn akonntizdéénn tka
tox6Otén,
Notes
@® Le comparmif de wots (mase. sing.) gui est en grand
nombre est whéwy (masc-Fém.), mAgov (neu) ul est en
plus grand nombre ; quant & whetous, c'est ace. mase, 04
‘ém. pluie! (voit lepon 49, paragr. 3). Le comparatif des
adjectfs se forme & aide de deux types de sulfixes: -repos
= tej vu et toy. Nous verrans la déclinaison du compa
naif en tev ultérieurement
si
Vocabulaire de base
amobherw Je regarde vers (verbe composé
4 panir de Brémeo je vois)
EmpeAospar [tous] je m applique
Dapbaver Je recois
pederd [-40] “ie pratique (avee soin, je
applique &
aiBebn J édugue
Anya. fs (A) coup
orAnpés, 6. ov
oKone [-20)
sévere (axingibssévérement)
Jobserve,j’examine
‘éellenent
121 + els nai etkoot nal éxarov
$ sinon tu auras d'autres coups de baton !
(sinon, coups encore plus-nombrewe tu-recewras)
6 — Puis il regarde Aristippe,
(apres cela regarde le pédotribe vers le Aristippe)
7 quis’applique avec ses camarades 4 lancer le
javelot et tirer a Pare.
(qui s’applique avec ceux de-son-dge [2] lancer-le-
javelot et tirersil’are)
(Phrases 4 et 5 dapris Psevb0-Lucien, L'dne)
Aan tu recovras. Le verbe NapBave je pronds, je recois a
pour futur fons je prendai je recevrai qui se conjueue,
Yous pouver vous en douter, comme un verbe en -opar,
exemple: Aiypovras ils, elles prendront, ils, elles recevront.
Nous reviendrons plus tard sur la formation du futur
45 qui est un pronom relatif (mase. sing. nom.) wais 3s
Su€aives enfant qui entre
ol
Leétymologie sans peine: La double racine (oxom- et
wer) dui verbe exon j examine, observe a permis,
le former, en frangais, beaucoup de mots savants qui
expriment différentes nuances de V'idée d’observation ou
«examen attentif : le microscope est destin€ & observer ce qui est
tres peti (uuxpés) ; le périscope sert & voir tout autour (epi) et
Je stéhoscope & examiner ce qui ce passe dans la poitrine
(e1480s), Depuis deux mille ans, ceux qui, au sein de IEglise,
veillent sur én) leurs “brebis” ou les surveilient (émioxoros qui
surveille)forment I"épiscopat. Mais lorsque les “brebis” mettent
cen doute les croyances religieuses et les dogmes, elles deviennent
scepriques, (oxenmines qui observe), cesteardire qu’elles se
contentent d’ observer sans rien affirmer.
Bio Kai dxoot xal éxaroy * 122
24
“AoKnoer
Exercice 1 — Traduisez
@'0 maiBoxpiens a68pa oxAnpds dv emrarret
roig natai oxomeiv [-£e1v] ra oxhpara. © Oi 8é
nai8es dpoow [-douary] adrov kai meipGvrat
[-zoveas] peAerav [-4e19] Gomep Aeyer dvip.
© Nov 8 dpyovra: dxovritovrés re xa rofedovres
© Toryapotv xaheriy kai émuiv8uvés gory 4
An. O'H pijrnp dmo€Aéme mpas tov waa.
Exercice 2 — Complétez
@ Est-ce que le maitre de gymnastique est sévére ?
Ap’ 6 maiBo7piéns ton;
© Le maitre de gymnastique est réellement sévere.
oxnpos conv 6 waiSorpiéns.
© Qu’enscigne-t-il (qu'enseigne l'homme) done aux enfants ?
Bara 8 aviip robs waiSas
@ 11 montee tes mouvements de (ceux destinés a) la compstiton
8é 7a oxqpara pas Thy
ayoviay.
@ Les enfants ne négligent pas la compétition.
Ov oirmaiées ... dyavias
123+ speis kai eikowt Kai éxarov
Corrigé de Pexercice 1 24
Le maite de gymmastique, étant ts sévére, recommand aux
enfants d' observer [attentivement] les gestes. © Les enfants le
regardent et tentent de s'appliquer comme il (homme) le dit,
2 Maintenant, is commencent&{s'exerccr] au javelot et a tir 4
Fare. © Voili pourquoi la late fest] difficile et dangereuse. 2 La
mire jette un coup d's vers [son] enfant
Corrigé de Pexercice 2 — Mots manquants
oxdnpés — TS Sve. — 0 Th BiSdoxe:
‘hk — © ~ dyshotow ~ sig —
Noir b* ipyorres dxovriCovres.
rérrapes Kal koo kai éxatév + 124
ke’ Népnrov kai eikoordv paenua
“H peonu6pia
Aaympa axris Nou | Badia Thy yay.
al 700 Bépous Te O78 Kal
74 BévBpa SNyny omdv mapexouer
rols doxotow
Oi pv posrdon ray wadaiotpay mpd?
onp€pias, of BE erd peonpEpiav.
Eel roo Opous _Bepnds gorwy 6 dtp,
xarerh yiyverar 4 owners év
Th maAaiotpa.
Tipds'® 8é peonpEpivdv Bddrros
ye
Prononciation :
Hee mésséémbrlaa 1 lompraa abtiss Hééllou bales — 2 HE® te
stoaa ~skiaann ~ 3 ~ pHoit@ossi — pro mésséémbrlaass - méta
mésséémbrlsann 4 épéé tOUou tHErououss thérmOss éstinn
Ho aaéer 5 ~ glgnétai ~ 6 ~ méssbemrinonn thalpass
Notes
( jaeris ANiou Fes ravons ou fa lumigre du soet! (mot & mot: fe
rayon du soleil).
rots doxodor(y) (Lovers) (dat. plu) d cewe qu [0'Jerer-
cent, Attention ! GoxoGou(y) peut signifier ils, elles exercent
(Gepersonne du pluriel de 'indicatf present) etd ceux gui exer~
cent (Gatif plurel masculin et neutre du participe présent)
@ mpé (+ gén) avant, devant ; werd (+ ace.) aprés
® of pév... of 8€... vous vous souvenez de la construction par
‘opposition: les uns d'une part. mais, cependant les autres,
autre part, ou bien ceux-ci..ceusla
125 + mévre nal elkxoot nai darby
Vingt-cinquiéme lecon 25
Midi
(le milieu-du-jour)
Les rayons éclatants du soleil frappent la terre
(Griltant rayon du-solei frappe la terre)
et en été, le portique et les arbres n’offrent que
peu d’ombre 4 ceux qui s’exercent.
(et en-été le et portique et les arbres peu ombre
offrent auc exercant)
Certains vont le matin & la palestre, d’autres,
Paprés-midi.
(les uns fréquentent la palestre avant midi, les
autres aprés midi
Comme en été I'air est chaud,
(puisque en-été chaud est l'air)
Vexercice devient difficile dans la palestre
(difficile devient Vexercice dans la palestre)
A\la chaleur du soleil de midi,
(vers de-midi chaleur)
‘Notez la paticularté de ce substantif neuze en -0s dont le géni-
tifest en -ous: x9 épos (nom), rob Bépous (aén.). Le aéni-
tif sert de complément de temps: 100 Bepous en été. Nous ¥
reviendrons ultsricurement.
-npds (+ ace.) vers (ume période de la journée) ; mpds
comtpiay vers midi Note V'adjctf drive: pweonpeprves.
‘dv de ou du midi
8 eal elon eal dearéy + 126
25
7 éyxoviera 14 cdpara doxoivra. ©
7 énkorilétai~ askOWounta
Notes
7) &ywovionas je me cowvre de poussiére formé & partir de 4
ows fa poussidre. Ala fin des exercices, les athletes devaient
se nettoyer la peau — comme on le verra plus loin —et lui Stet
cee mélange d'huile, de sueur, de terre et parfois de sang aprést
une blessure
“AoKioeis
Exercice 1 — Tradui
GMNaidés nes porrder [dover] rhv madaiotpay
nerd peonpGpiav. & 'O ap Oepporepds conv A
mpd peonp€pias. ® Ocppos oniv & arp: Sore
xadendy yiyverat trois dexodatv [-Eovsty] eis
dydva. > Npdrov pev ddeipovrar ra copara of
véor OAnrai, érerra 8 éyxoviovrat yunvalopevor.
Nov 8° &pxovra doxoivres [-covses] rofedav
eal axovrifev
127 + éwrd kal eleoot kai éxartév
7 les corps se couvrent (sing,) de poussiére lors
de Pexercice,
(se-couvre-de-poussiere les corps s exercant)
(Phrases 6 & 7, d'aprés PsevDO-LUCIEN, Amowrs)
Vocabulaire de base
doxodvea [-eovea] (neut, plur) s‘exercant, pratiquant
Baw Je jette, je lance, je
. Srappe
yiyvouat Je deviens, je suis
BévBpov, ou (rd) arbre
ene ou énadq, Torsque, puisque
dos, ov (6) soleil
8épos, ous (78) &4é (08 Bégoug en été)
Dapmpds, &. dv brillant
Heonn€pia, as (4)
‘midi, milieu de journée
porta [4]
Je fréquente (une école,
tune personne)
&
Corrigé de lexercice 1
® Contains enfants vont & (fréquentent) la patestre Vaprés-midi
@ Lair est plus chau que le matin avant midi. © Lair est chaud
fet] cela devient dificil pour ceux qui s’exercent pout le combat
(en-conséquence difficile devient aux s exercant). Tout d'abord,
les jeunes athistes enduisent leur (ls) comps d"huile, puis ils [le]
couvrent de poussiée en s"entrainant, @ Maintenant ils commencent
A pratiquer le tir a are et le lancer de javelot (commencent
s'exergant i tirer-d-lare et i lancer-le-javelot)
Siri Kai cikow: Kai éxaréy + 128
26
Exercice 2—
@ Chez le maitee ils pratiquent lécriture (s'exercent @ écrire).
19 BiBaaxddry yeadav,
@ Est-ce que le male de gymnastique (est) plus sévére que le
maitre (d’école) ?
* 6 mardorpi6ns 4
6 BiB4.cKados ;
© (£2) le maitre de gymnastique et le maitre d’école [sont] séveres.
Kai é masSorpiéns kai 6 &5doKados .
© Les enfants qui apprennent bien (les bien apprenant) ne
regoivent pas de coups
Oi naibes a of
ap€dvoucr mAnyas.
© Cet homme est allongé (en) a l'ombre du portique.
bavip ev tf Tis orods ond.
mplétez,
kg" “Extov kai eikoorov paenpa
Aud kai Kopvo
1 Mada yap Subav te Kai kapvev
dvarravecBa: deka ’Apiotimos.
Prononciation
HEktonn kai 6ékostonn
anapaQUestha’ etiéleg
dips®o kai K@Mn00 1 ~ dips®onn ~
Notes
G) ada (adr) beaucoup, rés. Cet adver ot es détivés (n@NROV
plus, waAora le plus) peuvent renforcer un verbe ou un
adverbe : pada oadias 12s claiement
129+ évvéa nal eikoot nal éxaréy
Corrigé de Vexereice 2~ Mots manquants
Taga ~ donate: - © “Ae - oxeanpitepac ~ © ~ awapol
i = parvevorees — 6 "OBe —
Leéeymologie sans peine: Notre mot jour, dy latin
“furms" ir) ex appateié a roe ro pon Te fo
rsaivon deta chaleur (Bep) On rerouve ce méme
rice” (Bepr furs war) dans” Caves langues Indo
Curopécanes” pa exemple dans emt “warn chen lead
cle anglais, Nomex sont en flangats lest Tigue
lémentthemo- is de Tadect Sepuds. chou. Ans Te
sermons i ee eS epow nes) a
temperature; en aogrpbie, une ne lovherme Gos egal rele
ls dens pints gaan la me emperor
{ orgue a fempérature do. corps eat anormatemem base. on
Sout alors Phopuhermie(Owd sous, desous)
Te
Vingt-sixiéme lecon 26
Vai soif et je suis fatigué
Gai-soif et je-suis-fatigue)
1 Tres assoiffé et fatigue, Aristippe souhaite s'arréter.
(tres en-effet ayant-soif et aussi étant-fatigué faire
une-pause veut le Aristippe)
2B Les sens des verbs 82ho et BodRopan soot ts vin fe
desire je veux. Copendat,é8¢ho expr In nuance de woh,
tor bende constr alors que Ponape vat Te Yolo
avon impose, je vu
‘tpidxovra Kai &xarov + 130
26
26
2 Matera: ody yunvatopevos @
3 Kai {grav tov waidorpiénv &:' Shou
Badife.
4 Tédos 8 dxovwy ris éxeivou gaviis,
mpoaépxerar mpds exeivov"
5 — Anja, Meyer, kai kapve
6 yunvatopeba yap wohiv ® H8q
xpovov.
2 pa0uétai ~ 4 t8az.d akouSYoonn ~ 6 ~ polunn eédeé
kerOnonn,
Notes
® Le verbe masowar je cesse,suivi du participe présent, signi
fie je cesse de faire quelque chose ; avarasopas je me repose,
je fais une pause. Nous reviendsons sur ta terminaison
‘jsevos dans la prochaine legon de révision,
® reapvee je me fatigue, je souffe ou je suis fatigue ; xépves
(part) fe me lasse de wayva wadaiwy je me lasse de luter
5
Vocabulaire de base
axotw (+ gén.) Jentends, j écoute
dvaravopat ye me repase
Bufo [-hol j'ai soit
excivos, 9.0 celui-la, celle, i, elle
(personne éloignée)
%pxopar Je vais, je viens
tyra [-é0) je cherche
Bxhos, ou (6) foule
xpoves, ov (6) temps
131 + ls nai xprdcovra eal &eardv
Mlarréte done entrainement 26
(ilscesse done s'entrainant)
et cherche le maitre de gymnastique & travers
la foule,
(et cherchant le pédotribe é-travers foule marche)
Enfin, entendant sa voix, il se dirige vers lui:
“(Enfin entendant la voix de-celui-lé, ilapproche
vers celui-la)
J'ai soif, dit-il, et je suis fatigué,
Oai-soif, dtl, et je-suis-farigué)
cat nous nous entrainons depuis bien
longtemps déja.
(nous-nous-entrainons en-effet beaucoup déjés temps)
‘Voici exemple d’un complément de temps & accusatifexpri-
ant la durée: woAby xpévoy (pendant) beaucoup de temps.
Ladjectif wots (pluriel: woNAot) pourra se traduire de diffé-
rentes fayons: beaucoup (ady.) ou considérable, qui est en grand
‘nombre (adj); woNot (adj. plur) nombreux. Nous reviendrons
sur Vadjecti woAds, oA} ohd nombreux dans la prochaine
legon de révision
26
“AoKnoeic,
Exercice 1 — Traduisez
© ‘O’Apiotummos dpxerat mapa Tov \SaoKahoy
mpd peanpepias. © ‘0 82 mais gidous nas dp@
[-4er] mpd 106 Bupiou. © “O te iARos Kai &
Kérrahos epi cod Siaéyovrat.” "Eneita 8°
euCaivouar mavres cis 79 SidacKadciov ev }
pavOavouct ra ypappara. Od pdvov gorda
[dour] tov ypappaniathy GAAa Kai rov
niBapioriv.
Exercice 2— Complétez
© Je me repose & Vombre du portique.
ev tf THis eros ong.
© Le vent ote ls fells terre
0 &vepos 7a Godda xapate
® Les feuilles sont étendues sing.) & (sur) terre.
Ta gudha éni yi.
© Maintenant, arbre est nu.
youv 7a BévBpov tony.
@ Je lis depuis longtemps déja.
Todby xpovov :
®
133 © rpeis kal rpréxovra Kai éxarov
Corrigé de lexercice 1
Aistippe va chez le maitre (@'écote) avant midi. @ L’enfant voit
dles amis devant la petite porte. “ Phillos et Cottalos discutent &
ton sujet. © Pui ils entrent tous dans M'école oils apprennent &
lire. © Us ne fréquentent pas seulement le grammatiste, mais aussi
le maitre de musique (ctharist),
2
Corrigé de Pexercice 2
“Avareatonan ~ 0 ~ BADE. —
~ wsina — 9 Nov — yay ~
rods. 6 Xpiq@ roivuy Siaredeiv yunvatopévous, 7 THis dpas otk ovons ® maveaBar Prononciation HEbdomonn ~ Hed skia® 1 akiindétoss —aader aéé tHérmainétal 2 = skisann ~ 3 Hépt@povouss - 4 ~ skia®_éstinn 5 — paldikoss povOUss 6 kHrae tolnunn diateiBénn — Notes © Le suffixe -ros permet de former des adjectfs & partir des verbes, un peu comme en frangais Ie sufixe ~ible ou -able, Il ‘marque la possibilité de I'action : 6p@ je vis s@parés visible. En faisant précéder Vadjectif du &- (in-) privat, on obtient Aéparos invisible ; de méme, a partir de xiva je déplace, je ‘meus et du & privat on forme éxivnres immobile, 2 Vous reconnaissez dans le composé énrémous (gén. EnramoBos) les mots érrrd sep et obs pied. @ Vatiectif warBueds enfantin, puéril est formé a partir du sub- stantif wags enfant. Nous expliquerons plus loin pourquoi le 8. du radical wau8- disparait au nominatif. Rappelons que la connaissance du génitif singulier permet de trouver le radical & mais (nom.) enfant, rod wads (gén.), radical wand ods (nom) le pied, 700 woBés (gén.), radical woB: 135 + mévre kai rpidxovra kai éxarév Vingt-septitme lecon | 27 Lombre Wombrey 1 Lair immobile devient trés chau. (immobile étant lair toujours se-réchauffe) 2 Voyant ombre, Aristippe dit: (le et Aristippe l'ombre voyant dit ceci:) 3— Maitre, l'ombre fait déja sept pieds ! (sepr-pied’, 6 maitre, déja Vombre) 4~ Lombre fait bien sept pieds, (sept-pieds sans-doute, 6 Aristippe, Vombre est) 5 mais des pieds d’enfant ! (mais-en-fait enfantin pied) 6 Il faut done continuer Pentrainement, (il-faut dans-ce-cas continuer s'entrainant) 7 puisque ce n’est pas encore le moment de s’arréter. (fe moment ne-pas éiant [de] s'arréter) (Phrase 1 extrate d AnisTore, Rhétorigue, Livre Il) + ® Notez la tournure impersonnelle trés fréquente xp (+ acc. inf, i fa, il est nécessaire ; xph rovBe rav AvBpa(acc.) Aone (inf) i faut que cet homme s'exerce. ® Scared (+ part) je continue d ou bien je poursuis: Seared pavBavev je continue d apprendre ou je poursuis l'étude ;xpA tue (acc,) Btaredety (inf,) pavBavovra (ace) il faut que je ‘continue d'apprendre (laut imo} continuer apprenan) ‘ri Spas... ons (gén.) Mhewe.. dant. Le panicipe et son Sut at génitif sont équivalent d'une proposition commengant par quand, comme, puisque. Le mot 4 Spa (a. long) signifi, selon le contexte: “la saison” (pa Bepiva I'été ou fa saison chaude) ;“Pheure” (h BuBexdrm dpa la doucidme heure) ou “le moment favorable” (€v pq au bon momen), 8 kai tprdxovra kai éxarév 136 27 Vocabulaire de base dxivatos, 0s, 0v immobile BrareAd [40] Je continue BrareAciv [-é2-v] continuer Sp av [doy] en voyant x4 il faut Spa, as (A) hheure, moment, saison étant (mase. fém, neut.) by, oda, &v (part) @ Ey +4 nahaiorpg 6 waiSorpiéns SiareAet exondy rods véous aBAnras doKoupévous, @ MaiSev nis moAbv Hn xpovov yonvaterar pera TOV AAiKwy. © Aupf dé wai kapver, O Ava oie éBéhat matey THis Tans Kai ON.yov xpovov dvaravco¥as. © "Hn yap dpa éorlv avarravecBa. Exercice 2 — Complétez © test clair que cot enfant est vallant Aados $idsrrovos obros é mais... © Lenfant observe Pombre et interroge le mate. ‘0 nats Thy away kal rev &iSdoKahov. © Exec qu'il est temps (moment) de se repose? “Ap? éoriv avamaicoBat ; © te vais chez mon (ami mapa Tov didov. © 11 faut prendre soin de [ses] amis. empedeiabar trav didov. 137 + dreds kai xpidxovra wai &xaréy op 2 = a dase A Corrigé de Vexercice 1 _ Dans la palestre, fe maitre de gymnastique ne cesse (continue) 1 observer les jeunes athlates qui s'exercent(severcamt). > Un des enfants s'entraine depuis longtemps déji avec les [jeunes] de son Age. © Mais il a soif et est fatigué, @ C’est pourquoi il veut interrompre la lutte et se reposer un peu (de temps). C'est dgja, eneeffet, le moment de se reposer L'étymoogie sans peine: Nous avons vu que Vadjectif axivqros immobile était formé a partir du verbe xvi WA <5 [-tal je meus, je mets en mouvement Parmi les mots de la nigime famille, nous trouvons en grec r6 wi ay 0 cn grec ro xivapa et A xivnots le mouvement qui ont servi a forger cinématographe (ou cinema, enregistrement d'images animes) et kinesithérapie (h Bepaeia fe soin, le traitement), rééducation par des exereices et des mouvements. La cindmarique est la partie de Ia mécanique sp ‘Gtudie les mouvements des corps, n me brrd kal tprdxovra Kai &ardy + 138 28 Pour mesurer le temps de la journée, les Grees du ¥ siécle se ser vaient du cadran solaire (6 ywipey) dont lombre portée était mesurée en pieds (paw les mesures, voir legon 56). Les “sept pieds (érrdrovg) d'avant le couchant, par exemple, correspondaient aapproximativement é la fin de Uaprés-midi. Des cadrans portaife exisialent également, Seul un elimat fréquemment ensolellé comme celui de la Grice permettait de profterpleinement d'un tel systéme ! Kn’ “Oydoov kai cikoordv pa8npa Revi 1 Larticle 5, 4, 76 4) Leanicle gree. peut préeéder toutes somes de mots qu'l ‘wansforme en substantifs fanicle ~ participe: 8 Aéyov celui qui parle, Voratew (le “parlant") ; elaiv of Reyoves Ilya des [gens ui] dsent (l- sont les disart) aticle + adjecit; 6 eads xdyaQ5s lhonndte homme (le beau et bon); vo maby la beau Ue [fad ere] beau) ~ ale + adverbe: of vv na contemporain (eu: d'anjourd Tui) = anicle+verbe: 79 pavBavay lapprentssage (le td apprenire 'b) Larticle masculin phuriel (ei) peut remplacer a lui tout seu les hommes, les gens: 04 &v x4 wadakorpa les [gens qui sont) dans la ‘polesie, Deméme,l'aticle neutre pluriel (x4) remplace ali tout seul Tes choses, les affaires: va raw diday xowwa (Gorn) entre amis, fout est en commun, mot & mot: les affaires) des amis communes sont «) Lartcleremplace ladjectf possess: ps rv GiAov fu vis, fon (ami lorsqu'il n'y a pas de doute sur le possesseur. 2 Les substantifs dont le génitif singulier est en -os (3* déclinaison) ‘Une partie des substantifs que nous avons rencontrés forment leur _2citif singulier en -os: 700 maBés de l'enfant, roo ypapparos dde la etre. Us appartienment ila 3 (et demiére) décinaison, 139 + évvéa eal tpidmovra eal éxatéy Pour mesurer une durée déterminée, les Grecs avaient mis au point ‘un autre instrument a elepsydre she psBge, du nom de la source Clepsydre (“voleuse d'eau”) située sur lAcropole. La clepsydre ait une sorte d’horloge & eau, composée de deus récipients et ‘onetionnant sur le méme principe que le sablien Elle était surtout uilisée pour mesurer le temps de parole des orateurs, Vingt-huitiéme lecon 28 mais enfant +d ypappa la lettre Mase. /seUT, sing nom, ais ivan whey yoo, (8) nat ‘eau aS ace. thy alba eae eS én. tod mab Ss 4 ye dat. cad Sekt Pir nom. sk sa vo. & sa ae or ey dt. racoily) ots Yokauarouv) — “yy on) Notez que fe 8- du radical wauB- et le -r- du radical ypappar: de se maintiennent que devant une voyelle et dsparaissent dans les 3 Liadjectif mods, moAAH, woAd nombreux, shondant Le radical woh: alterne avec woAA-: mod-Gs (nom), wod-iv (acc.), odA-od (uén.), woRA-G (dat), ete, Nous verrons la \dgelinaison complete de ’adjectif rots un peu tard. Voyons pour le moment quetques-uns de ses emplois Au singulicr wohés, wodhh, WONG nombrenx, étendu, fort; ‘mods yap tony &vOpwmos car c'est un homme fort; OND divepos (un) vent fort. ‘rerrapéxovra Kal éxarov + 140 28 28 ~ Aupluriel woNoi, woAAai, odd ombrewa; woNAOL ido. de nombreux amis ov beaucoup damis ; ot wodRot tov "EMMjvew laplupart des Grecs ; woNAa wai &ryaB beaucoup de bonnes [choses]. ~ Au neutte (valeur adverbiale) moAt irés, beaucoup, moXd HAMov beaucoup plus. Notez expression au neutre phiriel: moda: la plupart die temps ou la plupart des choses. 4 Les démonstratifs 48¢, odtos ce. celui-ci 8) Le démonstrati 8¢ ce (celui-ci) est formé de Varticle defini 8 suivi de la particule -Be. I désigne ce qui est proche de celui cui parle et annonce aussi ee que Ion va dire, ce qui suit. Exemples: Bbc 5 AvOpunos ou 6 &vOpumos Be cet homme-ct ; o08e Tod dvBpsmou de cer homme-ci; Be H mahn corte lute-ci; ‘Tbe rh wahp por cette htte-ci; 8 BiBdonados Aéyer taBe.. le maitre dt cee! b) Le démonstatif obros ce (celu-ci) désigne ce qui est face au locuteur ~ mais plus éloigné que dans le cas préeédent —ou bien ce ‘ui appartientl'interiocuteur Il designe aussi ce dont on vient de parler: ofr0s, arn, rove ce, cete,ceti-ci, celle mase. newt sing. 9 cain autens caien plus, ©) Ledémonstratif éxetvos ce. (celui) désigne ce qui est encore plus loigné, qui nappartient nau locuteur, nia interdocuteur: éxe- vos, &xeivn, éxcive ce... 1d, cete..la, celubla cele 5 Le pronom ou adjectif indéfini rus quelqu un, un, un certain Le pronom ou ladjectif indéfini 11s quelgu un, wo (certain), ne prend pas 'accent, Le masculin et le féminin ont la méme forme: 141+ els kai rerrapéxovra Kal &xarév mas, et fim, neu sing. ‘nom. ms nm ae Bin. wes ves plu nom. ives mwa tee, Ties me io wer vey ta How) rots) + Les prépositions ‘Qu’avons-nous vu de neuf cette semaine ? apd (+ ace) auprés de, chez, le long de (mouvement) Gs” ( ace) vers, a, chez (mouvernent) eis (+ ace.) dans, vers l'intérieur (mouvement) & (+ dat) dans, & I incériewr (position) bb bn) pr Gnd le complement agent dun verbe d la voix passive) een mpés( ace,) em vue de, vers (mouvement ou dans le temps) en direction de » werd acc.) aprés Bia Cee.) d cause de ae EEDA pend aera & (ou e€ devant une voyelle) (+ wen.) (issu) de (marque es yelle) (+ gén,) ssa) de (mag) epi (+ave,) autour de, ac environs de | C] £ pos, as w ba & 8) rapé ) epi Bio xai rerrapdnovra wai xardv 142 28 7 Les verbes 4) Linfinitif présent se forme sur le radical du présent du verbe {en ajoutant les terminaisons suivante: aw aPactifet la pise elle-méme (voir la note étymologique p. 152). Nous ‘errons plus loin que le pluriel le plus courant n’est pas neuire, mais masculin : Béxa oraious (ace.) (distance de) dix stades Adioravras (moy.pass.) ils s Scartent; ce verbe est compos du verbe simple ierapat je me place, je me tiens et du prefixe m()- qui marque la séparation, Péloignement : &r(o) = torapat (am + hiorapa. > aniicrapar > dgioraja) Adiorapar je m éloigne, je me tens @l'soart, De meme, do) + ew > amexw carte (je tiens & 'écar), je suis éoigne bur nai rerrapdxovra wai éxaréy + 148 29 29 5 Nov $i foravrar xara oroixov of Bpopeis. ; 6 — SiyGre 34, Nyer 6 warSorpiéns 7 Kai cvyGaw ot woddoi TOV ev TH aradig, 8B 8 Séyyis rhs waNaionpas keira. '5 nllunn d&é Histanntal kata st@ikHonn ~ 6 sig@até 7 ~sig@ossinn 8 Ho énnguss tess palalstraass Ket Vocabulaire de base ‘La forme des verbes contractes vous est maintenant un peu plus fa- imiligre. Les exercices seront done allégés de ta double graphic ‘contracte [non-contracte] Bpopos, ov (8) couse eyyis ( eén.) pres de, a cbté de Eroipatopar je me prépare Forapar je me tiens (debout) (dpforapat je me tiens @ l'écart) ehebus (+ ace.) ordonne, je commande col “AoKhoEIS Exercice 1 — Traduisez © Tis Bra épyerar ; "Epyerai nis. © Ta pUrAa yapai xeiras. © Moduv H5n xpvov apicrarat 8 “OSuaceds ris Mnvedorns te Kai rod Tndepaxou. © Enei dpxerat 708 Mbyou 6 prrTwp oryaor wavres 149 « 2vvéa nai rerrapaxovra Kai éxarév 5 Les coureurs se mettent en ligne & "instant. 29 (maintenant se-tiennent selon ligne les coureurs) 6~ Silence !s*écrie le maitre (aisez-vous done, dit le pédotribe) 7 et la plupart se taisent dans le stade (et is-se-taisent la-plupart de-ceuc dans le stade) 8 quiest situé a cOté de la palestre (qui prés de-la palestre est-situé) Notes 4 qui, que est un pronom relatif que nous verrons un peu plus tard. peréxeo (+ gen.) Je participe a mapacxedate Je prépare, je dispose (nagaccessxopse je me préipare) avy [40] jeme tais, je fais silence (4 orph, silence) oyare [-dere) arydouv) [-Zoucr(v)] orabiodpopeiv roixos, ov (6) taisez-vous ! Us se taisent courir dans le stade rang, ligne a Corrigé de Vexercice 1 © Qui (donc) vient? @ On vient (quelqu’un vient). © Les feuilles gisent (verbe singulier pour le sujet neutre plurel)& terre. @ Cela fait longtemps qu’ Ulysse est loin est élojgné) de Pénélope et de Télémague. @ Puisque l'oratcur commence son discours, tous se taisent mevréxovra kal éxarév + 150 29 Exercice 2- Compliétez ® Cet homme-ci (nom.). Ces hommes-ci (ace). Obr056 oe cess TOUS avOpdrous. © Cotte lutte [est] difficile. Cette expedition militaire [est] difficile. 4 waAn xahenh, Todro 73 oxpareupa © Elle continue de jouer de la cithare Araredet © Quand les maitres sont sévéres, les enfants se taisent. Tav SiBacxdhov oxAnpav ; oi rraides. © Ii paricipe& rexercice commun, Tis kowis doxiaews [Inutile pour vous de courir. En marchant d'un pas régulier vous pro- | gresseres sur le chemin, parfois un pew rabotew, de gree ancien I51 + ets nai evréeovra eal dearév Corrigé de exercice 2 - Mots manquants — “vipers. Toitoug - @ Gry - yanerby ~ rallagRoven ~ bvewy, axyBory ~ @ ~ weréye. 2 Ss se ‘0 duos AGH L'etymologie sans peine: La course (6 Bpsp0s) était ZF pratiquée dans un stade, dont il reste aujourd hui quelques r& exemples suffisamment bien conservés pour nous donner uf idee de son aspect. Le stade esten fait une unité de longueur (76 araB:0v) mesurant 600 pieds (environ 177 m). La piste était recouverte de sable et les athletes la parcouraient une ou plusieurs {bis, en aller et retour. La liane de départ etait matérialsée dans te sol par des dallesstriges oi le pied prenait appui, mais le coureur atendait e départ debout, légérement incliné vers avant, On cou rait nu et parfois avec des armes (easque, bouclier..). Parmi les ‘mots composés i partir de drome, on peut citer le tes c&lebre chomp de courses des chevaux: 6 twmbBpopos (8 Ummos le cheval) et aujourd'hui, notre aérodrome (8 ap lair). En Afrique du Nord, ‘on connat, depuis PAntiquté, une espéce de chameau (H xau™ Os) ‘qui cout vite (5 Bpopas, 700 Bpopados): le dromadaire. Bio kal nevréxovra wal &xaréy + 152 29 NX Tpraxocrév paenua “0 orépavog 4 Efaiovns aviovayrarxai épudvrat of Bpopeis, 2 100 maiSorpiGou omaivovros 3 Ek angi obtw raxés roexe. 8 0s, Gate vopiLouawy aurov ranerov | elvan. 4 “Omobev pévror Hn wale 6 “Apiorunmos 7a ixvn abtod ? rots Todt 5 mpiveomoprav $aiverar. 6 ‘Apionmmmos ev obv ° oldrus Aadpds kal woBdens éoriv 7 Gore pabios pave Tos Aornods tpexwv ®. xeipi. Prononciation ‘viaakosstonn ~ Ho_stépHanoss 1 éxaioHindéss - Horm@onntal 2.~ séémainonntoss 182i kHééri 3 éks arkHl€dss — takHéooss {@iHistonn -& OpistHénn ~ palés ta iktinés 2outUou 10s poss 5 prinn koniortonn pHalnéstHai 6 -arstiopoz mén ~ daphi odoOkééss éstinn 7 ~ Haaidlooss pHtH@néé touou2 leipououss Notes © Notes Paltemance du radical (say /8érr-) entre le compara: tifet le superlatif de Vadjectif says rapide : Brrr plus ra ide, raxraros tris rapide, ® avros “de iui” (@’est-A-dire de Phillos) est un pronom non- r6fléch et il ne peut se rapporter a Aristippelui-méme, On em ploierait un autre pronom dans ce eas, mais nous verrons cela ‘un peu plus loin. 153 + tpeis kal mevréxovra kai éxarév Trentiéme Iecon 30 La couronne Soudain, les coureurs se redressent et s’élancent (soudain se-levent et s’élancent les courews) au signal du maitre (le pédotribe signalant de-la main) Dés le départ, Phillos court si vite qu’on croit qu'il est le plus rapide. (du début si rapidement court le Phillos que ils- ensent lui le-plus-rapide étre) Mais, Aristippe, derriére, frappe déja de ses pieds les traces de Phillos (derriére mais déja frappe le Aristippe les traces de-lui avec-les pieds) avant méme que le nuage de poussiére ne se forme. (avant nuage-poussiére paraitre) Aristippe est si léger et si rapide (Aristippe justement si léger et aux-pieds-rapides est) qu’il devance aisément les autres coureurs. (que facilement il-devance les autres en-courant) 8 xomoprs, 0 la poussive (4 xbis) gui s‘éleve Bpyvran) de a terre. Bpyypias (moyen-passt) je me leve ou je m lance. wiv ody (paticules combinées) justement,effectivement ($88ive (+ part) jesus le premier & faire (quelque chose), mot mot ye devane,j'amicipe...en faisans” Bava (+ ace. je devance quelgu hn ou quelque chose. Exemple : @84v0 abrous rpéxov je es devance en courant ‘rérrapes kai mevréxovra wai éxarrov + 154 30 8 Nov 8¢, rdv maidwv Boas peyddats xpupévev ©, 9 Oo vuKdy rijs vinns évera matSotpiGou atepavodrat. bd 00 8 - botiz, méo@lass tHroomfnoonn 9 Ho nikOonn tess niles Wena ~stépHanOUouta Notes © xpapevos, n, ov se servant de, du verbe xp@pax [-hop2] CF dat, se servir de ® (gin. +) Evena a cause de, en raison de. La “préposition” (i faudtait dire “postposition") évexa suit le mot aaquel elle se apporte; celui-ci se met au génitif: xfs viens évena d cause de la victoire. “Aoxtioets Exercice 1 — Traduisez © Oi Meépoar (Les Perses) oCodvrar Tov "AdgavSpov, trav dxovra moNt atpireysa. © Xpiy fds taéeny thy pany vindy, Nye 6 “Aréfavbpos tois otpaniorais. @ Tév mohepiov Apiorapévey efai>vns dppdvrai oi otpanarar Boats xpopevor. © 'Enei obv of roh{uiot Boov dxotouar, doCodvrai xai anopodaw. @ AfAov 8n 7 'Adebav8py vin yiyverai, 155 + mévre kai nevréxovra kai éxarév 8 — Maintenant, alors que les enfants poussent de grands cris d’acclamation, (maintenant ies enfants clameurs grandes utilisant) 9 le vainqueur est couronné par le maitre de gymnastique pour cette victoire. {le vainguamt de-la victoire en-raison par le édotribe est-couronné) Vocabulaire de base avierapat jeme tive Gpxi. Ais (A) commencement Bon, fis (a) cri, clameur evexa 4 cause de Gatto, Barrwv, Bdtrov plus rapide ued [-40] Je suis vaingueur viren, ns (A) vietoire obras)... Sore si. que ompaive Je fais signe, je signale orebavi [-60] Je couronne raéqotos, n, ov ‘és rapide taxis, da, 6 rapide spexo je cours $8av0 je devance xeip. xeupds (4) main xpapar [-houae] (dat) je me sers de a Corrigé de Pexercice 1 Les Perses eragnent Alexandre, qui posséde (possédam) une puissante armeée, “Il faut que nous wagnions (i nous faut vaincre) cette batalle” dit Alexandre a [ses] sokdats. Alors que les enneris, se tiennent & 'éeart (les ennemis se tenant-d-l'éear), les soldats soudain s°élancent en poussant des cris (se servant de cris) ‘Comme (puisque donc) les ennemis entendent ls eis, ils ont peur et sont désempards. ® Il est évident qu’ Alexandre est vaingueut (@ Alexandre la victoire survien) nal mevréxovra wal dary + 156 Exercice 2 - Complétez ® année des bartars approche (vient yrs) Athnes. To av BapCépov Spxerat mpds ras : © On voit is voien es aces des soldat 14 TOV otpartorav ixvn. © Les athltescourent et {un} grand nuage de poussire se forme Gdevien i 40Anrai rohis kai kovioprds @ Soudain, !’animal s’élance. *Efaiguns 73 Gov : © Ilest évident qu’ Aristippe court plus rapidement que Phillos. Afjiov yap én. 6 'Apiotummos Barrov tpexet 157+ éwré gai mevréxovra Kai éxary AGH Letymologie sans peine: Achille a toujours ét, pour les Grees, le plus grand des heros, doué des qualites de sf bravouire et de fore, préférant une vie glorieuse et courte “ite vi longue et sans poi Orignaire de Thessale (vor la cate, 1, 640), i se joignit aux Achéens pour assigyer la ville de Trote, \fin de rendre Achille invulnérable, sa mére Thétis auraitplongé enfant dans les eaux du Styx, le fleuve des enfers. Mais le talon par leque elle le tent resta au see et devin son point faible I ft ‘mortellement bless¢ au talon par une fléche et tomba devent Troie »ans voir la victoire des Grees, Parmi ses qualificatifs figure celui Achille aux pieds agiles (wbBas oxi AyNhebs), dont on tire "ject composé: moBdxns aux pieds acies (rapicies) La racine tndo-européenne de & 0%, 08 woB6s le pied apparaltclairement tans P'allemand “Fuss”, dans anglais “foot, dans le latin “pes, redis” et dans les langues romanes. En frangais, le bipdde et Ie ‘dieu d'origine latine cohabitent avec leurs cousins prees en = vode. Citons par exemple, le myriapode,vulgairement appelé “mille. dates”: Ie nom savant de cet animal li en attibue genereusement es millers (uupios, at, a). Le poulpe (6 rrodMimous), ui aussi, doit ‘on nom & ses “nombreux pieds”. En raison de ses hut tentacules, ‘es zoologues Wont plus précisément classé parm les octopodes, ‘Quant au podologue, ita deja fora faire avec nos deux pieds, dont i iuie et soigne les maladies, ‘Le nom gree Hy wévus la poussiere est & rapprocher du latin “eins” ene, AVorigine de nos mots frangais“ncinérer’“incinération”, ete, Seri kai mevréxovra nal ékaréy + 158 30 da’ “Ev kai Tpiakoorov Ha8npa “0 adds 1 Oi aides yonvatovrar mpds adddv. Oi pév Movrai, of B¢ maAaiouc. 2 Xpove 8’ ot rodAG » Garepov 3 tyre’ o maSorpiéns tov ‘Apiotrmov 8s © avamaverar kabpevos ® wou woud 4 nai épurd maida twa Sou éoriv b vikv o° Prononciation Hénn kai trisakosstonn — Ho_aoul®ss 1 ~ Hallionats palalououssi 3 zdBer6é ~ katHemenoss pou énn_skiBai ~ 8id@ tine Notes ‘toAAG (dat) (de) beaucoup. Pout indiquer un degeé de Zomparalson devant un compara om peut user woAG Bemeoup ou ONyov un pes ad), soe 2 acca, st dent Ciesure de rence): wo¥A@ (de Beancoun, Oy? {de pew Lxenple: iy Govepov = @Xyow Gorepov Hn peu pls tr 2) 8s qui est un pronom relatif nominatif, masculin, singuligm Remargue7, a similitude de Ta terminaison avec les substantits ddu groupe en -0s, 3 qa iyevos, 1, ov dant assis du verbe x&Onpia je sus assis, je demeure la méme place. Le mouvement sasseoir est exprimé par le verbe: xaBelopas je m assieds (inf xaBéleoBa. 159 + 2vvéa wai mevréKovea kai éxarév Trente et uniéme lecon 31 ‘aulos 1 Les enfants s’entrainent au son de Paulos. Certains pratiquent le saut, d’autres, la lutte. (es enfants s’entrainent selon aulos. les uns Sautent, les autres luttent) 2 Peu de temps aprés, (temps pas beaucoup plus-tard) 3) le maitre cherche Aristippe qui se repose assis quelque part 4 Pombre (cherche le pédotribe le Aristippe qui se-repose etant-assis quelque-part dans ombre) 4 et interroge un enfant [pour savoir] od se trouve le vainqueur: (et interroge enfant un-certain oi est le vainguant) “0 dyer ype Sedu apy is Abts. '¥ ® wou quelque part (indéfini ; remarquez les deux autres adverbes de lea: noi ot? (interogatif, phrase 3); mou (12) oi (relat dans un discours indirect, phrase 4). wuxdiv (-4ev], ~Gvr0s (part. prés.) vainguant ; du verbe vax [4 je suis vainquewr Nous avons vu que le participe précédé de articles valeur de1nom : & vixiy le vainguewr 6 Meyeov orate eiycovra wal éxarev + 160
You might also like
- Francophonie et langue française en Amérique du Sud: Problématiques de recherche et d'enseignementFrom EverandFrancophonie et langue française en Amérique du Sud: Problématiques de recherche et d'enseignementNo ratings yet
- ABC Letter Tracing for Preschoolers: French Handwriting Practice Workbook for KidsFrom EverandABC Letter Tracing for Preschoolers: French Handwriting Practice Workbook for KidsNo ratings yet
- Usages et appropriation des technologies �ducatives en Afrique: quelques pistes de r�flexionFrom EverandUsages et appropriation des technologies �ducatives en Afrique: quelques pistes de r�flexionNo ratings yet
- Anaïs Nin's Paris Revisited: The English-French Bilingual EditionFrom EverandAnaïs Nin's Paris Revisited: The English-French Bilingual EditionNo ratings yet
- Manuel de Conjugaison de L'amazighe IRCAM 2012Document495 pagesManuel de Conjugaison de L'amazighe IRCAM 2012idlisen100% (6)
- مراحل درس ايقاظ علميDocument1 pageمراحل درس ايقاظ علميDaly BaltyNo ratings yet
- Corrections Au Glossaire de La Mudawwana PDFDocument15 pagesCorrections Au Glossaire de La Mudawwana PDFDaly BaltyNo ratings yet
- Arabi04251 المفصل في الألفاظ الفارسية المعربة PDFDocument63 pagesArabi04251 المفصل في الألفاظ الفارسية المعربة PDFDaly BaltyNo ratings yet
- الرّد على الحروف الظفاريّة والحروف الامازيغيةDocument14 pagesالرّد على الحروف الظفاريّة والحروف الامازيغيةDaly BaltyNo ratings yet
- Comparaison Structurale Entre Le Berbère Et LDocument1 pageComparaison Structurale Entre Le Berbère Et LDaly BaltyNo ratings yet
- Axsa G Wakud N KurunaDocument1 pageAxsa G Wakud N KurunaDaly BaltyNo ratings yet