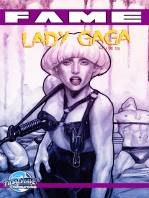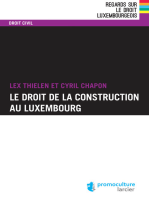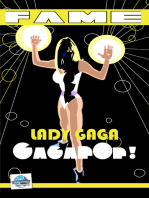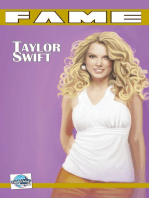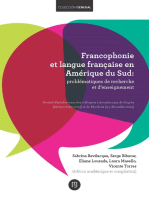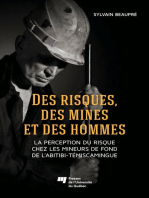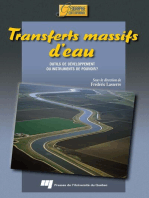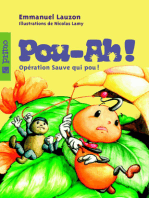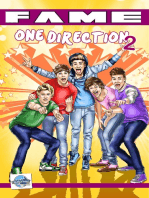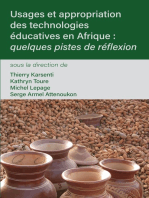Professional Documents
Culture Documents
Appuis Des Tabliers-1-3-1 PDF
Appuis Des Tabliers-1-3-1 PDF
Uploaded by
Bensalah sayf0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views49 pagesOriginal Title
appuis des tabliers-1-3-1.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views49 pagesAppuis Des Tabliers-1-3-1 PDF
Appuis Des Tabliers-1-3-1 PDF
Uploaded by
Bensalah sayfCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 49
MINISTERE DE L' URBANISME DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS
Direction des Ploutes
Appuis des tabliers
P.P. 73
13.1
Prédimensionnement géométrique
Cotts et quantités
(Piece d'usage non systématique )
Ce document est propriété de l'administration et ne peut étre utilisé
ou reproduit méme partiellement sans 1'autorisation du Service d'Etudes
Techniques des Routes et Autoroutes ou de son représentant autorisé
SERVICE D ETUDES TECHNIQUES =Q QO
DES ROUTES ET AUTOROUTES soe
1.3.1
PREDIMENSIONNEMENT GEOMETRIQUE
cOUTS ET QUANTITES
GENERALITES.... : eee See ee
1.1 - Prédimensionnenent géométrique. Emploi du document FOOT 67 1
1.2 - Colts et quantités. Complement au document EST 67 1
EVALUATION DES ACTIONS QUES AU TABLIER .. 2
2.1 - Réactions d'appui maximales 3
Cette partie n'est utile qu'en l"absence de calcul des
efforts du tablier,
2.2 = Efforts horizontaux eee. cere ereeeeecce Sag
PREDIMENSIONNEMENT D'UNE FONDATION SUPERFICTELLE*
Ce chapitre associé au § 2.1 est complémentaire du docu-
ment FOOT 67 et n'est A utiliser que si 2'on souhaite une
précision plus grande que celle donnée par la méthode sim
plifige applicable aux ouvrages les plus courants (chapitre &
de FOOT 67).
PREDIMENSIONNENENT D'UNE FONDATIGN SUR PIEUX.. 25
PREDIMENSIONNEMENT DES FUTS*. : oe 30
PREDIMENSIONNEMENT DES APPAREILS D'APPUI 32
COUTS ET QUANTITES . 7 34
Ge chapitre complate en ce qui concerne les appuis le do-
cument EST 67.
* 1, Pour les piles-culées apparentes, non traitées dans cette
pigce, on se reportera & la pidce 1.3.2 § 3.2.
2. Le choc de camion, traité pice 1.3.3 sera souvent pri
pondérant pour le dimensionnemeat de La fondation (sta~
bilité des ouvrages Stroits) et des fits (résistance au
choc).
1- GENERALITES.
3.2 - PREDIMENSTONNEMENT GEOMETRIQUE - EMPLOI DU DOCUMENT FOOT 67
Queiques remarques peuvent étre faites concernant le prédimension-
nenent : il y a tout d'abord lieu de préciser qu'il porte principalement
sur la fondation, accessoirement sur les fits et les appareils d'appui.
En ce qui concerne la fondation, ce qui suit est 4 considérer
comme conpiémentaire du document-type FOOT 67 sans se substituer a lui.
Comme iT est rappelé au § 13.20 de CAT. 75, on a été amené a compléter,
développer et préciser certains résultats numériques tels que 1a prise en
compte des tabliers 4 2 travées, des réactions d'appui dues aux charges des
camions B, et du convoi wilitaire M, 120, l'introduction des différents coef
ficients applicables aux charnes de service, en application du titre II du
Fascicule 61 du C.P.C., une meilleure estimation des efforts horizontaux
transmis par le tablier, les efforts supplémentaires en téte sous l'effet de
Ja force centrifuge dans les ponts courbes.
Toutefois, I'usage de la partie "Prédimensionnerent" n'est pas a
envisager de facon systématique et pourra étre réservé, par exemple, aux
cas suivants +
= cas dans lesquels certaines données de base du projet ont des
valeurs non courantes (par exemple tirant d'air);
= recherche d'une certaine précision au niveau A.P.0.:
- vérification des résultats fournis par une note de calcul
automatique;
- recherche des réactions d'appui en T'absence de note de cal~
cul de tablier.
Bien entendu, cette liste n'est pas limitative. Dans les autres
cas, il suffira de prédimensionner les semelles 4 l'aive du document-type
FOOT 67 (ou Edition ultérieure) et de passer au§ § de 1a présente piace.
1,2 - COUTS ET QUANTITES - COMPLEMENT AU_DOCUMENT EST 67.
Le chapitre 7 - Cots et quantités contient des bases d'estima-
tions plus détaillées que celles figurant au § 6.1.1 “Piles types” du do
Cument EST 67. Ces bases Concernént & la fois les piles intermediatres
et Tes piles culées.
Des colts types rapportés a la Tongue r de la semelle et au volu-
me de béton “es appuis y sont donnés. Ces colts sont établis au moyen du
méme bordereau de prix unitaires que celui utilisé pour 1'établissement des
Prix composes du document EST 67.
2—-EVALUATION DES ACTIONS DUES AU TABLIER
QBJET - Le présent chapitre permet d'obtenir directement et avec une
bonne précision , au stade de l'avant-projet, les valeurs des réactions
d'appui_maximales dues au tablier sous la charae permanente et les dif-
férentes charges routiares normales, ainsi que les efforts horizontaux
a prendre en compte. La partie essentielle est constituse par des aba-
ques donnant les réactions d'appui unitaires pour chaque nature de char-
ge 3 quant aux efforts horizontaux, une valeur approximative pour les
différents appuis en est donnée par un tableau. En outre, on trouvera
des indications pour 1a prise en compte @yentuelle des réactions supplé-
mentaires dues 4 la force centrifuae dans le cas des ouvrages courbes.
2.1= REACTIONS D'APPUI MAXIMALES
On déterminera.les réactions d'appui maximales (charge perma~
nente + charges routiares) relatives 8 la largeur totale du tablier,
qui seront désignées par Ree
Elles sont obtenues 4 partir des abaques joints, dont Te domai-
ne d'emploi et Tes conditions d'utilisation sont definis ci-aprés.
DOMAINE
MPLOI.
Les abaques ont été établis pour des tabliers d'inertie cons~
tante a 4 et 3 travées symétriques et 2 travées de longueurs quelconques;
cependant, leur utilisation peut étre étendue de facon satisfaisante @ des
tabliers d'inertie constante comportant un nombre quelconque de travées »
symBtriques ou non, dans les conditions précisées plus loin (cf. page ')).
HYPOTHESES DE BA
DESCRIPTION DES ABAQUES.
Pour l'évaluation des réactions d'appui dues a 1a charge per-
manente, i] a 6té considéré un ouvrage courant moyen du type PSI.DP 3
dalle parfaitement rectangulaire dont 1'épaisseur est donnée par le
rapport drétancenent, qui depend du hovbre de travees et du repport
de portees @ . Les valeurs de ce rapport ¢'élancenent £ sont Tes sui-
vantes- ;
- cas des tabliers comportant_au moins trois travées
(e portée de rive ) 6< 0,85 & = dy de Ja portee centrale (£)
portée centrale 620,85 = 2b de la portée de rive (0f)
= cas_des_tabliers comportant deux travées :
ite porte 1
(o~ Beslte BerHEE ) pour toute valeur de #, E =zh de 1 portés Yo plus
grande (£ )
La charge de superstructures a été prise égale 4 0,35 t/m2. La
charge permanente (ossature + superstructures) est, de plus, plafonnée
4 2 t/m2 gar, au-dela d'une certaine portée (entre 20 et 23 m selon Te
rapport défini précédemment), 1a dalle rectangulaire est remplacée par
des dalles a encorbellements latéraux, a nervures, élégies,ou des sruc-
tures a caisson dont l'ordre de grandeur des charges permanentes au m2
de surface utile est voisin de 2 t/m2. I1 en résulte que les courbes re~
latives a la charge permanente présentent une discontinuité ta point ob
l'on atteint la valeur de 2 t/m2.
Les abaques, sur lesquels les portées figurent en abscisses et
les réactions d'appui en ordonnées, se composent d'une série de courbes
donnant séparément les réactions dues 4 la charge permanente (y compris
Jes superstructure) et aux différentes charges (trottoirs, ACL),
Camions Bc, convoi militaire Me 120) sur ies bases suivantes i
ge Pi
nente R,_[CP): pour 1m de largeur utile droite (1)
ACL) Rv (AZ) : pour 1m de largeur roulable
camions Be Ro (Bc) : pour 1 file de_camions, non excentrée
“ convoi militaire Mc 120, non excentré
rg} aA.
Nota . Toutes les valeurs, obtenues par lecture directe, sont données en
tonnes ; les réac : is dues. Sete 7 chaussée({A et cleat de
trottoirs sont pondérées par 1,2, celle due au convoi militaire
- He 120 nest. pas ponderée.
ot) : pour 1m de largeur de trotti
Lorsque T'abaque comporte une courbe unique, celle-ci correspond
is 4 une valeur moyenne de la réaction d'appui, qui varie peu avec @ pour
Vappui considéré ; lorsque I*abaque comporte plusieurs courbes, on in-
terpolera linéairenent en fonction de @ .
EXPLOITATION DES ABAQUES
- Données en entrée
on entre par la portée adjacente af
4 et 3 travées : on entre par Ta
portée centrale £
2 travées : on entre par la portée
Ja plus grande
- Résultats en si
> appui les abaques donnent directement les réac~
tions Po dans tous les cas (dans le cas de 3 travées J'er-
7 reur conmise est négligeable) (2).
- appuis_intermédiaires : i] y a lieu de considérer séparément
- Jecas de 4, 3 et 2 travees.
- (1) Les reactions hyperstatiques de précontrainte sont 4 considérer sys-
tématiquement conme négligeables au stade du prédimensionnerent.
(2) Les valeurs correspondant aux appuis d'extrémité (charge permanente,
charges de chaussée et de trottoirs) tiennent compte d'une longueur
d'about du tablier de 0,70 m environ.
4_travées
U*abaque donne directement les valeurs des réactions Ro sur
Vappui le plus sollicité. si T’on désire connaitre les
valeurs des réactions sur les autres appuis, i] est né-
cessaire d'appliquer un coefficient de corrélation
Cig - 3) aux valeurs Ro (CP) et Ro (AL) Wes sur Taba
que 3 ces coefficients sont donnés page 13.
3 _travées
Les valeurs & prendre en compte pour les appuis (2) et (3)
se déduisent de celles obtenues directement pour 4 travees,
par application d'un coefficient de rattacherent C, 3 try aux
valeurs correspondantes Ro (CP) et Fo (AL). (of bate) 43),
2 travées
Liabaque donne directement les valeurs des différentes réac-
tions d'appui Ro.
La réaction d‘appui maximale intervenant dans le calcul de
la semelle de fondation est donnée par I’expression suivante =
R (AL). KA
R= R, (CP)-KEP.LU +R, (rot) LT + MAK {R, (Bc). KB. KSEMB
Ry (Me 120). KSEMC
Dans cette expression, 1es variables ont les significations
suivantes :
KCP : coefficient par leque) i) faut multiplier 1a réaction
d'appui due aux charges permanentes si l'ouvrage dif-
fre de louvrage moyen utilisé pour établir Tes abaques
LU: largeur utile droite.
LT: Jargeur totate des trottoirs (droite + aauche)
KA et KS : coefficients applicables aR, (AL) et R, (Bc)
(articles 4 et $ du C.P.C. fascicule 61,titre 11).
KSEMB : coefficient d'excentrement applicable a R, (BC)
KSEMC : coefficient, d'excentrement applicable & > (Mc 120)
Les coefficients KCP, KA, KB et KSEM sont explicités cf-aprés.
[KCF] est le rapport des densités au matre carré de surface
utile des charges permanentes (ossature + superstructures)}
réelle et de l'ouvrage moyen (défini page 3). Le calcul
de ce coefficient ne présente dane aucune difficulté.
KA, KB]: le tableau ci-dessous donne les valeurs de KA et de KB
paste 1 NOMBRE DE VOLES (xv) 5
Tare classe | 3,50 7,00 | 9,45 | 10,50 | 2,45.nv
classe | 3,00 540 | > - |=
3eme classe | 2,475 440 f 7 z
lere classe | 1,20 2,20 | 2,85 | 3,20 | 0,75.xv
KB | 28me classe | 1,00 2,00 - ~ -
3éme classe | 1,00 1,60 - - -
11 convient de noter que+pour la plupart des profiis en travers,
KA est voisin de 0,70 fois la largeur utile du tablier.
a Je
KSEM|= 1 + Poh
e = excentrement maximal des convois Be ou Mc 120 par rapport
3 7a Tongueur de la semelie (LSEM). ~
Dans le cas particulier of le profil en travers de la voie
portée est symétrique, ces excentrements sont égaux res-
pectivement 4 =
e(ac) = ESURCH > 2,5 - NV
e{itc 120) = ESURCH = 4.30
ESURCH désignant Ta largeur de chaussée chargeable.
La valeur 3 dans 1'expression de KSEM résulte de ce que,
en fonction de 1a classe du pont et du nombre de voies
dans les calculs de fondations superficielles, on utilise comme con-
trainte de référence au poinconnement 1a contrainte calculée aux 3/4
de la largeur comprimée.
cf. art. 2 du C.P.C. Fascicule 61, titre II.
EXTENSIONS
Lorsque le tablier comporte plus de 4 travées ou des travées
dissymétriques, les abaques sont encore utilisables sous certaines condi-
tions et moyennant une adaptation, comme i] est indiqué ci-aprés. SeuTs
les cas courants od notamment la dissymétrie n'est gas trop accentuée
sont susceptibles d'€tre traités de cette maniere; les confiaurations
trop spéciales sont donc exclues.
“o @ @ ® o
0 aaa dy i eae Vo,
On peut avoir intérét a considérer séparément Jes appuis. de
fagon @ ne pas trop se pénaliser dans }'évaluation des réactions d'appui-
Les différentes valeurs sur appuis seront obtenues en prenant
en compte successivement les tabliers 3 4 travées symétriques suivants
appuis (Let 2)
Appuis (9) et
Nota - Pour I'obtention des valeurs sur appuis 2 et 4, ne pas oublier
Torsque 6<0,85 lapplication du coefficient C/y _ 4) (cf page 18)
appyi (3)
RE ee ae ieee
o
Lost, bxbitle da betls —_boey
oe :
Nota : Ne pas oublier conne précédertient Itapplication de C/p . 3) Tors~
que yt 20,88 ff. ma 13
Cependant, si l'on ne considére pas séparément les appuis, on
peut utiliser simplement les deux résultats fournis par T'abaque en se
ramenant au cas Te plus défavorable du tablier 4 4 travées symétriques
défini ci-dessous (1) .
Ree He Pree ere rea Pree rer ere een
fenwrtl, fy)
obemanc 00,02)
Tablier a3 travées dissysétrigues :
o @ o «
oh 4 wb
—
Si I'on considére séparément les appuis, i1 faut se ramener
Successivement aux tabliers a 4 travées symétriques définis ci-aprés.
appuis (1) et (2)
Si Ion ne considare pas séparément les appuis, il suffit de
se ramener au cas le plus défavorable défini ci-dessous :
Le max 6L,VE)
Nota : Dans tous les cas i] est nécessaire d'appliquer les coefficients
C(3 tr) aux valeurs obtenues par lecture directe (cf. pay
(1) Les deux résultats sont les valeurs de Ja réaction sur T'appui d'extrémité
et Sur lappui central le plus sollicité.
Tablier. a.m travées_quelcongues
A il a baa tLe ba
Ramee =z a
4) (2) i dint) (i) (iol Mt {a} (nat)
Pour_les appuis d'extrémités (1) et (n + 1) et les appuis adja-
cents (2) et (n) ¢
On se raménera aux tabliers 4 4 travées symétriques ci-dessous
Pour les appuis intermédiaires (i)
On considérera lus 2 portées £,-1 et 2; adjacentes @ 1'apput
dont on veut determiner la réaction d'appui.et l'on se raménera au ta-,
biier 4 quatre travées symetriques :
ABAQUES,
4 et 3 TRAVEES
Rawot
-W-
10 6Lom
i
Row +
60
0
0
Appuis intermédiaires (1)
_. Charge permanente cr we
ey
charges:{ aw
‘gonderees) | U Trottoirs
Voir NOTA page suivante
aya
NOTA - L'abaque précédent relatif aux appuis intermédiaires donne directe-
ment les valeurs de R, sur l'appui le plus solticité , dans le cas
de 4 travées symétriques.
Pour obtenir Tes réactions sur les autres appuis (cas de 4
travées ou de 3 travées), i] suffit de multiplier les valeurs Tues sur
Vabaque par un coefficient, comme i] est précisé ci-aprés +
(1) fa8_de_4, travées
~ Pour @ <0,85, 1’ appui (3) est prépondérant et T'on obtient la
réaction sur T!appui (2) ou (4) par application du coeffictent
de corrélation C {2 - 3)
3
= Pour @>0,85, Vappui (2) ou (4) est preponderant et 1'on obtient
Ja réaction sur }'apoui (3) par application du coefficient de cor-
rélation C (2 - 3)_ = ett
Ro
(2) Cas_de 3. travées
Les valeurs lues sur l'abaque sont a multiplier par Tes coefficients
de rattachenent C (3 tr).
Ces coefficients sont 1S directenent: sur les courbes ci-dessous.
SREY
“IY Coefficients de corrélavion entre (i! L[ Coefficients de rattachement
appuis (2) et {3) pour 4 travées. | our 3 travées
4 -
o @ rc)
= 16 -
Re
ra
Ee
35
7
édiaire
Appui_interm
Rio Camions Be
ss tyenderds
0
oo}
0
6 Ey 25 30 35
Rolo Convoi Me 120 j
40
8 :
20
wh
100
5
° i 2 B wu a «Le
19 -
2,2- EFFORTS HORIZONTAUX
Ils ont une triple origine :
= Ceux dus au freinage d'un camion Be ou de la charge ACL).
~ Ceux dus aux variations de longuewr du tablier
> Seux dus & la force centrifuge, dans le cas des ports courbes.
Selon 1'élément d'appui considéré, i] y a Tieu de prendre en
compte les premiers seulement (prédimensionnement de la semelle) ou 1a
totalité (prédimensionnement des fats).
2.2.1. EVALUAT
DES EFFORTS.
a - Freinage. On considérera qu'il est produit par un camion
Bc, @ I'exclusion de la charge A(£) méme si celle-ci est prépondérante
par ailleurs, et l'on admettra qu'une force horizontale totale de 30 t
appliquée au niveau supérieur des appuis se répartit entre ces derniers
(force F) comme i1 est indigué au tableau ci-dessous ; les valeurs qui y
figurent correspondent 4 un cas moyen dans lequel tous les appareils
@ apput sont du type en élastomére fretté et of tous Tes appuis ont méme
auteur.
et tocar Ge F cur chats enbai eo tonne
Te [sans dale as ‘rencivton Payee a2 lie de tranatitar
eo Toe reteeutée [rvieds 1! | pite-curee
- 15.6 - 159
les 9,0 3 Kw
3 2 745 ok on
° : 4 8,28
. |
(1) La valeur de F est supposée 1a méme pour les différentes piles.
Ces valeur§ sont des valeurs minimales qui correspondent &
des appuis ayant des rigidités tres voisines et qui peuvent effect ivement
atre atteintes,par exemple par un dimensionnement approprié des appareils
d!appui.
Dans Ja réalité les valeurs peuvent étre tras différentes, par
exemple dans les cas suivants :
- si la force de freinage est excentrées :
- si_une ligne d'appareils d'appui seulement est réalisée a
Vaide de sections rétrécies de béton (Tes efforts seront augnentés sur
cette Tigne d'appui) ; 7
20 -
= si certaines lignes d'appui comportent des appareils d'apput
glissants ;
- si les appuis sont de hauteurs trés différentes. Par exemple, dans
Je cas d'un passage supérieur sur autoroute a 3 travées et réalisé en
déblai avec des piles vues de grande hauteur (8 4 10 m) et des piles
culées de hauteur courante (4 4 5 m),i] a été constaté que les efforts
horizontaux dus au freinage sur les piles intermédiaires sont fortement
minorés,et que Yes moments & la base des piles dus au freinage ne diffé-
raient pratiquement pas de ceux calculés pour le méme ouvrage dont tous
Jes appuis avaient 1a méme hauteur.
Aussi_es rudent de majorer les valeurs du tableau de 50 %
pour les calculs de prédimenstonnement.
On notera que les efforts de freinage peuvent étre considérés
comme indépendants de la largeur du tablier et de la lonqueur de 1'ap-
gui; il stensuit que leur effet, rapporté a l'unité de longueur de
Vappui, sera d'autant plus important que cette derniare sera plus faible.
b - Variations de lonqueur du tablier. Les efforts correspon-
dants, a la difference des efforts dus au freinage, peuvent étre considé-
rés comme proportionnels a la largeur du tablier (donc a 1a longueur de
ltappui) et 2 1a longueur des travées ; i1 s'ensuit que leur effet, rap-
ports 4 l'unite de longueur de 1'appui, dépendra peu de cette dernisre;
la valeur de ces efforts, dont l'ordre de grandeur peut atteindre et méme
dépasser celle des efforts de freinage pour certains appuis et certains
ouvrages, est difficile a évaluer. Toutefois, au stade du prédimension-
nement, Ta prise en compte d'un effort de freinage majoré permet de né-
gliger leurs effets et i] est rappelé que le progranme de ‘alcul considére
que ces efforts ne sont pas a prendre en compte pour le calcul des semel-
les en Fondation superficielle (cf. sous-dossier 2, piece 2.1, page 40).
Nota - Dans le cas des ponts biais, l'effort de freinage serait 4 minorer
en ne considérant que la composante normale & la ligne d'appui, soit F.sine,
Teffet des variations de longueur serait & majorer (cf. sous-doesier 2) dans
an rapport voisin de zh . Au stade du prédimensionnement, i1 n'y a pas
de correction 4 prévoir en cas de pont biais.
2.2.2. SOLLICHTATIONS DE LAPPUT.
Ltensembie de ces efforts - freinage et va~
5 riations de To-gueurs du tablier - se traduit
¥ par un moment ta base de 1'élément considérs,
soit :
HM ~ Semele de fondation : M.k.F.H (F,=freinage
seul)
- - Base du fot ok.F) Hy (F)=freinage
+ varia
: tion de lon-
gueur ou frei-
nage majoré}
Dans ces deux expressions k est un coefficient, éga] 4 1 dans le cas d'une
pile et 0,4 dans celui d’une pile-culée.
-21-
2.2.3. CAS DES PONTS COURBES - FORCE CENTRIFUGE.
Dans le cas des ouvrages courbes, des études effectuées &
Vtaide des programme EUGENE du SETRA ont montré que, pour certaines
conditions d'appui des tabliers, les forces centrifuges développées par
Tes systémes de charge Bc peuvent engendrer des efforts en téte d'appui
considérables, en particulier nettereit plus importants que ceux dus au
freinage.
La valeur de cette force centrifuge totale, définie a l'article
7 du titre II du fascicule 61 du CPC, est aisément calculable. Pour
situer son ordre de grandeur, Ja force centrifuge développée par un
camion est une fraction de son poids égale &
0,30 pour un rayon de 56 m
4,25 pour un rayon de 125 m
0,20 pour un rayon de 400 m
0,10 pour un rayon de 800 m.
Par contre, le calcul de la répartition de cette force centrifuge
entre les différentes lignes d'appuis est un calcul complexe et dépend de
Ja position du véhicule.
Au stade du prédimensionnenent, on pourrait considérer que
l'ordre de grandeur de la force centrifuge Fc appliquée en téte d'un
appui quelconque est Sga) a la moitié de la force centrifuge totale
appliquée au tablier (sauf dans les cas o¥ les conditions d'apnui sur
Piles-culées permettent d'y reprendre la quasi-totalité des efforts dus
aux forces centrifuges) et qu'elle est dirigée perpendiculairement 3
Vaxe de }ouvrage.
Dans le cas oi les appuis sont radiaux, les forces centrifuges
développent un moment dont l'effet est équivatent pur Te calcul des con-
fraintes aii le sol a un supplément d'effort normal*égal environ &
Nx20.¥o .H,
Ye étant 1a fraction de poids donnant 1a force centrifuge et
H la différence de cote entre le niveau de la chaussée et celui
de 1a fondation.
x Cette équivalence entre l'effet des forces centrifuges et un
supplément d'effort normal résulte du raisonnement suivant :
On considére que ta force centrifuge Fe appliquée en téte d'un
anpui quelconque est égale 4 la moitié de la force centrifuge totale ap~
pliquée au tablier, soit Fe ae Yc . be . NV. 60 (en tonnes, be étant
te coefficient défini a l'art. 5.22 du CPC 61, II).
Pour une différence de cote H entre le niveau de la chaussée et
celui de la fondation, te moment 3 1a base de ta fondation di a la force
centrifuge, soit H.Fc,entrafne un supplement de contrainte sur le Sol aux
3/4 de la largeur comprinée éoa) a Ao, - 2H-Fe
B.L
Bet L étant respectivement la largeur et Ta longueur de 1a se~
melle de fondation.
= 21bis —
Ce supplément de contrainte est équivalent 4 celui que donnerait
un supplément d'effort normal
an = 3
Pour des profils en travers voisins de ceux définis au catalogue
CAT 75 et pour une largeur de semelle voisine de la largeur utile du ta~
blier, 1a quantite 2° MY est proche de 0,22 (m™!) et 1 en résulte que
lieffet de 12 force centrifuge sur la contrainte sur le sol est équivalent
& celui d'un supplément d'effort normal égal environ a 20. Yc . He
al.
~22-
3. PREDIMENSIONNEMENT D'UNE FONDATION SUPERFICIELLE
OBJET - Ce chapitre est essentiellement consacré 4 1a détermination de
Ya largeur 8 de la semeile d'une pile ou d'une pile-culée,en fonction
de Ja pression admissible sur le sol de fondation et sous l'effet des
actions dues au tablier (réaction d'appui et efforts horizontaux}et du
poids propre de 1a pile ou de la pile-cuiée (y compris le poids des
terres).
On ne considére ici que le cas d'une semelle filante. De tou-
te facon, pour des raisons de stabilité 1a largeur de 1a semelle seva
dtau im
Qans cette détermination sont a considérer comme données
- la longueur L de 1a semelle, qui est 1iée a la superstructure
de l‘appui, laquelle dépend de 1a longueur de la ligne d'appui ;
- le niveau de la semelle, qui dépend des caractéristiques
géotechniques et mécaniques du sol de fondation.
En ce qui concerne la hauteur de 1a semelle h, celle-ci est
au moins égale a (B-b)/4, valeur permettant de considérer 1a semelle
comme rigide (repartition linéaire des deformations sur le sol) et d'em-
ployer 1a méthode des bielles pour calculer les ferraillages, avec une
valeur minimale de 0,60 m.
Lorsque la senelle de fondation comporte une nervure jouant un
rdle raidisseur pour l'appui {pile ou pile-culée), on se reportera 4 la
piéce 1.1.1 § 2.2.4.3 pour dimensionner cet élément raidisseur.
ACTIONS ET SOLLICITATIONS.
Elles sont explicitées ci-aprés.
ER (REACTION D'APPUI_ET_EFFORTS HORIZONTAUX)
leur évaluation se fera d'aprés les indications du chapitre 2
EVALUATION DES ACTIONS DUES AU TABLIER.
Son poids total comprend celui
se < de la partie enterrée { y compris
les terres supportées directement
par la semelle’ et celui de la par-
tie vue.
f A - Partie enterrée - Dans un
"Wivesu dea bUt_de simplification et compte
plate forme tenu des volumes respectifs de bé-
ton et de terre du prisme (B,D.L),
on peut lui attribuer un poids vo-
lumique moyen équivalent de y,.
’ Son poids total est donc :
Pps y XBxDeL
Avec 1a tonne et le matre comme
unités, on prendra ¥, = 2,2 t/m3.
® - Partie.
~ Son poids total P, sera @ alué d'aprés \'avant-
métré correspondant au modéle choisi (cf, pice 12.2)
Pe ona Py Py + Py
P BxOxl+
A= Lorsque 1a pile-culée est cons-
tituée par une semeite supportant des
colonnes ou des poteaux, ce qui est une
disposition trés courante, on aura une
bonne estimation de son poids total, y
compris Jes terres supportees directe~
ment par la semelle, en attribuant au
prisme (B,4,L) un poids volumique moyen
equivalent de ¥ cette derniare
valeur tenant conpte de ce que le volume
des terres portées y est prépondérant.
on aura donc Py =| yp x Bx Hx L
8 - Si la pile-culée est vonstituée
par une simple semelle ou un petit mas-
sif en téte de talus, son poids total
sera:
XB K Myx L
Avec 1a tonne et le métre- comme unites,
on prendra : ¥> = 2,1 t/m3
pF 2,5 t/m3
3.2. DETERMINATION DE LA LARGEUR UE _LA SEMELLE.
Dans le cas des fondations sur semelles superficielles, T'exa~
men des notes de calcul des appuis des ponts par Je programme PP 73 fait
apparaitre que 1a largeur de la Semelle est en général determinée par
la vérification au poingonnement parla semelle (cf. FOND piace 5.1) sous
la solicitation en service en charge : actions permanentes et charges
d'exploitationn:ximles avec freinage. I1 est rappelé que les charges
routiéres non exceptionnelles et celles du vent de courte durée sont
a pondérer par 1.2.
Soit : Q la résultante maximale des charges verticales
4 Ja pression admissibie du sol sous la semevie .
D'aprés Tes errements classiques cette pression est égale a qr/r
I= coefficient de sécurité pris en général égal a 3
ar = pression a rupture sous 1a fondation, calcutée suivant Jes
errements habituels (cf. FOND 72,chap. 5.2).
avec :
~ 24 -
3.2.1. CAS_D'UNE PILE INTERMEDIAIRE.
En ne tenant compte que des charges verticales (réaction du
tablier + poids propre de 1a pile), et en désignant par Bo la largeur
correspondante de la semelle, on aurait
Q=R + y Bo. D-L4Py=
Pour tenir compte de l'effet d'une force horizontale en téte
de la pile, on augmentera la valeur B, trouvée ci-dessus de 3 fois
Ttexcentrement de la résultante (application de la méthode de MEYERHOF,
cf. FOND 72, Fascicule 5, chap. 5.3 p. 6) et I'on obtient finalement :
|
La méthode de MEYERHOF (FOND ch. 5.3) conduit 4 ajouter 4 la
largeur de semelle, caTculée sous les seules charges verticales, une
largeur égale 4 2 fois ]'excentrement. La méthode qui consiste a prendre
comme contrainte de référence au poingonnement 1a contrainte calculée
aux 3/4 de 1a largeur comprimée revient a ajouter 2 fois l'excentrement
conme dans la méthode de MEYERHOF dans le cas od 1a charge est 3 I'ex-
térieur du tiers central,et entre 2 et 3 fois l'excentrement lorsque
Ja charge est 4 1'intérieur du tiers central et que le diagramme des
contraintes est trapézo‘dal
Le coefficient 3, égal a la borne supérieure des valeurs ci-
dessus, a ét6 choisi pour tenir compte de ce que Tes valeurs des efforts
horizontaux transmis par le tablier (cf. 1.2) sont des valeurs minimales
correspondant a des appuis ayant des rigidites tres voisines jet qu'il
y adans 1a réalité une certaine dispersion par rapport 4 ces valeurs.
3.2.2. CAS D'UNE PILE-CULEE NOYEE DANS LE SOL.
En procédant conme ci-dessus, on a :
Q=R ty Boe HL eG. BL
dod B= oe
(@- HDL
04 F
” aH 7 ‘ i‘
et 3, +324 T= (prise en compte d'une force horizontale)
B
By + 1,2
Nota - S'i] y a une dalle de transition, la force F est reprise directe-
ent par cette derniére et 1a largeur de Ia semelle sera 8, (dont la valeur
ne sera jamais inférieure a 1,50 m).
D'autre part le cas d'une pile-culée apparente n'est pas traite
ici. Se reporter piéce 1.3.2.§ 3.2.
4
1
~ 25 -
4. PREDIMENSIONNEMENT D'UNE FONDATION SUR PIEUX
OBJET - On veut déterminer_les caractéristiques d'un ensenible [ pieux -
semelle de liaison] ,susceptible de résister aux actions et
sollicitations qui lui sont imposées, a savoir
+ les actions dues au tablier (réaction d'appui et efforts
horizontaux);
~'ie poids propre de la pile ou de la pile-culée.
Seul le cas d'une semelle continue est envisagé, 4 l'exclusion
des massifs isolés sur 2,3,4 pieux.
Sont & considérer comme données :
= Ja Jongueur du massif constitué par 1'ensenb1e[pieux - semelle]
le type
le
{pieux battus ou pieux forés, etc.
es, généralement 2 pour Tes ouvrages courants
le ni liaison, qui sera fixé le plus
haut possible, compte tenu de ceTui du terrain naturel et de
Ja présence éventuelle d'eau.
ACTIONS ET SOLLICITATIONS.
Elles sont explicitées ci-aprés.
Leur évaluation se fera d'aprés les indications du chapitre 2:
EVALUATION DES ACTIONS DUES AU TABLIER.
4.1.2. POIDS DE_LA PILE OU_DE_LA PILE-CULEE.
11 est nécessaire de connaitre au préalable les dimensions de
Ja semelle de liaison, qui dépendent elies-mémes du systéme de pieux.
Ce poids sera donc évalué lorsque les dimensions de la semelle auront
été fixées, comme i] est indiqué ci-aprés.
KX 4
cas d'une pile Cas d'une . Si 8 est la largeur de
pile-culge \ i
\ la semelle supposée connve,
\ o one:
is
# Cos,
4 \
\ S \ Pay, xB xDal
TS 7 v |
| 2
z Cas dune pile-culee
Pe ¥)xBuHal
vec le tonne et le rétit
ale corre units :
Pee PA bine
Yo = @1 Ud
- 26 -
4.2. DETERMINATION DES ELEMENTS DE LA FONDATION.
Elle porte sur la section des pieux et Teur nombre total ; de
Ja section des pieux s@ déduit la largeur B et 1a hauteur de 1a semelle
de liaison. Ce qui suit concerne uniquement les systemes de pieux ver-
ticaux.
Pour cette détermination, on distinguera les actions et solli
citations dues aux charges verticales et celles dues aux efforts hor:
zontaux.
4.2.1. CHARGES VERTICALES.
Soit 9 la charge admissible d'un pieu et n leur nombre total
7 a= fy xBxDxL+P dans ie cas d'une piie
OvarmxQeR ry penx dans ie cas ‘une
Comme, d'une part, 1a charge admissible d'un pieu est proportion
nelle 4 sa section @ , on a toujours :
Q=2%x & (= contrainte moyenne de compression admissible
dans les pieux)
et que, d'autre part, on peut prendre B= (3N - 1)¢ , valeur conseillée
(i = nombre de files et o = dimension transversale d'un pieu), on a:
nxQxe=R +f Pet (3N-1) 6 x Dx bx yy
(3N-1) @ x HX Lx ry
Si l'on se fixe 1a section d'un pieu —, donc leur diamatre, le
nonibre te*al do pieux a pour expression aénirale :
r +P] +* QN- 1) 6 xD x Lay] dans Je
cas d'une pile
R + (3N-1)@xHXLxy, | dans Je
Tne 7 cas d'une pile-culée
me am}
Dans le cas des ouvrages courants, pour lesquels le nonbre de
files peut généralement étre fixé 4 2, et dans I'hypothese de pieux pieux
cylindriques en béton, les principaux paramétres prennent les valeurs sui-
vantes =
xo?
N=2 Qe aH
et les expressions précédentes deviennent :
1,273
6366
R+ Po) 4 = DL. ¥
tet eta gt 1
1,273 p 6,366
pen Ele o.8
HL. Y9
-o7-
Elles sont explicitées ci-aprés pour 3 valeurs courantesde g
3,54 4 10,61
384 (Ra ey) + EEL
ye Wel
2
yy Ob Voy.oy + 0,267 n - S'(R + Po) | dans te cas
Spe : SITae a a d'une pile
eV (rpiity? + 0.1257 nt R | dans Te cas d'un
ae __| pile-cutée
2.2. EFFORTS HORIZONTAUK.
Comme pour une fondation superficielle, ils sont pradutts par
une fraction de la force de freinage de 30 t d'un camion Bc, apptiquée
en téte de l'appui. On peut distinguer trois cas principaux :
Une force horizontate F appli-
quée en téte de T’appui crée au niveau
de la face inférieure de ta semelle
un moment M = K.F.H (cf. page 20)
La reprise de ta force F se fera
par butée sur Te terrain de l'ensemble
semelle ~ pieux et par Flexion dans
les pieux 3 quant & l'effet du moment
M, il se traduit par un couple qui,
dans le cas de deux files de pieux,
contribue 4 augmenter 1 réaction
d'une file et a ta réduire dans 1'au-
tre ; on a ators
Compte tenu du supplément d‘efforts auquel est soumise au moins
lune des files (les deux si la force F peut sexercer dans les deux sens),
on verifiera si le nombre ou le diamatre des pioux détermings 4 I'aide des
formules ci-dessus conviennent ou s'il y a lieu de les modifier.
weR
La résultante des forces verticales étant
- { ou 2,2 BAW.L
2,9 B.0.L + P.
2 } -
deux cas peuvent se présenter :
1) n->V: Te nombre et le diamétre des pieux peuvent convenir,
Sous réserve que ceux-ci puissent résister au supplément de contrainte do
au moment M.
2) n.Qsi z Je nombre ou te diamétre des pieux devra @tre auamenté,
les nouvelles valeurs 4 retenir étant obtenues par application des formules
précédentes .
Dans les deux cas, on déterminera les efforts dans les pieux &
Taide des formules figurant dans l'additif au dossier FOND 72.
Nota - Si la force F est susceptible de stexercer dans les deux Sens, Te
Systeme de pieux sera symétrique ; dans le cas contraire i] peut y avoir
intérét a répartir les pieux dans chaque file, de maniére que leur nombre
soit plus levé du cdté 00 s'exerce la force F.
C moyennenent inportante et_le
$0]_peu_réa
Des moments de flexion relativement importants risquent de se
produire dans les pieux si, comme dans Te cas précédent, ces derniers
sont préyus uniquement verticaux. Trois possibilités se présentent alors :
- leur diamétre restant Te méme, leur nombre sera auomentés
= Jeur nombre restant le néme leur diametre sera augmenté (a sec-
tion égale, leur aptitude a résister 4 des efforts de flexion
est meilleure ; en contre-partie, les dimensions de 1a semel-
le seront augnentées);
~ of conserve le diamétre initial, mais on inclinera certains
pieux (cf. 3eme cas ci-aprés).
pas_réacti
D On inclinera certains pieux,
de préférence dons Ja file située
du coté od s'exerce la force F.
Dons I'hypothase of les pieux
sont supposés articulés en téte et
en pied sans résistance Jatérale du
terrain, ce qui constitue une option
a considérer comme exceptionnelle, et
sin; est le nombre de pieux d'incli-
naison par rapport & la verticale, on,
aurait la relation :
-29
Conme, d'autre part, Iensemble des pieux inclings peut re-
prendre une charge verticale = F.cotg a, le nombre de pieux verticaux
serait alors
ny « Re fasotae
; a
et ie nombre total de pieux serait cu moins
®@, Fl - asa)
fl sina
Un calcul prenant en compte une réaction latérale du terrain conduit 4
des résultats qui peuvent étre trés différents.
4.2.3, DISPOSITION pes PIEUX.
On se référera a 1a pice 1.1.2 (Conception et choix des piles)
et 4 la pléce 1.2.3 (Nodeles de piles-culées).
30 -
5 -PREDIMENSIONNEMENT DES FUTS
OBJET - On veut déterminer 1'épaisseur a Ta base des voiles des piles,
ainsi que la dimension des poteaux ou colonnes des piles~culées,
sous 1'effet des actions et sollicitations qui leur sont imposées
(cf. chapitre 1)
5.1, PILES.
Lorsque la pile est constituée par un ou plusieurs voiles, leur
longueur est, le plus souvent, 1iée 4 ls géométrie du tablier et 4 la
répartition des appareils d'appui (cf. NOTICE GENERALE, piéces 1.1.1, p. 16 et
1.1.2 pl0);on peut alors la considérer comme une donnée. Le prédinension-
nement portera donc essentiellement sur 1'épaisseur a 12 base, 14 ou Tes
efforts sont les plus importants. Fee
Lorsqu'il s'agit d'ouvrages courants et si_le tirant d'air est
(
(} yoisin du_gabarit normal, 1'épaisseur standard de 0,50 0 suftit Te plus
(} souvent. Toutefois, cette derniére pourra se révéler insuffisante dans
(} Tes cas suivants :
(
0 = la hauteur de l'appui est importante ;
Q = Je nombre d'appuis internédiaires est réduit (cas des ouvrages
(2a deux travées) s
(Q) = 1a longueur des voites est faible (ouvrages a larges encor-
( bellements) .
a marche & suivre est alors Ia suivante
On vérifie rapidement 4 l'aide des abaques de flexion composee
du sous-dassier 4 si une épaisseur de 0,50 m suffit, compte tenu des sol-
licitations que T'on aura déterminées selon les indications du chap. 2
Si elle s'avere insuffisante, on l'augnentera de Ja quantité nécessaire;
dans cette recherche on s‘attachera 4 respecter un pourcentage raison-
nable d'armatures (1 % au maximum).
A titre de premiére approct2, la formule ci-apres donne ure
valeur de |'épaisseur qui est satisfaisante du point de vue de |'aspect
(cf. piece 1.1.2 page 40) et qui, généralement,est mécaniquement laraement
Suffisante quand Ta hauteur de )'appui est importante =
4Hvtt . 9 30 20,50 m
£ 20.4 40,5 by
hauteur vue de l*appui
portée droite
hauteur du tablier
Nota - Si Ta pile est constituée par des voiles trés courts ( ¢ 1,56 m)
ou des colonnes, i] y aura lieu de vérifier sa résistance vis-a-vis
d'un choc de véhicule lourd ; pour cela, on se reportera a la piéce
1.3.3,
3) -
5.2. PILES-CULEES.
Ges bases pour un prédimensionnement sont données dans la
NOTICE GENERALE (piéce 1.1.3, page 27) ; elles sont rappelées ici pour
ménoire :
Cas de colonnes Cas de poteaux
© 102
9 20,60 m aza.s0m bc = at
uf Hf
pot az % hauteur maximale de
i Velément cons idéré
On vérifie ensuite a I'aide des abaques de Flexion composée
que les dimensigns ainsi déterminées conviennart ; pour cela, et bien
que le taux de ferraillage réel soit prévu 4 2 2, cette verification
se fera en considérant les sollicitations de service et un ferraillage
fictif plus faible (1 # par exemple), Ja difference servant a résister
2 d'éventuels efforts supplémentaires dus au remblaiement et aux poussées
des terres sur les colonnes.
En ce qui_concerne Tes poteaux des piles-culées apparentes, on
se reportera a la piéce 1.3.2 § 3.2 qui trafte plus particuliérement du
prédimensionnement de la largeur des seneties et de ia section a la base
des poteaux.
6 — PREDIMENSIONNEMENT OFS APPAREMS D'APPUL
OBJET - Dans un calcul d'apnuis,notamment pour te vemplissage du torde-
reau des données du progranme PP 73, il est nécessaire de connaitre au
préalable les caractéristiques des appareils d'appui utilisés. Dans
ce but, on donne ci-aprés des indications pour déterminer les caractéristiques
de base des appareils d'apnui du type "élastomére fretté", A T'exclu-
sion des sections rétrécies de beton, plus simples & diwensionner et
pour Tesquetles on trouvera des indications dans le dossier JADE 68.
DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DES APPAREILS D* APPUT.
Ltappareil d*appui est défini par ses
mensions en plan, ainsi
que par l'épaisseur et le nonbre des Feuillets
mentaires..
6.1, DIMENSIONS EN PLAN.
On calcule 1a surface minimele en admettant un taux de travail
de 1'élastomére fretté de 150 bars pour les piles intermédiatres et de
125 bars pour les piles-culées.
Cette surface minimale est traduite sous forme d'une dimension
en plan DAP x LAP a intraduire dans es bordereaux des données (LAP dé-
Signe la longueur du grand cété, parallele 4 la ligne d'appui). On s'at-
tachera 4 choisir pour Tes dimensions DAP et LAP des sous-multiples des
dimensions des plaques méres dont disposent les fabricants (900 x 1000
et 700 x 1400) (cf. JADE piéce 3.1 et Bulletin Technique n° 4 de a DOA.A)
sur les appareils d'appui en élastonére fretté), On natera que le coef-
Ficient de forme « HAF est niaximal pour un ouvrage droit et tend vers 1
(carré) lorsque Mouvrage est tras biais.
Le calcul de la surface minimate ainsi définie implique da
connaissance de la valeur de la réaction d'appui maximale correspondante,
dont ja détermination sera effectuee en pondérant les charges routiéres
civiles nan exceptionneltes et en appliquant aux différentes charges, y
compris Ta charge permanente, un coefficient de majoration pour tenir
compte de 1'inégalite de réactions d'appui entre les différents appareils
d'une mame Vigne.
Si l'on utilise les résultats fournis par une note de calcul autowa-
tique de tablier du type PS1.DA ou PS1.DP, on retiendra que ces notes fournis-
sent,ligne d'appui par ligne d'appui, la réaction d‘appui maximale pour un ap=
pareil d'appui . Cette réaction est calculée en appliquant aux reactions tota~
jes par ligne d'appui, réparties également entre les différents appareils
d'appui, des coefficients de majoration pour inégalité de répartition et des
coefficients de pondération.
-33-
En l'absence de note de carcu?, on pourra évaluer Ja réaction
dappui totale 2 Vaide des abaques du chapitre 1 et l'on appliquera les
coefficients de majaration correspondants, évalués par exces, en s'ins-
pirant des indications données a la piéce 2.5 § 4.4 du dossier PSI.OP 69.
Si les appareils d'appui ne sont pas réguliérement espacés, une
correction est a faire sur les résultats obtenus comme il est dit ci~
dessus et l'on pourra s'inspirer pour cela des indications données a Ja
piece 2.1 § 8.4 du dossier PSI.OP 69 (et § 12 de Ja piace 2.1 du dossier
PSI.DP 73 3 paraitre).
6.2. EPAISSEUR ET NOMBRE DES FEUILLETS ELEMENTAIRES.
Dans le cas des ponts courants, pour Tesquels les réactions d’ap~
pui restent modérées et les rotations du tablier fatbles, des feuiftets elémen-
taires de 8 4 12 mm conviennent en général et }'on choisira une hauteur tota-
te a’étastomere supérieure oy égale a environ 1,5 fois le déplacement absolu
du tablier sous les efforts de raccourcissement élastique, retrait, fluage et
dilatation thermique, qu'on peut évaluer 4 partir du raccourcissement unitaire
cirapres :
4.10" pour Tes ponts en béton armé
7.1074 pour tes ponts en b&ton précontraint.
= 34 -
7. COUTS ET QUANTITES
ESTIMATION
7.1. QBSET ET DOMAINE O' APPLICATION.
Le présent chapitre a pour objet de permettre une évaluation sim~
plifiée des coats, éventuellenent des quantités, relatifs aux différents
appuis (piles et piles~culées). Cette avaluation se fera directement a
Taide d'abaques ou de formsles approchées lorsque les appuis sont de T*un
tes types standard de référence définis ci-aprés :
~ pour les piles : modélede base 1A du catalogue de formes des vailes
Elenentaires (voites rectangulaires de sections constante) (cf. piéci
1.2.2, page 3) +
> pour Tes piles-culées.: modéle du type courant
~ comportant des colonnes (exemple s let 2) et modele du
type a semelle en téte de talus (exemple 4) (cf. p‘*ce 1.2.3 Exemples
Dans tous Tes cas, on se place dans I'hypothése d'une fondation
Je Filante superficielle. (1)
Les schémas ci-dessous définissent les caractéristiques et pa-
ramatres essentiels des modéles de référence, dans le cas d'une pile et
dans celui d'une pile-culée de type courant. Ces modéles correspondent
i‘ 4 tablier de 10 m de largeur utile, droit, ou peu biais, dégageant un tirant d*
ie Bm
PRE CULEE
PILE
380
_
L———a00 — sent
by = hs 2 0,25.8- 0.15, yey 0.25 80,005
Si ltappui différe sensiblement de ‘un des modeles standard
définis ci-dessus , on procédera comme i] est indiqué plus loin, page 37.
(1! Dans le cas d'une fondation sur pieux, on serait anené & faire une éva-
luation distincte :
- soit de la fondation dans le cas d'une pile (1a partic we restant la
méme) ou d'une pile-culée de type courant (exempleS 7 et 2) ;
= soit de T'ensemble dans le cas d'une pile-culée d'un autre type.
-35-
7.2. COUTS.
Les colits sont stablis avec 1a mame base de_prix uniteires que
Je_document-type EST 67 ; 11 conviendra de les rattacher aux conditions
Economiques locales @t du moment en utilisant te coefficient d'actualisa~
tion 1/1, defini p. 2 du document EST 67-
7.2.2. COUT! ALLA LONGUEUR DE LA SEVELLE..
Gans te cas d'appuis de ?'un des types standard définis ci-
dessus, 11 apparait que les coats sont sensibiement proportionnels a 1a
Tongueur de l'appui 3 iI en résuite que chaque appui peut &tre caracté-
risé par un colt de référence rapporté a 1m de longueur de semelle.
Les cofts de référence sont donnés ci-aprés sous forme d' aba-
ques et de formules approchées, pour un appui-
PORT,
Abaques - 11s comportent :
a - Pour les
~ 3 courbes correspondant chacune a une valeur fixe de D, qui
est la profondeur de 1a fondation par rapport au niveau du
terrain ; chaque courbe représente le cot de référence total
Po, le paramétre d'entrée étant 1a largeur B de le semelte
Compte tenu de I'allure générale des courbes théoriques dans
le domaine envisagé et du degré de précision recherché, ces
dernigres ont été remplacées per des segments de droite pré-
sentant un point singulier 4 T‘abscisse & = 3,0 m
Les valeurs retenues pour D sont 2,0 m 3,0 met 4,0 m.
~ L'indication des colts de référence partiels, a savoir :
+ celui de Ta partie vue sur 5 m de hauteur : pow S40 F/ml
: celui de Ja partie enterrée (base des yoiles et nervure),
a exclusion de la semelle : po = 95.0 - 10 F/ml.
Ces cofits partiels sont indépendants de la largeur de la se-
metie.
b - Pour les piles-culées :
- 2 courbes relatives a une pile-culée de type courant, corres-
pondant chacune a une valeur fixe de D, quia Ya méme signi-
fication que ci-cessus ; chaque courbe représente Te colt de
référence tota) Po. Les valeurs retenues pour D sont 1,5 m
et 3,0 m.
- 1 courbe relative a une pile-culée en téte de talus ; elle
représente le colt de ]a seule partie en béton, a l'exclusion
du remblai spécial. Hee
Comme pour les piles, les courbes théoriques ont été rempla-
cées par des segments de droites présentant, pour les déux
premigres, un point singulier a l'abscisse B = 3,10 m.
- L'indication du colt de référence du fat seul d'une pile-culé
de type courant (constituée par 3 colonnes 8 0,60 m) sur une
hauteur gale 2 5m, soit 280 F/ml.
Colones
{280F pour(Hy 5m)
ie
ye
%
partic wue at partie sntersée au-dessus de lt semeile’
HL %
Heats totaux
BS
joo enh Cate oacties(
i
7.2.2 > COUTS RAPPORTES AU vOLUN
A ~ Cas_d'une pile.
Si 1'on prend pour base d'estimation le yolume total de héton
(partie yue + partie enterrée) par métre de longueur de semelte, la for~
mule approchée ci-aprés donne te codt unitaire P., du m3 de béton de pile :
» = 350 [1 + 0,05 (p ~ Bj}] F/m3 de beton
On peut également estimer Je codt d'une pile en considérant que
les colits conposés du m3 de béton , c'est-a-dire y compris coffrage et.
armatures, sont de !
= 300 F/m3 pour 1a semelle et la nervure (y compris les fouilles
pour une profondeur D égale @ 2m),
- 375 F/m3 pour Jes fits (les coffrages interviennent pratiquement
pour moitié dans ce coat)
On notera que dans Je cas de la pile standard de référence,le
cout de la partie vue est compris entre le tiers et 1a moitié du cout to~
tal de |‘appui.sauf si Ta semelle de fondation est 4 a fois large et firo~
fonde.
type coi
En prenant pour base d'estimation le volume total de béton par
metre de longueur de semelle le colt unitaire du m3 de béton a pour valeur
approchée :
Poy = 440 [1+ 0,05 (0 = Bi}{ e/m3 de s8ton
Le cofit de 1a partie intermédiaire de 1a pile-culée, pour une
hauteur Hf = 5 m,est de 280 F/m rapporté @ la Tongueur de Ta-semelle ou
de 660 F/m3 rapporté au volume da baton.
82 ~ Cas_d'une_pill
Sur Jes mémes bases que ci-dessus, le colt unitaire du m3 de béton
@ pour valeur approchée :
375 (1 ~ 0,10 B) F/m3 de béton
Ce colt ne comprend pas Te remblai spécta?.
Nota - Dans le cas des piles-culées, les coiits indiqués ne tiennent pas
compte des parties Tatérates éventuelles (murettes ou petits murs en re-
tour) ; on devra donc les ajouter. A titre indicatif, le colt global de
deux petits murs en retour de 1.50 mde longueur dont le modéle est de-
fini dans Ta piéce 1.2.3 (p. 37) est de 600 F environ.
7.2.3. EXTENSION A_UN APPUI_ DIFFERENT DES MODELES
REFERENCE
Pour estimer une pile dont 1a partie vue est différente du modéle
standard de référence,on utilisera les coats rapportés au métre linéaire
7.3
- 38 -
de semelle ou au volume de béton qui ont été établis aux § précédents
ainsi que le montrent les exemples suivants :
Exeepl€ 1 - Liappui considéré ne diffare de l'appui standard de référence
que par 1a hauteur vue Hiv.
On estimera son colt au matre linéaire de longueur a l'aide de
Iabaque de la page 36 en fonction de ta largeur B de la semelle et de la
profondeur D, avec uné majoration de 110 F par métre de hauteur supplémentaire
par rapport 4 1a hauteur standard.
mpl€ 2 - L'appui considéré ne differe de T'appui standard de référence
par le rapport entre Ta longueur des voiles et la largeur biaise d'in-
trados ou plus généralement par le rapport de la surface totale des voiles
a la surface de T'enveloppe de I'appui (définie piéce 1.1.2 p.1)
Dans le cas de 'appui standard retenu ce rapport est de 0,52 5
lorsque ce rapport est différent i] est facile d'obtenir par simple pro-
portion le colit correspondant de ja partie vue.
Par exemple,soit un voile unique
de largeur variabie det en tate 3 0,61
& Ja base. Le rapport de Ta surface du
voile 4 1a surface de l'enveloppe est de
0,8 et Te colt d'un tel appui peut étre
estimé au métre linéaire a l'aide de
T*abaque de la page 36,que I'on majorera
de 300 F/ml (= 540 x 98-0252
3- Ltappui différe sur plusieurs points de l'appui standard de
nce hauteur, proportion entre Yes surfaces de voiles, complexité
de forme et de coffrage.
On utilisera dans ce cas les colts unitaires de 300 F/m3 pour le
béton des parties enterrées, semelie et nervures,et de 375 F/m3 pour les
fats au dessus de la nervure.
Le coat du m3 de béton de fOt est a majorer en cas de complexité
de forme telle que la multiplication des plans, en cas d'exigences esthé~
tiques nécessitant l'emploi de coffrages spéciaux ; i] est a minorer lors-
que l'épaisseur des appuis est supérieure 3 0,5 m (par exemple,on pourra
retenir 320 F/m3 pour un voile de 0,8 m d'épaisseur).
Pour apprécier la correction 4 apporter au colt du béton de fat,
rappelons que les coffrages interviennent pour moitié dans Te coit de
376 F/m3 relatif & un voile de 0,5 m d'épaisseur.
UANTITES
7.4.1, QUANTIT
Dans le méme esprit que pour les colts, on peut définir des quan-
tités rapportées a 1 m de lonqueur de semelle, ces quantités étant fournies
pour Tes principaux postes relatifs aux appuis ; elles sont obtenues a par-
tir des formules générales d'avant-métré connées en annexe.
-39-
les résultats sont traduits en abaques, les modes d'évaluation
tant ceux définis au C.P.S. type de 1969.
Ces quantités ont permis d'établir les prix composés du § 7.2
précédent ay moyen du bordereau de prix unitaires suivant (niveau de prix
du document EST 67) :
Prix n° 2 - FouiTtes pour fondations 10,8 F/m3
"2 ~ Remblaiement des fouitles 5,4 F/m3
"3+ Béton de propreté 1147 F/n3
“4 = Béton pour semelle et nervure 326 F/m3
"5 = Béton pour fats 135 F/m3
“6 ~ Beton pour chev8tre et garde-grave 235 F/n3
“7 = Coffrages ordinaires 27 Fmd
"8 + Coffrages soignés 35. F/m2
9- Aciers H.A 1,71 F/kg
"10 - Drainage de la face supérieure pour mémoire
Pour l'utilisation des abaques, le paramétre d'entrée est la
largeur B de 1a semelie.
ES DE_REFERI
7.3.2 ~ EXTENS
~ Si T’appui considéré est notablement different de l'un des types
de référence définis au § 7.1, on procédera de 1a maniére suivante :
‘une pile - Pour un ouvrage donné, 1a partie enterrée est
pratiquement toujolirs la méme ; seule la partie vue peut étre différente
de celle du mod3le standard de référence : i) suffit donc d'évaluer tes
quantités correspondant & cette derniare A l'aide des résultats d'avant-
nétré (béton et coffrage) fournis pour chacun des modéles décrits au
catalogue.
ulge_~ On sera amené a faire le plus souvent
&tre limité aux volumes de béton.
On peut utiliser en partie les résultats donnés pour une fonda-
tion superficielle, notamment dans Ye cas des piles pour lesqueTles la
partie vue reste 1a méme ; seule la fondation est différente et l'on fera
une estimation séparée pour la semelle et pour les pieux,
je : Ses dimensions sont Fixées 8 partir des caractéristiques
des pieux (diamétre et nonbre de files) + on peut donc
en faire un avant-métré.
On se reportera aux indications données dans te dossier
FOND 72 (cf. Fascicule 4 ch. 4 § 2.3).
ABAQUES.
—
ion
rouuses
«
SRA LA tie
“[~ Mota - Pour des valeurs de D intermédiatres, on interpolera linéaire-
ib
ment pour obtenir les différentes quantités, 4 1'exception des
t
guantites® , © et © dont res valeurs sont indspendantes de 0.
a
remy
Nota - Pour des valeurs de D intermédiaires, on interpolera linéairement
our obtenir les différentes quantités, 4 l'exception des quanti
@ et ® dont les valeurs sont indépendantes de D.
Quantites_moyennes relatives au fit (pour 3 colonnes espacées
de 3,50 m, 60 et Hy = 5m), rapportees & Tm de longueur de semelle =
- Yolume béton 42 a3
v
= Coffrage —S = 2580 m2
- Amatures P= 84 kg
PILE-CULEE EN TETE DE TALUS - Béton de propreté 1,6 m2
= BEton pour sommier 2,0 m3
~ Coffrage 4.4 m2
[exemple n° 4 des MODELES) - Armatures 140 kg
(!
abate
7.3.3.
TES.
9
7.3.3.1 - Les paramétres - ITs sont définis aux schémas ci-
dessous, dans le cas d'une pile ; on s'est placé dans I'hypothése of Ja
Tongueur de la nervure est égale 4 celle de la semelle.
longer ty poramant
dommle con
Hy (hover wer
ne cle)
=
Dans le cas d'une pile-culée avec colonnes, le sch3ma général est ana
logue, mais L, et E sont @ remplacer par ¢
7.3.3.2 - Expressions générales des quantités pour une pile.
Elles correspondent au cas od il y a une nervure (cas le plus
fréquent).
on Vy = (B+ 1) (Ls + 10
s - La hauteur de renblatement D,
dépend du niveau de la plate-forme inférieure par rapport @ celui du
terrain 3 elle est au plus égale 4 la profondeur de la fouille O.
Les schémas ci-dessous montrent deux cas de remblaiement.
1P'eas + Plate-forme au-dessus du terrain 227 cas: Plate-torme au-dessous du terrain
+s
| forrest
0,<0
Houtur 8 rember >
- Dyed
ky [e (hg + 0,10) + or, | ~ mle. ¢
- propreté : Sz = (B + 0,10)(L, + 0,10)
- 45 -
4 ~ Beton pour semelle et nervure : Vy = (Bho + B.h,) by
Vg 2 mely.£ (Hy +c)
Stre - pour mémoire.
IIs sont arrétés 4 0,10 m au-dessous du niveau de Ta plate-forme
S722 [egs9mngrtt 00%, + nit #€)(6-0,10)]
8 - Coffrages_soignés - Sg = 2n (L, +E){H + 0,10)
9 - Acier HA. _p S:
~ SemelTe et nervure : $0 kg/m3
- Fats + 40 ko/m3
jeure - Evaluation forfaitaire.
10 = Drainage de la fac
pe!
Nota ~ S'i] n'y a pas de nervure 41 suffit, dans les formules ci-dessus,
de fairer, = 0
Expressions générales des quantités pour une pile
7.3.3.3 7
mur, garde-gri
B+ I(l, +10
Vyrby [s0h,90.10)00.5,
{B + 0,10)(L, + 0,10)
4 BSton pour semgtie et nervure
(B+ ot BARS
ajouter éventuellement les
murettes latérales(ou Tes murs
en retour’ ¢: 12 corbeau d' ap-
pui de la Ve de transition.
= 46 -
age
$, 22 [tvcstangrtt oh] tnx treefped[orea)] +2(ah teg)
Ajouter éventue\lement les murettes
lalerales (ou les murs en retour}
et le corbeau d'appui de la dalle de
transition.
8 - Coffrages. soignés.
Seulement dans le cas de petits murs en retour et dans celui de
piles-culées apparentes; 4 évaluer dans chaque cas.
5 ~ Aciers_H.A._pour_armatures.
~ Semelie.et nervure : 70 kg/m3
- Chevétre :110 kg/m3
= Colonnes 3200 kg/m3
10 - Drainage _du_chevéts
¢ ~ Evaluation forfaitaire.
Nota - S'il n'y a pas de mur garde-gréve il suffit, dans les formules
6 et 7 ci-dessus, de faire g = 0 et a = $+ 0,10.
Les paramétres sont définis au schéma ci-contre.
nS - pour mémoire.
pour mémoire.
{8#0,10)(L, + 0,10)
4 ~ Beton pour sonmier et garde-gréve : Vax (BH + eg) Ly
ajouter éventuellement les murettes latérales
et le corbeau d'appui de la dalle de transition
5 - Béton pour fats - pour mémoire.
6 - - pour mémoire.
: =2 fh H+g)+(B.H
T= C pes 1S = 2] L,(H4g)4(8.H +e.)
ajouter éventuel lenent_ les murettes latérales gt
le corbeau d'appui de la dalle de transitign.
B- ignés-
Cf. le cas d'une pile-culée a colgnnes.
HAL pour arma
= 70 kg/m3.
10 - Drainage - Evaluation forfaitaire.
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- L' Ingénieur et le développement durableFrom EverandL' Ingénieur et le développement durableRating: 2 out of 5 stars2/5 (1)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5811)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- ABC Letter Tracing for Preschoolers: French Handwriting Practice Workbook for KidsFrom EverandABC Letter Tracing for Preschoolers: French Handwriting Practice Workbook for KidsNo ratings yet
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Anaïs Nin's Paris Revisited: The English-French Bilingual EditionFrom EverandAnaïs Nin's Paris Revisited: The English-French Bilingual EditionNo ratings yet
- Francophonie et langue française en Amérique du Sud: Problématiques de recherche et d'enseignementFrom EverandFrancophonie et langue française en Amérique du Sud: Problématiques de recherche et d'enseignementNo ratings yet
- Des risques, des mines et des hommes: La perception du risque chez les mineurs de fond de l'Abitibi-TémiscamingueFrom EverandDes risques, des mines et des hommes: La perception du risque chez les mineurs de fond de l'Abitibi-TémiscamingueNo ratings yet
- Les Transferts massifs d'eau: Outils de développement ou instruments de pouvoir ?From EverandLes Transferts massifs d'eau: Outils de développement ou instruments de pouvoir ?No ratings yet
- Usages et appropriation des technologies �ducatives en Afrique: quelques pistes de r�flexionFrom EverandUsages et appropriation des technologies �ducatives en Afrique: quelques pistes de r�flexionNo ratings yet