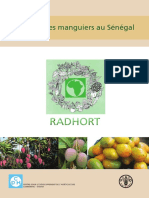Professional Documents
Culture Documents
Sc. Nat MORERE 2nd PDF
Sc. Nat MORERE 2nd PDF
Uploaded by
samba0 ratings0% found this document useful (0 votes)
16 views215 pagesOriginal Title
Sc. Nat MORERE 2nd.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
16 views215 pagesSc. Nat MORERE 2nd PDF
Sc. Nat MORERE 2nd PDF
Uploaded by
sambaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 215
INTRODUCTION
Observation préliminaire
d’un site
Protection de la nature, environnement
sont des formules et des mots du
langage courant. Actuellement, Homme
Slapergoit de plus en plus quil fait partie
d'un monde fragile, complexe, quiil lui
convient de protéger sil veut lui-méme
assurer sa survie. Gest, pourquoi
Yétude des étres vivants dans leurs
milieux, Vétude de leurs interrelations,
sans oublier action de Homme,
LA BOUCLE
DE MOISSON
apparaissent. comme une nécessité
Cest-un travail difficile et la simplicité
dun beau paysage n’est souvent
qapparente. Un exemple va nous lo
faire comprendre.
Choisissons un site de I'le-de-France, oi
les méandres de la Seine constituent des
aysages tres attractifs : la boucle de
‘Moisson. Elle se situe & 50 km de Paris,
entre Mantes-la-Jolie et Vernon.
Introduction. La boucle de Moisscr [iil
La Sene is de a Roche. Goyer. © Cotens ena @ Rie 6
de Seine @ five gauche oe Sane
2 Staton dis boul de tiseon
les figures 1 et 2 représentent une we générale
uel sone es ments les pls caractéristiques
1s dei Sei averse un miu bose
ent Téiément le plus fappant est Toppenton
fntve les deux reds: un coteau abrupt BOO),
‘aux affleurements calcaires. occupe la rive droite
la rive gauche, formée par des depots alluvions,
est plane ot accupée par la forét de Moisson,
Ge site tire également son originalité de la luxu-
lance de sa flore et de sa faune, réparties dans
des espaces extrémoment différents. détallés
dans la figure 3.
1a rive droite est occupée :
it le bois de Villers © essentiellement cons-
titué de Chenes,
— par des pelouses en contrebas @), peuplées de
plantes et d'Insectes méditerranéens, a
~ ar un bois de Ghénes ©, le long de la Seine
bortge de Saules et dauines,
Sar la ive gauche, la forge de Moisson © pri
Sente Tuniguo station du Chéne tauzn [gue 1)
en Tle de France = est un Chéne habitueloment
Tepart! sur ia ebue sud-atlantque euen Espapne
Hct al ie domine oer cup arn bs
ae Hits Peupe e nombrewses plates mona
Elin lo mardeage dela val6e de FEpte © et un
Introduction. La boucle de Moisson
4 Le chéne aun on haute sa fei fau-dessous)
plan d'eau artificiel, le lac de Lavacourt ©, atti
Font los visitours par la variéte des Oiseaux
migrateurs (figure 6) qui y nichent 'hiver.
Quels sont les éléments les plus étonnants de ce
site?
A travers la présentation sommaire de
ce site, nous voyons apparaitre les
estions essentielles que nous
développerons dans cet ouvrage.
Pourquoi un végétal, un animal sont-ils
|B Une ponte monteanarde I Hepatique tebe
6 Un Oiseay av ie de Lavaeourt Le Hare biewe
‘Les deux coteaux présentent des caractéres tota-
Jement opposés. En quelques kilometres, une
vegetation méditerranéenne cede la place a de
sombres fordts montagnardes |
Ee cifne taurn arsine limite nord do
artition. On ne le retrouvera en France quau
sud de la Loire. y
présents dans tel ou tel site 2
‘Les étres vivants impliqués ont-ils des
relations entre eux ?
Dans quelle mesure I'Homme peut-il
bouleverser ou rétablir ces relations ?
tude ei Precnieaetl
de deux”
B
animal et végétal
milieux
Parmi les étres vivants qui nous
entourent, les plus visibles, car les plus
grands, sont les arbres. Couvrant jadis
la majeure partie du sol européen, ils ne
sont plus maintenant localises que dans
de vastes ensembles : les foréts.
Les foréts de Chénes, de Hétres,
uk de Cos
ms
es
10%.
de Pins ou de Sapins couvrent
actuellement des superficies
‘res variables dans les divers pa
européens. La figure ci-dessous illustre
Je pourcentage de surface boisée par
rapport a la superficie du territoire du
pays ; ce pourcentage varie de 32 a 5 %
ce bose des pys européens A
Pertinent pee sei stale
retore
ax|os}ss
W
‘Surlacebowséeen France au cours des sétos.
Inportee cu tosement
dans ls dpartements 10%
a
ine
BD wins
0 tite
© crite or
® sasio
® in
F Finsyvesue
© crenotege
Face
© Pomertine
roe de Bein
Fors
Prod Rng yin 4
a Foret de Gérardmer
fort
Be Hsien
La surface boisée de la France a considérable-
‘ment diminué au cours des deux derniers millé-
naires. Une amélioration de la situation sobserve
4 partir du xixe siécle (gure 1). La Forel couvre
actuellement quelque 185 millions. hectares
auxquels, s‘ajoutent un million de bosquets et
arbres épars (figures 2 et 3),
12
a
‘Sivtion des pus bees ets. de Fance
Quolles remarques vous sugsére Texamen des
deux carts eaves la free range?
a
6 care oeoicique sini 1/50000,
A — LOCALISATION
DU SECTEUR ETUDIE
Parmi toutes les possibilités de choix qui sfffrent
au naturalist, la Toret de Retz est Tune de celles
aqui sont interessant
Lobservation des pis 9 et 19 de la carte Michelin
1° 56 (figure 4), montre que cette forét est situee
ane ‘de la Picardie, dans Te déparement de
a earned cma era
Secteur choi, situons-le précisément, sur los
Ghgure oy ares que sur la nro pluviotheraigue
{igure Mot la carte des sols igure
B Locaisaton rangle aune) dy secteur én sur ca
tapegraphique au 1/25000
8 Coe des sos 1/1200) (Vale capi «Les facteurs
Gaaphiqves
Qu’en déduisons-nous ?
Ce sectour a une surface denviron 2 000m il
fest essentiellement constitué-d'un sol sableux,
bbrun lessivé, recevant en moyenne 600 &
700 mm d'éau, par an; sa
moyenne est de 10°.
Méthode d’étude d'une forét
State arbustive
State herbacée
Strate eryptogamig
B — ASPECT GENERAL
DE LA FORET
Regardons la photo de la figure 9.
Qu‘observe-t-on ?
Les végétaux, arbres, arbustes et herbes, qui ont
des tailles et sans doute des ages différents, for
ment des tages ou strates,
Ces derniéres sont définies dans le Livret pra
tique. La figure 10 permet de les schématiser.
C — INVENTAIRE DE LA FLORE
Laspect de la forét varie au cours des saisons
(igure 11), Aprés avoir fait Tinventaire floristique
lune station, chaque espice est affectée de ditt
ents coefficients (voir Livret pratique) et an cal-
tale le coefficient de dominance relative. Ce der
nier Sobtient de la facon suivante :
Dominance relativ
Nombre dindividus d'une espéco
‘Nombre total dindividus par strate
100
Il Méthode d'etude d'une forat
te
Chine sessile
State
asbustive
Ponce
Swate
Aspanle
tere
(are des ois
Magus
Ls forét au printemps
11 tes wigs de fort a cour lessons
Il. Méthode d'étude d'une {016
12 soventaie torstaue desi stations,
Pour la forét de Retz, on a pu établir ainsi le
tableau ci-dessus pour six stations (figure 12)
Que nous apprend Ie tableau 12?
sont deux espéces dominantes qui caractarisont
fe type de fore: hétrale-chénale.
~ La strate arborescente recouvre les espéces
des strates inféricures. On y distingue des espé-
cos dives, uy sont Loans
associées au Hétre. Ce sant : la Veronique, TAspé-
Tulle Lamic. Le autre, ou espeees compa.
nes, tees que la Ronce, le Muguet, la Jacinthe,
euvent vivre dans autres ensembles vogetaux.
— EE FoRTE
Espéces dominantes, et com-
Pepiee formant oo. enero vet on
‘groupement végétal.
Que peutcon dire quant a la répartiton des végé-
taux
Te Hétre et la Ronce ont le méme coefficient
dabondance-dominance (6), mais un coefficient
de sociabilité trés différent (5 pour la Ronce, 1
pour le Hétre). Ceci est dit au mode de reproduc-
tion de ces plantes. Tous les pieds de Ronce déri-
vent dun pled initial ct sont tous groupes, Ils
occupent le terrain, ot ne laissent pas de piace
‘aux autres plantes pour pousser. Les Hétres, au
contraire, sont des individus dispersés.
— Ee Forte
es
eee
Le
Que penser du relové de la station 1 6?
On y/trouve deux espéces nouvelles le Fréne et le
Carex, Elles ne font pas partie du coriege florist.
edo te teaechénaie. Leu présence.
ique love a 646 fait en bordure
forte fisiére, ‘ob Yensoleillement est plus
important.
—— DEE FORTE
D> Le groupement végétal est ié aux facteurs du
Il Méthode d’étude d'une forét
my
Oe
4
&
ef
18. Empreineslassées por quelques animaux dans esl
‘ume ou ere
D — INVENTAIRE DE LA FAUNE
Les animaux se déplagant, il est trés difficile,
pour un non-spécialiste, de faire un relevé aussi
précis que pour les véegétaux. Aussi doit-on se
contenter de noter les espéces dune facon plus
lobale, en. suivant les conseils donnés dans le
Livret pratique.
(On peut avoir des indications sur la faune gréce :
‘© aux empreintes que les animaux laissent sur le
sol (figure 13),
© aux déchets de nourriture abandonnés. Pre-
ons Texemple des graines contenuos dans les
cones de résineux dont certains animaux sont
friands. Les oines sont décortiqués de différentes
manidres (figure 14).
LBoureull commence par attaquer le cOne & la
Base en arrachant les calles, puis il mange les
Gcailles dures insérées en spirale en tournant le
fruit. Le travail est grossier et les écailles du haut
forment un plumet car Yanimal a du mal a les
deétacher.
17
14. cims tae pr des Hac
{Le Mulotépluche les cines en les rongeant, doa
Ana oes ie ular, Soxwent
terrane atta ue a sett
Pour allows espa
giaines, le Bec croisé introduit
son bec sous une Gcaille quill souléve en tournant
Sa téte, Il saisit sa nourriture et se retire, ce qui
déchire souvent lécaille dans le sens de la lon-
gueur.
Le Pic épeiche, quant a lui, cogne sur Ie fruit et
dechiquette les écailles pour saisir les graines
frie a sa langue visqueuse.
1 Sore 14 présente un certain nombre de cfines
decors Bais le tere et les oles dea
figure IS, recherche quel est Tanimal qui a
mange chaque eine.
II. Méthode d'étuy
‘ps ypocrapte:
‘crate
1B Les animaux de afore,
les strates végétales sont richement.peuplées
(gure 15).
Dans la fort, animaux ot végétaux sont étroite
iment assocés, Nous decir ic) quelques
exemples
=e Sanglierfouille le sol de la chénaie pour se
nourrir de larves d'insectes et de bulbes i Téa.
Marte
lise ainsi un brassage de !humus favorable a la
germination des glands et a la régénération de la
foret. Avec le Blaireau, grand consommaveur de
larves d'insectes, il freine et régularise le déve-
Tappement dex populations was
ductive pour les’ générations futures. Afln
surer “une ‘cereaine permanence dela
fortt, i travaile par parca
Ill. D'autres foréts franG@iS@S sass
A — UNE FORET
DES HAUTES-VOSGES
est. une forét altitude 700-850 métres, située
sur les flancs du Ballon d’Alsace (figure 22). Le
Sous-sol est uniformément granitique. Les princi.
ales espaces végétales sont rassembiées dans le
tableau 23.
B — LA FORET LANDAISE
La forét landaise (figure 24) est une plantation de
YHomme exploitée pour le bois et la résine. Jus-
gqu’au xix* sidcle, cette région était couverte de
andes et de marécages. Aprés des travaux das.
sainissement et de drainage, on entreprit la plan-
tation de résineux (gure 25). En 1940, la forét
recouvrait 900 000 hectares.
23
Li Dates [or¢:s fen¢ises
26. ine forét de sinew dans les Apes
De 1943 & 1949, elle a subi de. graves incendies
(430 000 hectares ont été détruits). Mais un gros
effort de reboisement a été entrepris et une pro:
tection efficace contre les incendies a été mise en
place. TI faut signaler qu‘actuellement, certaines
ppinedes sont arrachées au profit de la culture du
Mais.
C — UNE FORET MONTAGNARDE
Prenons Texemple dune forét des Alpes du Dau-
phiné a 1700 m daltitude, exposition Nord-
Ouest (figure 26), Dans ce cas, une seule espace
occupe la strate arborescente. La strate herbacte
est, en tavanche, riche de nombreuses especes
(gure 27).
24
iq doo fort landsise
D — UNE FORET DU MASSIF
DES MAURES
Cest une forét située a 400 metres daltitude
(figure 29), essentiellement caractérisée par la
rareté darbres résineux (Higure 28)
Ces quatre exemples montrent que la forét peut
prendre divers aspects. Ils traduisent action de
nombreux facteurs, qui seront envisagés ultérieu:
rement.
IV. Conclusion
Au sein de a forét, chaque espéce végétale et
‘animale yit a un endroit précis. Les différentes
Strates végétales sont composées de plantes asso-
cides 8 un ensemble animaux.
—— ee Forte,
espéce vit dans un
tun blotope particulier. Les végéta
‘maux qui vivent ensemble forment une com-
‘munauté, ‘appelée biocénose. La biocénose
dans son biotope constitue un écosystéme.
1a forét est donc une formation végétale possé-
dant sos earactéristiques propres. Elle represente
Fassoctation de biotopes et de biocénoses = cest
Neensystéme forét Tl se. différencie tres netie
ment autres unites qui Tentourent. ‘comme
Feeasystéme prairie-on Fécosysteme éiang. Les
composants vivants de Fécosysteme forét sont en
felation directe avecles conditions du milieu : les
facteurs climatiques et édaphiques feonstituants
du sol,
Mais la fret agit & son tour sur le milieu exé-
‘eur pout eréer tn microolimat
do mess oes Moures.
$0
Felovd 6
'
ae
Relevé nt 4
|
Tow
Wt Ronee
Howe
?
rnsest théorique de fore
(ie carex
On peut résumer les caractéristiques de la forét
de Retz en établissant, un transect (figure 30)
(voir Livret pratique).
25
Exercices.
Mm EXERCICE 1
dl
OL 06 1s 21 28 a ae aT a
i ib eT
Le diagramme représente la disteibution des arbres en
fonetion de leur cl ‘mesurée 41,20 'm du
Cos mesures ont été effectuges dans la réserve biologi
que du Gros Fouteau (Région de Fontainebleau). Ona
compte 67 Hetres ot 28 Chenes.
Pose eee
eee aoa
eae
See can eye
de nigendetion de corte ret a
See an eee
aa
el tie
Th oe
lm EXERCICE 2
ARES
x fle [ais[ =
Jeune Hitre eft r 2
Sane meals
Voici quatre relowés despices végStaes ful dans uno
{ores ciltivee du Massif Armoricain, Le relove a fest le
pls ancien te eleven 1 le plus rocont.
es nombres indiquent ta valour du couiient dabon
dance dominance fir Lvret pratiqudl
bee
eee
See te ter» ura?
5 Bic ete ene
tenner Se Bee ores acts dens
bee ecet
lm EXERCICE 3
dea Murs.
‘etCampagnots
[partition des petits Rongeurs en fore,
© Questions
Analysez le tableau. Comment se répartissent Mulots et
Campagnals?
‘Quels sont es facteurs qui interviennent dans cette
iparttion ?
26
1. La forét
lm EXERCICE 4
‘aulie——_porchis
vals
” i
a sans 00ers
rouon deo tae pendant le cycle evplotation
Evolution de Fabondance des Oiseaux corespondaot au cycle c-dessus
1a Stele fit son pit dang un rou dare te mare
Barieloment. avee do Tage. lle se trouve fequer
tent en compagnie ds Mésanges, ee
La Mésango niche dans la cavté ds vieux ares,
Ex Fauve ich excashement dan es fours bas
Les Pics creusent leur nid & coups de bec dans te
tone dos arbres,
© Questions
1, Analyse Tévolution de abondance des Oiseaux
chou epurs dun cyte doxpatatin de afte.
"combien de groupes d Oiseaux distinguez-vous ?
= Aquolies formes de forét correspondents ?
= Gitez les Oiseaux les plus représentatifs de ces
groupes.
{Les schémas suivants illustrent Yévolution de Tavifaune
ddes foréts de Chénes pedonculés et de Charmes de la
plaine de Sadne bourgulgnonne.
fatale
180)ans 200 08
Sites
‘Grimpereaux
Mésanges
Fawvotes
Divers
tives, Mares
Rouge-gorges|
Pinsons, Gros Bers
Linotes, Bours
2. Bs mchorchant sur les dctments es exigences de
vie do quelques Oiseaux caracttiques Sno part et
es dnt ates venation cos des
tapes de developpement duno. futaie’dautre part
saayes dexpliquer es groupements.ornithologigues
oe es
i"Guel serait alors Je peuplement,diseaux dune
fitale jandine, cest-adive tno futaic hoterogéae, of
Fede ue gt arboracant ihe oe arbres
st jeunes sujet) et une state arbustve Tice noe
tals dense?
AC Dans une faaie do 200 ans (font de Cltaaux, Gite
‘On fos denombrements dOisomux efbeies 4 dix ans
Gintervale ne montrens qu'une variation ineeeure d
{16 pour le nombre total dO seaux
‘uelponsos-wous do cette popliaton ?
Molle sont les principe ics importants que
Fon peut setonin de ett
edhe! est Fintluence da tratement forstior sur les
Oiseaux?
27
La surface des foréts a diminué au cours
du deuxiéme millénaire. En devenant.
6leveur de troupeaux, I'Homme a
découvert les bienfaits de I'herbe pour
Jes animaux et a cherché a étendre les
espaces déboisés.
Paysage de bocge. Vora.
Ta ainsi abattu la forét et Ya
transformée en prairies pour les
animaux ou en champs cultivés. La
prairie est donc une formation végetale
composée uniquement de plantes
herbacées,
Spear
A — LOCALISATION
Située en bordure de la Loire (figures 8 et 9), dans
tune zone de bocage (figure 10), cette prairie est
Tecouverte par les taux plusieurs fois par an, au
‘moment des crues du fleuve.
B — ASPECTS FLORISTIQUES
Ts varient notablement au cours des saisons
(Gigure 11),
32
Il. Une prairie dans le Val de Loire sus
10 Une
‘Quelles remarques peut-on faire concernant Fas
pect de Ja prairie au cours des saisons ?
La hauteur des plantes varie de quelques, centi-
metres a prés de un metre, Les végétaux a bulbes
et 4 rhizomes ont une croissance plus rapide et
apparaissent.dés le printemps
Ia floraison des autres espéces s'échelonne
toute Vannée donnant a la praine des aspects
colorés trés varies.
|. Une prairie dans le Val- de jr.
“© Pantes annus
Pin onl 5
escola 2
16 Ponte 4 bute
Feaes 3
sprain ou prntomps.
Laprie wete de rhiver
© Plantes eizome
Fagus des pres.
Pltuon ces res
Sache ogonit
Gate savage
La pie verte de river
La protic au printmps
La pre color de rate
La prac nande de tin ts
A prin u ous oe sasons
IL Une prairie dans le Vel-ce- 0i¢
2
fmol de peti 6 tone dune pro —
— suceuns oe sive era
Inangeur de fleurs
<
Syiphe
{wompe courte)
‘eeu de nectar
Clete
Fale ou sou.
Lombrics
debs vegetaue
Fétuque dos présPiturin dos rds Renoncule cre Vesoo
Colomblas
oy irs vegetaux
= névareurs
Coccinelle >
Preerons
Chrysope
ballon et
Paoerone
2 UNE PRAIRIE 2, Ses variations salsonnires
Gee Se Au cours des saisons, on retrouve Ja plupart des
1, Composition spices cites avec des variations de population
Ghservons attentivement le diagramme tris sim-“"fevrier mars + reprise active pour un Bon
pliié dela faune dela pratie (igure 1h nombre dinsectes
“omars-evnil: apparition des premiers but
eur:
Comment se fit la rparion des animaux? De = debut-mal : grand développoment dos Hymé
inlay maies eo neurites noptores (ourdons, Guepes):
34
Une prairie dans le Va-e-0(¢
— Pinvtornacts:
a Teale
pe longue
Secour de nectar ©
sineuse Cartaute jacée Grende Marque Carte sauvege — FAUNE De SURFACE
Cioponte m
berore
Tomes
fer
bene
aa
feaees
caige
ec
hase
Foun
Plcsrons
Arinees
= fin mal-début juin : prolifération des Pucerons
etdes Altises;
= fin: taximmumn de la faune ;
alit: abandance de Papillons ;
© Septembre abondance od Araiznées
= tare * décin de ia faune. Les Orthoptéres
(Gicadeles,alises restontvisiblesjusqu aux pre-
alors froids.
35
lll. Quelques biotopes aNneXCS mmm
‘A - L'IMPORTANCE DU VOISINAGE :
‘LA HATE
Un bon nombre do praities surtout dans TOuest
el le Nord de la France sont entourées de haies.
{Homme a ainsi dalimite des parcelles eréant un
ppaysage artificiel appele bocage.
En_plus de son réle de frontiére, la haie sert de
brise-vent et assure par la présence du talus et
du fossé ime regulation de Técoulement des
eaux.
{Ta haie sert aussi de refuge a de nombreux ani-
maux qui trouvent leur nourriture dans les
frbtes et arbusias ainsi que dans la prairie voi-
sine (figure
Par exemple, la Mésange charbonniére, qui batit
dans Ia haie & moins de cing metres du sol, pre
lve chaque jour dans la prairie jusqu’a 500 che.
nilles et petits Insectes pour nourrir ses petits
Le Campagnol qui creuse de nombrouses galeries
gs In pri our gy nourir heres, de bul
bes et de racines diverses peut provoquer des
‘dopats importants, On observe sa pullulation tous
feq trois ans, mais cette prolifération est limitée
ges des enemis qu trout refuge dans a
aie, tels que 1a Chouette et la Belette dont les
popslauonssubssent es memes factutions que
‘Beaucoup de haies ont été rasées dans le cadre du
Temembrement des lerres, ce qui a eu pour
Sensequence une meoafcaton “ela Gune deta
prairie
_— wee rorre
D> otis pp pte ln alejone un ote
Crnivores Bota Mottusques
eiste || campagro! || Geenouite || Escargot
Reptiles
ovieure
3 laa ets Pato
36
nipiFicaTion
IIL Quelques bictopes annexes
14 ne bouse can prairie
“GserantImerfaco sol bouse :
Sol sus acont
B — UN BIOTOPE PARTICULIER
AUX PRAIRIES PATUREES :
LES BOUSES
Une pale dun hectare suf aux besoins ali
mentaies de ois ties de beta. ba production
oumallce de Bouse per ue Vache ost de Forde
sm Gova0'g co qui corréspand environ 800 pds
moter ie
En salson de paturage, cot environ 200 jours par
0, pl de 2 tonnes de matin eles
Sonal deposées sur la prairie. Ge dapat moyen cor
Fospond a Taccupation duno surlace do sol do
Forte de 600 me sot de a praies
Ce mlcomien igure 4) évoue rapidement
im tha faune speciale xy suede dae temps
Bie” nt anges ponies” here),
Caltoptiretcoprophages igure 161 (ponte
touruure|: enfin Golembole et Lomb, eos
Cis aun Hactries ot sux Chempignons, snk
isan dans le sel a mates ofeenigud uate
tol envifon sont nécesairs pour I dspantion
complete d'une bouse.
let > Be Pacis piueserteore porenennr nee
Sie par"fappor aux: praifies naturales on
inne paturtes.
omeuiier Changement de faune, fumure organique, brow-
anausres ) Somes taye des vegétaux ot pletinement sont les consé-
pi ‘quences de ce paturage.
Une étude raliée sur tris années a permis de
4am Toenant 49 exptors de Goleopttres lonnateu's
(er bouses Burm! ome certains gen nowrrs:
‘Sent et se localisene au sein de Texcrément de
tre ent dans ntrfe ot pour dos
rumies, Lo premier groupe est dt eoprophage,
Second coprophiie.
1 taleny edemsons donne les variations men
belies des Inseetes eolomsaisurs Go houses.
HERBES ET CHAMPIGNONS
Peuton définirplusiurs phases dans Téyolution
nizoanidre des populatioss do os deux types de
Coléopatres 1
37
Il. Quelques biotopes annexes Ee
16 0 neiouse tv train ootal,av centre (A et devant es
buts)
C - UN TYPE DE PELOUSE
SPECIALISEE :
LE TERRAIN DE FOOTBALL
Un terrain de football (igure 16 a} subit un cer
tain nombre de contraintos, celles des joueurs,
en particulier dans la zone centrale et autour des
buts (figure 16), celles du passage des engins
pour Tentretien et la tonte de'la pelouse.
1. Une prairie normande et un terran de football
Foodions le tableau [7 S
a prairie. normande est caractérisée par une
atid varete desptces,tandisque'le werain de
Football ne content que‘ trois ou quatre eapsous,
uniquement des Geaminées.
38
flange pour terrain es oud
ay Grass anglais 358
ecleve 28
despre 28
Melange comenem pourtous ates trans
Ray-rssanglas «40%
Baars Bs
Huderomie’ 30
Fetunesentinte 158
17 Prat noord ot anains ds football
2. Le choix des Graminées
Tl sest fait a
reunies dans
tableau 20.
ParUit de certains caractéristiques
les schémas (figures 18 et 19) et le
Ill. Quelques biotopes ann¢x¢s
1B Giamnses ies (1 ~ rale princi)
ma: mawals;me : médioore;M: moyen; 8: bon TB tis bon
20. carctirstiqws de qveaves gramindes
Bia des renseignements donnés, justifie
EO repr
pa ase ESS ps
2 ees
‘se aes
2:Latonte
Setiate genet ae par eam
partir du moment on i vogétaton atin tne
hauteur de 10 cm. ee
Ee tableau 21 montce un effet de la tomte sur les
Plantes
19 Gramings 4 soins ov mm2omes
21 tier 00a foe sw ts planes
est
action surles racines, y aurafeil dautros incon-
‘vénionte a fare une tonte plas ase?
IV. CONnCIUS(ON pe
4a prairie est un écosystéme terrestre qui pos-
Side ane structure corparabie cle da fet
| ex qui évolue comme elle au cours des Saisons
Gn onstate que les plantes y sont dispostes’ en
Stratos ot ur les animaux sy répartissent selon
tun emplacement bien précis
| Nous avons vu, dans le chapitre précédent que la
39
forét posséde ses caractéristiques propres et qu'il
existe plusiours types de foréts.
Ten est de mémo pour les prairies. Homme les
‘a dabord créées pour son utilisation personnelle :
ries d'élevage ou prairies cultivees. Par la
Suite, il les a encore diversifiées en en faisant des
lieux dagrément : terrains de oll ou de football,
‘ou implement, pelouses de j
xercic
lm EXERCICE 1
=, [i
oie [ota
fapesmeaier | 9 |e
ee 3 | 8
soatie 2 | 8
rs Bel
sa a | |
ae
(em i | «|
Le tableau ci-contre donne le nombre de captures d'n-
‘sctes dans un pré fauche ot dans un pre non fauché, La
methode utlisée est celle da filet fauchotr (50 cous &
(heures
© Questions
Paltes Vinventaire quantitatit et qualitatit des dewx
prés. Bn vous referant au tableau de la page $4, tentex
{de justfor les differences observées.
™ EXERCICE 2
le scm cicontre montce le mode de vie de quatre
espéces d’Araignées. <
Spectre de prole des quatre especes
pee [Arson | Agen [inhi
inars — e | +
Pues | |
Gets fle
bates | + | ot | t
earns t
Gaomboles #
© Questions
Observes ies diférents pidges et justifies le spectre des
pproies attrapees.
40
Les deux tiers de la surface de la Terre
sont recouverts par la mer. Avec une
profondeur moyenne de 3 800 m,o«
fait figure d'inconnu, et malgré les
progrés techniques, les fonds marin
Testent peu accessibles. Notre
connaissance de la haute mer se borne
surtout a ce que nous pouvons en
observer directement : sa surface libre
et, sous celle-ci, une zone de quelques
dizaines de metres éclairée par
les rayons solair
A Vinverse, la frange cétiére a été
beaucoup étudiée, Milieu riche et
directement accessible
YHomme, elle offre a exploration de
vastes étendues que la mer découvre
parfois : 'estran.
Ta France s‘ouvre sur la mer par
5.500 km de cates : 40 % de rivages sont
rocheux et 35% sont représentés par
des plages naturelles,
Pour cette étude, nous retiendrons : les
cates rocheuses, les plages de sable et
s zones vaseuses ou slikkes qui
offrent un milieu favorable &
Tinstallation d'une flore et d'une
faune variées.
|. Un littoral DrCtON) tts
Bein de Mosaic
rca 1: Vert
‘ines rotheun
xen 2 Site
tts veos "mia de
‘Sdimons movies
[EE] extn
41 ascot eta baie de Mort
Be
Hater de Zones’
(EES53] Sabie et blocs rocheux
[ears] Rochers
Limite des basses mers
‘a2 Stuavon de ie vere
v3 Lie
aro roceuse exon 8 marie basse.
De tout Je littoral francais, la Bretagne offre les
aspects les plus divers : vasieres, plages natu.
relles sablouses et rochers bordent plus de la
moitie de ses cbtes,
Lestran est particuliérement étendu, car 'ampli-
tude de la marée y est exceptionneliement forte
pre amie aaah a
1 Un littoral breton|
oma
Himanthali
\VERSANT NORD
Lichen vert
antore Lichen jaune
Caloplaca — Lichen jaune
Verucsire~ Lichen noir
Pobétie
(ES Aiques vores MEN Alguesbrunes EINE Algues rouges
ve
Entéromorphe
VERSANT SUD
4 Pépandvon des wigsove sur les wersants Nord et Suc dee Vane
A — EXPLORATION D'UN MILIEU
ROCHEUX : L'ILE VERTE
Eile Vere est un rochor (igure 2} situ dans la
‘Bertie de lestran comprise entre Iile de Batz et
ete.
Sa face Nord, exposée au large, est battue par
Tes vagues, sa face Sud, tournce vers la jetde, est
4u conitraire, abritée (figure 3)
En so rotirant, la mer découvre les rochers
Jhébergent une flore et une faune variées, en lals
Sant un chenal de sable fin inondé.
4. Inventaire et répartition des vegétaux
Le résultat des observations est reporté sur une
‘Goupe topographique des deux versants de Ile
Verte (figure 4}
45
(Obeorvons co dociment. Comment les wigteaix
Seat le tastes
Dursommet du other jusqau niveau de ln basse
Beason pect lating sous caserannene rad
ropes :
res Lichens encrottants noirs,jaunes ov vers
gui colonise io sommet as Te uur
es. Algues verte, flincées, ot dos
irunes, dr thal digtts ot patos arnt
Hott "on rence. alert a ved
infereur de nomprauses Alguse rotges 3
sts ands thal wbins de premires
Aiguos Saminaires‘fixcos" au roche? sus
eset eee
cenTunes
AUGALES
Etagomor simple des végétau sur rocner
ef res algales
HGitorines
Gibbules,
Patelle
rittorines
Gibbules.
PPourpre
Listorines
260
On constate donc une répartition ordonnée
selon un étagement précis ot chaque étage est
caractétisé par Yespece la mieux roprésentée
(igure 5).
Giteiles differences observe-t-on entre le versant
Nord et le versant Sud ?
Le faciés rocheux abrité est recouvert d’Algues
Vertes (Ulve et Enigromorphe, et dAlgues brunes
(Fucus spirale et Ascophylle). Le facies battu est
caractérisé par le Lichen pygmé, le Fucus vésicu:
lou ainsi que certaines Alzues rouges a faible
profondeur.
46
7 Le Chtonsurson ccher
8 Litonnes
9 saree of Fatales
2. Inventaire et répartition des animaux
Dans étage occupé par les Lichens, on note la
présence de nombreux “animaux torrestios “:
Miycinpoaes ot patty Insectes dépouras dates
tels que. les Collemboles. be petits Crustacts
tigi Lyges et Pues, de’ mer, y ‘rowwent
refuge lors que des Mollusques Gasteropodes se
Cachont’ dans les anfractuosites, hummldes” du
focher : par exemple, ia Littorine blow, peut
‘Bigorneai’a la coquile tes pointe qu se nourrit
de Lichens
1s tableau 6 donne le résultat dune récolte effec-
2 ET ES Sa
MODE BATTU MODE ABRITE
Blane Palo Moule | tinerie | Gibbuie | Pate Chiton
Focus spirale
Foose
‘esicleur
scone
Focus dentelé
Laminaire
‘tue au nivean des ceintures algales durant
15 minutes.
Gomment les animaux renconirés se répatis.
ssentils 7
existe unc opposition ts neti entre les deux
ee es eee
lone du ‘exposition aux vagues.
Quant 4 la richesse de la faune, on compte
53 Individus ‘en. mode battu, conire 1 870 en
mode abrité, soit trois fois plus.
En mode abrité, on trouve essentiellement. des
‘Mollusques tols que les Chitons (figure 7) les Lit
torines (igure 8) et les Cibbules.
En mode batty, ces animaux disparaissent et sont
remplacés par les ‘lanes, les Moules ot les
Patelles (figure 9).
Pourpres et Perceurs apparaissent indifférem-
‘ment sur Tun et lautre versant : ce sont des Gas-
‘iGropodes carnivores qui ont la propriété de per
forer les coquilles de leurs proies. En considérant
‘séparément chaque mode, on voit que les espéces
Se succédent les unes aux autres verticale-
‘ment : il y a un étagement coincidant avec
celui des ‘végétaux. Ceci est illusté par le
schema (figure 10),
Tl apparait que chaque espéce est inféodée a une
ceinture algale précise : celle-ci assure done les
besoins vitaux de son héte : nutrition, reproduc-
ton, protection.
Nous avons vu dans le tableau 6 que les Littori-
nes sont omniprésentes dans les celntures algales
superieures,
La réalité est-elle aussi simple ?
En fait, on peut différencier quatre espéces dont
Ja répartition est la suivante (figure 11)
47
10 Feu quale ratsons ies Ginbulessuccesent ales aux
tones eas Patallos ax Saiane
ares
cmees [one | Unie
tone |e
ne
sae
11 ipativon vets ds tions
Analysts, raphiqu do a Hier, 1. 2a riper
‘ition est elle
dontes’?
‘aux conclusions. proce
Un littoral breton
oDe eaTTU ‘MODE ABRITE
Myiapode
ge
Colembo
‘nmate
(vat de Baie)
Imierophage
es ee
tivorve itoring
et lee etalon
ype di fore ee ove o mites Flore ot faune de la cbte rocheuse bretonne sont
illustrées par la figure 12.
S22 pirrdens 22 eer eee
Flore ot faune du litoral rocheux so répartis
p> sent vertislement‘en formant dos assoc
ions soumises 4 Faction dela mer:
1 Un fittoral breton:
erie de Zostiras ~ ike
cS Sable tn [EAGAA] aloe chews
Vasa mate === Limite doe basse mer
13 Cestan de Pompeu!
16 Ceordue sabes 8 Pompou
weer,
Teer mee
baci os
B — EXPLORATION D'UN ESTRAN vers lamer, une zone. vaseuse ou slikke
‘SABLEUX : PEMPOUL fe
‘Le site choisi est voisin de la plage de Pempoul 1 Le sable
dans la baie de Morlaix. Observons Ja photo (figure 14) Les rochers sont
Cest une Gtendue de sédiments meubles divers _tapissés d’Algues et de Lichens, tandis que Iéten-
ge de fochgs lealmont recovers} due sablouse ext mig of pou ‘de vegeta
fharée haute (es Vernes). On ist Cette absence de flore est caractéristique de
Retement we bone sotiouss ongeant'is cote Taranablate
49
0: ee eT
(crabes: Crabe vert
‘Tourteau
en surface
enfouis
[Couteau
Arénicole
tephtys
Giycene
nfouis
1B sovontar de a faune coo d basse me
16 Patourde
la liste des animaux récoltés a
marée basse (figure 15) est assez importante,
Toutefois, la plupart dentre eux sont invisibles.
Inversement,
Pourquoi?
Parce quils sont en grande partie onfouis dans le
sable les Palourdes (igure 16), les Praires et les
Gntenox sont ‘des Mollasgurs qui restent en
relation avec la Surface par les det siphons qul
rolongent leur manteau. Les Vers mains ane
js, Lanice igure 17) et. Sabelle. (igure 18)
sejournent dans an tube maquows quis sécre
tent, tandis que UArénicole vit dans un terrier en
forme de U quelle creuse
‘Toutes cfs espéces sont des espaces. séden-
taires
‘Au contraire, la Nophtys et la Glycérie sont des
‘Annélides nageuses munies de puissantes rames
‘patatoires qui leur permetient de se cacher dans
Ie sable a Tapproche de la marée basse. Elles par-
ticipent avec les Crabes et les Pagures a la faune
errante de lestzan.
50
17 aes oo Lanice
18 Sabet
2. a slike
File est envahio par dos Zostéres, véritables
oral ante dea Manche. est psp
51
1 Ur Litors! bert, SES eee a ee a
Ss
=
8
PHASES DE LA LUNE
Hauteu dela peine
Cootfcen dois Roscott
beasm
Jours/sptembre 1984
24. Vanavons da pastor plie er §Roscot dornt un mos unave
C — LES CAUSES que 638 m (cae) = cost une pletne-mer de
DE LA REPARTITION Marées de vive eati et de morte eau alternent
{YS ica ot iniaer ocaameste ‘mensuellement tous les 15 jours. Ala nouvelle
lune du 25 septembre, la marée de vive eau pos
A quoi tient Tétagement des végétaux et des _sécie uno amplitude exceptionnelle (coef. 116}. Ce
are phénoméne est dil a fequinoxe (mars el septem-
Quels sont les facteurs qui influencent la distri- bre) qui détermine les grandes marées {marees de
‘bution des étres vivants chs milieu ctier ? vive eau exceptionnelies).
Consultons un horelre des marees. On constave
a a eaten varias urea arsscelie Feane-
ES Be sirheues Cestan st dqncaleauie- Tes dee niveux de pletne-er ot de basse,
Ment emerge et immerge selon un cycle Sontelles-responsables de la sonation wertcale
Suite sta aono'do tnancoment dos aimee?
Tecvelfciontdelamarge évaueIampltnde de 1) $UfRt dobserver & Iie Verte 1p nivenu des
1 oes eae de Pleines-mers pour constater que les. comes
Che eee ee egeaies son eterminges pa la hauteur de la
Nee ne eee de ese es mer (igor 2)
eure 24 donne, pour le mole de septembre 1284 ‘Ans, lesLichens colonseat Ia partie du rocher 1a
eee tolno ates parla mee Sourte aux cuban
Liamplitude des marées_ eee liée aux phases cette zone partiellement inondée aux
Gel Lune, Ala nouvel lune @ et a a'pleme marées 'équinoxc, ost une. zone de. transition
fie’ Ove Solel et la Line sone algnés avec ia olonisée essentiolement. par des tres vvants
‘Terre : leurs forces attractives s'additionnent. La terrestres. Cest létage supralittoral.
faci de poner ote gee m2 Dans lame etd ae marng compence
{eoot ‘o)‘“'cest une pleine-mer de vive eau aver les Algues et. les Dalanes. Cost Tétage
(ewe). ‘médiolittoral.
Achaque quartier, Yalignement Soleil-Lune fait Tes. Laminaires, au contraire, so dévoloppent
in angle droit avec la Terre les foros attractives exclusivernent dans dos zones jomals ex
Se rettanchent “la hauteur de la mer matteint Gest Fetage infraittoral,
54
| RR re ETE EEL EE SY
= ware
a |: | Ve
i mail
os
a2 Mimarée
Ea :
=
alle
2
2B LAlque se protege co
2. Les facteurs de la répartition
‘a) La lutte contre la déshydratation
Sur une oSte rocheuse, lémersion provoque
Fasséchement de tous les niveaux. La durée de
Témersion augment de bas en haut sur le ver-
sant du rocher. Animaux et, végétaux de Vétage
madiolittoral doivent donc résister a la déshydra-
tation, Les Algues sont. recouvertes dune sub
Stance mucilagineuse qui leur donne un contact
isqueux et les protige de la dessiccation
igure 26).
27 Le Bacon et son opera.
Elles conservent ainsi sous leur thalle une humi-
dité suMMisante pour la survie des animaux.
Ceux-ci se protegent de différentes fagons :
Buccins (gure 27) sécrétent un opercule
muquewx qui oblitire leur coquille. Les Patelles
ft les Balanes, étroitement fixées au substrat,
femprisonnent une provision deau en attente de
Ta marée haute.
Dans Vélage médiolittoral, les conditions ne sont
pas uniformes et les espéces les plus aptes a
Fésistor a la déshydratation colonisent les parties
Tes plus élevées du rocher.
Un littoral breton
Supralittoral
Seblesee |
Médiottors| |
Zone detention |
NORIZON DE RESURGENCE
Toate oa]
Camino
Intealitorl
Zone de saturation
2B. ransect apicitt doa raprttion des ana sur sédiments moubes
La situation estelle la méme en sédiments
meubles ?
‘A marée basse, une partie des sables reste imbi
bbée dreau : cest la partie qui se situe au-dessous
du niveau of Yeau infiltrée a la pleine mer resur-
Bilt. Ce niveau est appelé horizon de résurgence.
Ta figure 28 explique la zonation en milieu de
sédiment meuble. On voit que Vendofaune ne
subit pas Yemersion.
Wh La ealinits
eau de mer contient en moyenne 36 grammes
de sel par litre. L'eau retenue dans les flaques est
soumise a Tévaporation mais aussi a la dilution
Par les eaux douces du continent ot les eaux de
pluies.
Comparons le comportement de deux Crustacés
dans les eaux de salinités différentes (igure 29) :
YAraignée de mer et le Crabe vert.
‘Le Crabe vert supporte dos écaris assez impor-
tants de salinité, Ceci lui permet de chercher sa
nourriture dans Iétage médiolittoral et de saven-
turer dans les eaux desealées des estuaires.
LAraignée de mer, au contraire, ne peut survivre
que dans Vétage infralittoral
©) Lexposition par rapport aux vagues
Nous avons vu que les espices animales et végé-
tales rencontrées en mode battu et en mode
abnité sont différentes.
En mode battu, le rocher est soumis a la pression
des vagues : les souls animaux proservés sont
‘ceux qui peuvent. se fixer solidement, comme les
Fatelles et les Bolancs. Is forment des peuple
ments encrotitants caractéristiques. De méme, les
Algues sont fixées par des crampons au rocher,
‘mais leur nutrition est indépendante de colui-i
Milieux | Anémone de mer | Crabe vert
eau pure ‘mort mort
_ log ‘mort normal
36 e/ ‘normal ‘normal
50g ‘mort ‘normal
eee ee
29. Fiers des concentrations successes su dour espces do
Custaces
— wee Forte
1a zonation des végétaux et des animaux da
Tittoral"dépend. de alfférents facteurs qui
D> variont avec les marées : hydratation, saline,
température t agitation des vagues.
Un littoral méditerranGen : muss
La cOte catalane
32. schéme de ite Grosse
31 Localsavon asgraphiqve aes sites chasis
ta chte catglano qui correspond aia chute de Ia _lsés par des spéialistes car il est intondit de
Ghaine pyrangonns dane later oflve des payse, Cue ou'pacher dans une reserve natelle.
ee aliuptes,crques & plots et
porate aden tn chee Dig ‘A - EXPLORATION DE
{tora sont 8 Torgine do son classe. ONES ROCHEU:
Rent comme reserve macine de Cerhére-Banyuls ZONES ROCHEUSES
depuis 1374. 1, tude du Titoral de Ile Grosse en made calme
11ap neanmoins possble de ire tude de sts He Grose ext un ensemble a tigtes 2,
meotsablous a paride prelevements én: 31,92)
57
Un littoral méditerranéen : a céte catalz1¢
simpli de FA de Me Grosse apres un document da Laborato Azago de Banya
Observons le transect de Ilot 4 (igure 33)
Que constatons nous 7
On observe essentieliement
= lat zone de Lichens noirs avec la Verrucaie.
Elle'est toujours exondée ot peuplée de minus
Gules Melaraphes : cest letage supralittoral,
sli, sAtquoy runes enioaianis a
sant penser & dos taches de goudron avec la Ral
Sie ol ia Némoderme, Elle et colonisce par des
Ghramates et quelques Patellos : vest ie
médiolittoral recouvert seulement par mauvalse
— Lo zone inférieure riche en Algues de divers
groupes et en animaux On troave-en pariclier
des Coralines au thale. plumeus, cae des
Gystoseies aspect buissonmant et ala base des
‘Anomones et-des Ours Cette zone toujours
inmergée correspond 8 'étage infralttoral,
2, Htude du pied des falaises da Cap YAbelle en
mode bats
Un examen attentf du pied de ces falaises mon-
tre do haut on bas une stosesion de trois bandes
igures 2a, Bet C)
— Une ceinture supérieure de couleur brun
Jaune consttuse par des Riscoelles Uigure 95)
‘gues rougs typiques de in Maltrranie et
dépigmenties par Finsolation laquelle elles sont
= Une ceinture moyenne blanche correspon
dant au ctrotioir», formation caeaite Gai
ae Algo Lithopie tortuous ture Bh
Getie console a tine largeur doa 4 60 cont
58
BAA caprareie
‘tres pour une hautour de 30 oentimatres. Situé
ila jonction de la terre et de Tea vest un rai
ions es oct seat abe ee
animaux terrestres (Araignees, Myriapods} ct 3
des animaur marins Often)
~ Une ceinture inférieuro do couleur brun
os comportant des hulssons. de Cystoserres
{figures et 30} ede Coraliines (igure 38) On y
bserve une moulére naturelle.
Comparez la Nore de Ifle Grosse A celle du Ca
abate: Que constatez-vous ? =
[WUn littoral mediterranéen
RR RR ERATE A TIS BER EAE IE,
B Asscote
.
3B conse 39 cystosone
MB cone agate
au pied de fale
‘exploration de cos deux sites rocheux a permis
observer un étagement vertical des Algues et
des animaux qui y sont associés. Cotte distribu-
tion moins spectaculaire qu’en Bretagne est due
au resserrement des ceintures d’Algues ui
Sont, en Méditerranée, des organismes de petite
taille
Te parton oédute des Algues dans, space
Sexplique en particulier par la nécessité de leur
ihuntectation et leur besoin en lumiére, Le facteur
éterminant reste la faible amplitude. des
‘marées car la cilférence entre a basse ot la
Eautesmort Hanyuls est que de 40 contimétres
es Algues sont donc en majorite regroupées en
36
0 opsesi
59
Lthophyiletortuo 387. Lanophyieinsastnn
Fisotle
Niveau dela haute mer
FS littonhvle tonweux
ceintures étroites ot resserrées. Cette compétition
pour la place et la lumiére expliquerait leur petite
{alle Guant aux animaux, leur distribution dans
espace est directement liée a celle des vegétaux
dont ils dépendent.
—— ee Forte
a cdte catalane offre un étagement spécifi-
D> que TAlgues mais clu-c est moins spectacu-
laire que celui du littoral breton & cause, sur-
‘out, dela faible amplitude des marées.
IL Un littoral méditerranéen : la c6te catalane SS
1 Poscone
43, ature des tonas mastertanens en lenction dea protendeur
{aleiseschistouse
a
rotor caleaie
B — EXPLORATION
D'UNE ZONE SABLEUSE :
L'HERBIER A POSIDONIES
1 forme dans Ja baie de Peyrefitte, sur fonds
‘meubles, une veritable prairie sous-marine cons.
tituée par uno plante a fleurs : la Posidonie
(igure 41). Cette plamte comporte des feuilles
rubanées verdatres dun centimetre de large et de
trente centimetres de fong Elle lourit la fn de
rete,
Sur ies plages, on observe fréquemment des bou-
les brunatres ou «pelotes de mer» forméos do
morceaux de feuilles brisées de cette plante et
mélées a des grains de sable roulés par les vagues
(figure 42). Cot herbier contient une faune tres
diversifiée (figure 43).
Felted mer
riveau dela mer
‘Analysons a réparttion verticale des animaux en
bordure ow 4 Tintorieur de Therbier & Posidonies
itiqure 43).
Ot consis qu cranes epics vive en ena
pou profonde’: Anémones (Rgure 5), Eponges
figure 46) et Montes * elles sont souvent asso.
ties aux Posidonies
Dautres, comme les Crevettes (figure 47) on cer
{ains Crabes ont une repartition indifférente pour
la profondeur et donc pour la lumiere. En revan-
che, le Seiche (igure 48) préfee les profondeurs.
Uherbier heherge également do nombreux. Pois-
fons tels quo lo Loup ou Bar (igure 49) a Saupe
figure 50) et le Rouget (figure 31) car cette zone
leur sert de frayere et de source’ de nourriture.
Therbier § Posidonies est done une des grandes
ressources de la Mediterrance, qui rappelle Ther-
bier A Zostétes moins riche de la Bretagne,
IL Un littoral méditerranéen : la céte catalae
Oasm ‘Anémone ow Tomate de Mer
‘Moule
atom Coquille Saint Jacques
Toadom — | Epenge
Anemone
B0AA0m | Patite seiche
Grovette
140m | Ggatede mer
‘Aralgnte de mer
9A Les anima de Vherbor ot de sa bo
81
80 ssupe =
Bus, au larg, par 90 ou 40 métres de fond.
coralligene (figure 62) est une zone rocheuse cal-
faire recouverte de Coraux et d’Algues calcaires
abritant de nombreux animaux.
— fe rorre
Le littoral méditerranéen est caractérisé par
eherbier» a Fosidniesabrtant une fore et
une faune variées et par le coralligene, zone &
Coraux et Algues calcaires.
Fouger
Conaigine oe
Exercices.
mm EXERCICE 1 ‘le reese ow paren es a le
et végétales rencontrées sur Ta falnise de Morgat en
Bretagne.
Verrusire noire et Littorne bleve © Questions
1. Définissez les différents étages littoraux a partir de
‘eat inventaire
ee 2 Quel est ic le mode dexposition aux vagues ?
3. Cola est'il conforme a Tabsence de Fucus et de
Pelvitie ?Justifiea votre réponse,
lH EXERCICE 2 © Questions
1. 0 avez-vous rencomtré les Algues de a méme
‘hiaa etal hea i
Algues rouges des genres Lithophylle famille ?
Ae as aac rot a ae
val ee eee ae ee
ih
lm EXERCICE 3 ide arouse woe Gi
ag eS
‘caieres | troqe | cunue | rome | toate ane eg op aan ee eS
- fanche-Atlantique, les Gibbules récol sur les
ee ee eee
[SSS | sate | ete | ee | Ena aa: Geet
@ Questions
— Comparez cet étagement 4 celui des Littorines.
eS /hypothéses pour expliquer cette répar-
Pott On se rappellera que les Gibbules possédent une
Gee eee fe heed arpa
‘Focus spirale séerétent.
Ss
re
62
Le milieu marin
| EXERCICE 4
de phytoplancton
Distomées sont ‘de petites Algues microsopiques
Antarctic n a pu mettre en évidence la migra-
verticale de ces Diatomées : le Jour elles se trou
pris de la surface des eaux, la'nuit elles sont en
arallbementon a déouvet les ft suivants: a joo,
‘es Algues utlisent la lumiere et ls sels minéraux pou
8 cages lipides de reserve, la nul elles consom-
@ Question
Expliquer cette migration sachant que les Diatomées
‘ont aucun moyen de locamotion autonome.
EXERCICE 5
Un transect réalisé, en hiver, sur Tilét A de Ile Grosse
clomid méme feo que cei Gadi dant le
hapitre (page Se) montre Texistence des especes ainsi
sépartios
EXERCICE 6
comparative de la Petite Roussette (Poisson
ux) & Roscoff et a Banyuls.
Inesures reaisats dans Tos dix stations, ont
Geeaeaaat
em
‘S2an
Dap Vie et Milou n° 1389 du laboratalre Arogo de Ranyuls
© Questions
“Analyses le tableau, Ouobserves-vous ? Quel
lien peutil y avoir enice maturité sexuelle et taille
‘muaximale chee ce Poisson ?
2."Les facteurs. présentés dans Je deuxiéme tableau
suventils avoir une influence sur fa croissance des
Rousetes ? Voyez-vous dautres: explications possi”
Face a limmensité des océans, la masse
des eaux continentales nous semble
bien réduite. En réalité, il faut ajouter
aux riviéres, lacs et étangs, les eaux
cachées au sein de la Terre, les nappes
phréatiques et les riviéres souterraines,
et les eaux qui sont provisoirement
immobilisées sous forme
de glaciers.
Toutes sont synonymes de vie et
constituent, avec les animaux et les
‘vegétaux, autant d’écosystémes variés.
|. Les eaux douces en FranCé sum
— cou gens
pete
11 Répariton des Newest des rs de France
(On distingue dans les eaux continentales
— Les eaux courantes qui sont en constant
‘renouvellement. Ce sont les fleuves, les rivigres,
les ruisseaux et les torrents qui sont répartis en
six hassins (higure 1).
T2Bassin Artois Picardie
I Bassin Rhin Meuse
TIL: Bassin Seine-Normandie
V': Bassin Adour-Garonne
‘Vi: Bassin Rhone Mediterranée
— Les eaux stagnantes qui se renouvellent
beaucoup plus lentement. Ce sont. les lacs, les
ft les marals dont les principaux sont
répertoriés dans la carte (gure 2).
1 Camargue
2 Baie de IAiguillon
3: Sologne
4. Bronne
5. Dombes
6. Basse-Loire, Bridre, Grand-Lieu
7. Golte diy Morbihan
8. Etangs du Languedoc
9, Estuaires picards
10. Baie des Veys
2. Acaisot ones hums importness eennigne fiose
Invrationle boc] teaver aur)
11. Baie du Mont-St-Michet
42, Embouchure de la Vilaine, marais de Redon
¥3, Baie de Bourgneut, marais breton
14, Marais Olonne
418, Bassin Arcachon
16, Champagne humide
17, Bangs de Lorraine
18, Rieds Alsace
19, Bresse, plaine de la SaOné et du Doubs
20: Brine da Forex
21, tangs de Biguglia
22. Marais de Saint Gond
23. Btangs de Argonne.
24, Zone riveraine du Rbin
25, Sundgrau
26, Marais de Sacy-le-Grand (Oise)
27; Plaine inondable de Valle
28. Marais de Chautagne et Lavour
29. tangs de la petite ct grande Lede
30, Médoc et Blayais
31; Marais de Plovan
532; Ftangs de Diane et de Pato (Corse)
33, Marais du Drugeon
La France est un pays au climettempéré dont les
‘servos on ea doulesont coisas
Il. Etude d'un ruisseau : la Couze Pavin m
ws. Cae <<
a H
4: Estat ot cate googie dr (10000
LOCALE leret ot le Puy de Chambourguet. A Ja bareque de
cee Vassivire (1 206 ml. elle soriente c’Ouvet on Est
414 Gouse Pavin prond sa source entre 1500 et ‘Elle se Jette dans’ Aller air nivess dieses
1700 m daltitude dans le massif du Mont-Dore (400 "m)'-aprés' un’ trajet We "40. kilomaters
dela Biche) Ble resulto dela confluence de {igure},
fulselets plus ou moins temporaires,aimentés La Couze Pavin so trouve dans une région dont
| parla fonté des neiges. Apres avoir traverse le lac les roches afleurantes sont des rocker omnes
|) Seretenue de SuperBeae cle coule uivantune _iiorte en rouge ot face an in see ees
iection Nora-Sud sur’ kim, entre le Puy de Pal. (igure 4.
| 67
* UL Etude d'un ruisseau : fa Covze Poi)
B ~ EN SE PROMENANT
‘LE LONG DE LA COUZE
Sine stations ont 6x études, depuls la source jus
nia Fentrée du village de Cotteuges gure 5
tr chacune delles'on a note
"sa localisation par rapport a la source,
= Sos caracteristiques Pysiquos Gargeur de la
Tivibre, protondeur, tat di courant et nature du
substrad.
Siig nature de son environnement
a compesition faunistique et forstique
= Son pil et sa DCO. [demande chimique en
Sayin) collect correspond a Ta quantite d oxy
ore, exprimée en mg/l nécossaire pour oxyder
fos atgres organiques presentes dans Teau ce
dosage nest pas realisablo en classe de Seconde,
Stations elo Coure Poin ctuais
Station n° 1
Dans lo bois de la Biche, & 500 métres de la
Largeur du ruisselet : de 08 a 1,2 m: profondeur
inférieure 4.02 m.
‘Au fond se trouvent. quelques blocs de pierre. Le
‘courant est vif,
Le ruisseau est peu ensoleill.
Station n° 2
‘6 km de la source, au milieu des prairies.
Largeur : de 3.4m; profondeur :au maximum.
08 m.
‘Le fond est surtout sableux et bououx avec quel-
‘ques pierres.
ff Etude d'un ruisseau
I aie
Station ne 3:
En aval d'une cascade, a 400 m de la station pré-
cédento.
Largeur : de 4 a5 m; profondeur :0,3 m au maxi-
mum.
Le fond est rocheux avec des blocs de pierre.
Guelques zones calmes sont graveleuses et
oueuses.
Station ne 4
Toate db esas 40 km de a source.
Ee rlsseau selarsit pour former un pu
Targeur' de’ 4b nh profondeur 62m,
Te fond est constitué Ge sable ev de boue av
Guelgues piers. Lensoleillement est importan
Station n° 6 =
En aval d'une laiterie qui rejetait récemment
importants déchets, Le fond était constitue de
cailloux plus ou moins recouverts de particules
organiques. L'eau était trés trouble,
Le ruissoau est trés ombrage.
Largeur : 5 m; profondeur : 04 m.
Station n° 6 :
A10 kin de la souree, entrée de Cotteuges.
{Le ruisseau coule enire une route et un mur de
Soubassoment de maison,
Targur8'm profonde : de 04 & 05 m,
Les blocs de pierre sont nombreux et ospacés par
un peut de sable et de boue
Il Etude d'un ruisseau : la Couze Pevin cc
{© Het demande chimique en oxygen relvds dans sx stations dea Coure Pain
Pr vant eaecondement dealers ia station ¢épuraton
1. pt ot demande chimique on oxygéne
Lap Sltts sont regu cant le able 6
GI En vous seportant aux renseignements donnés
‘pour chaque station, evaluez tes variations de pH
‘vexpliqeztes, Fates de méme pour la D.CO.
2, Role sur la flore
Te tableau 7 résume différents renseignements
concernant la végétation et les principaux fac-
‘eurs Tinfluencant.
70
BI Diaprés le tablean 7, comment, pouver-vous justi-
fler la ‘ou absence de net sa
preence ou Uaboenc de eget
3, Réle sur la faune
File est particuliérement adaptée au courant.
Ta figure 8 montre quatre Insectes dont les lar-
ves vivent dans Ie torrent au contact des cailloux.
3 Quelle icularité morphologique distingue les
Se os ncaa
“Gos d ln vie Gena Ie courant? oan
fh Etude d'un ruisseau : la Couze Pavin
“Stations 1 2 3 a 3 6 =,
‘Nombre de roo | 1265 | 925 | os | aaa0 5
lervesparm?
Bombrotoial | 1510 | 2135 | 2290 | 1015 | 10490 | 7250
Finversebres
9 Rekeut des lres de Chironome dans le sx stavons
Pees les nombreux relevés faunistiques quill est
deffectuer dans ce ruisseau, retenons
‘Bini des larves de Chironomes (figure 9).
BBD cee constatervous concemant Ia population
fotale dinvertsbres dune part, puis calle des lar-
es Ghronomes autre parle tong du cours
jeau?
Gomment variont-eles Yune par rapport a Yautro 7
Ee vous reporiant aux renseignements dannés
Ser les stations et dans le tableau 9, pouver-vous
fs donner une explication ?
Pail une autre maniere de présenter cos résul-
ats?
nN
‘are de Chronome
1 Une mire cours lent
D ~ GENERALISATION
AUX S
1. La végétation
Ta flore d'une rividre est composée de trois grou-
es principaux : les végétaux supérieurs, les
Mousses ct les Algues.
Que peuton die de leur réparttion, dans tes
Uvibres dapres los transects Ulgures 12 ot 13) ?
Ca repartition des végétaux superteurs depend
Surtaut du courant et de ia granulomeétrie,
IL Etude d'un ruisseau : la Cove Pov) cc
12 Tense de viva & cous rapiae | — Aubanier ram
2 Gyosne fount, 9 ~ Eodée du Canad.
4 fononoulttante. 8 ~ Myionnylc a feuiles ates
2 Fontnate (Mousse)? = Valsnena 8 —
14 nénundor
Dang les cours d’eau rapides et aux fonds éro-
és, la flore est peu variée : on trouve essentiel-
Toment des Renoncules et des Callitriches (voir
Livret pratique).
Elle est plus diversifiée dans les cours d'eau
ents et plus envasés : Polamots, Myriophylles,
Sagittaires, Elodées, Nénuphars (figure 14), et,
es Mousses (igure 15) forment un reveiement
Sur les roches, dans les zonos ombragées et les
‘courants rapides. Elles préférent les eaux douces
gt aces deel
La plupart des Algues sont microsoopiques
(Diatomées, Cyanophycées). Les Characées (vége-
15 Fonrale
12 ~ Potamot chvels
16 char
taux voisins des Algues) peuvent atteindre une
taille importante (Chara — figure 16)
a competion de la végéiation varie au cours de
Vannée
— Tes plantes a fleurs croissent surtout au prin
temps,
~ les Diatomées dominent en hiver,
= Jes autres groupes d’Algues se développent a la
belle saison.
Enfin, il faut tenir compte de la végétation des
ives dant la présence peut faire de Yombre et
tentrainer la disparition plus ou moins complete
de la végétation aquatique.
Ii Etude d'un ruisseau : la Covze Pov)
Tansec ire 3 cours lent 1
2= Butome en one 3 — Sc
Ga iedens 8 Pete des mar
7 ferips ampniie: 8 yosons des maa
B= Lentile d'eau 2 ros ites 10 ~ Caratopyle merge
Carex aigu
des mar
dans une rivigre des
Gu des végétaux. on Saperoit irs vite de
et de la variété de petits animaux.
Tous ont une taille comprise entre un
fet quelques centimetres. Ce sont
ment, des Vers plats (Planaires), des
annelés (Sangsues), des Aracl
‘et surtout des insectes (adultes ou lar-
(voir Livret pratique)
exptoo oxigo pour vivre des conditions
@ plus ou moins précaes *gronulomé-
~Genanthe itueuse
73
11 = Nénuphar: 12 = Renoneule uanguée 19 = Mier
Chitagna eau. [4 Myeoatylan 6p: 15 — Chara
(Algue] 16 — Bencude amohibe 17 — Fav» Nénuptar
1a” Sapttave. 19 ~ Utpevare. 20 ~ Lanuied
luseur aces 21 ~ Prience deau 2 ~ Carrside
19 Segitare
trie, vitesse du courant, pH, présence ou non de
vvegétaux.
Un prelevement de,cailloux, de vase ou de végé-
tax permet done dobserver une faune adaptoe
#chacun de ces micromilieux.
— we rors
1a river présente une faune dautant plus
D> viche que "ses caractiristiques “sont plus
Il Etude d'un ruisseau : la Covze Pavin
‘Rividroslentas, penta faible.
oxygens, tompératires < 20° Oxygenation et température variables.
eee Omniyores avers theres
‘Fonte en hiver dans les gravibres Ponte au printemps surles végétaux
20 cussiteatin ozonation dos res
22. cane des rts tancases
Dans une rividre, on distingue différentes zones
fondées sur des ‘parametres fondamentaux liés
entre eux :
— la pente et Ja largeur du lit qui déterminent
Ja vitesse du courant,
Ja température,
~ les conditions d’oxygénation.
On différencie de cette fagon deux types de rivie-
tes correspondant a la présence de deux faunes
Gominantes : les riviéres & Truites et les rivié-
res a Brochets.
‘Lo tableau 20 résume cos caractéristiques.
a carte des riviéres frangaises fournit des ren-
seignements utiles sur la classification des cours
dloau (igure 22. a ae
_—— IEE FORTE. E - CONCLUSION
{Une rviére est un milieu biologique cohérent. Yn cours d'eau est un miliew biologique tris varié
p> Saprotection et sa gestion ne concemment pas cen meme temps trs fragile. Pout imtervention
seulement Se vein mals aus Sur un point a des reperetssions, non seulement
fn ce point, mais sur tout Tensemble et en parti-
culier sur les communautés de aval.
14
A — LOCALISATION
“Ee Lacassou est un petit étang ant de
400 m: environ et dont ls profendour maximale
“Si de 3 m (figure 23). Il est situé & 30 km au
-Est de Clermont-Ferrand (figure 24).
‘Localisons le lac en altitude et étudions les rap-
Bars de Fetang avec lac Chambon.
“Etang se trouve a une altitude de 880 m. L’étude
iphique montre quill peut. communiquer
‘par intermittence avec le lac Chambon quand
‘eelui-ci déborde. L‘alimentation en eau de Tetang.
‘se fait donc par Ie lac Chambon mais aussi par
‘eau de fonte des neiges et par la nappe phréat-
que.
erature
‘Des rolovés faits au mois d'aoit ont permis de
|
| B — ETUDE PHYSICO-CHIMIOUE.
| éaliser le graphique de la figure 25.
‘Comment, pouves-vous interpréter le graphique
igure 25) 2°
. L'étang de LacaSSOU sues
A 23 LeLacassou,
28 Localisation do Fxg ou tacessou (1/1000,
YY. 2B Température oe Feeu dy Lacassou av mos 9008
75
jee se
profondeur én m
2,
eau en équilibre avec air ambiant, est saturée
‘en O», produit en majeure partie par les véegétaux
chlorophylliens (voir dans le chapitre « Relations
trophiques » : «Production primaire »)
En été, on constate une forte diminution de la
teneur en 0, vers le fond du lac ot elle nest que
de 10'%.. Cette diminution est due a Yactivité de
Bactéries et d’animatx.
3. Le pH
Pratiquement, neutre (entre 7 et 74), le pH du
Lacassou est influence par la qualité du sédiment
du fond, Tactivite des organismes et les apports
extérieurs (feuiles’mortes, eaux de rusolle-
4. Lalumiére
La quantité de lumiére absorbée par les eaux est
fonction de différents facteurs
= intensité, extrémement variable, de Véclaire-
‘ment en surface,
= diincidence des rayons luminoux,
= turbidité de Teau lige ala présence de sub-
stances et dorganismes en suspension.
A 7, CR A Le a eI
o 164 102 238
05 1 2 3
‘wdsdouce | wésdouce | douce | dure
2B ‘iseen eence cele dure ce eau
2B. carx dowd 28 Linsigrat
5, Dureté
On dit quune eau est «dure » lorsque sa teneur
fen sels minéraux dissous est élevée ; elle est dite
«douce » dans le cas contraire.
Expérfence : Mise en évidence de la dureté de
eau.
"Tale une solution de savon avec
g,jQgrammes de snvon rape ype avon de Mar
160 grammes dalcool & 902,
© 109.em! eau aie,
rélever 40 cm" deau A analyser, y ajouter peu
‘peu un volume que Fen mesurera de solution de
salvon (I cm 2 cin eto}
a Nagiter apres chaque adjonction de savon et
mesuror le volume nécessaire pour obtenit une
mousse persistante (plus dune minute)
Comparer vos résultats. avec’ ceux
tableau 26.
du
C - LA VEGETATION
Yétang, on sapergoit que la vegetation se répartit
plus ou moins nettement en différentes zones ou
ceintures de végétation. Les résultats des
observations sont donnés dans la carte (figure 31)
et le transect (figure 32).
Vétang est entouré presque complatement par
27 Jone dos toners
80 Poxamer
eur
une prairie humide constituée de Jons ot de Gra
mindes. Sur ia parse ouest. dans Ta zone plus
asso aul mot lo Lacasgou en Gomtmuntion
avec elac Chambon plusieurs Auines glutinewx
Sevsont installs. Cette espece support bien les
in Borda de Yétang, figure 27)
n bordure de Vétang, les Jones gure 27) et
leg Carex (igure 26) fotment une ceinture & peu
pies continu, Co ont des pana is para
1 car leurs thzomes et ours suches Abeuses
trts guzomnantes aesurent le mation des res
de ang et partion sn ombleme: En,
es exptces résistent. bien aux -variauons de
En compagnie des Carex et des Joncs, on trouve
Gqabumt des Piles des marais ot des Lamigree
tes tigure 25
La zone centrale est occupée par des plantes &
racines fixées dans la Vase du fond. Les feulles
ont fottantes ou submergées ot los ours a
Felsen a surfece ot a-desnus de Teas
a zone Potamots (igure 40) qul eomporte il en
plus du Potamat nageant,TElodée du Canada ove
Siyriophyile verticie (voir Livet pratique
est
— wee rorre.
1a répartition des autour dun étang
D> se fait en fonction de Phumidite et de la pro-
fondour.
76
WW Watang de Lacassou
Prairie humige
Noo 00
1000,
.
3
p
x
Xeon
we
an
oo Be
ones et Graminéos
‘Algve flamenteuse [WOY) Urrcuteie
a
Naricoe [ELEY cores Jones om
Lente eau (WW) Pte [EBGR] Aune glutineux
BI Corte dei wgétatin du Lacassou
82 Trancoot dy sacassou selon AB. 1 — Carox:-2 — Lanes /2 — Potamot 4 — Myiphylle 5 ~ Elodée. 6 Utieulsre
Ill, Vétang de Lacassou
1 sei
upharaie
133. Les cntures de wgstaton dun stang et el prame
‘wise Chara 2 — Céarophyln 3 — Potanet
Lennie desu 6 ~ Uineulaie 0 ~ Bods
2. Généralisation aux autres
Le Lacassou est un petit étang de montagne pau-
wre en végétation. Les élangs de plaine ont une
flore plus riche (figure 33}
A la limite de Yétang et de la prairie, dans une
zone peu profonde@), s‘installe un grand Carex.
Cette espéce est particuliérement favorable au
‘comblement des étangs car elle retient les parti-
cules de vase dans les toutes formées par la base
de ses feuilles (touradons). Un peu au-dessus on
‘trouve la Marisque, puis la prairie a Molinies. On
atteint ainsi le niveau maximal des eaux. A cette
hauteur sinstallent les Saules et les Aulnes (voir
Livret pratique),
De la rive vers le centre de Yétang, on peut distin-
uot les ecintures de vegetation suvantes@)
— La roseliére ou phragmitaie, caractérisée par
Ja présence du Roseau associé souvent aux Mas:
seties, Cette zone joue un role tes important
dans la protection des rives de létang. Blle sert
Sgalement de lieu de nidification pour de nom-
breux Oiseau ot de fral pour certains Poissons,
en particulier la Bréme et le Brochet.
= La scirpaie avec le Jonc des tonneliers dont
les thizomes fixent le sol.
= La nupharaie, Les Nénuphars sont des plan-
tes A rhizomes superficiellement enfouis dans la
ipsie
Ceinures de rétang @
78
Aoseleve
Prana mumise @
7 Nénuphar:8 ~ Mynophyle 9 = Jone des rannetiers
{= Moseetto 1 = Roseau 12 ~ Core
12 Mansque 14 ~ Mtns 15 ~ Aulne 16 — Saule
vvase. Cest ce niveau que se trouvent le Myrio.
phyile et 'Blodée, qui sont enracinés dans le sol
n'y rencontre également des Lentilles d'eau qui
flottent librement la surface et /Utriculaire
‘peu prés complétement immergée.
— La zone & Potamots. De nombreuses espéces
sont ici présentes dont plusieurs Potamots ainsi
que le Gératophylie,
— La charaie. Les Characées tapissent souvent le
fond des étangs. Ce sont des vegétaux voisins des
Algues.
D — LA FAUNE DE L'ETANG
Selon les méthodes décrites dans le Livret prati-
que, on a dénombré les animaux dans. huit
endroits différents autour du lac.
Ties résultats sont répertoriés dans le tableau 37
‘et labondance relative des individus est indiquée
par les signes :.R'~ iris rare; +
$4 = commun; +++
444+ = tris abondant
A quoi pouvee-vous attribuer les variations de la
fae des dilérentes stations?
I
|
| $38 ornate 3B Nive 36 tav0 ao Prigane
| 137 tpartion de taune
Gans ha tvonrt
lll Létang de Lacassou
40 Algue lamentesse Spioaye. 41 Algue miroscopiue Costérivm.
Daphne et Cycops
44, ats poncton, en eet an autre, dans sx pons de étang,
E — LE PLANCTON des; peu nombreuses 16, elles se développent&
Yautomne,
Le plancton est constitué d'organismes de taille Le zooplancton comprend_essentiellement des
generalement infériure & 02 mm qui vivent ct Houleres et ds Crustacé (Cadoctres et Copépo
lottent_librement dans eau. On distingue le des — figure 43). Il se nourrit de phytoplancton.
phytoplancton et Ie zooplancton.
Ee phioplancion est ‘constitué de dironts Ui tableau 44 donne los séultats do comptages
yroupes Algues = Algues vertes filamenteuses _effectués a deux époques de année.
(figure 40) ou unicellulaires et microscopiques.
(igure 41), Cyanophycées, Diatomées. Les Algues.
vertes ont une multiplication active lorsque les a emia
Conditions déclairement. sont importantes et que Soe ee eae eaaeyaina
Ta temperature stéleve au-dessus de 14°. Ce sont Biolog dt plasclon, abalyser et expliquer les
Jos conditions de Tete. Les Diatomées (figure 42) Variations salsonnisres de fa lore et ee la foune
‘au contraire préférent en général les eaux froi- planctonique.
hr be La ss, a a a a ee a
mp
Lae oligotrophe
‘© Eaux tansparentes
'@ Pau do mates nutri
1 Faucde fond bien onygénées
Lae eutrophe
9 Eoux vores & bends
‘© Beaucoup de matiéres nitves
‘8 Eaucde fond peu oygénses
tang on vole de combler
© Abondantevogétation de bordure
‘Marécage cu tourbidre
‘© Coloistion par des arbustes
Font
5 Fotuton nature dun ae
F ~ EVOLUTION DE L'ETANG
tang du Lacassou est un étang peu profond
Borde dune vegetation abondante, ou ies Insectes
ft les autres in Sont également. nom-
Ereux. Lo fond do Tetang est vaseux et surtout
frés peu oxygené. Ceci est da a une forte activité
Ges Hactéries ot des animaux consommateurs de
Shatires organiques. La faible teneur en O» nest
{as componsée par le mécanisme photosynthe:
Eque (voir dans le chapitre « Relations
‘ophiques 5 : « Production primaire »).
‘Toutes ces observations permettent de caractéri-
Ser cet étang. comme un étang de type « eutro
phe », cest-a-dire riche en matiére organique.
81
i ges eee en ete
ener aera
salar Saag em
Ieee areal cars
files Siteiee aera
—— wee Forte:
“Eévlution ctorgue ot naturale un ac ot
une
Ce phénoméne trés lent peut étre accdléré
D> cephénoméne pi tee sot pes
<échots (pollution).
Exercices.
@ EXERCICE 1
Po lu io ee at de septembre A ewier La True et le Saumon sont des Poissons migroteurs
Rin pour ka ras Pramldr catégone t do ever Ils sp déplacent vos leg sonreee See sera
jin pour les riviéres de deuxidme tategore, fen, puis redescendent vers dautres. tervals
Juin pour les rivigres'de do gor Banden ui
© Question eines
En vous reportant au tablet 2, justifee cote mesure, a
uelles sont daprés vous les mesures de protection &
‘rendre pour sativegardor ces dewx copéees F.
‘Le Brochet et la Porche sont des Poissons carnivores,
‘prédateurs d'autres Poissons
© Question
Quel peut bre leur rble dans une rividee ?
™ EXERCICE 2 |
Prue 0 2th 4 Pais 0 ant
ban f= :
eas
| Ee document ci-contre montre Yeffet de la pluie du
dots arin se
ats ee
Le ann tu an
Epp wrt aah di eae
, giioty Titus marin ant
Sarita rie oe
a _ Questions
ales f ante de pie ui est tombe sur chacun
nso comparda es bis cet hac
a
SIE ams fe rt gules ncn
ones sous true eaons tos Sones
a Gireulation de eau ?
15
Bassin do Paper, (bocage)
48 260 4 8 12 16 20 Memes
4 mare 1975 5 mare 1995 4 mars 1975
82
‘eaux douces
eee.
XERCICE 3 See ee nee
eee eon
re cs,
0. C0;
Dicnyle de carbone
© Question
Gis pouvertour dire de iolopique au
wenvou act e
eutrophe ?
a
‘La nutrition d'un Poisson.
‘Le schéma ci-contse montre les variations dabondance
de deux groupes de Gristacés des caux douces et Tac-
(roissement moyen d'une Carpe dans un tang.
© Question
uelles remanques pouves-vous fire
‘Surla biologie de ces deux Crustacés?
Sur fe mode de nutrition dela Carpe ?
"Planeton)
indus dans 100 cm
thn 1S hin TfL Spat Toth TS wat Tm TS
Les facteurs intervenan
des étres vivant
ns la répartition
FACTEURS
ABIOTIQUES
LES FACTEURS
Liensemble des conditions
atmosphériques qui régnent sur une
région définissent son climat.
Comment peut-on le caractériser ?
‘Quelle influence a-t-il sur les étres
vivants ?
|. Les principaux facteurs climatiques mm
d'une région
| sonore
| comme
ie
III oie rtm
11 Transect Sucd-Nord ou Masi Sar
2. eovesges température ctpreiptations moyennes mensulosdDammard dans lator de Fete
oe
A — OBSERVATION DU MASSIF
DE LA SAINTE-BAUME.
Que nous montre fa figure 1?
(On observe une dissymétrie et une variation dela
végétation sur les versants Sud et Nord, blen que
Ta nature du sol y soit identique. Ajoutons que les
conditions atmospheriques y sont différentes. Le
versant Sud est plus ensoleillé et chaud que le
vversant Nord, parfois nuageux et pluvicux.
we FORTE.
Les facteurs climatiques sont des éléments
tres im ui influent sur la répartition
des étres vivants, ici les wégétaux.
CQuels sont les principaux facteurs climatiquos ?
Ov/e rayonnément solaire. | conditionne Tin-
onsite et la durve déclarement d'un lou, ainsi
fe sa tomperature.
Me Ftumfdite Elle détermine la pluviosité ou
Tenpelgement
"le vent
B - COMMENT CARACTERISER
UN CLIMAT ?
Suivant I’étendue du territoire considéré, on parle
de macroclimat (une région), de_mésochimat
tune montagne) de microglimat (une foret). Les
facteurs du elimat peuvent tre mesurés (figure 2)
selon des méthodes décrites dans le Livret prati-
que. Toutatois, ils sont intimement liés, et ne
peuvent souvent étre interprétés isolément.
On les traduit graphiquement en construisant des
mes ombrothermiques et climati-
ques.
Le di we ombrothermique,
Gn porto en abscisse les mois de Yannée et en.
ordonnee
~ dine part, les précipitations mensuelles
CGxprindee Gn)
= dautre part, les températures moyennes men-
suellos (on degrés Celsius).
Léchelle des temperatures doit étre double de
celle des précipitations (figure 3). Dans ces condi-
tions, un mois est considéré comme sec lorsque le
total mensuel des précipitatons (en mm) cores-
pond au double de la temperature moyenne de ce
Les principaux facteurs climatiques d'une région Decacenerr a aD
+ Sion consdére que les mois possé-
ne de. 10° sont favo-
‘vegetation en tracant
ide 10°, paralldle a Yaxe des abscisses.
ea et comparez les diagrammes ombrother-
e'Dammard (igure 3) et de Montpellier
oonstruit en portant les températures
Tmensuelles en ordonnee, et les precip
jon abscisse (figure 8).
II. Influence des facteurs climatiques sur
la repartition de la faune et de la flore
os
y= Shine pedo
HEB nes tse cue} "3 = Shine sie
0 Chive pubescent
tat (ONie-vr, hee)
luence des facteurs climatiques sur la répartition de la faune et de la (or)
‘France
‘carte simplifige des essences forestiéres domi-
‘en France (figure 6) nous donne un certain
do renseignements.
constatons-nous ?
partion des essences west pas uniforme et
‘une localisation relative des espoces :
‘Les Hétres sont abondants au Nord et a YEst
[Les Chénes ont une vaste aire de repartition, &
de lauele on peut dlsngue deren
Se répartissent ainsi:
Sessile et pedonculé = centre do le
‘et bordure atlantique ;
sessile ot pubescent : centre - sud - Val-
das secteur pics, vrs
Pind Alop ae miéditerranéenne
ailanique
Pin maritime : région + Landes
Pin laricio : Corse
ivestre : montagnes et Champagne
s ‘picéas et Mélézes sont mt loclisés
semble done pas due au
extérieurs doivent Tinfluen-
7.
‘Gexpliquer la répartition des essences
Tempsratres et précittions dans quelques vies ancases.
forestiéres en analysant, ot on
ir deg. exigences climatiques des. arbre
peared pare figare 7 oe et coll des are
nées climatiques de quelques villes frangaises
autre part (gure 8
‘Les exigences du H@tre correspondent aux
conditions climatiques do Lille et de Brest.
— ‘Les Chénes ont des exigences variées suivant
les espéces, done une vaste ition generale,
‘Neanmoins, le Chéne ped le plus exigeant
en eau, a une Teprésentation plus limitée. Le
Chene vert, qui exige une température élevée, est
donc localisé dans le Roussillon et la zone médi-
terranéenne. Le Chéne sessile et le Chéne pubes-
cent, moins exigeants en eau, correspondent. aux
conditions climatiques de Toulouse.
bbaisses'cie température pendant un certain
toms, afin de pouvoir germer.Cest le phémo-
mene de vernalisation.
Les facteurs climatiques interviennent direc-
tement dans la vie des plantes et dans leur
cycle biologique.
Ill Influence des facteurs climatiques sur activité animale et io
23 Un baton
24 Gciedoviedu Bslonin
ml
a
Nympbes Lanes:
: DIAPAUSE g
B — CAS DES ANIMAUX
4, Le Balanin
Gomme, "bon nombre, JInsactes, le, Belanin
(figure 23) passe par plusieurs stades successifS
fa cours de sa vie Garve, nymphe, adulte). Mais,
durant Thiver. il y a un arret du développement.
fan stade larvaire, activité de animal ralentit
Gnormément, et les ec ‘respiratoires sont
Bratiquemer mule Gest Ie phénomene, de Ie
fiapause ({igure 24). Au printemps, Taugmenta-
tion de la durée du jour et la hausse de la tempé-
ralure ambiante « levent la diapause », et 'in-
Secte polit reprendre une activité normale.
2, L-Beureullspermophile
Gest um peti Mamie (igure 25) dont Yat
Mite est intense au cours de Fete. En particulier, i
rouse le sol afin daménager une galerie ou une
Chambre dans laquelle il passera Phiver & Tabri
es prédateurs. Cette chambre a un microclimat
particulier sa temperature y est constante (6) i
DY a pas de vent, ot Fobseunts y regne en perma
97
2B crew spermophie
2B carscives physiciogiques de cre spermophile au
Lorsque Thiver arrive, 'Boureuil pénétre dans sa
chambre'et se met en boule. 1 tombe alors dans
fond sommell et nese nourrit pas. Bien
quil se réveille quelques heures tous les quinze
jours, Cast ati printemps quil vetrouve une act
vite normale
Ta caractéristique de ce mode de vie est une acti
vvité eyelique, avec repos pendant lhiver, appelé
hibernation.
bservons able 26, Duran iver, PHeureui
tt poids, tandis quo sa temperature corp
Foie bale et que son Fythme cardiaque ralent
Pourquoi ?
En Gat hibernation, animal wise ses reer,
vyes, done maigrit. La baisse de temperature et le
ralentissement du rythme cardiaque sont en rel
tion avec sa faible activite. Les periodes de réveil
servent a élimination des déchets.
1 FORTE.
> ‘out, comme les ep aman ont
jes phases ‘sont en relation
avec les factours extern
Ill. Influence des facteurs climatiques surlactvittaimae i
2D tweoraten esEoureitcurantqoare andes sucessnes
‘Quels sont les facteurs qui déterminent et contré:
Tent co phénoméne ?
La figute 27 illustre Yactivité du Spermophile en
Captivite durant quatre années a une tempéra
tute constante de 23:
Qu nous apprend-elie ?
Tye toujours une activité ovlique avec hiberna
igh’ mais celle-c ost dacalee dans le temps et de
durée negate
ep motion clintigues ne sont pa sul
Saites pour expliquer le déclenchement du phé
Somene dhibernation, Ty a aussi des mécanis
Tes, interes. qui inierviennent ©. sont. des
écanismes hormonaux.
3, La Cigogne blanche
Get oiseau [igure 28) passe Tév6 en Europe (on
peut encore le-voir en Alsacel et Vhiver en Afrique
Gu Sud. Les Cigognes effctuent ainsi un grand
voyage. Certaines contournent la Méditerranée
pour atteindre Asie Mineure et lBaypte, autres
assent par le detroit do Gibraltar (gure 29). Ces
Voyages seflectuent toujours aux mémes saisons
Le depart est en alutomme, le retour au printemps
Auels sont tes facteurs qui peuvent ifluencer ces
dloplacoments ?
GaP sont los facteurs, climatiques, ‘els que la
temperature, les vents, la pression atmosphe-
que locale, ia photoperiod,
Cahsing aniinaune accumlent des résorves de
nose avant Te dpart, autres, au moment de
{Ei migeation, subsent des modifications co:
porelleg mternes et externes importantes
28. Senémadeismigsindes Ggosnes
IL y aurait done des facteurs internes particu-
liets qui détermineraient chez eux un état phy-
siologique précis qui les rendraient sensibles
‘aux conditions exidrieures.
_—— we FORTE,
Hibernation et migration traduisent inter-
JP action des facteurs externes et internes sur
Torgenisme de Fanimal.
‘Euudios le microelimat de la prairie.
© Question
Fouver-vous donner des expications sur les variations
‘de chaque facteur?
EXERCICE 2 nee eee
ae
Sees
© Questions
1, Quéstce quiine lairére? Quella peut étre son on
PP Localisee la dlaiiée Caprese document.
2t oe atieae doladiatig
1 Gino Gast Tar eonsequences toes sur la
E "Fates une reconstitution chronolagique des événe-
Tents qul so Sont ja deoules ou Gl se prediront
Tinie Punt ns inicio Gare
6 Les facteurs climatiques
m EXERCICE 3
Une expice d'Eseargot a deux modes de vie différents
‘eavernicole épigée,
{ine camectaiaiques de vie des deux groupes sont és
mdes Gans Te t2bleau crcontre (H.R = humiaité rel
tive
oroustecan ay
eC oeeee ss careciritqes clmiqies ch
‘milieu cavernicole ? =
Se ee tice cameo dos dons de
Be sees cfrnces observe
1 Gull ippotiése pourez-vous emettre pour exp
eee Pe a Te verse
eee
m EXERCICE 4
Document : Caractéristiques du climat monta-
ao press érique diminue ai fur ot
smesuip qus fon monterenalutuge. cect eatraine Jes
ivan des autes fetes cimatiques,
“Ste température Yar dane ‘de 05" colsns
pout 100
Pe titerence entre le mos le plus chaud ot le moi
{elplus trod setenne lorsqud fon seleve. Ele est
Ge Lyi a 8a0'm: 145° 1 800m: 138 82500 m,
iiss variations entre Te jour et la mat sont 15
importantes.
— 1a pluviosité avgmentejusqu’t $ 500 m mais
peutic tui duly secetess pests bese
Bind a iets a ma
tarrappos calle qu sobsere en
Pee Beige ove nro import car elle protege
div fold Bu gel tout ceequ ent auras du se
{Bkempte plans des combet 8 neg
ree rent! souvent local eat eb mporant,
= ifn fa-pas oublier enfin. Texpostion du ver~
Sante coe onsale (eu et le ete non enso
Tail (thao ot des mlorocinatscerents
@ Questions
aston a ager er oa
Eee eae =
Seer a
Se ce megs ot
ee cans mars
Ble ne tis mene
Soe a eS
FE ete nas abun
ieee ie pas ae
De
| 5. Les facteurs climatiques
|
(ml EXERCICE 5
5 courbes de gure | opésentent a variation de
‘emperature dune journée di mois de mat en miles
[découverte sous’ une chénaie-hétraie, Elles sont
Sccompagnées du tableay donnant Ia varaton vereale
ea temperature mayenne hebdomedaire en jullet
Le courte dela figutw'2 represome Tintenste de feclai-
Fement ecu aux diferente niveaux dune chenaie-
ARtzae Le tableau qui 'ccompagne donne Ia variation
Se Thumidtd relative moyenne a mois de jun,
© Questions
En rassomblant toutes ces données, prévisee quels
‘tiles joe la forét sur les facteurs cimatiques.
2 Ny orci pos une strte qu ove tn tle préponde-
fant
| Température en °C
»-
auteur au sol (on m)
8
5
‘
2
. Fs @ ae
element relat (on 8) 7
100}
o Chénsie beta
»
0.
0
wo.
0.
a
»
e Pinide
Ogre yt
ant Fa AW Sal ASO WD
us courbes de i figure 3 représentent Iélairement
rola au sol dans deux groupuments foresters volsing
(binéde et chénaie-hétraie) pendant une année.
© Question
Explquez les résultats observés.
La figure 4 donne les résultats des mesures de_la
vitesse dy vent relovées au fur et a mesure que Ton
‘Séloigne de la lisibre.
© Question
Que pouvez-vous en conclure ?
Toms
theutes une
Joumée de ma)
1
Erry 25%
101
L'importance des facteurs climatiques
ne doit pas faire oublier le réle capital
joué par le sol. Cest un lieu priviliégié of
se rencontrent, le monde organique et le
monde minéral, et par oi transitent les
substances élaborées par les étres vivants.
Sol ocilaux
|. Observations a propos d’un SO! sms
eee eee
1. Frotipsdolog.quaen
A - ETUDE D'UN EXEMPLE
Comme il Ta 6té proposé dans le Livret pratique,
realisons un profil pedologique dans la forét vos
gienne de Haye (figure 0)
Ge profil est-il homogéne ?
Gn distingue trols couches ou horizons de cou-
leurs differentes.
En nous approchant, observons chacune dente
‘La couche superficielle, ou horizon A, est peu
épaisse, de couleur foncée. En. surface, elle est
composée de feuilles mortes formant la litiere
plus on moins degradée et qui constituera Thu-
Imus, On y voit de nombreuses racines. A cette
tatiére vegétale ¢associent des cailloux ealeaires
(effervescence a acide).
~ La couche moyenne, ou horizon B, est brune,
dépaisseur variable. On my reconnaft plus de
debris vepotaux, mais seulement des racines. Les
cailloux caleaires sont plus nombreux.
S"Enlin, la roche-mere, ou horizon C, est ici
composée de calcaire on plaquettes. On y distin:
ue encore quelques racines.
104
2. Fenantiloncbson ag leupebinocule
— te rorre
>
‘Une analyse en laboratoire nous donnera des ren=
selgnements. complementaires intéressants sur
Tes constituants de chaque horizon.
Le sol est formé de différents horizons ayant
leurs caractéristiques propres.
B - TECHNIQUES D‘ANALYSE
DES CONSTITUANTS D'UN SOL
1, Observation a In loupe binoculare des échanti-
long prdlevés dans le differents horizons
areal et des elements, organiques
tGébris wegetaun et animaux) (igure2)
—— ee rorrE.
Le sol est formé d'une partie minérale et
une partie organique.
|. Observations & propos d'un sol
3 Métnode d'éaluation dela quant demmanére organique
4 cakimevede Bernard >
2, valuation de ta matiére organique contenue
ans Phumus dun sol parla technique de destruc-
Son
BOE 20 grammes dre sich eave 05 ot amis
Hien Virion spon te
SESE de fons onprnce') 20 volumes, pul super a
FPTTO ouumes stage camp fe Io
Tage tut rs enon ie est oo
und feu oes ence, on ea
ca
Siem
Ge or lnc en dla cops rpm su un ra
arnt asd capes apr suru rahe.
Eee ave sto user SoM le pas cto.
Bp iat a) = mate de mebire crane
3, Dosage du calcaire du sal
‘Bans un eacmtre de Bernard (igure 4) on mesure la gusntite
Ge dloxyde de carbone aézagée por Tattaque du alae avec
Facde chiohyarique
Gerse de Tea slee dans Tapparell pour vite a dissolution du
(60, dpa tl fat aiseer Auer Reglor cote eau au niveau O
is fpurtte produce fire calcier le veau de Tampoule
ses ibe rac
oar dslonner layparel placer 03 gramme de CaCO, dans un
Efeameyer vec ut pai fube de verre comerant 10 ml CL 3
fia W Beemer en A'et ager pour renverser le tbe UHC. Te
0, dégagé entrain une based nveau eau dans épro
sete ac Mia ata re psn com ane
Sproalpndatt ie pagent. Fompea
tee is aut ans apne tle tbe grade reset es
Mines: Bon te depgement fre lance du tune V de
Saag en vent ne concer les nau de ampoule
fe tee rade
clare tnd mesure avec éhantilon de sol dont a ase est.
Some ene 03 pet f bot Ml. Oo mesure ain Ve
volume de CO, dg
eile a sede CO, Ca dans 100 g déchanton On
sait qe | ml do CO, déggécomespond & 25 g de CaCO, Dans
Techantillon,on en déditquily & done
OB XY 4 docx,
Dans 100g de so, on ura
03 XV x 1005 ge cato,
VM
Pour le sol de la forét de Haye, les résultats sont
rassemblés dans le tableau 5.
Rappelons que la technique de mesure du pH est
deatte dans lo Livret pratiguo. a
||. Les propriétés physiques du Sol —_
6 sssmenaion
faconee sue
CObservion taoupe binocular des éments de
ural Trorton
7 Lesaitretes asses de texture
a0 gies en 20 [Appellation des difrentesclassos de texture
1
2
3
+
8
6
1
4
2
10, Lions sableue
1 Sables imono-ariews
Umons en 9
1 2 30 40 > 7 9 100
vente or rs de ies in pb arn mt it pn
Gui déterminent sa texture. Tataille des fis les lions et enfin les angles (gure 6
ni stata ete
imho" ceap deo inone G04 ns amas dass
5 anette ete w dus
Sue Fourie ah Ses:
Seneca
1 Ditermintion a mention facto ca a oy dum cm, de
Hoe Gg ora oo Et
ei ereier
seevain mide ceeag bane acne BGs cate alia
ee ee
‘Shiient un volume V. Ajouter 4 fois le volume V d'eau distillée, mode dassemblage des particules du sol permet
nes ie A See ie mdm den dlr ia ster.
106
Il. Les propriétés physiques du sol
be
Opalescent
(On peut réalisr la sme
‘expérionce avec humus.
seule a phase Aditi
100 mit eau Fiat {00 mi Na OH 4 g/t
+2 dargie +20 9 dthumu,
Phaso A Phase 8
Agitation Fitration
9 Mise en endence des coloies dso
‘Structure paticulire Structure glomérulire
|S Particles independantes (a Porvcues en agrégats (ar Particles
Vides Vides Pas de vides
Coles (iam) [=I Collies dispersés
10 Les cterents tyes srctore um so!
B — LA STRUCTURE DU SOL
“Lobservation de la figure 8 montre la présence de
‘Sembroux vides, délimités par des particules for-
ides agrégats ; los éléments qui lient les par-
‘entre elles. sont les colloldes. Gest une
‘Smucture glomérulaire. Les colloides sont repré-
par Vargile et "humus (gure 9)
— nee Forte:
Rie caialrena alae
ome ns Saal cee
renga rea alaaenene et
eine Te
ea aera ar
existe différents types de structures.
Aiférences observées portent sur la présence
Wabsonce de colloldes et la faon dont is som >
ion agrogats ou dispersts). Col crée des
‘ides occupés par Tair ou par Teau indi:
es la vc Gans te sl (igure 10)
107
Ill. L’eau dans le sol
1B eau dans eso
ETAT DE LAPLANTE
erarpu sot
ETATOE VEAU
A — LA PENETRATION DE L'EAU
analyse du tableau 11 montre que la vitesse de
penetration de Teau est dans un sol &
Structure glomérulaire. On dit. que sa i
its ost importante, La figure 10 montre quil
‘Sagit dun 30] avec de nombreux vides. On dit que
Sa porosite est grande. Elle est lige @ la struc-
‘ture du sol.
— ke FORTE:
Porosits ot porméabiite pendant des
> pies dus Els ret eouoment do
ar graviation.
Leau ne fait-olle que traverser le sol ?
B — LA RETENTION DE L'EAU
eau peut rester dans le sol.
Mais estelle toujours disponible pour Ia plante
Hl pst
fea peut Sassocier song
ux partcules du sol, Gost eau fixée, non ds-
fomibi,permettant de dir Te pont de Nets:
Soment de la plante,
‘Leau peut étre mobile entre les
fst alars utlisable par la plante
tile) Sila quantite deaw du sol est
‘ante, elle occupe tous les
‘ales et en chasse Tair.
si (Ge stade est dangeretx pour la
Plants carl ya agphyie ds races
‘capacité de rétention deau d'un sol dépend
cen fait de
mates ‘
fits ats defeat dane fe sl sont présen-
‘és dans le tableau 13.
108
‘|V. La température dU SO! sees
‘Température do ir
Température ata surface
dusol
“Température dans le so!
aon
—— Température dans le sol
shgem
Temps
Variation jurnare dela température deeauetdu so!
dans une praivede Havte-Savore
vrvons-nous ?
En surface, fa ti 4
le ult ella far etc as
_décalage dans le temps, En revanche, dans le sol
pout mesurer la température journaligre du” la température est Telativement. constante (on
a surface et en profondeur, logit pendant es variations annveles en
parons les quatre courbes de la figure 14. des saison).
. Influence des facteurs CU SO! sus
sur son peuplement
— REPARTITION ANIMALE EN
ON DE LA GRANULOMETRIE
deux courbes de la figure 18 représentent la
rition de deux espéces de Carabes en fonc-
de la taille des particules du. sol. Compa-
©, bien quirégulire, montre que les
se répartisvent sur Tensemble des si
"On pout observer trois sommets cor-
ndants aux sables grossiers, aux sables fins
mt argles, Cee espece est donc inifferente
jométre du sol
la courbe © montre que cette
cea une nette preference pout les Sos & ra
fie fine ou tres fine.
15 Répartion de dewxespbces do Caabes.
V. Influence des facteurs du sol sur son peuplement
Pa
3s]
4
4g
5|
55)
| Sable. Sol acide sec. pH-<4.
‘Sol caleare basique sec. pH>7. Bruyére, Calune, Gendt.
Genévrier Brome érgé, Brachypode
6g pens.
Groupement 1 eres
a
‘Comparison de dux grovpementsvigétouesur sols
"
16 Réparitin des Vrs
Aeterean tonction
tuphdelainre
Pied de mur arrosé durine
18 Grospamenisweoitauxparteviers
Ils sont formés de plantes différentes, qui po
sent spécifiquoment sur chacun des milieux.
B — REPARTITION DES ETRES
VIVANTS EN FONCTION plantes du groupement vogétal 1 sont
DU PH DU SOL celles du groupement végétal 2 sont calcifuges.
feria eek ean
i Cee a
Topattition de trois espices de Vers de terre en
fonction du pH u_sol : Lespoce 2 est indiffé COMPOSITION CHIMIQUE DU SOL
Femte: Tesptee 1 préfere les sols acides, alors que
Tespove 8 est plutOt inolérante aux pH acides. Certaines plantes sont toujours associées 8 un
fiche on nitrates : ce sont des plantes nitropl
les.
2. Répartition végétale ‘Dautres sont associées 4 un sol riche en sel : &
Observons les deux groupements du tableau 17. sont des plantes halophiles (figure 16).
110
VI. La faune du sol et SON O/C ut
4.19 Dispostifexpénmortapermettant disolert¢ mictaune de
lala
‘2D Larvesce Diptve() de Cokoptive 2lernymohe
Acer 8
A — METHODE DE RECOLTE
Afin de récolter la microfaune, on utilise le dis
sitif suivant inspiré de celui quinventa Berloze
(Ggure 19),
QI) Pourquoi retrouve-t-on la microfaune dans Falcool
‘aprés quelques houras ?
‘Au moyen dune loupe binoculace, on peut ainsi
determiner sommairement les ellérentes formes
Tencontrées.(volr Livret pratique) et faire un
Compage par categories.
B — LA REPARTITION DE LA
FAUNE DU SOL
1Los relevés faits a 10 heures du matin dans deux
Stations A et B ont donné les résultats suivants
figures 21 et 22)
BY) oueties remarques penton faire & propos, des
relovés dans Thumus des deux. stations (tenir
comple des donnees numériques) 21. Lamerotaune de deurstations
Comparex. los relevés de chaque station entre
Iitere et humus.
Comparer les relovés faunistiques entre les deux
stations.
—— EE ForTE.
Litidre et humus ont une faune abondante et
vvariée. Le sol forme un des écosystémes de la
biosphere les plus riches en organismes.
22. cracitsistques des dou siatons
11
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Biologie Cellulaire PDFDocument28 pagesBiologie Cellulaire PDFsambaNo ratings yet
- Culture MangueDocument12 pagesCulture Manguesamba100% (4)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- BiotechnologieDocument2 pagesBiotechnologiesamba0% (1)
- Chlorophylle PDFDocument10 pagesChlorophylle PDFsambaNo ratings yet
- L Utilisation de L ATP Par La Fibre Musculaire PDFDocument27 pagesL Utilisation de L ATP Par La Fibre Musculaire PDFsambaNo ratings yet
- Sujet Concour General PDFDocument1 pageSujet Concour General PDFsambaNo ratings yet
- Cours Carte GnetiqueDocument70 pagesCours Carte GnetiquesambaNo ratings yet
- M InterieurDocument7 pagesM InterieursambaNo ratings yet
- L'appareil UrinaireDocument25 pagesL'appareil UrinairesambaNo ratings yet
- Dosage GlucoseDocument2 pagesDosage GlucosesambaNo ratings yet
- Corrigé Bac S2 1999 (1) Actvite Musculaire PDFDocument2 pagesCorrigé Bac S2 1999 (1) Actvite Musculaire PDFsambaNo ratings yet
- Corrigé Bac S2 1999 (1) Actvite Musculaire PDFDocument2 pagesCorrigé Bac S2 1999 (1) Actvite Musculaire PDFsambaNo ratings yet
- Généralités Parasitologie 2O17 PDFDocument56 pagesGénéralités Parasitologie 2O17 PDFsambaNo ratings yet
- Cours Site - Diversite Et Stabilite Genetique Des Individus PDFDocument5 pagesCours Site - Diversite Et Stabilite Genetique Des Individus PDFsambaNo ratings yet
- Nutrition VégétaleDocument31 pagesNutrition VégétalesambaNo ratings yet
- Microbiologie Du SolDocument192 pagesMicrobiologie Du SolsambaNo ratings yet
- Comparaison de La Mitose Végétale Et de La Mitose AnimaleDocument1 pageComparaison de La Mitose Végétale Et de La Mitose AnimalesambaNo ratings yet
- Comment Les Gamètes Se Forment-IlsDocument5 pagesComment Les Gamètes Se Forment-IlssambaNo ratings yet
- Echanges CellulaireDocument4 pagesEchanges Cellulairesamba67% (3)