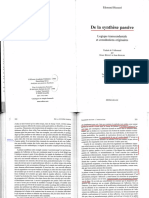Professional Documents
Culture Documents
Histoire y Verdad
Histoire y Verdad
Uploaded by
narratologia0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views15 pagesOriginal Title
Histoire y verdad
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views15 pagesHistoire y Verdad
Histoire y Verdad
Uploaded by
narratologiaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 15
Paul Riceur
Histoire
et vérité
Estil possible de comprendre l'histoire révolue et aussi de vivre —
et, pour une part, de faire ~ histoire en cours, sans céder &
esprit de systéme des «philosophies de histoire », ni se liver &
Virrationaité de la violence ou de l'absurde ? Quelle est alors la
vérité du métier d'historien ? Et comment participer en vérité a la
{che de notre temps ?
Tous les écrits de ce recueil débouchent sur ce carrefour dinter
gations. Ceux de la premiére partie, plus théoriques, sont inspirés
ar le métier dihistorien de la philosophie, que pratique l'auteur.
Dans la seconde partie, c'est a travers des thémes de civilisation
et de culture (le travail, la violence, la parole, l'angoisse, etc...)
que l'on siinterroge sur les chemins d'une unité qui ne soit pas
une synthase prématurée.
Paul Ricewur ~~ Histoire etvérité
‘Seuil | Esprit
| HF ISBN 2020025911 pring en Fane 84-11 | collection Esprit | Seuil
a =) AR
NEGATIVITE
ET AFFIRMATION ORIGINAIRE
cette méditation, une méme question pro-
gresse, Quelle et cette question? i est ifiele de Vénoncer
Sans préparation ; car ce n'est pas seulement la réponse, mais
Ja question elleméme qui sera progressivement élaborée. Tl est
plus facile de dire ce qui a suscité la question : le désir de voir
clair dans mes propres réticences & Végard des philosophies
Qui, depuis Hegel, font de Ia négation le ressort de la réflexion,
ou méme identifient Ia réalité humaine & la négativité ; le sen
timent que Hegel représente une coupure, une mutation par
rapport & l'ensemble des philosophies antérieures et que, pour-
tant, il est possible et nécessaire de récupérer une philosophie
du primat de Vétre et de Vexister qui tienne compte de facon
sérieuse de ce surgissement des philosophies de la négation,
Telle est, tr8s en gros, la motivation subjective de cette étude.
Mais ce n'est pas encore une question rigoureuse ; séparée de
ses approches, la question serait celle-ci : étre ail Ia priorité
sur le néant au ccur de homme, cestidire de cet etre qui,
luiméme, s'nnonee par un singulier pouvoir de négation? La
question ainsi posée, en bralant les étapes de sa propre élabo-
ration, parait abstraite; pourtant, on le verra, elle commande
tout un style pilosophique un ste ex « oul» et non un sxe
en « non >, ct, qui soit, un style en joie ct non en angoizce’.
Laissons done cette derniére question — que. nous ne connat-
trons que dans sa réponse méme — glisser A V'horizon et res-
i "y ail
A emi crdnel inteoge ue a négton jut sel n'y ak
an ginny ey dnt Pesce fa asi mF
Soman Nc po cee nigton al net foute Te pine, de
muon et la fat poaire ongionire? Mais cette question doit ere
‘ipeme pour mencr i ban celle qui ext Gabor dana cea pape
336
PUISSANCE DE. L/AFFIRMATION
serrons notre prise sur ce qui pourrait constituer un acs &
Ia question.
Par ot commencer? Par la réflexion méme sur Ia réalité
humaine. Nous allons tenter de déborder, par Vintérieur en
quelque sorte, V'acte de réfléchir, afin de. récupérer les condi-
tions ontologiques, en style de néant et d'étre, de la réflexion,
‘Mais que signific partir de la réflexion, de V'acte de réflexion ?
Cela signifie, plus précisément, partir des actes et des opérations
dans lesquels nous prenons conscience de notre finitude en ta
dépassant ; donc de la connexion entre une épreuve de finitude
et un mouvement de transgression de cette finitude, C'est 18 que
Rous trouverons la principale et fondamentale négation, celle
qui tient a 1a constitution méme de la réflexivité; l'épreuve de
finitude nous apparaitra impliquée dans un acte de dépassement
qui, & son tour, s‘exhibera comme dé-négation.
Ce moment négatif une fois dégagé, la question proprement
ontologique sera élaborée : la dénégation atteste-tlle un Néant
ou bien un Etre dont la négation est le mode privilégié de mani.
festation et d’attestation ?
1. FINITUDE ET DEPASSEMENT
II nous faut done établir cette proposition initiale : que Y'ex-
Périence spécifique de la finitude se présente d’emblée comme
une expérience corrélative de limite et de dépassement de
limite.
Cette structure paradoxale de Vexister humain doit étre
décrite comme telle et non brisée en deux; comme sion pou.
vait, dans un premier temps, mener & bien’ une description de
Yétreau-monde (par exemple dans la perception ou dans Vaffec.
tivité) puis, dans un second temps, amorcer le dépassement de
cet @tre-aumonde (par exemple par la parole ou le vouloir).
Dun seul mouvement, d'un seul jet, V'acte d’exister c'incarne
et déborde son incarnation,
Crest d’abord dans 'étrange et insolite relation que j'ai avec
mon corps et par lui avec le monde quiil me faut chercher le
noyau d'une expérience de finitude.
Par quels traits ma relation A mon corps et, par lui, au
monde dénonce-telle du fini? Je crois qu'on répond trop vite
en disant que la fonction de médiation du corps est comme telle
finie. A vrai dire, ce que mon corps se révele étre d'abord, c'est
337
\VERITE DANS L'ACTION HISTORIQUE
cine ouverture sur.. Avant d'étre la fermeture de Vhuitre dont
patie Piston et, plus forte raison, le Fombeau des Orphiques,
Beast ouverture, Bt cela de multiples fagons : ouverture du
besoin par quoi je manque du monde; owverture de la souf-
france elleméme par quoi je me découvre exposé au dehors,
oiler ss menaces, overt coe un Hane découvert: ower
ire de la pereeption per quoi je rego's Vautre; manquer ¢
fire vulnerable, recevolr, voila deja treis manitres irréductibles
entre elles d’étre ouvert au monde. Mais ce n'est pas tout : par
expression, mon corps expose le dedans sur le dehors ; comme
Signe pour autrui mon corps me fait déchiffrable et offert & la
amtualité des consciences, Enfin mon corps offre & mon vouloir
tin paquet de pouvoirs, de savoirfaire, amplifés par Vappren
tissage de Phabitude, excités et déréglés par 'émotion : oF ces
pouvois me fenden fe monde patcable, m‘oovent 2 Tuten
ie du monde, par les prises quils me donnent sur le monde,
vce nest done pas la fnitude que je trouve dabord mais You.
verture, Quels traits de cette ouverture Ia qualifent comme finie?
Estee seulement la dépendance au monde inscrite dans Vouver-
fure? Estee Te fait de manguer de.., de subir... de recevoir.
Gexprimer,, de pouvoir? Kant semblait Yadmettre tacitement
puiegu'll div nous autres, etres finis, pour désigner des étres
eit de produisent pas la réalite de leurs pensées mais la rego
sein phe oppose & un étre doté dune intuition originaire, au
rene Fe ceectrice, qui svaurait plus objet mais se donnerait
sere cr Voit (Enestand et non plus Geger-stand). Or il est
Giestite de tenir Te monde pour une limite de mon existence.
Ce quily a précisément de bouleversant dans le role médiateur
Ga dorpe cebt quil mvouvre sur le monde ; autrement dit, il est
Yorgene d'une relation Intenionnele dans laguelle 1e monde
rest pas la borne de mon existence mais son corrélat,
eee ee seabie alors quill faut chercher dans ouverture elle
éme un trait additionnel qui fait de mon corps une ouverture
nie pour rester dans Timage de Vouverture, il faut discemner
tn prinee Getyoltese une femeure dan Fourertor,w jos
dire, qui est précisément la fnitude,
Parmi lee cing exemples ouverture que jai donnés — man
quer de... subir recevotr, exprimer, pouvotr, le cas de la percep-
flon (ie Zecevoh) est le plus éclairant; on verra comment on
le genéraliser. ~ °
Pei anitude spéciale de Ta perception est lige ala notion de
point de vue. il est Temarquable que cette finitude, je la
338
PUISSANCE DE L'AFFIRMATION
remarque dabord sur Vobjet méme; je rebrousse ensuite de
objet vers moi comme centre fini de perspective. C'est en effet
sur Vobjet que j'apercois le caractére perspectiviste de Ia per-
ception; Vobjet est pergu d'un certain cété; toute perspective
est, au sens propre, unilatérale; on voit comment s'articule
Vunilatéralité du pergu et sa temporalité; c'est parce que je
wois chaque fois 1a chose d'un cdté que je dois déployer le Aux
des silhouettes oit 1a chose se donne successivement de ce cété,
puis de ce cété; et.ainsi 'inadéquation meme de la perception
comme étant toujours en route (et non pas sa seule réceptivité,
Ja réceptivité comme telle) m’annonce Ia finitude de mon point
de vue ; refluant en effet du pergu vers le percevoir — et plus
exactement vers Je percevoir comme incarné dans des organes
= ie forme Vidée de ma perception comme un acte produit
de que! ¢ part; non pas que mon corps soit un ew parmi
autres ; au contraite il est le « ici » auquel toutes les places
se référent, le © iGi » pour lequel toutes les autres places sont
labas. Je percois toujours la-bas mais d'ici. Cette corrélation
entre le ici du percevoir et 'unilatéralité d'un pergu constitue
la finitude spéc* que de la réceptivité. Ce n'est plus alors
seulement Vidée d'une intuition créatrice qui sert de contre.
partie & celle d'une intuition réceptrice dans Yopyosition infini-
fini; c'est Vidée sYautres points de vue corrélatifs ou opposés
au mien ; ici c'est le fini qui limite le fini ; nous verrons tout A
Yheure & quelle condition précisément. je puis mopposer un
autre point de vue.
Comment puis-je connaitre ma perspective comme perspective
dans l'acte méme de percevoir, si je ne lui échappe en quelque
fagon ? Crest ce « en quelque facon » qui fait toute la question,
Nous l'avons suggéré en passant : appréhender mon point de
Yue comme fini, c'est le situer par rapport & d'autres perspec.
tives possibles que j‘anticipe, en quelque sorte a vide. Cette
anticipation, je l'opére sur la chose méme, en ordonnant cette
face que je vois par rapport a celles que je ne vois pas mais
que Je sais. Ainst je juge de la chose méme en transgressant
la face de la chose dans Ia chose méme. Cette transgression,
Ceest Vintention de signifier, c'est le vouloirdite, le Meinen. Par
elle je me porte au-devant’ du sens qui ne sera jamais pergu
de nulle part ni de personne. Si je remarque maintenant que ce
vouloir-dire, ce Meinen, c'est la possibilité méme du Dire, il
apparait que je ne suis pas seulement regard, mais vouloir-dire
fet dire ; car des que je parle, je parle des choses dans
339
VERITE DANS L'ACTION HISTORIQUE,
eure faces non pergues et dans leur absence. Ainsi 'intention
perceptive finie, qui me donne le plein du percu & chaque ins-
fant, le présent de la présence, cette intention perceptive finie
nest jamais seule et nue; elle est toujours, en tant que pleine,
prise dans une relation de remplissement plus ou moins complet
4 Végard de cette autre visée qui la traverse de part en part, qui
la transit littéralement et & quoi la parole est originairement
lige. Le regard muet est pris dans le discours qui e articule
le sens ; ef cette dicibilité du sens est un continuel dépassement,
au moins en intention, de V'aspect perspectif du pergu ici et
maintenant. Cette dialectique du signifier et du percevoir, du
dire et du voir, parait bien absolument primitive et le projet
d'une phénoménologie de la perception, ob serait ajourné le
moment du dire et ruinée cette réciprocité du dire et du voir,
est finalement une gageure intenable.
‘Autrement dit, je ne suis pas entigrement défini par mon sta.
tut d’étreau-monde : mon insertion au monde n'est jamais si
totale que je ne conserve le recul du singulier, du vouloir-dire,
principe du dire. Ce recul est le principe méme de la réflexion
sur le point de vue comme point de vue ; c'est lui qui me per-
met de convertir mon ici de place absolue en une place quel-
conque, relative & toutes les autres, dans un espace social et
géométrique od il n'y a pas d'emplacement privilégié. Dés lors
je sais que je suis ici; je ne suis pas seulement le Nullpunkt
ais je le réfiéchis : et je sais du méme coup que Ja présence
des choses m’est donnée d’un point de vue, parce que j'ai visé
Ja chose dans son sens, par-dela tout point de vue.
Estil possible, maintenant, de généraliser cette dialectique
générale de la finitude et du dépassement ? Oui, dans la mesure
ou Yon peut retrouver un équivalent de la perspective dans
tous les autres aspects de la médiation corporelle : manquer
de..., subir, exprimer, pouvoir. Le caracttre spécifié et électif
du besoin est évident. Je suis également accordé sur un com-
plexe défini de menaces qui dessinent les contours de ma
fragilité et font de ma vie une fragilité orientée. L’affectivité
dans son ensemble me dit comment je me « trouve » au mond
cette Befindlichkeit est & chaque instant Y'opacité inverse: de
cétte lumitre qui commence avec la premitre perception claire,
Cest-i-dire, précisément, offerte, ouverte. Ainsi cette manigre de
= se trouver bien ou mal » confére au point de vue perceptif
tune épaisseur qui est la fausse profondeur de l'existence, la
muetie et indicible présence & soi du corps; le « ici » de
340
PUISSANCE DE L'AFFTRMATION
‘mon corps, manifesté par le sentiment opaque, vibre sur place ;
cette senstbilite « profonde » fait du corps autre chose que le
laisser-passer du monde, le laisserétre de toutes choses; le
corps n'est pas pure médiation, mais aussi immédiat pour
méme. Que le corps ne puisse étre pure médiation mais aussi
immédiat pour lui-méme, c'est 18 sa fermeture affective.
Ce méme facteur de fermeture nous le trouvons dans tous
les pouvoirs qui donnent prise au vouloir. Tout pouvoir est un
complexe de puissance et d'impuissance ; l'habitude opére méme
selon cette double ligne ; elle n’éveille des aptitudes qu’en leur
donnant forme et en les fixant; l'admirable petit livre de Ravais-
son sur I'Habitude serait tout entier A verser au dossier de
notre méditation sur la fermeture dans ouverture. Un pouvoir
qui a une forme, tel est le « Je peux »; en ce sens on peut
dire que le« Je peux >est la perspective pratique du « Je veux ».
Finalement on arriverait & résumer toutes ces notations sur
la perspective, sur V'immédiateté affective du corps a lui-méme,
sur les contours du « Je peux », dans celle de cavactére; un
caractére cest une figure finie (un caractére d'imprimerie) ; le
caractére c'est Vouverture finie de mon existence, c'est mon
existence en tant que déterminée, Mais afin de ne pas transfor.
mer ce caractére en une chose, il ne faut pas le séparer de
Vidée de point de vue ou de perspective; dans la nisi
la perception est la lumitre de Vaffectivité comme de Vactivité
— done du manquer, du subir et du pouvoir — c'est la notion
de perspective ou de point de vue qui explique le mieux celle
de caractére, parce que c'est elle qui nous rappelle que la fin
tude n’est pas une cloture spatiale, n’est pas le contour de mon
corps, ni méme sa structure, mais un trait de sa fonction médi
trice, une limite inhérente &’son ouverture, l’étroitesse originelle
de son ouverture.
Or ce qui a été dit plus haut de la « perspective » dans V'acte
de percevoir peut étre repris, mutatis mutandis, de toutes ies
manifestations de notre finitude : je ne puis en faire 'épreuve
que dans le mouvement qui tend & les « dépasser ». Puisje
éprouver quelque besoin, comme homme et non seulement
ommie béte, sans fommencer de évaluer, Cestadire sans
Yapprouver ou le réprouver, et donc sans prendre positi
a son égard? Immergé dans la souffrance, je suis ause! celui
qui la juge et la mesure & Yéchelle de biens plus précieux que
mon corps, de biens qui, peut-tre, me réjouiront au plus fort
de Ja douleur. Nous sommes ainsi renvoyés, par l’épreuve dv.
341
VERITE DANS LIACTION HISTORIQUE
besoin et de la douleur, du désir et de la crainte, & chercher
dans T'acte méme de vouloir le dépassement originaire de notre
finitude ; Tacte de prendre position pour évaluer fait apparaitre
Vaffectivité dans son ensemble comme perspective vitale,
comme vouloirvivre fini. Mais je ne le sais que dans le vou-
irdire et le voulotrfaire. :
we ersire analyse'a atteint ainsi un premier niveau : Ia notion de
limite appliquée & existence humaine a une double significa.
tion ; d'un cote elle désigne mon étrela fimité en tant que pers-
pective; de ‘autre elle désigne mon acte-limitant en tant que
Yisée de signification et de vouloir ; c'est mon acte comme limi
tant qui révéle mon étrela comme limité, 2 peu prés au sens
fou Kant disait que ce nest pas la sensibilité qui limite la rai
Son, mais la raison qui limite la sensibilité dans sa prétention
aa étiger les phénoménes en choses en soi.
2, LE DEPASSEMENT COMME DENEGATION
te analyse préalable terminée, il est possible de faire appa-
rats le probleme : que signifie Vindice de négativité qui sat-
tache au mouvement de « transgression » de la perspective par
Tintention de signifier et, plus généralement, de Ja situation de
finitude par la transcendance humaine ? ;
"Reprenons notre analyse réflexive de la perspective ; elle nous
fa paru s'insérer dans une expérience contrastée du signifier
et du voir; je pense la chose pardela cette perspective et je
saisis la perspective comme silhouette de la chose.
(it est ici la premiére négativité ? Dans 'opération méme du
Aépassement ; je ne puis dire ma transcendance @ ma perspec:
tive sans m'exprimer négativement : je ne suis pas comme
transcendance ce que je suis comme point de vue; sous forme
raccourcie et paradoxale : je ne suis pas ce que je suis. Mais
je macctde & cette expression radicale de ma transcendance que
par voie indirecte, réflexive : c'est sur la chose méme que
Yapercois le négatif eh quoi consiste ma transcendance, de
méme que, tout a heure, c’était sur la chose méme que je
comprenais ce que voulait dire point de vue, perspective, etc.
Crest sur la chose méme aussi que son sens se donne comme
signification « vide », comme visée a vide, que « remplit » plus
ou moins le plein de la présence ; la toute premitre négation,
je la trouve donc dans ce vide de fa signification, telle que Hus-
342
PUISSANCE DE L/AFFIRMATION
serl la décrivait dans la Premiere des Recherches Logiques : je
vise la chose comme n’étant pas selon ma perspective. 11 est
remarquable que la grande cuvre de Husserl ne commence
pas par la présence des choses, mais par la puissance de les
signifier : le comble de la signification, c'est alors celle qui
ne peut pas étre remplie par principe, c'est la signification
absurde ; je suis puissance de significations absurdes ; ce seul
pouvoir aiteste que je ne m’épuise pas dans une intentionalité
de présence remplie, mais que je suis double intentionalité
d'une part intentionalité néante, élan du signifier et puissance
du dire dans absence du cecil; d'autre part intentionalité
comblée, accueil du recevoir et puissance du voir dans la pré
sence du cecila; je sais gré a Husserl d'avoir commencé son
ceuvre, non par une phénoménologie de la perception, mais par
tune phénoménologie de la signification, dont I'horizon est la
signification absurde, sans remplissement possible.
Mais Husserl n'a pas tiré les conséquences de son analyse
Pour une philosophie de la négation. Ces conséquences n’appa-
raissent que lorsque Yon porte la premiére Recherche Logique
& la lumire des analyses qui ouvrent la Phénoménologie de
Esprit; la premiere négation dénombrée par Hegel apparait
dans I'écart de la certitude et de la vérité; le « cela est »
demeure la plus riche des certitudes et la plus pauvre des
vérités ; en effet dés que je veux dire cette plénitude de la
totalité offerte & la pensée, cette plénitude & laquelle rien ne
peut étre ajouté, il faut d'abord que j'annule dans Vuniversel
le ceci qui prétendait dire tout ceci dans un ceci; la vérité de
la chase, c'est d’abord noneci; de méme que l'universalité
du concept moi, c'est non-celui-ci. Cette analyse recouvre exac-
tement celle de Husserl lorsqu'il distingue la visée de la vision,
Ja signification de la présence; car c'est de la description phé
noménologique de la visée que Hegel fait surgir la négation;
la visée, dirons-nous donc est la non-vision ; le sens est le non-
point de vue.
Reportant sur l'acte méme de signifier ce que nous venons
de découvrir sur la chose méme, nous dirons done, comme plus
hhaut, mais avec Ja conscience d'avoir élaboré Ie sens de la
formule : je ne suis pas, comme transcendance, ce que je
suis comme point de vue.
. Ce que nous venons de dire de la négation du point de vue,
hhérente & mon intention de vérité, il est encore plus aise de
le dire de la dénégation de mon vouloir-vivre qui appartient &
343
ViRITé DANS L'ACTION HISTORIQUE
la constitution de mon vouloir proprement dit. Si prendre posi:
fion cest évaluer, évaluer clest pouvoir refuser ; c'est pouvoir
ne refuser et me repousser dans mon impulsivité instantanée,
Comme dans la coutume de moiméme que ma durée secréte
par un étrange et redoutable processus de sédimentation. Le
Pefus est ainsi ame militante de la transcendance du vouloir.
jolonté est nolont 5 a
veiortest was difficile d'en apercevoir les ramifications du cté
de Véthique | pas de vouloir qui ne repousse, ne désapprouve :
fa réprobation et la révolte “sont le surgissement premier de
Téthique comme protestation ; le démon de Socrate aussi res
tait muet quand il acquiescait ; il ne se manifestait que pour
opposer, pour dire non. : ‘
Sopponrs Fsjonté sans nolonté : ecla veut dire aussi que la
valeur exprime en creux ce qui manque aux choses quand un
youloir étend sur ces choses ombre de ses projets ; une analyse
wen négatif > de la valeur, rejoint ainsi, de facon inattendue,
fe que Kant a voulu dire en interprétant la raison pratique
comme la limite de ma désirabilité ; Yanalyse en négatif de la
Yaleur que font les modernes rejoint paradoxalement I'analyse
tn négatif de Vimpératif que Kant avait déja élaborée; le
motif en est le méme : le signe négatif est inhérent & Tobli-
gation (ou défense) comme a la valeur (ou manque), en raison
fnéme de la transcendance de obligation au désir, de l'évalua-
tion au vouloir-vivre. ;
Tl serait aisé enfin de montrer comment ce style de négati
vité qui caractérise tous les aspects de ma transcendance par
Tapport & ma finitude commande aussi toute anelyse possible
fe ma relation & autrui. Ce n’est pas étonnant : je ne trans-
bende mon point de vue qu’en imaginant ce sens vide de la
‘ose signifige, rempli par une autre présence, donné & un autre
{que moi ; imagination sympathique d'une autre perspective qui
jimite la mienne appartient & titre originaire & ma transcen-
dance. En effet je puis dire, dans les deux sens, que je ne
Jugerais point ma perspective comme perspective, si je n'ima-
ginais une autre perspective, — et que je n'imaginerais pas
tne autre perspective si je n’échappais & la mienne et si je
ne lancais vers l'objet pensé et non vu Kintention vide de le
signifier ; est ce savoir de V‘autre face que la perspective d'au-
trui, imaginée et non percue, vient remplir d'une maniére autre.
‘Ainsi mon pouvoir de me décentrer imaginativement dans une
autre perspective et celui de juger ma perspective comme finie
344
PUISSANCE DE L'AFFIRMATION
sont un seul et méme pouvoir de transcendance ; autrui ne me
limite que dans la mesure ot je pose activement cette exis-
tence; je participe imaginativement a cette limitation de moi-
méme; désormais Yaperception d’autrui fait apparaitre ma
finitude comme du dehors, dépassée dans un autre; mais elle
nest qu'un aspect — sous la forme ‘d'une imagination sym-
pathique tournée vers autrui — de ce pouvoir de transcendance
corrélatif de ma finitude. [1 n'est done point étonnant que la
position de existence d’autrui comporte le méme indice de
négativité que le mouvement de transcendance par lequel je
‘transgresse ma perspective : autrui est le non-moi par excel-
lence, comme I'universel est le non-ceci par excellence ; ces deux
négations sont corrélatives et, si Yon peut dire, co-originaires.
Et, parce qu’elles sont co-originaires, elles ont méme exten-
sion: tous les modes de transgression de ma finitude et tous les
modes de négativité qui les accompagnent ont leur double dans
un indice négatif qui affecte également imagination d'autrui. Pas
de volonté sans nolonté, disionsnous plus haut; et nous recon-
naissions ce creux > du vouloir, pardel mon simple vouloir
vivre, dans le « manque’> de la valeur ; mais ce « manque » ae
la valeur, ce déni du fait inhérent au devoir-tre, est expressément
corrélatif de la position d’autrui comme dénégation de tous mes
empigtements ; dans un langage proche de Kant : je n’échappe
& la perspective, non seulement de mon regard mais de mes
désirs, je n'oppose d’autves valeurs a mon ambition, qu’a tra-
vers limagination de l'existence-valeur d’autrui ; c'est sa dignité
qui met une borne & ma prétention & user de lui seulement
comme d'un moyen, d'une marchandise ou d'un outil; Vidée
d’humanité est ainsi le négatif de ma faculté de désirer, en
tant qu'elle est « la condition supréme restrictive de toutes les
fins subjectives ». Nous cisions que le vouloir n'est pas contenu
dans le vouloir-vivre, meis le contient ; cela est possible par
la médiation d’autrui comme limite de ma faculté de désire
je me limite moi-méme a travers la position de la perspective
et de la valeur d’autrui et cette limite appartient originairement
ala puissance de dénégation qui dresse ma propre transcen-
dance par-dela ma propre finitude.
Notre réflexion nous a conduits jusqu'au point ot Iacte
d'exister se découvre comme acte néantisant. Jusqu’a ce point ;
mais pas plus loin, Ce qui est en question, c'est le droit d’hypo-
2. Kav, Fondement: de la Métaphysique des Merurs, Ut section.
345
VERITE DANS L'ACTION HISTORIQUE,
stasier ces actes néantisants dans un néant qui serait, comme dit
Sartre, la « caractéristique ontologique » de etre humain, cest-
adire cette réalité qui s'annonce par le moyen de l'interroga-
tion, du doute, de absence, de Yangoisse, de la riposte pétri-
fiante au regard pétrifiant d’autrui. Je n'ai pas cru utile de
refaire ces analyses célébres du « négatif »; j'ai préféré partir
@’une réflexion sur la perspective dans la perception et le vou-
loir. Je pense avoir établi ainsi une base de départ suffisante
pour reprendre le probléme du fondement de Ja négation.
Je voudrais esquisser, sur cette base, une réjlexion sur ta
réflexion par laquelle il serait possible de récupérer, au coeur
de la dénégation, « l'affirmation originaire », comme dit M. Na-
bert, affirmation originaire qui s‘annonce ainsi & coup de néga-
tions.
3. LE DEPASSEMENT COMME NEGATION DE NEGATION
Il me semble que le premier stade de cette réflexion récu-
pératrice consiste & montrer que la dénégation n'est pas une
négation simple mais recéle implicitement In négation d'une
négation, Autrement dit la premitre ceuvre de la dénégation
crest de faire surgir comme négation premitre, avant elle, le
point de vue luiméme ; rétrospectivement je découvre que ce
qui est primitivement négatif ce n'est pas le sens par rapport
au point de vue, le dire par rapport au voir, la prise de position
évaluante par rapport au vouloir-vivre ; c'est le point de vue,
crest la perspective, cst le vouloir-vivre. C'est Descartes qui
avait raison lorsqu'll disait que V'idée d'infini était tout entiére
positive et identique & Iétre plane et simpliciter et que le fini
était en défaut par rapport a V'étre. « Et je ne me dois pas
imaginer que je ne concois pas l'infini par une véritable idée,
mais seulement par la négation de ce qui est fini, de méme que
je comprends le repos et les ténébres par la régation du mow
vement et de la lumitre : puisqu'au contraire je vois manifes-
Tement qu'il se rencontre plus de réalité dais la substance
infinie que dans la substance finie, et partant que j'ai en quelque
facon premitrement en moi Ja. notion de. 'infini, que du fini,
Cestadire de Dieu, que de mviméme. »
La réflexion complete, et en ce sens concréte, envelope non
seulement la certitude irrécusable du présent vivant, mais aussi
la vérité de ce présent vivant qui est, selon Descartes eacore,
« que je suis une chose imparfaite, incomplete et dépendante
346
PUISSANCE DE L'AFFIRMATION
d'autrui, qui tend et aspire sans cesse & quelque chose de meil-
leur et de plus grand que je ne suis ». Husserl ne dit pas autre
chose lorsqu’il parle de Vinadéquation de la perception, de la
possibilité permanente qu'une silhouette infirme la précédente
et qu’ainsi le monde comme sens soit détruit.
Mais aiors que signifie cette négation antérieure & la déné.
gation du penser et du vouloir, cette négation de finitude, si
Yon peut dire?
En disant que la négation convient & titre primaire & Ia fini-
tude et seulement comme négation de la négation au dépasse-
ment de la finitude par pensée et par vouloir, je ne veux pas
dire que la négation nait tout entire dans Vexpérience vive,
dans l'épreuve de la finitude. Sans doute vientelle de plus loin
encore, de la sphére méme de l'objectivité; car la négation est,
une parole et il faut bien la constituer dans le discours méme.
Mais, avant l'épreuve de finitude, il n'y a pas encore de néga-
tion radicale, il n’y a que la distinction du ceci et du ceci, c’est-
ardire non pas encore la négation mais. 'altérité : ceci est autre
que ceci. Du moins fautil accorder que la négation de finitude
présuppose la constitution préalable du langage négatif au ni-
veau du distinct, au niveau de V'autre, Cette constitution appar-
tient & une ontologie formelle, clestavdire aux catégories du
« quelque chose en général »; il serait vain de vouloir tout
tirer de l'existentiel, si l'objectif n’était pas déja constitué. Ma
these est donc limitée : avant la dénégation ou négation de
transcendance, il y a la négation primaire qui est la négation
de finitude ; avant celle ce que
Jes analyses antérieures nous permettaient seulement de nom-
mer des « actes néantisants* ».
ACES.
. Santas, L’Bire et le Néant, Ps
350
PUISSANCE DE L'AFFIRMATION
Sartre part de cette remarque, tournée contre Hegel, que
Vétre et le néant ne sont pas logiquement contemporains ct
quiil n'y a pas de passage de l'un & l'autre; V'étre ne passe pas
au néant et le néan? a V'étre ; Vétre est Vétre et jamais la néga-
tion ne mordra sur lui, puisqu'll faut le nier pour penser non-
étre. L’entitre et pleine positivité de I’étre est donc inentamable.
Reste done, si I'on veut rendre compte de « Yorigine de la néga-
tion », que le néant surgisse « au sein méme de W'étre, en son
ceeur, comme un ver.» (p. 57). Autrement dit, il faut que le
néant soit « donné en quelque facon, donné au cceur de Vétre >
(p. 58); si en effet Pétre exclut le néant et se pose méme sans
rapport avec lui, il faut qu'il y ait uni étre qui ait pour propriété
de « néantir le ‘néant, de le supporter de son étre, de 'étayer
perpétuellement de son existence méme, un étre par quoi le
néant vient aux choses », Parodiant et retournant un mot connu
de Heidegge:, Sartre l'appelle : « un étre en qui dans son étre
il est question du réant de son étre » (p. 59).
Comprenons bien ce que Sartre attend de son analyse : non
pas seulement un-ensemble d’actes néantisants qui, reconnait-i
lutméme, requerraiznt @ leur tour un fondement dans Vétre,
mais « une caractéristique ontologique de Vétre requis » (p.59).
Bref un néant et pas seulement un acte néantisant. La question
est bien la : est-ce que les nombreux actes néantisants que
Sartre décrit avec une virtuosité extraordinaire — depuis Vin-
terrogation, le doute, l'absence, V'angoisse, jusqu’a la riposte
pétrifiante au regard pétrifiant d’autrai — postulent un tel néant
d’étre comme caractéristique ontologique ?
Ce néant, source des actes néantisants, Sartre pense Je tenir
dans la liberté : « cette possibilité pour la réalité humaine
de secréter un néant qui l'isole, Descartes aprés les stoiciens
lui a donné un nom, c'est la liberté » (p. 61
‘A quoi Sartre faitil ici allusion ? A la liaison que Descartes
établit luiméme enitre le doute et Ia liberté. I est vrai que
Sartre omet de noter que, chez Descartes Iuiméme, la liberté
A laquelle le doute donne accés n'est que le « plus bas degré de
la liberté », quill appelle liberté d'indifférence. Quoi qu'il en
soit : dans cette liberté de doute, Sartre trouve le souvenir de
Yéroy} stoicienne, — ce « suspens » du jugement qui retire
Yame du sage au tumulte de ses passions — et annonce de
Yéroy4 husserlienne par quoi le mo: méditant se retire du tout
naturel, du tout fait. Ce geste de décrochage, d’arrachement, de
désengluement, ce « recul néantisant », Sartre le retrouve en
351
VERITE DANS L/ACTION HISTORIQUE
tout acte authentiquement humain; i rattrape ses analyses
anciennes de imagination qui néantit tout le réel au profit de
Yabsence et de Virréel ; il réinterpréte le temps pour retrouver,
entre le passé et le présent, cette coupure qui n'est pas un
obstacle mais vraiment rien; ce rien, cest précisément ma
liberté ; il veut dire que rien dans mon passé me me force, ni ne
me justifie : « la liberté, c'est V’étre humain mettant son passé
hors de jeu en secrétant son propre néant » (p. 66).
Ayant ainsi centré tous les actes néantisants sur le néant
comme liberté, il reconnait dans l'angoisse la conscience d’étre
ainsi néant de son propre passé en tant que liberté : « c'est pré
cisément la conscience d’étre son propre avenir sur le mode
du n’étre pas que nous nommons angoisse » (9. 69). On connalt
le bel exemple du joueur qui s‘était promis de ne plus jouer
et qui, devant le tapis de jeu, découvre l'inanité d'une décision
passée et dépassée; que rien ne V'empéche de jouer, c'est cela
3a liberté ; clest ce rien qui l'angoisse ; ainsi est récupérée pour
la conscience du néant comme liberté Vangoisse que Kierkegaard
‘Tattachait & Ja faute et que Heidegger découvrait sur la voie
‘de Vétre en tant quiétre.
Enfin ce concept de néant éclaire la fameuse thése de Vanté
riorité de essence sur existence ; si mon essence, c'est ce que
Je « suis été » — selon un expressif barbarisme qui traduit le
mot de Hegel — Wesen ist, was gewesen ist — le rien qui
sépare la liberté de tout passé, de tout acquis, est aussi le rien
qui met Vexistenve au-dela de toute essence : « essence clest
tout ce que la réalité humaine saisit ¢elleméme comme ayant
été » et V'angoisse est la « saisie du soi en tant qu'il existe
comme mode perpétuel d'arrachement & ce qui est ».
Nous n'avons pas & opposer & Sartre des objections spécu-
latives, mais, si possible, une meilleure description, — quitte &
nous demander ensuite ‘quels présupposés viennent interférer
avec la description et I'empécher de livrer son véritable sens,
selon nous.
La question que je me pose est celleci : un refus estil A
luiméme sa propre origine ? Une négation peut-lle commencer
de soi ? Nous allons faire porter la description sur deux points :
sur la relation de Ja décision & ses motifs en quelque sorte en
arritre d'elle, et sur le mouvement du projet en avant delle.
Réfléchissons sur ce rien » qui signale l'insuffisance de tout
motif & me lier c'esta-dire 4 me délier de ma responsabilité,
352
PUISSANCE DE L/AFFIRMATION
et & me fournir une excuse, un alibi. Ce « rien » a toujours
été reconmu : les classiques I'introduisaient dans la définition
méme des motifs, lorsqu’ils disaient quills inclinent sans néces-
siter. Qu'estce que cela veut dire ?. Nullement, me semble-til,
que la décision « s'arrache » au cours de la motivation ; je ne
Fencontre nulle part d’acte qui rompe avec Ia totalité des
incitations et des sollicitations de la conscience; je ne romps
avec la puissance de sollicitation d'un groupe de motifs que
parce que j‘acquiesce & d'autres motifs; la relation de la déci
sion aux motifs n'est pas une relation de rupture mais d’appui :
elle ne rompt ici que parce qu'elle s'appuie I; se décider, c'est
toujours se décider parce que... L'idée de refus n'est donc pas
la clé de ce « rien » qui fait linsuffisance des motifs. Qu'estce
donc? Ce rien n’apparait que si je projette mes motifs sur le
fond des choses et les interpréte en langage de chose c'est-a-dire
en termes de causalité physique; alors je dis : un motif n'est.
Pas une cause, Mais alors le néant n'est pas, dans mon acte,
entre motif et décision, mais dans ma réflexion entre cause et
motif, C’est Ia motivation qui tranche sur la causalité des
choses, mais non point la décision qui s‘arrache a la motivation
psychologique ; quand done jfinsiste sur le cdté négatif de la
liberté, je veux simplement dire que la détermination de soi par
soi est détermination par des motifs et non par des causes;
Cest le sens du : « incliner sans nécessiter »; la négation est
seulement dans la définition, non dans l'acte.
On objectera que les décisions authentiques ne s'appuient pas
sur..., qu’elles sont au contraire surgissement d'acte, innovation
gui « néantise » le passé en tant que donné. On tentera done de
faire des décisions subversives au sens propre, surrectives si l'on
peut dire, les décisionsmodales, les décisions canoniques.
Admettonsie et demandons & quelle condition nous pouvons
angantir notre passé en tant que donné,
Prenons le cas le plus extréme, celui d'une conversion qui aux
yeux de mes amis prendra figure de reniement 4 Végard de
tout ce que Javais jusquedla atfirmé et cru. A quelles conditions
les négations que j'oppose & mes anciennes convictions et A
Tensemble des raisons qui les soutenaient peuvent-elles m’ap-
paraitre & mes propres yeux comme dénégation, comme acte de
me déjuger, mais non point précisément de me renier? Si je
ne pense point m’étre renié, c'est que ma décision n'est point
Yuniverselle néantisation de mon passé ; une conversion, aussi
Tadicale qu'on puisse l'imaginer, n'a pu néantir un passé mort
353,
VERITE DANS L'ACTION HISTORIQUE
ue pour se trouver et se susciter en arritre d’elleméme un
pry te rues ot ec ae ale
€omme une mutation de figure dans mon passé, faisant de la
forme le fond, du fond la forme; et ainsi je ne dénie une part
de moiméme que parce que j’en assume une autre. Ce mot
méme « dassumer > n’est pas étranger au vocabulaire existen-
tialiste; il marque le retour en force de l'affirmation dans une
Philosophie de la négation ; par cette assomption, je me con-
tinue moiméme & travers les « crises » les plus radicales de
existence ; une conversion n'est pas une conscience d'ampu-
tation ; j'ai plutdt conscience de libérer en moi ce qui restait
inhibé, refusé, empéché; j'ai seulement renié des entraves,
nié des négations; ainsi, & coup de négations et plus profon-
dément que tous mes refus, j’ai pensé, en me convertissant,
constituer une meilleure suite de moi-méme, une suite plus plei-
nement affirmative. |
‘Ce que nous venons de dire de la dénégation en relation avec
le passé nous améne nous retourner vers l'avenir et & consi-
dérer la décision comme projet. Crest ici que le primat de la
négation dans la liberté parait puiser toute sa force. Car qu‘est-
ce qu'un projet ? n’est-ce point un événement qui manque aux
choses ? comme étre de projet, ne suis-je pas celui qui, selon
Timage percutante de Sartre, opére une sorte de décompression
dans le plein des choses! La valeur n’est-elle pes ce manque, ce
trou, que je creuse en avant de moiméme, pour Je combler
par des actes, au sens ott Yon dit que l'on comble un veeu,
que l'on remplit son programme, que Yon accomplit une pro-
mmesse ? | ;
Que le projet ait ce sens négatif, que la valeur soit ce qui
manque au dong, cela est bien vrai et l'analyse sartrienne
appelle non une réfutation, mais une sorte de reprise critique
qui la justifie en Ia dépassant. z
TL me semble quill est possible de montrer que, en toute
contestation du réel par quoi une valeur surgit dans le monde,
lune affirmation d'étre est enveloppée. Tl me semble qu'on peut
Je montrer par une analyse des attitudes valorisantes en appa-
rence les plus « néantisantes », telles l'indignation, la protesta-
tation, la récrimination, la révolte.
‘Quiest-ce que se révolter ? Crest dire non, sans doute : non,
je ne tolérerai plus, je ne supporterai pas davantage. Mais V'es-
Clave qui se révolte contre Ie maitre ne nie pas seulement le
maitre, il affirme qu’il a raison ; comme Je disait si justement
354
PUISSANCE DE L/AFPIRMATION
Camus, sans en epercevoit toutes les implications métaphy-
siques : « En iuéime temps que Ja répulston & Végard de Yintrus,
ily a dans toute révolte une adhésion entiére et instantanée
de Vhomme une certaine part de lui-méme » et il ajoutait :
« toute valeur n'entraine pas la révoltc, mais tout mouvement
de révolte iavoque tacitement une valeur ». Adhésion, invoca-
tion, mots suprémement positifs. Dira-t-on que l'objet de l'adhé-
sion, c'est précisément ce qui nest pas, puisque cette part de
luiméme que Tesclave éleve a la face du maitre n'a point de
place en ce monde ? Cette part n’a point de place dans le donné,
dans l’étrela, mais V'adhésion qui fomente la révolte est lattes:
tation d'un « je suis » par-dela l'étre-donné, un « je suis » stric-
tement égal A un « je vaux ». Liadhésion va droit & lexistence-
valeur, & la digmité, laquelle n'est pas seulement absence au
monde, mais tension d’étre; le veu que « autrui soit » y est
simplement abrégé dans un « cela est & faire »; ainsi le « &
faire » de la valeur et le « quill soit » de Vexistence dautrui
sont strictement réciproques.
I me semble dés lors que nous ne pouvons plus tenir la
valeur comme un simple manque, si elle est I'aétive position de
Vexistence d’autrui, comme corrélative de la mienne. Par la
valeur je me dépasse en autrui. J'accepte quill soit, afin que
moi aussi je sois, que je sois non seulement comme un vouloir-
vivre, mais comme une existencevaleur. Je ne dirai donc pas
que la valeur est manque, mais que la situation, comme scan-
daleuse, manque de valeur, manque & la valeur. Ce sont les
choses qui ne valent pas et non pas.les valeurs qui manquent
détre.
Cette discussion n’a pas été vaine : si 'existentialisme privi-
Iégie le moment du refus, du défi, de 'arrachement au donné,
du désengluement, c'est que d'une part le moment de néantisa-
tion du donné est toujours obscurci par une volonté coupable
annihilation d’autrui; mais la réflexion philosophique est
purifiante en ceci qu'elle discerne le noyau d’affirmation der-
igre la colére, et Ia générosité derritre Vimplicite volunté de
meurtre; dautre part le moment d'existence-valeur d’autrui,
qui est me du respect, est toujours obscurci. par une ten-
dance mystifiante & cacher cette affirmation sous le manteau
des abstractions solennelles : justice, liberté... Mais la position
de I'existence par l'existence, de existence de l'autre comme
condition de mon existence pleine et entire, ne me condamne
pas & une philosophie des essences mais m/oriente vers une phi-
355
q
VERITE DANS L/ACTION TSTORIOUE
losophie de Tacte d’exister. Lillusion de l'existentialisme est
double : il contond la denegation avec les passions qui Venfer-
‘ment dans le négatif, il croit que l'autre alternative & la liberté-
néant c'est 'étre pétrifié dans l'essence. .
Faisons le point, & ce stade de notre réflexion récupératrice
affirmation, au sein méme de la réflexion néantisante. Nous
avons dit d'abord :-le pouvoir de dénégation de la conscience
est une négation au second degré; c'est une négation de néga-
tion; le néant de finitude étant le néant de premier degré. La
possibilité de retrouver une affirmation dans la dénégation était
ainsi ouverte par cette analyse. Puis nous avons dit : en fait
‘on peut toujours retrouver une affirmation implicite aux néga-
tions les plus virulentes de la conscience : rupture avec le
passé, entrée dans l'avenir par la révolte. Fautil aller plus
loin ? Peut-on montrer ia nécessaire subordination de la néga-
tion & affirmation ? Autrement dit l'affirmation ac-elle valeur
de fondement ?
5. UIAFFIRMATION © ORIGINATRE »
Crest done le caractére originaire de Vaffirmaticn qui est en
jeu. Ii me semble que si.cette voie parait bien souvent barrée
Crest parce qu'on se donne au départ une idée étroite et pauvre
de Yétre, réduit au statut de la chose, du donné brut, — ou de
Vessence, elleméme grossiérement identifiée & quelque para-
digme immuable et sans relations, comme I'ldée platonicienne
interprétée par les « Amis des Formes » que Platon précisément
combat dans le Sophiste. Ce point est clair chez Sartre : c'est
sa notion de V’étre en soi, qui sert de repoussoir a sa notion
du néant, qui est trop pauvre et déja choséifiée; & partir de ce
moment, le néant que la réalité humaine est a elleméme, n'est
pas néant de tout l’étre, mais de lé choséité qui envahit- mon
corps, mon passé, & la faveur d'une sorte de tassement, de sédi-
meutation, de rechute au sommeil du minéral si Sartre a pu
ainsi pratiquer une sorte d’hypostase de Yacte néantisant dans
un néant actuel, c'est qu'il a préalablement rabattu l’étre sur le
donné, sur le mondain hors de moi et en moi; dés lors ‘tout
ce quill a démontré, c'est que pour étre libre il faut se cons-
tituer en nonchose ; mais non-chose n'est point nonétre;
nothing is not not-being; c'est ici, & mes yeux, le point difficile
de sa philosophie, sa philosophie du néant est la conséquence
356
PUISSANCE DE L'AFFIRMATION
d'une philosophie insuffisante de l’étre; en particulier toute
sa théorie de la valeur est grevée par cette conception pauvre
de Yétre; si Vétre est le donné brut, la valeur qui atre en
quelque sorte le donné, qui introduit du devoirétre dans Vétre,
ne peut plus étre que lacune et manque ; toute possibilité de
fonder les actes néantisants dans uné affirmation supérieure est
exclue sous peine de retomber l'engluement initial; rétre
ne peut plus étre recours, mais pige; glu, mais non élan et
fondement ; la valeur doit tirer son étre de son exigence et non
son exigence de son étre et il ne reste plus qu’a s‘en remettre
au néant de la liberté pour faire exister la valeur comme valeur,
« du seul fait de la reconnattre comme telle » (76); « en tant
quétre par qui les valeurs existent, je suis injustifiable » et ma
liberté s'angoisse d’étre « le fondement sans fondement des
valeurs » (ibid.).
és lors ne faut-il pas procéder en sens inverse ? Au lieu de
fermer & lavance notre idée de Vétre, de Ia refermer sur une
notion de V'en-soi tout entiére batie sur le modéle de la chose,
demandons-nous plutét ce que doit étre Vétre pour qu'il soit
Yame de la dénégation, du doute et de la révolte, de l'interro-
gation et de la contestation.
Le bénéfice d'une méditation sur le négatif n'est pas de faire
tune philosophie du néant, mais de reporter notre idée de l’étre
par-dela une phénoménologie de la chose ou une métaphysique
de essence, jusqu’a cet acte d'exister dont on peut dire indif-
féremment qu’il est sans essence ou que toute son essence est
exister. Mais cette affirmation estlle une affirmation néces-
saire?
La philosophie est née avec les Présocratiques avec cette
découverte immense que « penser » c'est penser Vétre, et que
penser ('étre, c'est penser I'épi au double sens de commence-
ment et de fondement de tout ce que nous pouvons poser et
déposer, croire et mettre en doute. Anaximandre, le premier,
sion en croit les doxographes, I'a vu : « Tout, en effet, dit
Aristote (qui semble ici avoir sous la main un recueil de textes
présocratiques), tout en effet, ou est principe ou vient d'un prin-
cipe ; or il n'y a pas de principe de Vinfini; ce serait en effet
sa limite. » Et encore : « il n'a pas de principe, mais c'est Tui
qui parait étre principe des autres choses et les embrasser et
les gouverner toutes » (Physique III, 213 b; ef. Diels, Vor-
sokratiker, fgmt A 9 et A 15). L'idée de quelque chose qui fait
commencer le zeste sans avoir soiméme de commencement met
387
VERITE DANS L'ACTION HISTORIQUE
tun terme & cette régression sans fin dans les générations des
Gieux de la mythologie. En méme temps on peut trouver dans cet
archaisme philosophique deux traits décisifs pour notre médi-
tation. D'abord la conviction que cette ‘\g4, ce principe, est
woos et vo}, « ordre » et « justice »; ce principe en effet
est la racine commune d’intelligibilité du physique, de Véthique
et du politique. Ce que nous prenons pour une confusion entre
le réel et Pidéal, entre le fait et 1a valeur, est Ia conviction que
Yontologie, sous peine de se casser en deux, est la racine com-
mune de l’étre au sens du donné, et de Vétre au sens de la
valeur. Le second trait qui nous importe est que la méme médi
tation sur I'épy4 fonde la négation sur le sol de V’affirmation.
Le Premier, dit Anaximandre, ne comporte pas les déterminations
de ce qui vit aprés le Premier ; il est nonceci, non-cela, préci-
sément parce qu'il est, purement et simplement; ainst Ider
des Présocratiques, est ter, iblimitée, in-déterminée, ines-
sentielle; le mouvement de la négation est secrétement animé
par laveu de I'épy}. Xénophane a su le premier en tirer la cri-
tique de 'anthropomorphisme dans la représentation du divin ;
pour nous le dieu n'est plus beeuf ou homme ; il pourrait étre
essence ou valeur ; la critique est la méme.
Le cantus firmus de V’étre et de la pensée de l’étre se poursuit
des Grecs & nous, plus fondamental que les différences d’école.
Peu importe que Parménide ait tenu le « (il) est »— que la déesse
lui découvre au terme de son voyage par-dela Jes portes du Jour
et de la Nuit — pour une sphére physique; peu importe que
Platon ait appelé Bien ce qui donne aux Idées d'étre connues
et d'exister ; et qu’Aristote l'ait appelé « V’étre en tant qu’étre >.
Tous, du moins, ont défini "homme par cet acte quills appellent
watiy ou gponiy — penser, méditer ; pour eux Vaffirmation de
Yétre fonde existence de l'homme et met fin & ce que Parmé-
nide appelait « Verrance », cestadire, pardela l'erreur, Ia
condition d’errance.
Mais, dirat-on, ne puis-je pas interroger encore et toujours
et poser la question de Vorigine de Vorigine ? Cette seule possi
bilité n’attestot-elle pas que I'homme est cette interrogation
Sans fin, capable de mettre en question et de néantiser la posi-
tion méme d'un principe de V’étre? Plotin a connu ce genre
de vertige et en a démontré le faux prestige : quel est le principe
du principe, demandonsnous ? Cette question n’est pas une
question sans réponse, ce nest pas une question du tout. La
notion du Premier est I'extinction méme de la question de lori-
358
PUISSANCE DE L'APFIRMATION
ine du Premier. Dans le Traité 8 de la VI Ennéade sur la
iberté de I'Un, il dit, comme Anaximandre hutt siecles avant
lui : « Demander sa cause, c'est Iui chercher un autre principe ;
or le principe universel n'a pas de principe »; puis, cherchant
& percer le motif de la question, il le voit dans une illusion
spatialisante qui ferait surgir 'étre comme dans un trou anté-
rieur qu'il viendrait boucher ; cest cette venue d'un étranger,
hhantant soudain son absence préalable, qui suscite la vaine
question de son origine (Enn., VI, 8, 11). La philosophie s'a
nonce ainsi comme la pensée qui supprime le motif de I'aporie
de Vetre.
Ce devait étre le mérite inestimable de Kant de confirmer que
la pensée est pensée de I'Inconditionné, parce quelle est la
limite — Grenze — de toute pensée par objet, de toute pensée
phénoménale, animée par la prétention de la sensibilité. Par
la Kant ramenait 4 V'intuition d’Anaximandre : V'étre est ori-
ginairement dialectique : déterminant et indéterminé. C'est par
cette structure dialectique qu'll éteint Yinterrogation concernant
son origine et fonde la possibilité d'interroger sur tout le reste.
Siil en est ainsi, nous pouvons considérer tout notre itinéraire
fa partir de son acte terminal et fondateur. Il me semble qu'une
philosophie de I’étre qui ne s'abime pas dans une métaphysique
de essence, et encore moins dans une phénoménologie de la
chose, est seule capable de justifier et de limiter en méme temps
le pacte de la réalité humaine avec la négativite.
Diun cété Vaffirmation originaire doit se récupérer par la
négativité, parce que mon incarnation joue globalement le role
dobturateur ; elle est la tentation de la dissimulation du fonde-
ment ; la tentation seulement : non la faute. Le sens de l'incar- .
nation demeure ambigu : d'un cété mon corps mrouvre au
monde, & la réalité dans son ensemble; mais, en méme temps,
il me suggere de me définir par mon étrea, par mon étre au
monde; cela méme qui m’ouvre au donné, me dissimule 1a
pensée de l'origine. C'est ce que ‘Kant appielait la « prétention »
(Anmassung) de la sensibilité. L’affirmation originuire est ainsi,
par ma faute actuelle, originellement perdue. Cest un point que
Heidegger a montré avec force : Ja dissimulation de la non-
vérité fait partie de Vessence de la vérité. C'est pourquoi la
négativité est le chemin privilégié de la remontée au fondement ;
est pourquoi il fallait tout ce complexe cheminement : décou-
vrir la transcendance humaine dans la transgression du point
de vue et la négativité dans la transcendance; puis découvrir
359
VERITE DANS L'ACTION HISTORIQUE
dans cette négation, une double négation, la négation seconde
du point de vue comme négation primaire ; puis découvrir Vaf-
firmation originaire dans cette négation de la négation.
‘Mais la méme réflexion récupératrice qui justifie une philoso-
phie de la négativité en montre aussi Ja limite : le caractére
dissimulé et perdu de la question de Tétre fait que je dois
miarracher & I'étant par néantisation, mais aussi que je puis
apercevoir cette négativité de homme sans son fondement dans
Yétre, Une philosophic tronguée reste possible. Cette philoso-
phie tronquée, c'est la philosophie du Néant ; mais c'est seule
ment Ja philosophie de la transition entre étant et étre. Toutes
les expressions sartriennes — arrachement, décollement, désen-
gluement, recul néantisant — témoignent avec génie de cette
Philosophie de la transition ; la néantisation représente la moi-
tié d’ombre d'un acte total dont Ia face de lumiére n'a pas été
dévoilée; c'est pourquoi une expression telle que : étre son
propre néant est finalement dénuée de sens. Plotin parle en
apparence le méme langage de la « néantisation » lorsqu'l
décrit 'ame ensorcelée par la fascination de son corps et qu'il
résume Tapproche de I'Un dans I'héroique précepte :
+ Dida wives aote — « supprime tout le reste » ; mais les mémes
mots rendent un autre son, parce qu'lls sont pris Yans le mouve-
ment de l'affirmation (Enn., VI, 8, 21).
Sans doute est-ce le mérite des philosophies de la négativité
depuis Hegel de nous avoir remis sur Je chemin d’une philoso-
phie de I’étre qui devra décrocher de la chose et de essence.
Toutes les philosophies classiques sont & des degrés divers des
Philosophies de la forme, que ce soit de la forme comme Idée,
ou comme substance et quiddité. La fonction de la négation
est de rendre difficile la philosophie de I’étre, comme Platon, le
premier, I'a reconnu dans le Sophiste : « Vétre et le nonétre
nous embarrassent également ». Sous la pression du négatif,
des expériences en négatif, nous avons & reconguérir une notion
de Vétre qui soit acte plutot que forme, affirmation vivante,
puissance d'exister et de faire exister.
Laissons une derniére fois la parole & Platon, par la bouche
de I'Etranger du Sophiste : « Eh quoi, par Zeus! nous laisse-
ronsnous si facilement convaincre que Je mouvement, la vie,
Yame, la pensée n'ont réellement point de place au sein de
Yétre universel, qu'il ne vit ni ne pense, et que, solennel et
sacré, vide d'intellect, il reste la, planté, sans pouvoir bouger ?
— Leeffrayante doctrine que nous accepterions 1, étranger. »
360
NOTE SUR
LORIGINE DES TEXTES
« Objectivité et subjectivité en histoire » est le texte d’une
communication aux Journées pédagogiques de coordination
entre Tenseignement de la philosophie et celui de: Uhistoire
(Sevres, Centre International d'Etudes Pédagogiques), déc. 1952.
« Lhhistoire de la philosophie et 'unité du vrai », d’abord
publié en allemand dans offener Horizont, Mélanges en L'hon-
neur de Kart Jaspers (Piper, Miinich, février 1953), a paru dans
la Revue internationale de philosophie, N° 29 (1954).
« Note sur l'histoire de la philosophie et a sociologie de la
connaissance » a paru dans ['Homme et 'Histoire, Actes du
vit Congrés des Sociétés de philosophie de langue francaise
(Strasbourg, septembre 1952),
« Histoire de la philosophie et historicité », in L’Histoire
et ses interprétations, entretiens avec Toynbee (Paris-La Haye,
Mouton, 1961).
« Le christianisme et le sens de W'histoire » a paru dans la
revue Christianisme social (avril 1951).
« Le socius et le prochain » est extrait de I'Amour du pro-
chain, cahier collectif de La vie spirituelle (1954).
« Liimage dé Dieu et l'épopée humaine » (Christianisme
social, 1960, p. 493-514).
« Emmanuel Mounier : Une philosophie personnaliste » a
paru dans Esprit (dée. 1950).
« Vérité et mensonge » a paru dans Esprit (déc. 1951).
« Note sur le veeu et la tache de Yunité » est extrait d'un
article « "homme de sciences et 'homme de foi » publié par
le Semeur (novembre 1952) et les Cahiers du CLC.
« Sexualité, la merveille, Yerrance, l'énigme » a paru dans
Esprit (nov. 1960)
361
« Travail et Parole » a paru dans Esprit (janvier 1953).
« L’homme non violent et sa présence a I'histoire » a paru
: dans Esprit (février 1949),
« Etat et Violence » (Les Conférences annuelles du Foyer,
; John Knox, Gendve, 1957). TABLE
« Le paradoxe politique » (Esprit, mai 1957).
| « Civilisation universelle et cultures nationales » (Esprit,
; octobre 1961).
i « Prévision économique et choix éthique » a paru dans Esprir Préface & la premiére édition (1955) 7
(fev. 1966), Préface & la seconde édition (1964) : »
« Vraie et fausse angoisse » est extrait de 'Angoisse dti temps
présent et les devoirs de esprit (Rencontres Internationales
de Geneve, sept. 1953. Ed. de la Baconniére). PREMIERE PARTIE
| « Négativité et affirmation originaire », in Aspects de la dia VERITE DANS 1A CONNAISSANCE
| lectique, Recherches de philosophie, II (Desclée de Brouwer, DE L'HISTOIRE
1956, 101-124).
I. Perspectives critiques.
Objectivité et subjectivité en histoire 2B
Lhistoire de la philosophie et lunité du vrai 1 4%
| Note sur l'histoire de la philosophic ct la sociologie de
la connaissance : 5 60
| Histoire de la philosophie et hisioricité 66
| Il. Perspectives théologiques.
: Le christianisme et Ie sens de l'histoire : 81
| Le Socius et le prochain. 99
| Limage de Dieu et l'épopée humaine 2
: DEUXIEME PARTIE
| VERITE DANS L'ACTION
| HISTORIQUE
i I. Personnalisme.
| Emmanuel Mounier : une philosophie personnaliste .. 135
IL, Parole et Praxis.
Vérité et mensonge.. pitgeieecreeesesees 165
Note sur le veu et la tache de 'unité. |"! 193
Sexualité, la merveille, l'errance, !énigme * 198
i Travail et parole . i210
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Guillermo VidalDocument2 pagesGuillermo Vidalnarratologia0% (1)
- Diagnostico PsicodinamicoDocument520 pagesDiagnostico PsicodinamicoJesús Reyes100% (3)
- Fernando Pagés LarrayaDocument2 pagesFernando Pagés LarrayanarratologiaNo ratings yet
- Sintesis PasivaDocument2 pagesSintesis PasivanarratologiaNo ratings yet
- José María AlvaradoDocument4 pagesJosé María AlvaradonarratologiaNo ratings yet
- Sistemas Clasificatorios en PsicopatologíaDocument1 pageSistemas Clasificatorios en PsicopatologíanarratologiaNo ratings yet
- Criterios de Normalidad PsicológicaDocument1 pageCriterios de Normalidad PsicológicanarratologiaNo ratings yet
- Jorge Joaquín SauríDocument2 pagesJorge Joaquín SaurínarratologiaNo ratings yet
- Psicopatología de La SensopercepciónDocument4 pagesPsicopatología de La SensopercepciónnarratologiaNo ratings yet
- Todorov El Relato Argentino de Los DesaparecidosDocument6 pagesTodorov El Relato Argentino de Los DesaparecidosnarratologiaNo ratings yet
- César Augusto CabralDocument2 pagesCésar Augusto CabralnarratologiaNo ratings yet