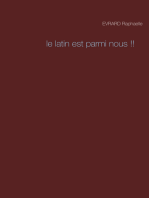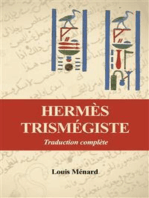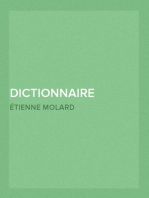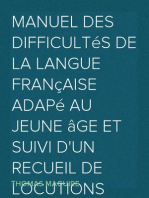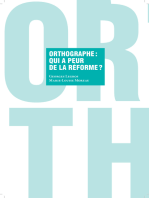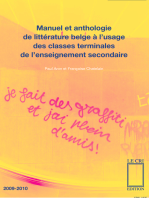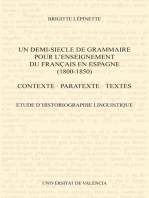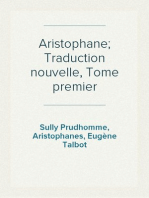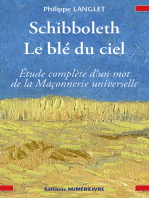Professional Documents
Culture Documents
Diccionario Etimológico de Latín
Diccionario Etimológico de Latín
Uploaded by
Noemí Ruiz Sotillo0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views427 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views427 pagesDiccionario Etimológico de Latín
Diccionario Etimológico de Latín
Uploaded by
Noemí Ruiz SotilloCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 427
DICTIONNAIRE ETYMOLOGIQUE
DELA
LANGUE LATINE
j
|
|
DICTIONNAIRE ETYMOLOGIQUE
DE LA
LANGUE LATINE
HISTOIRE DES MOTS
PAR
+ Alfred ERNOUT
‘Membre de Institut
ef Alfred MEILLET
Membre de Tinstitut
retirage de la 4* édition augmentée d’additions et de corrections
par Jacques ANDRE
Paris
Klincksieck
2001
premiére édition : 1932
2 dition : 1939
3° édition : 1951
4 édition : 1959
révision : 1985
. format
retirage dela 4 ition, nouven
© Libre ©. Klinkseck ot Cie, 2001
Ten 2-252-09950°2
AVERTISSEMENT
On s'est proposé do présenter ici un exposé historique du vooabulaire latin,
Les deux auteurs du livre se sont partagé la tdche de manitre inégalo.
1M. A. Emout a traité de ce que l'on pout connattre par l'étude des textes. C'est Ini qui est res-
ponsable de tout co qui est enseigné sur le développement du vocabulaire latin depuis les plus anciens
monuments jusqu'au début de I’époque romane.
‘M. A. Moillet s'est chargé de la partie préhistorique. Il est seul responsable de ce qui est enseigné
sur le développement du vocabulaire latin entre l'indo-curopéen commun ot les promiers témoignages
ayant un caractére historique.
Néanmoing, il a semblé inutile et incommode de marquer, dans chaque article, la part qui a été
traitée par l'un ou par Pautro des doux auteurs : Vhistoire d'une langue est chose continue, ot le
fait que, pour Pétudier, on doit recourir & deux méthodes, Ia méthodo comparative ot l'étude philo-
logique des textes, n’oblige pas & diviser Pexposé en deux parties séparécs.
Dans chaque article, on trouvera, d’abord, "état des choses a l'époque historique du latin, exposé
par M. Ernout, puis, la ot ily a lieu, des indications, par M. Meillet, sur histoire du mot avant les
premidres données des textes.
AB ct AM,
Le leoteur sera dégu par la partic d’étymologie préhistorique de ce livre : il n'y trouvera ni
‘toutes les étymologies, méme possibles, qui ont &é proposées, ni aucune étymologie neuve.
Dans une langue comme le latin, il faut envisager, d'uno part, des mots indo-européens ou faits
avec des éléments indo-curopéens, de l'autre, des mots empruntés.
‘On a estimé qu'une étymologio indo-curopésnne n’état utile que si Je rapprochement. proposé
‘aves d'autres langues de la famille était ou certain ou du moins trés probable. Tous les rapproche-
ments qui ne sont que possibles ont été, de propos délibéré, pessés sous silence. En D'état actuel du
‘raval,ilimporte avant tout de déblayer Ia recherche des hypothéses vaines qui lencombrent.
Depuis plus d’un sidcle que les savants les plus pénétrants ot les mioux armés travaillent & rap-
procher les moté latins de coux des autres langues indo-européennes, il est probable que toutes Jes
ftymologies évidentes ont été proposées. Il convenait done de ne pas exsayer d'en proposer ici de
i on eroyait en avoir trouvé une, il faudrait Tentourer do considérations de détail dont
1s place n’est.pas dans un livre destiné a résumer avee critique lee résultats aoquis.
Comme on n'a retenu ici que des rapprochements qu'on croyait certains ou, du moins, haute-
ment probables, il était superflu de faire Phistoriquo des étymologies ou de doriner des renvois biblio-
raphiques. Pour cela, on renvoie-une fois pour toutes au Lateinisches etymologisches Worterbuch
A. Walde, dont M. J. B. Hofmann public maintenant une troisitme édition améliorée & tous égards
st a fait un livre nouveau — le présent ouvrage ne se propose pas de le remplacer—, ot aussi &I'AUt
italisches Wérterbuch do M. Fr. Muller. Redonner ici cette bibliographic serait faire un double emplo
Un rapprochement qui n'est que possible ne sauraitservir & faire Vhistoire d'un mot. Les voos-
Dulaires des langues indo-curopéennes.sont divers; lee altérations phonétiques ont eu pour consé-
quence que beaucoup de phonémes de la plupart des langues admettent plusicurs origines, et parfois
tit ou dix origins distinctos, ainsi f-initil en latin; ls prooédés de formation des mots sont mul-
ac ee |e eee eae cee ee eee
es es, nt ok rele sent inn dey gl trae Pe re eg mptan os
See ago ae Ait fines Pol iaefeongeretoe tasebeie ake
mF ca
Ff
tn trouve py 3
i permettent un rapproc soncordance no saurait étre miner I'sire o8 l'on rencontre des correspondants
aqui pormet srouve sexprime par Ia formule : «1a conco ai :
ire comparée, toute preuve #exprim¢ p 7 facilité. Cast 02 Tous les mots ne sont pas & un méme niveau; il ¥-a des mots « noble » et des mots « roturiers »
Or, on grammaire compart: ybante tout oe quil gagne en fal
iment perd donc en valeur prok
fortuite » Un rapprochement pé
| saa mot gui digo sere pl gl, oman mt our, estes ty ne
58 stymologisten perdent parfoi de Ye, remand ot pip du védique satstit, | ot Bibere les relations do famille, pater, miter, frat, les principaux animaux domestiques, equus,
1 endo porns fw dy vou hat alemand i ty GH NN, | Sis haitetion de fal goat ont pra, domar et foes, so, mpi
‘Gost quill ne snurait ttre fortuit que trois mots cones a soi européen. Si Yon n'a fait que vocabulaire de Paristocratie indo-européenne qui s’eit étendu A tout le domaine ; oes mots désignent,
Structure et I'emploi; ils continuent done un soul < Paaiae veil court, i eoule rapidement », c'est des notions ; ils n’ont pas de valeur affective, ot ils ont un minimum de valeur conordte : dds, ouis,
rmentionner Je rapprochement de [int ne rio, que la concordance no '6tend pat as eld dee sis ’appliquent a la fois au male ot & la femelle ;o* sont des termes qui indiquent des biens, non des
we intial da latin adm des orgines multiples, aye Je Ponies 'tme pas mentionné le termes d'leveurs; de méme, domus et forés évoquent Thabitation du chef, non une construction
i tenn dst vague ener ni Tommi 6 S| Sueur ata deta i a ert artaoaq ve iag stu tt
rai aun comeryarganae seer SUH NETS TA, | anal i abled bay vaso dass src pop
fede pas Tide que coer tir iat rien & fir ny a uaymoligie qi reconnaissables & beaucoup de traits, vooalisme radical & gémination de consonnes intérioures, eto. ;
rents, Pot-tre wst-on encore trop conformé & Tusagy oii Ee mana, cet mots ont souvent une valeur affective, souvent un caractére technique. La plupart du temps,
‘ont pour elles qu'an peu de raiemblanc, Maison espe Fret en entendv, aucun "4pPro 4 moins sou les formes quils ont en latin, le mots de ce genre n’ont de correspondants que dant
cot qu'auoune des etymologies données Po eee “été adoptée pour ce dictionnaire exeluait Ia peu de langues ; beaucoup n'en ont pas. Le vocabulaire « populaire » est austi instable que lo Yoo:
Shoment nouveau ne figure ici. 1 le critique qui & Dulaire aristocratique est permanent. Des noms de parties du corps comme lingua, as, lién attestent
cae iy on inte tun fevered fome dr trmen «populace Dasa meno oer ymolgin ots adn,
Boe ea qn se hr ign pte tn Wnt dons ainct'& arqur betas doa ola esi
vie tan,
4 | En sommo, on s'est offoreé de ne pas so homer & des compara
fs verhes radioaux, les novia de rombro, les nome des principaus, oTfanes
Preoque 10 jerbes radicaux, rae
une étymo-
s chaque rapprochement avee d'autres langues indo-europsennes dor réalié, les unes do caractire
rr nom mau dometigue, Jes adjectfeeston- | porphologque, d'autres do carastre aémantique, d'autres de caratir socal. objet de oe dition-
corpo des ciao ntins de parent dv prinsipave annie Cam gras petomels, | pur qt dela lt mite tle quis ont 6 employs depuis indoeuropln junq'a ain, ot non
tite comme now, nes, Pri a gann, ve reconnaisentsistment pout indo-européens, dee borer A une dissection Tnguitique
Jes démonst rat in ere garactireindo-curopéon est Gvident, il ne mult pas do signaler dnelant ‘On a easayé aussi de faire apparattre que, 1 méme of un mot I
Pour ts ot east non do simples racine, mun de mats ndoeuapdne qu 0 Ma 8 So
Sey dont on pot ot on dit deminer eer potion WAT eeroplonne
sor ume étymalogie que de rattacker wn mot latin & une + : rae
donner me ic par de dir que It eb ext &rapprocher de gr lea, desk. Bhérdmd 10 0 Ni
Tae a pee her admettat & Ja fois Te flexion thématique et Ja exon a
quer que la racine *Dher- adm
contin oxttemant on
tot nd-sorapin, ite Pu chonger etre de nature Pour owen msm lad oe
Tike gun ade atu sn orignal indosuropln, Tot ot kant peer are
ttn ee ain, teas ques theme sd europrn qui opens Se fron no
‘eure asin indo-uropince’ et ws indquela vee» tle quo Tenn moder eno
new | Rr etn eopinngetoeeesa vr iecassr si
fe fsion ennai os arn moneyinbigoe | Sah viiqu et me dana ow apse homtiqus do Fae eve oom, Ban
sftextaent let 1 fk spin gue Mn ee rad de feral, | Ygnqun ind-eroeante at Pépoqoe romans, tvs ls nom asin ont shang de alo Free on
“ie re: em Te darn ne, | hop
(of-Yers wont indo-earopéens i ‘ni aoriste ni parfait, ot Von eompren
Ct Sesto a dri er | ag ay wane ng nen de wt se ine
' rev dens la forme et dana Ymploi un détal inexpliqué, | européenne, comme Ia morphologio Vettentigrement. Les petits groupes de chefs qui ont étendu leur
Ja fore ot Yemploi du mat, ot tant avi roe Om ‘vit que paris ext ancien ot que palernas | domination du centre de Asie & Vootan Atlantiqus, dele protqulescandinave a la Méditerranée
elle no sats pas pleinment, A regarder de prs, nO Peas. Ce vont le tals pris | ont trouvé dan le pays quis oceupaient des civlmations gui, au mins au pont de vue matériel,
tna Tort pa, o que, pri de miter i n'y «pas de aient souvent plus avanoées que la leur, et des objets qui n'avaient pas de nom dans leur langue
de co genre qui donnent & Péeymologi une WAY agrigineindo-curoptenne. Tel mot et | Tous ont done « emprunté» des mots
ie ys consenter dodo gn mot iano rin HCP Cocina |" mans nur indurapen, on put dcr a ute gullet prt
indo-ouropbn commun, ot roprésnts d'un bout A Tavire 00 2 A do-iranian, de Tautr, }emprunt Ilva de oi quel fit, pour un mot, de n'aoir pas de corepondant clair dant une are
at Mast ute no one qu igo en oi Prine indore | gordo faileneppore sie pat ane prwompton en fovea do Pomprat a, powers
Tin ered ou re, Her, dane deux dos langues qui orsupat des Onn erent par des | Tetgmologe de fren on sTavait que den rapprochoments avo d'auten angus Tomenet, rou
pen ii Yn tom piance hose on ino-aroprae et ia diaper dant 6 par) sTndiquerat le cractie lta du mot; et sult Io hegnag dain ancien rem qu avor-
tones lah nas 6 epson rg Gt
correspond:
Tro, urn grins
sete mci se 0, pi
see inci a ne
om von ignore prosque toujours quel voeabrlairt les grou - ;
sn geen een i ae ee ee
cnt cn ie es nn
ns tose wn ae gr
een ef up rey Es se oe
wae a ene ok mo
ce ta
os ec Ait
ent et, ew a
canna Ser oe be
mein or fon fn
sn he rege et
a atin ca nt ma
Fe et ep
mania in
1 ana
i ea oe ——
ttn 7s mtn a
® ples grand eon d’étre empruntés, et Von ne peut proposer ie n
cn nn han ent TE mth rit
Fe orc arn Sern Eur en i a
pt mr emt ee a
sar or di gc prs
Fague dans Ia famille oi il figure ne prouve done pas qu'il ne sol! nin po bl
nn ar Me ae ce eee to
aioe ain Laon em pi
to tte am vdentel Il tent & 08 que, durant plusieurs sites aan
eoeneed we rs amas
ayaa am ite an me
ne a
Vinge cmt tan aes gen i ten mee er
conn sp fn Se rnin a
a ‘Rome quelques ‘mots importants : le lat eae st eS ee oes
ees tty fe cra toe
vb a ey er ome a tah
ror nme os ee
wma ens cen Sl ne
Sige eo a i eo
+t prin en Tong rele du ehistianisme dan Textenion do Yorn
rea ing re ate om va ree
dnt sr eh ee a me
pe in end compte dent. ros. Lo gre ob tin ont done empran neatly
tet eee aS
chance @’étre indo-européens, alors
“Le fait que lat. e&d0 ou ramp)
me indo-européen n’empéshe
ot uetus, taueni ot sener,suduis ot Tens oe Aénoncent comme
do langue indo-curopéenne qui se sont établis dans la région méditerranéenne y ont trouvé des oivi-
Tisations matérielles partioulidrement avancées. Or, du vocabulaire de oes civilisations, on ignore
presque tout. Tl n'en est pas moins str que le vocabulaire grec ot lo vocabulaire latin lui doivent
beaucoup.
Sie latin a emprunté lslphabet grec, c'est par voie étrusque. On voit assez par 1d que Faction
‘4a vocabulaire étrusque sur le vocabulaire latin doit avoir 6t6 grande. Sans douto est-oo par 'Etru-
rie quo des mote de Ja civilisation méditerranéenne ont, pour la plos large part, pénétré & Rome.
Des détails avortissent que méme certains mots grees sont venus au latin par un intermédiaire
‘trasque : «porta remonte & gr. empl «corbeille », ace. sg. omit; Je-- latin au liou du d attend
‘ablit Io passage par Mtrusque. Grice au hasard qui a fait trouver un monument étrusque ot le
mot gersu ext Grit & e9t6 d'un manque de théttre, on aperyoit que lat. persina ost d'origine étrusque.
1M. Emout « montré, dans le Bulletin de la Socidé de linguistique, XXX, p. 82 et suiv., combien do
‘mota latins sont suspeots d'avoir 66 pris &I'étrusque. Mais présomption n'est pas prouve. Comme le
‘vocabulaire technique de Iétrusque n'est guére connu et que ce sont des termes plus ou moins teoh-
niques que le latin a repus de Iétrusquo, la part a faire a Pélément étrusque dans le vocabulaire lati
niest pas détorminable.
Ge qui achive do rendre malaiséo & préciser Ia part des emprunts dans le vocabulaire latin, c'est
{que les origines de Rome sont complexes. Rome est un liou de passage, et @ d0 au fait qu'elle tonait
Je pont par loqual T'talie du Nord communique avee F'Italie du Sud beaucoup de sa grandour. U1 y
1, duns le vocabulaire latin, dee formes qui manifestent Ia diversité de oes origines: ni '8 de rabus
ai lf de rifus no s'expliquent par les rigles de la phonétique romaine. Et, & Rome, lo b do bis ne
sexpliquerait pas, non plus que le I de oleb.
En romme, rien ne serait plas vain que de vouloir expliquer tout le voosbulaire« latin» par Ia
‘tradition indo-européonne ot par les formes normales du latin de Rome. En particulier, parmi les
‘termes techniques ot dans les mots « populaires» la plus grande partie est origine inconnue ou mal
‘connue. 11y a done, dans oe diotionnaire, beaucoup de mots sur Vorigine desquels rien n'est enseigné.
Mais, pour la plupart, co sont de cos termes dont soulo Thistoire des techniques et du commerce
permettrait'de connattre le passé, ou des mots « populaires ». La plus grande partie du vocabulaire
sinéral a une étymologio, ot c'est surtout ootto étymologio qu’on a essayé d’expos
titude que comportent les études déja faites.
Los recherchos précises sur Mhistoire du vocabulaire sont & leurs débuts. On en ost & pose
problémes plus qu’d donner les solutions. Les quelques cas oi Ton « pu fournir des explioations
complexes et présises donnent une idée de ce qu'il rte a faire pour éclairer Pistoire du vocabulaire
latin. Le prisent dictionneire aurait mangué son but s'il donnait l'impression que l'étymologie du
latin est achevée ot wil ne faisait pas sentir qu‘ y a oncore un grand travail & oxéouter.
‘A. Mruuuzr.
En rédigeant la partie proprement latine de oo dictionnaire étymologique, on
fixer aveo autant de précision quo possible Io sons do chaque mot, do montror les valours anciennos
qi a conservées, ot qui refltent avec une fdélité plus ou moins grande la mentalité indo-euro-
plenne, comme de faire apparattre aussi les développements et les acquisitions propres au latin, qui
Hivilent un changement dans les modes de vivre, de penser ot de sentir.
Le vocabulaire d'une langue est composite : & o0t6 d'un fonds ancion de termes généraux dont
|u fixité n'est pas, du resto, immuable, il comporte une grande part d’éléments spéoiaux et chan-
‘ants, de toute provenance, oréés & mesure qu'il faut exprimer des concepts ou des objets nouveaux.
De,ces mots, souvent techniques, savants ou vulgaires, los origines sont diverse : formations analo-
ques, oréations par composition ou dérivation, empronts, calques sémantiques, spéciaisation ou
ici avoe Vexao-
‘eat effores de
extension do sons par lo patsage de Ta langue commune dant Te angue spéciale ou inversement.
extension teporeano dannts a chaoun do ct facaur, chagte Wa¥s f 6 ‘physionomio propre, of
Savant pon ngraphiqus ls fit Rstoriquse ou esau ont 2008 Ta constitution de tout vooa
Je nt rae considérable, encore qu'il ne te Tans pas touloor fexactement déterminer.
i tn, langue une population exsntolement rurale & Tories “us en contact avee deux
civiionnurbaines auzguelis ie domandé la plopart des Wn Sot Tui manquaient pour oxpri-
cient one nouvalls de vs et de pensée qu'il « progensventts ‘adoptées : de son contact
sor My peuple étruaque, pis avo le peuple gre sont rent 0 Ce foment et une transform
sr Per cabal, dont Umsignnt non sevlement ls emprints ee ‘mais — on ne peuty
tion Ng montzer que pour le gee — les adaptations ooncemany Ve S08 98 te forme, de mots latins
au rete Jlor gro; aint, une parte des tens de causa sont oahtues 0 ‘dete. Loa vooubulaies
aan es du ntn somblet content, pour autant quon pout Sotto de nombroux termes
eeneittgs éranqu aves len mir tex dinilines dont 1 elévent ils en présentent un grand
man a origin blige st Evident tw nnn prise 0 oS ‘d'un emprunt ancien,
momilie et fai par vole orale, ov an contra, dun ferme caren implement tranterit ou 46>
0 nua rng «de Donne bau cvé de ener; An dat ot aDRaeisn 1 TG,
Fone font me valent I ovale tn Ga
dovumant fa gu ngs Btrare nerd son indlpendance, To Earvaguns om détruits om
a tin TnMuencegeoque ma jamais cme agi: on tint dep A, ‘emprants
a Ms machin asa pases dvi de ioe ou 2 Gras’) fevant apparition
een er rane fais & époque du Bas Empire Foe SO de FEglse,
ee maine, mene in branes de eno, La NST a philosophie,
ou ase rae entrar; ot male os ernc® DON On a gram
ton oe Eatin appasinet cs Yabord Somme ritoment PPSST OT ‘evant tout
ini ti vocab asco techiqus du atin kon rane Ps quan reflt du Yea
pare du ever pest aio ele-mtrn ot fe do penste sreege. SA instant, on
Dulin Fn des anton novels vant du res Pes de Tos noter at
soe tn nr ae, ar Tnroinomet wean an ne ie progrés de
ra raproduie in rots qo no wont un ds transnipans 2 eat attaché &
I paat, Sane Pod te de mo ou eprant d wes, ql ont aegis 4 Rome oo cite
dug ongutt du monde par vt arms 8 00 PO ae
vee tare armas aur pruebas civibations Sous TES
a a io ame devent dps on lt oe ae
commen Svan un pew purout vntoduset dan lang, Ba our fentiment de
ovina tar vr nan & pagan lag pat un Cnn ou pr on ln 0 Ta prose,
a ee Vinin v chaos joo faint, Ua recor 2s Tt du ptto
wae ein de renouveler dev expresons unt ou devenuee oESiN contribuent & modifier
re onal, Entre Segue et Tei, one pat et Geta TA iin'y a pas un
Tasped de veeve, et pourant les formes expression ont ebangé. Lt tr, rornan, In diatribe,
sel Satan rr jotet ler part 8 o hangomenty fan panties C2 langue érit
ls amare « Pope get en avait ign, on bunnaant ates, doves Tees désuct
des termes eu dorveine Soiginedtangér, et dont le latin n'est as 6 raternll,
En ote de nombres rp, L'retain ve pure aun rape dant a ermal 2 Oe
a ea Tinvonce de Tacent, aspect dt mote ve mode, Piparan TU De,
Gis ont free pouvat veo une documentation eouventlacunir, Snore ot toujours
arden a tent eeoquiner histoire de chaque mot Iti, loreqait on avait une, depuis Ia date de
mer in mgt torn
commana aor eg los développements de sons qu'il a pu présenter au o vannon earunen,
iva dt at pr, dot Spent ils wr omer argu be
“ea on ni dane or er roves Panic Cetres
eee Leer péndtrent et se complétent I'un l'autre, On a indic uh a thee
eae nat ims ee ean en
en ie dt boat bene ‘achématique, on s'est efforeé de faire a its dua
we mls slur évlopprent. Te peut que ie pute sn rend Teves nea socoaeah
Cesare a bien ‘tout simplement. Du reste, tous les. rablémes wont parpmes
eeu tpt a tu rp de sin, Pe ro on (vm evil
eae ee ne font ‘nattre, et, comme en fur td de pare
A. Ennovr.
Plosieure personnes amiee ont re
sani pron ei ot r ommiiatin Cane pee de dito
rice aoxquls dos ases graves ot oats ot ds compliments nor
toto ont We appa mmr
ti ott ar" Rees ra indy as Nara
ae Bn xa Meni lo pa vi sr Spreves os sont sul re
pn tri fy vit, aan ‘ur ur prt de raacion, Main nour davon
{rep oats jien voulu accepter de nous aider et de nous critic ee eS eae
note ince, et pour ne pas prier le leoteur de Sa eerste cae
‘qin puen overdue daw note re
3 savoir aussi gré d'une part au moins do
ARAM,
PREFACE DE LA DEUXIEME EDITION
pe
dee may i
‘opta vl a revoir Ja partie de Pouvrag | avait =
Teper ar a oper, eats ps 2 Daven UN ae
te sage Tuma iadoeu0pieny te
inn pu Tenn 1902 Gann ht yt accept. Tt partic sndo-eurpennns
cote wee ca * Feet bon! eee des fautes matérielles, & réparer ‘des omissions invo-
Des deux.
mentation,
‘auteur a enrichi sa doour
Gopuis $932 du Thesaurus,
par M. J.B. Hof-
ite aussi
‘été modifiée davantage. L's
‘ib Tournis par es fascicules pars
‘Warterbuch de Walde, revue
Worterbuch de Meyer-Labke. 11 « pro
sae
wi ate
aes et 1 s'est efforee, en multipliant Ie
vee ‘ou privées qui lui ont été adressées. Il s'est nm otonnaln
‘eee ie ae he
do rendre plus aisé® 16 Cvoillant acctiil qu'il a regu sous sa premiere forme’ rion
Se ent wa 9.0 Ftp eit te
A in cpa,
rae al oe aos
tous Jes Ieoteurs.
PREFACE DE LA TROISIEME EDITION
Cotte troisiéme édition, entiérement recomposée, a bénéficié des recherches personnelles quo
auteur a poursuivies dans ces dix demniéres années sur V'origine et histoire du vooabulaire latin;
lle & profité aussi des corrections, des suggestions et des critiques qu'on a bien voulu Tui adresse.
T1a, naturellement, ét6 tenu compte des fascicules parus depuis 1939 du Thesaurus Linguae
Latinae ot du Lateinisches etymologisches Werterbuch de Walde-Hofmann, qui va maintenant jusqu’a
Ia lotro p (s'arréto au mot pracda). information de M. J. B. Hofmann est toujours abondante ot
sie; ot les Iistes de formes latines qu'il donne permettent de suppléer aux lacunes du Thesaurus.
Le nombre des mots étudiés ot cités, notamment des dévivés ot composée, a pu étre ainsi passabl
‘ment augmenté, les dates d'apparition plus d'une fois rectifiés.
Pour répondre a un désir souvent exprim, j'ai indiqué les emprunts faits au latin par les langues
cnltiques ot les langues gormaniques. La substance de ces indications m’a été fournie par les travaux
de J. Loth, J. Vendryes, H. Pedersen pour le celtique, de F. Kluge pour le germanique. Pour le cal-
tique, jai signalé les mots empruntés par la langue de VEglise, bien qu'il s'agiase 14 d'emprants
savants et, & vrai dire, de transcriptions plutét que d’emprunts : Ie lectour n’aura, du reste, pas de
peine a les reconnattre. Le témoignage des langues romanes a ét6 revu et compléts.
Yai fait figurer aussi, sur le conseil de M. Niedermann, un plus grand nombre de mots greos.
Ici, le départ est souvent difficile & faire entzo oe qui est emprunt véritable et simple transeription.
Yai aoowell les tormes les plus courants introduits par 'Rglise chrétionne, et aussi d'autres termes
techniques (scientifiques, médicaux, ete), qui, par los dérivés de forme latine qu'ils ont fournis, par
Jes déformations phonétiques ou morphologiques quils présentent, par les changements de sens, ou
‘enfin par leur survie dans les langues romanes, attestent quis ont véritablement pénétré dans le
latin. L'étude des mots greos en latin n'a pas encore été faite de fagon satisfaisante : je souhaite quo
les trop brives ot trop rares indications de ce Dictionnaire engagent quelque philologue jeune ot
‘ourageux & reprendee le travail.
‘Jai peu touchs a la partio étymologique, estimant que l'couvre de Meillot risste & l'épreuve du
temps. Jai ajouté pourtant quelques formes hittites, que Millet n’avait pu eonnaltre, et qui m’ont.
‘48 obligeammont communiquées par M. Laroche; de Strasbourg.
Le sens de certains mots (notamment de noms de plantes ou de poissons) a pu dtre précisé ou
corrigé, souvent gréve aux travaux du chanoine P. Fournier et de MM. André ot de Saint-Denis.
Bnfin, chaque article a 66 Pobjet d'une révision minutiouse. Cartains ont été remaniés partiellement,
tres entidrement récrits; les renvois d'un article & autre, permettant de confronter et de grou.
per des formations semblables, sont devenus plus nombreux ; et, dans ce domaine, M. Minard, pro-
{oseur Ala Faculté des Lettres de Lyon, m'a apporté une aide précieuse. Bref il n'est pas de page,
00 peu pris, qui ne présente un changement ot, je Vespére, une amélioration.
PREFACE DE LA QUATRIEME EDITION
aa
Sas ge a ceat aoe me. le-ei apparait sous un
rar ian nce ime Pew Ye oe
ae yr deux colonnes page : il en résulte une ea
ee ne os ep eo
si ian Cgc net
“i se igo tente Tui-méme n’a pas été Vobjet de moin« rev re atten
ioe oct pT ey nena
onl int om tion savante; j’ai not ‘ast rues
ra ears ité douteuse — 1a encore, le départ est ms
ym tl ee ear
mot 2 Ee fg »ments de forme ou de sens.
wi a 2 he
ir npg rh
Sign mn rece ayo mas
roy ur got 7 eee
un bya i ae or
a a sacré des notices spé¢ les me ui, par leur eee
cet festa ae a
i ea a el erm
cine ee ey a a
Cre a ans arta, foscinus;, Poubnins, Faunas, fordusy fdas, (Bene, exis, EEC Soe
arp, in, rs, acina Foie tnt ome f=
Dl ct nc eee rain ow
tee ‘M. Benveniste a publiée dans le BSL, t. Li (1955), p. 14-44. Le — a sO me
oa teal, et il est apparu que certaines interprétations généralement i ca a
216 contrdlé ot a joute (ol. ombr. tigit sous deel, ong, Flagist sous flagrd). a
fies ou mee on revidnten, on ne ranquere pas de constater qu'il ent pas une egy, PT
wigs ey eg, a tn
er ac oleae iis une enistion du nomi le pages 1
ree
aad leurs critic w'ont aidé a corriger certaines faute agréor
Je pie toute les peronnes Foe, Mew remercements vont pariculiement & M. J. Andi
ran na San ee a
oe Tins hae ge fo
i raat ata
ios dan Ie istionaie ylume nou tars ses dresauy, een partoalier M. Mibel =
ou
one, de notre tie vive grotitud
Paris, janvier 1969.
|
|
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
Outre le Dictionnaire dymalogigu atin de Beal et Bally, thon abrgh parle otres B. . (Pai, Hachette,
105), dont le détall est viel mat Ia tendance exellent, out wee
‘A. Watbe, Letniches etymologchs Werurbch, dont la sition, entérement rfondae par lessons de
4.8. Hofmann, est malntsnanttormin : Heidelberg (Winter), 1980195. Ourragefondamenta, la foe pri ot
‘our ote leceur towers tout x gui peut y awit dul dane la biblogrph du sujet ot angel on renvoie une
{ois pour toutes 4 ce point de rae. Abrigt en W.
Fr. Mowe, Alitalacher Worerbush, Gitingen (Vandenoeck o. Rupes 986. Lire personnel et qui fa
tovjonrs resi.
"ue Theraras Lingua latinas xa ps besoin dire enppeld; ap fie wld pour es lattes 4, B,C, D, EF,
6, Hit partellement pour I, 3, dnt la publication exten cour. Notices btymologgaes rts hrver de Thar?
seyin, pls de JB. Homann. Poor supper la parte mangusnte,om peut constr
‘Aorander Sovren, A Glory o lar Latin, So 600d, Oxford, 199, o pour le veabulie chen: Albert
‘ane, Diionnir latin ranges des auteurs erin, Strasbourg, 1984.
‘our les tenes de Dotanique: Jacque Axo, Leia dr tres debtnigae en atin, Pai (Kline), 1956
De pls, ily « maintenant lee gintal (bid spre la mort de Petes) “Ac Water, Pergiehnde Wor
terol dr indogemanscen Sprachen, brsoggten Yon Poston, Bin (W. de Gray, 1927490 Ben
‘ours de pubiatin).
‘Bentcoup de fais sont rani dans Vouvrage de C.D. Buer, A Disionary of Slated Synonyma inthe Principal
‘Indo Buepean Language, Te Univenty of Chicago Press, 12
‘Pour Fevienter dune manire ginal urls fle lato, wee
1M Nispenuans, Phoniqu hiriqu dla one 9 dion, tv agmente et mire, «pre, Paris (Kinck-
sick), 1958, ot A. Eanour, MorphaopsRatrigue du latin, Pais (lichsech), "Ed evae st corigb, 1858.
Enno et F. wows, Syntace tine, Pate (Rlnckec) 36d 196,
‘A. Metuier et J. Vewontas, Tred de grammaire compart ds lng catgut, 2d, Pars (Champion, 1988
‘WM. Linosay-H. Nome, Di laine Spach, Lape (8. Heel, 109,
F, Sounrn, Handbuch der letinischon La. und Formenlte, 2 f Hedelberg (Winter, 196, avec un fast
‘ale db Kraehe Evaurangen. Ouvrage ts plein d faite que nour ane tonne doctrine,
Bresette Cra yetnnt roe nai renown) pa ML
xan oJ. B. Horsann, Munich (Bech), 1936 ot 1998, Ovvragy ample, largeent inform ul est Te man
{perch cctuaenent,e punatis pte, wre Urea lle eat wehaeaie
1a 3 partie dat volume de In Hinerisce Grammatik dar ainschen Sprache 2 Sol est une Stanmbildung-
‘ere, Lepsig Teuboer, 1898, Cato seul ouvrage dveloppé sua formation des mot latin, Ute, quolqu Wel
Pour Voscrombrien, wit G D. Boex, A grammar of Orcan and Umirian Baton (Gin), 1906 ti, 198,
‘CB Viren, Handbuch dHalvchen Diao, ¥ Band, Heldlberg (Winter) 4969 abrghen Vetter, 24).
‘Vittore Pusan, Le linge dealin ent lee laine, Tarn Rove et Set, 198.
(ine Bormtiom, Manuals det dst lac, Bolgne, 1984.
Pour Vhitoir gedrale do aig latino, wie =
Srous, Gshie der lainichen Sprace, dd rvue par A. Dasnonnan, Darin et Lepaig (W. de Grate),
inte pe ig (W. de Grater
J. Manors, Le atin, dis casei, Toulouse ot Ps (Didier), 193 amma, mals ont hen sul ara.
ir ds fits lating.
‘A Mastixr, Hoque une hive de a Unga latng, 3 hn, Pai (Hachete,199,
©. Devore, Stra dela Lingus di Romo, Bologn (Le Cappel: "62.190,
The Latin Languege, Londres (Faber &. aber, 4
Phin Ft, Pos (Hine) 96 ot 1957, oh sont rain paius ads execrant
relatn,
Arps ocbulaie latin Pavia (Rlnciieck, 196
e mews
rane Asuna, Coir ancenSprei,Pranuta-in (it Kiser 184 ‘site wetout
«orgies et do ln priate dn latin.
gas Ft etn Rome ave ncn aun nt Sui 05 7
diene du robe lati, Pais (Champion) {9% 5
an eer canacis te gramnaie compare: Zeer He -Forchungen,
sa Pet tin On rermarqrs gu, Gas es volumes ane Miva “Soi de inguistigue
eft an Fc asprin de Michel ral et de Lan Hares Sa i ents des Mémoires
cFai ee e es MM noa etMarusnn, Vir Hour den erate a Revue de phil
ca Saity a de nombreax comptes reds.
wae tntatn, en 199, a ree Glaus (x GaKGnge, Vandenhoesk Ruprecht) suit, anne par année,
+ aca fit nur la lange atin eon particulier sur tyme
aval ft hiblogrephe, on ocourra ax grands recalls
Pore ihe Jaicbch, Dela (W. de Groytr). Tojoars ay enarat
Ie seep sie, 19-1824, Pa (De LA) Lanne phic
she ea kets, s08-400 ot svn, ie pr MM BO ie rare bilographiqee
Par gre dea angue lie, 1860104, Pan (es Bele ati)
Te Cont cs plement hinges la Ree de Pho 58 77-4928),
a ute er eran toe nein nas are irs of ares oR ‘pet eons
pour fave Pnstoire de Ingue tating
sae nsetcon a ngenet tie Diconnaive dgmotniue de ens owaca (Heidelberg,
Fee ee mesic. vee inde, $950, aug sacle Is Gees Soe iaches Worterbuck SC
Wine ee oar de pation Halong Wit, 194 cts ot 8 Poet “Grammatik der kelischen
a eH Paveasen, tingen (Vandenhoek apr) 12085
Sprains litte Clary de MB. H,Sartevant 3°62, Baltimore #96,
cits da lrg (Wit), 4994. Pou les angus romans, on renvole a
aoe Sect Heeler (Want) 195, abtgd on ML AY Einebrne “Stim d romaniahen
Fea, A, eiaieng (itn, 00 (St pas Terai Corrections sont dues &
Sprache Diese n.d a eng cela On wih oar Ee Trowvelle edition di
Moro ee GLinpet ot Sco rorae par H. 8. 100s Og, (ete par Pabeé-
Gk nai ir ie cr Hac a ple ve a cobras de M.S von Diionnaire
itn 12a engus range, ar (asses rr de Pans, 952 (02 rd revue en 1960),
aie dee aes principe gue ene (brig BW)
snp es mt Pe evmanus ent gaa aps eeu de Poe phat haat, et
er es mas ns dant egies Witoizn, Pa Bo Dehiber
1 gan tia oiinm vpn, Pars (Kicks, 198 oF HSS 58+ ‘Bamok. Ware
es wna s+ 490, Grund gm. Pl, 2 LT, 2 SEIN
mace Sele, 8° 29 de Ronis Marlin o ee Origin tos de Si 0 taps los
eee Lindy grammates tins (LK) Cpr in "Varro et les glo
ate ven ee aa da at, Lone et Sb. inition Ste ras 8ST ". Sote, Late:
hes Romanischer aus Haun Sebel, Gotingen (Vandetorsh w- Raprech), 1230
ha Reni Ee ei el sa alee ap a ‘et de
phe, pour es Indogrmanocke Forces; KE, pout la Zee dt Fr ‘neglchende Spr
Pill TF Pom ue Mémates et Bullen dela Soci de inguin, ot
oh BSP es Mes Soabrvintona ens arm, oar arto, ome SST Er pour gallos,
ne tga poor les, Mi pon hp lnd pot Mee pou Tete, 1 po
8 ror thie en, pour asia pour ux aa, Be ar we falemand, et.
ale, VP adie de Pauly Wisowa est cil sus Tes initales PW.
NOTE
CONCERNANT L'USAGE
DU QUATRIEME TIRAGE DE LA £ EDITION
sn i de Faves cite dx «ans oo
ston eat inn one as BS 419,08 le
Gl a ct i cree ae it
igne 1 comme renvoi aux « Additions et corrections». .
‘Quand un mot nouveau a été ajouté,
so téajouté, ce signe figure a la fin du mot
4, Hh, aha interjection destinde &exprimer des émo-
tions ot dee passions anex forte. Comme tlle, appar-
tent surtout Ala langue pariée st dla pots’ Lk de
‘Shreprésnte une notation de I longue ot une proton.
Gallon emphatiqus. Aha attesté cher Plaute et dans la
‘Valgte ect une forme A redoublement,fsue cans doute
de oh {ache JB. Hofmann, Lat Umgengepr., 19.
Gb. 8 i, 2, oe, — Vo
4b, abu1K - priverbo ot prtpostion. Abe prisente
vina'vis de ob le méme Sargacement en» qud sum de
ule > *eupe, ov do tole > cope vis-tvis deb, ub.
Brn compartion, ab temploie devant voyelle, devant
‘at devant ler cousonnes ¢ (=f), mr #2 bau,
sligh abigh, adorn, abt; abl)ici8,'ahds, aBldts,
itnué, ebripia, abou (prosonet aprum) ;abs- devant
leseuploives cet t:abecond, abstrah, bein, abel
{en face do abla): devant un p iil, abe red
Bsus ayports, appl aspernor de *abe)pernar &
‘tla forme rédute de “abe devant Ics Ieblaensomorcs
tym; Bt dmouel, dull do rlO}zmoueb, "aru,
hub, cenit do *oeeuir. fut, paral de abou, et
tne forme analogque; devant la sourde fle atin recou-
‘it erdinsire Aon autre preverbe, au, ef. plas as
ars la phrase, Yes omplois de ab abs, & sont aus
ghd punts du mot suivant, et sulvant les times
rigles quien composition; toute, Pusage comporte
plus de libert@ on trouvera par ex abe det dete,
"toujours a pate. Des rao @euphonie et de carts
fotamment Ie dir e'eviter dee confusions avec Let
omposts dead — eralent avoir rglé Templo dee
Aiverees formes de ab (a, abe, am, ot muss a).
"AD sigalio« on s'lekguant, en pattant de, depus,
dsj et marque le pont de dapart (de environs, dao.
sinaje dan endrott, et non de Mintécenr del, co
fave eq accompagne Tabla; se dit hues de
Feepace comme du tompe, evec ou sent Idde de mo
‘Yemen Caeser maturat eb urbe profie, Cis} 80.17;
[eeu anqus fre sptis ab casts Aro aber,
Bid, 148,41 malice. ab re dina (a0 sort de,
Tots apts») apparebunt domi, Pl, Poe. 647; sem
‘dere veg, Wire, B. AL G6NCTtt Ie sens de «en eto
ihant de» qui expliqu ab ré contrarement ax ate
1s» (par opp. Ain rem). A adaum soppose adeum, et
A abvens, prams (la variation de paver eat Instroc-
tive. Abs distingvo de ex et de de Bx marque Ia sor.
‘ue de Vintérour un lieu et oppose A im ul indique
1s prtuecn ou rarve Anti dn nda. Quat
‘expime one ide de retranchement, de din
ion et nas un mouveron Ge het en ef Veron,
fgm. ap. Seaurum OLK. VII 32, 2 Odaérlement le
‘itirences de sus sont observes pa les bons eras,
Hanis dtingoe: Diss fon fc Lrsy S835
li eaters ex tarts henserunt, A624; Hector ata,
A
de Troiano mare iadari, 86. 82. Cetron, Cave. 90, 8,
‘abit dane une subtle discussion Jurdique ta die:
nce entre decre abot deicre ex Vado deat cot
‘Chana? Barbe, Vnde Telia? AB urbe Vade diet
Galli Capitan” Pade gut eum Grachefuarunt? Bz
Capi, Tooetis, ds Pépoque de Plate, des conte
‘ons tendent so produre dans la langue’ populaire
Sil on it dans Plate aire de fre Mon 599. fer.
fbeant, Pe. G42 (v Lindsay, Syn of laut, pp 8-87),
(et Lacres drt indifremimoct 1787-8 meare « aalo
tf orem, de era ad eidera mundi On it abhin, tals
‘Linde, enim abo, or inter, ste Coat 2 gui ost le
particule vivant, ot dont Femplot se gtotralise x
pent de ah ot deez, qul perdent petit & petit leur va
leur précis. Sut ccs fats, ve Thek 113,87: 47, 39. 4D
test souvent en corlaton avec ad pur marguer le pas
Sage du point do départ au point Qrvives + alierum
{Gil siderum genus) ab ort ad occu commeane, Ci,
N- D.2, 19, 49. La dieence entre abet per est mar
‘que par Cictroa, De inu. 2, 80 (textes dant Thes, 1 20,
11): eqn a pr guoe ot qunmada. stata deo ve cone
Inert a Brut 11,1 guid wus wl per uss potas
‘Niuon ad te ete delat ses Amer” 80 quid air?
alge soidchaturd per quot? ota guibas?« par quales
tmalns? ot sur Pordre de qui et de qui venait ordre)?»
‘Per, dont Io sna propre est « 8 travers, pendant, du
Fant 5, 2 signi socondairement «par Pntermadilee
de, an moyen de, pars, pus «A extse de»; c-€. PL,
(Cap. 690, qu per uaraom inter at mon inert if.
{ire gutro de Ge, AUL 3, 42,4, litear non tam explo.
‘aaa time} fab arte ot per atom. On coeit ae
‘Get por, formes plus pleios ot qu ayant vantage
‘de commancer par une consoine, gardaient micas eur
SSotonomie dant Is phrase et requalent moins dese
fonfondre avee la finale du mot precbdent, sient réusti
Palmincr ab etx comme préperitions; aus! 14 pre=
pation estlle peu et mn représente dans Tes 1 ro-
manos, ef ML. Litalien da semble une contamina
tion do d et do dé, Ab marquant le point de départ 4
servi 4 Tpoque impfriae 8 latrodur Te complement
di comparatit; maior Pers «plus grand que Pierre »
‘ent-d.¢relativment grand en pertaat do Piere
‘Eb renforoten maior € Pa, sana doute en commen
fant par des exprestonsloaice du type citer, infe
For, reperior yl. Ths. 139, 40 aq. Liempol Sen
‘ct Honda A dos verbor marquant is rapironlé 08
Piatti ! minaare, mine, et, et on le Ure
‘méme aprie tun pot, Ain! rexpliquent dane Dioso-
Fide les formes cbaus,ebengurtas qui equivalent & des
Compara, ef Thes 3. u
Te sens do ab expigue qu'il ait pu serve Aintree
Je complémeat da verbe fas, won pas, comme on To
Ait souent, your marque I som de Fogent
‘ogigue» de Taction, mais lout a mot
b, abs,
_ pour indiquer de gut provient action exprmnte par
= Pte ltl Bao. 2p uct, ad Her. 3,24 38, ine
S's cer aul me vient de tl aftr, of Te sens
it evn que dans Teor vt plage ab omico quam
chores ley, Pat. 2, 16,7, blesrue ert ples
give want d'un aque en éblteur » Ce se ne
fre as Deawcoup de « In Besure et pls ghey
ores Far un amt que par uo debieur»; ot on com
rend due eb al pu parfos servi intiodur Te nom
I Tagunt; mais Cent un empl secondaire, # du reste
"dans une phrase comme dase ab anime, deen ab
cy daeo ab segriadne, Pit, Cl 0, pouval com
rendre fesouir drone Soulwur qui me vient dete
re fe sole du cde Vine» Ab a pu prendre all
m seas de «partite de 0 cb do, en ce qui concern »,
gui exique lee expressions dela Tangue impérale
Netiooum ab sputli, Pellatem a rations, Salt,
128, dont le prototype se trou dij dane letron
Pile eran &'petinee me, AU 8, 8,1. Cl, aus
fare ab tre eth de, du port & »
“Dons la base lait, usage st develop de ren-
rear Taide de eb certann adverbs ou prepositions
font le sens wétalt afb: abintn, abinuicem, ct
rend i ant de ebaae cM. 30 bextra, 34 abhine
langue), 18 abinde, 23 abinvo, 30 aint, S13. ab
Mire, &Joren ors Mais es formes avec dé sont pls
ert igaloment 8 renorer des verbes composts,
“Tie erd fgnlementrenforcer ds .
sont Jo provebe ait fab: are, lca re
wii Yeni, tvs tars et dole de TEEhy sans
joate fats sr dos moddles res.
"ab priverie marque PSnigsement, absence et par
site Ia privation Sebdaes, abel, aborar,quelqueois
ris, comme apy Lachovemeat = eberbe, aban. Ea
composition, i a'servt A Tormer quelques adjectifs qu,
mar rapport temple marguent e_privation, Tab
nee amine, tua ebnormis, absinis, abionas, ab
radu; ab sua =r. x” Oyen a post da Tes
jangues romanes(f aveugl) . L. 98, B. W, 8.8. Co
(7 deformation et eerrare abs rouvantconcar-
rence par de. (dsmona, dit (dari), (2) (2ormis),
Ie pers od ba parle ert avs, dans les nome de
parent former carting noe dati, ebans,ebeva
Uicconcuus, sbmdtarars, sbamta, patra, abneper,
cbneptr, ebscrr =. a.
a ei, pour sens ex ce que gr do et b,c,
avec une racine diferente, ce que Yakov (ot) et &
ir. La ditrecs et aymtrigue call ont ad i;
iw ven de surprenan, cat Te nna ditingvo wn
chlatir dan dati, comme un alla un Haty et un
cdeost dun inva, ob Tindo-eoroplen a un cis
nique : te loca
atin a's que a avec b constant tamale, an-
ais que Tombrien ap. Gace apebre« ab extra, extin-
secus + (mime opposition entre la sub et coq. our;
entre Tat ob ot cag. Sp, op). On interpéte @orinaire
lat eperid et oper par Sep-veryd, mai
tat éttange que’p igre devant“ sevlement dang cette
paire de mots la forme sonore seralt seule possible i
Fant envisger une autre expleation; ¥. sous ape.
‘Quant A erigine, en ne prouve que ab ait perdu lt
voyelle ale qu'on obeere dans le formes parentes
2
sr. dxo (préponition ot proverbs), Indoiren.epa (seu
Iimoat proverb), hit. appa et qui figurat sans doute
ano Torgoal de got af, etc: of une voyele finale
‘Seot amu, le lain a ne aourde, sind dans cf
ts mequey reste le Wtualen a (2
le slave w on face de
tment a
Utaitement = des anetennes dentales finales
“Ls aw qui devant f ert de préverbe, dans oxford (A
cold do abetal,abletur) fuga, pond Av 6,
eel ap. prash uy Yh ochre ot Int
rst vn met férent. 1 prévala en lrlandais pares
(fue, p ne eubsstant pas en calique, le groupe de “ep)
$ poral on caractiiatique principale
Ea forme abe: du type alee, qui oppose nettement
caxudt bends rapond'& gr. 4, aver addition dee ql
‘gore dans beaucoup. de formos adverbals; cf sr.
avalon face de den er. dels en aco de duet. Le
gure idl per reiclon élymologigue,comine on le
Joi par srpl,sutad, ob b ne ee rencontre amals,
Crest seulement dane export que le 6 manque, pour une
Faison évidente. Le earactero non phondtique de la pr
ener debs dane abu, et. sort aust de arenda,
Clow, tend « onenditd 7 lagi de lien d=
Tint consonno, on face de ab Cet -rde abe, *0(0)-,
Tels ebte dead, sub, ob, ifs das constant de
2 [t toteeis eer.
‘tant donne que ex. abovtt & & devant m, u con
sonne) on expliguera de mime par abe Ta de dmc,
‘Burt duction éueho(eandia que Ton ada, acs ea
{ce de td, acd. Main In forme & de Voxcoombrien
‘dons cog, aamanaied = mandault», ombr. ahevend
SMiuertth sr ahuiiparsatay abtepureto, ele. « "abet
podits» reste éoigmatique. Phonetique dans des cat
[ia que 2m @ nbn, & usb, ote, lea result d'une
‘xtomon dane des cas tala que 2, icone, purd ee.
ea forme a, ateste sporadiquement &Tepoguerépu-
icine (of nobel CL 588, 156 ay, Joe; of lo
XC Se07 jf muro 1° 1674; af Copus T 688) et qui, pour
Gictron (Ora. 188), me sulctalt que dant de expres
lone Rea, est pas expliqee (v- Ernout, BL dial,
ful On fa retrouve en peligaien = efdel'« abit;
Fone oftahad’s datera? »est tre tncetan,
‘Le groupe de lat. a, gr dn, otc, ext apparenté &
spor (escn mot) de polis, ee, spew (¥ owt "pt (6
Ate le) A got: afar «apne» ete
Abeqae (apaque) : compost de eb et de gue, sit sur
tout 8 Tepoguearehaique dans Texpresion abepue fore
te abepoe ted eet (ot PHL, Te 693}, qu xt proprement
tthe propesition conditinnelle 4 forme coordonnte et
flndfaement. en pareathice, dont Te tens est « It
‘howe oe serait parse anal em dehors de tl, ean tl».
cers sea conditionnel ne result pas de aloqu,
‘Fun des dlsments de absyue, mais dela forme verbal.
‘Mais aens gendral de Fexpresion et certains phrases
‘ont pu fire erie pus tard Pexlstenee d'une’ prep
tition abegue, Cette méprce @ 0 commise par Fron
fon quia choi abvque 4 tre de veux mot. Mis la
ode, asgue vst propagé avec is fonctions et le sent
‘Tone proposition» (Leay, Te PM 26 (1942), 259; sar
|
|
|
tautesecais explication, vole Schmalr Hote
‘tat Grp. 501),
‘ababalsamum, -In,: forme vulgare pour opobalie-
‘am (etprant dela impbriale a8 gr, ou opobloe-
‘Raton, bldmbe par Papp. Probi et qu'on Fotrouve dans
Sal Chiron.
‘abacus, Im. (forme courantefatiniske du gr. ba:
on trouve aise I transcription pure ot simple ebar:
‘hacus ent sane doote batt sur le gta. Kaeo ct al
Phantus de Bayer, trans de spynee, delphus
EeRoigvea) stout atpice do table (imple, préiewse,
SSjoer! Cae glométne, de Pythagore, ete); puis!
‘onvole, tailor du chaplieay aur lequel vent repose
Farehitreve; plaque de revdtoment dune parc.
Empraat techaigue; deja dans Caton.
Ditivés#abeculu; abacinu.
badd ind, : 8 roc; «abaddir deus dictur, quo
snomine lapis wacatur quam deuorauitSeturus pro Toe,»
Glows Pap. CGL V 645, 12
‘Mot cratal, dtsignant sans doute une ples divine;
non attectd avant Pepoque Impérial (AU).
ct ee tr ita
Ear es
sizes Se
Se ts
Pees
Sl al any tnt
sctoamtiens aes ot i at
si lat
iS reese Pea
rm as
staat gr len es
amit oth Dig eee rs
2 SEES ee
Sane
ar
‘th rte hen ho
tied cis ata ary
Soomro ete
Bere sie Ae Me a
Pa
Te iaieee ssa
Preri, Sinae fee
Zien a ea
Gee aie See
ee ee ae ea
le (Celse, 6, 1, p. 122). Non roman. 7
cdi es its a
penis aimee
sateen tae
Spice os colar ees
Se ee
Rikam gure euctnate
Reine See
sSeonlrn a, um a, driv de A,B,C, «a
‘Boia: Caue Ge iphoto, Boclata @ ANg
= aboles
alg) sf, COL 1 $78, 16, elamantarin; qu dict abi-
late "ABC et peutdire conserré dane certalnes
formes romanes,ef.'M. L. 46; etn cell, inl. abgir,
sprit, ee. V. alphabicun.
‘Abella -40 {,: nom d'une ville de Campasie, sans
ot &
tse eoque abd « destroction », ot + oubi, amnis-
ws eh Oren, His, 2, 17,25, quad factions gens
neta uocuserunt, ie. abeitionem malerun
wr abokjond (Tert). La glase draeigo, CGL TT
5245, se Jotife parce que abled raploe souvent de
stare: es ndmina,erip,earmina, rit, te, ef
eas T 146, Stagg, Ls formes ls pus trquentes sont
nbn prévent et le partcipe past, Attest seule
wat a partir do Vg. et de T. L. (Gedron ne connatt
we dala} et rare a premier sicie de TEmpire; es
drives soot tour tardifs. BL 39 2
THen ert de mime pour alec, dont le premier ex.
st dane Vile, Ae. 3,291, ne. tan. ebleet gratia
bole eblebiur. Brutus et
s Torne coupe antithtique avec adel, edie que
tigmologie populaire avait rapprochs (et adele) set
on peut se demander sce n'st pase sens de sense»
Jona A adald qul a amen Ia eration de abled; f
snot, Paillogcs, I, set Thy 4 peu de cas 8 faire
el pose eer der, COL V 544,28; 216, 8; 997,25
ter, qu nest pan surement attest, 2 pouttte 6d
it aoltriremnent de Bole. Dan les gost, les verbet
aed Slant devenss pour Ia plupart transits, do:
decd ect cenfondn avec bole et trait axe.
ie arose Ia forte ablgent & rapprocher: sole,
sett peut-tre deed, deeut— edlees (ans, parce
ro ada avec perfect oda) est un aulze ¥erbe)
weld, Unde — else, ex, — Cb oUpe
st, Gaui part, iséparable deal ut — indo,
rity, uber ~~ ite. Le sons paricaler de chacun,
jer mols da groupe de abeed ele, est daterminé par
Je preverbe, Mia 5 ane formation commune cn 2
ral donne tus ces ees un aractere propre en face
[ealf- M1 4 tis des opinions autzer; de bold,
moa rapprocbe gr. Six dane. Oly, Gheow; depuis
Prscen, on a coupé aed eu dele, ct dum. Mas In
fracture dane dfles em face de Tem n'est pas claire:
dam ont &rapprocher sane doute de gr. Se Le mieux
emale ttre de ne pas rompre le groupe de cbole, et
our Patymologie, va
boll a8 f.: ¢ manteau » de nine gros, épsis
ot Toube, dont se courant les soldat tle paysans,
ot que certains piloophes portient par affectation. —
Aud Sep Varo. Orig ncn Lat forme
tanive 400m semble ere uno traceipion
St mot latin; de meme asa Te motte par Hesychio +
Wats mega tb Daxn
sbbmind =v. amen.
inks -am m. p.: Ie «autochtones », on pre-
mere habitanie du Latiam et de Italie dont les ois
lagendaree cont Latinas, Peus, Saturn, Faunvs,
“Gouventexpliqu comme derivé de ab origine, comme
ae: pedepland «dn plela pd » est rive dans le cod.
Tod. podeptina «es eux qui tote plain pled»,
fed amd ct drvt dmanudnie«crie, serdar»,
tte, Mais Pempoi comme nom propre par ies hstorieas
{Caion, Balas, Tite-Live) Ize 4 pencer qu'il agit
i a,
peut dire d'un nom de peuple ancien, dformé par ty-
‘mologie populaire?
‘sbracadabra : mot magique (Seen. Sammon. $35).
vv. Auel Nelaoe, Eranos Radbergioaus, 826 et
Airases.
brolonum, 1. (fonus m) :aurone. Empront au
‘7 Abpbemonconervb ps ot moins alert dans les
Fomanes, ML. 39; B. W. su.
absconsus : doublet tarif de abveonditu, refit sur
ation forme de parfait qu west substitude & abron-
‘Hat, ateatie'& partir de Statue.
ae: chavr d'une élite, abide, Empront
‘popular rpandi dans in. de Bic, fai sur Pace.
rite’ ean Taspnée et aver passage 3 la 0 dtc,
(ct. tampade, ete}; poor le bt abeinthum. Portogals
use Me 5.
‘Dérvée peidauy, -dula. On trouve aussi trans
cripton svante (ean aspiration): opis, die; Pa
[inte arapparait quae fis dane Pline le J. 2.47. 8,
Ui faut sane douterstablir le mot gree
absinthium, -19,: absinthe. Emprunt au gr &fiov
«aja dans Plate, MC L4G; B_ We. u, La graph
‘i iew de p- ext analogique de adeum, ete
‘iives abeinhitus (Dios)
bogus: ¥. a, in fine
sbstiming: . emdtum.
beurdus-, -um: discordant: Sens vosin de abvonue
augue! Il et font par Gi, De Or. 8, 61, wor. qu!
tite madam abvenaaigue sbvurds. De Ih hors de pro
por (qul net par dans le ton, linus), abeurde. Ch.
Engi eric ie amen, el
Disivé + abeurdide: dsconance (I: grammaticle,
Prlcien), ot hit) absurd
De tebsardes, V. suturut,
bands : v. und
nde ese te
ama cerraam a
ee oie eerie geet
“ite
Tee
(ocr et ogame
sonemrimchaet esos
orate
‘cea : terme du langage enfantin désignant Ia ma-
many els alld gr fash mater Crear», De mle
(gue ce dericr, employé comme nom propre, et passé
{ne a lagen, 9 dusgns Ia mre nouricire de Ré-
{nu et Romulus, femme de Faustulos, et mare des douze
tires Arvlen, cor Laren, peutatre dorigine
‘requ, hu on ofralt de ites Aeclie, Lireidlia.
(Gf asa Asse, Acoava, caus (plignen), Accas, ete.
Mime gemination de coosonnes que dans abbd, anne,
ta, ol, V. Frisk, Gr War, 8
—8- fer
coe, sec, ef (ta): blest, Mot tard sans
oute dranger MC Le 66
secand : ¥.cand(l)
seen 5, area.
‘Aecherfins, -untism(ecche- chet Plante, dcht cher
tes potter dactyigues & partir d’Banios; pour la ge
‘oy ef, brahim) + Achéron. Emprunt at gr. "Axleo
par ua interes dtrusque pour le nl fle type
Ervine, “unts; Ta forme proprement laine serait
Saehers, ani. W. Pasquali, St eruachi 4,394 et 23
Develo hd, 2,325 ts
itive: aechruntcus (PI).
ceil: v, cos.
seek: ¥. can.
sceipiter, trim. (t.dans Ler)
pervier ou feucoa.
Drives atiiols: aeipivd, ws, « lacerd » Lace
vise acparine (ei manus, «"fOrkttx + Pit,
approche par ttymologie populace de azcipis, ct
sid, Ong. 12, 7, 867 et Caper, GLK VIT 107, 8, ec
Dit, nem acpar, Le nom rstique et tinmanclas
ELCol 8, 9,7, genus acipiri, immanent wocent Pat!
{ii est ecepio ult pass dos les anguosromanes.
(ML 66 ot acepirdias 69 el est de acceptor QUE
‘sive sane dovta Ia forme astur(¥.c0 tot) on,
‘dane un pasaage rieent et interpld'de Firmices; oti
frat renoneer A vir dans stur on emmprovt su gp. dave:
fl Gl pa), induenes. por wall. La forme tor-
‘Sve aucepir eat influence par aucepe ¥. BW. sous
“Sion fot abetraction de Vin luonce de acipi, te
smot asipler ent parllle & acupediue De
rime quo. au padiue rappel. dnd-mous, accor
appellee. ice tepot (cL 18, 62), hr. Spcpatean-
{gui vale rapidement» 16 ql se trouve dans gr doce,
‘ees conaervé dans lat dear y-ce mot) La forme at
Seu! surat To vocalisme aro du” type gr. Pap, cle}
100 de Ia. dear reprécente un degre pelo, normal
comparatf,tandis que Tat. acw- euralt un «lesu de
ise dont aucun Semerpondant n'a 4 signall (ale
‘mination vient prottire deco quvuo confit avec Te
troupe de ane, ea 6b fits), Quant & pil,
‘ns propre et pa. — POU le sens, ef. jor
tegba «autour » (chet rocker, Ste Wére, p32) dont
Ietradical serait elu delat, deer.
‘bees eed, dekdus Beerbus; Hei8s ; deus; Keer. La
‘acae des ive piquant, aga, pointu»acarel & former
des mots dont le sens propre ou désivé, physique ou
‘more, ext demeurd en gunural proche du sen orginal.
1 Tout Gabord uve sie de mots #oppliquant sux
santtions du goOt! eed av tre algre ou ate (dja
‘dans Caton) ase, is en) agri et aor, im.
(Colum, line), cides (G4ja dans Pit), seidalus, le
(OC L406, $05 eset, B. Ws.) deriv tails
ide, viii >. Maroc), anda faire
‘estomee » (Mare, Anthim.), oidéncus
‘ctu, 1: vnalgre (ML. 38, peut-tre neutre subs
tantive don ade estar qui seit A end comme ene
sean de-proie,
azus & exalies, le. Pash én germ. : got. abit aki,
ge ead, m. beck « Baigs (do Cascum), ot do Ik
fen. oa; on inact —~ Do acts ar «air
{tre tard); setabuam : vinalgrer, pois mesure con.
tenant Te quart d'une hemine pls toate sorte d'bjele
rappelant par leur forma le vnaiqrier; eftrium ¢ =a:
ade ou mets proparé au vinegre; actus M.L. 97 b
‘sirbur: sige, cur (souvent de frits non mr), cf
Serr, a At.'6, 42%, qu ft. tent). abil lve
dlr a funere mrt carbo : eerb, immature, wanaatie
' pomis, cl. Thes. I $6 Sq, Au sens moral, frequent,
‘pramataré»et surtout camer ign » et + ersel = male
‘aria atqueecrbe dit PIL, Ba. 628; cf. Ge, Brat. 324
‘Ancien, class, usul. ML. 94; cal, gall agar, il.
carb. De Ik ecerbis, ot 4 Pépoque implrale cer,
“as, cearbsaerbuds (Gell). Semble formé corame
proba, superba.
"Dee mots désiguant a pointe: cis, et. (civd
en ge cf lacs) "pola, fculté de pénration (ens
[hysiquee€ moral) en particule feculte de pears:
fron du regard et par mdtonyae «onpune qu posebde
‘nt qual, pupil» et mime «il» Dane i langve
militaire ans ddtigoe Te «front» ane arm, league
{de batile»conriddee comme comparable a0 fone
Jame (ct exes et son oppostforfers era, globus su
is tore. Kretschner, Gotta 6, 30), et par exten
Sone «combats Iubiaéme,— Ancien, wel Las repre-
fsentants romans sont rare, v. M. L. 106-107,
‘mire! mole gloss scare aurea qua in sacrifice
ushantursecerdtt, P-B.9, 7. Ch. eteuus (00 asiew
Ine de aicia? la forme eat douteuse):inetrament de
lapidsve, dolabre; arsealirinn (texan! as). Le
‘ipprochement de portuedu, lutte obscur, Wen
‘gue rien.
‘leita n fram dura (Gos. zrtram Or.)
ML 109 et elle dgalement passé en germanique)
‘aur, Bef: aiguile (et «agulle de ner» Babe)
—"Kaceg, aol. Es rom. allotent ne flexion acu,
“ors at des formes de diminvtity, aula acdeulao acd
alle (ed sewedariua), secu. M. L190, 120,
421,423,143, 148. A acts so rattace aia. (ans rap
pork ave ais, ef cua ania, cle); sigulloe de
Na. acca, MU. 102. GE. ab acid oad aed qul corres
‘ond’ noo « de fl en algulle», Do acu dvivent
‘eup,ta aguser (lens pisique of moral e exac
‘tty, M. L195 (panroman, sf tums i cu
(Gens physique ot moral) sorvi aussi &tradite le gr
buh, ML 28; acining er), eta fe au)
‘lou. De actus + acti; "artis, a, panrotian, saut
ouiala, M.L. 483-13, atts igloe). Sor la valeur
fubetantive de atta, ¥. Soto, p. 82.
"dcu:sert de premise terme de comporé dans azipen-
er cud (= Bbc -pe, pedis acpi,
‘Sipitire, ard
‘rular [acca f., Bas lat) + aiguilln, épine, ot
‘cult, ML. 125437. Ls formes romancssuppecent
‘tua agile, ardln (Gi. Reich), Paulo, 7. Me Le
Gl. pour Ia formation equ jecuieus. Ch. B. W. sous
elanta.
‘3 Un adjectit & voyelle longue : dex, Ss, dere:
iu, point jot en parent du gout «piquant» Pline 15,
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Le prisme des langues: Essai sur la diversité linguistique et les difficultés des languesFrom EverandLe prisme des langues: Essai sur la diversité linguistique et les difficultés des languesNo ratings yet
- Comment on Prononce le Français: Traité complet de prononciation pratique avec le noms propres et les mots étrangersFrom EverandComment on Prononce le Français: Traité complet de prononciation pratique avec le noms propres et les mots étrangersNo ratings yet
- Linguistique et psychologie: Lois intellectuelles du langageFrom EverandLinguistique et psychologie: Lois intellectuelles du langageNo ratings yet
- Des variations du langage français depuis le XIIe siècle: Recherche des principes qui devraient régler l'orthographe et la prononciationFrom EverandDes variations du langage français depuis le XIIe siècle: Recherche des principes qui devraient régler l'orthographe et la prononciationNo ratings yet
- Un siècle d'enseignement du chinois à l'École des langues orientales: EssaiFrom EverandUn siècle d'enseignement du chinois à l'École des langues orientales: EssaiNo ratings yet
- La langue à l'épreuve: La poésie française entre Malherbe et Boileau. Études réunies et éditées par Guillaume Peureux et Delphine ReguigFrom EverandLa langue à l'épreuve: La poésie française entre Malherbe et Boileau. Études réunies et éditées par Guillaume Peureux et Delphine ReguigGuillaume PeureuxNo ratings yet
- Grand dictionnaire des mots savants du français: Ouvrage pratiqueFrom EverandGrand dictionnaire des mots savants du français: Ouvrage pratiqueNo ratings yet
- Hermès Trismégiste: Traduction complète précédée d’une étude sur l’origine des livres HermétiquesFrom EverandHermès Trismégiste: Traduction complète précédée d’une étude sur l’origine des livres HermétiquesNo ratings yet
- Une réforme radicale de l'orthographe française ?: Pourquoi oui ? Comment ? Pourquoi non ?From EverandUne réforme radicale de l'orthographe française ?: Pourquoi oui ? Comment ? Pourquoi non ?No ratings yet
- Dictionnaire grammatical du mauvais langage ou, Recueil des expressions et des phrases vicieuses usitées en France, et notamment à LyonFrom EverandDictionnaire grammatical du mauvais langage ou, Recueil des expressions et des phrases vicieuses usitées en France, et notamment à LyonRating: 2.5 out of 5 stars2.5/5 (3)
- Littérature italienne: Les Grands Articles d'UniversalisFrom EverandLittérature italienne: Les Grands Articles d'UniversalisNo ratings yet
- Manuel des difficultés de la langue française adapé au jeune âge et suivi d'un Recueil de locutions vicieusesFrom EverandManuel des difficultés de la langue française adapé au jeune âge et suivi d'un Recueil de locutions vicieusesRating: 1 out of 5 stars1/5 (1)
- Cours de linguistique générale (Edition Illustrée - 1916)From EverandCours de linguistique générale (Edition Illustrée - 1916)No ratings yet
- Orthographe : qui a peur de la réforme ?: Réflexions sur la langue françaiseFrom EverandOrthographe : qui a peur de la réforme ?: Réflexions sur la langue françaiseNo ratings yet
- Manuel et anthologie de littérature belge à l'usage des classes terminales de l'enseignement secondaire: Anthologie littéraireFrom EverandManuel et anthologie de littérature belge à l'usage des classes terminales de l'enseignement secondaire: Anthologie littéraireNo ratings yet
- Rodolphe: French Reader on the Cumulative Method: The story of Rodolphe and Coco the ChimpanzeeFrom EverandRodolphe: French Reader on the Cumulative Method: The story of Rodolphe and Coco the ChimpanzeeNo ratings yet
- French Phrasebook for Tourism, Friendship & FunFrom EverandFrench Phrasebook for Tourism, Friendship & FunRating: 4 out of 5 stars4/5 (3)
- Un demi-siecle de grammaire pour l'enseignement du français en Espagne (1800-1850). Contexte, paratexte, textes.: Etude d'historiographie linguistiqueFrom EverandUn demi-siecle de grammaire pour l'enseignement du français en Espagne (1800-1850). Contexte, paratexte, textes.: Etude d'historiographie linguistiqueNo ratings yet
- Manuel et anthologie de littérature belge à l’usage des classes terminales de l’enseignement secondaire: Manuel scolaireFrom EverandManuel et anthologie de littérature belge à l’usage des classes terminales de l’enseignement secondaire: Manuel scolaireNo ratings yet
- Aguiche: 100 termes d'aujourd'huiFrom EverandAguiche: 100 termes d'aujourd'huiNo ratings yet
- Lexique comparé de la langue de Molière et des écrivains du XVIIe siècleFrom EverandLexique comparé de la langue de Molière et des écrivains du XVIIe siècleNo ratings yet
- Comment étudier: Méthodes pédagogiques et astuces didactiquesFrom EverandComment étudier: Méthodes pédagogiques et astuces didactiquesNo ratings yet
- Europe et traductionFrom EverandEurope et traductionMichel BallardNo ratings yet
- Vie de Benjamin Franklin, écrite par lui-même - Tome II suivie de ses oeuvres morales, politiques et littérairesFrom EverandVie de Benjamin Franklin, écrite par lui-même - Tome II suivie de ses oeuvres morales, politiques et littérairesNo ratings yet
- Prose d'almanach: Gerbes de contes. récits, fabliaux, sornettes de ma Mère l'Oie, légendes, facéties, devis diversFrom EverandProse d'almanach: Gerbes de contes. récits, fabliaux, sornettes de ma Mère l'Oie, légendes, facéties, devis diversNo ratings yet
- Éloge de la Folie: un pamphlet d'Érasme pour éveiller les consciences et la société de son tempsFrom EverandÉloge de la Folie: un pamphlet d'Érasme pour éveiller les consciences et la société de son tempsNo ratings yet
- Philosophies du langage: Les Grands Articles d'UniversalisFrom EverandPhilosophies du langage: Les Grands Articles d'UniversalisNo ratings yet