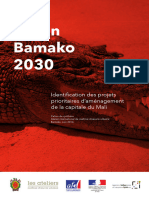Professional Documents
Culture Documents
André MIRAMBEL (1947)
André MIRAMBEL (1947)
Uploaded by
Bamana Yeah0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views12 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views12 pagesAndré MIRAMBEL (1947)
André MIRAMBEL (1947)
Uploaded by
Bamana YeahCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 12
REMARQUES SUR DEXPRESSION DE LA ¢ PERSONNE »
EN GREC MODERNE
En grec moderne, Vexpression de la « personne » est Ia fois
morphologique et. syntaxique, clest-A-dire que, d’une part, certaines
formes sutlisent, par tels éléments qui les caractérisent, 4 marquer
des distinctions «le personnes, mais que, d’autre part, la langue
recourt aussi 4 des groupes de mots ordonnés selon. certains types,
pour traduire cette notion, Celle-ci est done tantat synthétique,
tantot analytique, et il y a lieu de I'étudier conformément. & cette
distinction.
1
Morphologiquement, c'est. seulement dans deux espaces de mots
que se marque en’ gree moderne la persannalité : le verbe et le
pronom personnel.
1. Le verbe néogree présente & ee ps
suivantes : 4
19 deux modes comportent une expression de la. personne,
dicatit et Vimpératif':
20 Lun de ces modes, l'indicatif, admet. deux types de désinences
personnelles 5
3° chaque série personnelle est, autonome.
19 Parmi les modes dont, se compose le verbe, le participe est.
Je seul dont la notion de personnalité est exelue, soit. qu’ill se pré-
sente sous une forme invariable {-avra, & le voix active), soit, qu'il
se réduise & un adjectif (-objevos et -uevas, & la voix médio-passive).
Le gree moderne a éliminé un mode, Vinfinitif, anciennement
attesté, mais dont la personne était absente : c'est dire que l'évo-
lution de la langue, liant Vidée verbale & Vidée de personne, a
abouti 4 éearter la plupart des formes du verbe quine comportaient
1 de vue les particularités
36 JOURNAL DE PSYCHOLOGIE
pas cette idée, pnisqu'actuellement seul le participe fait exception,
Il n’y a pas lieu de faire mention du subjonctif, car les désinences
de ce mode se sont confondues avec celles de Vindicatif : sans entrer
dans le probléme de syntaxe qui se pose & propos du subjonctif,
‘on peut done considérer que tout se passe comme si, du point de
vue de la personne, on n’avait affaire qu’a un mode unique, On
peul en dire autant des modes dits « dérivés » (conditionnel par
exemple), puisque leurs formes ne sont autres que celles de l’indi-
catif, dont ils se distinguent par des éléments étrangers aux dési-
nences, Par contre, on peut ajouter qu’a la différence d'autres
groupes de langues (romanes, germaniques, ete.), le médio-passif
est marqué, non par un auxiliaire, mais par des désinences propres
qui expriment la personne exactement dans les mémes conditions
que l'actif (type : yave « je perds », yévovyss « je me perds» ou « je
suis perdu »; yee « perds », yéoou sois perdu », ete.), L'indicatit
‘oppose, au singulier et au pluriel, trois personnes & tous les temps
qu'il forme. Quant a l’impératif, c’est un mode unipersonnel, puis-
qui n’exprime, & chaque nombre, que la seconde personne, Il y a
done cette différence entre Vindicatif et Vimpératif, que celui-ci
niexprime pas de distinetion de personnes, puisquil n’en admet
qu'une seule, alors que celui-li exprime essentiellement une distine=
tion des personnes ;
20 Liindicatif, qui jadis admettait cing séries de désinences
personnelles (présent, imparfait, aoriste, parfait, phis-que-parfait)
et méme six dans les verbes contractes (le futur étant distinct du
présent), comporte aujourd’hui une série de désinences dites « pri-
maires » (présent, futur) et une série de désinences dites « secon-
daires » (aoriste, imparfait). (vest 14, certes, un fait de morphologic
qui laisse intact Ie principe de Ia distinction des trois personnes,
mais il y a a noter que le gree n'a pas de désinences propres du
futur ; la confusion des modes subjonctif et indicatif a pour résultat
que la distinction des trois personnes se trouve ainsi liée essentielle-
ment & expression du temps : temps présent (et futur) et temps
passé. Il n’en va pas de méme a Pimpératif qui ne connait pas, en
grec, de temps, et oi expression de la seconde personne, par
conséquent, ne reléve que du mode lui-méme ;
3° Les personnes se trouvant. exprimées par trois séries de formes
A, MIRAMBEL. — LA « PERSONNE » EN GREC MODERNE 37
(deux & Vindicatif et une & Vimpératif), ces trois séries sont auto-
nomes, c’est-i-dire qu'elles ne se confondent, pas les unes avec les
autres. Pour prendre un seul exemple, celui de la voix active, &
Vindicatif la premiere série de désinences personnelles est + -0,
~ere, -ouv(e), la seconde est: -a, -25, -€, ~ape,
-ave, -zv(e); A Vimpératif on a: -c,-ere. On constate que, dans une
méme série, il n'y a pas de formes communes, chaque désinence
81, “et, -oupe,
étant l'indice d'une personne distincte, Comparées entre elles, les
séries ne présentent en commun que les désinences -¢ au singulier
(troisiéme personne du passé ou deuxiéme personne d’impératil)
ot -ere au pluriel (deuxidme personne du présent et de Fimpératit).
Mais, outre que l'usage, en grec comme ailleurs, empéche la confusion
des deux désinences du singulier, celle de troisiéme personne compor-
tant. un sujet, tandis que l'autre exprime l'ordre quand on s‘adresse
directement & quelqu’un, dautres indices morphologiques peuvent
jouer, notamment augment, et, par suite, Paccent, au moins dans
les verbes dissyllabiques : Eyeupe, Eypage « il a écrit, il éerivait »,
en regard de yedie, yedpe © éeris », La notion de théme verbal
(aoriste ou présent) intervient, en outre, quand il s'agit de la dési-
nence -ere : ypdpere ne peut ébre qu'un impératif momentané (la
seule forme ambigué est ypdpere, commune au présent de Vindicatit
et & Vimpératif continu). Dans ces conditions, on congoit qu'il n'y
ait pas nécessité & exprimer de maniére constante le pronom per-
sonnel sujet, devant, la forme verbale, puisqu’elle suflit a elle seule
A indiquer clairement la personne. Le réle du pronom personnel
sujet est, comme on le verra plus loin, tout autre que celui d'un
simple indice morphologique.
Les formes du verbe & l'indicatif comportent certains emplois
intéressants en ce qui touche la notion de personne ; il s’agit de
faits généraux de « dépersonnalisation », puis de faits particuliers
de « personalisation ».
Il n'y a guére lieu d'insister sur expression de ce qu'on appelle
«V'impersonnel », quand il s'agit de phénoménes naturels, du type
«il pleut », «il neige », ete. Le grec les rend par la troisiéme personne
du singulier : Bpéyet, yroviter. Remarquons qu'en ce qui concerne
le verbe Bpéyer, c'est en gree un emploi spécialisé de Beéye qui
signifie « mouiller, tremper » et qui comporte normalement, une
38 JOURNAL DE PSYCHOLOGIE
opposition de ‘personnes, au contraire dn frangais «pleavoir > @
west personnalisé que par métaphore. Plas importante est expres:
sion de Vindéfini, que le frangais, comme d’aubres langues, rend
par ¢ on», sujet d'un verbe 4 Ja troisiéme personne du singulier,
Le gree a Péquivalent dans la forme eouvante ovate (Ade. xavele
won dit », voriter xavele «on pense », ete,). Mais il y a, en outre,
deux auties fagons Wexprimer Vidée de «on » dans eette langue :
c'est, d'une part, Femploi de la deuxiéme personne du singulier ;
de Tantre, celui de la troisi¢me persone du pluriel, ainsi: 2&¢ «on
dit » ow « on dirait », vopiZere « on croit», etc. ou encore 2éve,
youltouve (inémes significations), West en ce sens que Von peut
parler de « dépersonnalisation » du verhe dame maniére étendue,
puisque lon aaffaire 11-4 deux types constants d’expression, Aucum,
indice morphologique wintervient en ce cas, et cest seulement de
ln proposition que se dégage la valeur « dépersonnalisée » de la
forme verhale. Rien @ priori n/indique que voyiters ng doive tre
interprété comme « tu penses que » ou comme «on pense que»
Mais Je sens défini ressort’ du contraste entre cet emploi de la
seconde personne et) femploi d'autres personnes dans les proposi-
inns qui suivent ou qui précédent, Quant & yopitouver’s, qui peub
signifter «ils pensent que » ou oon pense que », clest absence de
sujet qui dépersonnalise la forme verbale,
Les cas de « personnalisation » se rencontrent dans les verbes
de voix active qui sontdits impersonnels parceiquiils ne comportent
pas de sujet, type Ppadud%er « le soir tombe n, wysdver « il fait
nuit», lorsque ees verbes se trouvent employes au médiv-passif,
eb marquent alors une participation diun sujet action ; ‘ainsi
Peadvstouuat signifie «je suis’ puis par lesoir qui Lombe » at vaya
voupay 4 j¢ suis pris par la nuit». Hn ce eas, intervient, comme on
voit, la distinction des voix, et ¢’est em passant de Vactif au médio-
passif que Ta forme verbale se personnalise,
AL, = Le pronom personnel, qui, pour les deux premitres’per=
sonnes, offre en gree une flexion distinete de celle des noms et. des
adjectits, n'est pas A considérer ici-dans ses particularités morpho-
logiques, mais seulement dans le fait qi?il distingue par zine forme
simple trois personnes : 87a, €eb,.ecbedc, eb au-pluriel pete, nets,
odrol. En néalité, ce sont essentiellement Jes deux premieres per-
A. MIRAMBEL. — LA « PERSONNE s EN GREC MODERNE 39
sonnes qui expriment la personnalits (elles n'ont pas d’autre emploi
en dehors de celui-la), ear le pronom de la troisiéme personne n’est
quinn emploi particulier d’un démonstratif, qui peut normélement,
employer comine tel, Te gree n'ayant pas un jeu de formes, comme
le francais, qui distingue le démonstratif du pronom personnel de
troisi¢me personne. Ajoutons que la distinction des genres n’a lieu
qw'a la troisiéme personne, Seul le pronom sijet la permet, le verbe
ne Vexprimant naturellement pas.
A la différence des désinences verbales, dont deux sont suscep-
tibles de revétir un emploi de personnalité, les pronoms personnels
nadmeéttent jamiais pareil emploi. Tl convient toutefois d’examiner
Vexpression de la troisiéme personne. Elle eomporte, & edté du
pronom régulier adrbc, Pusage de deux formes pronominales qui
sont sedrawog eb xavelg (on xzevévac) « quelqu’i ». Entre-ces deux
mots, il existe cette:différence que le premier exprime une troisiéme
personne indéterminée, mais ‘non pas dépersonnalisée + wiros0s
sine « quelqu'un a dit », xéno1o¢ Foe «quelqu’un est venu », tandis
que le second exprime une indétermination, mais dépersonnalisée :
GéRer vavele «on veut», Aer navele« on dit >: Avec ne négation,
ona le méme-emploi : 8év unset xavele « on ne peut »; en outre
ce pronom est employé pour marquer Vabsence de personnalité
« personne, aucun» ; 8 Uéner xavels « personne ne peut »; 88 etze
yanelg «personne n'a dit)», Biv Hee xavele « personne (nul) n'est
venu », La langue distingue &-cet égard, dans la construction néga~
five, ndmowog Ady €ypabe «quelqn‘un nia pas éeriba, clest-A-dive «il
s'est trouvé quelqu'un pour ne pas éerire 0, de xavets B8v Eypale
«personne n’a écrit 3, clest-d-dire «il ne s’est LrouVé personne pour
éorire », Dans le. premier-cas, on oppose 2 une action exéeutée par
plusieurs personnes attitude d'une seule; dans le second, an
contraire, on signale que Faction n'a pas 646 exéeutée, faule de
sujet pour Vaccomplir. Le\pronom xavels admet donc, dans Vexpres+
sion négative, deixemplois: Yun quivest celui de con »accompagné
Wune négation (on dit », con ne dit pas») et qui se référe iessen-
tiellement 4 Vaction du verbe (elle a'lieu ou elle n'apas lieu), l'autre
qui traduit essentiellement absence/de:sujet d'une action: «9
40 JOURNAL DE PSYCHOLOGIE
I
Lrexpression de Ja personne peut, en outre, se faire par le recours
& plusieurs termes ou A des formes composées : pronom personnel
et verbe, extension du pronom personnel d la possession, formes ana-
Iytiques du pronom personnel, réfléchi.
1, — Les rapporls du pronom personnel el du verbe ne sont, pas
dus 4 la nécessité de distinguer les personnes, puisque les désinences
verbales, comme on l'a vu, sont suffisamment nettes, et qu’elles
n'ont pas lieu d’étre précisées par un pronom comme c'est: le cas
dans les langues oit les désinences verbales viennent & se confondre.
Le réle du pronom personnel en grec est double : il consiste, soit
& donner au sujet une valeur « expressive », soit & souligner une
«opposition » entre les personnes, Ainsi, d’une part, on dira : yé
Ealpo « c'est moi qui sais », ob xdverc «c'est Loi qui fais », dust
88 Oéovue « nous, nous ne voulons pas », éaeic Eyere Blew « c'est
vous qui avez raison », y@ elyat « c'est moi », ésd clea «c'est toi »,
duets elyzore « c'est nous », etc. Gest un emploi qui se retrouve
dans les cas fléchis, lorsque le pronom est répété, ainsi : rt pe pérse
tudva.; « quiest-ce que cela me fait, A moi? », &aéva ic ob Aéves
«toi, comment, Uappelles-tu ? > (littéralement : comment t’appelle-
ton ?), éuéve pod elmay « c'est & moi que l'on a dit (littéralement :
A moi, on m’a dit) », 26évz oo8 Sivovy « A toi l'on te donne », ete.
Diautre part, on dira : &yé O£d0, dob 88 Oderc « moi je veux, mais
toi tu ne veux pas », &ad wis, asbcds péver © foi tu y vas, mais lui
il reste », nous mips xb Bt6Mo, to) 4 adréc, «qui a pris le livre, toi
ou lui? », ete. Par conséquent, lemploi des formes pronominales
avec le verbe est déterminé par le besoin d'exprimer certaines:
notions qui n'appartiennent pas & la forme verbale.
Il. — Un trait du gree moderne consiste & avoir éliminé les
séries de formes qui servaient & indiquer jadis le possessif, et d'uli-
liser par extension le pronom personnel en cet emploi. C'est par une
« construction » que le pronom personnel peut, en un cas particulier,
tenir lieu d’un possessif lorsqu’il est employé au génitif avec un
nom ; x8 Bi6Aio wou « mon livre (le livre de moi) », 74 GLENlo gov
« ton livre (le livre de toi) », 7 Bi6Alo zov « son livre (le livre de
lui) », 28 Bi6Mo pxe « notre livre (le livre de nous) », + Bi6Alo aag
A. MIRAMBEL, — LA « PERSONNE » EN GREC MODERNE 4h
« votre livre (le livre de vous) », 73 @i6Mo cous « leur livre (le livre
d'eux) ». Ge qui est dit de V'adjectif possessif vaut aussi pour le
pronom possessif, qui ne peut se rendre par une forme simple, mais.
par une expression composée d'un adjectif Bueq « en propre »,
déterminé par le génitif du pronom personnel : 3u26¢ ov « mien »,
Bouts ov» « tien », Boris roo sien », Buxig wag « ndlue , Buxbe axe
«votre », Buxé¢ ove « leur », On saisit par 1a l'or ité du procédé
il tient &
par lequel se rend V'idée possessive dans le gree actuel
Pabsence d'un terme proprement possessif, et A une spécialisation
du pronom personnel. est un procédé essentiellement analytique ;
Vune de ses conséquences est de permettre, & la troi
{an moins au singulier), expression du genre du possesseur, ce que
me personne
Vancienne forme possessive (ubz, a2) ne permettait. pas : la langue
actuelle distingue ainsi 8ué¢ tov (masculin et neutre) de duebg 74g
(féminin), et +d BiEMo tov « son livre & lui », de rd Gi6Mo =mg « son
livre 4 elle », Blle s'est done, sur ce point, enrichie d’un élément de
précision, qui tient & l'emploi du pronom personnel. On voit aussi
comment se sont discociées les notions de possession et de
personnalité,
TIT. — A coté des formes pronominales personnelles simples, il
existe en gree des formes périphrasliques, dont il n'y a pas liew
dinsister igine ni sur les valeurs de style, mais qui méri
détre retenues pour leur construction. Ge sont , 26), a’tbc, le verbe
se mettant, A Ja méme personne que le pronom. Ainsi dira-t-on :
roB Méyov Lov ypdpw « c'est moi qui écris », vob Aéyou auu hic « c'est
toi qui dis », ro Aéyou tov (ou Tob Abyou ty) OéAet « c'est lui (ou
‘est elle) qui veut », ete. Au contraire, les deux autres périphrases,
4 dgeveud ov elf ebyevela pov, admettent deux constructions : ou
bien le verbe subit l'accord de la personne indiquée par le pronom
42 JOURNAL DE PSYCHOLOGIE
an génitit (jj ager cov claw wec'est toi qui es », % ebyevela ou
vouitere « clest vous qui pense», ete,), ou bien le verbe se met.
Ia troisiéme personne du singulier (s’accordant, aye Je substantif
sujet (f doevzvk cov dgites « v'est toi qui décides », 4 dgeverd ong Réet
«c'est vous quicdites », % ebyevela oov vouller « elest toi qui penses »,
4 ebyevela axe vouller « c'est vous qui penser », ete). Il y a done
hésitation, pour deux de ces périphrases du moins, entre deux syn-
taxes qui s‘opposent : la premitre comporte une double expression
de la personne (Je pronom et la désinence verbale), la forme prono-
minale se trouvant en quelque sorte en apposition au verbe ; la
seconde ne contient qu'une seule expression de la personne (le
pronom), la périphrase pronominale se trouvant, ébre le sujet. réel
de la phrase ; mais, en ce cas, le verbe se trouve « dépersonnalisé »,
et cette construction introduit dans la syntaxe un type nouveau :
toute proposition constituée de la sorte avec une périphrase prono-
minale et un verbe aboutit & un type verbal invariable quant & la
personne (la troisiéme) et quant au nombre (le singulier) ; la per-
sonne n’est. en définitive exprimée que d'une maniére indirecte, et
en vertu d’un fait: de syntaxe ; il n'y a pour ainsi dire plus de mor-
phologie: de la personne.
1V. — Glest une remarque analogue qu'il y a lien de faire a
propos du pronom personnel néjléchi. D’abord, i] convient, de noter
que le réfléchi n'exige pas nécessairement: en gree une forme prono-
minale et que la simple désinence verbale médio-passive sullit, pour
donner & un verbe Ia valeur véfléchie, Ainsi, en regard de yave,
yar, yéver, otc. «je perds, tu perds, il perd », ele.,.on a ydvouuen,
yhereoa, ydverat « je me perds, tu te perds, il se perd », ete, eh
ailleurs o’est beaucoup plus la valeur réiléchie qu’exprime la voix
médio-passive que le passit proprement dit. A cxordve « je tue»;
oppose cxorévounas, qui ne signifie normalement, pas «je suis tué »,
mais« je me tue », Le'sens passif exie d’étre précisé par un complé-
ment @agent (oxordvevyat dnb... «jesuis tué par....»). Cette valeur
de-la voix médiv-passive limite, par conséquent, l'emploi du pronom
personnel réfléchi, La forme du pronom réfléchi est actuellement en
gree'une périphrase ; elle est. composée de trois éléments ; un article,
un ément qui indique le réfléchi (auzdq), biré d'une -ancienne
troisiéme personne, eb un pronom personnel au génilif qui indigque
A. MIRAMBEL( LA © PERSONNE » EN GREC MODERNE’ 43
A quelle personne se réfave le réMléehi. Ainsi : 6 fourde wow, 6 émveds
ov, 6 Eaveds vow (rye), 6 Emurbs pace, 6 Exurde cnc, 6 exvtés tous;
seul se déeline, naburellement, ‘le groupe 6 Sauré-: xorrdto shy
four ov wjetme regarde moi-méme», Auméou: chy &xue6 cov « tu
te plains toi-méme », ete. On remarque que, dans cette périphrase,
ni Ie pronom proprement. réfléchi n'est personnalisé (Ia forme a été
méme dépersonnalisée), ni le pronom personnel n'est. réfléchi, mais
est la détermination du réfléchi par le pronom qui personalise
le réfléchi : il est curieux de voir dissocides les deux notions de
réfléchi et de personne, qui ne se trouvent réunies que dans une
expression syntaxique, rappelant, par le rdle du pronom personnel,
les formes étudiées précédemment, tod Myou pou, } &peverd wou et
Buxds yor.
Liexpression de Ia personne est done en gree moderne chose
complexe, car elle reléve de plusieurs systémes de formes et de
syntaxe.
Elle tient, morphologiquement, du verbe et du pronom,
mais, dans cette derniére série, elle admet des formes simples et
des formes composées, ce qui revient 4 exprimer la personnalité
par deux procédés fort différents : lun réel et coneret, l'autre
métaphorique.
Un premier systéme syntaxique consiste dans l'emploi des formes.
verbales seules. Un second systéme consiste A utiliser en méme
temps les formes pronominales et les formes yerbales, Mais, en ce
cas, on peut avoir une double expression de la personne ou une
expression unique. C’est au développement de 'analyse qu’est due
Vextension du pronom personnel dans Ja langue : elle en a étendu
et spécialisé certains emplois et a réussi par Ia syntaxe & remplacer
des types morphologiques disparus. Mais ces constructions n'ont été
possibles que par le maintien de certaines formes et par le jeu d’une
flexion, C'est ce qui constitue l'originalité de ce systéme, ott la per-
sonne s‘exprime tantot directement (action verbale, contraste),
tantdt indirectement (possession, réfléchi). Plusieurs systémes s'al-
irontent entre lesquels la langue ne parvient pas 4 choisir : elle les
JOURNALacsnons
PSYCHOLOGIE
NORMALE ET PATHOLOGIQUE
PONDATEURS
DI St
P, GUILLAUME er I. MEYERSON
XL’ ANNEE
1947
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
108, Bourevanp Sar ALN, PARrs
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- These PHAM Thi Kieu Ly 2018Document640 pagesThese PHAM Thi Kieu Ly 2018Bamana YeahNo ratings yet
- 27 Mali InfrastructureDocument2 pages27 Mali InfrastructureBamana YeahNo ratings yet
- Synthese Bamako v2Document12 pagesSynthese Bamako v2Bamana YeahNo ratings yet
- Etude SUR La Carte de Base de La Republique Du Mali Dans La Zone de Kita Rapport Final (SommaireDocument47 pagesEtude SUR La Carte de Base de La Republique Du Mali Dans La Zone de Kita Rapport Final (SommaireBamana YeahNo ratings yet
- Marcel Griaule (1940)Document10 pagesMarcel Griaule (1940)Bamana YeahNo ratings yet
- Désigné Coupable, Un Film de Kevin Macdonald - Culture31Document2 pagesDésigné Coupable, Un Film de Kevin Macdonald - Culture31Bamana YeahNo ratings yet
- L'oeuvre Des Géologues Français en AOFDocument18 pagesL'oeuvre Des Géologues Français en AOFBamana YeahNo ratings yet
- Sūtra Du CœurDocument8 pagesSūtra Du CœurBamana YeahNo ratings yet