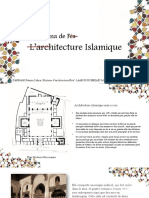Professional Documents
Culture Documents
Fiche de Lecture Droit D'urbanisme
Fiche de Lecture Droit D'urbanisme
Uploaded by
Fatima Zahra DannamiOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Fiche de Lecture Droit D'urbanisme
Fiche de Lecture Droit D'urbanisme
Uploaded by
Fatima Zahra DannamiCopyright:
Available Formats
DANNAMI Fatima Zahra
Les territoires au prisme de la planification urbaine
Impact des documents d’urbanisme sur la fabrication et la
reconfiguration des territoires, cas de l’agglomération de Rabat.
Auteur : Karibi Khadija, Architecte urbaniste, professeur habilitée à l’Ecole
nationale de Rabat.
Résumé :
La ville marocaine s’est développée au gré des conjonctures sociales et politiques.
Les documents d’urbanisme y sont un outil primordial pour l’encadrement des
territoires urbains, impactant le façonnage et la réorganisation du territoire qui eux
même ne sont pas dogmatiques, de façon qu’ils évoluent d’une manière inopinée
hors les normes pragmatiques des documents de l’urbanisme.
Le diagnostic du cas de Rabat à travers l’étude de l’impact de la planification
urbaine sur le modelage et le remodelage du territoire et son influence sur la
préservation de sa figure emblématique, ainsi que la métamorphose des régulations
de l’espace qu’a connu à travers le temps.
Passages marquants / citations emblématiques :
« Rarement la planification urbaine a constitué une entrée pour comprendre les
phénomènes urbains et les processus d’urbanisation. »
« Les territoires urbains refusent de se plier aux paradigmes des plans »
« Dès ses origines, l’urbanisme est fondé sur un principe d’ordre ; il est prescriptif est
normatif. Mais, il est surtout politique »
« Au Maroc, le protectorat français a voulu afficher sa manifestation à travers
l’espace »
« La maîtrise du territoire n’est que partielle. »
« Le Maroc de la période du protectorat a été un laboratoire d’essai »
« Les documents d’urbanisme sont formellement précis, sont établis sans enquêtes,
sans perspectives économiques et sociales. Ils sont longs à approuver et bien
souvent obsolètes quand ils sont enfin applicables. »
« La modernité ne résume pas à importer des solutions étrangères souvent
inadaptées hors de leur contexte, mais bien chercher dans son propre pays les
germes et les éléments d’une modernité renouvelée. «
« La planification urbaine a atteint ses limites »
Axes et Idées principales : Urbanisme et urbanisation à travers les années :
• Le XXème siècle : Adoption d’un urbanisme moderne au Maroc où le plan
d’Aménagement constitue l’outil primordial dans la régulation des espaces
urbains.
• Nouveau urbanisme = Nouveaux phénomènes urbains
• Inaptitude de la planification urbaine à gérer les phénomènes urbains et les
imprévisions de l’urbanisation.
• Rébellion des territoires contre les paradigmes des plans.
• La somme des documents d’urbanisme établis légalement constituent la
planification urbaine qui assure l’encadrement des développements des
territoires urbains et ruraux par moment et par endroit.
• L’Urbanisme, discipline d’action rationnelle et scientifique sur les espaces bâtis.
• Au Maroc, la planification urbaine est sous l’égide de la politique et des
invocations étrangères.
• Installation du protectorat : Vision à maîtriser le territoire et s’afficher à travers
l’espace.
• Maroc, 1914 : Promulgation de la première loi d’urbanisme appuyée sur
l’élaboration du SDAU de Rabat-Salé sans de même investir de manière à
superposer les études urbaines et les faits urbains.
• Le Maroc, laboratoire d’essai et d’expérimentation des politiques et des principes
urbaines
• Les invocations des méthodes étrangères dans l’urbanisme au Maroc ont
engendré une désarticulation de l’armature territoriale voire régression des villes
continentales, littoralisation, densification, paupérisation, prolifération de l’habitat
non réglementaire.
• Création des villes européennes et marginalisation des médinas. Ainsi que la
décision de faire de Rabat la capitale su nouveau régime colonial, ville à vision
politique et urbaine, le crayon fut l’urbanisme, la main fut la politique.
• Dressage des règlements d’urbanisme en 4 mois, le plan d’aménagement y fut
l’outil.
• Planification protectorale européenne ignorant les besoins des marocains
implique la résistance des territoires marocains dépassant même les outils
urbanistiques.
• Le document d’urbanisme, objectif de gestion des institutions humaines.
• Le rattachement de l’urbanisme au ministère de l’Intérieur accentue lui attribue
un cachet sécuritaire.
• 1944, Plan d’Ecochard de la ville de Rabat : configuration de la ville en zones
homogènes à deux radians de quartiers populaires implantés dans les sites les
moins favorables, intercalés par un troisième comme ensemble urbain aisé.
• 1956, Indépendance du territoire marocain se trouvant devant des défis
consistant en l’exode rurale et la prolifération de l’habitat réglementaire. Ayant
comme outil de solution, la planification urbaine.
• Option pour une économie libérale visant l’efficacité maximale alors que
l’urbanisme a demeuré centralisé et basé sur l’intervention de l’Etat à travers les
lois visant des solutions tranchées à caractère statique.
• Planification urbaine à orientations marquant le territoire en termes de tracé à
hiérarchie d’éléments consistant en les voiries au sommet, les ilots et les parcelles
à la base.
• Plan d’aménagement de Rabat réalisé par Prost, le réseau viaire basé sur les
anciennes pistes cavalières.
• Le secteur privé intervient dans la construction et la production de l’espace avec
des procédures à rythme différent de celui du secteur public.
• Vers les fins de 1960, institution d’un organisme pluridisciplinaire : Centre
d’Expérimentation, de Recherche et de Formation CERF.
• Vision d’inscrire de l’urbanisme dans une politique volontariste d’aménagement
du territoire, y assigner à chaque ville un rôle, traiter caque territoire selon sa
vocation et établir un urbanisme de concertation et d’incitation.
• Elaboration des Schémas d’Armature Rurales, et Loi cadre de l’aménagement
Urbain et Rural, proposant le Schéma Directeur et le Plan d’Utilisation des Sols.
• Remplacement de l’urbanisme d’incitation par un urbanisme de contrainte.
• 1971, Elaboration du SDAU proposant la mise en place d’un réseau de voirie,
l’extension linéaire du tissu urbain, la préservation des espaces verts, la création
de centres secondaires, zones industrielles, zones de sport et loisirs, zone
universitaire et la protection des sites naturels.
• Le SDAU 1971 bénéficient de l’influence de la dynamique des consultants
nationaux et du foncier public important.
• 1980, désormais, on s’est tourné vers le rapport des politiques urbaines étatiques,
les actions sociales et la diversification de l’occupation sociale de l’espace
urbain.
• 1981, Emeutes contre la marginalisation de certains espaces à Casablanca.
• Planification urbaine, outil de contrôle de population et de l’urbanisation.
• Processus de périurbanisation : Résorption des bidonvilles pour réaliser en
périphérie de grands établissements humains.
• Plan de Témara : Unités Urbaines-Rurales Auto suffisantes : développement du
potentiel agricole. Approche irréalisée vu le refus du rejet économique des
périphéries de Rabat.
• 1981 à 1995, Elaboration des Schéma Directeurs et des Plans d’Aménagement
monopolisée par un seul bureau d’étude piloté par Michael Pinseau à charge
des grandes villes.
• Entérinement du modèle socio spatial mise en place par l’urbanisme colonial et
renforcement par les documents d’urbanisme : La ville de Rabat se présente
toujours sous forme de deux radians populaires intercalées par des quartiers aisés.
Ainsi que le souci de la maîtrise de densité toujours présent.
• 1990, phase de planification urbaine du territoire et refonte de l’environnement
institutionnel de l’investissement, ayant comme conséquence la mise en pratique
de la procédure dérogatoire en urbanisme.
• L’Urbanisme à nouveau rôle suite à la dérogation : Générateur de dynamique
économique et sociale et incitateur à la création d’un environnement favorable
à l’investissement.
• 1994, Promulgation de la loi d’urbanisation 12-90, nouveau itinéraire des SDAU vit
le jour, à savoir la couverture d’un groupement d’agglomération.
• 1995, Elaboration d’un nouveau SDAU à aménagement territorial plus qu’urbain,
allant de Kénitra à Bouznika à options différentes mais sur une aire
d’aménagement plus grand avec orientation vers un aménagement par projet.
Cette différence conséquente de la différence des contextes des deux
documents : celui de 1971 sur fond de crise politique et économique, et celui en
1995 dans la période du plan d’ajustement structurel.
• SDAU 1995 disposant du cadre réglementaire de la nouvelle loi 12-90, mais à
foncier public rare.
• Lecture des plans d’aménagement montrant que l’habitat résidentiel individuel
occupe plus que la moitié de surface totale pour une capacité d’accueil d’une
minorité de population à un pourcentage moins du quart de la population.
• Décision de baisse de la densité de la capitale pour des raisons sécuritaires.
• Rétention par les petites et moyennes villes consistant les déversoirs des besoins
de l’urbanisation, participant dans la baisse de l’exode rurale : Urbanisation du
milieu rural.
• Nouvelles villes fut créées : Sala El jadida, Tamesna …
• 1998, le secteur de l’urbanisme mis sous la tutelle des socialistes à intérêt sur
l’aménagement du territoire.
• 2000, Retour de l’habitat suite à l’arrêt bilan de la phase de la planification
urbaine : Evaluation de la mise en œuvre des documents d’urbanisme par le
lancement de 4 études par l’Administration qui ont connu une défaite à
Casablanca et Taza.
• L’urbanisme désormais est vu à travers les projets urbains se réalisant en dehors
des documents de l’urbanisme.
• Subdivision du territoire en régions et le découpage a fait la transition de la
référence tribale à la référence urbaine.
• Projet urbain, nouvelles échelles d’intervention, outil de remodelage de
l’espace : antithèse du paradigme du plan, remède aux dysfonctionnements
que la planification urbaine n’a pas pu résoudre. Faisant du territoire un capital
d’investissement. (Rabat lumière comme exemple : mise en valeur des espaces
publics).
• Enjeux économiques non résolus vu la planification spatiale sans planification
économique et sociale.
• Villes alimentées par l’exode rurale : urbanisation fragmentée.
• Rejet des populations résidant avant l’aménagement d’une ville, fait preuve de
l’absence d’éthique dans la pensée de la planification urbaine marocaine.
Absence de respect du concept « droits des premiers occupants »
Conclusion :
• Ville marocaine à développement politique et social.
• Encadrement des territoires urbains se pliant aux documents d’urbanisme
• Territoires rebêles contre les paradigmes des plans.
• La planification urbaine n’a plus de capacité de maîtrise des phénomènes
urbains
• Solution proposée par l’auteur : Questionner le système de planification urbaine
en veillant à le relier avec le contexte où il opère.
You might also like
- Cahier de ChargeDocument22 pagesCahier de ChargeFatima Zahra DannamiNo ratings yet
- Métamorphose Des Styles ArchitecturauxDocument35 pagesMétamorphose Des Styles ArchitecturauxFatima Zahra DannamiNo ratings yet
- HTA FesDocument12 pagesHTA FesFatima Zahra DannamiNo ratings yet
- Martil Et Cabo Oueds Et ContraintesDocument14 pagesMartil Et Cabo Oueds Et ContraintesFatima Zahra DannamiNo ratings yet
- Sebta Du Projet de La Cité Linéaire À Une Gestion Urbaine Au PolitiqueDocument32 pagesSebta Du Projet de La Cité Linéaire À Une Gestion Urbaine Au PolitiqueFatima Zahra DannamiNo ratings yet
- DANNAMI Fatima Zahra Histoire Et Théorie Des VillesDocument5 pagesDANNAMI Fatima Zahra Histoire Et Théorie Des VillesFatima Zahra DannamiNo ratings yet
- Charte Visuelle Des Villes Mdiq Et FnideqDocument55 pagesCharte Visuelle Des Villes Mdiq Et FnideqFatima Zahra DannamiNo ratings yet
- Les Territoires Au Prisme de La Planification UrbaineDocument4 pagesLes Territoires Au Prisme de La Planification UrbaineFatima Zahra DannamiNo ratings yet
- Urbanisme TETOUANDocument48 pagesUrbanisme TETOUANFatima Zahra DannamiNo ratings yet