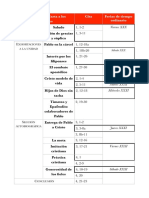Professional Documents
Culture Documents
La Sanctification Des Eaux Et La Fête
La Sanctification Des Eaux Et La Fête
Uploaded by
Santiago Martín Cañizares0 ratings0% found this document useful (0 votes)
27 views7 pagesOriginal Title
La sanctification des eaux et la fête
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
27 views7 pagesLa Sanctification Des Eaux Et La Fête
La Sanctification Des Eaux Et La Fête
Uploaded by
Santiago Martín CañizaresCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 7
53 [NICOLAS CERNOKRAK
‘Tous ces verbes sont au futur et montrent que 'accomplisse-
‘ment de la promesse commencera aprés « peu de temps ..», dans
le temps de VEglise.
Dans la tradition messianique ct liturgique de la bénédiction
et de la sanctification, saint Jean dans le discours d’adieu rend
indissociables la parole et limage. Si la bénédiction est le don
exprimé par la parole dans V'assemblée, image rappelle la sancti
fication et la venue du Paraclet, condition pour garder les par
roles et Jes images. L'hymnographie liturgique trouve son rythme
et ses formules précisément dans ce parallélisme parole/image,
comme le destin final — la bénédiction achevée. Si la parole du
Christ est vivifide par I'Esprit Saint, Ia bénédiction liturgique est
accomplice par l'épiclése: porter du fruit, c'est garder les paroles
cet demeurer en elles. Le discours annonce Ie nouveau retour du
Christ, du Paraclet et du Pere chez ceux qui gardent les paroles,
‘qui glorifient et qui aiment ... Ainsi 'Esprit ne vient plus pour
annoncer la venue messianique mais pour accomplir le retour
post-Pascal — l'eruvre de la Sainte Trinité.
Nrooras Ceanoxeax
Institut de Théologie orthodoxe
SaintSerge, Paris
LA SANCTIFICATION DES EAUX
ET LA FETE DE L'EPIPHANIE
DANS LA TRADITION SYRO-ANTIOCHIENNE ET SES DERIVEES
Dans toutes les Eglises Orientales — a la seule exception,
semble-vil, de la tradition syrienne-orientale (Assyro-Chaldéenne)
— la « sanctification des eaux » en la féte des Saintes Téophanies
compte, sans nul doute, parmi les fonctions liturgiques les plus
solennelles. Son étude cependant — comme dVailleurs sa signif:
cation propre — soulevent bien des questions qui sont loin d'etre
résolues, La structure du rituel, 'évolution — tant des textes
que du cérémonial — sont loin, dans l'état présent de nos con
naissances, d’étre connues avec la précision souhaitable. L’origine
méme de cette fonction et sa localisation premiére demeurent
insuffisamment assurées. Dans quelle mesure peut-on faire état
du passage bien connu d'une homélie de saint Jean Chrysostome
dont Tauthenticité demeure incertaine:
Car, cest Je jour oi il (le Christ) a 18 baptisé et ot il a
sonctife 1a nature des eaux. EC cest aussi pourquoi en cette
Solennité les chretiens se reunissent vers fe miliew de la nult, puis
Un ate tet, ext un seit Su fs mytires dc Ber
et de To : e me, ct méme plus violent
sneer de Foblaton, et encore pls ferme f
fegard de coun gut sublent quil wagit de benediction
Teas er non de suncifcation (ou conseoration
pe: utes er ses ie
sci Lac “Hani Cpa) a St
Ede
lg, ben tasters a a eatin Fondant
trois fois:
snéme done, Ro ami des hommes, render-vous présent
a clue Neue par la’ wenwe de votre Saint Esprit et se
Et de nouveau par trois fois & la fin de la pritre:
«Vous done maintenant, Seigneur, sanctifie. cette cat par votre
Saint Esprit»
est vrai que le Pontifical syrien atténue quelque peu cette
seconde formule, disant seulement:
ivent expressions explicitant les. bien:
ie d'expressions explicitant
Suivent toute une s i
faits que 'on attend de ces usages, avec dans chaque cas — com:
» Fol. 1M
LA SANCTIFICATION DES FAUX or
me diailleurs pour Ia formule précédente — un signe de croix
tracé au dessus des eaux sanctiides.
Bien que son centre d'intérét premier se porte sur un détail
énigmatique du cérémonial qui semble retenir Vattention des
fidéles *, Mgr Khoury-Sarkis s‘est trouvé conduit par Vexames
des textes de Jacques d’Edesse a s‘interroger sur la nature meme
du rite: bénédiction ou consécration? ”. 1 reconnait d'abord sane
hésiter: « Que les Syriens alent considéré, & une certaine epoque,
eau de l'Epiphanie comme ayant regu une sorte de consteration
par effusion et linhabitation de Esprit Saint, comme le saint
Myron, cela est plus que probable. Nous en avons la preuve
dans les éerits de Jacques d'Edesse ». Aprés en avoir cite quel.
ues passages, il continue & propos du texte de notre prigre 4}
« Nous noterons en passant lépiclése qu'elle contient; nous note-
ront également les mots employés pour demander 4 Dieu sa
benediction sur les eaux: barék w-kadesh’ = bénis et sanctife,
deux termes qui viennent de la messe pendant la consécration
du pain et du vin ..: Il prit du pain dans ses mains saintes, sans
tache et immaculées ... w-barék w-kadésh »,
Quant a la priere 5): « Outre Vépiclése qu'elle contient, com-
me la précédente, elle demande & Dieu qui crée et "tiansforme”
(rshahlef) toutes choses, de transformer (shatléf) les eaux quon
va bénir, par la vertu de son Esprit Saint. Les transformations
Peuvent s‘opérer de plusieurs manitres: en affectant la qualité
dun objet, sans toucher sa nature, comme ce fut le cas pour
les eaux de Mara et de Jéricho; ou en affectant la nature meme
de Vobjet, comme Yea de Chana changée en vin. Cette pritre
est done en relation étroite avec la précédente oit ces transforma
tions sont citées »
Wl estime enfin que la priére la plus traditionnelle ©) com:
Porte une véritable épiclese analogue & celles des anaphores euch.
ristiques des Constitutions Apostoliques, de la Liturgie de Saint
Jacques ou de la Liturgie syrienne des Douze Apdtres étroite-
ment apparentée & la Liturgie byzantine de Saint Jean Chrysos.
tome. Or le rite syrien, et ceux qui lui sont apparenies ou qu
en dérivent — cestadire tant le rite maronite que les rites
coptes et éthiopiens — ont modelé le rituel de la sanctification
des eaux sur fa Liturgie eucharistique, ainsi d'ailleurs qu'ils Yont
21 Fasit d'un personaage enveloppé d'un voile bane et communément
sppalé = Parrain du Christ» te, are eit n. 3. p 2e2is
art elt, p26,
8 _misatever pataaass
fait pour le rituel baptismal, Le déroulement est done devenu
beaucoup plus complexe que ne le prévoyait l’ancienne tradition
dont Jacques d’Edesse s'étaitefforeé, sans grand succes semble-ti,
de se faire le defenseur, et cela dés la fin du VII" siécle.
Diaprés le Pontifical de Michel le Grand, dont la disposition
8 616 depuis alors conservée & de minimes nuances prés, cet
office prend place au cours des vigiles (Lilyo) entre la seconde
et la troisitme station. Le rituel actuellement en usage I'a transté-
r€ aprés llofice duu matin (Sajrc) et les deux premiers services
‘qui précédent Ja Liturgie eucharistique. Le Pontifical Yorganise,
ssur Ia base des dispositions attsibuées & Jacques d’Edesse, selon
usage du grand monastére de Barsauma. La célébration s‘ouvre
par une premiére procession des ministres. Prigres et strophes
hymniques évoquent surtout le Baptéme du Christ et la sanctifi-
cation des eaux du Jourdain lorsque I'Esprit, comme tn feu, se
posa sur elles. Elargissant In perspective, le premier Sedro, cet
alément caractéristique de la liturgie syroantiochienne, eélébre
Yéclat et Ia diversité de Veruvre créatrice. Ces deux strophes,
‘chantées tandis que les diacres versent dans Ia vasque le contenu
des deux vases dans lesquels eau a été apportée, marquent
bien V'ampleur des themes évoqués:
tapitme ent ‘nncile dats te une Jourdain Lox foes ston
Fansembices, tes anges. sont terifics, le Hleuwe ‘rule it fea Qui
repose sur fui'®, Diew est descend il a été baptise dans les eaux
ourantes, tous ies fleaves, tous Les fontaines ont été sancties
Sur fe fleave se tenait le fot Davi, jusqu’a ee que epouse ait ie
Dbaptisgeet soit remontés des ea; i prt sa cithare el en joua devant
elle: Oublie ton peuple, la race de In.maison de ton pete, que Ie rot
Lssire ta Deauté. L'Bglise sainte et pauvre, sur le chainp est devenue
‘Fiche; voici quelle est une reine»
Cing lectures de VAT. (Gen 291-14; Bx 152227; Jud 74-8;
Ec 471-12; [3 12,1-6) achévent ce premier service construit sur le
type de T'office du matin (Safro) avec les Ps 50,148-150 et le Can-
tique de Marie,
Ce n'est encore la que préparation. Une nouvelle procession,
plus solennelle, se forme qui conduit jusqu’a Yambon la vasque
eau. Viennent alors les lectures du N-T. (Ac 8,2640); Heb 10,15-
25 et surtout I'évangile pris de Jn 4,4-42). L’offciant chante alors
sur le ton de Vanaphore les trois grandes pritres de bénédiction,
© Allusion & des évangles apocrsphs.
1A SANCTIFICATION DES EAUX o
il fait Yostension de la vasque en chantant le Trisagion, on récite
Yoraison dominicale et Voftice de vigile reprend son cours.
Cot ensemble complexe témoigne assurément d'une longue
Evolution dont nous ne pouvons malheureusement suivre les
Glapes depuis le rituel ts sobre auquel Jacques d'Fdesse de-
mandait avec insistance de s'en tenir.
Une premigre question est posée par la juxtaposition de deux
services, par leur insertion assez maladroite dars le déroulement
de Voflice des vigiles, d’autant que c'est Voffice du matin (Safro)
qui fournit le cadre du premier service auquel ont été jointes
les lectures vétérotestamentaires auxquelles Iz premier Sedro
sert dintroduetion en célébrant 'épanuissement de Voeuvre créa-
trice et notamment le rayonnement de la lumigre qui met fin aux
sénébres, ainsi que le surgissement des eaux qui suscitent Ia vie.
Phusieurs indices invitent & penser que, primiivement, ce pre
mier service s'accomplissait en plein air auprés d'une eau cou-
ante. Les ancients documents maronites sont d'ailleurs explicites,
sur ce point.
La rubrique initiale prescrit:
Pendant ta mut on fle sonmer ta coche. Les prétes t tes
dicpas se reanssent das Figtive et procstent, at premier te, 2
Silicon feta source «rand ors aoe teat dant
Iequel i» de Peon ancianne"' Tex préres etx cere, portant
tekns able turgiqes, sorte, tenant des lares, des enznslrs
iE Get Tabotes Or chante Hatlelaa. Vener zen aloes voit
Trbre plane a: bord de tenuret dons fe Fels ne ae fetit pas
1S sommet nice fig cleste, ef dans at batches In eolomibe
dh Sain Hope Sa racine Tepe Tea Gu baptemey les pecheurs
9 descendent sont apdage ts remontest puri, Vole Te
Thome dea jiation 0 entre Ia haoter nik quelle easing
{ins in cumre maptane et ee devient eine nando procession
Sorve da cone tes es, Ye dare proctans (on chandans Ai
‘Targele pits ae tent le Seignour dex mers et der ewes, 5
{Temunde de Fou ala ‘Smatiai, hi gut fit woaor les went et
euler le eamt‘Eemne,doonornot de Youu cat Ta sit oJ fe
Sloaneai Ie vie ctemelc. Ele ut népondi Le pate ext aba
frofond; dou aety Tea vivane pour que tt mel douoes? Eee
Fete gol bile de facob? Hatleaih, Halak»
Les dernitres rubriques de ce premier service prescrivent:
«Le prétre prend, dans Vencensoir, un charbon allumé et le jette
dans la source des eaux en disant: Au nom du Pére, qu’elles
0 TRENER-HENRI DALMAIS
soient purifiges »*. I renowelle ce geste deox autres fois en
invoquant les Personnes du Fils et du Saint Esprit.
Le theme de tout ce service — qui, depuis prés de deux sitcles
au moins se déroule Vintérieur de T’église avec une finale cu-
rieusement Iatinisée — est nettement baptismal, mais la réfé-
rence au Baptéine du Christ y tient pew de place.
Le second service, Iui, a pris au rite maronite une destina-
tion précise: il a pour objet V'eau qui sera réservée pour les
baptémes. La rubrique par laquelle il souvre déclare: « Si le
prétre veut conserver l'eau pour les baptémes qui seront admi
nistrés dans le courant de année, il met eau nouvelle devant
Fautel et il place une croix sur le goulot du vase qui la contient »
Tlest évident qu'une telle rubrique ne saurait étre trés ancienne
‘et quielle témoigne d'une influence latinisante. L’usage de con-
server ainsi l'eau baptismale a d'ailleurs été trbs. généralement
abandonné dans I'Bglise maronite. Comme il arrive souvent, nous
nous trouvons en présence d'une compilation tardive et de réar~
rangements. Il conviendrait de distinguer, avec plus de précision
cet sur des bases micux établies que ne I'a fait JM. Sauget, les
strates qui interférent,
De ce trop rapide regard sur une tradition apparentée &
celle de !Eglise syro-antiochienne mais qui présente de nombreux
traits originaux, nous voudrions seulement retenir combien, au
cours des temps, le service de la sanctification des eaux au cours
de la célébration de 'Epiphanie s'est ouvert 2 des perspectives
au'il ne semble pas avoir primitivement considsrées.
Une seconde question se trouve posée du fait que, dans les
traditions syro-antiochienne et appareniées ce rituel a été mo-
delé sur le déroulement de la célébration eucharistique. Aucune
sans doute n'a poussé cette conformité aussi loin que IEglise
copte. Le seul élement quelque peu exceptioanel est la place
faite aux lectures vétérotestamentaires qui sont habituellement
absentes dans la liturgie copte, Or, ici, on en trouve six, & la
suite de In pritre de Vencens: Hab 3,219; [s 40,15; 9,1-2; Bar
3,36 - 44; Be 36,25-29; 47,19. S'y trouvent 1 Cor 10,1-3 et Me 3,147,
Mais ensuite le service suit dans tous ses détails le déroulement
de la liturgie eucharistique, la priére traditionnelle pour la sancti-
"IM, Swworr, Bénddiction de rea dans te suit de Epiphanie selon
Mencions tradivion de VBplise maronit, dans Orient Syren 35 0959/3), 319578
[LA SANCTUFICATION DES EAU a
fication des eaux tenant la place de l'anaphore dont les éléments
épiclétiques sont particulitrement mis en relief, Et, aprés V'oral
son dominicale et les pritres traditionnelles de VAbsolution du
Fils, le célébrant élevant la croix quill tient dans sa main, pro-
‘lame: « Aux saints les choses saintes ». A quoi le diacre répond:
‘Amen, clest bien ainsi; et avec ton esprit ». Le célébrant signe
alors l'eau avec la croix en disant: « Bént soit le Seigneur Jésus
Christ, le Fils de Dieu. Sanctification du Saint Esprit». A quoi
Te peuple répond: « Un seul saint, le Pere; un scul saint, le Fils;
tun seul saint, "Esprit ». Enfin chacun est marqué au front avec
Yeau sanctifiée*.
Les Ethiopiens qui, on le sait, ont amplement développé tout
ce rituel ne se satisfont pas de cet attouchement et plongent
dans le vaste bassin en plein air dont les eaux ont été sanctifiges.
Il semble bien que Vimportance donnée & la « Féte du Baptéme »
(Tamgat) tienne pour une large part aux conditions de la lutte
contre les relents ce paganisme et de magie, ainsi qu’a la réac-
tion antistéfaniste sous le régne de Zaré's Ya'qob (14341468).
‘Ace trop rapide regard sur un buissonnement de traditions
dont on aurait voulu seulement faire percevoir Ia richesse, il
ne peut étre d’autre conclusion que des questionnements. Ce qui
met en lumiére, dans la diversité de ses expressions, le rite de la
« sanctification des eaux » — dans la perspective du Baptéme du
Christ et dune effusion nouvelle de 'Esprit qui reposait sur les
‘eaux aux origines de lauvre créatrice —, est que le Diew créa
teur ne cesse d’agir, au sein méme de ses eréatures et par leur
instrument, pour conduiire cette eréation vers son achévement
dans le Christ.
‘RENEE: HeNet DALMATS
Institut Catholique - Paris
* Ce B. Coens, La festa del Battesimo ¢ 1Bucaristia in Btiopia nel se-
colo XV (Silangee P. Pats T, Analecta Bollandlana 180, p- 86482) b propos
‘Gun manuscrit des Miracles de ia Vierse (BML Orient. 60).
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Alvar 2001 (Índice)Document4 pagesAlvar 2001 (Índice)Santiago Martín CañizaresNo ratings yet
- Alvar - Muñiz 2004Document4 pagesAlvar - Muñiz 2004Santiago Martín CañizaresNo ratings yet
- Alvar 1996Document17 pagesAlvar 1996Santiago Martín CañizaresNo ratings yet
- Phase 258 (2003) - Tra Le Sollecitudini Lectura TeologicaDocument9 pagesPhase 258 (2003) - Tra Le Sollecitudini Lectura TeologicaSantiago Martín CañizaresNo ratings yet
- Questions Liturgiques 80 (1999) - La Veneration de La Croix PDFDocument27 pagesQuestions Liturgiques 80 (1999) - La Veneration de La Croix PDFSantiago Martín CañizaresNo ratings yet
- López Quiroga, Jorge - Rodríguez Lovelle, Mónica (1995-1996)Document9 pagesLópez Quiroga, Jorge - Rodríguez Lovelle, Mónica (1995-1996)Santiago Martín CañizaresNo ratings yet
- Los Orígenes de La Navidad y EpifaníaDocument5 pagesLos Orígenes de La Navidad y EpifaníaSantiago Martín CañizaresNo ratings yet
- P. 84-85 e ÍndiceDocument2 pagesP. 84-85 e ÍndiceSantiago Martín CañizaresNo ratings yet
- Ritual de Igelsias y Altares...Document14 pagesRitual de Igelsias y Altares...Santiago Martín CañizaresNo ratings yet
- 204 205Document170 pages204 205Santiago Martín CañizaresNo ratings yet
- Duval - Février 1972 PDFDocument41 pagesDuval - Février 1972 PDFSantiago Martín CañizaresNo ratings yet
- Fernández Alonso 1955Document18 pagesFernández Alonso 1955Santiago Martín CañizaresNo ratings yet
- Liturgia Con Espíritu - MisaDocument1 pageLiturgia Con Espíritu - MisaSantiago Martín CañizaresNo ratings yet
- Carta A Los FilipensesDocument1 pageCarta A Los FilipensesSantiago Martín CañizaresNo ratings yet
- Novena de Las ÁnimasDocument28 pagesNovena de Las ÁnimasSantiago Martín CañizaresNo ratings yet
- 75 PDFDocument56 pages75 PDFSantiago Martín CañizaresNo ratings yet
- 117 PDFDocument48 pages117 PDFSantiago Martín CañizaresNo ratings yet
- Profesin de Fe y Juramento de Fidelidad A La Iglesia Palabras Mons Valera 2020 11 27Document2 pagesProfesin de Fe y Juramento de Fidelidad A La Iglesia Palabras Mons Valera 2020 11 27Santiago Martín CañizaresNo ratings yet