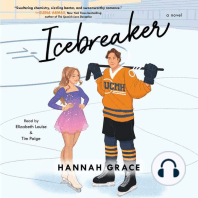Professional Documents
Culture Documents
BESSE - 2018 - Necessidade de Paisagem - Capitulo1
BESSE - 2018 - Necessidade de Paisagem - Capitulo1
Uploaded by
Patrícia Azevedo0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views18 pagesOriginal Title
BESSE_2018_Necessidade de paisagem_capitulo1
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views18 pagesBESSE - 2018 - Necessidade de Paisagem - Capitulo1
BESSE - 2018 - Necessidade de Paisagem - Capitulo1
Uploaded by
Patrícia AzevedoCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 18
Ty ale paysage décor, marchandise esthé-
tigue. Et il y a 'autre, le paysage profond, essentiel,
nécessaire. Un paysage certes reflet et dépot des
dégradations que lui inflige activité humaine ; mais,
néanmoins, dans le méme temps, miroir d’aspirations,
de pratiques et de désirs pour ’habitabilité du monde.
Les signes se multiplient aujourd’hui de nouveaux
rapports a la campagne et 4 la ville. Des formes de vie
différentes cherchent & s'expérimenter, des géogra-
phies alternatives apparaissent, ouvrant des horizons
nouveaux 4 la pensée du paysage et A sa conception.
Crest de ce contexte et de ces perspectives
que ce livre et la collection éponyme qu’il inaugure
entendent témoigner, dans une démarche résolument
pluridisciplinaire.
A ce premier opus d'une série de monogra-
phies et d’essais théoriques, il revient d’établir que le
paysage est une donnée constitutive et ineffagable de
existence humaine ; qu'il en est une condition, une
absolue nécessité.
Jean-Mare Besse est directeur de recherche au CuRS
et directeur détudes Ecole des houtes études
en sciences sociales. lest également co-drecteur
de reve Les Comets pasage. ens ty
le nationale supérieure de poysoge de Versailles.
tons: Le Godt du monde (2008) et
‘mon image (2013)
nécessité
Copyright © 2018, ations Porenthéses, Marslle
\wunsditionsporentheses.cam
IS@N 978.2-86364-400-2
_ Lattention
gu paysage
Nous parlons mal du paysage. Nous en parlons beaucoup pourtant,
mais pour le plus souvent Foublier dans nos actions et nos pensées,
Nous nly prétons pas une attention véritable, alors qu'il nous couche
de toutes parts, quil nous entoure et d'une certaine fagon nous,
regarde, Nous en parlons comme d'un décor plus ou moins agréable
A regarder, comme d'un cadre pittoresque propice & la réverie et &
la nostalgie, comme s'il était une amabilité du monde. Ou bien nous:
le voyons comme le thédtre repoussant de nos déjections indus-
les. Nous l'aimons et nous le dénongons. Et puis nous Youblions,
us passons 4 autre chose. Nous oublions le plus important en
fait: que le paysage, sil nous entoure, certes, sil nous environne,
fest aussi en nous, non pas comme une simple pensée, un souvenir,
fou une image mentale, mais comme une impression, une sensa-
tion & a fois puissante et diffuse. Nous oublions que le paysage est
"u qui nous affecte et dans lequel nous baignons,
ms, vons aussi. Il est une des conditions
agissons, pensons, déc
sensibles et émotionnelles de notre existence. Nous ne sommes pas
Seulement «dans» le paysage. 1 est une dimension constitutive de
Une des questions m:
Thumanité en tant qu’espéce et en tant que soc
che naite a condition écologique de son devenir, Elle est en crise,
ie connait de profonds et vastes bouleversements : modificaions
climatiques majeures, réduction effrayante de la biodiversité vege
iesurée et en apparence inréversible
et dappauvrissement des sols, de
au, élévation du niveau moyen des océans, auxquels
tion des catastrophes naturelles
5 que rencontre aujourd'hui
est celle qui
‘enfrichement
abandon de sites industriels, ete, ces faits désor
n établis provoquent dores et déja des transformations
considérables dans les modes de vie humains. Tous ces éléments
Se traduisent dans les paysages et leurs dégradations, qui en sont
Comme le refer et le dép6c. C’est Fexistence humaine, dans ves
fendltions et dans ses formes économiques, sociales, spatilen,
Sanitaies, qui est touchée par les bouleversements écologiques
contemporains.
rurd'hui denvisager ces données
ive. Mais non pas seulement en fone-
tion de leurs conséquences, Les observations sur dégradation de
aysages, n, sont multiples et précises et
ecaut& alt nécessaire d'approfondir Venguéte et de développer
is réflexion sur Vétatréel des paysages dans lesquels les soidvén
Contemporaines sont amenées & vivre. Je voudraistoutefois, dane
ce livre, orienter Fattention vers le paysage en consid
‘ton comme tne conséquence m:
‘part de Vexistence humaine.
de poser la question de Tétat du p
ie vais mietforcer de est une donnée constitu-
tive et ineffagable de la vie individuelle et sociale. On parle bean.
Coup aujourd'hui, & Yépoque de Vanthropocéne, de la nécesseg
ou de retrouver le sol terrestre de histoire
humaine’. Nous sommes entré, dit-on, dans la geohistoire Plus
Sie cnt motte épogue est celle de la géographie. De la géogra-
Phie comme écrture de Fhistoire sur la terre, géographie des lines
et des espaces, et aussi des actions, des usages, des pensées ot dee
sographie des hommes, des guerres, de la violence et
Dabs géographie des plantes et des bétes, de Iai, de Yeau, de
ére et des diverses fagons dont ils sont pergus, transforynés
st wécus. Le visage coneret de cette géographie, est le paysoge
Nous ne pouvons plus nous contenter de regarder les
Paysages comme de beaux décors et des marchandises consom-
iubles, Nous devons sortir des conceptions classques qui les
Fedulsent & ne que des objets esthétiques, issus, directement on
indirectement, du regard porté par les peintres sur
vérit
riches. ur organisa-
tion et ion possible. lls sont des miroirs des conditions
matérielles et morales
bien sur un pla
Paysage doit désormais devenir centrale
*s contemporaines, tant du point de vue écologique
que des points de vue économique, culture
Pavtage est une condition nécessaire pour la reformulation d'une
écologie pol
Sexpriment fortement,reflets de pratiques et de désing Tenouvelés
du monde. Le souci de développer de nouveaux
farbots & ts nature et a la ville, les perspectives ouvertes par
la transition énergétique et la critique de la not mn de croissance, la
urilisés quotidiennement, la promotion des circuits courts dans
‘mentation, Vessor des pratiques de jardinage, le retour de la
‘Question des communs, etc, sont autant de signes que, aussi
dans le public que chez les professionnels, des formes de vie diffé-
yentes cherchent& s'expérimenter, de nouvelles maniéres @habiter
{es paysages naturels et urbains se font jour, des formes alternatives
organisation et de pratique de Vespace apparaissent.
Crest dans ce contexte qu’émerge, chez les paysa-
sistes, les architectes et dans les sciences humaines et sociale,
june volonté de redéfinir la question du projet et de penser autre
‘ment les métiers du projet, Ia théorie et la pratique dela concep-
ifs dans le monde des jeunes
"affirmation du réle central des pratiques locales et
=xigence de la participation des hal
expertise surplombante au nom d'une
considération renouvelée des biens communs et des exigences
Morales et politiques du développement de la personne humaine,
de souci de Ia préservation des milieux vivants, la recherche de
4a sobriété, et peut-étre tout simplement le souci des lieux, sont
autant de caractéristiques nouvelles des métiers du paysage et de
architecture, et de signes de Youverture horizons nouveaux pour
la transformation des paysages et des espaces.
Ce livre, qui se veut propédeutique et reéflexif, se
compose de trois parties, dans lesquelles je mefforce de répondre &
trois séries de questions :
1 De quoi parlons-nous quand nous parlons du
Paysage ? Quel est, & ce moment, «objet»
Ascours, de nos pensées et de nos projets ? Quel est le paysaye de
‘os actions ? Que visons-nous quand nous lenvisageons ? Et, au
fond, de quelle nécessité humaine, sociale et politique, mais auset
‘morale, procédent le paysage et l'intérét que nous y portons ?
2/ Comment pouvons-nous déterminer une modalité
action vis-a-vis du paysage ? Ou, plus précisémen
vais essayer de l'établir, le paysage est une dimension esse
de la definition deta vie humaine, comment peut-on agir avec
fants et la remise
en est un, de nos
Plueét que seulement sur tui comme on le dit habituellement ?
Quelles sont les directions que devrait prendre une tele action au
sein des sociétés ?
3/ Comment pouvons-nous enseigner le paysage ?
Eduquer au paysage ? Quels dispositifs didactiques appelle-t-il de
fagon générale? Et quelle épistémologie réclame-t-il? Comment
le paysage pourra
sécole des arts de I
devrait contribuer ?
Cese & Pin
et pratique d'ensemble, oi se croise
>istémologie et la didactique, qu'il me semble que la néces-
étre aujourd hui reconnue t parcourue.
re est le premier d'une
fournit ses axes directeurs, Cette co
ine, Paysagistes,
fectes, artistes, historiens, sociologues, philosophes, anthro
Pologues, historiens d'art permettront de développer et dappro-
fondir les perspectives dans les trois directions qui vien!
esquissées : théorique, pratique et didactique.
Ce qui réunira ces ouvrages sera cependant un souci
commun: celui d'écablir et diillustrer la place fondamentale
Gu paysage dans Jes cultures contemporaines de Vespace et de
fonnement, et une volonté commune: celle de montrer en
quoi Fattention au paysage est devenue une nécessité pour cell
ct ceux qui se prévecupent de dé conditions pour une meil-
leure habitation du monde.
Ce sont, au bout du compte, les paysages de rhabiter
quil Sagira de dessiner,
Définir
séographie, histoire, ranthropologie,
le droit entre autres, développent
des représentations et des théories parfois trés différentes & son
et le but n'est pas ici d’en parcot
commentaire’,
au préalable ce qui va étve Pobjet di
roposerai done, dans les pages qui suivent, une approche progres-
sive de la notion de paysage, en la confrontant a des notions qui lui
Cette analyse distin:
en évidence ce qui con:
le caractére essentiel dur
paysage, & savoir sa dynami Le paysage est avant
ut constitué de relati est espace des ¥
métamorphoses : dans le paysage la nature, le territoire, la vue
fables au coeur desquell
is participent,
contient effectivement des
n'est pas seulement «la nature ».
‘ments «naturels», le paysage
Ce sont ces deux idées qu'il faut
‘enir ensemble, et dont il faut poser et penser la rel
Plusieurs des «éléments naturels» de la physique traditionnelle
sont des données premiéres de Yexpérience que nous faisons du
plus ou moins léger que nous respitons, le vent
tagne, la terre qui
hous nous enfongons, le sol
‘ui nous porte, le sable, la roche qui parfois gronde et sa
aussi Ia lumiére, la chaleur et le froi
dinsupportable sécheresse,
' plantes,
leurs odeurs, leurs couleurs, plus
déplacent...
lesquelles nos vies terrestres sont mises au contact et aussi 2
Teépreuve de réalités extérieures que nous appelons «naturelles»
¢* qui nous semble que nous constatons, que nous subissons, que
ous navons pas voulues mais qui nous accompagn
blement. Dans sa générosité méme ou bien dans sa violence, «la
‘ature, dans le paysage, est le nom que nous donnons & ce qui est.
au niveau de la famille ou du quartier. Ces
Paysages habituels que Yon traverse sans y penser, mais dont om
depuis nos fenétres dans leurs sono-
stallent et entretiennent par leur
Par leur permanence le plus souvent discréte, comme un
familier du monde, voire une ambiance dint
ions sociales durables, et peuvent
dans une histoire collective.
diidentité,
Jn dimension tertitoriale ne recouvre pas la total
du paysage. Plus généralement, comme Ia ét ippe
faut soutigner que toute relation la surface terrestre
pas de Tordre du territoire et de appropriation territoriale. Le
cept de territoire n'est pas universel et n'est pas nécessairement
‘plus approprié pour rendre compte des relations a la terve et des
‘ayes de la terre qui sont mis en ceuvre dans des sociétés qui nvont
adopté le dualisme naturaliste caractéristique des sociétés occi-
entales modernes ni développé une conception «productiviste »
lo Faction humaine vis-a-vis de la «nature »
: De fait, plusieurs aspects de la réalité, de Vexpérience,
‘#tde la pratique paysagéres viennent contester cette réduction &
_ tenitorialité et conduisent, au contraire, a dégager des situations,
des moments et des mouvements de
Je ne sais pas si Ton peut
arrive que des territoires s‘usent jusqu’a l’effacemes
se dispersent, se
et cette disparition lente ou rapide de l'éner~
érieurement les conduit vers une sorte de
une entropie du terri-
toire, qui vient défaire son organisation si l'on n'y prend garde, si
Yon ne 'entretient pas. Alors on perd le territoire. On entre dans
tun espace indécis. I] faudrait faire la géographie de ces lieux usés,
s'évanouissant presque sous le regard jusqu’a perdre leur sens, dans
une désertion de I'écriture territo
Pour autant, Veffacement du territoire niest pas néces-
sairement synonyme de la perte du paysage. Gilles Clément appelle
Tiers paysage «ensemble des lieux délaissés par homme».
Tiers paysage n'est pas un territ
Résultat d'un enfrichement agri
ou bien reste d’une exploitation impossible, c'est un espace qui n’
plus, ou pas, de fonction.
tion, comme le reflet d'un abandon. C’est pourtant dans ces marges,
au ceeur de ces espaces délaissés, que se réfugie
gique, végétale et ani
‘Aux marges des territoires anthropisés, le Tiers paysage, qui n'a pas.
de forme déte
Une des legons les plus riches des débats contemporains
en faveur d'une réévaluati
inée ni précongue, est un milieu vivant,
espéce et comme société doit composer. Il n'est pas un simple spec-
tacle, un décor & contempler, ou seulement le territoire produit par
tun projet social, économique, technique, il est également travers
centre espéces vivantes,
et les humains ne sont qu'un élément, certes parfois prédomi-
nant, dans ces rencontres et dans les ensembles qui en résultent,
Considéré en ce sens, & savoir comme un mi
‘est traversé par des ve
1e projetée par les humains, Se pose alors la que:
assemblages, dans les paysages, entre humains et non-humains,
animaux et végétaux, et des modalités de ces assemblages. Les
lement, Manifested Tiers-paysage, Rennes,
jucommun, 2016.
est désaffecté, déserté et sans affecta-
“if faut se mettre dans la cond
#6 bes temps des paysages ne se confondent pas et ne se
espaces et aux temps humains, on Ya dé dit:
paysoge conduit au-deli des stratéies occupa
Jon proprement territorial déployées pa les
uenaines,
Mas ce qui vaut sur le plan des objectivités paysagéres
des pratques et des expriences de
fs tervtoriaux les plus dérermi
il reste toujours la possbiité
de Tétendue, de Vaileurs, de
(dela transgression, du passage de la
oh des signes de propriété Jean-Francois Lyotard fait naitre
d'un moment particulier dans le rapport que le sujet
W avec le monde et avec soi-méme, moment
aysemenc, et qui est rien dautre que lr
ain indestination premire et fondamentale, «Une anse mari-
tun lac de montagne, un canal dans une métropole peuvent
i¥@ ainsi suspendus en dega de toute destination, humaine, divine,
falssés la» Le paysage, dans cete perspective, n'est pas
Aésinvesti des sign
est d’abord la rencontre de
tension originaire au sein de laquelle
té de Nexpérience,
Dioii cette relation profonde, fondamentale, entre le
‘paysage et le voyage, ou le nomadisme. Pour accéder au paysage
mn estrangement dont parle
Montaigne : voir le monde comme s
ays comme un étranger, dans une posture dextériorité et d’
Fité qui suspend en quelque sorte les habitudes visuel
significations attendues, et ainsi resti
nly @ pas de paysage sans cette espéce d'étonnement qui nous s
face a la contingence, la sul
‘ui se développent dans les lieux que nous visitons. Cet éronne
ment est la suspension du jugement nécessaire a
paysage, et Yon réve alors de renco
neurs silencieux, stupéfaits devant létrangeté des mondes quis
arcourent et découvrent. Comme sil fallat se déplacer physique:
ment dans espace, le traverser, pour mieux en sentir la grandeur et
les largesses
Ainsi, le paysage se trouve en deg ou au-dela du te
ot des différents
priation quile définissent. Peut envisagerle paysage
comme faisant partie des «choses communes», des «choses sans
rmaitres», a savoir des «choses» qui n'appartiennent personne et
dont usage est commun & tous, pour reprendre la formule du Code
civil frangais. I ser
peut pas étze compl
‘nous rappeler que nous ne pouvons pas disposer du monde terrestre
A notre guise, et que cel
trouvent, ne peuvent pas étre considérés uniquement comme des
biens appropriables. I faudrait au contrare, comme nous y invite le
paysage, penser positivemen
Vue
On ne peut contester Ia relation intime que le paysage entretient
avec la vue, Historiquement, culturellement, et pas seulement en
Europe, nous héritons d'une mn du paysage qui en fait un
monde de leil, un univers visuel (une vue sur Ie pays disent les
dictionnaires). Il serait utile, toutefois, de préciser et de nuancer
cette affirmation,
insi que les choses et les étres qui s'y
ct la complexité des organisa:
tions sociales, des pratiques territoriales et des manidres d'habiter
sur le chemin des prome-
visuels au sein desquels Ia relation
Wiviwe a &té élaborée, Différentes formes de regard
‘do voir» se sont succédé et coexistent encore dans
spaynayéres A la surface de la planéte. Ces regards diffé-
‘paysaye entrainent sans doute différentes facons de le
# ide le comprendre, conférant ainsi aux cultures paysa-
est important d’établir et de faire recon-
‘le paysage est atteint au ceeur de multiples expériences,
‘pas, ou pas seulement, visuelles. Les contacts avec le
fers les autres sens. Autrement
ialité et, 1a aus:
jmes, notamment en Europe, les héritiers d'une tradi
le qui nous invite a défi
Jquement et sociale-
rérature et les sciences jouent un
a peinture, la photographie, le cinéma ont insti-
set de techni-
‘intérieur des onga
Ahniques que celui-ci a 6cé désigné et défini comme «paysage>.
: ‘voquer les débats contemporains sur les
es et les localisations historiques et culturelles des repré-
ms paysagéres, on peut accorder que le monde terreste
lére générale, est devenu un paysage dés lors quill a é
‘et représenté comme t
‘egurd, artistique ou non, Autrement di
correspond a une histoire et & une géographie soci ‘nniques
et culturelles, du regard.
cence du paysage
regard sont sans aucun doute des con
guaient trois types de vues la catoptique, l'anoptique, . ire paysagére.
Savoir la vue frontale, la vue de haut et la contre plongée, Chacune © Néanmoins, le paysage ne peut pas étre réduit Ala
de ces modalités visuelles engage, o , 4 les simplement efficaces sur le plan
difference au réel et, au fond, cond: EF eon ne doic pas non plus se contenter de le ranger parm
suits sles arts de la représentation, Il porte
séme de la visibilité du monde terrestre qu’
une teneur affectives et morales
pons avec notre monde. Aux regards qui viennent d'étre évoques, |
dilleurs, Phistoire des cultures et des pratiques vis
Sraphiques en a ajouté beaucoup autres. Ain 4
sur les paysages, depuis la fenétre d'un train ou dune automobile la tristesse, le dégoit, la colére, le mépris ott la
traversant Fespace, a été insérée dans la gamme des ex 7 is heureux, tous les paysages
eptives du monde, et de méme, q peut aimer voir la Terre, on
é contemplative, na ajouté, au cours du q jal détester découvrir ce qu'elle est ou qu'elle est devenue,
1a possibitité concréte du parcours syt : maniére qu'un visage longtemps adoré peut désormais
mobile du paysage depuis un objet w Jn répugnance. Cette ambivalence affective traverse
Crest done a Yintérieur d : age et en un certain sens le dénonce comme prot
‘echniques de Ia perception, de la représentation et de la pratique {gas soelal et politiqne Fl signale et souligne la responsabilité
qu'il faut envisager la question du paysage, en tenant tache au fait de regarder. Regarder n'est pas un acte indif-
compte dela diversité, du renouvellement aussi, de ces techniques, ‘et neutre. Cest un engagement dans le monde, une émotion
et de leur impact sur les expériences et la notion méme de ussi une prise de position. Le paysage, monde de la vue, nous
Pat exemple, sux regards distants, comme en retrait duu monde, ‘et nous affecte de multiples maniéres.
Postés immobiles sur une hauteur, quiils soient regards admiratifs
oubien scrutateurs, on doit opposer les regards cliniques, impliqués
etrapprochés, attentifs aux détails mimuscules, de Vobservateur qui * ce rest pas seulement une
‘examine pas 4 pas, au fil de son chemin de promenade, les accidents ‘emotion paysagéres, qu’elles
du visible et les traces dispersées sur le sol. Crest dans la circula- ent également nos autres
tion entre ces modalités visuelles, naviguant entre la proximité loie simultanément
distance, Foblique et Ia frontalité, Vattention scrupuleuse et Fatten-
Mlottante, qu'un véritable art dobserver s'éléve et stexerce. : aa
anthropologue, du géographe, : res sens. Aux paysages visuels s'ajoutent les paysages sonores,
4 paysagiste, entre autres, participent tous dune méme aptitude des paysages olfactifs, les paysages tactiles, les paysages gustatif
4 toucher le monde par les yeux, pour ainsi dire. Cette du eau, le vent, la pluie, les oiseaux) et
istruit du nacuraliste, celui d
s sur le trottoir, les voix humaines), fabriquent des
paysages, ailleurs modifiables dans l'histoire en relation avec les
transformations de la vie sociale et des possibilités techniques. 11
y @une histoire et une géographie sonores du monde. Les paysages
ne sont pas seulement visibles, ils sont audibles également. Les
le bruit des
tel point quil est possible de parler d'une sorte d’organisation olfac-
del'espace dans es paysages naturels et urbains,
ont on peut tenter de fare la cartographie, aussi épisodique et frag
évoquer également une dimension gustative du paysage ? Ce n'est
pas seulement le godt du fruit ou de la plante que nous eueillons
au bord du chemin qu'il faut invoquer ici, mais aussi la sensualité
d'une couleur, d'une surface, d'une matiére qui nous invite, comme
y passer la langue : «fl y a bien des années
résidence D.L,James & Carinel (Califor
Henry Greene, je me suis senti poussé & magenouiller pour toucher
de la langue le seuil de marbre brillant de Ventyée. Les matériaux
sensuels et les détails délicatement ouvragés de architecture de
Carlo Scarpa, ainsi que les couleurs sensuelles des maisons de Luis
Barragin, évoquent souvent des expériences buccales. Les surfaces
aux couleurs délicieuses du stucco lustro, une teinte ou une surface
de bois bien polie soffrent aussi a 'appréciation de la langue.» Et
Vauteur d'insister : «L’origine la plus archaique de l'espace archi-
tectural est dans la eavité buceale.»
Au total, le paysage peut étre considéré comme une
composition de ces variables affectives que nous procurent nos
sensations corporelles, pour peu qu’on en soit conscient et qu'on y
soit attentif. Toutefois, la polysensorialité du paysage est plus ou
moins riche, elle peut étre réc
sens ou de nos organes perce}
) congue par Charles et
saa Le Regard des ens {2005}, Ps
2010, P67.
naturelles ow par manque d'ducation. Cet appauvrissement de
notre expérience, qui peut étre véritablement appelée une pauvreté
en monde ou en paysage, est aussi parfois la conséquence directe ou
Indirecte d'un état réel, ’est-a-dire social, technique et économique,
du monde. Quelles que soient les raisons (subjectives et objectives)
de cet appauvrissement sensoriel, celui-ci nous signale cependant
tune chose décisive : que le paysage est une donnée essentielle de
notre culture sensor plus précisément, quil y a une condi-
tion sensible, corporelle et affective de Pexistence humaine, dont le
paysage est une composante déterminante. L'idée d’une nécessité
du paysage est aussi celle d'une nécessité de la con
des sociétés, et elle conduit a interroger de fagon ct
é, Cest-a-dire les engagements du corps dans le monde,
Cette remarque nous permet daller au-dela de la
conception du paysage comme simple «cadre de vie», ou plutdt
‘elle nous permet 'approfondir cette notion, Plus qu'un cadre, ou
un contexte, de nos existences humaines, il faut eomprendre que
le paysage en est une forme sensible. Ses rythmes et ses intensi-
tésspatiales et temporelles, ses matiéres et ses qualités, constituent
les formes sensibles de In présence humaine au monde terrestre,
‘Autrement dit le paysage n'est pas un théitre vide et inerte que nos
de Fextérieu, remy
riques et personnels, et animer de sigifications affetives, sociales
‘1 politiques. Ni simple dépot de nos histoires ni dépotoir de nos
‘éyorements. Il y a une énergie dans le paysage, et elle ne se réduit
pas la notion de ressources énergétiques. Elle est plutot une puis
tance formatrice propre, qui joue
‘existences viendr dévénements histo-
des ordonnancements sen: lement notre
entrée dans le monde, en fournissant les formats et Jes contenus
premiers de ce qu’est pour nous le monde. Il existe quelque chose
‘comme une «santé» du paysage, ou, tout d
bbon droit poser la question des relations entre la santé humaine et
Je paysage. Celui-ci, comme forme de la sensibilité humaine plus
comme cadre extérieur et impassible de son déploiement, est
ins, 'on pourrait &
Venveloppe préalable et non réfléchie qui nous accompagne lorsque
‘nous nous élangons vers la surface de la Terre et ses espaces. IL
est comme la couleur ou Phumeur premiéres de nos actions, de
nos pensées, de nos imaginaires méme. Autrement dit, le paysage
fest un milieu sensoriel complet oit se déploient les échanges pas
toujours conscients et réfléchis des individus et des sociétés avec
les endroits du monde cerrestre ot ils se sont instalés.
Ce nest pas seulement la question de la «qualité» du
paysage qui est & envisager. Certes la dimension qualitative y est
Je paysage exprime tout simplement
‘en est une condition. Mais
il ne faudrait pas pour autant oblitérer la dimension quantitative,
cou, plus précisément il faudrait saisir que dans Vexpérience que
nous faisons du paysage, les quantités sont également des qual
je déterminant dans la défi
tence. Les bruits assourdissants
incontournable et essenti
du confort, ou non, de notre e3
qui envahissent notre paysage sonore auprés dune artére surchar-
ée d'automobiles, les luminosités excessives de nombreuses zones
urbaines, les odeurs pénibles qui imprégnent jusqu’ nos pensées
lorsque nous approchons de certains espaces agricoles ou indus:
signalent avec précision et vigueur impact qualitatif des
ifs de nos paysages. L’enjeu, notamment pour
les aménageurs, est alors celui de la détermination de la bonne
dire celui de l'ajustement entre le désirable et
«mesure», ces
le supportable, Réglage qui ne peut étre effectué que dans V'expé-
rience sensible, et qui ne peut étre prédéfini et prédéverminé dans
un bureau d’études.
Ambiance
Leespace du paysage, entrelacement vivant de Thumain et du
monde, est un espace pré-subjectf et pré-objectif. Cest Fespace
d'une relation, mais d'une ion qui précéde les termes qu'elle
telie, Crest Vespace de Thabiter qui se vit avant toute prise de
istance réflexive, si Yon entend par la que la réflexivité sera
Yopération «postérieure» qui va séparer ontologiquement le sujet
et Fobje érieur. Cet espace, cependant, posséde
deux faces, deux aspects distinets et concomitants : une face active,
qui correspond l'ensemble des gestes habituels par lesquels nous
‘aissons dans le monde, nous pratiquons le monde et en usons, et
lune face réceptive, qui correspond aux différentes maniéres dont
ctés par le monde oii nous nous tenons, Lespace
Ia fois actif et affectif
se de cété Faspect «
‘oncentre surla dimension affective
Daysage, est dabord véeu comme un état ou partir d'un &
hhumeur, dune situation affective ou d'une émotion, qui
au moi
autant, Yaffect ou T'émotion ne sont pas ici des sentiments «inté-
Hleurs», subjectifs, qui seraient provoques par la représentation
0 Texpérience d'une situation externe, objective, Ils sont plutée a
__ envisager phénoménologiquement comme des états pré-personnels
le Vétre humain, au sens od ils répercutent en lui et pour lui une
fertaine maniére d'étre traversé, voire d'étre envahi, par la teneur
«di monde a un moment donné.
Get état, ou humeut, ou émotion, ou plutét espace de
je Vappelle papsage. Essayons de faire apparaitre
pment ce qui caractérise, du point de vue phénomé-
nologique, cet espace émotionnel ou «tonal
Avrai dire, le mot espace est peut-étre déja trop fort,
‘Gop appuyé, par rapport la situ
Acre, et qui est marquée par
onfusion. Le paysage, phénoménologiquem¢
‘gomme une zone aux bords flous, comme un nuage au sein duguel
‘ous serions jetés sans y percevoir immédiatement des formes et
es ‘e quelque chose semble posséder une réalité objective,
sau sens pas purement intérieur 4 nous, comme une simple
feprésentation mentale : il nous traverse, stale
‘#8 nous, nous touche, nous pousse, bref c'est une expérience que
‘nous faisons, et qui nous affecte d'une fagon ou d'une autre. Mais en
aiéme cemps ce quelque chose ne se présente pas & nous comme un
‘momentanément, le «ton» de cet espace, sa tonalité, Pour
objet physique usuel, solide, dont nous pourrions saisir les contours
jons décrire comme une chaise ou un rocher. Il est
ertes, mais pour ainsi dire une réalieé inobjec-
tive. Une réalité qui n'est pas celle d'un objet tel que nous Venten-
mcontrons hal
présence et la puissance,
en nous. Le paysage serait la rl
touche et nous affecte. Nous sentons cette réalité «non objectale»,
nous y participons & notre maniére. L'inobjectif nest pas le vi
rien, Nous sommes affeetés par quelque chose qui ne ressemble pas
s physiques auxquels nous avons affaie habituellement,
avec leur substance et leur forme, mais qui nest pas rien: c'est une
réalité sans substance, et ajouterais quelle nest pas représentable.
Er pourtant elle nous touche.
La philosophie contemporaine nomme ambiance ou
sphere cette articulation entre un sentir non subj
réalité non objectale. Ces mots nous permettent de caractériser
plus précisément le paysage comme sentiment spatial ou sentiment
sographique.
Les choses qui nous entourent et dont nous faisons
expérience ne se présentent pas & nous enfermées dans une forme
strictement délimitée ni réduites leur pure et simple matéralité
Elles nous viennent dans une sorte de halo de sonorités, de couleurs,
de lumigres réfléchissantes, dombres, ou dodeurs. Les choses
viennent & nous d’abord au sein de cette zone qualitative quelles
projettent aucour et au-devant d'elles-mémes. Le philosophe alle-
mand Gernot Bahme parle des extases des choses, pour désigner
‘ces maniéres que les choses ont de se tenir au-dela d'elles-mémes,
dans leurs couleurs, leurs sonorités ou leurs textures apparentes.
Plus encore, les couleurs se répondent et se mélent dans Tombre et
lalumiére, les sons s'enchainent & autres sons, les couleurs et les
sonorités se détachent des choses matérielles et eréent ensemble
tun espace presque sol Cet espace qui flotte
autour des choses et qui leur donne leur relief et leur apparence,
est Fatmosphére ou ambiance.
6 de cette inobjectivité qui nous
Juoique non chos:
L’atmosphére est ce que le philosophe allemand
Hermann Schmitz appelle une semi-chose. Blle n'est pas, comme
‘on vient de le voir, une chose physique dans le sens usuel que nous
donnons a ce mot, cest-i-dire dotée d'une matérialité substan-
tlelle et d'une forme circonscrite. Elle n'est pas non plus une simple
| qualité extérieure des choses physiques. L'atmosphére posséde
lune sorte d'indépendance et une relative permanence, disons une
‘continuité ou une du tent celle que I'on trouve dans
les choses, sans quelle soit pourtant identique aux choses. C'est
lune réalité effective, quoique non physique ou chosale. Atmos
est Fair ou Vespéce de vapeur qui envelope les choses et qui leur
donne en méme temps leur aspect si Crest cet aspect, ce
relief, cette espéce de profondeur au sein de laquelle et par laquelle
t tres ont cherché & repré-
‘enter sur leurs toiles. Merleat-Ponty, parlant de Cézanne, rappelle
‘que le peintre ne peint pas le contour d'une pomme, car «le contour
des objets, concu comme une ligne qui les cerne, nlappartient pas
au monde visible, mais & la géométrie™>. Le peintre suit dans
‘une modulation colorée le renflement de Tobjet et en rend ainsi
Ia profondeur, cest-a-dire «la dimension qui nous donne la chose,
ais comme pleine de réserves et
shoses se présentent & nous que les ps
non comme étalée devant no
comme une réalité inépuisable
Dans Je méme temps, exactement dans le méme temps,
les qualités ou valeurs atmosphériques des choses, leurs appa-
ité que parce qu‘elles me touchent,
paree que je les sens, ou plutot parce que mon corps est disposé
A les recevoir. Crest cette réceptivité sensorielle qui rend effec-
tive la présence de cette phénoménalité. Autrement dit c'est parce
‘que mon corps s’expose, ou parce que je suis exposé par mon corps,
que je suis touché, affecté par ces extases des choses, cest-A-dire
par atmosphere qui les enveloppe et dans laquelle je les recois.
Au bout du compte, c'est la relation, ce nouage, cette
réversibilité entre exposition corporelle et extase phénoménale qui
constituent l'ambiance, ou encore la spatialité du paysage comme
icé tonale ou émotionnelle.
Rappelons-le encore une fois,
sur ce plan phénoménologique, rest pas de
physiques ou macérielles», il nest pas un objet au sens usuel dir
terme. Il n'est pas non plus une idée, une image ou une représenta
tion mentale. Il est le nom d'un état, une émotion, d'un sentiment
particulier qui n'est pas localisable & proprement parler mais qui est
13, lottant dans tout espace, c'est-&-dire présent en nous et autour
de nous, dans une maniére d’étre et un mouvement uniques”.
La question qu'il faudrait alors poser est la suivante
comment est-il possible de déterminer cette unité entre nous et
le monde que nous avons appelé paysage ? Comment, de quelle
maniére cette unité est-elle effectuée ? Par quels moyens ?
Nous savons que cette unité n'est pas objective, au
sens oi elle ne se trouve dans les choses matérielles. Nous savons
quelle n'est pas non plus le résultat dune opération synthétique
de la conscience, que ce soit au niveau du concept ou au niveau
de image. Autrement di 6 du paysage tel que je viens de
le définir n'est pas de Fordre de la représentation mentale. Cet
nité n'est ni objective ni subjective. Point décisif, qui signifie que
Yunité du paysage est d’abord et en premier lieu vécue, éprouvée,
sentie par le corps, et que nous devons chercher a identifier cette
cexpérience d'unité au niveau de la corporéité, et plus exactement
‘au niveau d'une corporéité la fois vivante et véeue.
Un rapprochement avec la musique nous permé
peut-étre de mieux saisir les enjeux de cette question, Parmi les
différents moyens qui permettent de produire l'unité dans le temps
musical, &c6té du tempo et de la mélodie, se trouve le rythme. Le
rythme est une maniére de définir les relations entre les durées
musicales, c'est une maniére organiser la durée. Mais cette régle
rythmique, qui certes peut étre représentée graphiquement et
conceptualisée, est d'abord vécue, qu’elle soit ressentie & 'audition
paysage, envisagé
wrdre des «choses
pour sa part la notion de
jon CEM Rosa,
ois Le musical
s6e dans le jeu. En deg méme de toute volonté musi-
rythme est une sorte de structure fondamentale a
cet dans laquelle on pergoit le monde environnant
-x¢on agit sur hui, Rythme nacurel des saisons, des jours et des nuits,
rythmes humains de nos routines sociales : c'est d'abord la que se
et au temps.
Sur ce méme mode, musical, on dira que le paysage
‘est dabord vécu et il se présente 4 nous immédiatement comme
lan rythme spatial c'est-i-dire comme une organisation ressen-
‘the de Vespace, comme une mesure des lieux et des distances que
"ous éprouvons en nous et autour de nous. Habiter cst entrer
dans ce rythme, c'est y participer et le vivre, ou plutét c'est donner
lune forme & notre existence en fonetion de ce rythme. De la méme
Jaaniére que le rythme musical est une maniére Porganiser la
durée vécue, le paysage comme rythme est une maniére d'orga-
inser Vespace vécu. De la méme maniére quill y a une temporal
‘gation de la durée brute (et une régle de cette temporalisation),
de Vétendue indéterminée (et une régle
ile cette spatialisation). Habiter espace et le temps c'est étre en.
‘gonversation permanente avec ce rythme ou cette mesure. C'est au
hiveau de ce que j'appelle le rythme du paysage que seffectue, du
‘poinc de vue phénoménologique, la synthése affective ou émotion-
pelle entre nous et le monde qui nous entoure et dans lequel nous
sommes situés, et non au niveau d'une représentation intellectuelle
‘ou imaginaire
Le paysage et les métamorphoses
‘Au terme du parcours qui vient d’étre effectué, le paysage appa
want cout comme une entité relationnelle. Ces deux termes,
surs, doivent étre commentés, « Entivé», car le paysage es
jer est un affect autant quill est un espace,
mais aussi un territoire organisé, prati-
est un mouvement, ou plut6t un ensemble plus ou.
moins ordonné de mouvements qui se cri
‘eux-mémes changeants et provisoires, il n'est pas complétement
cen forme nos relat
une chose que Ion peut poser face soi et encore moins tenir entre
ses mains. Bt pourtant il nous touche comme le ferait une chose,
comme une chose il présente des opacités, des relief, des ouver-
tures, des faces, des textures. Il est une «quasi-chose», autrement
dit une entité qu, sans étr elle-méme une chose au sens ordinaire
de ce terme, provoque chez les humains des sensations, évelle des
sentiments, et conduit a des actions comme le ferait une chose.
Le paysage engage une ontologie particuligre.
Le paysage est constitué de relations. Ce ne sont pas
seulement des relations entre un sujet et un objet et encore moins
4es relations uniquement visuelles. Car le paysage, comme on vient
de Tindiquer, nest pas un objet mais un assemblage d’étres et de
mouvements divers, assemblage qui est lui-méme traverse par
plusieurs processus de transformation. Ainsi le paysage accom-
pagne et souligne les transformations de Ia nature en territoire
est Fespace dans lequel la nature est transformée en histoire
et dans lequel Yhumanité, ses valeurs et ses actions, deviennent
le de la géohistoire, Le paysage est
le d'une autre série
de transformations, qui conduisent le territoire & déborder pour
ainsi dire au-dela de lui-méme, et Vouvre en horizon, en chemins
de départs, en transgressions de frontires, en expérience directe
d'un espace indéterminé. A Vintérieur du territoire, le paysage est
Ja possibilité toujours ouverte de bien des voyages.
Des voyages qui ne sont pas seulement visuels, et q
engagent au contraire toute la personne, corps et esprit eonfon-
dus, dans une suite ou une dispersion d'expériences oi tous les sens
sont mis en mouvement et intensifiés. Le paysage est une activa-
tion de nous-mémes dans le contact que nous avons avec les choses,
les étres et Fespace. I est véritablement une activation de nos pui
sances sensibles,cest-irdire de nos capacités& tre touches, sas
rus par le monde autour de nous. Le paysage, dit-on parfois, est
ation de Vespace. II faudrait prendre cette formule
au sérieus, car elle porte plus loin qu’an simple propos d’aménage-
‘ment : e paysage correspond a une expérience (et cette expérience
nature.
pace ete tervitoire
#epitrent de nouvelles qualités, ou renforcent leurs qualités dé}
pentose effectves. Lexpérience paysagdre transfigure espace
‘6b torvtoire en révélant en eux les puissances affectives et signi-
ene Is contiennent.
‘Payiagistes quedela préparer) dans laquell
‘Ainsi, au-dela du systéme des relations entre la nature,
ire et le regard humain, le paysage doit étre compris
_ sete un espace et un temps de transformations, de déplacements
int de la nature a Vhistoire et de Vhistoire & Vexpérience
{quelque chose a chaque fois passe et subsiste. La nature
nature dans le territoire et les pratiques de territorialisation
la ceaversent, le territoire ne disparait pas dans les regards qui
le serichit et se
- @ fe debordements qui en font une entité instable, dynamique,
ve. Plus encore : dans ces opérations de transformations qui
int en nous.
act du paysage. Aucrement dit, le paysage est un ensemble
§ wétamorphoses. C’est sans doute cette expression de «méta-
earphose» qui le caractérise le mieux. Dans la métamorphose en
piven fir, quoique sous une autre forme et une autre appa-
“Gage, Letre transformé existe toujours, quoique autrement et
Bee sure manire. La riviére, méme canalite ne disparate pas ni
Ss pusvance agi Ex isa dynamique i
ae
AL agit encore au cceur méme du terrtoire, li oft sa forme et son
‘apparence semblent s'étre effacées. Le paysage est le milieu et le
" sfaultat toujours changeant des métamorphoses qui le traversent.
Aces relations et ces échanges, & ces métamor
phoses, les humains participent, comme acteurs animés dinten-
‘hans parfois puissantes, et comme sujets affectés, touchés, mis en
ent au contact du monde, Toute une tradition subjectiviste
s'est efforcée de placer létre humain au centre du paysage, devant
ou au-dessus de lui, le paysage étant présenté (et vécu) comme
le contac des perceptions, des représentations et des pratiques
entendu, de remettre en cause
ontologique, morale et épistémologique de la présence
humaine. Les humains pergoivent, ant, transforment le
Paysage et ils le projettent. Toutefois ils nen sont pas nécessai
rement le centre fondateur et constitut
avec et dans le paysage, comme un de ses foyers métamorphique
comme des acteurs transigeant avec d'autres acteurs, en connexion
les autres puissances d'agir, habitant un théatre d
animé ex dont se sont pas les auteurs, Pour employer une auste
métaphore, Vespace du paysage est celui d'un tissage, Cest-d-di
su. qui en résulte et le processus de sa fabrication, qui
siinstalle et se développe au long des rapports quotidiens et ordi
naires que les étves humains entretiennent avec le lieu od ils vivent.
Les étres humains et le monde sont pris dans 'entrelacement de
ce tissu qui s'autoproduit en quelque sorte. Dans cet espace les
distinctions a ‘extérieur sont effacées ou bien ne
sont pas encore appartics, Ni extérieur ni intérieur ou bien les deux
en méme temps, espace du paysage est une zone de pa
de homme au monde et de la présence du monde en homme.
Reconnaitre la nécessité du paysage, c'est accepter ce
déplacement, intellectuel et pratique. Le paysa
par la société de transformer le pays
avec de m
OHAPITRE DEUX
Agir avec
le paysage
‘Les relations humaines au paysage se déploient en une large gamme
attitudes. Ainsi, sur le plan de la perception, des usages et des
affects; la contemplation esthétique et/ou 5
attentive, l'éducation au regard, la vue distraite, la présence affai-
‘he ou de simple loisir, la promenade qui fait de Vexpérience des
aysages une jouissance désintéressée. Ou encore, sur le plan de la
pratique et a : Fintervention, Yaménagement, rentretien,
a réparacion, la fabrication, Autrement dit les paysages ne sont pas
seulement sentis et vécus émotionnellement, ils sont également
\uilisés, pratiqués, et transformés de fagon plus ou moins consciente,
Crest sur les modalités de ces transforma-
juées, que j'aime
mnt. Les sociétés
isqu'd un certain
rraduisent des
Labsence de volonté paysagere, cest-a-dire le manque
ion, de consideration pour les paysages et pour la relation,
entretient avec eux, est encore lexpression d'une volonté,
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (353)
- Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A MemoirFrom EverandFriends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A MemoirRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (2141)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20060)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelFrom EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (5658)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 5 out of 5 stars5/5 (3296)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyFrom EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyRating: 4 out of 5 stars4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2485)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionFrom EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2507)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceFrom EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceRating: 4 out of 5 stars4/5 (2558)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationFrom EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationRating: 4 out of 5 stars4/5 (2499)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (2568)
- How To Win Friends And Influence PeopleFrom EverandHow To Win Friends And Influence PeopleRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6533)