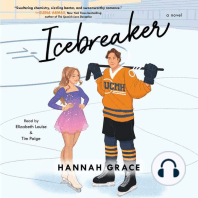Professional Documents
Culture Documents
BESSE - 2018 - Necessidade de Paisagem - Capitulo3 FR
BESSE - 2018 - Necessidade de Paisagem - Capitulo3 FR
Uploaded by
Patrícia Azevedo0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views38 pagesOriginal Title
BESSE_2018_Necessidade de paisagem_capitulo3 fr
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
7 views38 pagesBESSE - 2018 - Necessidade de Paisagem - Capitulo3 FR
BESSE - 2018 - Necessidade de Paisagem - Capitulo3 FR
Uploaded by
Patrícia AzevedoCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 38
Linventaire (en vérité non exhaustif) des directions A suivre
auxquelles les paysagistes et les collectivités qui les sollicitent
doivent étre attentifs dans les actions paysagéres permet de mettre
en évidence la complexité des enjeux (écologiques, sociaux, écono-
migues, etc.) auxquels ils sont confrontés, et la diversité des savoirs
et des savoir-faire qui sont impliqués dans Yaménagement et la
transformation des paysages. Au-dela de la nécessaire prise de
conscience de ces enjeux, se posent alors deux questions. Celle,
dune part, pour les paysagistes et les architectes, de l'acquisition
de ces différents savoirs et savoir-faire et de la capacité a les mettre
neuvre. Autrement dit, la question de la formation, ainsi que des
modéles et des principes directeurs de cette formation, dans et hors
des écoles. D’autre part, outre la formation spécifiquement adressée
aux (futurs) professionnels au sein des écoles de paysage et d’archi-
tecture, s'éléve aussi la nécessité d'une éducation plus générale au
=o dune éducation par le paysage, destinée non plus
nt aux paysagistes et aux architectes mais plus large-
Populations (habitants, acteurs institutionnels, décideurs
Ment aux
es dans organisation, l’entr
‘ion des cadres matériels et spatiaux de la vie coll
paysage engage donc une interrogation de type épistémoloy,
et didactique sur les modéles de formation, ainsi qu'une ee
sur les enjeux cultures et sociaux de 'éducation au paysage,
Ce chapitre traitera ces deux questions en trois é3,
Je rappellerai, dans un premier temps, quelques notions ding
taires concernant les savoirs nécessairement engagés dans la for,
tion a l'activité de projet. J'aborderai ensuite le positionnemen: 4,
paysage dans le domaine de la réflexion sur les savoirs, en pros,
sant l’analyse d’une des opérations cognitives mises en ceuvre dais
la démarche de projet ; la description. Enfin, aprés cette esquise
épistémologique, je proposerai une réflexion plus générale sur
nécessité d'une éducation au paysage (qui peut devenir aussi un:
éducation par le paysage), et sur les objectifs principaux d'une tele
éducation.
Liidée générale que je veux défendre dans ce chapite
est la suivante : il ne suffit pas de faire et de savoir construire, il fut
également, et peut-étre d’abord, savoir habiter. Le paysage est:
fois une condition et une expression de ce savoir habiter.
Les savoirs du projet
Lorsqu’on s’efforce de comprendre et de modéliser l’ac
projet et de rendre compte des compétences qu'elle mobilise, i"
den reconstituer la rationalité particuligre au-dela de apps
désordre et de Vopacité qu’elle oppose parfois V'analyse, &*™°
le souci de définir et d'organiser un dispositif de forma
observe que cette activité se déploie en fonction d’une structul®*
quatre péles, qui sont le plus souvent en tension dynamique jay
avec les autres. Je désignerai ces quatre piles qui opérent ca
projet par les termes «situation », «savoirs », «références”» aid
Chacun de ces pales est en interaction avec les trois autres &®
Yensemble quils constituent. L’activité de projet est P* e
quent un ensemble dynamique et instable, évolutif et ifféren™
caractére singulier d’un projet est fonction de l'accent
tivite de
‘ion,
qui est
Timent des autres. Certains projets sont plutét du
le «savoirs », d’autres du cété du péle «
‘méme structure fondamentale, mais des projets différents, en
nction des différentes maniéres dont ces péles sont investis par
ituation », etc.
Jes projeteurs.
Le projet est une « réponse » vis-a-vis d’un « probleme »
(spatial, social, écologique, etc.). Il propose une lecture et souvent
tne reformulation de ce probléme, et une démarche de résolution
quipasse par la définition de solutions, d’objectifs et la recherche de
moyens. Le projet indique les voies possibles pour une reconfigura-
tion du contexte problématique auquel il s’adresse et dans lequel il
sinsére, Les quatre péles qui vont étre détaillés dans les lignes qui
suivent sont des éléments déterminants dans cette opération de
reconfiguration. En ce sens, chacun de ces péles engage une forma-
tion spécifique. Toutefois c’est aussi l'ensemble de la structure qui
doit étre pris en compte dans la réflexion sur la constitution d’un
dispositif de formation au projet.
Situation
On utilise souvent le mot site dans les écoles et les
agences, pour désigner, en général, ce qui est appelé le contexte
stographique du projet. Cependant, méme si on peut lui accor-
der une certaine pertinence, ce terme ne me parait pas suffisant ni
‘atisfaisant, comme je I’ai déja indiqué. A la fois parce qu'il renvoie a
‘ine compréhension « naturaliste » de la géographie qui est obsoléte
“tréduetrice, et parce qu'elle est trop statique, trop « essentialiste »,
“Sens ot elle identifie le site avec une réalité spatiale substan-
ite dans laquelle les humains seraient placés, et face & laquelle ils
“nt agir, voire dont ils subiraient les déterminismes.
wee Or, les paysagistes sont moins face a un site (et encore
ace dun site naturel) que dans une situation, situation carac-
tgp, et Plusieurs composantes (dont le site n'est qu’une partie),
aires laquelle les paysagistes participent en tant qu'acteurs,
Aut £n tant qu’habitants et sujets affectés, si l'on peut dire.
dit, il me semble nécessaire d’intégrer un enseignement
rs la lecture et la transform:
f d’apprentissage ne large, gui prendrait ey
son compréhensive les Bicuations; et qui mettrait o,
éthodes d'investigation pour leundécryptage et permet
F a ir des modalités d'action pour y intervenir.
ee situation (c'est-a-dire, rappelons-le, le context,
contraignant et évolutif dans eae a eyed lequel le Paysagiste
développe ses propositions) peut étre définie co approchée comme
une entité complexe et mobile comprenant DES types de reali
tés qui sont en interactions constantes. Ces estes) qui const}
tuent les «données» de la situation, sont de plusieurs ordres. Oy
y trouve, certes, des données topographiques, géomorphologiques
hydrographiques, biologiques, climatiques, etc. caractéristiques dy
site, et qui donc déterminent les conditions abiotiques et biotiques
de l'action paysagére. On y trouve également des données sociales,
culturelles, économiques : une démographie plus ou moins dense
et diversifiée, des villes, des batiments, des voies de circulation,
des organisations territoriales, des opérateurs économiques, des
acteurs institutionnels, des habitants regroupés en associations,
des habitudes culturelles, des pratiques spatiales... bref tout un
ensemble spatial et social auquel le paysagiste, en tant qu’expert
ouen tant que résident provisoire, appartient et auquel il participe
selon son point de vue et en fonction de ses propres représentations
et de ses désirs. La situation comprend en outre des contraintes ét
des possibilités, a savoir des traditions juridiques, des obligations
réglementaires, des normes administratives, des injonctions pol’
es on. ensemble de codes prescriptifs dont le projete
» qu'il doit connaitre, et avec lesquels, peut-éu®
than “ Prose sinon a ruser. Enfin, la situatio"
données ea eee intervient comporte également !es
commande, piety ‘mplicites qui sont portées et engagées pa #
Programme, ses chro “ Par les objectifs des commanditaires, P*""
EES nologies et ses contraintes budgétaires, et
Foppent leur lesquelles les paysagistes 4&
le
complexes, et comportent “
trait de de!
tuations dans };
activité sont done
sions, écologiques, sociales, juridiques, politiques,
, qui jouent simultanément, qui sont contraignantes ou au
rraire favorisantes, et avec lesquels ils doivent apprendre a agir
ex a composer: Une formation au paysage implique nécessairement
Japrise en compte et la maitrise de ces différentes dimensions.
Savoirs
Corrélativement 4 l’analyse de la situation ou ils inter-
yiennent et dont ils sont partie prenante, et en réponse aux infor-
mations qu’ils ont pu collecter et rassembler, les projeteurs mettent
en ceuvre un ensemble d'outils intellectuels et pratiques, et mobi-
lisent des compétences cognitives et des savoirs de divers ordres.
Outillage intellectuel et compétences qui relévent, également, d'un
processus de formation.
On y trouve, d'une part, des savoirs de type «acadé-
migue», scientifique et artistique. Sciences de la terre et du climat,
science des sols, sciences du vivant et en particulier des végé-
taux, sciences sociales (géographie, sociologie, sciences politiques,
philosophie, histoire, droit) et, en outre, la littérature et les arts :
le spectre des savoirs convoqués par le paysage est extrémement
large, et cela correspond a la complexité des situations paysa-
géres elles-mémes, dont nous avons vu précédemment qu’elles se
déploient dans plusieurs dimensions simultanément.
On y trouve, d’autre part, des savoirs «techniques»,
essentiels pour la mise en ceuvre des conceptions et des proposi-
tions paysagéres. Le dessin, la photographie, la vidéo, la réalisation
de maquettes, la cartographie, l’informatique, les techniques de
communication verbale et écrite, jouent, A des titres et des degrés
divers, un rdle central dans I’élaboration des projets et dans les
Processus d’analyse, de description et de conception paysagéres.
lies savoirs paysagers ne sont pas seulement des savoirs acadé-
Tigues, au sens ow ils auraient leur fin en eux-mémes. Ils ont une
teneur opérationnelle, et, si les médiations techniques ont une
Place décisive dans les apprentissages du paysage, c'est parce que
"est au cceur méme de ces dispositifs techniques que la pensée
en se donnant un ensemble diversifié
ions. En ce sens, les savoirs que j'ai présentés comme «te¢]
niques» ne sont pas des savoirs secondaires par rapport aux savoir,
«académiques», et ils n’en sont surtout pas des illustrations. C’es,
dans les images qu'il fabrique, dans la succession des cartes qu’
dessine a différentes échelles, dans les maquettes qu'il construj,
dans les montages photographiques quiil compose, que le pays:
giste construit sa pensée, en donnant 4 ses idées et ses intuitions
des espaces de figuration, c'est-a-dire une visibilité et la possibilité
d'une réflexivité critique.
Outre les savoirs académiques et techniques, les paysa
gistes mobilisent des savoir-faire et ce qu’on pourrait appeler
terrain. Il ne suffit pas, en effet, pour le
de «savoir comment», il faut «savoir
| savoir
l'expérience ou le sens du
paysagiste, de « savoir que » et
pour quelles raisons on va mobiliser te!
autres en tel lieu. Plus exactement
gulidre dans
pourquoi» : savoir
et telle technique plutét que d’
savoir adapter, ajuster, ses savoirs 4 la situation sin,
laquelle il se trouve. Il nexiste pas de paysage général, il n'y a que
des cas A chaque fois différents, méme si certains se ressemblent. £t
Yenjeu est de proposer une solution qui soit 4 la hauteur de la part”
cularité de la situation rencontrée. Pour cela il faut savoir mobil
ser ses savoirs de facon inventive, et ne pas se contenter de repete!
les solutions déja connues et pratiquées. La notion de savoir-faité
correspond bien a cette capacité a aller plus loin que les regles
générales acquises, et 4 se les approprier de fagon créatrice, pout
proposer des solutions inattendues. Il existe un art du paysais
qui est d’abord un art de «sentir» le terrain. Mais ce « terrain»
pas seulement une topographie parsemée d’indices et su requel!
faudrait déployer ses compétences d’affat et de pistage- Cest ee
un terrain humain, social, politique, réglementaire, etc: Crest a
situation singuliére, dont il faut prendre la mesure. Liart dup
giste est un art de rigueur et de précision.
es
Tout concepteur emporte avec lui, consciemment ou
férence, qui vient nourrir son style propre,
hétiques, idéologiques et politiques, et lui
ropositions de transformation
s de tout contexte, ¥ compris
ultiplier les
une
maginaire de ré
s choix est
de les légitimer. Les p'
s’élévent jamais hor:
rorsqu etre en cause. On pourrait m
exemples cet égard, ou les relations avec une esthétique e'
jdéologie darriére-plan sont explicitement assumées. On connait
yerdle de la référence a Claude Lorrain et a une certaine relecture
dela culture an! s anglais du xvi" siécle. Pour
se part, Roberto que sa pratique de
paysagiste devait a ses relations avec le Mouvement moderne et
péenne du premier xx° siécle, et la puis-
Ja peinture abstraite euro]
référence al’acte pictural dans sa pratique de concep-
1 la topographie comme
sance de cette
teur : «Je me décidais, écrit-il, 4 utilise
surface de composition et les éléments naturels — minéraux, vége-
e les matériaux de Vorganisation plas-
—quejy trouvais comm
e nimporte quel artiste compose 4 partir
met parfois
des paysages n°
mn veut le rem
tique pour les jardin:
Burle Marx a reconnu tout ce
taux
tique, exactement comm
dela toile, des couleurs et des pinceaux'.» Aujourd’hui, alors que
de nombreux collectifs de paysagistes affirment la nécessité d'une
participation des habitants a |’élaboration des solutions de projet,
cest la référence a une esthétique pragmatique et relationnelle qui
semble s'imposer *.
Limaginaire référentiel des projeteurs se forme par
des lectures de tous ordres, par la fréquentation des ceuvres dart
du passé et du présent, et plus généralement par ce qu’on pourrait
appeler l'activation d’une culture générale qui s’acquiert aussi au
contact des écrivains et des artistes vivants. Il est fondamental, en
fescns, qu’au cours de leurs années de formation, les paysagistes
uissent rencontrer les mondes de l'art et de la littérature, dans et
io des écoles. Mais la nécessité du développement d'une culture
sénérale chez les paysagistes ne se réduit pas au choix et Ala mise
1 R Burle Marx, « Conceitos de composicao em paisa-
gismo», dans J. Tabacow (dir.), Burle Marx: Arte e paisa~
gem, Sao Pauio, Livraria Novel, 1987, P-1I-
N. Bourriaud, Eschétique relationnelle, Dijon,
Les Presses du Réel, 2001. = zl
euvre d'une référence esthétique. L’insertion des py
paysage dans des problématiques scientifiques, sociales, ¢,
miques et politiques, exige de la part des concepteurs la Capacig
A s’orienter dans ces problématiques,
en prendre la mesure, ety
définir un positionnement «philosophique» vis-a-vis des grangg,
options possibles en ces matiéres. C’est une intelligence Politique
au sens large du terme, qu’on envisage ici, c’est-d-dire une capaci,
A analyser une situation, a en saisir le sens, 4 adopter une Stratégie,
A poser des objectifs, a définir des moyens d'action, etc. et l'on yojy
mal comment le paysagiste pourrait la faire naitre et développe,
en lui dans l'ignorance et l’explicitation de ses propres références
scientifiques, idéologiques et politiques. L’enjeu de formation es:
sur ce point moins celui de l’acquisition d’une culture politique a.
sens réduit du terme que celui de la prise en charge des questions
du sens et de l’horizon politique de I’activité paysagére. Pourquoi
agir ainsi, avec tels objectifs et tels moyens, plutét que de telle
autre facon ? Quelles sont les raisons de ces choix ? Quelle ratio-
nalité veut-on promouvoir en tant que paysagiste ? Au nom de
quoi agit-on ? En fonction de quels horizons de référence ? Est-ce
la rationalité économique et I’horizon de la rentabilité, qui doivent
Yemporter ? Ou bien la rationalité écologique et horizon de lt
préservation des conditions environnementales ? Ou encore hot
zon, méme indéterminé, de l’émancipation humaine ? Ces diffe
rentes options peuvent-elles étre combinées, et de quelle maniére?
Telles sont les questions que les concepteurs doivent étre capable
Wexpliciter et de prendre en considération. r
Outre les références esthétiques et idéologico-Po"”
tiques, ce sont les références «professionnelles » qui nourrisse"*
Vimaginaire des concepteurs, L’histoire des paysages et des jardil®
est aussi l'histoire des paysagistes, des jardiniers, de leurs réali*
tions et de leurs projets, méme non aboutis. Et c’est par lbs
vation des projets et des réalisations du passé et du présent
se forment I'eeil, esprit et la main du concepteur, et peu
aussi quill apprend & préciser ses choix et a définir son «S'""
de travail. L’«art» ou le «métier» du paysagiste s‘acquiert
les autres professionnels et dans la circula-
Jes, des expériences, des idées, des propositions. On
f, cet égard, sous-estimer la valeur et la place de latelier
s concepteurs. L'atelier comme lieu du faire et
sla formation de:
des apprencissages qui y sont impliqués, mais aussi, et peut-étre
artout, comme lieu du faire avec et ensemble. L'atelier comme
Sige et vemps des transmissions et des échanges, et surtout de
yaddition des connaissances, des informations, des savoir-faire, des
opinions aussi. En relation avec la mobilisation des savoirs acadé-
pigues, les enseignements d'atelier, si on ne les réduit pas & un
simple apprentissage de techniques commodes pour la réalisation
de projets, si, au contraire, on les envisage généreusement comme
des conditions collectives de possibilité pour l’affirmation d'une
intelligence du monde, permettent la construction de l'expérience
et du savoir paysagistes, c’est-a-dire l'appropriation d'un métier.
Idée
L'Idée est le quatriéme péle de I’acti de projet (et
done de la formation). Je l’écris avec une majuscule pour indiquer
quelle ne se confond pas avec le fait d’avoir des idées, ou des repré-
sentations, ou des opinions. Saisir I'Idée, c'est plus que simplement
«avoir des idées ».
Iln'y a pas de projet (et peut-étre, plus généralement, il
ny apas d’ceuvre) s'il n'y a pas une Idée, c’est-a-dire un «point de
we», une forme organisatrice dans laquelle s’articule une propo-
sition. L'acquisition de cette Idée est le moment de la créativité a
proprement parler dans I’activité de projet. Ce qui conduit a trois
questions : comment définit-on (et donc comment reconnait-on)
cette Idée? Comment apparaissent, naissent, les Idées ? Quels
ony les dispositifs pédagogiques 4 mettre en place pour favoriser
Temergence des Idées, et donc la créativité ? Je me contente ici de
uelques remarques générales®.
innen La position que j'adopte ici est celle d’une épistémologie
is «intuitionniste» et « constructiviste ». L’activité de projet,
> Jeme permets de renvoyer, pour un développement
de cette question, a J.-M. Besse, Le Gotit du monde,
Exercices de paysage, Arles, Actes Sud/ENSP, 2009
(chap. 4 : « Cartographier, construire, inventer, Notes
en architecture, consiste en une circulatio}
«voir» et le «construire» : on doit d’abord savoir voir pour poy
construire, et savoir voir ce que Yon veut construire, mais symg
triquement on construit pour voir, on construit ce qu’on veut yoj,
ou ce qu’on cherche a voir. Circularité énigmatique du processus
de projet, qui mobilise l’cil, la main et lintellect, d’ot cependant |
forme émerge, comme proposition visuelle et comme organisation
de la pensée. Il serait possible de faire converger cette lecture des
activités de projet avec l'analyse épistémologique de I’émergence
des hypothéses dans le domaine des sciences et avec les recherches
sur la logique de la construction des connaissances. Autrement dit
faire servir les réflexions sur le projet en paysage et en architecture
ala compréhension des démarches inventives dans les sciences.
Le projet de paysage est 4 la fois description et inven
tion, proposition et révélation d’une forme qui est déja 1a, esquis
sée potentiellement, dans la situation. Mettre a jour cette forme,
Ja révéler en la dessinant : c’est un travail d’explicitation en meme
temps que de création. On pourrait peut-étre reformuler la situa
tion de la maniére suivante : projeter, c'est imaginer le réel. la
formule est volontairement ambigué. Projeter le paysage, ce serait
Ala fois le mettre en image ou le représenter (projection), et imas!
ner ce qu'il pourrait étre ou devenir (projétation). Cette ambiguité
ou cette circularité, est constitutive de la notion méme de projet
dans la pensée du paysage. Elle met en valeur les deux dimensio"s
contenues dans I’acte du projet : témoigner, d'une part, et modifies
dautre part.
Le projet est en méme temps une cartographie et une
requalification de la situation. Ce qui veut dire : il ne faut pas
opposer schématiquement le réel et le possible, mais envisager
réel dans la perspective des possibilités qu'il contient et quien ®
pu décrire. Le projet c'est la saisie des possibles dans le réel et *”
explicitation dans une proposition formelle, c’est-d-dire un aispe>’
tif simultanément spatial, social et environnemental. Ce dis?
est une reconfiguration de la réalité paysagére.
er le sens du mot «forme». Il ne doit pas
avec une «figure» ou un «contour». L'Idée, comme
fst pas une figure visuelle ou graphique simplement,
esiclle s‘incarne dans des figures graphiques, des dessins, des
mes, elle est avant tout une puissance, un élan, une mobili-
tion de la pensée ala recherche de son expression et de sa formu-
Fein Autrement dit, I'Idée n'est pas visible 4 proprement parler,
et la forme n’est pas le contour défini des choses faites mais la
force qui permet de les défaire et de les refaire, inlassablement, &
iarecherche d'une meilleure expression d’elle-méme, tout comme
}écrivain refait !'ouvrage dans l’espoir de trouver une parole plus
juste. Dans La Pensée et le Mouvant, Henri Bergson commente un
propos du philosophe Félix Ravaisson en ces termes ; «“Le secret
de l'art de dessiner est de découvrir dans chaque objet la maniére
particuliére dont se dirige 4 travers toute son étendue, telle qu’une
vague centrale qui se déploie en vagues superficielles, une certaine
ligne flexueuse qui est comme son axe générateur.” Cette ligne peut
dailleurs n’étre aucune des lignes visibles de la figure. Elle n'est
pas plus ici que 14 [mais] les lignes visibles de la figure remontent
vers un centre virtuel [qui est] le mouvement que I’ceil ne voit pas,
{et méme] derriére le mouvement lui-méme quelque chose de plus
secret encore. [...] [C’est un] art qui ne souligne pas les contours
matériels du modéle, qui ne les estompe pas davantage au profit
dun idéal abstrait, mais les concentre simplement autour de la
pensée latente*, »
Le paysagiste est a la recherche de cette « pensée
ltente» résidant dans le paysage, telle une vague qui traverse
toute l’étendue sans étre yue et qui pourtant lui donne son sens. Le
Projet est la tentative de saisir cette vague invisible, qui est comme
le «centre virtuel» de l’espace ott le paysagiste intervient.
Les quatre péles qui viennent d’étre détaillés (situation,
‘avoirs, références, Idée) constituent les dimensions de l’activité
Ales paysagistes etles enjeux de leur formation. Comme je !’ai dit, on
Pourrait classer les Projets, les projeteurs et leurs styles de travail,
® fonction des différentes maniéres qu’ils ont de s'approprier -
& i, Bergson, La Pensée et le Mouvant, cité par
G. Didi-Huberman dans Mouvements de Vai
chacun des péles. Cependant, tous, si peu que ce soit, méme sj ce
a des degrés divers, s'insérent de fagon active dans des Situation
complexes, mobilisent des savoirs et des savoir-faire, Mettent a
ceuvre leur culture générale, et formulent des propositions inva
tives. Du point de vue didactique, la question posée est alors cele
de l’élaboration de dispositifs qui prennent en compte et en cha, fe
chacun de ces péles ainsi que leur articulation différenciée ay sein
dun parcours général de formation.
Une épistémologie
de la description
Nous avons vu précédemment, a la suite de Joachim Ritter, ¢y
quoi le paysage pouvait étre considéré, dans histoire des cultures
savantes et artistiques européennes, comme la survivance et |;
reformulation des conceptions du monde pré-galiléennes et
pré-newtoniennes. Le concept de paysage prendrait désormais
en charge, mais sur le registre de la sensibilité et dans le cadre
d'une expérience de type esthétique, le rapport contemplatif au
cosmos caractéristique de la philosophie antique. Le paysage serait
le témoignage, dans la culture européenne moderne, de la perms
nence active du monde sublunaire, dont les sciences modernes arr
mées A une approche physico-mathématique de la nature se seraient
détournées. Le paysage serait, ainsi, l'expression de la coexistence
de deux cultures et de deux natures dans la modernité européenne,
dés lors divisée intérieurement entre science et art, et entre intel-
ité. Le paysage et les expériences paysagéres, cas
cette perspective, pouvaient 4 bon droit étre présentés, mais ass!
vécus et racontés, comme des figures de compensation, sur le plan
de lesthétique et de la vie intérieure, vis-a-vis de la froideur des
calculs égoistes déployés par la science et la technique dans les
sociétés modernes.
Il rest pas certain, cependant, que ce s
riographique dualiste soit totalement satisfaisant, s’agissan'
paysage et de son histoire dans les cultures européennes. S2”®
lect et sensil
chéma hist”
it du
ans analyse du parcours et de la géographie de ce Core
ses emplois dans l'Europe moderne (qui reste enc
on peut rappeler que le terme de paysage, dans ee
Sa de Europe (et notamment en iat cn oo De
sapord Une signification esthétique : plutét juridique et politique.
so dschaft (et Vensemble des termes de méme famille dans les
ma germaniques) designe es entité politique cy une forme
uvernement «local» qui Sa dans un CS oe
faire histoire du rapport paysager 4 la nature, Uinistonopy ani
gnerait, dés lors, 4 ne pas se contenter d'une archive Dead
Bae des arts, mais 4 explorer les Ee relevant de la pone
du droit politique. On pourrait montrer ainsi, par exemple, en quoi
Ja problématique contemporaine des CoE correspond, sur
Je plan territorial, 4 une histoire longue qui est celle des paysages
entendus comme espaces de gouvernementalité.
Le terme de paysage peut en outre étre inséré dans
une histoire des savoirs. Tout un pan de l'histoire des savoirs de
la premiére modernité reste sur ce point 4 explorer, dans une
optique qui n'est pas celle de la division entre pratiques savantes
et pratiques artistiques, mais au contraire celle de leurs croise-
ments et de leur association. Ainsi, pendant toute la période qui
court du x1v° au xvii" siécle, et probablement au-dela, on assiste a
une circulation des techniques de représentation et des acteurs, de
leurs habitudes de travail, etc. entre peinture et cartographie. Ces
phénoménes de transfert sont trés ordinaires. Dans l'histoire des
concepts et de l'organisation des pratiques savantes en géographie,
le paysage reléve de ce qui est appelé la chorographie, a savoir d'une
approche régionale et locale, qui se soucie plus d'imitation que
exactitude dans la représentation des lieux. La chorographie est
unart de la peinture des lieux, répéte-t-on a l’envi dans les traités
de la Renaissance, alors que Yapproche mathématicienne, fondée
surlamesure et la géométrie, reléve de la cosmographie. Le paysage,
soulignons-le, n'est pas rejeté, dans cette configuration épistémique,
hors du champ des savoirs. $'il suppose la mise en ceuvre de compé-
tenees qui sont aussi celles des artistes, ces compétences mémes, et
‘autres que je vais évoquer par la suite, sont mises au sey
représentation des territoires et de leurs contenus®. Si Jes a
graphes déterminent les positions des lieux en longitude et lat,
mesurent les distances qui les séparent, dessinent la forme Benérale
des territoires, les chorographes, tout & la fois peintres et saya,"
en élaborent le portrait. Ce qu'on appelle chorographie, et don
représentation des paysages, correspond par conséquent a |, Bh
en ceuvre d'un style de savoir spécifique en géographie, ot commy,
niquent sans difficulté particuliére des compétences cognitives,
des pratiques de représentation qu’une historiographie rétrospes
tive et, au fond, anachronique, sépare entre « science » et «arty,
Ce style se caractérise également par un second trait,
Dans un texte fondamental pour la compréhension de la structy
ration interne des savoirs géographiques de la premiére mode.
nité européenne, l’humaniste suisse Joachim Vadian distingue
deux approches de la géographie. L’une, qu'il appelle cosmographis,
engage un ensemble de savoirs qui reléve des mathématiques, de'as-
tronomie et de la géométrie. Pour présenter l'autre approche, quil
appelle géographie, Vadian rappelle que le géographe, «a l’énumé
ration des lieux, ajoute l'histoire, en indiquant Vorigine des cits,
des races, des nations, des peuples, et en plus d’ou viennent les
noms des choses, ainsi que les ouvrages prodigieux de la nature,
qui abondent sur la terre», et ainsi, affirme-t-il, « le géographe est
plus proche du poéte et de l’historien, en ce que leurs procédés de
description sont semblables. C’est pourquoi, comme nous pouvors
le voir si nous faisons attention, Strabon, Pline, et d’autres, vinret
au secours des Poétes et des Historiens dans leurs descriptions de
lieux de la terre ®. »
La géographie, telle que l’entend ici Vadian, met ¢
ceuvre des savoirs descriptifs. Lorsqu’il évoque «histoire, i
inscrit la géographie, et, au-dela, les savoirs du paysage,
0
5 C£.J-M. Besse, Voir la terre, Six essais sur le paysage
et la géographie, Arles, Actes Sud/ENSP, 2000.
© J. Vadian, In geographiam catechesis,dans:
Pomponii Melae Hispani, libri de situ orbis tres, adiectis
Toachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis : Addita
quosque in Geographiam Catechesi : & Epistola Vadiani
ad Agricolam digna lec, Vienne, 15:8, fol. A3vet
Agr.
‘enqueéte, de collection, de classement, et
ent des pratiques documentaires, qui se résument
im d'historia. Strabon, Pline, et aussi Hérodote, sont les
ints principaux de cet ensemble de savoirs qui s’appuient
Ja frequentation du terrain, sur l’observation des détails et des
jndices, sur la collecte des informations, sur leur accumulation et
jes problémes que cette accumulation pose pour leur mise en ordre.
Savoirs empiriques et savoirs documentaires, dont la persistance,
dans histoire moderne des cultures savantes européennes, d’une
signale que celles-ci ne peuvent étre identifiées ni réduites au
| paradigme galiléen-newtonien, mais qu’elles doivent au contraire
tre lues et comprises dans la diversité des régimes et de styles de
rationalité qu’elles contiennent, et d’autre part souligne la pauvreté,
au bout du compte, de opposition, dans Vhistoriographie, entre
«arty et «science’ ».
Les savoirs paysagers enjambent cette division, et, dans
lagamme des opérations cognitives qu’ils développent, ils mettent
en euvre des opérations descriptives et documentaires. Essayons
de préciser les caractéristiques et les effets de cette approche
descriptive.
D'un point de vue épistémologique et pédagogique, les
_ fatiques descriptives qui sont mises en oeuvre dans les savoirs et
les projets paysagers correspondent 4 des compétences de lecture
et @écriture, a savoir des compétences indiciaires, des compé-
tences documentaires, et des compétences d’assemblage ou de
composition.
Le postulat qui anime I’'approche du réel (et du projet)
ar la description est le suivant ; on peut tirer des legons des
choses, c'est-A-dire des territoires et des personnes qui y vivent,
en les regardant, en les observant, en les écoutant. Autrement
dit fl faut apprendre 4 regarder les choses, étant entendu que
"on na pas affaire 14. une opération naturelle et banale, et qu’au
_—Sittaire cette attitude implique la mise en ceuvre de pratiques
| Mtolectuelles, ainsi que d'outils d'investigation et de systémes de
c'est mettre en action un systéme de régles qui orientent la vis
Dans cette perspective descriptive, le Paysage
dabord, considéré comme une sorte de carte animée (une «9
vivante», dit Jackson) oi les étres humains peuvent découvn
quiil en est de leur condition et de leur histoire, sur le plan inj,
duel comme sur le plan collectif. Ce qui suppose la mise en ol
d'une herméneutique d'un genre particulier, qui est avant toy, wm
savoir indiciaire, un art du relevé, un art d’observer les surfaces
Ja distribution des phénoménes quis'y déploient, une attention ay
détails révélateurs, un art clinique. Dans un texte célebre, his,
rien Carlo Ginzburg a analysé avec précision les ressorts de cette
pratique sémiotique ainsi que les domaines oii elle pouvait sap»),
quer® : l'enquéte policiére, la psychanalyse, l'histoire de l'art par
exemple, & propos desquelles il a pu montrer en quoi elles pars
geaient un méme socle épistémique. La notoriété acquise par ce
texte a contribué a considérer de fagon extensive, dans un grand
nombre de secteurs du savoir que Ginzburg n’avait pas, pour sa par,
évoqués, la mise en ceuvre de ces techniques indiciaires. C'est le cas
pour le paysage et les savoirs du paysage, pour la géographie égele-
ment, mais aussi pour les autres sciences sociales, telle l'anthro-
pologie, qui se caractérisent par le souci accordé aux lecons issues
de la fréquentation du terrain, par I’'attention aux détails significa:
tifs, par un gott de l’observation, du dessin, de la photographie et
de l’écriture. La notion de pistage, et plus précisément de pistaze
spéculatif, telle qu’elle est développée par Baptiste Morizot dans
le prolongement des travaux de l'anthropologue Louis Liebenberg
correspond de fagon générique a cette forme d’intelligence os"
tive qui est déployée sur le terrain”.
Le paysage est une méthode, écrit pour sa part le philo
sophe et médecin Frangois Dagognet au moment oi il affirme lt
nécessité d'une science des traces, d'une tracéologie: «La fam
dont un phénoméne quelconque se dispose dans ses lignes ¢ sy
SC. Ginzburg, « Traces, Racines d'un paradigme indi-
ciaire» [1979], repris dans Myches emblémes traces,
, Verdier, 2010, p.219-294.
> °B, Morizot, Sur la piste animale, Arles, Actes Sud,
2018, chap. 6.
quily dessine nous éclaire sur Ia nature
simplement étalé. Il suffit de lire, de recueillir et
ie conserver, par-dela la quantité et mieux qu'elle, cette
on globale, les diverses zonations, la configuration que
udiée projette sur le sol 10» Dagognet rapporte cette
e «révolution épistémologique» qui se profile au
anouit au x1x*, II n'est pas stir que les savoirs du
sat
ine reait€
péthode & une
xvint siecle ets : 5 : P
re soient sortis de cette révolution-la.
gaysage so satre cette espece Thistoire longue de lintelligence
rears, Ia pratique de Ia description, dans la géographie
ee dans Vethnographie, l'histoire naturelle et la littéra-
notamment, me fn 7 ji
ure, s'inscrit dans la tradition de l’inventaire et de la construction
ture,
nces par listes et par tableaux.
e, c'est associer un nom et une liste
de thémes qui constituent simultanément des entrées analytiques,
des moyens pour amplifier, c’est-d-dire développer, le discours,
mais aussi les éléments d'un programme d’exploration du réel. Le
savoir ici mis en ceuvre n'est pas de type « géométrique » : il corres-
yond ila mise en place d'une liste et d'un ensemble de listes qui
rir et a remplir, afin d’accumuler des informations et
des connaissa
Décrire un paysag'
sont 4 parco'
de développer le discours.
Cependant, les opérations descriptives se caractérisent
par un ensemble de tensions et d’obstacles internes. Tensions,
tout d’abord, entre disponibilité sensorielle et procédures tech-
niques. Double difficulté ensuite, qui, d'une part, est provoquée
par Vhétérogénéité des régimes descriptifs (diversité des régimes
de production documentaire et des ontologies qui y sont associées),
et, autre part, est relative a l’accumulation en droit inachevée des
informations recueillies. I est nécessaire, pourtant, de produire une
image homogéne du paysage, et méme de produire une image aussi
compléte que possible du paysage afin d’en procurer une intelligi-
bilité, La description tente alors de rejoindre ce double objectif de
cloture et d’homogénéité, et cherche a répondre a ’hétérogénéité et
ATinachévement documentaires, voire a les résoudre.
10 _F, Dagognet, Une épistémologie de l’espace concret,
Néo-géographie, Paris, Vrin, 1 123.
A) La description nous conduit d’abord vers
nombre d’attitudes cognitives, que l'on désigne par des tg
voisins ; ceux d’attention, d’observation, d’affit, de lecture
d'écoute. Ces termes renvoient 4 la tradition trés ancienne 4
Vautopsie entendue au sens large comme technique des _ le
ou de la sensibilité. Relever les indices, glaner des information,
faire une collecte d’objets, se concentrer sur les détails reve,
teurs, savoir lire et interpréter les traces : toutes ces demas
impliquent une disponibilité cognitive au réel, une sympathie, a
moins une attitude réservée et silencieuse, qui permet de Tegarder
les faits «en face de fagon brute», comme le dit John Szarkowskj
4 propos de Walker Evans. Cependant, l’objectif final de toutes
ces techniques d’activation de la sensibilité sous toutes ses formes,
qui relévent comme nous I’avons vu d’une démarche clinique, a
dinventer le paysage, au sens archéologique du terme «invention, .
décrire, c'est faire apparaitre ce qui est déja 1a dans le paysage (es
comme faire une cartographie de son histoire, de son épaisseur, de
ses formes et de ses dynamiques, c’est-a-dire de ses orientations
potentielles), c’est dégager ce qui est déja la pour le porter au jour,
le rendre visible, perceptible, pensable. Mais cette visibilité est
obtenue au terme de la mise en ceuvre d’un certain nombre d’opéra-
tions de « dévoilement ».
Aussi, face A cette premiére orientation, celle de
la disponibilité, il en existe une seconde, totalement liée @ la
premiére quoique symétrique, et que j/appellerais une orients
tion vers la notation, l'inscription, l'archivage, la documents:
tion. L’opération descriptive est une opération documentaire, elle
consiste A produire, collecter, rassembler, ordonner des documents
de toute nature. Que signifie cette proposition (décrire c'est docu
menter) ? Ou plutét qu’est-ce que cela implique pour le rapport
au réel ? Tout enregistrement, visuel, sonore, graphique, on le s*
implique une mise en langage, un codage, c'est-a-dire 4 la fois h
mise en ceuvre d'un formalisme et un formatage. Il est possible 8
égard, de reprendre les réflexions de I’historien Michel de Cement
A propos de la notion de document en histoire et de les appliqué
frieur de cette tension que se développent
tions de description.
p) Revenons aux deux obstacles constitués par Theta
yn documentaires et sur leurs enjeux ontnd
lo.
généité et Taccumul:
giques et méthodologiques.
Les documents produits et utilisés par les Projeteurg
dans le cadre des opérations de description sont trés variés, ays
bien du point de vue de leur nature que de leur forme et de leur
contenu. Les supports documentaires, ainsi que les modes Cacqui.
sition, les apparences matérielles sous lesquelles les documens
sont présentés, sont hétérogenes. On parle alors d'une divers
des régimes documentaires : on y trouve des relevés de sen,
tions et d'ambiance, des notes ou journaux de terrains, des docy.
ments d’archives, des entretiens, des enregistrements sonores,
des photos, des vidéos, des films de fiction, des romans-photos, des
cartes d’échelles et de natures différentes, des textes, littéraires oy
non, des documents juridiques, etc. Ce qu’on appelle l’exploration
dun terrain de recherche correspond a la constitution, a la mobil-
sation et a la manipulation de cet ensemble documentaire dont on
voit bien qu'il conduit le chercheur et le projeteur dans des lieux
tras variés selon les moments : le site, le terrain, la bibliothéque, la
cartothéque, le musée, la cinémathéque, par exemple. On pourrait
méme aller plus loin et envisager Tidée que ce qu’on appelle le site, |
pour un paysagiste par exemple, correspond a Vensemble de ces |
matériaux documentaires au sein desquels il se donne A voir, a lire,
au sein desquels il se médiatise en quelque sorte et regoit un sens.
La diversité de cette documentation conduit @ rencon-
trer deux niveaux de difficulté : la premiére est lige a I’hétéroge-
néité des régimes documentaires, et la seconde est li¢e au caractére
cumulatif de la documentation.
L’hétérogénéité des régimes documentaires, qui mest
pas forcément absolue d’ailleurs, doit étre surtout envisagée du
point de vue de ses effets et de ses enjeux ontologiques. Autrement
dit: partir du moment oft nous posons que les objets auxquels les
documents font référence sont produits par les documents, ou plus
ott omentome
le genre de pratique documentaire adoptee par le
ou le projeteur, nous prenons conscience du fait que les
, ou plutdt les mondes d’objets auxquels ces documents nous
ent accés, peuvent eux-mémes étre hétérogénes. La pluralité
des pratiques documentaires conduit vers une pluralité des mondes,
une pluralité des ontologies, et pas simplement des modes de repré-
sentation. Il west pas du tout sar que j'ai affaire 4 la méme ville, par
exemple, selon que je me concentre sur les notations d’ambiance
quejentegstre en faisant de mon propre corps une sorte de sismo-
phe des valeurs et qualités spatiales, ou que j’adopte la méthode
des itinéraires, qui repose sur la photographie et l'interview d’inter-
Jocuteurs qui marchent dans la ville et y développent un récit, ou
bien encore que j’adopte le regard fonctionnel de l’ingénieur qui
cherche a y organiser et coordonner la régulation des circulations,
etc. Ces points sont bien conus, mais ils invitent 4 aller plus loin
que le simple constat de la diversité des langages, des représenta~
tions, des opinions, etc. On ne voit pas la méme chose, on ne vit
paslaméme chose, selon la méthode et l’outil d'investigation qu'on
adopte, car Youtil que nous utilisons n’ouvre pas au méme plan et
au méme ordre de réalité. Et donc, toute la question va étre celle
delacoordination de ces divers plans de réalité, de organisation de
cette pluralité des mondes et des modalités ontologiques.
La seconde difficulté est une difficulté classique dans la
théorie et ’histoire des pratiques descriptives. Elle se rencontrait
déja dans les grandes cosmographies descriptives de la Renaissance,
etelle se retrouve au fond de toutes les tentatives de type encyclo-
pédique, C’est la difficulté liée & la profusion documentaire, et plus
précisément encore au caractére en droit inachevé de V'accumula-
tion documentaire. Le questionnaire, méme s'il n’est pas infini, est
en droit largement ouvert. On se demande toujours s'il est possible
dachever la description, d’atteindre une description compléte :
¢st-on bien stir d’avoir tout vu, d’avoir tout dit, etc. ?
. Comment envisager donc, d’un point de vue épistémo-
logique, cette double difficulté : celle de l'hétérogenéité des régimes
‘ocumentaires (hétérogénéité des pratiques, des supports, et des
sroduetions), d'une part, et celle de l’allongement du qu
autre part ? Quels sont lenjeu et le probleme épistémologiqy
sont engagés ici ? Partons de deux exemples. Ati
Paola Vigano évoque l'ouvrage de Venturi, Scott Broy
et Izenour sur Las Vegas pour mettre en rapport la question, de |
transformation des objets urbains et celle des techniques d'obsey,,
tion et de description. Elle montre en quoi, ALas Vegas, pour sit
compte d'une situation spatiale 4 certains égards inédite, i] ais
ane collection dimages, de photos, de bandes filmées, de dessin,
de dépliants, de slogans, d’objets composés en collages, des saa
mies, des listes et des répertoires’*» afin de dégager un ordre Fit
ce qui paraissait confus et dispersé.
De son cété Michel Corajoud rappelle un aspect décisi
de sa pratique pédagogique : «Jobligeais tout le monde a tout coller
dans des cahiers. Il fallait faire comprendre aux étudiants que Je
“projet” n'est pas seulement une enclave de temps réservée a l'exer-
cice qu’on nomme ainsi, mais que le fait qu'on aille au cinéma, se
proméne ou rencontre quelqu’un participe de cette activité globale
qui rend finalement le projet perméable a lidée de ce film. D'une
certaine maniére, collectionner le billet d'entrée au cinéma symbo-
lise la préoccupation qui vous habite a l'égard du projet. Cétaient
des cahiers énormes que les étudiants fabriquaient et qui consti
tuaient un instrument de travail passionnant. Plus tard, jen ai
abandonné la pratique, mais je trouve cela dommage car c’étaient
z utiles et aujourd’hui encore tous les étudiants
alors se rappellent ces énormes cahiers ow tout était consigné”.»
La diversité documentaire et Vinventivité déployée
pour produire la collection documentaire importent moins ici que
la question de l’organisation de Ja collection elle-méme. Cette ques~
tion engage la constitution d’un espace de représentation, et en
Voccurrence la définition de régles d’organisation et de principes de
composition spécifiques pour 'espace documentaire, espace dans
lequel l'image du paysage décrit se met en place.
des outils asse
12 P. Vigand, Les Territoires de 'urbanisme, Genéve,
Metis Presses, 2012, P.142-
3 Citédans A. Pernet, Le Grand Paysage en projet
question est double donc : comment caractériser cet
Pune part, et comment caractériser les opérations cogni-
ges en ceuvre pour composer cet espace ?
Les textes de Venturi et Corajoud nous fournissent des
nents de réponse. Nous sommes du cété de pratiques compo-
onnelles * le collage, l’'assemblage, le montage. Ce sont des
patigues dont le postulat repose sur la croyance dans la vertu
roductrice, créatrice, de la juxtaposition, de la superposition, du
rapprochement cest-a-dire dans la vertu cognitive de gestes
patios appliqués sur un matériau documentaire hétérogéne, dont
on assume en quelque sorte I’hétérogénéité pour en tirer une lecon
ausujet des territoires concernés. Gilles Deleuze évoque, dans un
texte eonsacré a Leibniz, la possiblité d'une synthése sans totali-
sation. C'est le cas ici, dans cette démarche parataxique qui repose
sur la croyance dans la puissance cognitive de la spatialisation, de
Jacomposition spatiale, de la mise en place de dispositifs spatiaux
dans lesquels on range et réemploie des documents de toute nature,
pétérogenes, et deja constitués. Et, en vérité, cette pratique compo-
sitionnelle, qui est une pratique de second niveau, une pratique
de réemploi, correspond a une activation de T'imagination, au sens
que Georges Didi-Huberman, reprenant en quelque sorte l’héri-
tage baudelairien, donnait A cette faculté : «L’imagination n'est
pas la fantaisie gratuite ou purement personnelle, mais bien cette
recomposition du réel ott s’inventent les possibles 4 venir™*.» Il
faut sarréter 4 ces notions de composition et de recomposition, qui
sappliquent sur le matériel documentaire pour produire un arran-
gement, un ordre, dans le cadre duquel s’élabore la connaissance du
paysage.
mis
siti
Lanotion, un peu banalisée aujourd'hui, de dispositif, est
celle qui s'impose 4 ce stade de la réflexion : décrire, c'est produire
des dispositifs spatiaux au sein desquels les matériaux documen-
taires sont réemployés, c’est-a-dire rassemblés, juxtaposés, réor-
donnés par leur réemploi méme, resémantisés en quelque sorte.
Rappelons le sens donné a cette expression par Michel Foucault :
un dispositif, explique Foucault, est «un ensemble résolument
terogene, comportant des discours, des instit
gements architecturaux, des décisions réglementaire, des
mesures administratives, des énoncés scientifique:
tions philosophiques, morales, philanthropiques, bref:
bien que du non-dit. Le dispositif lui-méme, c'est le
peut établir entre ces éléments, »
On peut retenir deux as}
= Pro}
U dit,
Xéseau gunn
On
pects dans le propos de Fou
la dimension WMhétérogénéité, d'une part, et celle
part. On vient d’évoquer Thétérogeénéité. La not!
a elle, renvoie a la question des modes d’eni
gement, autrement dit des régimes narratifs
apparaitre une structure au sein méme de Thetérogéngirg docy.
mentaire, Quelles logiques de classement, d’association, enchs.
nement, d’assemblage, sont mises en ceuvre ? Lemboitemen:
analytique des échelles ? L’organisation séquentielle en fonction
dun itinéraire ? La mise en série ? La pure et simple juxtaposition
Parataxique, dans une sorte de confiance accordée au Carambo-
lage actif des documents posés les uns a cété des autres, déplaces of
replacés ? Mais on peut imaginer aussi d’autres modalités compo-
sitionnelles : le film, le récit, la cartographie, l’atlas, etc, Cest a
chaque fois un type de description, c’est-a-di
Paysage, qui est proposé.
Cault.
de réseau, day
ion de réseau, quan,
chainement, dara,
Aadoptés, afin de fair
re
ire de lecon sur |e
Au total, nous sommes conduits 4 nous interroger sur
la nature et sur la forme méme du dispositif spatial au sein duquel
la description est élaborée. Et, surtout, c’est la-dessus quill me
semble nécessaire d’insister, nous sommes amenés a reconnaitre
Ja valeur épistémique spécifique de l'espace de représentation en
tant que tel. Il faut envisager cet espace a la fois comme un support
matériel et comme un atelier au sein duquel la pensée se construit:
qu’on l’envisage comme une surface d’inscription,
comme une table
de montage,
comme une boite de fiches, un ensemble de panneaux,
de tableaux, etc, c'est 1a, sur ces surfaces, qui sont des espaces
Wenregistrement et de (re)composition du réel, que l'image du
Ppaysage se construit.
15M. Foucault, « Entrevue, Le jeu de Michel Foucault»,
Ornicar, n°10, 1 . 65.
luction de formes, de formalismes, de formules
rent des choses et des idées. L’espace est l'une de ces
;T’espace est un opérateur d’organisation et de rangement
pensée.
fvoquons alors un modéle possible de ce dispositif
spatial quiest produit par les opérations de description et en méme
‘enpstes rend possibles : atlas.
Je prends ici 'atlas comme forme visuelle/graphique de
construction, dorganisation, de présentation, et d'utilisation (ou
de lecture) des connaissances/informations. Considéré indépen-
damment des «contenus » qui y sont présentés (et notamment des
‘contenus: géographiques), mais plutét par rapport aux stratégies
yisuelles et graphiques qui s'y développent, l’atlas est une forme
déeriture extrémement efficace pour les opérations descriptives,
une forme qui permet l’enregistrement et la présentation visuelle
des informations, l’archivage, la conservation et le transport des
documents (par exemple ; cartographiques, iconographiques,
photographiques), ainsi que Yordonnancement de ces documents.
En outre, cette forme permet la composition des connaissances
et des objets, voire la production de connaissances nouvelles, par
lebiais des rapprochements et des combinaisons, c’est-a-dire des
(re)découpages et des (re)montages qui s’effectuent dans T’atlas
lui-méme. L’efficacité de la «forme atlas» est due également a sa
flexibilité, ainsi qu’ son inachévement structurel (I’atlas met en
uyre un principe d’accumulation : on peut toujours ajouter une
page ou une planche nouvelles). Cette combinaison entre rigueur et
ouverture dans la composition est sans aucun doute ce quia retenu
Tattention des scientifiques et des artistes dans leur recherche
de formes d'expression appropriées. II s'agirait donc, au bout du
compte, de s'emparer de cette forme-atlas pour la faire travailler
dans les opérations cognitives du projet. Je précise que j'entends ici
Par «forme» également des dispositifs pratiques et matériels, des
Procédures mentales ainsi que des gestes graphiques par exemple.
Videe est de développer une épistémologie des procédures de
bout du compte, qu'une épistémologie des opérations par Te
se fabriquent des espaces de connaissance.
Les opérations cognitives mises en ceuvre dans les de
recherche et de conception ne se limitent pas a cet
descriptive. L’analyse épistémologique fait apparait;
la présence de trois autres opérations,
d’évoquer rapidement.
A) Les opérations de conceptualisation,
une approche constructive de la connaissance et qui c
dun point de vue pédagogique, Ala mise en ceuvre de
de modélisation,
lemarches de
te approche
Te Egalement
que je me Contenteraj ici
qui activent
‘orrespondent,
Compétences
8) Les opérations hypothétiques, qui
élaborer des conjectures, et qui correspondent a ce
le régime fictionnel de la recherche et du projet.
c) Les opérations argumentatives, qui soulignent quela
recherche et le projet sont des activités collectives, reposant sur |
dialogue et l’échange des opinions.
A) Le but des opérations de conceptualisation est de
fournir un éclairage, une compréhension, et de donner un sens aux
situations paysagéres. L’objectif, en quelque sorte (qui est valable
aussi pour les autres opérations cognitives — la description, la
conjecture, la délibération), de mettre en place une structure inter-
prétative, abstraite, a partir et dans les termes de laquelle il devient
Possible de proposer une intelligibilité de ces situations paysageére.
La mise en place de cette structure interprétative
S'effectue au sein d'une opération de modélisation. Le modéle
€st avant tout une représentation structurale qui a pour fonction
organiser de facon a la fois programmatique et ouverte le champ
investigation empirique et de hiérarchiser le questionnement
Par rapport 4 ce champ empirique. Une bonne partie du travail des
chercheurs réside dans la recherche de cette structure organist”
trice. C’est un travail qu’on peut dire morphologique qui consiste*
Consistent 3
que j’appelle
le
ter depuis un autre domaine, par transposition
iabonne forme qui permettra d’éclairer et d’ordonner le
pirique :
Cependant le concept, comme modéle de la situation
tout une valeur opératoire et prospective :
ie que par ce quil permet de voir et de penser. Mais il ne
100 je» pas son objet, n’en est pas 'imitation, c'est un cadre
aire, un cadre dopérations. Autrement dit il est le schéme
e iagramme qui oriente une série de recherches, de proposi-
ce orques et de figurations graphiques. Dans cette théorie de
eye conceptuelle, il n’existe pas de séparation entre penser
acetals) voir, et dessiner ou tracer. On dessine, on trace,
voir et pour savoir ce que Yon pense et que l’on veut penser.
Autrement dit, une théorie constructive de la connaissance met
en évidence le travail simultané, ou tout du moins: coordonné, qui
seffectue sur le plan de la logique intellectuelle et sur le plan de la
figuration graphique. L’activité de conceptualisation est donc prin-
cjpalement un travail de imagination qui s’efforce de proposer des
formes, Cest-a-dire des figures et des relations, a l’expérience que
nous faisons des réalités paysagéres, pour en comprendre l’organi-
sation interne.
B) L’analyse des opérations conjecturales devrait nous
conduire a revenir de maniére critique sur quelques notions, que je
me contente d’évoquer :
—La notion de scénario que, pour ma part, je tendrai a
renplacer par celle de fiction, dans I’héritage de la philosophie du
«comme si» développée par Hans Vaihinger ”.
— En relation avec cette interrogation de la notion de
fiction, il faudrait évoquer la notion d'histoire contre-factuelle
ci teritoire (Qu'est-ce qui se passerait si? Qu’est-ce qui se
Strait passé si?), qui conduit A des propositions de reconfigura-
aa du territoire, et qui démontre en quelque sorte
nsion «expérimentale» de l'opération fictionnelle. Qui
re, posséde avant
16 Voir sur ce point J.-M. Besse, Le Gotit du monde,
op. cit. (chap. rv : « Cartographier, construire, inventer :
1otes pour une épistémologie de la démarche de projet »).
int Yahinger, La Philosophie du «comme si», Pars
ai
e, autrement dit, que la fiction ne s‘oppose pas au rég|
quielle en est une dimension : celle du possible. Qui nous ing
finalement, A assouplir le concept de ré
— La notion dimagination productive, dans thy,
tage des théories renaissantes de la «fantaisie» — Calving .
«Limagination est un endroit oi il pleut», & propos de Giordang
Bruno, dans ses Lecons américaines — ou dans celui des theories
de l'imaginaire radical — Castoriadis : limaginaire comme « facultg
originaire de poser et de se donner sur le mode de la Teprésentation
une chose et une relation qui ne sont pas (qui ne sont pas données
dans la perception ou ne I’ont jamais été) ».
c) Par ailleurs, il est nécessaire de développer tne
analyse épistémologique des opérations argumentatives et commy.
nicationnelles vis-a-vis du paysage, dans la mesure ot, comme on |e
sait bien, les activités projectuelles et les activités de recherche sont
développées au sein de collectifs d’acteurs, et plus généralement
dans la sphére publique (au sens large de ce terme : pas seulement
la sphére administrée par Y'Etat, mais aussi les espaces du marché et
ceux de ’auto-organisation de la société civile). Il faut souligner la
dimension performative du projet et des opérations cognitives quiy
sont engagées. L’espace est une performance collective.
Ce qui veut dire au moins deux choses :
D’une part que les opérations cognitives sont sociale
ment distribuées au sein d’une pluralité d’acteurs dont les savoits,
les savoir-faire, les représentations, les intéréts le plus souvent
divergent, voire s‘opposent. En ce cas, les opérations de connais-
sance propres au projeteur ne peuvent pas étre séparées des activ"
tés communicationnelles par lesquelles le projeteur confronte sé
compétences cognitives a celles des autres acteurs (institutionnels
politiques, habitants, etc.) avec lesquels il travaille.
D’autre part, affirmer que le projet, comme la recherché
se développent dans des espaces publics et dans la sphere publigu®
se rent
et qu’en tant que tels impliquent, engagent, la pluralité, celate"™
18 Q Deluermoz et P. Singaravelou, Pour une histoire
des possibles, Analyses contrefactuelles et futurs non
advenus, Paris, Seuil, 2016. ;
1° C. Castoriadis, L'Insticucion imaginaire dela société,
ts opérations se déploient dans un espace de la dépos-
un espace des croisements des savoirs et des représenta-
espace non appropriable par un expert ou un groupe quel qu'il
Tout l'enjeu de cette situation cognitive de type dialo-
jque est de parvenir 4 conduire cette pluralité des acteurs vers
qausein d'un projet commun. C'est le sens méme de la notion
destion collective qui est ici engagé. Ce qui demande du temps,
jeaucoup de temps : la durée de la conversation, du dialogue, de
jacontroverse, de l’échange des arguments et des points de vue, et
delarecherche d'un accord, méme provisoire. La proposition pour
me stratégie de l'espace, qui est élaborée par le projeteur, doit
sinsérer au bout du compte dans une stratégie collective.
On pourrait reformuler cette question a partir de la
thématique actuelle des communs, ou plutét du commun, quil
faut comprendre comme élaboration de pratiques communes et
comme institution de régles d’action communes déterminées sur
Inbase d'une délibération collective*®, La communauté politique
se constitue a partir de la reconnaissance et de I’élaboration d'un
sens commun, de significations communes, d’un projet commun.
Silespace public, c’est-a-dire politique, doit étre compris comme
tne performance collective, Y'enjeu est que cette performance
parvienne 4 devenir commune.
Le paysage
? 1 r
comme éducation a lattention
Jaitenté, dans les pages précédentes, de faire apparaitre en quoi
kts relations cognitives et pratiques que les paysagistes et les
‘chitectes entretiennent avec le paysage mettent en jeu leurs
‘apacités 4 percevoir, a observer, a décrire, et aussi a «sentir» les
Situations dans lesquelles ils se trouvent, c’est-a-dire a reconnaitre
‘eus dynamiques internes, et a s'y insérer pour mettre en place de
*aueaux assemblages et d’autres configurations. L’art du paysage
‘lar de se glisser a lintérieur du monde, de s’accorder (au sens
2% Voirace sujet le dossier «
te jes multiples sij
ent en tous sens, et de tisser avec elles une histoire
dant, penser et agir avec le paysage, de la maniérg
que j'ai suggéree, présuppose la mise en euvie d'une disposition
mentale, affective et pratique, que Yon peut désigner par le terme
attention. Penser et agir avec le paysage cest d’abord y étre atten.
tif, ety faire attention. Le paysage engage,
capacités du paysagiste, mais aussi de tout un chacun, a l’attention,
Notre époque, entend-on souvent dire, est celle d'une
crise de Fattention, et plus précisément d'un affaiblissement des
capacités attentionnelles, a ’école et dans la société. Les raisons
que Ion donne de cette crise sont diverses : développement des
outils numériques avec leurs effets anthropologiques « dispersifs»
sur les régimes de perception, stratégies d’excitation visuelle et
mentale déployées par l'industrie du divertissement et des médias
A Tage du capitalisme néo-libéral, techniques de manipulation de
Ja curiosité déployées par les firmes dans le monde de la consom-
mation de masse, accumulation exponentielle des données et des
informations qu'il devient impossible de traiter de maniére synthe-
tique, etc. Il existe, comme le rappelle avec vigueur Yves Citton,
une économie et une politique de ’attention, et la réflexion sur les
régimes d’attention et leurs transformations contemporaines est
aujourd'hui devenue cruciale, dans la perspective d'une réflexion
fondamentale sur les dispositifs et les conditions de I’habitation du
monde par les humains”.
Le paysage est lui aussi traversé par cette question du
devenir de Vattention et des capacités attentionnelles de Vu
humain, La situation du paysage est a cet égard ambivalente. Fn
effet, d'un edt, on peut observer bien des phénoménes dinatter™
oe a he le regarde méme pas, on nen pe
ou plutét le fond loint ane a ny pee poe in ce ee e ee
ee cea uae humaines considérées ca
ae an se a le plus souvent, comme je ae
nan a a le aysage semble ere aus
sensibilité et de l'expérience un
commune. Cepen
explicitement ou non, les
a
seul scion, Pour une écologie de Vattention, Pai
peut étre restituée. Autrement dit, le paysage, c'est du
nypothese que je vais explorer dans les pages qui suivent,
@ere envisagé comme un dispositif d’attention au réel, et par la
e une condition de base de I’activation ou de la réactivation
pport sensible, et sensé, au monde environnant.
Comme Yves Citton le rappelle, «notre individuation
gesenourtie que des échos générés en nous par les circuits informa-
dunt
tionnels qui nous traversent et nous constituent, mais notre activité
pre, en tant qu ‘individus, consiste a projeter sur ces informations
des cadres interprétatifs seuls capables de leur conférer une signi-
tion”? ». Le paysage est I’un de ces cadres interprétatifs. Sur le
node particulier qui est le sien, a savoir celui de la sensibilité, il est
um opérateur central dans les dispositifs d’attribution de la signi-
fication, et d’abord parce que, comme nous I’avons vu au chapitre
deux, il est le milieu du sens. Il est articulation sensible de I'habi-
ter humain.
Le propos d’Yves Citton nous indique également un
autre enjeu de la présence du paysage au sein des dispositifs atten-
tionnels : individuation. Autrement dit le paysage est une condi-
tion et une dimension de la constitution de l’individualité humaine,
dans sa capacité a devenir un foyer de sens. En cela, et parce qu'il est
une des conditions permettant a l’étre humain de se sentir, comme
une personne, en se sentant appartenir au monde, le paysage est
Porteur d’une puissance d’émancipation pour les humains.
Lattention est simultanément une puissance cogni-
tive, éthique, et eschatologique (si du moins I’on détache ce dernier
teme des connotations religieuses qui lui sont habituellement
“uachées, pour l'envisager avant tout comme l’ouverture du temps
Verse futur, comme présence de I’horizon au sein du présent). Etre
atentif, faire attention, se tenir dans l’attente : ces trois attitudes,
§S toujours articulées l'une a l'autre, forment les trois dimen-
de Pw attentionnalité ». Elles tapissent de fagon permanente,
Souvent de fagon implicite, les relations humaines au
% Ibid. p.274 (souligné par Y. Citton).
nous l’avons déja vu, de plusieurs facons, Bile
1 d’observation, un attachement clinique ayy
écouter, gouiter, sentir, bref une mobilisation
Ase tenir a l'affait et pour aing}
mplique une riguew)
traces, Un savoir li :
active de tous Jes sens, une capacité
dire a la lisiére des choses en guettant leur venue, soit au total un
ensemble de vertus cognitives propres aux savoirs indiciaires, Poyy
ingo Faustino Sarmiento, en 1845, les compétences atten-
tionnelles des gauchos et plus exactement de celui qu’il appelle le
baquiano, détenteur de la science des traces et des sentiers suivis
Jes animaux, étaient exceptionnelles. Le baquiano est «le plus
accompli des topographes. Un général n’emporte pas diautre carte
pour diriger Jes mouvements de sa campagne. Le baquiano est
[..] Au plus sombre de la nuit, au milieu des
pois ou dans les plaines sans limites, quand ses compagnons sont
perdus, égarés, il tourne en cercle autour deux, observe les arbres ;
s'il n'y ena pas, il met pied a terre, se penche vers le sol, examine
quelques buissons et détermine a quelle hauteur il se trouve; il
remonte a cheval et dit aux autres pour les rassurer : “Nous sommes
endirection de tel point, a tant de lieues des habitations ; le chemin
doit aller vers le sud’, et il se dirige dans le sens qu'il indique*.»
L’attention posséde également la valeur d'une conduite
éthique vis-a-vis des autres humains, des vivants et du monde en
général. Faire attention, c’est, a minima, prendre conscience de la
présence des autres, de leurs puissances d’agir et de leurs inten-
tionnalités. C’est limiter l'exercice de son propre pouvoir en accor
dant toute sa légitimité et sa valeur a l’existence des autres. Plus
encore, c'est s’accorder aux autres (ou du moins tenter de le faire),
comme le font des musiciens qui jouent ensemble, et développet
pore de respect actif qu’on peut appeler le souci ou le soin
pe eee ee est une forme de l’amitié. Elle
Feat esdcntaa condition de ossibilite de Voeuvre canoe
et le traversent, ea Seo ae ee
nee a pon humains, et ne volonté de tis é
toires. Cela va bien plus loin 4°
toujours a ses cotés.
25 D.F. Sarmiento, :
onde, 1964, p.43. , Facundo [1845], Paris, La Table
est P'éducation. A propos de l'éducation, Tim Ingold écrit
qui met en jeu le paysage et l'expérience du paysage tels que
ies définis dés le début de ce livre, 4 savoir comme «dehors»,
eoomme expérience de l’exposition au-dehors : «Si l'éducation
jste prendre soin du monde dans lequel nous vivons et de ses
sultiples habitants humains et non humains, il ne s’agit pas tant de
pecomprenare que de leur rendre leur présence, de fagon ace que
‘ons nous ouvrir et répondre a ce qu’ils ont a dire hay
Enfin, dans le mot «attention» il faut entendre aussi
Jattente de ce qui peut survenir, et donc une disposition particu-
ypre vis-a-vis de l'avenir. Certes, comme le dit l’expression « fais
attention», Ce qui vient au-devant de nous peut étre dangereux,
nous blesser, et il faut apprendre a s’en garder. L’attention est,
Yinstrument de cet apprentissage. Mais la disposition
ous puissi
justement,
attentive porte aussi une autre orientation, qui est celle de l'accueil,
deladisponibilité, de ouverture Ace qui arrive et de la tension vers
cequiarrive. Yves Citton a mis en relief, dans cette perspective, le
paradoxe de I’« attention flottante», telle quelle pratiquée par les
ysychanalystes**. L’écoute flottante permet de mieux comprendre
ce que autre nous adresse, « de ré-envisager les problémes d’une
fagon inédite». Et, de fagon significative, cette capacité a l’atten-
tion flottante est mise par lui en relation avec attitude du flaneur
qui, suspendant la pensée programmée, se rend «disponible au
monde ambiant», se met «en présence des choses» et laisse
You might also like
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 5 out of 5 stars5/5 (3297)
- How To Win Friends And Influence PeopleFrom EverandHow To Win Friends And Influence PeopleRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6533)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (2568)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyFrom EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyRating: 4 out of 5 stars4/5 (3321)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20060)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationFrom EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationRating: 4 out of 5 stars4/5 (2499)
- Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A MemoirFrom EverandFriends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A MemoirRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (2141)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2485)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (353)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelFrom EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (5658)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceFrom EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceRating: 4 out of 5 stars4/5 (2558)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionFrom EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2507)