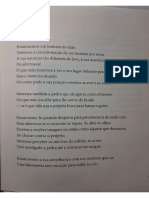Professional Documents
Culture Documents
Tostain - Rome 1974
Tostain - Rome 1974
Uploaded by
Marcela Maria0 ratings0% found this document useful (0 votes)
17 views10 pagesOriginal Title
TOSTAIN.ROME 1974
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
17 views10 pagesTostain - Rome 1974
Tostain - Rome 1974
Uploaded by
Marcela MariaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 10
READY-MADE ET OBJET a
René TOSTAIN
Je précise tout de suite, parce qu'on m'a dit que ce titre
&tait un peu ésotérique, qu'il s'agit des ready-made de Marcel
Duchamp et de l'objet a de la théorisation de Lacan.
Les ready-made, j'en parlerai tout I'heure. Quant a
Vobjet a, dans |'énumération qu'en donne Lacan comme objet
cause du désir, & savoir le sein, I'exerément, le regard et la voix,
je m'en tiendrai aujourd'hui au regard.
Tout ce qui concerne la vue et le regard, essentiel a
lexpérience anclytique, est difficile & appréhender. Il y a dans
le désir de voir et le désir de donner & voir un caché qu'il serait
censé masquer, ou pire un au-del& qu'il laisserait supposer, qui
brouille la question méme de l'objet de ce désir et en méme temps
celle du sujet qu'il emporte.
Ce n'est pas que je pense amener aujourd'hui une bien
grande lumiare la-dessus, mais je voudrais relever quelques cnalo-
gies entre deux pratiques apparemment éloignées, celle de la pein-
ture et la nétre, 4 nous psychanalystes.
Je partirat de cette formulation de Lacan : "Ce que je
regarde n'est jamais ce que je veux voir", pour en extraire rapide~
ment, beaucoup trop rapidement, la vue comme désir et le regard
comme objet cause de ce désir.
Le vue, I'un des cing sens, comme tous les sens n'en fait
qu'a sa téte et cherche par tous les moyens et surtout le non-sens &
faire jouir son organe, l'oeil. Affolée d'un désir qu'elle ne sait
pas ~ il s'agit toujours du désir de I'Autre, elle cherche, dans I'er-
rance, @ faire, ou pourrait dire, déborder la coupe, l'accident.
Elle prend tous les risques et elle se perdrait si le regard ne l'en
empéchcit.
L'étymologie du mot "regard" va dans le sens de cette
formulation puisque dans "regard" il y a "garde", soin, protection,
veiller sur. Le regard donc prend garde, veille sur, évite que la
6?
vue ne s'égare, Quand i] se repére dans un regard autre qui lui
donne son sens, i] devient ce gardien qui impose des limites, fait
respecter I'écart, instaure la différence, interdit I'inceste, Au
moins il s'y efforce, car, en fait, il est de par sa structure vacil-
lant, évanovissant, refendu. Et il lui arrive bien plus souvent qu'a
son tour de faillir a sa téche. J'en donnerai quelques exemples. La
nuit, par exemple, quand iI s'assoupit et qu'on peut voir |'étoile
infime. Mais les spécialistes vous diront que c'est physiologique.
Ou bien quand il est fasciné dans la rencontre et qu'il emporte le
désir qui le bouleverse. Enfin pour Oedipe dont on pourrait dire
~ mais la je réclame votre indulgence ~ que s'il a perdu la vue,
c'est pour ne pas avoir été trés regardant, quant @ I'identité de
Jocaste par exemple. II était pourtant prévenu, Mais passons.
S'il est un domaine, par contre, ot le regard satisfait &
sa fonction, c'est celui de la peinture, car un tableau encadré est
exposé par un autre pour captiver, fixer, retenir le regard et avec
lui le désir de voir,
Co qu'on perd & représenter ov ce qui dans le désir de
voir se perd @ regarder était manifeste dans ces tous premiers ta-
blecux que nos ancétres du néolithique peignaient sur les murs de
leurs cavernes; ga s‘appelait les mains au patron ; tls appliquaient
sur la parol leur main ef la cernaient d'un trait. A la plupart de
ces mains, il manque une phalange. Elles sont amputées,
Mais cette exposition de la perte, du manque, de la
lacune, est un peu angoissante, Un tableau est généralement fait
pour plaire, et tout un aspect de la peinture sera de restauration,
de dénégation, d'écran de cette blessure, C'est son aspect qu'on
pourrait appeler I'endormissement,
A cela la plupart des mofires de l'art ont excellé; grace
& leur savoir-faire, & leur technique, ils maftrisent leur sujet et
permettent d'identifier avec certitude le mot a la chose. L'oeuvre,
la bonne oeuvre qu'ils font par charité répond de I'étre. Les régles
de la perspective qu'ils poss&dent & la perfection organisent cet
espace Idéal, profond, ow les paralléles se rejoignent en un point
de vue privilégié - ov pour privilégiés, La, tout est mesure et
harmonie, et la beauté est bien cette promesse de bonheur comme
le voulait Stendhal. Le talent ou le génie du peinire cerne le sujet
a l'abri du discours cohérent et sensé quiil tient.
Ces maitres 1a, nous les aimons. Nietzsche prétendait
quiils étaient les humbles valets d'une morale, d'une philosophic
et d'une religion, les flatteurs éhontés des puissants, les porte-
parole de l'essence des choses, les suppéts du pouvoir.
70
Clest un jugement sévére, Ce ne sont pas des imposteurs,
L'illusion qu'ils proposent n'a jamais trompé personne. Image est
l'anagramme de magie, et tout un pan de notre désir s'accroche &
ces magiciens avec passion, c'est celui de I'imaginaire ob le Féti-
che et le sacré sont rois, On proméne aujourd'hui et on adore la
Joconde comme on ne |'a jamais fait avec aucun veau d'or. II est
vrei qu'aucune pratique autant que la peinture, qui donne forme
aux apparences, ne donne plus prise & I'idéalisme qui exclut le
sujet du désir, Aucune non plus, hormis l'analytique, qui ne tente
davantage de le subvertir, ce sujet.
L'enjeu est d'importance, C'est celui-l& méme que Freud
défendait quand il maintenait le réle de la sexualité dans son tra-
vail en dénongant "le fleuve noir de l'occultisme". Et cette lutte
incessante que certains de ceux qui donnent & voir ménent contre
la cléture de ce qu'on pourrait appeler une interprétation, avec
tous les abus de pouvoir que cela comporte, cette lutte a donné
lieu dans les avatars de la représentation, c'est-a-dire l'histoire de
l'art qu'il serait complatement illusoire de vouloir croire autonome,
a des coupures. Les plus récentes : celles de Delacroix, les impres~
sionnistes, Cézanne, le cubisme.
A propos de ces coupures, Matisse a écrit quelque part :
"Qui veut s'adonner a la peinture doit commencer par se faire cou-
per la langue", On ne saurait mieux dire. Ces coupures, en effet,
surviennent @ un moment ow |'on pourrait penser que la langue
slinquidte, Clest comme si on n'en jovissait plus, qu'on n'en pouvait
plus qu'elle veuille si bien dire quelque chose, Et le trop-plein de
la figure déborde en méme temps que le systéme de pouvoir en place
apparait lui-méme comme en trop. On n'y croit plus, Et, dans la
représentation, quelques iconoclastes isolés ou groupés en école
- en fait ce sont les plus. crédules, des vrais passionnés de l'image -
introduisent effectivement une coupure, un trou; l'espace se désor—
ganise, et apparait une nouvelle forme inattendue, inclassable,
illisible. C'est la féte scandaleuse, révolutionnaire, dit-on, l'cvant-
garde. Mais la garde est la,celle du regard qui suit de prés cette
nouvelle vision du monde, et ga ne dure pas. Bientdt tout est classé,
identifié, nommé, le désir épuisé, et la nouveauté devient le nouvel
académisme, Le discours, a peine ébranlé dans son sens, reprend son
cours magistral un instant interrompu.
Certains ont bien essayé de tourner l'art en dérision ou de
stattaquer au matériau lui-méme en le démolissant. Mais c'est en
vain. Tout ce qui en résulte est trouvé beau, désirable et est estimé
trés cher. Quoi qu'on fasse, la machine & faire signe fonctionne.
7\
Elle a des ratés, mais tant que les regardeurs lui fournissent I'éner—
gie de leur d&sir, elle continue & produire son effet qui est de me
faire plaisir.
Et l'on en est aujourd'hui, dans la tradition des pompiers
dthier, & la copie minutieuse du quotidien le plus médiocre qui tente
une fois encore de tourner en dérision un réel hypothétique.
Tant que la peinture fera miroiter la possibilité d'un
sens - ef comment pourrait-elle faire autrement - le sujet qui la
regarde est, si j'ose dire, mal barré. Quelque soit la forme que
I'on donne & la soi-disant barre ou coupure, elle contribue & main=
tenir I'illusion de la maftrise de son objet et, avec elle, celle du
discours qui a son propos se tient,
La seule coupure vraiment moderne serait celle qui ope-
rerait un déplacement du discours. C'est dans ce passage étroit et
difficile que, comme psychanalystes, nous tentons de frayer, que
nous rencontrons Marcel Duchamp et son entreprise que je quali-
fierai d'emblée d'analytique,
Duchamp, la plupart d'entre vous connaissent, mais
pour ceux & qui ce nom ne dirait rien, je le situerai rapidement.
Ila été pendant trés peu de temps un peintre comme on
l'entend généralement, en participant aux débuts de ce qu'on a
appelé |'épopée cubiste. Il a envoyé en 1913 & New-York son nu
descendent I'escalier qui a fait bien sir scandale. Célébre du jour
cu lendemain, il aurait pu Stre un de ces peintres & succes comme
il y ena tant, Mais apparemment, ce n'est pas ca qui I'intéressait.
II disait : le frisson rétinien, la peinture olfactive gui sent l'essen-
ce de térébenthine, il trouve que, comme les impressionnistes,
clest un peu bes de plafond. Pour lui, le cubisme est un truc com-
me un-autre,
Ce qui I'a retenu davantage, en dehors des ready made
dont nous allons parler, et de I'épisode dada auquel il s'est amusé
pendant quelque temps, c'est la construction de son grand verre
"la mariée mise & nu par ses célibataires, méme". II y passera huit
ans avant de le laisser, comme il dit, définitivement inachevé,
belle définition d'ailleurs d'une fin d'analyse,
Apres quoi il s'adonnera aux échecs que Breton, agacé
de cette défection, appellera, en référence au silence de Rimbaud,
“ce détestable Harrar".
72
Interrogé sur ses raisons, Duchamp o toujours répondu
qu'il ne savait pas le pourquoi de tout ga, qu'il n'avait aucun but
et surtout pas social, qu'il n'avait rien voulu changer a I'ordre
des choses, que si ce sont les regardeurs qui créent les tableaux et
qui font des musées des cimeti@res, c'est que la production d'une
époque est toujours sa médiocrité, Le jugement et la croyance
étant des valeurs épouvantables, il convient de tout prendre avec
ironie, le seul sérieux étant |'érotisme.
Malgré ses dénégations, on a mis une véritable passion
depuis cinquante ans a vouloir lui faire dire quelque chose, Toutes
les interprétations y passent, || est le pape de l'anti-art, le porte-
drapeau de la contestation, un alchimiste, un grand initiateur, le
dernier des symbolistes, un de ces dandys décadents dont Baudelaire
faisait I'apologie, et je passe sur les interprétations analytiques.
Tout cela pour éviter d'entendre ce que Duchamp a toujours soutenu
avec l'insistance d'un leit-motiv : c'est Raymond Roussel qui est &
Vorigine de mon travail,
En effet, ce qui ‘:intéresse Duchamp, c'est le langage,
et pas dans sa fonction vulgaire de communication ou de compréhen-
sion, mais ce qui dans sa structure permet |'équivoque. Il a écrit
deux livres : "Marchand du sel", anagramme de son nom, et "Recher-
che sur les mots premiers divisibles seulement par eux-mémes et par
I'unité" qui sont des recueils de calembours, contrepateries et au-
tres singularités du type “avez-vous déja mis la moelle de |'épée
dans le poil de I'aimée", jeux apparemment dérisoires ot insigni-
fiants, en fait fondamentaux 4 sa recherche et & la rupture irrépa-
rable qu'il a instaurée dans le visible.
Pour Duchemp comme pour Roussel, dans des registres
apparemment éloignés, Iimportant, c'est le mécanisme du jeu de
mots, Je dis “apparemment éloignés" parce qu'en fait, peinture et
langage sont faits de la méme frame qu'on serait tenté de se repré-
senter sous la forme de ce porte-plume qu'on vend dans les bazars,
ov est enchassée une lentille dans laquelle on peut voir en y collant
son oeil le Mont St Michel ou je ne sais quel paysage suisse, Mais
cette image ne convient pas puisqu'il stagit la de I'écriture et de
sa trace. Alors que |'espace od le verbal et le visible s'entrecroisent
ne laisse nulle trace; il n'en reste rien. Les paroles s'envolent juste
la od le langage défaille, quand la figure qu'il parlait s'efface,
Roussel était persuadé de |'importance considérable de ce
qu'il apportait, Duchamp, lui, était beaucoup plus modeste quand il
inscrivait ses ready made, ||] avait tort, C'est, dans le domaine du
visible, tout cussi capital.
73
Ce terme de "ready made", il I'a rapporté d'Amérique.
Ca peut se traduire : préfabriqué, prét a l'emploi, prét & porter.
Cest du tout fait qui évoque un déja la.
Vous les connaissez, ils sont reproduits partout. Ce sont
des sculptures & trois dimensions, trés réelles. J'en décrirai quel~
ques-unes : le premier date de 1913, c'est la rove de bicyclette;
c'est une rove de bicyclette qui est retournée sur un tabouret, Le
deuxi&me, un porte-bouteilles qui est un sécho-bouteilles sans
bouteilles. Le troisiéme s'appelle la fontaine; c'est un urinoir
retourné, qu'il a signé du nom modifié du constructeur d'urinoirs,
Mutt. Enfin le quatriéme est un peu plus compliqué (il ena fait
une trentaine, je vous en donne quatre). II s'appelle "why not
sneeze ?" (pourquoi ne pas éternuer); c'est une petite cage a oi-
seaux dans laquelle sont enfermés des petits blocs de marbre en
forme de morceaux de sucre, un thermométre et un os de seiche,
le tout peint en blanc,
Voila done un échantillon de ces objets que selon
I"humeur on a troité d'aimable plaisanterie, d'attentat profanant
la notion d'oeuvre d'art, ov au contraire de geste souverain trans~
cendant la fonction de l'artiste. Quoi qu'on en dise, finalement
on ne sait pas of les caser.
Duchamp disait de ces objets "ce sont des objets-dards",
ou encore "des objets a-rtistiques". On ne saurait mieux formuler
les choses : le dard du regard et le 'a', ga parle. Et ca va nous
parler encore bien mieux quand j'aurai rappelé les ragles qu'il a
formulées pour les produire, C'est une sorte de méthode rigoureuse
qu'il a cherché & systématiser dans les termes que voici
II stagi
de trouver,. fabriquer, inserire un objet ov une
chose :
= un moment donné, précis, fixé dans le temps, tel jour & telle
heure;
= il faut que I'impression esthétique soit nulle; on ne d
aucune sorte de délectation;
éprouver
~ le godt personnel ne doit absolument pas intervenir;
~ ce doit tre un objet qui ne vous intéresse pas, et pour toujours;
- le danger Stant que n'importe quoi finit par devenir beau & I'usa=
ge, il convient d'en limiter le nombre; ce doit étre un objet qui
n'a aucune chance de devenir joli, ogréable & regarder ou laid;
74
~ enfin ce doit tre quelque chose quion ne regarde m&me pas, dont
‘on sait que ga existe, qu'on regarde en tournant la téte.
Ce sont des consignes, une sorte de programme, de carte
perforée qui est proposée & une machine, mais qui produirait quoi ?
De ces consignes, on dégage facilement, a mon sens,
trois éléments : l'atemporalité, la suspension du sens et la contra~
diction,
L'atemporalité vient de cette consigne : tel jour & telle
heure, Cette instantanéité, cet horlogisme rigoureux que Duchamp
impose est une fagon d'étre hors le temps. Ce rendez-vous fixé a
un moment précis rend tout autre temps indéfini. Il fait que le
ready made survient contre toute attente, de fagon obligée, inévi-
table, sans que le hasard intorvienne, au moins dans ses effets. II
ne provoque aucune surprise,
En cela il se distingue absolument de l'objet surréaliste
od le mythe de la renconire est privilégié, quand "les mots font
l'amour". C'était la recherche de I'expression d'un prétendu monde
intérieur, d'une profondeur qu'un artifice laisserait venir au jour.
On en attendait une émotion poétique, une possibilité d'interpréta~
tion inédite, un merveilleux qui surgirait d'une "forét d'indices",
Il est d'ailleurs patent que Breton n'avait pas du tout saisi la portée
de la psychanalyse dont il avait fait une symbolique & son usage.
Le ready made, lui, n'est le produit d'aucune rencontre
métaphorique comblante, mais rencontre manquée qu'il est inutile
d'attendre et dont il n'y a rien a attendre.
Le ccractére négatif et suspensif du sens qui apparaft en
second lieu émerge de ces consignes : pas d'émotion esthétique, pos
de délectation, pas de godt, pas de regard, pos d'intérét.
Si cette régle de |'évitement évoque quelque chose de la
structure phobique, c'est qu'ici aussi il y a un désir qui est menacé
et qu'il s‘agit de préserver comme le fait l'objet phobique. Ce qui
est menacé de perdition, c'est tout ce versant du désir dont j'ai
parlé au début qui ne demande qu'a étre captivé par cette véritable
sacralisation de l'objet esthétique, C'est pourquoi tout ce qui serait
du domaine du pouvoir, qu'il s'agisse de prise de pouvoir au niveau
du choix créatif ou de lui donner prise, & ce pouvoir, au niveau de
\"interprétation qui en est faite, est par principe de fonctionnement
éliming, Tout ce qui est du registre de la demande, que ce soit de
sens ou de plaisir, est frustré par systéme. J'emploie les ‘termes de
75
demande et de frustration & dessein, pour insister sur le fait que la
machine ne peut fonctionner qu'a partir de ce manque qu'impose le
"pas de", pas d'intérét, pas de plaisir.
Le désintérét, Kant en faisait un prédicat de la création
de l'oeuvre d'art, comme étent seul susceptible d'induire son imper-
sonnalité et son universalité. || disait & peu prés : le beau, c'est
ce qui plaft sans que l'intérét s'en méle, Cette formulation est en
accord avec la théorie de la sublimation qui déplace I'intérét éro~
tique : faire taire le désir sexuel pour qu'émerge le plaisir, celui
du beau,
la, c'est le contraire : iI s'agit de faire taire le plaisir
~ pas de beau, pas d'émotion esthétique, pour que le désir ait le
champ liore.
Cette consigne technique de la suspension du plaisir ou
du désintérét, (c'est la méme chose d'ailleurs, on ne s'intéresse
qu'a ce qui vous fait plaisir) évoque cette autre technique que nous
connaissons bien, celle de |'écoute analytique dite de |'attention
flottante, comme étant seule susceptible de lcisser libre l'associa~
tion, elle-méme devant produire ce déjarla.
Peut-on en déduire au passage que I 'analyste doit com-
mencer & se méfier quand ce qui se dit l'intéresse ? Metions qu'il
faut que ca ne I'intéresse pas trop. C'est une notion difficile & ma~
nier mais clest tout un aspect de la question du désir de l'analyste.
Ce qui est str, c'est que si son plaisir est sensible, il bloque quel-
que chose qui tond a émerger et qui est de l'ordre du désir,
Mais cette recherche pour Duchamp est plutét celle de
lindifférence au sens. Cette passion des sens qui donne prise aux
pouvoirs interprétatifs, le ready made I'exclut, Ca ne signifie rien,
ga n'a pas de sens,
Nous avons parlé de I'intérét de Duchamp pour les jeux
de mots. Ga ne saurait nous surprendre, nous qui avons lu Freud,
Car c'est bien dans le jeu de mots, quand le sens foire, dans |'es-
pace ob ga ne veut plus rien dire, que le langage perd pied dans
cette chausse-trappe que les grammairiens appellent espace tropolo-
gique. La se produit ce décalage minuscule, cette perte infime,
cette différence imperceptible qui change tout,
Le ready made qui n'a ni sens esthétique, ni sens dans la
langue, est le produit de cette perte infime qui change tout, C'est
& partir de son non-sens radical qu'il inserit, qu'il prend son sens
éthique comme nous I'entendons,
76
Aussi Duchamp avait-il bien raison d'insister sur cette
dette qu'il se reconnaissait, sans savoir pourquoi d'ailleurs, @
I'égard de Raymond Roussel. Celui-ci a dévoilé dans son ouvrage
posthume "Comment j'ai écrit certains de mes livres" le procédé
qu'il avait mis au point pour fabriquer systématiquement cet inter~
valle ; il s'agissait de trouver deux mots de sonorité approchante
mais de sens différent et de jeter un pont verbal entre eux. En pri-
vilégiant l'ordre phonématique, il trouvait, lui aussi, dans une an-
tériorité toujours repoussée ce déja-lade toujours prét & l'emploi,
ce langage qui se parle seul et ne suppose aucune personne qui
lexprime ou qui l'entende, cet appel qui n'attend nulle autre
réponse que le désir qu'il emporte.
La fabrique de Duchamp est I'homologue dans le domai-
ne du visible de celle de Raymond Roussel, machines a différences,
construites toutes deux sur I'écart du "pas de sens", elles sont struc-
turées autour d'un manque central. Ce sont des fabriques 4 désir ou
mieux @ désirer le désir,
J'en arrive pour terminer au troisiéme programme qui
est transmis & cette machine, & savoir la contradiction, ou plutét
le maintien de la contradiction, Elle est patente dans le geste de
donner & voir en le retirant dans le méme mouvement, elle se re~
trouve dans le fait de devoir regarder en détournant la téte, et
dans ce dégagement immédiat de |'intérat au profit de l'indiffé-
rence.
Tous ces mouvements renversés aussit6t en leur contraire
~ et leur coexistant cependant - aboutissent & une sorte de conti-
gulté inéluctable, sorte de retournement mis en acte qui n'a ni en-
vers ni endroit, ni surface ni profondeur, et que ne sépare nul bord.
Sorte de noeud ob s'entrecroisent et s'inversent tous les trajets du
désir, véritable défaut dont |'Autre ne saurait répondre, La contra
diction fonde cette pratique qui devient de ce fait signifiante. Ce
qui se produit était déj& la, sans moi; malgré moi, avant mol ; je
n'y suis pour rien, Le ready made contredit tout ce que je pourrais
en dire, mais dans un renversement structural, il acquiesce 4 co
que dans le moment de son devenir j'advienne.
N'importe quoi du domaine du visible finit par émettre
un sens aux dépens du sujet du désir qui est élidé. Pas la rove de
bicyclette ni le porte-bouteille qui sont |'exposition de |'atempo-
ralité, de I'hétérogéne & tout sens, de la contradiction maintenve.
Ces objets qui nten sont mame pas, des déchets, des
restes, insignifiants, inutilisables, inclassables échappent 4 toute
Th
grammaire, & toute genése repérable, IIs sont le discontinu méme,
le séparé qui séme le désordre. Ou plutat ils invoquent cet ordre
autre que nous connaissons bien, od la contradiction n'existe pas,
00 la certitude est différée, Iexplication inépuisable, le temps
indéfini : l'ordre des processus primaires de |'inconscient.
Ces objets coupés de tout corps organisé, tombés d'un
discours complétement décentré, sont bien ces objets préts & porter
qui invoqueni dans I'a peu prés de leur énoncé le manque central
du désir. Exerétés d'une machine structurée comme un langage, ils
sont cause, condition et effet de son fonctionnement. Cette fabri-
que n'emporte aucun stant, mais seulement du sujet qu'elle engen-
dre. partir de l'intervalle de son dire.
C'est de ces appareils a langage (le mot est de Freud
dans son livre sur l'aphasie) ou plutét de leur déconstruction & la
force de ce coin enfoncé dans leurs articulations signifiantes, entre
Vimaginaire et le symbolique, entre le figurable et le dire, qu'est
sorti, tout prét vraiment de la ov il n'était jamais entré, le ready
made de Duchamp,
Chose inerte, j'ai écrit indtre, dont il n'y a rien & atte
dre, c'est sans déception, sans angoisse et sans espoir que celui qui
désire voir peut le laisser l& ob il a toujours été ef se détournant
d'un ici sans objet, abandonner son regard.
Vois ce rien de ton regard et désire ailleurs autre chose;
il nty a de désir que de désir de I'Auire", c'est ce que le ready made
dirait s'il pouvait parler. Mais il est indifférent & tous les récits
qu'on en pourrait faire, y compris & celui-ci qui n'était pas un ré~
sit mais une tentative de théorisation & quoi il ne pouvait échapper.
Ce ready made, tache aveugle du regard, garant ef
limite d'un désir indestructible, peut-étre, modernes Orphées,
pourrons-nous un jour en inscrire un réussi absolument. Ce ne pourra
8tre qu'a l'heure de ce rendez-vous certain, quand déposant notre
regard comme on dépose les armes, détournant la téte et fermant
les yeux, nous verrons enfin Euridyce, objet cause d'un désir devenu
possible.
(Apploudissements)
S. FALADE
prendre la parole 2.
Je remercie Tostain. Quelqu'un désire-F.
Alors la parole est @ M. le Dr. Verdiglione,
78
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Amiralt, Monique - Accueillir La ContingenceDocument3 pagesAmiralt, Monique - Accueillir La ContingenceMarcela MariaNo ratings yet
- Brousse - Corps Et RevesDocument4 pagesBrousse - Corps Et RevesMarcela MariaNo ratings yet
- Calle-Gruber Tourner AutourDocument15 pagesCalle-Gruber Tourner AutourMarcela MariaNo ratings yet
- MATHIS-Écriture Et SexuationDocument8 pagesMATHIS-Écriture Et SexuationMarcela MariaNo ratings yet
- Raul ANTELO - Republica Do CurveloDocument4 pagesRaul ANTELO - Republica Do CurveloMarcela MariaNo ratings yet
- Diario de Poesía n71Document40 pagesDiario de Poesía n71Marcela MariaNo ratings yet
- Molloy Poéticas de La DistanciaDocument89 pagesMolloy Poéticas de La DistanciaMarcela MariaNo ratings yet
- El Texto Que Se Sabe - Tamara Kamenszain - Hispamérica, #7, 3, Pages 57-59, 1974 Jul - Hispamerica (ISSN 0363-0471) - 10.2307 - 20541225 - Anna's ArchiveDocument4 pagesEl Texto Que Se Sabe - Tamara Kamenszain - Hispamérica, #7, 3, Pages 57-59, 1974 Jul - Hispamerica (ISSN 0363-0471) - 10.2307 - 20541225 - Anna's ArchiveMarcela MariaNo ratings yet
- Daniel Faria - Alguns Poemas Do Livro Homens Que São Como Lugares Mal SituadosDocument8 pagesDaniel Faria - Alguns Poemas Do Livro Homens Que São Como Lugares Mal SituadosMarcela MariaNo ratings yet
- Um Limite Tenso - Lacan Entre A Filosofia e A PsicanaliseDocument308 pagesUm Limite Tenso - Lacan Entre A Filosofia e A PsicanaliseMarcela MariaNo ratings yet