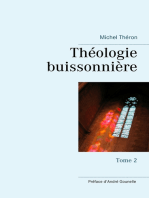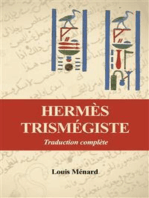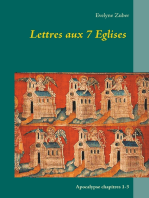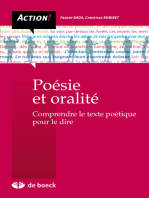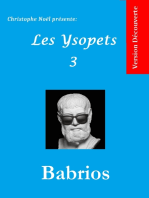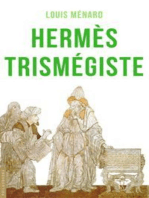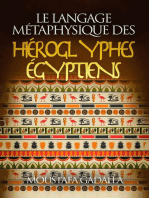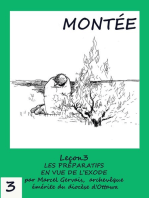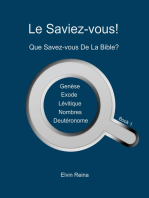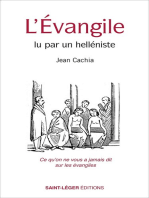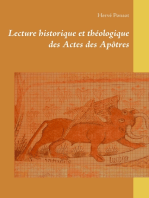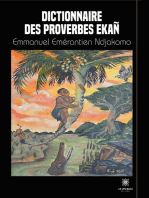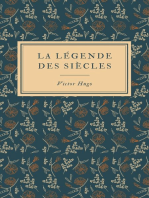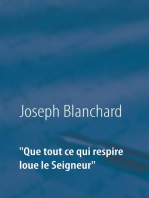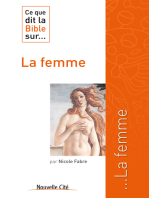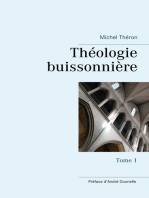Professional Documents
Culture Documents
L Homme S Entoure D Un Univers Sonore
L Homme S Entoure D Un Univers Sonore
Uploaded by
Bianca AnghelacheOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
L Homme S Entoure D Un Univers Sonore
L Homme S Entoure D Un Univers Sonore
Uploaded by
Bianca AnghelacheCopyright:
Available Formats
Pinchard L. et Haelewyck J.-C. (éd.), Traditions et Traductions des textes bibliques.
Études de critique textuelle et d’exégèse en l’honneur de Christian-Bernard Amphoux
à l’occasion de son 80e anniversaire (LCA, 35), Éditions Safran, Bruxelles, 2023, p. 437-474.
EN
L’homme s’entoure d’un univers sonore*
Dominique manGin
Vaugines (France)
IM
Certaines différences dans le Grec ancien de Job (G), quand on le compare au texte
massorétique (TM), sont structurellement importantes. Les écarts entre G et le TM sont
frappants en ce qui concerne la question : Job est-il dans son droit ? ()צדק, a-t-il raison ?
()צדק, est-il juste ? ()צדק1. Mais une fois inventoriés ces écarts, encore faut-il en préciser
la valeur, ce qui ne peut se faire qu’en analysant les relations que ces écarts entretiennent
ÉC
avec les autres parties du texte grec ; mais aussi en recherchant dans quelle mesure ces
écarts s’expliquent, d’une façon ou d’une autre, d’après le texte hébreu qui nous a été
transmis par la tradition rabbinique. L’écart pris isolément est un fait sans signification. À
l’intérieur du texte grec, c’est l’ensemble des relations qu’entretiennent entre elles les
différentes parties du texte qui permet de définir la cohérence d’un tout ; le tout du texte
n’est pas donné, il est le résultat d’une série d’analyses2. Dans les lignes qui suivent, j’ai
choisi d’analyser le motif de la faute de langage, motif en rapport étroit avec la question
de savoir si Job est juste ou pas, s’il a raison ou pas, s’il est dans son droit ou pas.
Le récit cadre de l’apologue qu’est le livre de Job (chap. 1-2 et 42,7-17) inscrit Job à
SP
l’époque d’Abraham, d’Isaac et de Jacob : son intégrité, sa richesse, sa descendance (1,1-
5). Une époque qui connaît — probablement dans une forme stylisée de fable — le
sacrifice, définissable comme le paiement d’une contrepartie (1,5). Dans ce récit se
superpose, comme au dos caché de l’espace humain où évolue Job, une seconde scène, qui
* « Er umgibt sich mit einer Welt von Lauten... », W. VON HUMBOLDT, cité par E. CASSIRER, La Philosophie
des formes symboliques. 1. Le langage, Paris, 1972, p. 34.
1
Voir le plus δίκαιος « juste » (1,1) ; la leçon ἐναντίον αὐτῶν dans le stique ἦν γὰρ Ιωβ δίκαιος ἐναντίον αὐτῶν
« car Job était juste à leurs yeux » (32,1) ; le stique οἴει δέ µε ἄλλως σοι κεχρηµατικέναι ἢ ἵνα ἀναφανῇς δίκαιος
dans le verset µὴ ἀποποιοῦ µου τὸ κρίµα / οἴει δέ µε ἄλλως σοι κεχρηµατικέναι ἤ ἵνα ἀναφανῇς δίκαιος « Cesse
de refuser Mon jugement. / Pourquoi crois-tu que je t’aie parlé sinon pour que tu sois déclaré juste ? » (40,8).
2
Peut-être une distinction doit-elle être faite entre un texte philologiquement établi et un texte non-critique ;
mais un texte édité ne procure de toute façon aucune assurance sur le tout qu’il constitue.
You might also like
- Surx4 II ParteDocument63 pagesSurx4 II PartepippoNo ratings yet
- Dictionnaire du Judaïsme: Les Dictionnaires d'UniversalisFrom EverandDictionnaire du Judaïsme: Les Dictionnaires d'UniversalisNo ratings yet
- Miracles et signes divins dans le CoranFrom EverandMiracles et signes divins dans le CoranRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (7)
- L'oiseau-ba: Seconde vie dans l'Egypte antique - L'iconographie au Nouvel EmpireFrom EverandL'oiseau-ba: Seconde vie dans l'Egypte antique - L'iconographie au Nouvel EmpireNo ratings yet
- La Torah sous l’arbre: L’oralité dans les plus anciennes sources du livre de la GenèseFrom EverandLa Torah sous l’arbre: L’oralité dans les plus anciennes sources du livre de la GenèseNo ratings yet
- Hermès Trismégiste: Traduction complète précédée d’une étude sur l’origine des livres HermétiquesFrom EverandHermès Trismégiste: Traduction complète précédée d’une étude sur l’origine des livres HermétiquesNo ratings yet
- Littératures apocalyptique et apocryphe: Les Grands Articles d'UniversalisFrom EverandLittératures apocalyptique et apocryphe: Les Grands Articles d'UniversalisNo ratings yet
- Lettres aux 7 Eglises: Apocalypse chapitres 1-3From EverandLettres aux 7 Eglises: Apocalypse chapitres 1-3Rating: 3 out of 5 stars3/5 (1)
- Monadologie de Leibniz: Les Fiches de lecture d'UniversalisFrom EverandMonadologie de Leibniz: Les Fiches de lecture d'UniversalisNo ratings yet
- Le Langage Métaphysique Des Hiéroglyphes ÉgyptiensFrom EverandLe Langage Métaphysique Des Hiéroglyphes ÉgyptiensRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Ancien et Nouveau Testament: Les Grands Articles d'UniversalisFrom EverandAncien et Nouveau Testament: Les Grands Articles d'UniversalisNo ratings yet
- Dissertation sur les psaumes traduite du latin de J.-B. Bossuet: Accompagnée de notesFrom EverandDissertation sur les psaumes traduite du latin de J.-B. Bossuet: Accompagnée de notesNo ratings yet
- Spatialités littéraires et filmiques francophones: Nouvelles perspectivesFrom EverandSpatialités littéraires et filmiques francophones: Nouvelles perspectivesNo ratings yet
- Poésie moderne: Les Fiches de lecture d'UniversalisFrom EverandPoésie moderne: Les Fiches de lecture d'UniversalisNo ratings yet
- La Torah: Les cinq premiers livres de la Bible hébraïque (texte intégral)From EverandLa Torah: Les cinq premiers livres de la Bible hébraïque (texte intégral)No ratings yet
- Précis du système hiéroglyphique des anciens ÉgyptiensFrom EverandPrécis du système hiéroglyphique des anciens ÉgyptiensNo ratings yet
- La remontrance du tigre: Histoires excentriques du pavillon de jadeFrom EverandLa remontrance du tigre: Histoires excentriques du pavillon de jadeNo ratings yet
- L'Évangile lu par un helléniste: Ce qu'on ne vous a jamais dit sur les évangilesFrom EverandL'Évangile lu par un helléniste: Ce qu'on ne vous a jamais dit sur les évangilesNo ratings yet
- Le Parti pris des choses de Francis Ponge (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreFrom EverandLe Parti pris des choses de Francis Ponge (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreNo ratings yet
- L’Apocalypse : Toute la vérité - Tome 1: Les prédictions divines dévoilées dont l'année de la fin de ce monde : 2052 ?From EverandL’Apocalypse : Toute la vérité - Tome 1: Les prédictions divines dévoilées dont l'année de la fin de ce monde : 2052 ?No ratings yet
- Linguistique et psychologie: Lois intellectuelles du langageFrom EverandLinguistique et psychologie: Lois intellectuelles du langageNo ratings yet
- "Que tout ce qui respire loue le Seigneur": La musique dans la BibleFrom Everand"Que tout ce qui respire loue le Seigneur": La musique dans la BibleNo ratings yet
- Ce que dit la Bible sur la femme: Comprendre la parole bibliqueFrom EverandCe que dit la Bible sur la femme: Comprendre la parole bibliqueNo ratings yet
- La Torah (édition revue et corrigée, précédée d'une introduction et de conseils de lecture de Zadoc Kahn): Les cinq premiers livres de la Bible hébraïque (texte intégral)From EverandLa Torah (édition revue et corrigée, précédée d'une introduction et de conseils de lecture de Zadoc Kahn): Les cinq premiers livres de la Bible hébraïque (texte intégral)No ratings yet
- UniversDocument11 pagesUniversBianca AnghelacheNo ratings yet
- Planeta Vietii in UniversDocument30 pagesPlaneta Vietii in UniversBianca AnghelacheNo ratings yet
- Grim StoriesDocument13 pagesGrim StoriesBianca AnghelacheNo ratings yet
- ALBA CA ZAPADA Fratii Grimm Ilustratii DDocument36 pagesALBA CA ZAPADA Fratii Grimm Ilustratii DBianca AnghelacheNo ratings yet
- Scufita RosieDocument8 pagesScufita RosieBianca AnghelacheNo ratings yet
- Scrisoare IntențieDocument1 pageScrisoare IntențieBianca AnghelacheNo ratings yet
- Hábito Alimentar, Estado Nutricional e Percepção Da Imagem Corporal de AdolescentesDocument9 pagesHábito Alimentar, Estado Nutricional e Percepção Da Imagem Corporal de AdolescentesDaniel Chaves Mascarenhas100% (1)
- Edgistify Company ProfileDocument9 pagesEdgistify Company ProfileANJALI AGARWAL Jaipuria JaipurNo ratings yet
- AGUA BorradorDocument9 pagesAGUA BorradorAcis TrujilloNo ratings yet
- Solucionario HT5 (Nivel III)Document4 pagesSolucionario HT5 (Nivel III)Tito RarazNo ratings yet
- Life and LearningDocument2 pagesLife and LearningSaeed NaushadNo ratings yet
- Benchmarking in QFD For Quality Improvement PDFDocument14 pagesBenchmarking in QFD For Quality Improvement PDFĐoàn TâmNo ratings yet
- M03 Procédés Généraux de Construction AC TSGO-BTP-TSGODocument201 pagesM03 Procédés Généraux de Construction AC TSGO-BTP-TSGOOussama MaachNo ratings yet
- Mba Finance Et Stratégie D'entrepriseDocument1 pageMba Finance Et Stratégie D'entrepriseMory CondeNo ratings yet
- TEA Analisis de Rosa de Vientos 2019Document7 pagesTEA Analisis de Rosa de Vientos 2019joel ferreyraNo ratings yet
- Reporte S1Document3 pagesReporte S1ramergrNo ratings yet
- Cita Banco de SangreDocument3 pagesCita Banco de Sangrecesar DJ DEIMOSNo ratings yet
- RarDocument45 pagesRaryoussefrafik220No ratings yet
- Math CotDocument2 pagesMath Cotliezl heranaNo ratings yet
- Cdi Ets 10012014 A B SolDocument8 pagesCdi Ets 10012014 A B SolOmar ColoradoNo ratings yet
- MorikolDocument2 pagesMorikolNeusa AlvesNo ratings yet
- Memoria Alcas Corregida-V2Document80 pagesMemoria Alcas Corregida-V2RayMundoNo ratings yet
- O Mundo de Sofia-ResumoDocument20 pagesO Mundo de Sofia-Resumoamefrmar0% (1)
- Conflicto Armado. Causas, Orígenes y ActoresDocument4 pagesConflicto Armado. Causas, Orígenes y ActoresGerson Daniel MosqueraNo ratings yet
- Sindrome Del Edificio EnfermoDocument4 pagesSindrome Del Edificio EnfermoYanneth Rosales de HerreraNo ratings yet
- Approaches in Environmental PsychologyDocument31 pagesApproaches in Environmental PsychologyInshrah MukhtarNo ratings yet
- 30 Proteccin de La CabezaDocument2 pages30 Proteccin de La CabezaSergio SáezNo ratings yet
- Ficha de Cátedra. Surgimiento de La Pedagogía Moderna. Los Sist. Educ. NacionalesDocument5 pagesFicha de Cátedra. Surgimiento de La Pedagogía Moderna. Los Sist. Educ. NacionalesAgustín GonzálezNo ratings yet
- Amélioration Et Fiabilisation de La Ligne CDCDocument88 pagesAmélioration Et Fiabilisation de La Ligne CDChamza elgarragNo ratings yet
- Chimie-TP4 Determination de QRDocument2 pagesChimie-TP4 Determination de QRChartier JulienNo ratings yet
- Taller Nutrición de Los Seres VivosDocument4 pagesTaller Nutrición de Los Seres Vivosmyriam consuelo alvarez zarateNo ratings yet
- Steel Grade: Material Data SheetDocument6 pagesSteel Grade: Material Data SheetFlorinFlorinNo ratings yet
- RuedaDocument17 pagesRuedaJaime MaximilianoNo ratings yet
- Tarea Unidad 1Document2 pagesTarea Unidad 1Dídîër TenenuelaNo ratings yet
- Plan Mantenimiento 2017Document8 pagesPlan Mantenimiento 2017Josué MNo ratings yet