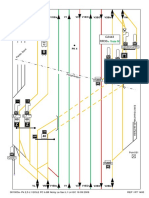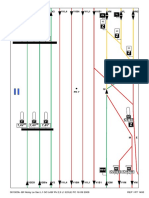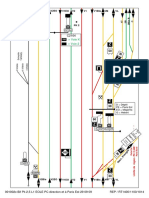Professional Documents
Culture Documents
Larousse Médical de La Famille
Larousse Médical de La Famille
Uploaded by
Jalil roumi0 ratings0% found this document useful (0 votes)
44 views183 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
44 views183 pagesLarousse Médical de La Famille
Larousse Médical de La Famille
Uploaded by
Jalil roumiCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 183
eee | AROUSSE
BIBLIOTHEQUE
médicale ~
DE LA FAMILLE
aa
LES MALADIES DES-APPAREILS
DIGESTIF ET URINAIRE
LAROUSSE
Cet oswrage 2 été réalisé sous la direction du docteur Yves Morin,
médecin des hopitaux, chef du service de médecine interne
= centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, Paris
avec la collaboration des
Doeseur Etienne Alexandre, stomatologue
Docteur Catherine Brémont, endocrinologue a 'hpital Cochin, Patis
Professeur Boyan Christoforov, chef du service de médecine inteme a Vhopital Gochin, Paris
Docteur Jacques Fricker, nutritionniste & Thopital Bichat, Paris
Professeur Bernard Gattegno, chirurgien au service d urologie de Phépital Tenon, Paris
‘Ont également cllaboué aux tentes
Pour la Sass, Jean-Mare Guinchaed, sexétaire général de TAssociation des médecins du carton de Gente
Pourla Belgique, Miche! Masson, dactexr en medline et membre de FAssoiation belge
es syndicas méicaun (ABSYM)
Pour le Canada, Bruno 1/Heureux, MD, ancien présidene de "Astociion metlcle canadienne,
membre di conse d'sdmninisation de 'Assaciation mice mondiale
Direction éditoriale
‘Adith Ybert, Laurence Passeneux, assisiées de Tatian Delesalle
Direction artistique
‘VaueaceLebot*
‘Conception graphique
Banque tbe
Mise en page
ee
sconographie
Nathalie Bocher-Lenoir, Catherine Dumeu
Index
Giles Le Jeane
ALecure-tévision
‘Annick Valade, assisiée d'Balth Zhu
Fabrication
Jkabelle Goulhot
‘uditourremercie Sophie Compagne, Asti de Lange de Meue. Anne Devile-Cavalin
Te Ae Sagi Nwepear ur ion
‘Malgré cout le toim apporté a wéacion de ce volume de I Bisque ade dea fale,
fn aon de en des domaine brs, une ee ai ay ghee
Nous ne sourions re tenus pout cesponsables de ses consequences oud une interpretation errand
«ar, rappelonste, aucun liste ne pest remplacer avis du medecin.
© Larausse-Bordas 1996
Toate reeduction ov iprsieataion intégmle ou patel,
poriquelque pede que de sbi. du rete vou dels nomenclenre cores da le pgent aveage,
‘qui vet la pps de PEateus, en ucternent ere
Edition du Club Face Loisiy, Paris
‘vee Isutorisation des Editions Larousse-Rardas
ISBN 27041-11480
YN Ealieur :27529
spend: Septembve 98
Inyprimé en France
1s Publigtiovaset- 93500 Pantin
SOMMAIRE
Préface . a ou Les atteintes rénales oe OE
Les calculs de la vésicule Gitinicer 37
Appareils digestif. Les calculs urinaires . .. 39
Le cancer de Testomac 41
urinaire- Le cancer de Poesophage v0.00... 43
systéme hormonal Le cancer du célon 45
=n Le cancer du foie . . a
Introduction 9 Le cancet du rein 49
Les caries dentaires . oe 61
L’ APPAREIL DIGESTIF Les citrhoses .. . we 8 wisn macs
Llappareil digestif : généralités. . Les colites 0... 0.005 . 55
La digestion sc... 0... : Lacolopathie soso
Les examens dellapparel! dlgesté. «Uf. | {La comtization, 59
La cystite ........., 61
L’APPAREIL URINAIRE Le dlsbéte insipide: 63
Lappareil urinaire: les reins ....... 19 | Le diabéte inslinodépendant
Llappareil utinaite : la vessie marl Généralités . 65
Les examens de lappareil urinaire .. 23 La vie quotidienne . 7
Le diabéte non insulinodépendant .. 69
Le sYSTEME HORMONAL Le diabéte sucré : les complications . 71
Le systéme hormonal : généralités .. 25 | Ladialyse rénale ................ 73
Les examens du systéme hormonal . 27 La diarrhée .. ve FS)
as digestions dBGl86. a ccvaccs 50 77
LES MALADIES DE A AZ Liexcés de cholestérol . wae 79
Lamibiase et la bilharziose ....... 29 | La gastrite ..... sees 8t
Les autres maladies parasitaires .... 80 | Lagreffe du foie ...0...0..00.... 88
L’anus artificiel - La greffe du rein i 85
Appendicite et péritonite .. 88 | Les hémortagies digestives 87
Les hémorroides ....... . 89
Les hemies de la paroi de abdomen 91
Les infections
des dents et des gencives .
Les infections urinaires
Liinsuffisance rénale aigué.
Liinsuffisance rénale chronique ...
Liintoxication alimentaire ........ 101
Les kystes des reins . - 108
La maladie d’Addison . «105
La maladie de Basedow 107
La maladie de Cushing 109
Les maladies du pancréas
La paneréatite . siaeene Td
Le cancer du panctéas . s. U2
Les malformations
de 'appareil urinaire ............ 118
Lobésité vax 105
L’occlusion intestinale .. M7
Prolapsus et incontinences ....... 119
Les prothéses dentaires .......... 121
Le reflux gastro-cesophagien ...... 128
La tétention d'utine ............. 125
Les troubles de ’hypophyse
L'insuffisance hypophysaite .... 127
Les tumeuts de 'hypophyse .... 128
Les troubles de la thyroide
Le cancer de la thyroide ....... 129
Le nodule thyroidien ......... 130
Les troubles de la cies
Les thyroidites 131
Le goitre : » 132
Les tumeurs de la vessie ......... 133
L'ukére gastroduodénal .......... 135
Les urines anormales
Lalbumine dans les urines . + 137
Le sang dans les urines . 138
Bien se nourrir
hilar
Introduction 139
Protéines, glucides et lipides ....., 148
Fibres, vitamines et minéraux 145
Les légumes et les fruits.
Les féculents et le pain ..
Viandes, poissons et ceufs
Les produits laitiers .
Les matitres grasses
Les aliments sucrés
Lieau et les boissons
Le petit déjeuner ...
Le déjeuner et le diner .
Les besoins énergétiques .......
Lienfant de la naissance 4 3ans.... 167
L’enfant de plus de 3 ans
et l'adolescent 169
Vadulte ..... 171
La femme enceinte . 173,
Le sportif . 175
Les seniors . 3 177
Comment bien inaigetr ¥ concn Ae
Comment grossir....-.......... 181
Associations d'aide aux malades
France . . 188
Belgique, Canada/Québec, Suisse 185
TMM seegeemenens ge eeeeearene LOE
LES MALADIES DES
APPAREILS DIGESTIEF
ET URINAIRE
On ne peut réduire la notion de santé au seul fait de ne pas
tre malade ; étre en bonne santé signifie également étre
dans une forme optimale, sur le plan physique comme sur le
plan intellectuel. La meilleure connaissance des nombreux
éléments contenus dans chaque aliment ainsi que celle des
besoins réels de l’organisme ont changé notre conception de
la nourriture : les aliments traditionnels conservent une place
de choix, tant par leurs vertus nutritionnelles que par le plai-
sir qu’ils procurent et la convivialité qu’ils favorisent.
En outre, la maniére de se nourrir intervient de fagon pri-
mordiale dans la survenue de maladies (cancers, diabéte, etc.).
Ainsi, pour combattre certaines maladies digestives, uri-
naires ou hormonales, le médecin associe aux traitements
classiques (médicaments, chirurgie, etc.) des régimes alimen-
taires. Parmi ces affections, certaines sont anodines (consti-
pation, cystite), d’autres, beaucoup plus graves (cancer du
rein, cirthose). Mieux connaitre ces maladies permet parfois de
les éviter, ou du moins de les diagnostiquer dés les premiers
symptémes, ce qui favorise bien souvent leur guérison.
Lobjectif de cet ouvrage est de fournir le maximum de
réponses aux questions que peuvent se poser les personnes
touchées ou dont les proches sont atteints par ces maladies.
LES MALADIES DE LAPPAREIL DIGESTIF
Les maladies digestives sont représentées par quatre groupes
d'affections. Le premier comprend les cancers (du célon, du
foie, etc.), en partie évitables par une meilleure hygiéne de
vie et par le dépistage des personnes génétiquement prédis-
posées. Le deuxiéme ensemble (cirrhose, pancréatite, etc.)
est constitué par les conséquences digestives de mauvaises
habitudes propres 4 certains : alcoolisme, tabagisme, surali-
mentation. Le troisiéme groupe est composé par les hépa-
tites B et C, qui lésent le foie au cours d'une longue évolution
(hépatite chronique). Le dernier ensemble est celui des
troubles fonctionnels, bénins mais génants (colopathie, dys-
pepsie, etc.). Aujourd’hui, les moyens de diagnostic sont effi-
caces : le fibroscope (tube optique) permet d’observer direc-
tement les organes et ainsi de déceler'de maniére précoce un,
cancer. Les traitements font appel a des médicaments dont
Vaction est de plus en plus limitée a une cible précise, évitant
au maximum les effets indésirables. Les traitements chirurgi-
caux utilisés sont devenus plus faciles & supporter.
LES MALADIES DE APPAREIL URINAIRE
Les maladies de l'appareil urinaire peuvent atteindre des
organes trés différents dans leur fonction, tels que les reins,
les uretéres ou la vessie. Néanmoins, en l’absence de traite-
ment, presque toutes les maladies de I’appareil urinaire sont
susceptibles d’évoluer vers une altération de la fonction des
reins (insuffisance rénale). Certaines maladies, comme I’in-
continence urinaire, entrainent un handicap important pour
ceux qui en sont atteints. Les traitements des maladies de
Vappareil urinaire ont beaucoup évolué et sont devenus
moins agressifs pour le patient. Ainsi, les progrés réalisés
ont permis de réduire les indications de la chirurgie conven-
tionnelle : les calculs urinaires sont, par exemple, pulvérisés
grace a des ondes de choc produites par un appareil externe
(lithotripsie extracorporelle).
LES MALADIES DU SYSTEME HORMONAL
Le systéme hormonal est composé d’un ensemble de glandes
(hypothalamus, hypophyse, thyroide, parathyroides, pancréas,
surrénales, ovaires, testicules) qui contrélent les grandes fonc-
tions de l’organisme. Il régule le métabolisme, c’est-a-dire la
production ou la dégradation des éléments chimiques, la
croissance et le développement, la fonction sexuelle et les
réactions du corps face au stress et aux maladies. L’atteinte
d'une glande endocrine peut étre soit fonctionnelle, a l’origine
d’un exces ou d’une insuffisance de production hormonale,
soit morphologique, se traduisant alors par des tumeurs,
bénignes dans la trés grande majorité des cas. Lorsqu’une
glande fonctionne insuffisamment, le médecin prescrit des
hormones de substitution, qui permettent de retrouver un
état physiologique satisfaisant. A I’inverse, lorsqu’une
glande produit trop d’hormones, le traitement consiste soit
& administrer des médicaments qui empéchent son fone-
tionnement, soit a pratiquer l’ablation de tout ou partie de
cette glande. Dans un cas comme dans J’autre, il est indis-
pensable d’expliquer au patient qu'il s’agit d'un traitement &
suivre a vie.
APPAREILS DIGESTIF-
URINAIRE-
HORMONAL
Les appareils digestif et urinaire et le systeme hormonal
regroupent des organes qui fonctionnent en étroite relation :
tous participent au maintien de l'équilibre de notre orga-
nisme. C’est pourquoi ils sont présentés ensemble dans ce
premier grand chapitre. Les maladies des dents et des gen-
cives (caries, parodontite, etc.) sont rattachées aux maladies
de l’appareil digestif ; en effet, les dents concourent, par la
mastication, a une bonne digestion.
LA CONSULTATION DU GASTROENTEROLOGUE
La plupart du temps, les gastroentérologues — médecins qui
s‘occupent des maladies touchant l'appareil digestif - regoi-
vent en consultation des patients qui semblent en bonne
forme. Ces derniers viennent signaler des troubles minimes :
faibles douleurs, difficultés a digérer, troubles intestinaux,
petites pertes de sang. C’est parfois la maladie d’un proche
ou la lecture de documents qui les incite 4 consulter.
L’examen clinique est souvent normal ; lorsqu’il existe des
anomalies, celles-ci sont généralement trop petites pour étre
percues en palpant l'abdomen. Aprés un interrogatoire
approfondi, le médecin choisit les moyens d’investigation a
mettre en ceuvre : échographie, endoscopie, scanner, image-
tie par résonance magnétique (IRM). Ces différents examens
permettent d’établir un diagnostic précis. Si le bilan est nor-
mal — cas le plus fréquent -, le praticien explique 4 son
patient que |’on peut ressentir des troubles sans pour autant
étre gravement malade, et que I’on ne doit pas obligatoire-
ment prendre des médicaments. Bien souvent, une meilleure
hygiéne de vie — arrét du tabagisme, limitation de la consom-
mation de boissons alcoolisées, alimentation équilibrée, pra-
tique réguliére d’une activité physique, etc. — suffit a faire
disparaitre les symptémes ou, du moins, a les atténuer. Si
une anomalie est découverte, le médecin fournit 4 son
patient des explications sur l’affection qui le touche ; il
décide avec son accord d’un traitement, d’un programme de
surveillance, d’un dépistage familial lorsque la maladie
est héréditaire.
La stomatologie, spécialité médicale qui traite des maladies
des dents et des gencives, a bénéficié durant ces derniéres
années d’importantes avancées technologiques : les prati-
ciens ont a leur disposition des équipements (instruments,
radiographie, etc.) et des produits (matériaux d’empreintes,
d'obturation, etc.) particuligrement sophistiqués. Les traite-
ments des maladies bucco-dentaires sont ainsi de plus en plus
efficaces. Le réle de la prévention est extrémement impor-
tant dans ce domaine : grace aux moyens préventifs mis en
ceuvre, les caries sont moins fréquentes et cesseront peut-
étre d’étre le fléau qu’elles constituent encore aujourd’hui.
LUROLOGIE ET LA NEPHROLOGIE
L'urologie et la néphrologie sont les deux spécialités médi-
cales qui traitent de l'appareil urinaire (la seconde concernant
les reins). Les organes qui composent cet appareil (reins, ure-
téres, vessie, urétre) sont essentiels pour maintenir l’équilibre
du milieu intérieur. Les reins épurent le sang de tous les
déchets que l’organisme accumule ; ces derniers sont élimi-
nés dans ’urine. Celle-ci est ensuite €vacuée hors du corps,
des reins jusqu’a la vessie par les uretéres, puis de la vessie
vers l'extérieur par l'urétre. Ces différents organes peuvent
étre défaillants 4 cause d’une anomalie dans l’élaboration ou
dans |'évacuation de |’urine. Cela risque d’entrainer un désé-
quilibre du milieu intérieur dont la plus grave conséquence
est l'insuffisance rénale, qui conduit a l'accumulation des
déchets dans l’organisme.
D’autres maladies touchent également l’appareil urinaire : la
formation de calculs dans les reins, qui peuvent ensuite
migrer dans les uretéres et la vessie, des tumeurs, qu’elles
aw
12
soient bénignes ou cancéreuses, des infections urinaires, des
troubles de |’évacuation des urines vers l'extérieur pouvant
provoquer une rétention d’urine ou, au contraire, une incon-
tnence urinaire.
LENDOCRINOLOGIE
L’endocrinologie, qui étudie les anomalies de fonctionne-
ment du systme hormonal, est une spécialité médicale rela-
tivement récente. Rétrospectivement, on se rend compte que
les maladies hormonales existaient depuis longtemps, mais
les médecins n’avaient pas la possibilité de les diagnostiquer
et encore moins de les traiter. Les avancées dans la connais-
sance de ces affections et de leurs traitements permettent
aujourd’hui de mieux les soigner.
FONCTIONNEMENT
LAPPAREIL DIGESTIF.
L’appareil digestif correspond & l'ensemble
des organes qui participent a la digestion. Il
comprend le tube digestif, qui va de la bouche
a anus, et plusieurs glandes : les glandes sali-
vaires, le foie et le pancréas.
@ U’'APPAREIL DIGESTIF
dopiragme
foie
vesicle biiave
Blon ascendant
eon
Meh Sein
Lappareil digestif assure & la
fois une Fonction physique
~ faire progresser les aliments
4 Vintérieur du corps — et une
fonction chimique - décompo-
ser ceux-ci en petits éléments
qui puissent étre absorbés puis
assimilés par les différentes cel-
lules de Vorganisme. Il est éga-
Jement chargé d’éliminer les
déchets de Vorganisme
LE TUBE DIGESTIF ET
SES DIFFERENTES PARTIES
Le tube digestif mesure environ
9 metres. fl débute avec li bouche,
se prolonge dans la gorge par le
pharynx puis, au niveau du
thorax, par l'cesophage. Il
se poursuit dans abdomen par
un grand téservoir, l'estomac,
suivi de T'intestin (intestin
mréle, célon, rectum et anus).
La bouche, les dents et la
langue. La bouche constitue
Ventrée du tube digestif. Les
dents permettent de mastiquer
les aliments. La langue les
pousse vers V'arriére de la
bouche pour quiils pénétrent
dans le pharynx
Le pharynx. Cest le conduit
qui va du fond de la bouche a
Ventrée de Voesophage. Il est
formé de muscles qui assurent
le premier temps de la dégluti-
tion, acte par lequel les ali-
ments sont avalés. Ces muscles
se contractent et propulsent les
aliments dans l'cesophage.
Lesophage. I] est respon-
sable du deuxiéme temps de la
déglutition. Les aliments y
13
LE ROLE DES DENTS
‘Les dents ossurent la or
fon, premigre étope de lo
igestion. Choque ca!
dents on «ble portic ioe
iiss, ples ‘et coupantes,
pelle, ranchent les
dol. les canines, les plus
poinives et les plus longues des _
dents, déchiquetient ceuxci. Les
moloires, et dons une moindre
mesure les prémolaires (qui sont
munies de deux protuberances —
situées sur lo surface de mast
cation}, servent & broyer,
progressent grice & une contrac:
tion réflexe des muscles de sa
patoi (le péristaltisrae). Liaxso-
phage eat muni a son extrémité
inférieure d'un sphincter, le
cardia, qui s‘ouvre au moment
adequat pour laisser passer les
aliments dans l'estomac
Lestomac. C'est une poche
extensible en forme de corne-
muse, constituée de deux par-
ties. La partic supérieure (le
fundus) sert de reservoit. Dans
Ja patio infdsiorire (Paiste), les
aliments sont malaxés et
réduits en une bouillie de Bines
patticules, impréanées de sucs
sécrétés par les glandes de
Testomac.
chyme, passe dans lintestin
getle par Vintermédiaine d’
anneau de muscles, appelé
sphincter pylorique,
Lintestin gréle. De 5 7 mé-
tmes de long, il comprend le
Guodénum, court et en forme
é C ainsi que le jéjunum et
Taleon, qui forment de grandes
eacles, appelées ances intesti-
males Li
in gitle regoit les
4
séerétions du panctéas et du
foie. Il assure Vessentiel de Ja
digestion et du passage dans la
irculation: sanguine (absorp-
tion} des éléments nutritifs, des
vitamines et de Veau contenus
dans le chyme. Sa patos est
tapissée de millions de minus-
cules exctoissainées en forme
de doigt de gant, les villosités.
Celles-ci, en augmentant la sur-
face de contact avec le chyme,
facilitent son absorption,
Le gros intestin. |i est dispose
en cadre sur trois ctés et com-
prend le cxcum, puis le cdlon.
Long d'environ 2 mets, le gros
intestin 9 pour fonction prinei-
pale de concentrer les matigres
non digestibles et de les trans.
former en matiéres fécales,
feces, destinges & étxe evacudes
par Vanus. Le célan absorbe
travers sa muqueuse Veau et
divers déments contenus dans
les résidus du chyme.
Le rectum et I'anus. Ils
constituent la detnitre portion
dui tube digestif, qui assure le
contréle de Vévacuation des
matiéres fécales, C'est leur
arrivée dans le rectum qui
déclonche le hesoin d'aller & la
selle. l’anus se compose d'un
sphincter inteme et dun
sphincter exteme, Pévacuation
des selles nécessitant action
coordonnée des deux
LES. GLANDES DIGESTIVES
Ces glandes secrétent des sues
contenant diverses enzymes
Les
role est de produire la salive et
de Ia déverser dang la bouche
par Vinteanédiaire de canaux.
glandes salivaires. Leur
LVAPPAREIL DIGESTIF
Le foie. Situé a droite de Wab:
omen, sous fe diaphragme, il
pése environ 1,5 kilo. {I remplit
plusieurs fonctions vitales,
comme Mélaboration de_pro-
1sines indispensables. & Vorga-
nisme, Il produit également de
la bile, & partir de graisses.ali-
mentaires dégradées. Cette der-
ndte participe a la digestion des
ptaisses, Elle est stockée dans la
vésicule biliaire, qui se contracte
au moment des repas,
fa bile dans Fintestin gr
Vintermédiaire de canaux.
Le pancréas. C'est une glande
situeée dans la pattie supérieure
gauche de T'abdomen, en
arriére de Vestomac. Le pan-
créas assure ta sécrétion du suc
pamncréatique, un liquide conte-
nant de nombreuses substances
(enzymes) nécessaires & le
digestion des lipides et des glu-
cides. Le sue panctéaique se
déverse dans lintestin gréle par
Vintermédiaire du canal de
Clost la spécic
se consacre |
quis bi? 5
paper de I'esto-
rene estin (intestin grale,
célon, rectum, anus} sont de son
taines anes jouant un ‘ee
~ dans lo digestion (foie, vési
bilicire, ake hepa.
elogie, qui se consacre a
Ven Tie Bs le ot de bs
FONCTIONNEMENT
LA DIGESTION
La digestion, l'une des grandes fonctions de 'orga-
nisme, consiste a transformer et & absorber les ali
ments afin qu‘ils puissent étre assimilés par le:
cellules du corps. Ce processus nous apporte le:
substances dont nous avons besoin pour vivre
La digestion est un
comple:
réle ov, s'ls ne sont pas a
milables, d’étre. réduits et
odifiés pour
ter leur
e de selle
Fique-nique en famille. Prendle son temps pour déjeuner
dans un cadre agréable fecilite la digestion
LE PERISTALTISME
Si comespond 4 l'ensemble des
contoctions du tube digestif,
provoquant la progression de
son conten d’amont en aval.
Ce hénoméne, également
cppalé motricié digestive, sert
propulser les aliments du pha-
ryax au rectum : les muscles de
Foesophage, de I'estomac et des
intesiins se contractent et se
reléchent de proche en proche,
foisont ainsi progresser le bol
alimentaire. Le péristaltisme sert
aussi & brasser les éléments
rtritifs, ce qui facilite leur
absorption.
ai
Wists de Fintestin gréle,
=e niveau du deodénum.
les wilositis permettont
em accroissement considérable
de bo sehace d absorption
alimentaire est mixé avec les
sécxétions et le mélange ainsi
ebtenu, appelé chyme, par-
dans |'intestin gréle
LE PASSAGE DANS.
LINTESTIN GRELE
La digestion se poursuit dats
ntestin gréle par la décompo
sition en particules élémen
taires des éléments nutritifs
contenuus dans le chyme (pro:
téimes, glucides et lipides), Pour
ce faire, Vintestin gréle a besoin
des sécrétions du pancréas et
de la vésicule biliaire, Le suc
pancréatique est riche en sub-
stances (enzymes) nécessaires
& la digestion des protéines, des
ghaides et des lipides. La bile,
cetient des sels biliaires qui
feemment une émulsion avec ces
demiess - ils les fragmentent en
goumeiemes microscopiques.
[iskeception dec substances
mmsinemses se fait immédia
memene ae niveau des cellules
intestinales qui permettent le
passage des aliments dans le
sang (entérocytes).
Dans la premiére partie de l'in-
testin gréle, le duodénum, sont
absorbés de préfeérence le fer, le
calcium et les vitamines, ainsi
que les sucres, les protéines et
les graisses. L’absorption se
poutsuit dans la deuxieme par
tie de I'intestin gréle, le jéju-
num, Les sels biliaires passent
dans la circulation sanguine au
niveau de la partie terminale de
Pintestin gréle, Vléon.
Apres leur absorption, les élé-
ments nutsitifs sont achemines
soit dans la circulation san-
guine, soit dans les vaisseaux
lymphatiques,
Grace a existence de multiples
replis, les villosités, la surface
d'absorption de Vintestin gréle
est considérable,
LA FIN DE LA DIGESTION :
LE COLON
Les matiéres qui n'ont pas été
absorbées par Vintestin gréle
parviennent dans le célon.
Celui-ci contient d'innam
brables bactéries dont la pré
sence constitue une barriére de
protection efficace contre les
microbes dangereux. Ce sont
ces bactéries qui produisent les
gaz, dont certains sont malodo-
rants mais Ae constituent en
aucune fagon un phénomene
anormal, L’eau et les minéraux
que contient le bal fécal sont
absorbés par la paroi du célon.
Les mati¢res non absorbées
sont mélangées a des pigments
de dégradation, a des cellules
morten et A des bactérics et
forment alors les matiéres
fecales, Celles-ci passent dans
LA DIGESTION
Dives wool lg coe
a Sine debe
- raient un per
diabéte. Toutefois,
tion peut provoquer |
et a eration transit, On
le rectum, fa demiére partie du
célon, avant d'étte évacuées
par l'anus.
LE BILAN
DE LA DIGESTION
La digestion est un phénoméne
tres efficace Vappareil digestif
assimile li quasi-totalité des
substances nutritives conte
coues dans les alintents. Le bilan
ent également remarquable en
matiere de liquides, Une
dizaine de litres d'eau pénetre
chaque jour dans le tube diges-
tif : boisson, eau contenue dans.
les aliments, sécrétions des
organes digestifs. A Texpulsion
des selles, il n'en reste qu'envi-
on 120 millilitres, et pratique
ment tolls les sels minéraux ont
éré absorbés par Vorganisme.
PREVENTION
selene 3 tse de baju de viwaser le
“Gow nest (a
Les EXAMENS DE LAPPAREIL DIGESTIF
Les organes de l’appareil digestif et leur | D’autres examens, regroupés sous le
i dendié __ | terme d’épreuves: fonctionnelles, ont
fonctionnement sont étudiés par de OR | sur boy Cobsenver-le Ronctionnesient
breux examens. Ceux-ci font appel & des | des différents segments du tube digestif
techniques d'imagerie médicale o ude du mécanisme de la défécation,
conned genie UOTE | cs fonetionmiant des aphinciars de
réalisés en laboratoire. Voesophage, pat exemple.
‘ramen Principe a Indications
cre cat Frpoocore
Anwsconie ipoanen deans edebendsrecum a lags des mene, des sues Files
Taide din tobe mu dun yam opaque aral,dex lcs dscns eV
‘oto pe ems,
‘Calosopie “Hain pl pe lesbo toe Recherche de leone fae dine, Hin gnemeny
lamuquetse du célon’ Taide d'un long tigniu digestif de douleuré abdotminales et dagrastie
{Uk ued Cen psnd opine ououopeh clan pps on dn cancer ena; stvdlnce
‘Ospestpaaut despre det dx pate syst opis dn cance du cen
‘{binpoie) pendant Fexamen, ainai que, ow du rectum.
Tscasdehéan,Fabation de polyp,
Fhoeadoscopie fsploton do ube digs ide duo tube Dag estimation de Veen de ens de
-Tubi 8 son extrérnité dune sonde emettane e€ — eesophage, de Yestommac et du ectum, des affections
renullane des ulacort. Selon pate eur, ajgues ou chronique du paces. des maladies des
‘etube ering purl techs ou garam. vos baie,
fehogaphie Répwo-blin. Technique pemetant de visual les oranes,Dépinage dmmatios, dune cnhose, de clas
pancréatque de uhdomen én déotacant surlnpeau une dee véseule ble. Mise en evidence din hye
sone émerast et recueillanc des wlurasons, -oud'une tumeur,
Gastroxpie ‘Eoplontion dela mugueuse du hiot du be amendes noguewes du the pst mation
‘jet ide Peesophoge au duiodénem) Tele de corps erangers, ablation de pees tumeurs et art
eum tube souple (broscope) introduc cthémoragies par injectiem ou coagulation,
gat la bouche jasgu’a Pestomag,
RM abdominal “Tecbigue wen lr props dexéonance Pc er Templcemenc et Vexersion
made nica du cope et denna des une eon
stages em coupe des oleae.
Lavement aryté amin tadiologique permettane, apis En ca ie wouibles di transi (sleenence de constipation
Inrodsrns ars Tabus fm pdude cde dates), pou dagroniques es ples
livers ou sn caer cen,
17
LES EXAMENS
peste ane ang, dot yeas
du taux est réwélatrice de certaines affections.
DE LAPPAREIL DIGESTIF
ame Peincipe Indications :
a TBamen pee: pectepais——Rechce ie cn encase duu ae
direc ide un egies res, array hézorge
inaytine ogg Despelbvenens, dele iar tu tubes du wait
a lp) se pom.
‘Scammer abdominal “nen ralog que ane wn apparel Frade tes ogame conenus dns a cavitt
‘eames’ tj Xu erst abe dehdeem xe pes esate, me
nage cape Sn de Tne ise cave ve, abe ia vee
“Teast bared ety eng oan pte lof | Mixed dune von de iveinale
Tren pe apesabsorion aiding pr ine Gehmimet er ond cere des
‘Xd (prs uc bu ene) a pode gma, de naton ewe cn
eta bye
Tamicuseyaueduaaa Si delchinodlphnsdela pair Ml dene de lin de pt de organs
sop da tbe Spe esophag, teu dre ne mal ato,
fen, ddean lis api pon we uur ou un he
de produit de contrase (haryte).
sno nN ij :
‘Aaylinie Main dl uae eeyne= ‘Dig Bune anne gu cued
rerveraredns discon deFaidon, mean es oss
Miabinimie Mavi du amd bib, pgment june rstton dag ers nee fle
trun dcr del émogekine pip os ue bition de ies lies,
cone ab.
Lpetnie ‘Meaue de ta de lips, ubwtances Spine Vaan ike GE
(eas pp soetatsfomatcns diana oud ue cbt ducal pars
chix dex gies Gide (anal de Wit) arya we ue mae
Tmmunawéne ——=—=—senae sds yanmipwsr meaner Ena e upicon d'aide de
‘ou dur ance da fie
oprcaise Teoemen iconcape dun darn de nea sls ese et sanlates (sets
sels poury mech dévenielsmiaobes dle die aromas de Bre
{exces is).
Enamen peritlogque mena un ehaellan de ‘fra cde spin une roe prasai aine,
esses sells poury eveataes pass, bia)
semers acronis
Meee ‘ramen devi & eyes preslons Ditecton de nhl de cation, dun dau
legen Peat Gate dig de lichen un hie de eophag
Plkeme cesphasienne ——_Mesutepehsiear res, du degié ‘Diag du pantape arom dhgude aie fs de
apace pe ‘aids du bas det eamphag, rie une Yestomic dns cespphape (lls pastes
onde munie d'une éectrode, introdite
or wie ice je Peaopige
onl eet pater cargo
wal dc fh
FONCTIONNEMENT
LAPPAREIL URINAIRE
LES REINS
Les reins assurent une fonction vitale. Ils sont
chargés de filtrer le sang, en éliminant les
déchets qu’il contient, et de maintenir constante
Ia quantité d’eau dans le corps. Les déchets et
eau en excés sont éliminés dans les urines.
nt des cen:
nilliers de minus:
4e filtration, ape
ale des
suifit & assurer cette fonction
indispensable 4 la vie, et les
personnes ayant subi ‘ablation
diun rein (néphrectomie}, vi
vent tout fait normalement
LA STRUCTURE DES REINS
Les rei
au nombre de deux,
anes en forme
Glomérules du rein. Le glomérule, visible sur lo photo sous forme
dene shire pourwe de nombreux repls, constive ove: ke be
exits, fe nephron, Hunité de hitration du rein
tebres lombaires et des deux
demigres cates — lun a droite
sous le foie, l'autre 2 gauche,
Chaque rein est entouré d'une
mince capsule hbreuse de cou
leur blanche,
tensible. Cette capsule ren-
ferme le tissu fonctionnel du
rein (parenchyme rénal), le:
tres nombreux vaisseaux irti-
guant les reins, ainsi que les
résistante et inex.
és dans Jesquelles staccu:
mule l'urine. Ces cavités com-
prennent les calices, caniaux qui
dainent l'urine sécretée par le
tissus du rein, et le bassinet
structure creuse en forme den:
te
ir formée par la reunion
des calices. Le bassinet
longe, da
P qui le relie a la
vessie et par lequel s'écoule
urine : luretére
LA STRUCTURE
DES NEPHRONS
Choque néphron est consitvé
de deux éléments : le glomérule
et le tube urnifére. Le glomérvle
ext une sphére consfituée de
inwscules capilleires sanguins
1) Slcbore une urine primitive
directement & parti du song, Le
fube utinifére élabore I'urine
déhinitive & portir de urine pri
mitive. I se décompose en
quatre segments, assurant cho:
cun une fonction physiologique
précise (réabsorplion de cer
foins éléments et sécrétion).
|
19
Le parenchyme rénal. La
fonction essentielle de ce tissu
est P@aboration de I'urine, Le
parenchyme de chaque rein
connent environ 1 3 1,2 million
de minuscules structures, appe-
lées néphrons, formées cha:
cune d'un glomerule et d'un
tube urinifére (ou tubule rénal)
Le gomérule, premiére partie
Su néphron, élabore l’urine pri-
mative en filtrant le sang. Cette
wunine est ensuite transformée
par ke tube urirufere,
| partie du néphron, qui réab-
sorbe différents éléments (une
partie de l'eau, du sodium, ete.)
‘et élabore l'utine définitive.
Le parenchyme est abonelam
ment irrigué par une ou deux
artéres (selon les individus), qui
naissent directement de la prin:
cipale artére de l'organisme,
Vaorte, et par une ou deux vei-
nes, qui se jettent dans la plus
importante veine ranienant le
sang du bas du corps vers le
‘cceur, la veine cave inférieure.
LE ROLE DES REINS
Les reins assurent plusieurs
fonctions essenticlles, qui, per-
mettent de maintenir Vorge-
niisme en équilibre,
L’élaboration d'urine & par-
tir du sang. C'est cetre fone-
tion qui permet d’élimminer les
déchets contenus dans le sang
et de maintenir constant le
milieu intérieur du coxps (équi-
libre acidobasique du sang),
La scerétion d’érythropoié-
tine, Lérythropoiétine est une
hhormone, dont le rdle est de
stimuler la maturation des glo-
LVAPPAREIL URINAIRE
@ STRUCTURE DU REIN
mide.
ae eadpigh
tic pile intviour
bules rouges a Pintérieur de la
moelle osseuse, Cest la baisse
du taux d'oxygene dans les ts-
qui déclenche la production
d’étythropoiétine, selon un
mécani encore mal connu.
La séerétion de rénine, La
rémine est une substance (en
zyme) qui participe a la régulas
tion de la pression artérielle
elle Yaugmente quand celle-ci
est top, tas Eile ese sécrétée
notamment lorsque Virrigation
sanguine du tein est anormale-
ment faible, par une zone du
rein située pres des glomérules
(apparel juxtaglomerulaite).
La transformation de la vita-
mine D en sa forme active.
Ia vitamine 1D est indispen-
sable a absorption intestinale
du calcium et a sa fixation sur
les os, ainsi qu’a la réabsorp:
tion do phosphore par les reins.
Elle participe également a d’au-
tes phénomenes tels que la
défense contre les infections.
Pour étce efficace, fa vitamine
D provenant de Yalimentation
doit étre tansformée, une
fonction assuxée par les reins.
FONCTIONNEMENT
LA VESSIE
LAPPAREIL URINAIRE
La vessie est le réservoir naturel dans lequel
s'accumule l'urine provenant des reins. Un
sphincter situé a la partie inférieure de la vessie
permet d’en contréler l’évacuation.
La vessie constitue, avec le
conduit par lequel s'évacue
urine (urétre), le bas de lappa-
reil urinaire. C'est dans cet
organe que s'accumule l'urine,
élaborée par les reins et dans
laquelle la plupart des déchets
de lorganisme sont éliminés
STRUCTURE DE LA VESSIE
La vessie est un organe creux,
de forme sphérique. Elle est
située dans la partie inférieure
du bassin (petit bassin ot se
trouvent aussi les organes géni-
‘aux internes),
@ UAPPAREIL URINAIRE MASCULIN
La vessie tegoit urine prove-
nant des teins par deux conduits
(un par rein) de 25 3 30 centi-
metres de long, les uretéres. Ces
derniets sont reliés & la partie
armite de la vessie par une sorte
de valve qui empéche l'urine de
refluer de la vessie vers les reins.
La pattie la plus basse de la
vessic est reliée a l'uretre,
conduit de 8 ou 4 centimetres
chez Ja femme, de 12 centimé-
tres chez homme, gui permet
écoulement de Iutine vers 'ex-
térieur (et du sperme chez
homme). Elle est entourée d'un
sphincter, muscle cizculaire,
UVAPPAREIL URINAIRE FEMININ
LES DIFFERENCES
ANATOMIQUES ENTRE
Lo vessio est positionnée d’une
maniére différente chez les
hommes et les femmes, en
tion de leurs organes génitoux
respectifs. Chez les hommes, la
prostato, une glande sexuelle qui
joue un réle dons la formation
du sperme, est située jus
la vessie ay les premiers
im tiene. ee
Pi pour @yacver
i Tetne Chee aired
21
de Foppareil urinaire.
(On distingue netiement les reins,
tes eretives et la vessie
(corties fchées)
@ controle Vouverture et la
fermeture du col de la vessie
de mission d’utine.
CURINE
ine est un liquide jaune
pile. ambré, limpide au mo-
ment od il est émis, d’odeur
sefande et légerement acide
‘Ele est constituée d'eau dans
Lequelle sont dissoutes des
substances minérales (sodium,
poxzssim, calcum, etc.) ct orga
seqees (urée, hormones, vita
smimes, etc) Elle contient des
bales rouges et des globules
Slams em faible quantité. A
Feet mcemal, elle ne content ni
sexe, me pecttine, ni bactérie.
Cictalemene, come 05 et
22
LAPPAREIL URINAIRE
litres
dlutine sont émis | LES PRINCIPAUX
chaque jour. Cette quantité | EXAMENS DE LA VESSIE
varie en fonetion de lage, de la
quantité de boissons absor- | De nombreux examens permet
bees, de Valimentation, ete. tent d’explorer Ia vessie et
d’étudier son fonctionnement
EMISSION D'URINE Certains font appel aux tech
niques dimagerie médicale
Llémission d'urine, ou miction, | échographie, scanner, radiogra
se déroule en plusieurs phases. | phie apres introduction dans
Le remplissage de la ve: une veine d'un produit de
uurine élaborée par les reins | contraste qui opacifie les reins,
est évacuée par les ureweres | les urettres, la versie ot l'urétce
dans fa vessie. Le muscle qui | (urographie intraveineuse), ra
forme la couche exteene de li | diographie’ apres. introduction
vessie se distend, Le bas de la | d'un produit de contraste direc
vessie (col vésical) et le sphine- | tement dans Ja vessie (cystogra-
ter qui lentoure sont fermés, | phie retrograde), examen de la
ainsi que le sphincter qui | vessieal'aide d'un tube optique
entoure l'urdtre, ce qui permet | muni d'un systeme d’éclaurage
le remplissage de la vessie (endoscope) intraduit dans
La miction. Lorsque la vessie | urétre (cystoscopie). D'autres,
st pleine (sa capacité moyenne | comme Vexamen cytobactério-
varie entre 300 et 400 milli- | logique des urines (ECBU), sont
litres), le besoin d'uriner se fait | effectués en laboratoire, a pactir
ressentir. Les sphincters se rela- | d'un échantillon d'uine, Enfin,
chent, tandis que le muscle | un ensemble d’examens réunis
vésical se contracte, entrainant | sous le terme d'exploration uro-
évacuation de T'urine par | dynamique, permettent den
Vurétte. Puis, les sphincters se | gistret les variations de pres
referment et (e muscle vésical | sion de la vessie pendant son
se détend de fagon que la ves- | remplissage, et le débit d’éva-
sie pursse & nnuveause remplir, | cuation pendant la miction
LES SIGNES D’ALERTE :
(CHANGEMENT D‘ASPECT DES URINES
De nombreuses maladies des voies urinaires peuvent altérer l'ospect
des urines, co qui doit alerter le patient et lengager & consulter un
médecin. Les urines peuveit prendre une couleur rougemarron, tro-
duisant la présence de sang {hématurie}, ou étre troubles, par le pré-
sence de pus sous forme de Hocons blanchéres (pyurie), ce qui
‘@voque une infection urinaire. Elles peuvent aussi contenir une sorte
de sable, signe de |évacvation spontanée de colculs. Plus rarement,
les urines peuvent renfermer des bulles d’air lors de leur émission
(pneumarurie}, ce qui doit faire rechercher une communication anor-
male de la vessie avec un organe creux, tel que l'intestin
- |
L’appareil urinaire et son fonctionnement
peuvent étre étudiés a l'aide des différentes
techniques d’imagerie médicale : radiogra-
phie, scanner, imagerie par résonance
magnétique, échographie et endoscopie.
Les EXAMENS DE APPAREIL URINAIRE
‘D'autres examens sont réalisés en labo-
ratoite 4 partir d’un échantillon d’urine
ou d'un fragment de tissu preteve lors
d'une petite intervention ou par endo-
scopie (biopsie). Ils permettent de déce-
ler diverses anomalies et de suivre |'évo-
lution de nombreuses affections.
Examen Principe Indications
‘bucant nleica FF pose
Gpptowofie examen de i vse fod us abe sop Observation ds br de panel urna fvsie, wit)
rigid murs un ytmeoprique top),
‘ue fn inrdu pa vies aus
(or), pre antic cher Phomime
Echographieprstatique Technique dnvageie méticale permeate
se sule pitt gre ne side
rerant cecil dev ule
rue paras,
ehoprapie rere Technigve ages médcale jermetant
de vale srt en déplaga ut apa,
Teed of sont suds ces ean,
be sande merase des ulasont
‘RM skdominopebieme Teche mages ripe se
np seme magpie
cae es compas 6 Cpe Somat
de mag
Seannerabdomino-pelien Examen nicogioue ena wn appar
(sme yn 1 emma es
Urographemaveneust Examen raising gt emet eaer
ages en coupe is fines de Roepe =
Teasing pendant xan tester dveres
‘nterverions prlévement
ete, extition de eae ee
Recheshe os dino Wine mabe dea praae
ani tienen
‘echt deals aes, estan des ees.
ae; yk LE ae en
de rouble de Véieion d'une, de dour,
Aileen, de présence desing dats les wines
eins sa FemplacementeTestendn une son
es organes de apparel rite (is essere)
fede det onpmes de Tapparel wnmie(cin, vse}
Emerald en cat infection uncare, de péence
lamorpbologe te faeionement de sag ins es ins, de ous es migton
apparel rte conse Saber den cake dans swe ries (ogues
estes rnaes apts avoir nde apes) x de trouls de sion die
‘opaque aux ayes Xen ijn, dan ae
‘veined palet, un procht1odé acho opaque. '
Lssixgsass oecatorsroks —— Megute dans un échantllen de angen tnx Recherche ox confirma dune enact
Crexisingmie de céatinine, une substance sormalement des ins assure corecerent eur de filet
‘mine pres ees dans les ines sang ufsance rae.
LES EXAMENS
DE LAPPAREIL URINAIRE
— Principe Indications
Coen rade secede elle desuomées Recerhe decele anda ned
dep des wei bet dun Atunlon en appr atc ine eu de sve
ies
a Mest en iret sen Diag et sense ts tet di cane
peoaigues signs (5A) lain de i, dtc de anger dela cute, di adeome de poate aren
spktiie deb pros, ape eae bie dine nnn aig depot.
Soa
Emme qrobacioogque fam umicncope, ath enabortone, Dag ne nection de appr wae
eee (ECHL) vm calor doe cues dass Enid etn de oles ges dns ies
smfhcen née diel tax dedeerminer mute) onenain de dent ve kl
Je naib de mies te oies ged mou ue tune de fp una
st bis at le dug.
Tenogrmme wise ace, dn fell ie imo: e so de males pert
hong conti ny, pt, acmpien eet eos de igs
can, magnum, coe, e:)etmenne de Fans dnb, netfee le
A ea oem pctv sy dato, ethan te
Shana paar dtekgse We tracanioee ‘valuation di sid foration de ale acide
ey ies, llectdeen about pti
un chile. |
‘ive an fg de rosa
de Fexamen ni ricroseap des tun pred
urgue en cas ins trop aide,
Diagauaie dev tumcurs (oéngnes ou malig)
dela prose.
(Confiracon du diagnostic eattctiensséoler
Pooction-biopse énale ilevement dun Sapient de teu dun rel,
aide enim uncon decay lie ee: yr eli,
rides Examen proiqué seleiethasquelespétatéte moueuse ov lupus ythémaceux dss.
utes moyens dinvestigation sont inwutfisants,
een dane Srey crac in|) toasted gine ne hah
-nicroacopigue échaallon during afin de déteainer store di dagnctc yr ine infcticn wine,
‘enti dv rang ue toner de ls eai;de ee rasa.
“eine Hic RE OUNel Acti Goal: RicheieW eeaierian eee ico deoeln
due, un produit de cher des allmens ‘assure cmectement lure de lire du sang
alsa ening pts es, Guinea
“Us Bens FONCTIONNELLES earn i -
(Débiemétre miconaelle ‘Mesure dels qualtéde a mon en sane Recherche obaalé vacuation del wel,
{seg pte da pyre (bine) on puede /ncasdnlsome de apa
sl pemet dealeldit ine ne
‘Explxaton urodynamique ‘Ensemble des examens permetiant ‘Rechorche de certaines anomaties de Févacuation
lesoitr erate depron de ies ie ds tio ae
et de dit sane dans Fappael urinate,
ela mieten.
24
}
I
}
FONCTIONNEMENT
LE SySTEME HORMONAL
Le systtme hormonal régule le métabolisme
(c'est-a-dire la dégradation ou la production —
d’éléments biologiques), la croissance et le déve-
loppement, la fonction sexuelle et les réactions
du corps au stress ou aux maladies.
‘Le systéme hormonal (ou endo-
ctinien) est composé de plu-
sieurs_glandes. L’hypophyse,
clle-eméme sous le contréle de
Thypothalamus situé a la base
du cerveau, en est le chef d’or-
chestre. Elle agit sur d'autres
glandes, dites périphériques :
thyroide, parathyroides, sur
rénales, pancréas, ovaires, tes-
ticules. Toutes ces glandes
constituent un réseau de com-
munication et de contréle com
plémentaire du systéme nex
veux, Pour communiquer, elles
sécrétent des hormones qui ont
une action sur d'autres glandes
ou tissus de Vorganssme.
LES HORMONES
Les hormones produites par les
différentes glandes sone sé=ré-
tées directement dans le sang.
@® LOCALISATION DES GLANDES ENDOCRINES
Jondos
Srréneles
LV ADRENALINE
Lodrénaline est sécrétée en por-
fie por les glandes surrendies,
‘en réponse & un stress, une
Smoson, om donge. Dis que
Elles carculent ainsi dans toutes
Jes parties du corps. Quand
eles arrivent au niveau des t-
sus sur lesquels elles agissent,
esse fixent sures récepreurs
spécifiques portés par les cel-
fules du tissu - chaque hor-
mone est adaprée 3 son récep-
‘eur spécifique comme une clef
& ume sermure. Elles modifient
alors le fonctionnement de ces
callules (dites cibles), afin de
xépondre aux besoins du
moment
UHYPOTHALAMUS ET LES
DIFFERENTES GLANDES
hypothalamus et I'hypo-
physe. Situé dans le cerveau,
Vaypothalamus sert de relais
entre le systéme nerveux et le
25
4 corps. Principal centre. |
conttéle
il
production hormonale,
hypophyse, ave:
fonctionne étroite-
physe, localisée a
au, est la glande
orchestre » du carps
re plusieurs hormones
qui influencent la production
des glandes périphériques. Elle
produit aussi des hormones qui
lent la ctaissance (hor:
mone de croissance), la produc-
ion et lexceétion de lait (prolac
tune et acytocine) et le maintien
du niveau d'eau dans le corps
(hormone antidiurétique).
La glande thyroide. Elie
séeréte des hormones (thy.
oxine, tri-lodothyronine-et cal.
citonine) qui jouent un rdle
dans le métabolisme et dans la
tégulation du calcium dans l'or-
ganisme, ainsi que dans la
croissance et le développement
z les enfants.
Les glandes parathyroides.
Elles “produigent la parathor-
Hypophyse vue par imagerie
IBM). Urypophyse correspond
6 bo toche rose, sitvée sous
fe ceneau
mone, qui assure la répartition
du calcium et du phosphore
dans le corps.
Les glandes surrénales. Elles
libérent plusieurs hormones
(edrénaline, comtisol, aldosté
rone), qui influencent notam
ment la réaction au, stress, le
meétabolisme des glucides, 'équi-
libre en sel et en eau du corps.
Le paneréas. Il sécréte plusieurs
hormones, dont l'insuline et le
glucagon, qui régulent lutilisa-
tion du glucose par l'organisme.
Les ovaires. lls produisent les
cestrogénes et la progestérone
qut commandent les caractéres
sexuels féminins.
Les testicules. Ils séerétent la
testostérone, I'hormone res-
ponsable des caractires sexuels
masculins.
LA REGULATION
HORMONALE
Uhypothalamus et Vhypophyse
sont capables d’apprécier le
taux d'une hormone dans le
sang, et, en retour, d’agir sur la
glande périphérique respon-
sable de la production de lhor-
mone en cause pour en ajuster
la sécrétion aux besoins du
moment : c'est le rétrocontrale
hormonal. Ce mécanisme de
controle agit un peu comme un
‘thermostat. Lorsqu'une glande
produit plus d’hormanes que
nécessaire pour Vorganisme, le
meécanisme de contréle formé
par I'bypothalamus et I'hypo-
physe commande A la glande de
séeréter_ moins d’hormones
(tétrocantréle négatif). Si, a Vin-
verse, la glande ne produit pas
assez d'hormones, ce méca-
nisme lui ordonne d’en produire
plus (rétrocontréle pasiti®
LE SYSTEME HORMONAL
UTILISATION
DES HORMONES
‘On connait la: composition ehi-
mique de presque toutes les
hormones. On « ainsi pu metire
av point des médicaments
ayant la méme formule. chi
migue, qui peuvent se substitver
& une hormone manquante lors-
qu'une glande est défectueuse.
Par ailleurs, il existe des médi-
‘caments qui font diminuer lscti-
vité dune glande sans qu’il soit
besoin dintervenir chirurgicole-
ment. Ce sont les inhibiteurs
d'hormones. Les chercheurs
découvrent sans cesse de. nov-
veaux mécanismes par lesquels
les hormones agissen. Ces
découvertes devraient aboutir &
des traitements plus efficaces,
‘en particulier en cancérologie
(hormonothérapie)
LES MALADIES
HORMONALES
TLoxiste deux types de dérégle-
ment hormonal, Le plus sous
vent, cest une glande péri-
phérique qui est atteinte, par
exemple par une tumeur ou
une maladie cazactétisée par
une agression de l'organisme
par son propre systéme immu-
nitaite (maladie auto-immune)
la glande produit alors trop ou
pas assez d’hormones. Le
deuxieme type de déréglement
est provoque par une maladie
de Vhypothalamus ou de l'hy-
pophyse (par exemple, pré-
sence d'une tumeu), entrainant
un mauvais fonctionnement
des glandes périphériques
quis contrdlent,
26
PREVENTION
Les EXAMENS DU SYSTEME HORMONAL
| LES DOSAGES HORMONAUX
Les dosages hormonaux font partie des exa-
mens régulitrement pratiqués lorsque Ion sou-
haite étudier le systéme hormonal.
Les dosages hormonaux. Effectués en laboratoire por des
personnes spécialisées, cas dosages nécessitent des moyens
techniques sophistiqués.
Les dosages hormonaux per |
mettent de mettre en évidence
une anomalie de la sécrétion
d'une hormone. Ils sont effec-
tugs en laboratoire, 3 partir de
divers peélevemients : de sang,
d'urine, ou, dans certains cas
particuliers, de salive. Tls peu-
vent étre complétés par des
examens d'itnagerie médicale
de la glande qui sécréte Mhor-
mone en cause (échographie,
scanner, jmagerie par réeo-
nance magnétique, scintigra~
phie). Pratiquement toutes les
hormones de organise peo-
vent étre dosées. Selon objec:
uf du médecin, Jes dosages
harmonaux sont réalisés de cif-
férentes fagons.
LES DOSAGES DE BASE
Ils évaluent la production spon-
tange d'une hormone par i
Jande concernée. Par exemple,
lorsque l'on soupgonne une
maladie des glandes surrénales,
‘on mesure la production spon-
tanée des hormones suména-
liennes. Le résultat permet de
mettre en évidence un mauvais
fonctionnement de ces glandes.
LES TESTS DYNAMIQUES,
Leé tests dynamiques sont
généralement demandés en
complément des dosages de
base. Ils ont pour but de mesu-
tet la réponse d’une glande hor-
LES HORMONES
SURRENALIENNES:
tes glondes surrénales sécrétent
plusieurs hormones > l'akdoste-
fone, responsable de la réten-
fion de sodium par les reins, le
‘contisel, qui influence certaines
réoctons chimiques, les ondro-
génes surrénaliens, hormones
méles, 'adrénoline et la nora-
‘rénoline, qui jovent un (dle
dons les efoctions de lorgo-
nisme face au stress, Un excés
Kens] de leur production entrat-
sent divers symptémes qui
sécessitent un traitement Ces
monale lorsque son activité est
stimulée ou, al'inverse, freinée. [I
Les tests de stimulation consis-
tent @ injecter une, substance
qui augmente [2 production
hormonale parla gignde concer-
née. lis sont pratiqaés lorsque
Yon suspecte une insuffisance
de production hormonale (par
exemple, une insuffisance sur- se:
sénalienne dans le cas des
gandes surrénales). A inverse,
les tests de freinage consistent &
administrer une substance qui
diminue, voire annule, la pro-
duction hormonale de la glande
en cause. Ils sont indiqués
lorsque l'on suspecte un excés
de production homonale (par
exemple, un hypetcorticolisme),
27
UIMAGERIE MEDICALE
Les différentes techniques d’imagerie
médicale permettent de visualiser les
diverses glandes qui composent le sys-
téme hormonal et d’évaluer leur fonction-
nement, normal ou anormal.
Examen Principe
Eehogaphie “Teague pepe eval ts
Ahetes pads en dept sare pa,
endo ester cx npn, ne
DU SYSTEME HORMONAL
LES EXAMENS
ues résulears des examens d'inagerie
médicale, quel que soit le type de tech-
nique mis en ceuvre, doivent toujours
@tre controntés aux données obtenues
ar l'examen clinique du patient et par
les dosages biologiques des hormones.
Ainsi, grace & ensemble des résultats
de ces examens, le médecin peut éta-
blir un diagnostic précis.
Indications,
Diagnostic de yes ou decumeurs des lande
thyroid, dl pacts, des oss et de yest
-sonde éiyetasn dea wftagans. Litmage
shtemie avis surun én, Por explorer
‘es andes pafondes panda) cee
‘chaque peur fre atone a Fendescopie»
‘a sonde est itenduite. dome fe coxps pa
Vintertediaite d'un tobe aptiqne ren
Uhaaysime Plage
FRM (image parésonance —Tectuique iant es propiets de tsnanee Didgnsticde tes de hyphae,
magnétique) smagnésique nucéaye des composants dt de hypophyse, des glands sinies, de bytes
‘cons burmin et peonevantde rcontuss dss srl
at onlateur des ager cep
desiree lands,
Scan ‘Bamen ufian un pp (anne Dapstiede rime e Thymus
Arayons Xl perma oa ex ingts de Fhypopye des ganes suis
‘eh csp ets pebeies ds dférmnen ales.
UUnordnser sense es donee
binues en inapes vibes stn ere
Sasgaphie Technique pemeuadevivalst ies ges Digeosne use melatonin dea gande
‘onnonwles eeaevatier leur fonctnnement thyroid (nodule ean ets de production de
url ditecapa des ruiation dss parla lane thyroid fypertivi et de lanes
‘une substance mdioactive (tadio€lément), ‘pacathyrides (hyperperathyro ie) Examen cgalernene
iene ae a iq en nde secdthen nrmalemene ewe
_alfiité pariculléve poot fs glande surlaquelle —aidostérone, honrmone produ par las glandes
celle se fine siuinénales (hyperaldosnénmciame}
MALADIES
LAMIBIASE ET LA BILHARZIOSE |
De nombreux parasites peuvent infester l'appa- | Les symptémes. Uamibiase
reil digestif, entrainant diarrhées, douleurs | "y-No"" Pat ne dlauhee
abdominales, ulcérations. L’amibiase et la bil- fre
harziose sont parmi les maladies parasitaires de
Vappareil digestif les plus répandues au monde.
iennent de |
g plications qui tou: |
aduisent fl
leur au
ak fj
Surtout présentes dans [es | La contamination
pays tropicaux, ces affections
peuvent atteindre les voya
geurs, sur place ou & leur retour
igions, lorsquils n’ont
et suffisamment les
regles prévertives, concemant
Yalimentation et les baignades
fectu
jue 3 Vinfes-
les bilhar:
des mol-
La contamination.
UVAMIBIASE
Cette maladie est due & une
amibe, organisme cot
d'une seule cellule
versent la
e develop:
t adultes. La
e jour des
i se propa:
ermédiaire de
. Le passage
ia peau pro-
ration,
ines plus tard, le
ent fivreux
mhée et a des
es urticaire. Les vers
suite, dans le gros
formation d'excrois-
normales (polypes) et
dulcérations. Le patient res-
férents troubles : diar-
douleurs dans Yabdo-
mentation du volume
Transmission des maladies parasitaires. Dans les pays chauds,
les eaux stagnantes sont souvent infestées de parasites. | du foie et de la rate.
29:
Les AUTRES MALADIES PARASITAIRES
Les maladies de l'appareil digestif dues & des
parasites se soignent grace 4 des médicaments
qui tuent les parasites en cause.
MALADIES DE A AZ
Pour éviter ces maladies, il faut
respecter des régles d’hygiene
alimentaice (consommer notam:
‘ment des boissons encapsulées).
‘xe sur mga denen
lectins types aunt
couraenment apples vers slats,
Maladies Causes Contamination Symprmes
Aisne ‘lft pu ds lanes de “arconsommition de posi Vives ules dase vente tree
Tmsohiy ver give Xa deliwe inks mangés crus La hve gaese anette ie,
dirsfalomenet donslesmasces —Vestomacou Tite es eke diangeisn, cece, ete. Ea Faber de
‘leaomie possons dea deer dans eurpte, teatemer, ne tumeuteghsbant a ant
(barns, mara, aqua fom, et emane ue ocuson esta
Ankyle ——-Inesation porn pase de ‘Enmcancpiedhmgurucsol Td ine 8h 8p.
storie quelques mimeties de Tong, seule Les lrves pact a peau, ~ Pui douleus et seasasinas de briese
Tankstome,Seslanves dosent migeatdans es purrs parle sirg! doné'shdomen. did, sande,
pars cfs pésenis dames pls ciniplament dons inten, aise.
costes nes maies,
‘Avcaridiace —Inestaon cds vers pmeses”—Pringestion ders ouiane eau, ‘Toun et douleus das le thors.
de 21a cenamares dekomg, ke Tuivetleslégunes es vers Fa fatigue amin, ables, rarst,
esas. elon daw Ibe digs cemangeisons, ahi, dukes
‘agent ef, es pou stains aus, mares
pi Vines gle
Disvomatose —Tnfsson pat une douve st plat Faritgetien dalimenes ens infers: ~Diamatose sigue fit, soos,
porat menue sql salad dstomagehepaize), aes du fe, pounes uae.
Seenmimérs de lng Le paste vega ou pois ros pis golem dexanltions.
se fice date edo ou les eesti (Ustomanovs esl). ~Ditpatoeeenale ouleu
‘dasha, dane onique
ave: mation de ese de sing
“Amnirsement et grande ge.
Lamblase ——aletation pac Glatt fai, ‘faringeton dite du pate. ‘Ds inal dses au sane
cu pardase pie present ule vole es mas mer Sn cae sabes
tae ou dt Vole aimera ‘lsd ease pos magsemen:
‘Tense Inston par unverpla guise Yarmgestion dines conenan des Fatigue, miguel on ps tere
Ines eas ase cuts: vane de
‘en de pore upon dex
owe lon le type We vet
gos appt, mau de vente, paral
slntde et démangeaions
Infeasion dy the
digestif par un pet ve,
Je tachocéphale.
“Pacing des ce et
ap soulet eles aipsert
suck goes vai
‘Askin ptm, suf en cog iaferaton
tassie: dare e aie.
MALADIES
LANUS ARTIFICIEL
L'anus artificiel est un orifice créé dans la paroi | #1 : Vonifice est percé sur le
f 5 i s6té du clon, sans que celui-ct
de l'abdomen pour évacuer directement les | soit sectionné, Elle pout égale-
matiéres fécales, en court-circuitant l’anus. Un tel | ment érre sae + le célon
dispositif peut étre définitif ou temporaire. Ine | [<0 ") bow spevear
constitue plus aujourd’hui une infirmité grave. inférieur fermé. Dans certains
cas, c'est la demiere partie de
Vintestin, gréle (iléon), qui est
Chez Jes personnes ayant un | | TECHNIQUE relige & la peau. Il s'agit alors
anus artificiel, les selles sont d'une ilgostamie
évacuées dans une poche en | Selon les besoins du malade, | L’anus artificiel peur étre défi
matiére plastique, maintenve | l'anusartificiel est créé en diffé- | nitif ou pravisoite. Dans ce der-
par une plaque adhésive collée | rents niveaux de l'intestin, La | nier cas, Je chirurgien prépate
sur la peau, On change cette pattie de I'intestin relide & la | les conditions nécessaires au
poche réguligrement, une ou | peau peut étre le gros intestin | rétablissement ultérieur du cis-
deux fois par jour, en fonction | (cdlon), On parle alors de colo- | cuit intestinal.
de lévacuation intestinale. stomie. Celle-ci peut atte laté-
LES INDICATIONS
L’anus temporaire. Il est posé
lorsqu’il existe un risque de
cicatnsation difficile et longue,
aprés une intervention chirurgi-
cale sur le clon. C'est le cas
quand le patient souffre d'une
infection de la membrane qui
sse les parois de l'abdomen
jtoine) ou lorsque son
jlon a été distendu par une
occlusion. Une fistule peut
alors survenir, c'est-a-dire un
écoulement de matiéres fécales
par la cicatrice abdominale:
Pour éviter cette grave conipli-
cation, on crée un anus artifi-
ciel temporaire qui dérive les
matiéres en amont et protége
efficacement les sutures. Deux
ou trois mois plus tard, lorsque
la cicatrice est complete et que
‘ayant subi une colostomie. les phénoménes infectieux ont
Elle recoit les matiéres évacuées | disparu, le circuit intestinal
par onus artificiel normal est rétabli. La fermeture
= COLOSTOMIE
Poche en place sur un patient
31
de anus artficiel est une opé-
ration breve et sans danger, qui
nécessite une trés courte hospi-
talisation.
Lanus définitif, Les indica-
tions de Yanus antificiel défini-
tif sont de plus en plus ares. I
slagit de cancers du rectum
situés tres bas, ou de maladies
inflammataires de Vintestin qui
décruisent définitivement l’anus
naturel. Parfois, I'anus artficiel
est imposé par la fragilité de
certains patients qui ne peuvent
supporter une longue intezven-
tion chirurgicale et chez qui on
craint une mauvaise tolérance
de 'opération de rétablissement
(patients agés, cardiaques),
LE FONCTIONNEMENT
La colostomie. Aprés ls mise
en place de I'anus artificiel, les
selles franchissent lorifice créé.
La difficulté du fonctionnement:
ent au fait qui nexiste plus
de réservoir ott les selles s'accu-
mulent. Leur émission fré-
qucnee ex imprevisible nécessite
donc Finstallation d'un dispo-
aif pour les secucillic. On
fabrique des. poches en. plas-
tique, comportant une colle-
rette qui se colle de facon
Gtanche als peau de abdomen,
Un dispositif spécial petmet
dévacuer les gaz en les désodo-
risant. Quand la poche est
pleine, on la remplace facile-
ment. Pour l'entaurage, l'anus
attificiel est invisible et imper-
ceptible. Des personnes spé
lisées, les stomatherapeutes,
sont en mesure d’apporter aux
colostomisés les soins et les
conseils nécessaires au bon
fonctionnement du dispositif.
Liléostomie. Liléon est une
portion de V'intestin ott la diges-
tion n'est pas terminée : les
matiéres qu'il contient sont
semi-liquides. Ainsi, quand
Vanus artificiel est ‘créé au
niveau de ce segment, le va-
lume des matiéres 4 évacuer
chaque jour est plus grand (pres.
d'un litre). Les poches doivent
donc ‘adapter’ ce volume. Par
ailleurs, les pertes de liquides et
de sels étant plus importantes,
le patent doit consommer de
grandes quantités de liquide,
afin d'éviter la déshydratation
LANUS ARTIFICIEL
et de prévenit le risque de for
mation de calculs dans les
reins. De plus, le contenu éva-
cué contient des substances
(enzymes digestives) qui peu-
vent itriter la peau. Les soins
locaux doivent étre particulie~
rement minutieux.
anus naturel. Si la colosto-
tie est définitive, elle s'accom-
pagne le plus souvent d'une
amputation de l'anus. Le péri-
née (plancher du petit bassin
situé entre les cusses), ne com-
porte plus d'orifice. S'il s'agit
d'un anus temporaire, la partie
inférieute de l"intestin continue
a fabriquer des selles, compo-
sées de sécrétions liquides et de
produits de desquamation de la
paroi du célon (chute des cel-
lules qui tapissent I'intestin).
32
MALADIES MALADIES DE ALK z
APPENDICITE ET PERITONITE
Liappendicite et la péritonite font partie des
affections les plus fréquentes qui tou
organes abdominaux. Elles n'ont pas
caractére de gravité, mais elles
toutes les deux une intervention chirur;
LA CONVALESCENCE
D'UNE APPENDICITE
'y 2 pas de durée standard
pour lo convalescence d'une
appendicite. En régle générale,
semaine apcés le retour au
2 et 6 jours
ces
fotigue lige 6 Fintervention chi-
nungicole se dissipe progressive:
mest. Pendent sa convoles-
cence, le t ne doit pas
reser couché, en raison du
msque de constitution d'un
cxillot dons une veine (phlé-
bite). Trois semaines aprés
operation, la reprise d'un tra
yall sédentoire est tout 4 fait
En Vabsence de com
possible
plication, les efforts physiques
importants et les activités spor-
fives sont permis deux. trois
mois aprés intervention.
Traitement de Fappendicite. Il consiste & ret
enflammé, bien visible ici, lors d'une interver
et la péritonite | Ses cause se. tradi
ns, Tes:
de 'appendice et
du péritoine, membrane qui
tapisse les patois de Vabdo- | matiéres
men et la mulent. 1
digestif
L’appendie
des viscére:
UAPPENDICITE
Les causes. L’appendicite
touche le plus souve!
lescents et les
Dans certains
troubles est
déterminer en raison
33
de ls position inhabituelle de
Tappendice, sous le foie ou trés
bas dans le bassin, par ewemple.
Les complications. Dans sa
forme Ia plur courante, l'ap-
pendicite consiste en une
simple inflammation de la
muqueuse. Dans dautres cas,
Tappendice est obstrué par du
pus. I] peut alors se rompre; le
us est susceptible de gagner le
péritoine, ce qui déclenche une
inflammation de cette mem-
brane, appelée péritonite.
LABLATION
DE VAPPENDICE
Le traitement de l'appendicite
consiste en ablation chirur-
gicale de lappendice (@p-
pendicectomic}, réalisée sous
anesthésie générale. Depuis
quelques années, !intervention
peut également étre réalisée a
Vaide d’un tube optique muni
d'un systeme d’éclairage (endo-
scope), introduit dans T'abdo-
men (céeligsvopie). Vineision
est le plus souvent de petite
aalle, lissantalora, apres I'inter-
vention, une citattice a peine
visible. Lorsque Vappenidice, en
raison de sa position, est diffi.
cile @ extraire, il peut étre
nécessaite diagrandir incision
initiale. Dans la grande majo-
té des cas, hospitalisation est
de courte durée (de 2 & 6 jours)
etla convalescence assez breve.
1A PERITONITE
Linflammation du péritoine,
ou pétitonite, est souvent lige
a une appendicite, dont elle
constitve une complication.
Les causes. La peritonite est
presque toujours consécutive a
34
Vatteinte d'un organe situé dans
Vabdomen (l'appendice par
exemple, un des cas les plus
fréquents), Elle survient le plus
souvent brusquement soit c'est
tun viscére plein qui est infecte,
et les bactéries se sont propa
gées de proche en proche jus-
qu/au petitoine ; soit c'est la
paroi d'un viscete creux (tel
Pintestin) qui s'est perforée, et
son contenu s'est accumulé
dans le péritoine.
Une péritonite peut étre géné-
ralisée a tout Vabdomen, ou
rester lacalisée. Dans ce dernier
as, Iinfection a entrain la for-
mation d’adhérences gui clot
sonnent la cavité du péritoine,
ce qui empéche la propagation
de Vinfection.
Une péritonite peut étre, beau
coup plus rarement, chronique.
Elle est alors, le plus souvent,
d'origine tuberculeuse.
Les symptémes. Une périto-
nite se traduit par une intense
douleur dans le ventre, des
vorniasoments et un arrét de
Permission des selles et des gaz.
Le malade est figvreux, abattu
et souvent anxieux et pale.
‘Dans certains cas, son pouls
sfaceélere. La paroi de 'abdo-
men est dure et douloureuse.
En car de péritonite localisée, le
sigge des douleurs dépend de
Vorgane en cause (en bas et &
droite de abdomen en cas de
complication d'une appendi-
cite, par exemple).
LE TRAITEMENT
DE LA PERITONITE
Une péritonite aigué générali-
sée nécessite une hospitalisa-
tion en urgence dans un service
de chirurgie. Le patient est mis,
APPENDICITE
ET PERITONITE
sous perfusion intraveineuse
pour compenser ses pertes en
liquides. Vintervention chirur-
gicale vise, d'une part, a soi-
gnet la cause de la péritonite
(suture pour fermer un ulcére
perforé, ablation de lappen-
dice, etc), d'autre part, & net-
toyer la cavité abdominale et
a mettre en place un drain, des-
tiné a évacuer du sang ou du
pus. Gette opération est com-
plétée par l'administration de
médicaments (antibiotiques)
L’hospitalisation dure en géné-
ral de 8 a 15 jours, mais elle
peut s‘éendre a plusieurs
semaines dans les cas les plus
raves
traitement de la péritonite
localisée est le méme, mais les
lésions responsables de I'in-
flammation peuvent étre trai-
tées quelques mois plus tard,
une fois terminge la phase
aigué ce |’inflammation.
IES DEA AZ
LES ATTEINTES RENALES
Les reins peuvent étre atteints de nombreuses | On classe les maladies du rein,
nd «| ou nephropathies, en. quatre |
maladies. Celles-ci touchent, selon le cas, les uni- | "eP4oPs Mes, due
|
}
MALADIES =
tés de filtration des reins (néphrons), leur tissu de | du rein qui est touchée
: rh «les i atteinte des glomérules ; des
soutien, ou encore les vaisseaux qui les irriguent. tubules uriniferes (glomenule et
tubule urinifére forment le
néphron, Vunité de filtration
du rein); du tissu de soutien du
rein (tissu interstitie) ; des vais-
seaux iriguant les reins.
LES ATTEINTES
DES GLOMERULES
sous le nom de gloméruloné- |
phrites taduisent par
wr tomes
ne de syn:
je, gui en
une tres |
cétention d
dans les tissus (aedéme). EI
aigués ou chro:
es. Dans ce dernier cas,
S peuvent entrainer une
atteinte irréversible des reins,
gui n’assutent alors plus leur
fonction de filtre du sang
(insuffisance rénale)
Glomérulonéphrites aigués.
Elles sont généralement consé-
cutives & une angine non soi-
gnée. Le vaitement est celui
des symptémes (restriction des
apports en eau et en sel et prise
iques pour faire dimi-
me), parfois associé |
4 des médicaments dont le rae |
est de faire baisser la tension, |
|
J
Massage des jambes d’une personne souffrant d’cedémes. Cette affection guérit en une
Le gonilement ces jombes constive un des symptémes de quinzaine de jours, le plus sou-
lo néphrose, une maladie qui aiteint les glomérules des reins, vent sans laissex de séquelles,
Clomérulonéphrites _chro-
niques. Elles peuvent survenir
sans cause connue (on parle
alors de néphrose). Elles peu
vent aussi étre consécutives. &
des maladies : diabéte, palu-
disme, affections auto-immunes
caractétisées par «ine agression
de Forganisme par son propre
systeme de défense (lupus éry-
thémateux disséminé, purpura
thumatoide). Elles peuvent
également découler de la prise
de médicaments (sels d'or,
D-pénicillamine). Le traitement
fait appel aux corticostéroides
ou aux médicamer
suppresseurs, associes si besoin
au traitement des symptomes
(régime sans sel, mécicaments
hypotenseurs, ete.)
LES ATTEINTES DES
TUBULES URINIFERES
Elles sont regroupées sous le
serme de tubulopathies et peu-
vent étre aigués ou, beaucoup
plas rarement, chreniques.
Tubulopathies aigués. Elles
se caractérisent par la destruc-
tion des tubules uriniferes, due
4 la prise excessive de certains
medicaments (antibiotiques,
par exemple), a absorption de
toxiques (mercure, plomb, etc.)
ou un état de choc, Les tubu-
lopathies aigués se manifestent
par une insuffisance rénale
aigué, se traduisant par un arcét
de Véraission d'urines. Le tai-
tement est avant rout celui de
la cause (arrét du médicament
responsable, par exemple)
Dans les cas les plus graves,
tune filtration aruiticelle du sang
(dialyse) teraporaire peut s'im=
poser en attendant la guérison.
‘Tubulopathies chroniques.
Hlles peuvent se traduire par
des symptémes tres vasiés. IL
peut sagir de Ja présence de
glucese dans les urines alors
que le patient n'est pas atteint
Ge diabate, r’entrainane dans
ce cas aucun trouble particulier.
Les tubules peuvent sere inca:
pables d’absorber certaines
substances (acides aminés), ce
qui se traduit par la formation
de caleuls, ou cheore ere
insensibles a [hormone anti-
diurétique, qui favorise la réab
sorption de Teau, ce qui
entiaine une Emission tres
importante d’urine,
LES ATTEINTES DU TISSU.
INTERSTITIEL
Biles surviennent au cours de
certaines intoxications médica-
imentetises ou d’infections par
une. bactérie (pyélonéphrite)
La forme la plus fréquente est
la pyélonéphiite aigué, qui
n’atteint souvent qu'un seul
rein et se traduit par des
LES ATTEINTES RENALES
troubles de'I'émission d’urines
{émissions fréquentes et impé-
Teuses associées & une sensa-
tion de brillure, utines troubles),
puis par des douleurs dans le
dos aa hauteur du rein malade
associée & une fiévre élevée, Le
traitement repose sur l'admi-
istration d’antibiotiques.
LES ATTEINTES DES
VAISSEAUX DES REINS
La néphroangiosclérose et le
syndrome de Goodpasture
sont les maladies les plus fré
quentes qui atteignent les vs
seaux sanguins du rein.
Néphroangiosclérose. C'est
tun durcissement (selétose) des
andres ot des artérioles. irsi-
guant les reins, consécutive &
tune hypertension artérielle mal
ou non taitée, sur plusiewts
années, La néphroangioselé-
rose se traduit le plus souvent
par la présence de protéines
dans les urines, Elle aboutit, &
long terme, 2 une incapacité
des teins & assurer leur fonction
Gnsulfisance rénale), Le traite
ment, essentiellement préven-
til, consiste a suivre et soigner
coute hypertension artérielle.
Syndrome de Goodpasture.
Tl est lié 8 la fabrication par
Vorganisme d'anticorps contre
ses propres constituants, qui
affectent la paroi des capillaires
iniguant les glomérules rénaux
et les alyéoles des poumons.
Latteinte des reins enttaine rapi-
dement une insuffisance rénale.
Souvent, malgré Je traitement
@ base de corticastéroides et
de médicaments. immunosup-
presseurs) Tateinte progresse,
nécessitant alors un traitement &
vie par dialyse.
36
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- BenQ LCD Monitor Dead Pixel Policy-FRDocument4 pagesBenQ LCD Monitor Dead Pixel Policy-FRJalil roumiNo ratings yet
- الكتاب الثّاني من سلسلة تعليم النّشء الصّغير النّحــوDocument90 pagesالكتاب الثّاني من سلسلة تعليم النّشء الصّغير النّحــوJalil roumiNo ratings yet
- الكتاب الأول من سلسلة تعليم النشءDocument38 pagesالكتاب الأول من سلسلة تعليم النشءJalil roumiNo ratings yet
- الكتاب الثاني من سلسة تعليم النشيء الصًغير العقيدة الصحيحةDocument66 pagesالكتاب الثاني من سلسة تعليم النشيء الصًغير العقيدة الصحيحةJalil roumiNo ratings yet
- Flyer NDO A5Document2 pagesFlyer NDO A5Jalil roumiNo ratings yet
- الإنسان في القرٱن وجودا وغاية، دراسة موضوعيةDocument522 pagesالإنسان في القرٱن وجودا وغاية، دراسة موضوعيةJalil roumiNo ratings yet
- 02 الكتاب الثاني من سلسلة الآدابDocument47 pages02 الكتاب الثاني من سلسلة الآدابJalil roumiNo ratings yet
- 001003a - PK 2,5 L1 EOLE PC À Bif Noisy Le Sec L1 L4 GC 16 09 2009Document5 pages001003a - PK 2,5 L1 EOLE PC À Bif Noisy Le Sec L1 L4 GC 16 09 2009Jalil roumiNo ratings yet
- 02 الكتاب الثاني من سلسلة تعليمDocument46 pages02 الكتاب الثاني من سلسلة تعليمJalil roumiNo ratings yet
- 001003b - Bif Noisy Le Sec L1 GC À Bif PK 2,5 L1 EOLE PC 16 09 2009Document5 pages001003b - Bif Noisy Le Sec L1 GC À Bif PK 2,5 L1 EOLE PC 16 09 2009Jalil roumiNo ratings yet
- 001002c-Bif PK 2,5 L1 EOLE PC Direction Et À Paris Est 29 09 09Document3 pages001002c-Bif PK 2,5 L1 EOLE PC Direction Et À Paris Est 29 09 09Jalil roumiNo ratings yet
- ABBeville - CONchil 14.03.08Document8 pagesABBeville - CONchil 14.03.08Jalil roumiNo ratings yet
- 001001a - Paris Est À Bif PK 2,5 L1 EOLE PC 29 09 09Document3 pages001001a - Paris Est À Bif PK 2,5 L1 EOLE PC 29 09 09Jalil roumiNo ratings yet