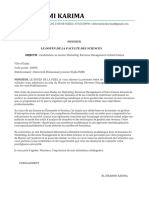Professional Documents
Culture Documents
Restuccia LF 2003 2
Restuccia LF 2003 2
Uploaded by
EL EBRAHIMI Fatima0 ratings0% found this document useful (0 votes)
22 views20 pagesOriginal Title
Restuccia_LF_2003_2
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
22 views20 pagesRestuccia LF 2003 2
Restuccia LF 2003 2
Uploaded by
EL EBRAHIMI FatimaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 20
ABDELLATIF LAABI
LAURA RESTUCCIA
Université de Palerme
Comme il est arrivé 4 tout le monde, c’est le jeu aimable du hasard 4
avoir déterminé la naissance de Abdellatif Ladbi au Maroc en 1942!.
Crest & son génie, au contraire, qu’il faut attribuer ce quil est devenu.
Poéte, romancier, dramaturge, traducteur, essayiste, écrivain pour la
jeunesse; journaliste, militant engagé: c’est surtout d’un homme qu'il
s’agit. D’un homme qui entrelace les genres; qui utilise différents moyens
expressifs pour se raconter et pour dire histoire @ travers son
expérience, afin d’essayer de convaincre ses interlocuteurs des valeurs
dans lesquelles il croit.
SA VIE
D’origine modeste, il fait ses études 4 Rabat au Lycée Moulay Idriss,
puis 4 Université ot il obtient une licence és lettres. Professeur de
francais dans l’enseignement secondaire, il commence a écrire presque
adolescent ses premiers recueils de poésie. Ce sont les années pendant
lesquelles son Pays amorce une ére nouvelle”. A cette époque, il a dgja
une connaissance profonde de la littérature francaise, mais ce qui fit
éclater en lui Purgence décrire ce fut la découverte de Dostoievski duquel
il apprit_ «que la vie est un appel intériour et un regard d’impitoyable
compassion jeté sur le monde des hommes». De [autre cété, son
développement intellectuel doit aussi reconnaitre sa dette envers les
cuvres de Driss Chraibi, Kateb Yacine, Albert Memmi qui lui ont enseigné
qu’on pouvait essayer de restituer au Maroc sa culture — dans ses
contradictions et ses tares, peut-étre —, mais que celle-ci pouvait aussi
constituer une référence. Mais, encore, son trajet idéologique est marqué,
de maniére évidente par la découverte du Manifeste du Parti Communiste
de Marx et Engels et, plus tard par celle des Dannés de la terre de Franz
Fanon. En 1966, il fonde avec des poétes marocains la revue "Souffles" et
les éditions "Atlantes" et donne vie avec Abraham Serfaty au mouvement
révolutionnaire Ilal Aman et a I'Association de Recherche Culturelle,
En 1942 le Maroc est sous domination coloniale depuis trente ans.
Au moment de I’Indépendance, en 1956, il a quatorze ans.
A, Laabi, La brilure des interrogations, Entretiens réalisés par Jacques Alessandra,
Paris, L’Harmattan, 1985, p. 30.
91
IARC qui, A cause de I’évidente orientation socio-politique de la pensée de
ses animateurs, ne plait pas au gouvernement qui fait arréter les deux
hommes. La (in)Justice ne lui fait pas peur et il continue 4 proclamer ses
idéaux; son combat pour la liberté lui vaut d’étre emprisonné le 27 janvier
1972 avec Serfaty et Derkaoui. Le 14 mars il sera de nouveau arrété et
conduit au centre de torture clandestine de Derb Moulay Cherif. II est
torturé pendant quatre jours, et, 4 la suite d’un vaste mouvement
intellectuels et d’étudiants, il est remis, comme ses camarades, en liberté
provisoire le 25 février. Il sera emprisonné 4 nouveau peu de temps apres,
pour étre condamné a dix ans de réclusion.
La prison a été pour Laabi une modification radicale de sa perception
du monde, «impitoyable école de transparence», qui lui a appris
énormément sur lui-méme et sur les autres, C’est le théatre privilégié de
Pobservation. A travers l’expérience carcérale, il lui semble avoir mieux
percé le mystére humain, et avoir également nuancé sa vision des choses.
Si d'un cété la prison peut provoquer une coupure dans Iexistence
individuelle face 4 un monde qui continue son parcours, elle représente
pour Laabi, d’autre c6té, un moment de rencontre et de réflexion avec et
sur soi-méme.
Abdellatif Laibi ne sera libéré que le 18 juillet 1980 et assigné a
résidence, grace a la pression d’intellectuels européens. A leur téte
Ghislain Ripault (ami d’outre mer) qui, en 1975, a entrepris une action
qui va déboucher en 1979 sur la création d’un comité international’.
Aprés une premiére période d’exil en France avec son épouse Jocelyne et
ses enfants, il tente de rentrer au Maroc oii il veut créer une maison
d’édition, mais des difficultés d’ordre financier le contraignent
s‘installer définitivement en France.
L’ECRIVAIN-POETE
Militant engagé depuis toujours, c’est a travers son inspiration
poétique qu'il a fait son entrée officielle dans le monde de la production
littéraire. A partir de L’Arbre de fer fleurit (Paris, Editions P.J. Oswald,
1974), Le Régne de barbarie (Paris, Inéditions Barbare, 1976), en passant
par U'Histoire des sept crucifiés de V'espoir (Paris, La Table rase, 1980);
Sous le bdillon le poéme (Paris, L'Harmattan, 1981); Discours sur la
colline arabe (Paris, L'Harmattan, 1985); L'Ecorché vif (Paris,
L'Harmattan, 1986); Tous les déchirements (Paris, Messidor, 1990); Le
soleil se meurt (Paris, La Différence, 1992); L'Etreinte du monde (Paris,
La Différence, 1993) et Le Spleen de Casablanca (Paris, La Différence,
On ne peut nier ici qu’aucune action pour sa libération n’ait été entreprise au Maroc.
92
1996), c’est la poésie qui domine I’expression Ia plus naturelle de son
étre: «J’ai toujours cru que la poésie est le vrai laboratoire de la littérature,
l’agent de subversion et de contamination, le creuset incontournable ot
les formes se font et défont, ot la langue se renouvelle, ob ces cimetiéres
de mots que sont les dictionnaires reviennent a la vier‘. La poésie occupe
donc, dans son travail d’écrivain, un rdle de premier plan. C’est la voix
spontanée du domaine des sensations les plus intimes; c’est la faculté
maitresse de connaissance et de communication.
Son entrée dans le marché du livre n’a pas été aussi facile qu’on le
croit aujourd’hui. Si au Maroc l’accés aux maisons d’éditions lui était
nié a cause de sa position politique, en France il fut longtemps objet d’un
certain ostracisme de la part des grands éditeurs, de la presse culturelle et
des média. Avant de voir accepter un livre par les éditions du Seuil ou par
Denoél, il a été publié d’abord en piéces détachées au mépris méme de la
succession chronologique de ses aeuvres.
Les sept longs poémes qui composent Le Régne de harbarie ont été
Gorits de 1965 a 1967 et représentent sa premigre prise de parole. Mais ce
recueil ne paraitra qu’en 1976 en France® suivi de Poeémes oraux
(composés entre 1967 et 1971). Marqués par une écriture violente et
haletante, ces poémes veulent répondre a la bartbarie organisée d’un
pouvoir qui étouffe l’identité d’un peuple. Le recueil nous relate une
situation d’urgence généralisée dont ne restent pas étrangers les massacres
de Casablanca de 1965, la guerre du Viét-nam (1964-1973), ni celle des
Six-Jours de 1967. Le poéme Race en particulier, prend la valeur de
manifeste pour souligner le devoir d’insoumission du peuple marocain afin
d’apaiser la soif de dignité et de liberté. A cause de son réve, de sa foi dans
Fespoir, 'homme est emprisonné, le politique inculpé. Mais Putopie se
renouvelle, Pespoir s°enflamme et ainsi L ‘Arbre de fer qui est stérile par
nature, fleurit. Sous forme de long monologue adressé en grande partie a
sa femme, le poste fait fleurir les images du désespoir qui se dissolvent
dans celles de l’espoir. Sous le baillon le poéme et I'Histoire des sept
crucifiés de l'espoir recueillent le cri au monde d’une ame mortifiée et
angoissée qui méne son parcours dans l’espoir. Les poémes qui composent
ce dernier recueil ont été écrits pendant une période d’isolement total. Le
rythme et la langue qu’il y utilise ressentent l’influence des griots
tambourinaires d’Afrique: il emprunte la forme orale du poéme épique
pour dénoncer le drame humain de sept opposants exécutés en 1974
Dans son recueil Discours sur la colline arabe suivi de Pdturage du
5 A. Laabi, Un écrivain en Seine Saint-Denis, Conseil Général de Seine Saint-Denis,
1993, p. 6.
La publication fut reprise toujours en France en 1980 par Les éditions du Seuil. Tl faudra
attendre 1983 pour que ce recueil soit publié au Maroc, vu interdiction qui a concemé
ses Gerits tout au long de son incarcération.
93
silence il intégre V'expérience de son écriture carcérale et celle de ses
premiers poémes pour dénoncer les atrocités perpétrées aux dépens du
peuple palestinien. Comme il avait déja fait avec L’Anthologie de la
poésie palestinienne (Paris, Messidor, 1990), il traduit les meilleurs
postes palestiniens comme Darwich et Al Qassim en confirmant ainsi &
houveau son engagement pour la cause de ce peuple. Le Spleen de
Casablanca écrit en partie au Maroc et en partie en France, est une sorte
de réflexion désolée d’un impossible retour, C’est la constatation
douloureuse de la perte de son propre Pays qui I’éloigne: c’est le chant du
deuil du double exil. ;
Le Petit musée portatif (Neuilly, Editions Al Manar, “Poésie du
Maghreb”, 2002) est construit sous forme de catalogue d’une exposition a
théme a laquelle concourent plusieurs codes expressifs. Les po&mes qui
décrivent les objets sont, a leur tour, représentés par les ceuvres de
peintres contemporains. Le visiteur est invité a accomplir le parcours
expositif qui retrace la vie de l’auteur partir des portraits de ses parents,
A mi-chemin entre recueil de poéme et album de famille, Poeuvre arrive
s’interroger sur le rapport étroit entre les mots, la peinture et le monde
extérieur.
C’est toujours en tant que poéte qu’Abdellatif Laabi fait des incursions
dans le domaine du roman. Ses romans doivent se définir en dehors du
code romanesque, dans une constante interaction entre genre poétique et
genre narratif, Son but est celui de rompre avec le genre occidental qu’on
appel “roman” pour laisser la place a une véritable sensibilité marocaine.
Dans son premier récit L’GEil et la nuit’, Vauteur superpose a la forme
romanesque occidentale une structure narrative arabe: la Rhila (itinéraire)
subdivisé en magamat (séances). Ce choix narratif correspond chez Laabi
4 la volonté précise de rompre avec la littérature colonisée et d’offrir aux
lecteurs un livre-manifeste qui soit la voix d’une littérature
authentiquement marocaine. Le “roman marocain” se définit, alors,
comme narration orale-écrite. Le croisement des genres s’accompagne
done d’une écriture polyphone: voix plurielles, mélanges des codes
linguistiques, interpénétrations des plans énonciatifs. Cette exigence est
clairement décrite par [Auteur dans la préface qu’il rédige pour la
derniére édition du roman, Mare Gontard soutenait que la réédition de
Gil et la nuit n’est qu’un acte de réhabilitation d’une phase de la vie
reniée par Laabi® L’Auteur déclare en réponse, qu’au contraire, «renier
une oeuvre ou une phase de sa création pour un écrivain, c’est concevoir
Ecrit en 1967 et publié pour la premiére fois chez I’édition Atlantes en 1969, il fut
ré6dité une premiere fois & Paris en 1977 par les Inéditions Barbare, et encore une fois
en 1982 & Rabat par les éditions SMER
* Chr. M. Gontard, La violence du texte, Paris, L’Harmattan/SMER, 1981, pp. 122 et ss.
94
une partie de soi-méme sous le signe de la monstruosité. C’est devenir
PInquisiteur de soi-méme»’. Le long du roman ressort avec force, une
confrontation entre la nuit de Pidentité et celle de oppression; c’est un
récit-itinéraire od le narrateur fait le point sur le séisme et la désolation
d'aujourd'hui en pensant aux fastes d'antan et aux nuits andalouses. A
travers la lucidité objective d’une mémoire impitoyable, le récit part de
son enfance et de son adolescence.
Si L’Gil et la nuit se terminait par un «A poursuivrey, son deuxiéme
roman Le Chemin des ordalies'® (Paris, Denoél, 1982), représente son
idéal, explicitement dévoilé dans la derniére partie du roman: «Tu sais
que, quelles que soient les variations du ton, du sujet abordé, du genre
utilisé, tu ne cesses en fait de rédiger le méme livre, de revenir a la charge,
de hanter de tes allées et venues le méme itinéraire de violence, de scalp,
de vision, de passion connue ou inconnue, de vérité marquées au fer rouge
de l’errance et du bouleversement d’étre» (p. 202). Le Chemin des
ordalies est le premier livre qu’ Abdellatif Laabi écrit aprés son expérience
carcérale. Roman autobiographique écrit 4 la deuxiéme personne, c’est le
récit littéraire d'une expérience douloureuse: prison, réflexion, Libération,
nouvelle naissance 4 la vie, sous forme de soliloque ot Abdellatif Laabi
nous transmet son choc de la liberté. L’Auteur nous fait parcourir a
rebours son expérience carcérale a partir du moment de sa libération, mais
au lieu de s’engager dans la rédaction d’un cahier de doléances, il met en
évidence le monde de la prison avec ses atrocités, les peurs quill a
éprouvées et les humiliations subies, mais aussi la solidarité, l'amitié,
lespoir, sentiments qu'il croit avoir vécus avec une intensité difficilement
reproductible dans la société libre. Plut6t que roman il faudrait définir
cette ceuvre une composition littéraire. Le récit s'alterne au poéme ou
encore s’interrompt pendant quelques pages pour laisser la place a des
monologues épistolaires dont le destinataire (sa femme) est en réalité sa
propre conscience vacillante qu'il cherche a éclairer.
Cette expérience carcérale servira aussi de toile de fond 4 Chroniques
de la citadelle d'exil (Paris, Denoél,1983). On ne peut pas définir cette
ceuvre littéraire a proprement parler pour l’absence d’une stratégie
consciente de sa rédaction; il s’agit en effet d’un recueil de lettres écrites
par l’auteur et a l’auteur pendant son emprisonnement. En 1977
Abdellatif Laabi et sa femme Jocelyne décident de confier 4 Ghislain
Ripault la plupart: des lettres de prison en vue de leur publication. Ces
lettres qui avaient déja été violées par les censeurs de la maison
pénitentiaire, avaient perdu leur c6té intime. Leur publication aurait pu
servir, alors, pour rompre le silence qui entoure la détention politique.
Préface & L’Gil et la nuit, p. 4.
"© Le roman aurait di avoir pour titre Le Fou d'espoir; Vauteur a gardé ce titre pour 1a
version arabe.
95
Les Rides du Lion (Paris, Messidor, 1989), écrit en France, est sans
doute le plus frappant de ses récits. Ici Rabat et Paris sont mis en
comparaison en tant que forces destructrices aussi bien que comme
sources de vic. Entre la ville-mére et la ville-maratre, auteur nage a la
dérive en se mettant en scéne avec une grande lucidité. C’est le chant a la
liberté, ob V'entrecroisement des voix du pére, de la mére et de I’épouse,
organise le récit autour des émotions. Un récit thérapeutique afin
dexorciser les injustices et afin de se fortifier dans l’espoir. C’est dans
Vexpérience de déterritorialisation de I’étre et du moi que Laabi aboutit 4
la revendication planétaire de l’étre: «Il advient que le pays n’a plus de
nom car tous les noms lui vont merveille» (p. 175). Dans ce texte, plus
que dans les autres, le code romanesque vole en éclats. La volonté méta-
narrative replie I’énoncé romanesque sur lui-méme. La méditation A la
premiére personne sur le probléme de I’écriture et, par contre, le
dédoublement du moi scripteur qui donne au récit une nuance auto-
ironique, révélent une attitude plus prudente par rapport a son image
@écrivain révolutionnaire. Cette ironie acerbe et impitoyable dénonce
aussi la nécessité de prendre les distances vis-a-vis de l’expérience
carcérale, Ladbi maintenant sait que cette expérience s’est terminée en
juillet 1980; il a enfin acquis sa liberté. Et ainsi, sur le méme ton, son
recueil de poémes Tous les déchirements, se termine avec ces lignes en
prose: «Je vous prendrai par la main et nous sortirons de la caverne.
Maintenant que notre mémoire est rafraichie, nous sommes redevenus
neufs comme lorsque nous sommes tombés du ventre de notre mére. Nous
avons vaincu ’oubli et la peur du souvenir. Si nous ne savons pas oft nous
allons, du moins nous savons d’ot nous venons. Et ce qu’il nous a coté
d’étre, au sortir du labyrinthe, a ce carrefour des épreuves humaines» (p.
147). La douleur a enfin été élaboré
Baptéme chacaliste (Paris, L’Harmattan, 1987), est la premiére piéce
théatrale de Laabi. L’enjeu est construit sur un discours dual qui est & la
fois ironique et lyrique, od se cétoient le quotidien le plus tragique et
Putopie poussée jusqu’A lespoir. Et c’est toujours l’espoir qui est 4 la base
des autres ceuvres théatrales: Exercices de tolérance (Paris, La Différence,
1993) et Le Juge de l'ombre (Paris, La Différence, 1994). Mais quel que
soit le genre de son expression, l’introspection se confond avec le regard
sur I’écriture; une sorte de mise en abime. II sent le besoin d’aller jusqu’a
Vessence de la tragédie. L’écriture est ressentie alors comme instinct de
conservation: il faut soulever les décombres qui obstruent I’horizon;
s’interroger sur son statut d’intellectuel.
Pour le théatre, Laabi a mis en scéne plusieurs représentations et il a
adapté quelques-unes de ses ceuvres parmi lesquelles: Histoire des sept
crucifiés de Vespoir, Le Régne de barbarie, Chroniques de la citadelle
d'exil.
96
Un volet trés important de son activité est représenté par Ie travail de
traduction. C’est pendant la période de détention que Laabi a appris tout
seul Parabe classique et s’est mis a traduire les ceuvres des poétes
palestiniens contemporains de l’arabe en frangais. Sa traduction en langue
frangaise, entre autres, des ceuvres de M. Darwich, A. Al Bayati, voulait
@tre, au départ, un acte militant visant 4 soutenir la cause du peuple
palestinien, mais est devenu, aprés, avec la traduction d’autres pogtes
arabes, une réflexion plus approfondie sur la nécessité de faire connaitre
dans le monde occidental la pogsie arabe contemporaine. La traduction
devient, alors, pour lui, un autre code expressif; un discours véritablement
littéraire; un ultérieur lieu d’échanges culturels.
Crest ainsi qu’Abdellatif Laabi a cru dans [’utilité de traduire, ou de
faire traduire, ses ceuvres en arabe. La diffusion de ses ceuvres au Maroc et
dans le monde arabe plus en général, lui a permis de se sentir réintégré en
tant qu’écrivain arabe; et encore, de sentir d’avoir enfin livré ses écrits
aux véritables destinataires.
LE JOURNALISTE ENGAGE: L'EXPERIENCE DE “SOUFFLES”
Au Maroc, la période post-coloniale voit surgir le besoin d’une
nouvelle forme d’expression et d’un lieu d’élaboration de l'urgence
intellectuelle. C'est une période bralante pour le Maroc et dans ce
contexte, en 1966 nait autour d’un groupe d’intellectuels, la
revue trimestrielle “Souffles”: «La. création d'une revue dans un pays
comme le nétre doit répondre a une nécessité. Elle ne doit pas combler un
vide comme le pensent certains mais témoigner d'une "réalité en actes",
ouvrir des perspectives qui, & long terme, définiront une voie, imposeront
une nouvelle vision. Ceci revient a dire qu'une revue est avant tout la
concrétisation d'un certain nombre de choix et d'options. Sans ces
exigences préliminaires, toute tentative risque de n'étre que la rencontre
d'intéréts (illégitimes dans ce domaine) ou tout simplement du
remplissage»''. Fondée par Abdellatif Laabi, “Souffles” s’engage dans une
action culturelle qui cherche a faire le point sur le probléme de Pidentité
nationale face 4 [utilisation de la. langue frangaise et 4 la menace néo-
coloniale du renforcement du pouvoir politique. II s*agit de revendiquer la
naissance d’une nouvelle écriture capable de rompre avec les stéréotypes
dans lesquels s'inscrit la littérature marocaine et de les dépasser:
«Souffles» fut enfin congue au départ comme un outil de travail, un
organe permettant a tous ceux qui ont quelque chose a dire dans le
“A. Laabi, Lisez "Le Petit Marocain", “Soutfles”, n. 2, II trimestre 1966, p. 5-7.
97
domaine littéraire et culturel, de s'exprimer en toute liberté, la seule
censure qui puisse exister étant la qualité de I'écrit, son degré d'apport et
de contribution a cette littérature nationale dont nous essayons de poser
les premiers jalons»'? La revue fut publige 4 Rabat jusqu’en 1972, date A
laquelle les activités de son directeur Abdellatif Laabi furent suspendues
par les autorités marocaines et la parution de la revue interrompue.
“Souffles”, qui a partir de 1968 a été publiée en édition bilingue, a vu la
parution de vingt-deux numéros, tandis que sa version arabe sous le titre
dAnfas” créée en mai 1971, ne comptera que huit numéros jusqu’a son
interdiction. En effet, la dénonce de Laabi, a travers “Souffles”, de
culturelle était devenue politique: oppression au Maroc, le Viét-nam, la
Palestine. Mais encore, il s’y trouve exprimé le méme soutien la lutte
des peuples africains contre le colonialisme, a la lutte des peuples
d’Amérique latine et d’Asie contre toute forme de dictature, et 4 la lutte
des peuples des Noirs d’ Amérique.
“Souffles” marqua un point de départ dans le développement
intellectuel_de Laabi. Le périodique pivotait autour de postes qui
partageaient le besoin d'un public et d'un renouveau poétique. Dans un bref
délai, la revue su attirer autour d'elle les énergies intellectuelles
marocaines les plus différentes: écrivains, hommes de thédtre, peintres,
chercheurs, penseurs, etc.; tous les domaines de la culture étaient
concernés. Le long de sa bréve existence, elle eut le temps de devenir un
carrefour de création et de réflexion pour les nouvelles générations
marocaines avides de libérer leur Pays, de lui restituer une identité, de lui
offrir un futur. Ces intellectuels étaient engagés 4 aborder un certain
nombre de questions bralantes visant 4 l’aboutissement de deux objectifs
principaux: abandonner le genre ethnographique commun a la plupart de
la littérature maghrébine et dépasser le cahier de doléances adressé aux
lecteurs de l'Occident. Bien qu’ils aient joué un réle déterminant dans le
débat sur utilisation de la langue frangaise, ils ne considéraient pas le
choix de la langue comme prioritaire: le plus important était de définir et
done de baliser les options idéologiques du patrimoine culture! national’?
Le groupe de “Souffles” aborda avec vigueur, 4 travers les pages du
périodique, des questions qui revétaient, selon leurs souteneurs, caractére
d’urgence: le statut de la littérature, & savoir, comment écrire marocain
authentique; les exigences de la décolonisation, c’est-a-dire affirmer que la
décolonisation n’était pas une affaire uniquement politique, mais qu'elle
était aussi une question intellectuelle et culturelle; la conquéte de Pidentité
qui devait passer par la critique de ses fondements, par l’écoute de la
° Bidem.
Il peut apparaitre aujourd’hui un peu étonnant qu'on utilise I'adjectif ‘national’ dans sa
valence positive. Il est bien évident, au contraire, A I’heure actuelle, que c’est justement
dans la défense des valeurs de chaque peuple et des ressources de chaque pays qu’on peut
essayer de se sauvegarder face & 'absorption globale du capitalisme.
98
mémoire et de sa marche: «La culture nationale n'est ni une négation, ni
une volonté de cléture. Volonté, nécessité et condition d'étre, on ne peut
pas y déboucher par des portes de service. C'est un itinéraire ardu que les
hommes de culture du Tiers-Monde doivent assumer. Epopée du corps et
de la mémoire avec le risque»'*.
La revue devint ainsi l'organe du renouvellement littéraire et culturel
au Maghreb. Les jeunes penseurs qui Panimaient avaient déja compris la
nécessité et I'importance du dialogue des cultures et ils avaient ouvert la
revue aux cultures des autres pays du Tiers Monde. Le groupe, qui
gravitait autour de cette revue, avait créé un mouvement culturel qui
influenga toute une génération d'intellectuels et d'écrivains.
SON MESSAGE
Au-dela d’une recherche textuelle permanente, son écriture présente la
cohérence d’une réflexion qui s’élabore autour de la mise a nu de sa
conscience et a la constante recherche des moyens d’affirmation des
valeurs de la justice. Son intention est celle de rompre avec le passé pour
créer dans le présent une réalité nouvelle plus authentique, limpide et
solaire. Critique des idéologies totalisantes, nostalgie, déchirure,
dénonciation des pratiques autoritaires du pouvoir: ces themes
s’entrelacent dans ses ceuvres en constituant la toile de fond des trames
narratives. L’originalité du rythme qui alterne l’accélération du futur
Pusage mallarméen des blancs pour suspendre le sens; le jeu des
correspondances et des parallélismes, le choix des mots parfois élégants,
parfois empruntés au langage oral, rendent sa pogsie unique. A la violence
du pouvoir, Laabi répond par la violence du texte dont la désarticulation
des formes traditionnelles va devenir la caractéristique spécifique de son
écriture narrative. Sa poésie semble étre née du souci d’exprimer, de
mettre A jour par le langage, les plus infimes mouvements de I’ intériorité
qui donnent naissance a l’exigence de lutter incessamment contre toute
sorte d’injustice. Dans tout son étre, Abdellatif Laabi ressent I’état de
violence qui envahit le monde et il ne peut cesser de hurler de toute sa
voix contre I’asservissement dont plusieurs peuples sont les victimes. Du
“je” qui s’exprime dans Le Régne de barbarie, il rejoint, le long de son
parcours tourmenté d’homme, le “nous” collectif des soumis, pour
fondre sa lutte individuelle 4 la révolte commune. Mais, si son message
poétique peut apparaitre, A une premiére lecture, un message de
protestation, il serait superficiel de ne pas reconnaitre le juste poids a
Lattitude constructive qui est un élément toujours présent dans son
\ Td., Réalités et dilemmes de la culture nationale (Ii), “Souffles” n. 6, TI trimestre 1967,
p. 29-35.
99
ouvrage. A travers l'utilisation de tous les registres littéraires, ses écrits
visent 4 la défense des valeurs humaines. On y trouve l’expression la plus
authentique de l’ame d'un fervent militant politique, qui, depuis son
enfance, a découvert Ie got de la justice et de la liberté. C’est
Vexpression transparente d'un homme confronté 4 une époque
tourmentée de histoire. $°il n’a jamais cessé de croire dans la possibilité
dun monde différent et plus juste, il a é&é emprisonné pour avoir eu
confiance dans ce réve. Il a donné une partie de sa vie a la cause de la
justice et il ne I’a jamais regretté. Au contraire, l'expérience carcérale qui
a laissé en lui des traces ineffacables, I'a amené une réflexion profonde
et a la réaffirmation de son engagement & continuer la lutte. Le crime qui
lui a été contesté, était de s°étre jeté sans réserve dans la lutte politique et
sociale contre les abus, l'oppression, la mortification. Ses mots, alors,
sont devenus son arme de combat, le levain de sa révolution. Son ceuvre
n'est pas séparable de Phomme ni de Phistoire contemporaine.
Aux dépens de sa production littéraire on a certainement davantage
retenu son militantisme politique et son engagement culturel, mais il faut
sans doute reconnaitre qu'il est avant tout un grand poéte: il déclare a ce
propos: «Je ne suis pas devenu poéte par la “grace” de mes prisons. Je
crois que c’est justement parce que j’étais poéte AVANT mon
incarcération que j'ai pu écrire au cours de mon épreuve ces ceuvres au ton
si particulier... J’accepte l’expression de “poésic engagée” quand elle veut
dire une écriture qui prend fait et cause pour sa raison d°étre, qui va
jusqu’au bout de son aventure, qui ne craint pas les remises en cause et la
brilure des interrogations. Une écriture engagée est une expérience de
création totale, irrédentiste. Dans sa création, on n’est pas engagé
comme on est engagé dans I’Armée du salut. On est engagé d’abord dans
sa fonction, celle d’un eréateur qui a pour souci de maitriser la réalité dans
laquelle il baigne, afin de transformer la conscience qu’on en a»!3.Son
ouvrage est donc la mise en forme esthétique de sa dissidence d’homme.
Son message? Qu’il faut toujours lutter contre injustice et Jes abus, et
qwil ne faut jamais perdre lespoir d’un futur qui peut et doit devenir
meilleur.
'S A. Laabi, La briilure des interrogations, cit., p. 21.
100
BIBLIOGRAPHIE
1. Ouvrages publiés par Abdellatif Laabi:
Poésie
-Race, Rabat, Souffles/Atlantes, 1967.
-L'Arbre de fer fleurit, Paris, Editions PJ. Oswald, 1974.
-Le Régne de barbarie, Paris, Editions Barbare, 1976, Paris, Editions du
Seuil, 1980; réédition 4 compte d'auteur: Rabat,
1983.
-Histoire des sept crucifiés de l'espoir, suivie de Oraisons marquées au fer
rouge, Paris, La Table rase, 1980.
-Sous le bdillon le poéme, Paris, L'Harmattan, 1981.
-Discours sur la colline arabe, suivi de Paturages du silence, Paris,
L'Harmattan, 1985.
-L'Ecorché vif, Paris, L'Harmattan, 1986.
-Tous les déchirements, Patis, Messidor, 1990
-Le soleil se meurt, Paris, La Différence, 1992.
‘Etreinte du monde, Paris, La Différence,1993.
-Le Spleen de Casablanca, Paris, La Différence, 1996.
-Le Petit musée portatif , Neuilly, Editions Al Manar (“Poésie du
Maghreb”), 2002.
Romans
-L'Oeil et la Nuit, Casablanca, Atlantes, 1969; Paris, Editions Barbare,
1977; Rabat, SMER, 1982.
-Le Chemin des ordalies, Paris, Denoél, 1982.
-Les Rides du lion, Paris, Messidor, 1989.
Thédtre
-Le Baptéme chacaliste, Paris, L'Harmattan, 1987.
-Exercices de tolérance, Paris, La Différence, 1993.
-Le Juge de l'ombre, Paris, La Différence, 1994.
101
Jeunesse
-Saida et les voleurs de soleil, bilingue frangais-arabe, images de Charles
Barat, Paris, Messidor/La Farandole, 1986. .
-L'Orange bleue, illustrations de Laura Rosano, Paris, Editions du Seuil
Jeunesse, 1995.
Autres publications
-Chroniques de la citadelle d'exil; letires de prison (1972-1980), Paris,
Denoél, 1983.
-La Briilure des interrogations, entretiens-essais (réalisés par J.
Alessandra), Paris, L'Harmattan, 1985.
-Un continent humain, entretiens, textes inédits, Vénissieux, Paroles
d'aube, 1997.
Oeuvres traduites de l'arabe
-Anthologie de la poésie palestinienne de combat, Paris-Casablanca, co-
édition P.J. Oswald et Atlantes, 1970.
-Rires de Varbre a palabre (poémes), Abdallah Zrika, Paris,
l'Harmattan, 1982.
-Rien qu'une autre année (poemes), de Mahmoud Darwich, Paris,
Unesco/Editions de Minuit, 1983. .
~Soleil en instance (roman), de Hanna Mina. Paris, Unesco/Editions Silex,
1986.
-Autobiographie du voleur de feu (poemes), d'Abdelwahab al-Bayati,
Paris, Unesco/Actes Sud, 1987.
-Je tlaime au gré de la mort (poemes), de Samih al-Cassim, Paris,
Unesco/Editions de Minuit, 1988. .
-Plus rares sont les roses (poemes), de Mahmoud Darwich, Paris, Editions
de Minuit, 1989. ;
-La Poésie palestinienne contemporaine (anthologie), Paris, Editions
Messidor, 1990.
-L'Espace du Noiin (poémes), de Hassan Hamdane (en collaboration avec
Leila Khatib), Paris, Editions Messidor, 1990.
-Les Oiseaux du retour, Contes de Palestine, bilingues. En collaboration
avec Jocelyne Laabi. Paris, Editions Messidor/La Farandole, 1991.
-La Joje n'est pas mon métier (po’mes), de Mohammed al-Maghout,
Paris, Editions de la Différence, coll. Orphée, 1992
-Retour a Haifa (nouvelles), de Ghassan Kanafani. En collaboration avec
Jocelyne Laabi, Paris, Actes-Sud, 1997.
Ocuvres thédtrales
-Le Bapiéme chacaliste, Deuxitme Compagnie des montagnes scabreuses,
dirigée par André Riquier, Nice, 1991.
-Le Baptéme chacaliste, Théatre de la Nuit blanche, dirigé par Dominique
Marouseau, Limoges, 1992.
-Exercices de tolérance, Théatre du Lamparo, dirigé par Sylvie Caillaud,
Tours, 1992.
Adaptations thédtrales d'autres oeuvres
-Va ma terre, quelle belle idée, Pice tirée du Chemin des ordalies,
roman. Compagnie des Quatre Chemins, dirigée par Catherine de Seynes.
Paris, 1984.
-Histoire des sept crucifiés de V'espoir, Atelier-théatre du Septentrion,
dirigé par Robert Condamin et Jacqueline Scalabrini. Antibes, 1984.
-Chroniques de la citadelle d’exil, Théatre Expression 7, Guy Lavigerie,
Limoges, 1984.
-Saida et les voleurs de soleil, Atelier-théatre du Septentrion, Antibes,
1987.
-Le Regne de barbarie, Compagnie du Mentir-Vrai, dirigée par Omar
Tary. Lille, 1988.
Journal du dernier homme, tiré des Rides du lion, roman, Lecture par
Edwine Moatti et Denis Manuel, Paris, 1988.
-Le Retour de Saida, Atelier-théatre du Septentrion, Antibes, 1992.
-Le Soleil se meurt, Théatre d'Aujourd'hui, Casablanca, 1994
Lectures-Spectacles
-La Parole donnée: du Maroc a Bahrein, la poésie arabe d'aujourd'hui,
en collaboration avec Catherine de Seynes et Guy Jacquet, Paris, 1986.
-Palestine: l'urgence de la poésie, en collaboration avec Catherine de
Seynes et Guy Jacquet, Paris, 1988.
Préfaces &
-Mohammed LOAKIRA, L’horizon est d’argile, Paris, P.J. Oswald, 1971
-Rachida MADANI, Femme je suis, Vitry, Inéditions Barbare, 1981.
-Amina SAID, Métamorphoses de Vile et de la vague, Paris, Arcantére,
1985
103
-Mohamed HMOUDANE, Ascension d’un fragment nu en chiite.
Morsure des mots, Paris, L’Harmattan, 1992.
Contributions parues dans des oeuvres collectives
-A propos de Ia littérature marocaine d’expression francaise, in: AANV.,
Actes du Congrés mondial des littératures de langue francaise, (sous la
direction de G. Toso Rodinis), Padova, Université, 1984, p. 393-402.
-L'interpénétration des cultures maghrébine et francaise, in: La Société
francaise et l'immigration maghrébine: Questions et perspectives
culturelles (dir. par J. Abancourt), Paris, Association des Travailleurs
marocains en France, 1987, p. 157-162.
-(Ecrire: traverser) Traversée d’écriture, in:Vision du Maghreb. Cultures
et peuples de _la Méditerranée, Aix-en-Provence, 1987, p. 29-31.
-Antipodes, in: Vision du Maghreb. Cultures et peuples de la
Méditerranée, Aix-en-Provence, 1987, p. 41-54.
-L’ami, in: Pour Kateb Yacine, Alger, ENAL, 1990, p. 33-34.
-Khadda peint encore et toujours, in: Khadda, Paris, L’Orycte, 1992, p
23.
-La poésie au secours de ma raison, in: Littérature Francophone
Anthologie (dit. Par J.-L. Joubert), Paris, Nathan/ACCT, 1992, p. 224.
-L’horloge, in: Pour Rushdie. Cent intellectuels arabes et musulmans
pour la liberté d'expression, Paris, La Découverte, Carrefour des
littératures, Colibri, 1993, p. 201.
-L‘écriture et le choix des questions, in: AA.VV., Voix marocaines de
Uespoir (sous la directions de G. Toso Rodinis, R. Saigh Bousta et GS.
Santangelo), Palermo, Palumbo (“Nouveaux rivages”), 2001, p. 175-186.
Articles parus dans la revue “Souffles”
-Prologue, n. 1, I trimestre 1996.
-A propos du ‘Polygone étoilé’ de Kateb Yacine, n. 4, 1V trimestre 1996,
p. 44-46.
-Réalités et dilemnes de la culture nationale, n. 4, IV trimestre 1996, p.
4-12.
JEL. de Bernard Jakobiak, n. 6, II trimestre 1967, p. 47-48.
-‘Le thédtre algérien’ d'Arlette Roth, n. 6, II trimestre 1967, p. 46-47.
-Réalités et dilenmes de la culture nationale (2), n. 6, Il trimestre 1997,
p. 29-35.
Gil, juin 67, n. 10, II trimestre 1968 p. 31-33.
-Les singes électroniques, n. 16, IV trimestre 1969-I trimestre 1970.
104
-'La résistance palestinienne'’ de Gérard Chaliand, n. 18, mars-avril
1970, p. 88-89.
-Au sujet d’un certain proces de la littérature maghrébine écrite en
francais, n. 18, mars-avril 1970, p. 62-65.
-Littérature maghrébine actuelle et francophonie, n. 18, mars-avril 1970,
p. 35-37.
Articles parus dans d'autres périodiques
-Lettre & mes amis d’Outre-mer, “La Nouvelle Critique”, n. 116, aoiit-
septembre 1978, p. 52-54.
-L’usage de la liberté, “Ecriture frangaise dans le monde”, n. 6, décembre
1981, p. 42-43.
-Paysages du silence, “Mot pour mot”, n. 11, juillet 1983, p. 40-44.
-Le bond en avant, “Actualité de |’émigration, n. 72, 14 janvier 1987, p.
37-38.
-Droits de l'homme et littérature engagée au Maroc, “Horizons
maghrébins”, n. 11, III trimestre 1987, p. 50-52.
-La traduction de la poésie, ou le traducteur dans tous ses états, “Le
Temps”, 12 aodt 1987, p. 8.
-Le traducteur dans tous ses états, “Motif. La revue qui traduit l’ailleurs”,
n. 1, automne-hiver 1987, p. 11-14.
-Les ailes de la terre, “Librement : regards sur la culture marocaine”, n. 1,
1988, p. 38-41
-Abdellatif Ladbi, écrivain:entretien, “Le Frangais aujourd’hui”, n. 81,
mars 1988, p. 22-26.
-Plaidoyer pour la poésie maghrébine d'expression francaise, “Le
Temps”, 30 novembre 1988.
-Poéme d'amort, “Awal. Cahier d’études berbéres”, 1990, p. 39-40.
-Le choix des arabes, “Le Monde”, 27 aoit 1990, p. 2.
-La poésie arabe aujourd'hui: poémes de Chawki Abdelamir, Nazih
Abou Afach, Adonis, Qassim Haddad, Saddi Youssuof, Ghassane
Zagtane et Abdallah Zrika, “Fonds de tiroir. Magazine d’information, de
communication et création poétique”, n. 10, septembre 1990, p. 3-4 et 9.
-L’Occident a perdu tout sens critique, “Jeune Afrique”, n. 1552, 26
septembre-2octobre 1990, p. 94-95.
-Et sion parlait d’éthique ? Opinion, “Jeune Afrique”, n. 1561, 28
novenbre-4 décembre 1990, p. 60-61.
-Octavio Paz ou l’honneur des poétes. Nobel 90, un choix courageux,
“Jeune Afrique”, n. 1563, 12-18 décembre 1990, p. 34-35.
-Le Maghreb, une utopie toujours possible, “Jeune Afrique”, n. 1567, 9-
15 janvier 1991, p. 18.
105
-Maghreb:une_ mémoire rebelle. ‘Le retour d’Abou el-Haki': les
tourments du récit, “Jeune Afrique”, n. 1568, 16-22 janvier 1991, p. 68-
69.
-La lente naissance d'une conscience nationale: les Palestiniens a la
recherche de leurs racines, “Jeune Afrique”, n. 1571. 6-12 février 1991,
P. 68-69.
-Irak: l'absurde aprés le mensonge, “Le Monde”, 21 mars 1991, p. 2.
-Exil et création, “Hommes et Migrations”, n. 1142, avril-mai 1991, p.
50-52.
-Le romancier et l'effet de serre. Deux livres de Tahar Djaout:
“L’expropié” et “Les Vigiles”, “Jeune Afrique”, n. 1588, 5-11 juin 1991,
p. 66-67.
-La société israéliens en proces. Sous Veil de candide, “Jeune Afrique”,
n, 1593, 10-16 juillet 1991, p. 40-41.
“Intifada, La génération des pierres. (Mohammad Jakoub, Abdellatif
Ladbi, Mahmoud Darwich, Yahia Yakhlef, Anwar Abu Eisheh, Maurice
Rajsfus : textes sur I'Intifada), “Lettres frangaises”, n. 16, janvier 1992,
p. 10.
-Le désordre du monde, “Jeune Afrique”, n. 1521, 30 janvier- 5 février
1992, p. 66.
-Léloge de la défaite, “Lire: le magazine des livres”, n. 201, juin 1992,
p. 95.
-Précision. La parole & l'auteur. (Réponse & article de Sylvie Bourgouin
paru dans “Jeune Afrique” n. 1702), “Jeune Afrique”, n. 1707, 23-29
septembre 1993, p. 74.
-Réflexions autour de la poésie maghrébine d’expression francaise,
“Cahier d'études maghrébines”, n. 5, 1993, p. 6-10.
-Le poste aujourd'hui, “Cahier d’études maghrébines”, n. 5, 1993, p. 71-
2B.
-Une seule main ne suffit pas pour écrire, “Cahier d’études maghrébines”,
n. 5, 1993, p. 74.
~“Souffles” c’était hier, Rencontre avec Abdallah Zrika, “Cahier d'études
maghrébines”, n. 5, 1993, p. 75-79.
-Rencontre avee Abdallah Zrika, “Cahier d’études maghrébines”, n. 5,
1993, p. 98-101.
-A Cologne, la primeur du recueil “Le soleil se meurt”, “Cahier études
maghrébines”, n. 5, 1993, p. 102-105.
“Seul l'amour. Die Liebe allein, (trad. M. Heller), “Cahier d’études
maghrébines”, n. 5, 1993, p. 106-127.
~Abdellatif Ladbi par Iui-méme, “Cahier 4’études maghrébines”, n. 5,
1993, p. 129-135.
-Lécriture et le choix des questions, “Sud/Nord. Folies et cultures”, n. 3,
1995, p. 67-77.
106
-Eloge de la déroute. Je suis l'enfant de ce sidcle pitoyable. Les Iles
éternelles (trad. De A. Alvarez de la Rosa), “Pagina”, n. 23, 1996, p.
104-115.
-L'Ecriture et le choix des questions, “Le Maghreb littéraire”, n. 3, 1998,
p. 77-92.
-Le lecteur pressé, “Qantara”, n. 29, automne 1998, p. 72.
-L'autre Maroc, Abdellatif Ladbi répond & Maroc Hebdo International,
“Maroc Hebdo”, n. 362, 5-11 mars 1999, p. 36-37.
Interviews a Abdellatif Ladbi
-Imerview avec Abdellatif Ladbi, (interview de J. Wolf), “Jeune Afrique”,
n. 601, 15 juillet 1972, p. 9-11.
-A propos de la revue “Souffles”, (interview de A. Tenkoul), “Celfan
Review”, n. 2 mai 1983, p. 6-9.
-Entretien avec Abdellatif Ladbi. ‘I’écris pour tous ceux qui peuvent
entendre le cri de Phomme’, (interview de A. Belhalfaoui), “Parcours
maghrébins”, n. 4 janvier 1987, p. 12-13.
~‘Méme quand j'écris un roman, je le fais en tant que poste...” Entretien
avec Abdellatif Ladbi, (interview de A. Torbey), “Arabies”, n. 30, juin
1987, p. 88-90.
-Entretien avec Abdellatif Ladbi. Des étres étouffés par le silence,
(interview de E. Mestiri), “Le Temps”, 12 aoat 1987, p. 8.
~Abdellatif Laabi : la poésie bruit des étres étouffés par le silence. La lutte
démocratique, enjeu primordial dans le monde arabe, (interview de E.
Mestiri), “Le Temps”, 12 aoat 1987, p. 8.
-"Quand j’entends parler de francophonie, je tire mon revolver”
(interview de N. Gassa), “Réalités”, n. 172, 25 aotit 1988, p. 37-39.
-Abdellatif Ladbi. Le devoir d’imprécaution, (interview de T. Djaout),
“Algérie-Actualité”, n. 1256, 9-15 novembre 1989, p. 39-40.
-Dall'anticolonialismo alla modernita, La sfida della letteratura araba
in un ‘intervista allo scrittore, (interview de E. Sortino), “Il Manifesto”,
15 giugno 1989.
-Sous le baillon, I’émeute, (interview de T. Djaout), “Algérie-Actualité”,
n. 1314, 20-26 décembre 1989, p. 25.
-Abdellatif Ladbi. Flammes d'un poéte, (interview de A. Cheniki),
Algérie-Actualité”, n. 1453, 17-23 aoait 1989, p. 28-29.
~Conversation avec Abdellatif Ladbi, (interview de T. Sbouai), “Notre
librairie”, n. 103, octobre-décembre 1990.
-*Rushdie ? C'est une plume merveilleuse...’ entretien, (interview de M.
Berrada-Gouzi), “Jeune Afrique”, n. 1558, 7-13 novembre 1990, p. 57.
-Aprés Souffles..., (interview de B. Ambold), “Cahier d’études
maghrébines”, n. 5, 1993, p. 92-98.
107
-Portrait:conversation avec Abdellatif Laabi, (interview de S. Bourgouin),
“Jeune Afrique”, n. 1702, 12-25 aoft 1993, p. 102-103.
-Entretien avec Abdellatif Ladbi (interview de F. Ahnouch), “Prologues.
Revue maghrébine du livre”, n, 3, printemps 1994, p. 33-36.
~Abdellatif Ladbi scrute le paysage social marocain (interview de Et-T.
Houdaifa), “Télé Plus”, n, 58, décembre 1994, p. 12-16.
-Les armes de l'amour, (interview de A. Kaouah), “Horizons”, n. 2685,
20 juin 1994, p. 11
-Abdellatif Ladi, & livre ouvert, (interview de C. Laabi), “Maroc Hebdo”,
n. 201, 18-24 novembre 1994, p. 17-18.
2. Références de livres et travaux publiés sur Labi
-Gontard Mare, La violence du texte, Paris, L’Harmattan/SMER, 1981.
-AAYV., Pour Abdellatif Ladbi : textes, dessin et photographies
(sous la direction de G. Ripault et A. Said), Paris,
Nouvelles éditions Rupture, 1982.
-Bovo Dante, Abdellatif Ladbi et Choix de poémes, in: AANV., Le Rose
del Deserto 2. Antologia della poesia magrebina
contemporanea d'espressione francese (sous la
direction de G. Toso Rodinis), Bologna/Padova, Patron
» 1982, p. 325-340.
-Benjelloun M.O., Entretien avec A. Ladbi, “Horizons maghrébins”, n. 3,
printemps-été 1985, p. 152-162.
-Dejeux Jean, Poétes marocains de langue francaise, Paris, Saint
Germain des Prés, 1985, 125 p.
-Tenkoul Abderrahman, Littérature marocaine d'Ecriture francaise.
Essais d’analyse sémiotique, Casablanca, Afrique-
Orient, 1985.
-Ripault Ghislain, Addellatif Ladbi, sow
librairie”, n. 83, avril
ier de la plus haute vie, “Notre
juin 1986, p. 68-72.
-AA. VV., La liberté inachevée, Mundisheim (67450), éd. de
l'Encrier, 1987.
-AA. VV., Poésie contre le racisme, Paris, Messidor, 1987, 143 p.
-AAVV., Abdellatif Ladbi. Un écrivain en Seine-Saint-Denis,
Bobigny, Conseil Général de Seine-Saint-Denis, 1989
-Kaouah Abdelmadjid, Rencontre avec Abdellatif Ladbi: J’écris dans un
séisme permanent, “Révolution africaine”, n. 1347, 29
décembre 1989, p. 44-45.
-Bousfiha Noureddine, Abdellatif Ladbi, in: Poésie méditerranéenne
d'expression francaise 1945-1990 (sous la dir. de G.
Dotoli), Fasano/Paris, Schena/Nizet, Comunita delle
Universita mediterranee, 1994, p. 182-189.
108
-Brahimi Denise, Appareillages: dix études comparatistes. sur la
littérature des hommes et des femmes dans le monde
arabe et aux Antilles, Paris, Deuxtemps Tierce,1991,
179 p.
-AA.W., Lectures critiques du texte maghrébin. Actes du colloque de
Kénitra, 16-18 avril 1987, Kénitra, Faculté des Lettres
et des Sciences Humaines, 1992, 149 p
-Daure-Serfaty Christine, Rencontres avec le Maroc, (Coll. “Cahiers
libres”), Paris, La Découverte, 1993, 240 p.
-Gontard Mare, Le moi étrange. Littérature marocaine de langue
frangaise, Paris, L’Harmattan (Coll. Critiques
littéraires), 1993.
-Bonn Charles, Littérature maghrébine d'expression francaise, sous la dit.
de Khadda, Mdarhri-Alaoui N., (Coll. “Histoire
littéraire de la Francophonie”), Paris,
EDICEF/AUPELF, 1996, 272 p.
-Dib Mohammed, Boudjedra Rashid, Modernité francophone contre
passéisme arabophone ?, “Qaniara”, n. 26, hiver
1997, p. 37-38.
-Restuccia Laura, Prison, sortie de prison et liberté: les troubles d'un
nouveau-né. Une lecture de ‘Le chemin des ordalies’
de Abdellatif Ladbi, in. AA.VV., Voix marocaines de
Vespoir (sous la directions de G. Toso Rodinis, R. Saigh
Bousta et GS. Santangelo), Palermo, Palumbo
(“Nouveaux rivages”), 2001, p. 23-35.
2.1 .Références de travaux universitaires sur Abdellatif Ladbi
-Belmejdoub Mohamed, La nouvelle littérature marocaine et la Société
marocaine & I'étape actuelle (Début des années 60-
milieu des années 70), Université de Aix-Marseille 1,
1981.
-Raybaud Brigitte, Poésie-Lutte, ou les moyens d'une représentation
textuelle (Aimé Césaire, Abdellatif Ladbi, Noureddine
Aba, Tahar Ben Jelloun, Nabile Fares), Université de
Aix-Marseille 1, 1983.
Bouderdara Mohamed, La problématique de l'identité et de la différence
dans la littérature marocaine d'expression francaise:
Cas de Abdellatif Laabi et Abdelkebir Khatibi.,
Université de Paris 12, 1984.
-Bentalha Mohammed, Lectures critiques de la poésie marocaine
contemporaine: analyse et évolution, Université de
Aix-Marseille 1, 1987.
109
-Gantare Abdallah, Mécanismes de la polyphonie et fonctionnement du
récit dans "Le chemin des ordalies" d'Abdellatif Laabi,
Université de Rabat, 1989.
“Secchi Annie, Za quéte dans UVoeuvre de Tahar Ben Jelloun et
Abdellatif Laabi, Nice, DNR, 1987.
-Dhelleme Maryline, La revue marocaine "Soufjles”, Université de Paris
13, 1990.
-Heiler Suzanne, Der Marokanische roman jranzdsischer Sprache zu
den Autoren un die Zeitschrift ,Souffles* (1966-1972),
Université de Berlin, Neue Romania 1990
-Illarzeg Karima, La poétique de Vengagement dans "L'Etreinte du
Monde" d'Abdellatif Ladbi, Université de Rabat, DES,
1995,
-Alessandra Jacques, Militantisme et écriture chez Abdellatif Laabi.
Université de Paris 13, 1994.
-Belmaizi Mohammed, Les arabismes dans "L’oeil et la nuit" d'Abdellatif
Laabi, ou la poétique de loralité et du bilinguisme
dans son oewvre en general, Université de Bordeaux 3,
1996
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Speaking Tasks For Intermediate Oral Exams Activities Promoting Classroom Dynamics Group Form - 85037Document10 pagesSpeaking Tasks For Intermediate Oral Exams Activities Promoting Classroom Dynamics Group Form - 85037EL EBRAHIMI FatimaNo ratings yet
- TCDocument1 pageTCEL EBRAHIMI FatimaNo ratings yet
- Line Cook Job Order # 004: Duties Include But Are Not Limited To The FollowingDocument1 pageLine Cook Job Order # 004: Duties Include But Are Not Limited To The FollowingEL EBRAHIMI FatimaNo ratings yet
- Marketing LettreDocument1 pageMarketing LettreEL EBRAHIMI FatimaNo ratings yet
- 1 Bac ExamDocument5 pages1 Bac ExamEL EBRAHIMI FatimaNo ratings yet
- - موجز لبعض نظريات التعلمDocument54 pages- موجز لبعض نظريات التعلمEL EBRAHIMI FatimaNo ratings yet