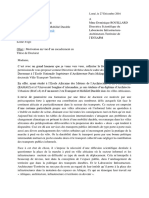Professional Documents
Culture Documents
UL
UL
Uploaded by
Gott'liebe GOKA0 ratings0% found this document useful (0 votes)
28 views37 pagesvv
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this Documentvv
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
28 views37 pagesUL
UL
Uploaded by
Gott'liebe GOKAvv
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 37
REPUBLIQUE TOGOLAISE
PY Travail — Liberté- Patrie
3 3
X94 UNIVERSITE DE LOME
PLAN STRATEGIQUE DE MODERNISATION
DE L’UNIVERSITE DE LOME
(2015 - 2020)
CULTURE DE LA REUSSITE
ET
IMPERATIF D’EXCELLENCE
2020 : a l’orée d’un nouveau cinquantenaire
opwne
SOMMAIRE
SOMMAIRE
LISTE DES SIGLES
FICHE D’IDENTIFICATION DU PLAN
PREAMBULE
PREMIERE PARTIE : L’UNIVERSITE DE LOME :
NOUVEAUX DEFIS
UUL HISTORIQUE ET STRUCTURES
LA FORMATION
LA RECHERCHE
LES SERVICES A LA COMMUNAUTE
QUESTIONS DE GOUVERNANCE
DEUXIEME PARTIE : LES AXES DE DEVELOPPEMENT
VISION ET OBJECTIFS
LES AXES DE DEVELOPPEMENT 2015-2020
JALONS
TROISIEME PARTIE : PLAN D’ACTION
QUATRIEME PARTIE : PLAN DE FINANCEMENT.
Nouw
11
12
19
23
25
31
33-35,
35
43
45
55
BU
CFC
cc
Commission LMD-UL
cRIQ
DR
DRH
DPSRMT
DIRECOOP
EAM
ENS!
ESA
ESSD
ESTBA
FASEG
FDD
FDS
FLESH
FSS
INSE
ISICA
1UT-G.
ump
REESAO
Tic
UE
UEMOA
UK
UL
LISTE DES SIGLES
Bibliotheque Universitaire
Centre de Formation Continue
Centre Informatique et de calcul
Commission Licence Master Doctorat- Université de
Lomé
Centre des Ressources, de I'Innovation et de la
Qualité Pédagogiques
Direction de la Recherche
Direction des Ressources Humaines
Direction des Prestations de Service et des
Relations avec le Monde du Travail
Direction de I'information, des __Relations
Extérieures et de la Coopération
Ecole des Assistants Médicaux
Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs
Ecole Supérieure d’Agronomie
Ecole Supérieure de Secrétariat de Direction
Ecole Supérieure des Techniques Biologiques et
Alimentaires
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
Faculté de Droit
Faculté des Sciences
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Faculté des Sciences de la Santé
Institut National des Sciences de IEducation
Institut. des Sciences de Information, de la
Communications et des Arts
Institut Universitaire de Technologie de Gestion
Licence Master Doctorat
Réseau pour [Excellence de [Enseignement
Supérieur en Afrique de l'Ouest
Technologies de information et de la
Communication
Unité d’enseignement
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
Université de Kara
Université de Lomé
FICHE D’IDENTIFICATION DU PLAN
INTITULE
Plan stratégique de modernisation de l'Université de Lomé
(2015-2020)
MAITRISE D’OUVRAGE
Université de Lome
BENEFICIAIRE
Université de Lomé
OBJECTIFS
OBJECTIF GENERAL
OBJECTIFS SPECIFIQUES
Faire de l'Université de Lomé une université moderne,
compétitive dans la sous-région
> Se doter d’un systéme et d'outils modernes de
gouvernance
> Adapter l'offre de formation aux exigences des
standards internationaux et du marché de l'emploi local
et régional
> Améliorer la qualité de la formation
> enforcer les liens entre I'université et son
environnement
> Développer des axes de recherche en rapport avec les
besoins du pays et de la sous-région
Valoriser les compétences de l’université
AXES STRATEGIQUES
‘+ Instauration d'une logique moderne de gouvernance
universitaire et renforcement des capacités des
différentes catégories de personnel dans Je sens de
cette gouvernance
* Modernisation de offre et du systéme de formation
+ Renforcement des capacités des enseignants en matiére
pédagogique, de recherche et d’entrepreneuriat
* Promotion de programmes de recherche adaptés aux
besoins de développement du pays et de la sous-région
© Instauration d’une culture de la réussite et de
Vexcellence
© Amélioration de la visibilité de l'institution
DUREE
Cing années
PERIODE
2015-2020
PREAMBULE
Au début des années 2000, les responsables des universités
publiques du Togo ont fortement ressenti la nécessité de la
rénovation du systéme de formation dont ils avaient la charge :
ils étaient, en effet, confrontés d des questions de rendement des
Institutions, d insertion professionnelle des diplomés, de
contribution des universités au développement, etc. En méme
temps, particuliérement avec le processus dit de Bologne en
Europe, on assistait a fa mondialisation Cun systeme de
formation Porigine anglo-saxonne, le systéme Licence-Master-
Doctorat.
Crest ainsi quavec fautres responsables universitaires de la
sous-région, notamment ceux, du Bénin et du Burkina Faso, le
choix, de la rénovation a été effectué lors de la fondation en
octobre 2005 du Réseau pour CExcellence de (Enseignement
Supérieur en Afrique de (Ouest (REESAO) avec comme objectif
de «promouvoir une nouvelle politique de coopération
universitaire axée prioritairement sur la modernisation de offre
de formation universitaire en vue de faciliter la mobilité et
Cinsertion professionnelle».
A partir de 2005, UL s'est attelée a cette rénovation 4 travers
Cadoption du systéme LMP, ce qui lui a permis de basculer dans
ce systéme pour ce qui concerne le grade Licence dés 2009 et le
grade Master en 2011: cela a constitué des avancées certaines
par rapport au chronogramme du REESAO mais ausst, cela a
demandé une grande volonté dadaptation aux réalités, Mais,
au-dela de la mutualisation des efforts de modernisation du
systéme de formation dans le cadre du réseau, pratiquement une
décennie aprés la création du REESAO, (UL qui est la
7
premiére université du Togo, reconnue pour fa qualité de son
systéme de formation, doit a présent se projeter dans le futur et
pour cela définir clairement ses choix, particuliers. Cela est
autant plus important qu'elle va féter son cinquantenaire en
2020, ce qui fait delle une université qui n'est plus toute jeune.
If semble important de définir dés a présent les options qui
guideront les années qui vont ouvrir pour elle son deuxiéme
cinquantenaire d existence.
Pour répondre a la question des options, Cexpérience des dix
derniéres années a montré qu'il est important pour une
institution denseignement supérieur, lorsqu’il s'agit de la qualité
de fa formation qu'elle donne, de maintenir le cap parfois méme
contre ses autorités de tutelle. Ainsi (UL pourrait prendre a son
compte la phrase de Barak OBAMA et la paraphraser de la
maniére suivante :
« L’Université de Lomé n'a pas besoin d’hommes forts, mais
Lhommes et de femmes qui fassent delle une institution forte ».
Ce sont les voies de réalisation de cette affirmation qui sont
tracées dans le présent document de planification stratégique.
PREMIERE PARTIE
L’UNIVERSITE DE LOME :
NOUVEAUX DEFIS
Une projection dans l’avenir ne peut se faire convenablement que si I’on
décrit avec précision le point de départ du changement désiré. Or, pour ce
qui concerne UL, Vhistoire de cette université est marquée par des
avancées en lien avec un processus de réforme commencé en 2005 et
toujours en cours. Il importe donc de présenter l'état de I’UL dans le
contexte de cette réforme, en vue de mettre en lumiere les nouveaux défis
permettant de fonder les axes de développement proposés dans le plan
stratégique.
VUL, HISTORIQUE ET STRUCTURES
UUniversité de Lomé est un établissement public a caractére scientifique
et culturel. Créée par le décret présidentiel N° 70-156/PR du 14 septembre
1970 sous le nom d’Université du Bénin, elle a pour missions la formation
et la recherche, la diffusion des résultats de la recherche, la prestation de
services, ainsi que la coopération scientifique, technique et culturelle.
UUniversité du Bénin devenue Université de Lomé en 2001 (Décret N
2001-024/PR du 9 mars 2001) compte 15 établissements de formation.
Faculté de Droit
Faculté des Sciences
Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs
Ecole Supérieure d’Agronomie
Ecole Supérieure des Techniques de Biologie Alimentaires
Ecole des Assistants Médicaux
Ecole Supérieure de Secrétariat de Direction
Institut Universitaire de Technologie- Gestion
Institut National des Sciences de I’Education
Institut des Sciences de I’Information, de la Communication et
des Arts
Centre Informatique et de Calcul
Centre de Formation Continue
KAKA KKK KKK KK
Hi,
11
La Bibliotheque Universitaire, et la Direction des Ressources Pédagogiques et
de l'innovation (parce qu'elle est devenue le Centre des Ressources, de
Innovation et de la Qualité Pédagogiques en 2012) apportent un soutien aux
activités de formation, bien que ces deux structures de I’UL soient souvent
classées dans les directions centrales.
Au plan administratif, "Université de Lomé dirigée par un Président assisté de
deux Vice-présidents, comporte 9 directions centrales :
Y Direction des Affaires Académiques et de la Scolarité
Y Direction de la Recherche
Y Direction Générale des Archives
Y Direction de I’Information, des Relations Extérieures et de la
Coopération
Y Direction des Prestations de Services et des Relations avec le
Monde du Travail
Y Direction des Ressources Humaines
Y Direction de la Gestion du Domaine Universitaire
Y Direction de la Prospective et de la Planification
Y Centre des Euvres Universitaires de Lomé
2. LAFORMATION
2.1. Une formation modernisée grace au systeme LMD
Cest a partir de 2005 que I'UL est entrée dans un processus de réforme
qui allait toucher & tous les éléments de son systtme de formation
(structuration du temps universitaire, offre de formation, méthodes
d’enseignement et d’évaluation, administration et gestion des flux
d’étudiants, etc.). Ce processus est la manifestation du désir des autorités
universitaires de 'époque de maintenir ‘institution ouverte aux grands
mouvements marquant le monde universitaire mondial: en effet, &
| époque l'Europe était de plain-pied dans le processus de Bologne, qui
consacrait son adhésion a Iuniversalisation du modéle de formation
universitaire anglo-saxon. Voila pourquoi, dés novembre 2004, a été créée
une Commission LMD (du nom des trois grades de ce modéle de formation
12
Licence-Master-Doctorat). Cette commission composée de représentants
de chaque établissement de formation, avait pour mission principale de
piloter le processus de réforme qui allait se mettre en place. C'est vraiment
en 2005 que le processus de réforme s’est mis en place dans le cadre de la
mobilisation d’un réseau d’universités ouest-africaines. C’est ainsi qu’est
né le Réseau pour I’Excellence de |'Enseignement Supérieur en Afrique de
l'Ouest (REESAO). Un premier séminaire interuniversitaire, en date du 11
octobre 2005, définira le cadre de la réforme pour les universités du
réseau,
Au cours de ces séminaires le REESAO va adopter ses standards et un
chronogramme pour la mise en ceuvre de la réforme. Pour ce qui est des
standards les universités du réseau ont longuement débattu du choix des
domaines avant d’en retenir les huit suivants :
Lettre, Langues et Arts
Sciences de I’Homme et de la Société
Sciences et Technologie
Sciences de |’Education et de la Formation
Sciences de la Santé
Sciences Agronomiques
Sciences Economiques et de Gestion
Sciences Juridiques, Politiques et de Administration
A585 & SHA
C’est donc dans le cadre de ces domaines que va se dérouler la formation
fondée sur la capitalisation et la semestrialisation avec la charpente
générale définie par le REESAO, charpente dont L’UL va tenir compte
pour définir ses propres standards.
C'est ainsi que le 2 octobre 2009 |a note de service N°03/UL/CP/2009
précisait dans son article premier :
« A compter de cette rentrée 2009-2010, dans tous les établissements de
UL, facultés, écoles et instituts, toutes les formations de grade L, doivent
se conformer au systéme LMD : Semestrialisation des enseignements et des
résultats, parcours présentés en UE assorties de crédits, capitalisation des
UE, systéme d’évaluation comportant des épreuves en fin et en cours de
semestre et pas d’épreuve de rattrapage. ».
a3
En 2011 des responsables de parcours et de domaines ont été nommés
dans ce sens. (Arrétés n° 017/UL/P/SG/2011 du 30 mai 2011 et n°
019/UL/P/SG/ 2011 du 30 mai 2011).
Un des aspects importants de cette administration concernait les
inscriptions administratives et pédagogiques. Pour faciliter ces derniéres
(comportant le choix des UE par les étudiants) des Cellules d’Information
Pédagogique (CIP) ont été créées a la rentrée de 2011-2012 (Cf. Arrété n°
022/UL/P/SG/2011 d'1 5 septembre 2011).
2.2, Des avancées certaines, des secteurs encore en chantier
L’examen de ce qui s’est passé & |'Université de Lomé entre 2005 et 2012
montre que beaucoup de choses ont été réalisées. Ainsi l'architecture de
base du systéme est respectée avec les trois grades (LMD). La
semestrialisation avec un semestre d/Harmattan (octobre - février) et un
semestre de Mousson (mars - juillet) est réalisée et les contenus sont
découpés en unités d’enseignement (UE) assorties de crédits dont la valeur
est restée stable depuis 2006. Des parcours ont été développés en Licence
(57) et en Master (65) dans les huit domaines créés conformément aux
choix du REESAO.
Le systéme d’enseignement et d’évaluation s’est adapté : semestrialisation
des examens et des résultats, capitalisation sans compensation.
Des postes de responsabilité ont été créés en vue de |’administration du
systéme: responsables de domaines et de parcours, responsables et
membre de cellules d'information pédagogique. Un outil de gestion des
flux a été adopté qui permet de gérer la formation et qui a permis de
délivrer des diplémes LMD, alors que le systéme d’inscription s'est adapté
au systéme.
Des dysfonctionnements demeurent cependant qui se manifestent au
niveau du calendrier universitaire (instable et démesurément étendu dans
le temps), du suivi des étudiants et de leur certification en temps voulu, de
Vinstabilité des offres de formation. Le plus grand probleme est celui de la
réussite des apprenants : pour beaucoup elle est remise en question par la
réforme. Or en termes de durée des études, avec des données
incomplétes, analyse montre que la situation n’a pas empiré depuis 2004-
14
2005, année de commencement de la réforme. Elle aurait di étre
meilleure puisqu’on est en réforme pour cela, pourrait-on répondre. Mais
cette réponse signifie qu’on ne prend pas en compte la continuelle
dégradation des conditions de formation: insuffisance croissante et
continuelle de ressources humaines, financiéres et matérielles,
environnement technologique déficient, etc. Dans le méme temps a cause
de résistances au changement, la réforme n’a pas pu étre convenablement
appliquée alors que le soutien des autorités n’a pas toujours été tres
manifeste : ainsi, @ part, le décret présidentiel instituant le systeme LMD,
aucune autre action ou déclaration n’a été faite en faveur du systeme
LMD.
Il faut en conclure que beaucoup de critiques faites au systéme LMD sont
imputer aux difficultés actuelles de l’enseignement supérieur au Togo.
2.3. Les nouveaux défis
> La professionnalisation
UUniversité de Lomé qui proposait dans les premiéres années de son existence
des formations relativement classiques (Lettres, Sciences, Droit et Sciences
Economiques) fortement inspirées du modéle universitaire francais, a été
constamment préoccupée par la professionnalisation : elle a donc élargi son
offre par la création de parcours et d’établissements destinés a asseoir cette
professionnalisation (INSE pour la formation des enseignants, ESSD et IUT-
Gestion pour la formation des Secrétaires de Direction, et les professionnels de
la finance et la comptabilité, ESA, pour les agronomes, etc. , EAM pour
l'assistance aux médecins, etc.)
Malgré ces efforts de professionnalisation et malgré le passage au systeme
LMD, la formation a I’UL garde les méme caractéristiques « les offres de
formation, bien que diversifiées en raison de I’adoption du systeme LMD,
demeurent dans le schéma classique et il y a peu d’offres de formation
professionnelle : celles-ci absorbent aujourd’hui moins de 10 % de la population
estudiantine. » (Conseil Présidentiel sur l'avenir de I’enseignement supérieur au
Togo, 28-30 novembre 2013, p.9)
15
» La qualité de la formation
La réforme a connu des avancées certaines mais elle n’est pas encore
totalement mise en ceuvre dans la mesure oU sur de nombreux points la
qualité de la formation laisse encore a désirer.
Ainsi, la semestrialisation et la capitalisation n'ont pu étre complétement
appliquées. Par conséquent, a cause de l’allongement du temps de correction,
les semestres ont eu des durées variables dans le temps mais aussi d’un
établissement a l'autre
Les efforts faits pour changer le systeme d’évaluation (réduction de la durée
des épreuves a 2 heures, recherche d'une solution pour l'utilisation des QCM a
correction automatique, formation au logiciel AMC pour les QCM, acquisition
de matériel, correction en salle) n’ont pas totalement abouti.
ll faut également noter que l’insuffisance de locaux empéche de répéter les UE
d'un semestre a l'autre, ce qui permettrait a ’étudiant de reprendre
rapidement les UE ou il a échoué et a I'administration de ne pas organiser
d’examens de rattrapage.
Quant a la qualité de l’encadrement, elle s’améliore puisque en 2013, le corps
enseignant de l'UL comportait certes 324 Assistants et Maitres-assistants,
mais 210 Professeurs et Maitres de Conférences. Mais une des exigences de la
réforme, énoncée par ses promoteurs, la nécessité d’« enseigner et évaluer
autrement » reste encore a faire entrer dans les faits par un renforcement des
capacités des enseignants en matiére de pédagogie universitaire, et un
systéme d’évaluation des enseignements et des diverses structures de
formation.
® Les conditions de la formation
Ueffectif des inscrits 4 'UL a constamment progressé entre 2007-2008 et
2011-2012, passant de 31 816 a 47 824 inscrits soit une augmentation de 50%
(Graphique 1). Cette évolution est progressive, on enregistre une
augmentation régulire d’environ 5000 inscrits de plus tous les ans jusqu’en
2011-2012. En 2012-2013, on note une baisse des inscriptions d’environ 8,6%.
Comment expliquer cette baisse? Lorsqu’on analyse les données des
inscriptions, on se rend compte que le nombre des nouveaux inscrits a
progressé de 12% par rapport a l'année précédente. Dans le méme temps, le
16
nombre des réinscriptions a baissé, ce qui signifie de pres 5700 étudiants
réguliérement inscrits en 2011-2012 n’ont pas souhaité renouveler leur
inscription @ UL en 2012-2013, Cette tendance a la baisse est donc Ie fait
d'une désaffection des «anciens » et non d’un manque d’engouement des
«nouveaux», il faudrait alors continuer a analyser I'évolution de cette
tendance dans les années académiques a venir.
Graphique 1 : effectifs d’inscrits (2007-2013)
® Total Inscrits
Source : Rapport Annuel de la Direction des Affaires Académiques et de la Scolarité, 2012-13
La conséquence de la croissance des effectifs est que le taux d’encadrement
était globalement satisfaisant en 2004-2005, n’a cessé de se dégrader
(Graphique 2) passant de 45 étudiants pour un enseignant a 85 en 2010-2011.
Une amélioration semble s’amorcer depuis 2011-2012 mais un ratio de 79
étudiants par enseignant est bien loin des normes internationales.
17
Graphique 2: Evolution du ratio étudiants/1 enseignant (2005-2012)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Source : Calcul @ partir des données de la DAAS, de la DRH et Présidence de I'UL
Dans les conditions de la formation, les locaux constituent un élément
important dans la mesure ou ils conditionnent l’organisation de telle ou telle
stratégie pédagogique. Or, I’augmentation exponentielle des effectifs des
étudiants de I’UL na pas été suivie par I'augmentation des capacités physiques
d'accueil. En effet, de 1999 & 2005, |’UL avait une capacité d’accueil de 10917
places assises, de 11917 de 2006 4 2008 et de 13782 depuis 2009 soit une
augmentation de 26 % alors que les effectifs eux ont connu une augmentation
de 126%. Il est de plus trés important de préciser que ce sont les places en
amphithéatre qui représente la plus grande part de l’augmentation des locaux
(plus de 85% de l’augmentation). Ce qui signifie que ce sont les cours
magistraux pour les grands groupes qui ont été favorisés au détriment des
activités en petits groupes (Travaux Dirigés) et des activités demandant un
équipement spécifique (Travaux Pratiques). En termes de ratio nombre
d’étudiants /pour une place assise, cela signifie que sur 4 étudiants un seul
dispose d’une place assise.
La formation universitaire n’a de sens que si elle donne accés a des ressources
qui lui viennent en appui. Les premiéres ressources sont documentaires. La
bibliothéque centrale de I'UL a un fonds documentaire de 38 880 ouvrages
auxquels s’ajoutent 14662 mémoires et théses, et 94 périodiques
(recensement de 2012). II est sr que pour une population de plus de 47 000
18
eétudiants, et d’un millier d’enseignants permanents et vacataires qui, en
principe, utilisent eux aussi les centres de documentation, ce fonds
documentaire est largement insuffisant. Plus grave que cela, la BU ne dispose
que de 500 places assises dans son local propre et en gére une soixantaine
dans différents établissements.
A 'heure de la généralisation des technologies de l'information et de la
communication (TIC), on peut opposer & l’affirmation précédente que la
recherche en ligne peut compenser le manque d’ouvrages. Or le parc
informatique de toute l’UL comporte seulement 600 ordinateurs : les places en
cyber pour les étudiants n’atteignent pas le nombre de 150 (80 au Centre
Informatique et de Calcul (CIC) et une cinquantaine dans les établissements).
En plus de cela, la connexion, la bande passante etc. constituent aussi des
difficultés 4 gérer. La généralisation du wifi (2011) sur le campus n’a de sens
que si la majorité des étudiants possédent un ordinateur personnel, ce qui
nest gueére le cas.
3. LA RECHERCHE
3.1. La premiére institution de recherche du pays
La recherche, une des missions confiées aux universités, joue un réle
essentiel et fondamental dans le processus de développement social,
économique et culture! d’un pays. Au Togo, les universités, et en premére
place 'UL sont les premiéres institutions de recherche du pays : en 2011,
elles regroupaient a elles seules, 67,5% du personnel de recherche du Togo
(Tableau 1)
19
Tableau 1 : Personnel de la recherche au Togo
Secteurs Type de Personnel 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
- Total | Total | Total | Total
Institutions |Chercheurs so | 6a o7_| 70 70
am [Techniciens 37__| 39 40 [a2 ‘| 42
universitaires | Autre Personnel de soutien | 197 200 205 | 205 194
Total 293 | 303 | 311 317__| 306
Chercheurs 456 | 463 489—«(| 498 519
Institutions {Techniciens 65 89 8D 3 OD
universitaires | Autre Personnel de soutien | 23 | 24 24 25 25
Total | 544 | 576 636
Chercheurs 515 | 527 556 568 | 589
[Techniciens 7 102 | 128 ‘| 129 1s | 134
TOTAL I oe oe Ls
NATIONAL | Autre Personnel de soutien | 220 | 224 229 230 | 219
TOTAL | 837 | 879 913 923 | 942
Source : Direction de la Recherche Scientifique, Etat des lieux de la science, la
technologie et l'innovation au Togo, au en sommes-nous ?, Novembre 2013
UUL, quant @ elle, conformément a ses missions, dispose de puis 1994 d’une
Direction de la Recherche qui s’occupe spécifiquement de ce secteur
d'activités, secteur qui s'est notablement développé ces derniéres avec
plusieurs centaines de chercheurs regroupés en 2013 dans 48 laboratoires,
unités et équipes de recherche. Cette recherche couvre les huit domaines de
formation du REESAO. Son dynamisme est connu hors des frontiéres du pays.
Cest ainsi qu’en 2014, a été reconnu comme centre d’excellence de la Banque
Mondiale, le Centre d’Excellence Régional en Sciences Aviaire (CERSA)
Le dynamisme de la recherche a été a lorigine d’un développement
exceptionnel de la formation a la recherche : 145 théses de doctorat unique et
276 theses d’exercice en médecine et en pharmacie ont été soutenues. Par
ailleurs, la Commission Scientifique et Pédagogique de |’UL (CSP) est 4 pied
d’ceuvre pour mettre en place les écoles doctorales.
Un effort a également été fait pour la diffusion des résultats. Depuis 1989, des
journées scientifiques sont organisées afin de permettre aux chercheurs
20
nationaux et en provenance de la sous-région de présenter leurs résultats de
recherche. Les Presses de 'UL, créées par arrété 06/UB/R/90 du 04 Avril 1990,
demeurent l'instance centrale de publication & Université de Lomé. Elles
éditent et publient les travaux spécialisés, les manuels, les cours et les revues.
La diffusion des résultats se fait aussi 4 travers un certain nombre d’organes de
publication créés par 'UL elle-méme ou par des laboratoires ou unités de
recherche
3.2. Un nécessaire recadrage
Malgré les atouts décrits ci-dessus, le diagnostic fait 4 propos de la recherche
sur l'ensemble du territoire national, lors du Conseil Présidentiel sur l'avenir de
Venseignement supérieur et de la recherche (28-30 novembre 2013),
s‘applique parfaitement a I’UL: « Une recherche absente des grands enjeux de
développement. (...) Elle souffre d’une insuffisance de ressources humaines
qualifiges et d’un manque de moyens matériels et financiers. En effet, le
financement accordé par |’Etat aux institutions de recherche représente moins
de 0,38% du PIB en 2011, alors que les recommandations du Plan d’Action de
Lagos et le document de Politique en Science, Technologie et innovation de la
CEDEAO, adoptés par les Chefs d’Etat et de Gouvernement, font état d’un
montant d’au moins 1% du PIB. Par ailleurs, le financement de I’Etat sert
surtout @ payer les salaires des personnels de recherche. Le nombre de
chercheurs et d’enseignants-chercheurs est trés faible : il représente 8,5 pour
100 000 habitants. » C’est pourquoi les laboratoires sont souvent sous-équipés
et ne peuvent pas développer des programmes ambitieux. La diffusion des
résultats, leur vulgarisation, posent également probléme, alors que Etat ne
valorise pas l’expertise locale, puisque, dans de nombreux domaines, il fait
encore appel 8 des experts étrangers.
Il faut ajouter que jusqu’en 2014, le statut de I'UL n’a pas permis le
développement de prestations de services propres 4 favoriser 'appel a
expertise de l'institution par le secteur privé.
Cependant, il faut avouer que I’état de la recherche & 'UL provient aussi de
facteurs propres a l’institution elle-méme. Ainsi, les activités de recherche tant
individuelles que collectives ne s‘inscrivent pas dans une politique générale de
21
recherche élaborée par institution, du fait que le pays ne dispose pas encore
de politique nationale en matiére de recherche. Et il convient de préciser que,
Vinsuffisance de moyens améne parfois laboratoires et chercheurs a accepter
des themes proposés par des partenaires disposés a financer la recherche, ces
thémes n’étant pas toujours en totale adéquation avec le contexte d’un pays
en développement.
De plus, les enseignants ne sont pas motivés pour faire de la recherche
d’abord 8 cause de leurs conditions de travail (effectifs pléthoriques, surcharge
d’heures d’enseignement et de correction a 'UL mais aussi a l'Université de
Kara(UK)) ; ceux qui effectuent des activités de recherche le font surtout pour
publier des articles dans le cadre de I'avancement de leur carriére, alors que
Vacces aux organes de diffusion des résultats demeure toujours
problématique.
3.3. De nouveaux défis
> Le lien avec le développement
La mission de recherche confiée aux universités, ne prend tout son sens que si
les résultats de cette recherche contribuent au développement du pays. II est
donc nécessaire de réaffirmer le lien des activités de recherche menées a l'UL
avec les options du pays en matiére de développement. C’est 8 ce prix que UL
deviendra un véritable centre de production des savoirs utiles au
développement.
> Le recadrage des activités de recherche
Dans la continuité de ce qui vient d’étre dit, il importe que toute recherche
individuelle ou collective s’inscrive dans un ensemble d’axes fondés sur les
priorités de développement du pays. Ces axes doivent étre regroupés dans des
programmes de recherche élaborés par 'université.
Dans cette perspective, il sera nécessaire d’encourager la formation de
regroupement de chercheurs (dans des laboratoires, centres, unités, équipes,
etc., dont le statut reste a définir) autour de thématiques inscrites dans ces
programmes ; il est entendu que ces groupes peuvent étre nationaux ou
22
multinationaux dans la visée d’une recherche centrée sur intégration
régionale.
» La modernisation des dispositifs de recherche
Pour arriver a un tel résultat, un effort doit évidemment étre fait en vue de la
modernisation des dispositifs de la recherche: il siagit d’équiper les
laboratoires, d’améliorer l'environnement technologique en vue de faciliter la
recherche et la publication en ligne; soutenir les organes de publication,
renforcer les capacités des enseignants dans le domaine de la recherche.
4. LES SERVICES A LA COMMUNAUTE
4.1. V'UL, un partenaire au développement
Pour répondre a la mission de services a la communauté qui lui est confiée,
plusieurs décisions ont été mises en ceuvre a l'Université de Lomé. C’est ainsi
qu’a été créée, par Arrété Ministériel N°014/MESR du 24 aodt 2004, la
Direction des Prestations de Services et des Relations avec le Monde du Travail
(DPSRMT). Il s’agissait pour la nouvelle institution d’assurer une visibilité a
l'Université de Lomé en tant que partenaire au développement, et de faire
valoir partout ol possible, le savoir-faire des différentes institutions et Experts.
Dans cette perspective, l'Université de Lomé a signé des conventions et
accords de partenariat avec des entreprises et sociétés du monde du travail.
Cela a permis, chaque année, de placer des étudiants en stage dans les
entreprises en vue de confranter les connaissances acquises aux réalités
socioprofessionnelles. Cela a également constitué une excellente opportunité
pour certains de ces étudiants des parcours professionnels en sciences,
sciences économiques et de gestion de trouver un emploi. Ce cadre de
partenariat permet également aux entreprises de s'intéresser @ la qualité de la
formation et de s‘impliquer davantage dans la gouvernance universitaire.
La Maison de l’Entrepreneuriat, qui a son siége 4 l'UL, constitue également un
atout dans la valorisation de cette institution comme partenaire au
développement : fruit d’un partenariat avec la Ville de Lomé et la Chambre de
23
Commerce et d’industrie du Togo, elle a été ouverte en mars 2011, avec pour
mission principale de regrouper les établissements d’enseignement supérieur
du Togo et divers partenaires institutionnels dans un réseau national d’acteurs
de la création d’entreprises et d’emplois.
4.2. La nécessité de renforcer l’engagement pour le
développement
UUniversité de Lomé ne peut en aucune maniére se soustraire aux grandes
mutations qui caractérisent aujourd'hui l’enseignement supérieur. Elle doit
donc opérer des changements structurels pour jouer pleinement son réle
d'interface et promouvoir le développement socioéconomique. La culture de
Vexcellence non seulement comme soubassement de la réussite mais encore
comme une réponse adaptée aux enjeux actuels du développement se révéle
pour elle un nécessité. Aussi doit-elle impérativement tenir compte des
besoins pratiques et intéréts stratégiques du monde socioprofessionnel, qui de
tout temps est le consommateur du savoir et des produits générés par
Vuniversité. Elle est donc appelée a s’ouvrir plus et @ nouer avec son
environnement des liens plus forts : c’est a ce prix que la professionnalisation
des formations, qui est un des piliers de la modernisation en cours depuis
2005, deviendra réalité.
Cela suppose que tous les acteurs participent a cette ouverture en
concertation avec la DPSRMT. Ainsi en plus des résultats de la recherche
constituant un corpus de savoirs sur le développement, en plus de la formation
de penseurs et d’acteurs du développement, I’UL pourra prendre des
initiatives originales dans le domaine économique. Pour ce faire, elle avait
besoin d’un cadre juridique qui lui a été donné en 2014: la loi n°2014-002 du
9 avril 2014 (portant modification de la loi n°97-14 de septembre 1997,
modifiée par la loi n° 2000-02 du 11 janvier 2000 portant statuts des
universités publiques du Togo) fait de l'Université, un véritable acteur engage
auprés du monde socioéconomique pour le développement.
24
4.3. De nouveaux dé
> Wélargissement des partenariats
UUL est appelée 4 adopter une attitude consistant 4 tenir compte des besoins
et intéréts stratégiques du monde socioprofessionnel : dans sa démarche de
professionnalisation des parcours elle doit amener les partenaires a
s‘impliquer dans la formation tant des étudiants que des autres acteurs du
monde universitaire. Par ailleurs |'UL peut participer au renforcement de
capacités des professionnels des entreprises, et de facon plus générale,
contribuer & la mise en place d’activités citoyennes (mise a disposition des
communautés de l'expertise universitaire de maniére bénévole)
> La visibilité de l’expertise
II s’agit pour I'UL de donner réalité aux dispositions de la loi n°2014-002. Cela
signifie, se doter d'outils performants (plate-forme d’incubateurs, structures
dédiges a l'innovation de l'entrepreneuriat universitaire, ...) permettant de se
valoriser sur les marchés d’appels d’offres et ainsi de se donner une meilleure
visibilité.
5. QUESTIONS DE GOUVERNANCE
5.1. Des structures adaptées aux besoins nouveaux
Pour assurer le processus de réforme, des modifications ont été apportées
dans l’administration de |’Université de Lomé : en 2004, une Commission LMD-
UL, composée de représentants des établissements et de certaines directions,
est chargée de la conception des divers aspects de la réforme ; a sa suite sont
créés des Commissions LMD dans les établissements. En 2005, est créée la
Direction des Ressources Pédagogiques et de I’Innovation qui sera transformée
en Centre des Ressources, de |I’Innovation et de la Qualité Pédagogiques en
2012.
25
Par ailleurs, des postes de responsabilité ont été créés en vue de
Vadministration du systéme: responsables de domaines et de parcours,
responsables et membre de cellules d'information pédagogique.
Pour la gestion des flux d’étudiants, un outil a été adopté pour gérer la
formation et qui a permis de délivrer des diplémes LMD, alors que les
modalités d’inscription et de certification se sont adaptées au systéme.
5.2, Nécessité d’un nouveau style de gouvernance
La question des moyens tant humains que matériels explique beaucoup de
difficultés actuelles de l’UL mais la gestion méme de linstitution est également
a questioner. En effet, en tout premier lieu, il convient de mettre l’accent sur
Vextréme politisation de la vie universitaire au Togo. II est vrai que l’université
he peut fonctionner en vase clos et que partout ailleurs la vie politique a un
impact sur la vie dans les institutions de formation. Mais la spécificité 4u Togo,
Cest la traduction de tout probleme en question politique et surtout
I'habitude de donner des réponses politiques 4 des problémes techniques,
comme celui de I’évaluation des étudiants par exemple. Cela a d’importantes
répercussions sur le fonctionnement administratif mais aussi sur les activités
pédagogiques. Pour ce qui concerne la réforme LMD, nous n’évoquerons que
le questionnement suivant. II concerne le fonctionnement administratif et se
résume ainsi : quel mode de régulation est en vigueur, de maniére a faciliter le
pilotage de la réforme ?
Cette question s’explique par le fait qu’on note une certaine intrusion
d’éléments de nature autre qu’administrative dans les rapports. Ces éléments
sont d’abord a connotation « politique », dans la mesure ou la position de tel
ou tel par rapport au pouvoir en place, lui donne plus ou moins
d’ « autonomie » par rapport au centre universitaire de prise de décision que
constitue la Présidence, c’est-a-dire plus ou moins de facilité pour appliquer ou
non les décisions de cette derniére. La hiérarchie administrative cohabite donc
avec des rapports de force qui sont de nature extra universitaire.
Cette hiérarchie administrative cohabite aussi avec les hiérarchies de source
universitaire, du moins telles qu’on se les représente : ainsi les grades donnant
un rang magistral semblent vécus comme la possibilité d’avoir plus de pouvoir
administratif et non pas, plus d’expertise scientifique. Cette appréciation
26
provient du constat suivant : souvent, arrivé au rang magistral on se plaint de
la non reconnaissance manifestée par le fait qu'on n’a pas un poste de
responsabilité administrative, plus que de la difficulté 4 obtenir des fonds pour
monter un laboratoire ou une équipe de recherche.
La conséquence de cette situation est que I’action de la présidence ne peut pas
se fonder sur la légitimité mais sur ses capacités et habiletés bien définir les
processus de régulation et a piloter. L'effet de ces efforts est souvent annihilé
par la perception que les doyens et directeurs ont de leur rdle: dans une
culture ou l'autocratie est de régle, le doyen, le directeur, décide de tout.
Face & un doyen d’un tel type quelle peut étre la légitimité du chef de
département ? Est-elle en liaison avec ses bons rapports avec le doyen, son
expertise scientifique, son grade, ses compétences managériales, ses relations
avec les autres enseignants ?
Le personnel administratif, quant a lui, a vécu le temps de la réforme comme
une remise en question de la routine, sans qu'on n’en voie vraiment la
nécessité, une simple surcharge de travail. Le degré de cette impression d’étre
«hors du coup» dépend généralement du style managérial de la direction de
I’établissement qui associe plus ou moins le personnel administratif au pilotage
local de la réforme.
En tous les cas, d'une maniére générale, la communication interne pose
probleme :
- & cause d’un environnement technologique inadéquat, l'information
circule difficilement puisqu’elle emprunte prioritairement la voie du
document imprimé a diffuser en se déplacant ;
- les liens organiques entre les différentes structures soit ne sont pas
visibles, soit ne sont pas opérationnels dans la mesure ou ces
structures ont été créées |’une aprés l'autre selon les besoins sans que
l'université ne se soit dotée d’une approche spécifique en matiére de
gouvernance.
Bref, il semble bien que la réforme ait posé probleme parce qu’on a voulu la
faire coexister avec des pratiques qui annulaient |’efficacité qu'on pouvait
attendre d’elle. Il y a donc eu des difficultés dans le fonctionnement des
structures et la gouvernance de l'université.
aT
5.3. De nouveaux défis
» Larationalisation du fonctionnement administratif
ll est urgent d’établir des liens organiques entre nouvelles et anciennes
structures, et donc de procéder 4 une refondation des structures. C’est ainsi
qu'une véritable culture de I’évaluation pourra étre instaurée a I'UL.
» Le renforcement des capacités des acteurs
Il ne semble pas possible de mettre en place ce type de culture sans que les
différents acteurs y adhérent et y croient : il est par conséquent indispensable
de former et recycler les différents acteurs en matiére de gouvernance.
» La modernisation du fonctionnement administratif :
A terme, il s/agira d’instaurer une e-gouvernance, améliorer la communication
interne
28
CONCLUSION
Apres ce descriptif, on peut dire de I'UL que c’est une université en pleine
évolution, qui manifeste un dynamisme remarquable dans les efforts
accomplis en vue de s'adapter aux exigences mondiales en matiére de
formation universitaire. £n matiére de recherche, malgré des efforts
individuels et collectifs, UL ne joue pas pleinement son réle de production de
savoirs aptes a contribuer au développement.
UUL doit, d’une maniare générale, se départir de certaines lourdeurs héritées
du passé dans son fonctionnement et s’ouvrir plus sur son environnement
sociogconomique ; mais elle doit aussi se doter de moyens adéquats pour
faire face avec bonheur a ces exigences. La gageure est d’arriver accomplir
cette mutation en cing années, cinq années qui sont donc d’une importance
axiale et qui demandent a étre correctement et soigneusement préparées si
l'on veut qu’elles aménent I'UL & devenir une institution moderne
d’enseignement supérieur.
29
DEUXIEME PARTIE
LES AXES DE DEVELOPPEMENT
VISION
Etre et rester une des premiéres universités
de la sous-région ouest-africaine
SiV’UL tient rester une des premiéres universités de la sous-région ouest-
africaine, son avenir doit reposer sur deux idées-forces :
> instaurer la culture de la réussite
» rechercher excellence pour mieux contribuer au
développement.
En effet, une université compétitive tant au plan national qu’international, se
préoccupe en tout premier lieu de la qualité de la formation qu’elle donne.
Cela invite a se centrer sur I'apprenant, et de facon plus large, sur tous ceux
qui doivent bénéficier de la formation les étudiants, les milieux professionnels,
les communautés urbaines et rurales, le pays et méme au-dela, dans le
contexte de la construction d’espaces régionaux.
Cela signifie qu’elle apporte un soin tout particulier 8 la qualité de la
formation. Cette qualité, si elle est réelle, ne saurait étre réservée a une
minorité : UL se doit de ne pas accepter de produire des « laissés-pour-
compte » de la formation. || s’agit en effet, dans le contexte de massification
qu’elle connait, d’éviter a la fois le nivellement par le bas, en permettant aux
meilleurs d’aller le plus loin possible, dans des parcours de haut niveau, mais
aussi d’offrir 4 tous une chance de tirer parti de la formation universitaire : en
plus des parcours classiques, elle mettra l’accent sur des activités de soutien et
de mise 4 niveau. Il s’agit donc d’instaurer et de maintenir la culture de la
réussite.
Cependant, ce choix ne sera réalisable que dans la recherche constante de
perfectionnement car I’'UL devra étre exigeante envers elle-méme pour
maintenir un certain niveau de qualité dans la formation ; elle devra accepter
de se remettre souvent en question, de changer d’avis et pour cela de vivre
dans la culture de |’évaluation et de la reddition de compte.
33
‘A Vhorizon 2020, le principal résultat que lon doit attendre de I'UL, est que
pour elle le systéme LMD ne constitue plus une innovation. Louverture au
monde socioprofessionnel deviendra une réalité et une tension constante.
La contribution de la recherche au développement sera effective dans les
programmes que développeront les diverses unités de recherche ; elle sera
rendues visible dans des actions de diffusion et de vulgarisation des résultats
de recherche.
Pour que ces buts soient atteints, il faudra qu’au cours des cing années de
2015 3 2020, I’UL se soit dotée d’un systéme de gouvernance moderne.
Finalement, cela implique, si on prend I’université comme un outil au service
du développement, une certaine conception du développement ; il ne s’agit
pas de se fixer un modéle correspondant a un état statique de la société mais
de vivre en tension constante vers une société qui recherche le mieux vivre de
ses membres, la mission de l'université étant de rappeler ce choix et d’ouvrir
des pistes pour sa réalisation
Ainsi, "UL sera devenue une université qui compte au plan national et
régional, une université moderne proposant une formation dont le standard
sera comparable & celui des universités africaines les mieux cotées.
34
>
OBJECTIFS
Faire de |’Université de Lomé une université
moderne, compétitive dans la sous-région
Objectifs spécifiques
Se doter d’un systéme et d’outils modernes de gouvernance
Adapter l’offre de formation aux exigences des standards internationaux et
du marché de l’emploi local et régional
Améliorer la qualité de la formation
Renforcer les liens entre l’université et son environnement
Développer des axes de recherche en rapport avec les besoins du pays et
de la sous-région
Valoriser les compétences de |’université
LES AXES DE DEVELOPPEMENT (2015-2020)
A’horizon 2020, le principal résultat que lon doit attendre de I’UL, est que
pour elle le systéme LMD ne constitue plus une innovation. Cette formation
ouverte sur l'environnement socioéconomique aidera les apprenants a batir
un projet professionnel a mettre en ceuvre au sortir de |’institution
universitaire. Pour cela l’ouverture au monde socioprofessionnel deviendra
une réalité et une tension constante. Au plan de la recherche, sa
contribution au développement sera effective dans les programmes que
développeront les diverses unités de recherche ; elle sera rendues visible
dans des actions de diffusion et de vulgarisation des résultats de recherche.
Pour que ces buts soient atteints, il faudra qu’au cours des cing années de
2015 a 2020, I'UL se soit dotée d’un systéme de gouvernance moderne.
Ainsi, 'UL sera devenue une université qui compte au plan national et
35
régional, une université moderne proposant une formation dont le standard
sera comparable & celui des universités africaines les mieux cotées.
Pour aller vers ce type d’université en cing années, I’UL doit mener des
actions dans plusieurs directions
6.1. Instauration d’une logique moderne de gouvernance
universitaire et renforcement des capacités des différentes
catégories de personnel
Il est clair que le changement de profil de 'UL ne peut advenir que s’il
est mené par des personnes qui y croient mais aussi qui sont capables
d’emporter I'adhésion des différents acteurs dans et hors de
Vuniversité. L'adhésion doit étre maintenue tout au long du processus
de changement: cela signifie une gestion caractérisée par la
transparence et la vérité mais aussi l’existence d’opportunités de
contréle par différents acteurs dans une logique de redevabilité
Dans ce sens-la, il ne s‘agit pas seulement de confier la gestion de 'UL
& des dirigeants élus par leurs pairs mais que ces dirigeants aient
comme priorité de moderniser [institution dans un climat de
responsabilité individuelle mais aussi collective, donc dans un désir
construire un véritable le vivre ensemble. Ainsi, des orientations
concrétes sont a prendre. II s’agit :
> en guise de préalable, de considérer toute
personne, concernée de prés ou de loin par la
formation universitaire, comme partie prenante
des nouvelles orientations décrites dans ce
document ;
de prendre les mesures pour que tout responsable
administratif soit reconnu par ses pairs et ses
subordonnés (représentativité, profil de
compétences) ;
> de travailler 4 ce que V'action de tout responsable
soit cadrée dans les différentes options et dans le
temps a ’aide d’outils appropriés
v
36
» de tout mettre en ceuvre pour que tous acceptent
de faire communauté en refusant 'exclusion de
certains sur la base de leur appartenance ethnique,
raciale, religieuse ou sexuelle.
Pour réaliser les orientations précédentes, il ne suffira pas de la bonne
volonté des uns et des autres, ni méme d’actions d'information et de
sensibilisation — indispensables par ailleurs pour optimiser la
communication - ; il faudra donner aux responsables administratifs et
@ leurs subordonnés les compétences adéquates pour s’adapter au
nouveau style de gouvernance qui sera adopté. Cela fait d’ailleurs
partie de ce style que de donner I'opportunité aux administratifs de se
former et se recycler tout au long de leur carriére et surtout de ne pas
considérer qu’un grade universitaire confére automatiquement des
compétences administratives.
Il faudra également revoir le syst8me de gouvernance et passer
progressivement & I’e-gouvernance. Parler d’e-gouvernance a I’UL,
c'est revenir sur le terme méme de gouvernance qui désigne la
capacité d’une organisation a controler et réguler son propre
fonctionnement. la gouvernance électronique (e-gouvernance)
renvoie elle, aux moyens de gestion et de régulation d’une
organisation reposant essentiellement su ’informatique et Internet.
Il faut dire que des dispositions en ce sens sont déja effectives a I’UL.
En plus d’un site web d'information, les inscriptions se font désormais
en ligne, les différentes facultés et directions sont connectées et
Vinformatique est présente dans tous les bureaux.
Cependant, pour que la gouvernance électronique soit une réalité
efficace, il faudrait commencer par la rédaction d’un projet de systéme
d'information prenant en compte tous les aspects de la gestion
administrative et pédagogique de l'université. Ce projet doit dire
répondre aux questions de la mutualisation des informations en vue
d'une bonne gouvernance : quelles sont les informations qui seront
partagées ? Par qui? Comment et ou seront stockées les données ?
Autant d’éléments dont devront tenir compte les organes qui se
chargeront de mettre en place le systéme d'information de I’UL.
af
6.2. Modernisation de l’offre et du systéme de formation
Cest dans ce cadre que l'on pourra développer un systeme de
formation moderne. II s’agit de permettre aux apprenants d’étudier
dans un cadre stimulant et proposant divers types de ressources
documents imprimés et en lignes, enseignements présentiels et a
distance, formations a la carte et sur mesure, diplomates ou non, etc.
Uoffre sera donc suffisamment diversifiée pour que chacun y trouve
son compte: les divers profils d’apprenants, ceux qui désirent une
formation professionnelle de courte durée comme ceux qui s’orientent
vers des études plus longues, les salariés désirant ure formation en
cours d’emploi comme ceux qui cherchent a se recycler au terme
d’une plus ou moins longue période de travail
Cela signifie une plus grande ouverture au monde professionnel et
économique dans la mesure oi les divers profils décrits ci-dessus,
arrivant ou non avec un projet professionnel a luniversité, celle-ci
doit les aider a s’insérer professionnellement au terme de leur
formation. La préprofessionnalisation est donc un axe important de
offre et du systéme de formation.
Pour que le systéme de formation garde ces traits, il faut évidemment
veiller sans cesse a sa qualité.
Le récent passage au systéme LMD rend encore plus pressant ce
besoin de gestion de la qualité dans la mesure oii il s’agit de nouvelles
offres et de formats inédits de formation qui doivent faire leurs
preuves. De toutes les facons, d’une fagon générale, il existe de solides
arguments qui vont en faveur d’une politique de gestion de la qualité
dans le contexte actuel de la formation universitaire. En effet, la
raréfaction des ressources alors que les effectifs continuent a croitre
exponentiellement, impose aux responsables de veiller 4 rentabiliser
les investissements tant humains que matériels et financiers en
mettant en place des mécanismes de surveillance de la qualité de la
formation.
38
Il s’agit, bien évidemment de créer au plan national une structure
spécialisée de gestion de la qualité en fonction des exigences
nationales et internationales. Cependant, pour assurer cette tache,
cette structure aura besoin d’informations que ne pourront lui fournir
que les établissements de formation eux-mémes. La gestion de la
qualité au niveau de ces établissements comporte alors des éléments
tels que le suivi pédagogique des enseignants chercheurs, |’évaluation
des formations, éventuellement |’évaluation des enseignants par les
€tudiants, les études de suivi des diplémés pour collecter des
informations sur leur devenir professionnel, etc
Dans cette perspective |'UL doit travailler a améliorer un certain
nombre de ratios qui 2 I’heure actuelle ne vont pas dans le sens de la
qualité. Il s’agit d’abord du taux d’encadrement des étudiants. Celui-ci
était de 79 étudiants pour 1 enseignant en 2011-2012 ayant connu une
légére baisse due a la des effectifs d’inscrits. II importe de rapprocher
ce taux de la norme prévue pour les pays africains (30 étudiants/1
enseignant) et donc de se situer 4 50 étudiants pour 1 enseignant en
2020. Cela signifie un effort pour recruter plus d’enseignant mais aussi
des mesures pour maitriser les flux d’entrée a I’UL.
Le second ratio sur lequel il est urgent d’agir est celui du nombre de
places assises (une place pour environ 4 étudiants en 2012) de facon a
le diviser par deux. Si l'on veut donner un enseignement de qualité, il
faudra donc construire des locaux.
6.3. Renforcement des capacités des enseignants
La mise en ceuvre de l’offre de formation dépend bien évidemment
des enseignants. Pour cela il est indispensable de disposer de
professionnels avec un profil de compétences bien défini :
39
Y un niveau de base académique équivalent au moins au
doctorat dans la discipline ou le champ disciplinaire
d’enseignement
¥ des compétences pédagogiques acquises en début et au
cours de la carriére
Y une progression dans la carrigre permettant la prise en
charge d’étudiants de plus en plus avancés.
Dans un souci de maintien de la qualité de Venseignement, ces
compétences académiques et pédagogiques doivent étre vérifiées &
intervalle régulier.
Il est clair que le schéma ci-dessus décrit, ne peut devenir réalité que
s'il est _mis en place un systéme de formation en pédagogie
universitaire et d’évaluation des enseignants au sein méme de
Vuniversité. Ce systéme travaillerait_ en amont d’une agence
d’assurance qualité externe telle que le CAMES.
Il reste un domaine ou les enseignants ont besoin de voir leurs
capacités renforcées : il s'agit de Ventrepreneuriat. En effet, aucun
d’entre eux ne peut rester en dehors du processus de
professionnalisation : une initiation a l'entrepreneuriat peut les aider a
mieux sinsérer dans ce processus. Mais surtout, |’Université de Lomé
doit de plus en plus compter sur des ressources propres pour
compléter la dotation de I’Etat : des enseignants préts a prendre des
initiatives dans ce sens sont indispensables dans le développement
d’une telle orientation.
6.4, Promotion de programmes de recherche adaptés aux besoins
de développement du pays et de la sous-région
Autant on doit se préoccuper de la formation pédagogique des
enseignants, autant leurs qualités en matiére de recherche doivent
étre développées. Cela se fera dans des laboratoires et équipes de
recherche ol les étudiants avancés s’initieront aux techniques de
40
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Lettre de Motivation 1Document2 pagesLettre de Motivation 1Gott'liebe GOKANo ratings yet
- Wa0059.Document2 pagesWa0059.Gott'liebe GOKANo ratings yet
- Togo Voyage Bordereau A37ms37rzDocument1 pageTogo Voyage Bordereau A37ms37rzGott'liebe GOKANo ratings yet
- Togo Voyage Bordereau A66vu82fbDocument1 pageTogo Voyage Bordereau A66vu82fbGott'liebe GOKANo ratings yet