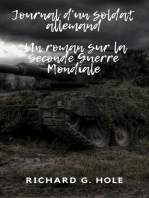Professional Documents
Culture Documents
BB03 Generalite Armement CT1
BB03 Generalite Armement CT1
Uploaded by
Sylvain YaroCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
BB03 Generalite Armement CT1
BB03 Generalite Armement CT1
Uploaded by
Sylvain YaroCopyright:
Available Formats
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
ECOLE SUPERIEURE
ET D’APPLICATION
Identification du document : BB 03 Indice : a
DU MATERIEL
Direction générale de la
formation
------------
DTEAP DOMAINE MAINTENANCE
------------
Cours Armement GENERALITES ARMEMENT
CT1
REMARQUE IMPORTANTE
En aucun cas la documentation de formation ne peut se substituer à la
documentation officielle réalisée par la DCMAT concernant l'utilisation,
l'entretien ou la réparation des matériels.
Diffusable en interne ESAM uniquement :
Diffusable en externe ESAM : X
Rédigé par : Vérifié par : ADC MICHEL Validé par le DGF : COL LEGER
TSEF PLANCHE Date :
Date : 1 Date :
Signature Signature Signature
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
1/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
TABLE DES MATIERES
1. HISTORIQUE : DU BATON A L’ARME A FEU ...........................................................................6
1 Préhistoire et histoire..................................................................................................................................... 6
2 Poudres et explosifs....................................................................................................................................... 6
3 Amorçage ...................................................................................................................................................... 7
4 Principe des armes à feu................................................................................................................................ 7
2. GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................8
1 Désignation.................................................................................................................................................... 8
2 Classification................................................................................................................................................. 8
3 Organisation générale d’une arme............................................................................................................... 11
3. LE CANON .....................................................................................................................................12
1 Introduction ................................................................................................................................................. 12
2 La chambre.................................................................................................................................................. 13
3 La partie rayée............................................................................................................................................. 14
4 Les canons lisses ......................................................................................................................................... 16
5 Usures des canons ....................................................................................................................................... 16
4. SYSTEMEs DE FERMETURE.......................................................................................................17
1 Conditions à remplir par le système de fermeture....................................................................................... 17
2 Système de fermeture .................................................................................................................................. 17
3 Culasse calée ............................................................................................................................................... 17
4 Culasse non calée ........................................................................................................................................ 21
5 Culasse particulière ..................................................................................................................................... 21
6 La feuillure .................................................................................................................................................. 22
7 Profondeur de chambre ............................................................................................................................... 22
5. SYSTEMES MOTEUR ...................................................................................................................23
1 Action directe des gaz ................................................................................................................................. 23
2 Action indirecte des gaz .............................................................................................................................. 25
3 Course de garde........................................................................................................................................... 26
4 Organes complémentaires des systèmes moteurs........................................................................................ 26
6. SYSTÈMES DE MISE DE FEU .....................................................................................................28
1 Les amorces................................................................................................................................................. 28
2 Mécanisme de percussion............................................................................................................................ 28
3 Mécanismes de détente................................................................................................................................ 31
4 Les sécurités ................................................................................................................................................ 35
5 Les sûretés ................................................................................................................................................... 37
7. SYSTEMES D’ALIMENTATION..................................................................................................40
1 Opérations à effectuer pour assurer le chargement ..................................................................................... 40
2 Opérations à effectuer pour assurer l’évacuation ....................................................................................... 40
3 Classification des magasins......................................................................................................................... 43
8. APPAREILS DE POINTAGE .........................................................................................................46
1 Pointage direct............................................................................................................................................. 46
2 Tir indirect................................................................................................................................................... 46
3 La ligne de lire............................................................................................................................................. 47
4 Dispositifs de hausse en pointage direct...................................................................................................... 49
5 Dispositif de pointage en tir indirect ........................................................................................................... 49
6 Précision et réglage de l’appareil de pointage............................................................................................. 50
7 Protection contre les chocs .......................................................................................................................... 50
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
2/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
9. SYSTEMES ACCESSOIRES A LA PUISSANCE DE FEU ......................................................... 52
1 Les accessoires à la puissance de feu.......................................................................................................... 52
2 Le refroidissement....................................................................................................................................... 52
3 La cadence................................................................................................................................................... 52
4 Facilités d’approvisionnement .................................................................................................................... 53
5 Les réductions des réactions dues au tir ...................................................................................................... 53
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
3/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
INDEX DES MISES A JOUR
Numéro Date de Evolution Indice du
des pages mise à jour document
10 2006 Création du document à partir du document de a
base B 101
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
4/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES
Sigles ou abréviations Désignation du sigle ou de l'abréviation
AA NF1 Arme Automatique NATO (OTAN) modèle F1
Cal Calibre
CN 20 F2 Canon de 20mm modèle F2
FAMAS Fusil d'Assaut de la Manufacture d'Armes de St Etienne
FM 24-29 Fusil Mitrailleur modèle 1924 modifié 1929
FR 12,7 Fusil à Répétition de calibre 12,7 mm
FR F2 Fusil à Répétition modèle F2
FSA 49-56 Fusil Semi-Automatique modèle 1949 modifié 1956
HK Heckler & Koch
LAI Levier Amplificateur d'Inertie
LGI F1 Lance Grenade Individuel modèle F1
LRAC 89 F1 Lance Roquette Antichar de 89 mm modèle F1
MINIMI Mini-mitrailleuse
MIT 50 Mitrailleuse calibre 50 (50/100ème de pouces)
mm millimètre
PA MAS G1 Pistolet Automatique de la Manufacture d'Armes de St Etienne modèle G1
PM MAT 49 Pistolet Mitrailleur de la Manufacture d'Armes de Tulle modèle 1949
Vo Vitesse initiale
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
5/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
1. HISTORIQUE : DU BATON A L’ARME A FEU
1 Préhistoire et histoire
D’abord pour survivre et se défendre, l’homme a eu besoin dès la préhistoire, d’utiliser des armes
afin de compenser ses attributs. Sans griffes ni crocs, ces moyens rudimentaires comme le furent
sans doute les bâtons et les pierres, lui permirent de pallier cet état de fait. Cependant, la limite de
leur utilisation était la force humaine nécessaire à leur propulsion.
Une étape fut franchit avec la propulsion et l’utilisation de la fronde et de l’arc. Ces dernières
permirent d’augmenter non seulement la portée, mais également la précision et la force d’impacte.
Plus tard, des systèmes mécaniques augmentèrent encore la puissance avec l’apparition des
arbalètes.
C’est au cours du début du XIVème siècle en Europe, que la révolution dans le domaine de la
propulsion a lieu avec l’apparition de la poudre noire…
La poudre noire est un mélange de salpêtre, de soufre et de charbon de bois, qui fut inventée par les
Chinois avant le XIIIème siècle, servant au lancement et à l’amorçage des feux d’artifice.
En Europe, c’est au cours de la bataille de Crécy qui en 1346 oppose Anglais et Français,
qu’apparaissent les premières armes à feu. La poudre noire est utilisée par les Anglais afin de servir
d’agent balistique (propulseur) pour lancer des projectiles à l’aide d’une bouche à feu.
Les Armes individuelles utilisant le même procédé n’apparaissent qu’un siècle plus tard, vers le
début du XVème siècle, ce sont les arquebuses.
Ce type d’arme ne cessera d’évoluer avec l’apparition de mécanisme comme la platine à serpentin,
puis à rouet.
Au XVIème siècle, l’invention de la cartouche combustible (poudre propulsive, bourre, et projectile
sont enfermés dans une enveloppe de papier appelée « calepin »), est une amélioration très
importante dans le chargement des armes.
Au XVIIIème siècle, la platine à silex puis au début du XIXème siècle de la platine à amorce sont les
dernières étapes de l’évolution des armes anciennes à chargement simple par la bouche, avant
l’invention du chargement par la culasse. Ces dernières, d’abord à chargement simple, seront
munies de magasins.
C’est à la fin du XIXème siècle que l’utilisation de l’énergie développée par les gaz permettra
l’automatisation des systèmes, donnant naissance aux armes semi-automatiques et automatiques.
2 Poudres et explosifs
Les poudres modernes dites « sans fumée » produisent, par inflammation et en un temps très court,
une quantité de gaz à hautes températures. A l’air libre ces poudres se consument à la vitesse de
quelques cm/s. Dans une enceinte qui ne permet pas la libre détente des gaz, la combustion de ces
poudres s’accélère et atteint une vitesse de l’ordre du m/s. On dit que ces poudres déflagrent.
Les poudres ne sont pas des explosifs. Ces derniers se décomposent en éléments gazeux en un
temps pratiquement nul. On dit que les explosifs détonent. La vitesse de propagation de la
détonation est de l’ordre de plusieurs km/s.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
6/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
3 Amorçage
Les poudres peuvent être allumées avec une simple flamme. Dans les armes de petit calibre, on
utilise généralement un amorçage fait avec une très petite quantité d’explosif sensible au choc.
4 Principe des armes à feu
La poudre fournie une puissance considérable mais indisciplinée car sa force expansive agit dans
toutes les directions.
Pour lancer un projectile sur un but défini, la poudre doit être utilisée dans une machine spéciale qui
se compose essentiellement d’un tube, fermé à une extrémité, dans lequel sont introduits la poudre
et un projectile adapté à son calibre.
Les parois du tube doivent être suffisamment résistantes pour ne pas céder à la pression des gaz due
à la combustion de la poudre.
Ces gaz agissent sur le projectile comme un piston qui cède à la pression et parcourt le tube à une
vitesse croissante.
En général le projectile, la charge et l’amorce sont réunis dans un étui métallique. L’ensemble
s’appelle : la CARTOUCHE.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
7/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
2. GÉNÉRALITÉS
1 Désignation
Les armes se désignent par :
- Leur genre, ex : fusil, mortier
- Leur calibre exprimé en millimètres, ex : 7.62 mm
- Leur modèle qui est généralement l’année d’adoption et complétée par l’année de modification.
Ex : modèle 1924 M 29
- Eventuellement un ou plusieurs renseignements complémentaires, ex : RTF1 Rayé Tracté
modèle F1
Nota :
Depuis l’année 1964, la lettre F remplace l’année d’adoption. Cette lettre est suivie du numéro
d’ordre dans le genre, ex : FR F2. La lettre G est utilisée pour les armes destinées à
l’exportation (ex : FAMAS G2).
2 Classification
Les armes sont classifiées en fonction de:
• Leur destination au combat
• L’énergie de leur système moteur
• La manière dont s’effectue le mode de tir et de chargement.
2.1 En fonction de leur destination au combat :
2.1.1 Les armes de poing
A tir tendu, légères, servies d’une seule main sans qu’il soit nécessaire d’épauler.
Ex : Les pistolets et revolvers.
2.1.2 Les armes d’épaule
A tir tendu, légères, à crosse, servies par un seul homme, mais qui doit utiliser ses deux mains
et généralement épauler.
Ex : les pistolets mitrailleurs, les carabines, les fusils à répétition et semi-automatiques, fusil
d’assaut.
Dans un cadre général, toutes les armes individuelles munies d’une épaulière.
2.1.3 Les armes collectives légères
A tir tendu, demande plusieurs servants pour leur mise en œuvre. Elles tirent une munition de
fusil. On distingue deux catégories :
Les fusils mitrailleurs :
Munis d’une crosse et d’un bipied
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
8/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
Les mitrailleuses légères :
Généralement munies d’un affût léger ou montées sur tourelleaux.
2.1.4 Armes collectives lourdes
A tir tendu, n’exécutent en principe que le tir continu et sont munies d’un support plus lourd
nécessitant plusieurs servants pour sa mise en œuvre et son service. Elles peuvent tirer soit la
munition du fusil , soit une munition plus importante.
2.1.5 Armes à tir courbe
Ce sont les armes tirant sous grand angle, mortiers et lance grenades. Ex : mortier 120 RT F1,
LGI F1.
2.1.6 Les armes antichars
Ce sont les lance-roquettes antichars comme le LRAC de 89 mm modèle F1
2.1.7 Les armes blanches
Pour information.
Classifiées en tant qu’armes suivant la législation en vigueur, elles se répartissent suivant 3
groupes :
• Perforante : il s’agit principalement des baïonnettes pour les armes modernes et des dagues.
• Contendante : à l’origine se sont les masses d’arme, mais également les matraques
commandos.
• Tranchante : Sabres F1.
2.2 En fonction de l’énergie de leur système moteur
2.2.1 Arme non automatique :
Arme dont toute les opérations du cycle de fonctionnement sont effectuées, directement ou
non par la force musculaire du servant.
2.2.2 Arme semi-automatique
Arme dans laquelle l’énergie développée par les gaz est utilisée pour assurer la presque
totalité des opérations du cycle de fonctionnement, le servant n’intervient que pour réaliser le
départ du coup suivant.
2.2.3 Arme automatique :
Arme dont toutes les opérations du cycle de fonctionnement sont assurées par l’énergie
développée par les gaz y compris le départ du coup suivant.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
9/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
2.3 La manière dont s’effectue le chargement et le mode de tir
2.3.1 Arme non automatique
A chargement simple par la bouche :
Arme qui ne possède pas de magasin et dont le chargement se fait à la main par la bouche.
C’est le cas des mortiers, et des armes anciennes à poudre noire
A chargement simple par l’arrière ou la chambre :
C’est le cas des lances roquettes antichars.
A répétition :
Arme dont le chargement s’effectue à partir d’un magasin fixe ou mobile: Ex: Fusil 7.62 mm
modèle F2 (FRF2).
2.3.2 Arme semi-automatique :
Arme dont le chargement s’effectue à partir d’un magasin, mais dont le cycle de
fonctionnement est interrompu afin de permettre le coup par coup et sur intervention du
servant.
Ex : fusil semi- automatique de 7.5 mm modèle 49/56.
2.3.3 Arme automatique :
Arme dont le fonctionnement est effectué automatiquement, à partir d’un magasin.
Suivant la façon dont est organisé le système d’interruption du cycle de fonctionnement, cette
arme est dite :
A tir continu :
Lorsque le fonctionnement n’est interrompu que par un acte volontaire du tireur, par le
relâchement de la détente ou par épuisement du magasin. Ex: AANF1.
A tir mixte :
Lorsque le système d’interruption du fonctionnement est organisé de façon à permettre le
choix avant le tir, des deux modes de tir suivants : coup par coup et tir continu (rafale
illimitée). Ex : MIT 50 M2HB.
Le FAMAS 5.56 mm modèle F1 dispose en plus du sélecteur mode de tir, un sélecteur de
rafales lui permettant de tirer des rafales illimitées ou limitées à 3 cartouches.
Nota :
Ces armes peuvent être complétées par "à chargement multiple", lorsque ces dernières sont
organisées de façon à pouvoir utiliser plusieurs types de magasins. Ex: MINIMI version
PARA (chargeur ou bande)
Remarque :
L’ancienne dénomination « pistolet automatique » constitue une exception qui est maintenue,
bien que l’organisation de ces armes doivent les classer comme armes semi-automatiques.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
10/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
3 Organisation générale d’une arme
A de rares exceptions prêtes, toutes les armes sont composées de différents systèmes et dispositifs,
assurant un rôle bien précis :
- Un dispositif assurant le lancement du projectile;
- Un système moteur;
- Un système de fermeture;
- Un système de mise de feu;
- Un système d'alimentation;
- Un dispositif ou un appareil de pointage;
- Des systèmes accessoires à la puissance de feu.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
11/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
3. LE CANON
1 Introduction
Le canon des armes légères comporte un vide intérieur qui constitue l’âme du canon. Il comprend :
• La chambre qui reçoit et positionne la cartouche,
• La partie rayée ou lisse en avant de la chambre.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
12/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
2 La chambre
La chambre présente les formes générales de la cartouche. Elle reçoit, positionne et encaisse la
pression des gaz au départ du coup, maintenant l'étui dans sa forme originelle.
Elle se compose :
• Du corps de la chambre,
• De la sortie de chambre.
Le corps de la chambre :
La plupart des étuis actuels ont un corps de forme cylindrique ou tronconique.
2.1 La sortie de chambre :
La sortie de chambre se compose :
• Du cône de raccordement (AB),
• Du logement du collet (BC),
• Du cône de forcement (CD).
2.1.1 Cône de raccordement :
Le cône de raccordement sert d’appui antérieur à l’étui.
2.1.2 Logement du collet :
Le logement du collet est destiné à loger le collet.
2.1.3 Cône de forcement :
Le cône de forcement comprend :
- Un premier cône (CE) pour loger la sortie de collet,
- Un tronc de cône effilé (ED) servant de logement à la balle et dans lequel débutent les
rayures,
- Un tronc (CD) qui est appelé cône de forcement parce que la balle doit se loger en force
dans les rayures dès le début de son mouvement.
La chambre des armes utilisant des étuis cylindriques ne comporte plus que le tronc effilé
(ED) : le logement de la balle.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
13/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
2.2 Les cannelures :
Certaines chambres sont cannelées pour éviter le collage de l’étui. Ce procédé est
particulièrement intéressant dans les armes à culasse non calée, dans lesquelles l’étui doit se
déplacer alors que les pressions des gaz sont encore élevées.
Les pressions qui se développent sur les cannelures font que l’étui ne travaille pas pendant le tir,
sauf à la partie arrière portant sur la surface non cannelée de la chambre. Cette partie de l’étui est
plus épaisse et résistante. Le collage, s’il existe, ne se produit que sur une surface très petite, près
du culot si bien que l’extraction de l’étui d’une telle chambre est grandement facilitée.
3 La partie rayée
3.1 Les rayures :
Les rayures sont des rainures inclinées, creusées dans la paroi du canon. Elles ont pour but de
communiquer au projectile un mouvement de rotation autour de son axe, afin d’assurer sa
stabilité au départ du coup et sur sa trajectoire.
Une rayure comporte un fond raccordé par 2 flancs (1 flanc de tir et 1 flanc de chargement) à la
paroi normale de l’âme qui forme entre 2 rayures consécutives une saillie appelée cloison
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
14/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
3.2 Action des rayures :
Au départ du coup, le forcement oblige le projectile à épouser la forme de la section droite de
l’âme. C’est la cloison, séparant les 2 rayures, qui pénètre dans le métal du projectile et y creuse
des sillons. Il se produit à la surface extérieure du projectile des tenons ayant en saillie les
dimensions égales à celles que possèdent, en creux, les rayures.
En raison du mouvement du projectile suivant l’axe du canon, chaque tenon s’appuie fortement,
dans la rayure où il est engagé, contre le flanc qui tend à s’opposer à son déplacement
longitudinal et qui est celui qui n’est pas visible à la bouche.
Ce flanc est appelé flanc de tir. C’est celui qui donne au projectile son mouvement de rotation.
3.3 Caractéristiques des rayures :
3.3.1 Le tracé de la rayure :
Le tracé est par définition le développement d'une arête quelconque de la rayure sur un plan
tangent à l'âme cylindrique du canon.
Le tracé de la rayure est établi de façon à communiquer au projectile la vitesse de rotation qui
lui est nécessaire. Cette vitesse de rotation dépend de la vitesse initiale (Vo du projectile et de
l'inclinaison de la rayure à la bouche ou appelée inclinaison finale de la rayure). Il existe des
rayures à pas constant ou progressif.
• Le pas est dit constant lorsque la distance du
passage d'une rayure sur la même génératrice est
constant. Il se traduit par un tracé en ligne droite.
Tracé
Pas
• Le pas est dit progressif lorsque la distance du
passage d'une rayure sur la même génératrice diminue Tracé
progressivement. Il se traduit par un tracé courbe.
Son but est de donner une vitesse progressive au Pas
projectile dans le canon.
3.3.2 La longueur du pas :
La longueur du pas est représentée par la distance séparant 2 passages successifs d’une rayure
sur la même génératrice. Le pas est exprimé en millimètres.
3.3.3 Le sens de la rotation :
Il est donné par le sens de rotation de la rayure supérieure. Le sens des rayures n’est utile à
connaître que pour corriger la dérivation.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
15/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
3.3.4 Le nombre :
Le nombre de rayures doit être tel que l’ensemble des tenons découpés dans le métal soit
assez résistant pour assurer la rotation du projectile.
3.3.5 Le profil :
Le profil est établi de façon à rendre très difficile le franchissement des rayures.
4 Les canons lisses
Les canons lisses modernes appartiennent:
- Aux armes à tir courbe et aux lance-roquettes. Les projectiles pour ces armes n’étant pas
stabilisés par rotation, seront obligatoirement empennés.
- Aux armes d'épaule tirant des munitions type chasse. Ex Valtro Cal 12 de la marine
5 Usures des canons
5.1 Usures normales :
• Erosion calorifique provoquée
par la détente des gaz.
• Erosion mécanique due aux
frottements des projectiles et
l’action des gaz dans le tube.
• Erosion chimique par la
détérioration des poudres
5.2 Usure accidentelle :
Occasionnées par des problèmes liés
à la munition ou de corps étrangers
dans l’âme du canon au moment du
tir.
5.3 Usures anormales :
Ce sont les détériorations par défaut
ou excès d’entretien qui entraîne des
oxydations, déphosphatation,
gravures souvent dues à l’utilisation d’outils non réglementaires, gonflement résultant de tirs
avec des canons non déshuilés.
Ces usures et détériorations se traduisent par une chute de la vitesse initiale du projectile et une
augmentation de la dispersion
Note sur l'encuivrage :
L'encuivrage est le résultat du dépôt laissé par la ceinture du projectile dans le flanc de tir des
rayures. Cette accumulation augmente avec le nombre des tirs, et peut dans une certaine mesure
freiner le projectile, voire le bloquer. Il existe des vérificateurs d'encuivrage destinés à s'assurer
qu'un canon n'est pas encuivré et apte au tir (ex : MIT 50 M2HB). Un encuivrage excessif
nécessitera un nettoyage spécifique.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
16/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
4. SYSTEMES DE FERMETURE
1 Conditions à remplir par le système de fermeture
Le système de fermeture des armes doit :
• Assurer la robustesse et l’étanchéité de la liaison canon-culasse au moment du départ du coup.
La fermeture effective de l’orifice postérieure du canon est réalisée par la fixité momentanée de
la culasse,
• Permettre, après le départ du coup, et pendant un temps suffisant, le maintien de la culasse en
position de fermeture,
• Autoriser, entre 2 coups consécutifs, toutes les manœuvres de la culasse pour que les opérations
d’alimentation de l’arme puissent s’effectuer correctement.
2 Système de fermeture
La plupart des armes modernes comportent une culasse. Cette dernière peut-être :
2.1 Fixe :
Montée à demeure sur le canon, c’est le cas des armes à tir courbe. Ex mortier de 120 mm RT
F1.
2.2 Mobile :
On distingue 2 catégories de culasses mobiles :
• Les culasses calées
• Les culasses non calées
3 Culasse calée
Une culasse est dite « calée » lorsque celle-ci, étant appliquée sur la face postérieure du canon,
un dispositif quelconque lui interdit tout mouvement suivant l’axe du canon. Ce dispositif
s’appelle verrou.
On distingue deux catégories de verrous :
• A verrou fixe :
La culasse à verrou fixe est animée d’un mouvement de translation suivant l’axe du canon pour
assurer la fermeture et d’un mouvement de rotation pour effectuer le verrouillage.
• A verrou mobile :
Le verrou mobile est indépendant de la culasse, celle-ci est amenée au contact de la tranche
postérieure du canon par un seul mouvement de translation suivant l’axe du canon. Il est
commandé par une pièce de manœuvre (levier, rampe…).
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
17/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
3.1 Culasse calée a verrou fixe :
3.1.1 Culasse à rabattement.
Ex : FR F2 et FR 12,7 (PGM).
3.1.2 Culasse rectiligne système Mannlicher.
Ex : Carabine US
3.1.3 Culasse béquille.
Ex: FSA 49/56
3.1.4 Culasse béquille variante colt.
Ex: PA 9mm Mle 50
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
18/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
3.1.5 Culasse calée rotative.
Ex: AK 47
3.2 Culasse calée a verrou mobile :
3.2.1 A translation ou glissant.
Ex : MIT 50 M2HB.
Culasse Logement du verrou
Verrouillage
Canon
Glissière
Boîte de culasse
Verrou
Came de verrouillage
Déverrouillage
3.2.2 A rotation ou bague verrou. Ex : carabine 5.5 Mauser.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
19/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
3.2.3 A béquilles rigides à étais obliques double. Ex : Canon de 20 mm F2
Culasse
Béquilles
3.2.4 A béquilles rigides à étai oblique simple. Ex : PAMAS G1
Bonhomme de déverrouillage
Rampe de déverrouillage
Glissière
Canon
Verrou
Rampe de verrouillage
Carcasse
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
20/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
4 Culasse non calée
Une arme est dite à culasse non calée dans la position de fermeture lorsque celle-ci est
maintenue appliquée sur la face postérieure du canon par la seule force du ressort
récupérateur.
On trouve :
4.1 Culasse non calée ralentie par sa seule inertie.
Ex : UZI 9mm, PM MAT 49 de 9mm.
4.2 Culasse non calée à masse additionnelle et levier amplificateur
d’inertie ;
Ex : AAN F1, FAMAS 5.56 mm modèle F1.
5 Culasse particulière
Culasse non calée à retard à l'ouverture par galets mobiles. Ex : HK G36, HK MP5
Galets
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
21/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
6 La feuillure
Dans les armes à culasse calée, on appelle feuillure la distance qui sépare le fond de la cuvette
de tir, point d’appui du culot de la cartouche, de la surface d’appui dans la chambre (surface
qui limite le mouvement de l’étui vers l’avant) lorsque le verrouillage est effectué.
La feuillure d’une arme par suite de l’usure des pièces canon culasse verrou, va en augmentant avec
le nombre de coups tirés. Quand la feuillure devient trop grande (nommée couramment « excès de
feuillure »), il y à risque de rupture d’étui.
Les mitrailleuses BROWNING de par leur organisation sont susceptibles de variations de feuillure
à tout moment suivant que le canon est plus ou moins vissé. Il y a donc lieu de régler correctement
la feuillure avant l’exécution des tirs. Un « défaut de feuillure »suite à un canon trop vissé, peut
également engendrer des ruptures d’étui.
7 Profondeur de chambre
Dans les culasses non calées, on appelle profondeur de chambre la distance qui sépare le fond
de la cuvette de tir, point d’appui du culot de la cartouche, de la surface d’appui de l’étui dans
la chambre, lorsque la fermeture est réalisée.
Nota:
La figure ci-dessus représente une profondeur de chambre pour une culasse non calée.
Ex : UZI 9mm.
Cette même figure pourrait représenter une feuillure s'il s'agissait d'une culasse calée.
Ex: PA 9mm Mle50
Notez que cela s'applique également à la figure représentant la feuillure.
NOTA: La feuillure et la profondeur de chambre sont contrôlées à l'aide de vérificateurs
spécifiques pour chaque arme
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
22/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
5. SYSTEMES MOTEUR
Les sources d’énergie actuellement utilisées pour le fonctionnement d’une arme sont :
• Le travail musculaire du tireur (arme non automatique).
• Le travail de la veine gazeuse résultant de la déflagration des poudres (arme semi-automatique
et arme automatique)
Le travail de la veine gazeuse peut agir :
• Soit directement sur la culasse, on parle alors d’une action directe des gaz.
• Soit indirectement par l’intermédiaire d’une pièce de manœuvre, on parle alors d’une action
indirecte des gaz.
Évent Culasse mobile
Tuyauterie
1 Action directe des gaz
1.1 Action directe des gaz sur une culasse non calée :
Seule la culasse recule au départ du coup, l’action des gaz lui est transmise par l’intermédiaire de
l’étui. Ex : AA NF1, FAMAS 5,56 mm modèle F1.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
23/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
1.2 Action directe des gaz sur une culasse non calée particulière:
Culasse non calée à retard à l'ouverture par galets mobiles :
Le canon est fixe et ne recul pas au moment du tir. Les gaz de combustion propulsent la balle
dans le canon et exercent en même temps une pression sur l'étui. L'énergie résultante, qui agit sur
la cuvette de la culasse mobile est transmise en partie à la boîte de culasse (par les rouleaux) et
en partie à la pièce de manœuvre (par la pièce de commande), les angles de la pièce de
commande et de la pièce de verrouillage étant calculés de façon à ce qu'il en résulte un
mouvement de recul retardé de la culasse mobile.
La culasse mobile ferme par conséquent le canon, jusqu'à ce que la balle soit sortie du canon.
Lorsque les rouleaux sont complètement rentrés dans la culasse mobile, l'ensemble mobile peut
continuer son mouvement de recul.
Galets Pièce de manœuvre
Pièce de commande
Pièce de verrouillage Culasse mobile
1.3 Action directe des gaz sur une culasse calée :
Court recul du canon :
La culasse est liée au canon, mais ce dernier est libre par rapport au corps de l’arme. Il y a recul
de l’ensemble canon culasse au départ du coup, et c’est au cours de ce mouvement qu’a lieu le
déverrouillage. Ex : PA 9mm Mle50, MIT 50 M2HB.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
24/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
2 Action indirecte des gaz
L’action indirecte des gaz agit toujours sur des culasses calées. On parle d’emprunt des gaz.
2.1 Emprunt des gaz en un point du canon :
2.1.1 Tuyauterie courte
2.1.2 Tuyauterie longue
2.1.3 A impulsion
2.2 Emprunt des gaz en plusieurs points du canon
Le canon de 20mm F2 fonctionne par une action indirecte des gaz avec un emprunt des gaz en
deux points du canon diamétralement opposés.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
25/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
3 Course de garde
Que ce soit dans le début du mouvement arrière ou à la fin du mouvement avant des parties
mobiles, la culasse étant immobile et verrouillée, la pièce de manœuvre accomplira une
certaine course appelée course de garde.
La course de garde est indispensable :
3.1 Lors du mouvement arrière pour :
• Faire acquérir à l’ensemble mobile une quantité de mouvement indispensable pour assurer
les diverses opérations du cycle de fonctionnement.
• Maintenir le verrouillage jusqu’à ce que les pressions dans le canon soient tombées à une
valeur suffisamment faible pour autoriser l’ouverture.
• Assurer le retrait du percuteur après le départ du coup. Soit directement lorsque le percuteur
est attelé à la pièce de manœuvre.
3.2 Lors du mouvement avant pour :
• Annuler l’effet de rebondissement des organes mobiles en fin de mouvement avant.
• Autoriser la percussion qu'à la fin du verrouillage.
Dans les armes à court recul du canon, c’est la durée du parcours du projectile dans l’âme
du canon.
Dans les armes à emprunt de gaz, c’est la durée du parcours du projectile de l’évent à la
bouche.
4 Organes complémentaires des systèmes moteurs
4.1 La pièce de manœuvre sur les armes utilisant l’action indirecte de la
veine gazeuse
Voir schéma "Action directe des gaz", "Tuyauterie longue" et à "Impulsion
4.2 Les ressorts récupérateurs :
Les ressorts récupérateurs ont pour rôle d’emmagasiner l’énergie du recul de l’ensemble
mobile durant le mouvement arrière en se compressant, afin de le renvoyer vers l’avant en
se décompressant lors du mouvement avant.
Dans une percussion rectiligne, armé culasse ouverte, les ressorts récupérateurs assurent le rôle
de ressort de percussion.
Sa force d'inertie sert à maintenir l'ensemble mobile sur la face postérieure du canon pour les
culasses non calées.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
26/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
4.3 Les accélérateurs de culasse :
Les accélérateurs de culasse sont des
organes de transfert d’énergie du canon à la
culasse.
Ils se trouvent sur les armes lourdes à
capacité de tir élevé et à canon étoffé,
afin de réaliser normalement les
opérations du cycle de fonctionnement.
4.4 Les renforceurs de recul :
Les renforceurs de recul sont adjoints lorsque l’utilisation d’un accélérateur n’est pas suffisant
pour mettre en mouvement l’ensemble canon culasse. Le principe est d’utiliser les gaz en sortie
de bouche afin que ses derniers agissent sur le canon.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
27/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
6. SYSTÈMES DE MISE DE FEU
Un système de mise de feu est composé de :
• Un mécanisme de percussion
• Un mécanisme de détente
• Un dispositif de sécurité
• Un mécanisme de sûreté
1 Les amorces
Les amorces se répartissent en trois catégories:
• A percussion centrale qui sont les plus répandues
• A percussion périphérique (5,5 mm)
• Électrique (roquette antichar)
2 Mécanisme de percussion
2.1 Mode de percussion
Le mode de percussion est déterminé par le mouvement général de la masse percutante. Il existe
3 modes de percussion :
2.1.1 La percussion circulaire :
La masse percutante fonctionne suivant une
rotation.
2.1.2 La percussion rectiligne :
La masse percutante fonctionne suivant une
translation.
2.1.3 Percuteur faisant masse percutante :
Il s’agit d’un percuteur indépendant de la culasse ou de la pièce de manœuvre.
Ex: MIT 50 M2HB
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
28/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
2.2 Mise de feu électrique
L’énergie nécessaire pour la mise de feu de l’amorce électrique est fournie
par une bobine d’induction (LRAC 89 mm modèle F1).
2.3 Composition d'un mécanisme de percussion
Un mécanisme de percussion se compose de trois pièces essentielles :
2.3.1 Un percuteur dont le rôle est de venir écraser l’amorce.
• Le percuteur est dit appuyé lorsque, au moment de la
percussion, il y a toujours contact entre le talon du
percuteur et la masse percutante. Le percuteur a une
longueur plus longue que sa culasse.
• Le percuteur est dit lancé lorsque au moment de la
percussion, il n’y a plus contact entre le talon du
percuteur et la masse percutante. Le percuteur a une
longueur plus courte que sa culasse et dépasse
légèrement de l’arrière de cette dernière. Au moment
de la percussion, la masse percutante est arrêtée par
la culasse et le percuteur continue seul son
mouvement grâce à l’énergie reçue.
• Il existe des percuteurs fixes, portés par la culasse ou
solidaire de celle-ci.
Ex : Mortier.
2.3.2 Une masse percutante dont le rôle est de venir frapper le percuteur :
• Dans une percussion circulaire, c’est le marteau,
• Dans une percussion rectiligne, c’est la masse additionnelle.
• Le percuteur peut être indépendant de la masse percutante ou en faire partie.
• Dans ce cas, pour une percussion circulaire il s’agit d’un chien.(Revolver 1892)
• Pour une percussion rectiligne, le percuteur est dit solidaire de la culasse (PM MAT 49) ou
de la pièce de manœuvre (FM 24-29).
• Il existe également des percuteurs indépendants, faisant masse percutante et constitués
d’une pointe, un corps et un talon qui porte le cran d’armé. Il reçoit directement la poussée
du ressort de percussion qui a son point fixe dans la culasse ou la boite de culasse (MIT 50
M2HB, FR F2)
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
29/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
2.3.3 Un ressort de percussion dont le rôle est de lancer la masse percutante en avant en se
décomprimant.
Rappel :
Dans une percussion rectiligne à armé culasse ouverte, le rôle du ressort de percussion est
assuré par le ressort récupérateur. Ex : AANF1, PM MAT49, MINIMI 5,56 F1
2.4 Retrait du percuteur
La condition essentielle de sécurité après la percussion est d’obtenir le retrait du percuteur. Ceci,
afin d’éviter que la pression exercée par les gaz sur le culot de l’étui vienne perforer l’amorce, si
ce dernier restait en saillie, provoquant la fuite d’une partie des gaz vers l’arrière.
2.4.1 Le percuteur est appuyé :
Le percuteur ne peut être effacé que lorsque la masse percutante recule.
• Ressort de rebondissement :
Ex PA 9mm Mle50
Indicateur de chargement Ressort de rebondissement
Ressort de levier de sûreté et de l'indicateur de
Cuvette de tir chargement
Glissière-culasse Levier de
sûreté
Percuteur
Arrêtoir de culasse
Marteau
• Commande mécanique spéciale :
Percuteur attelé sur la pièce de manœuvre (Canon de 20 mm), levier d’armé (MIT 50 M2HB),
LAI (FAMAS)
2.4.2 Le percuteur est lancé :
Aussitôt après la percussion, le percuteur est
effacé par un ressort de rebondissement ou de
rappel
Ex: PAMAS G1.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
30/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
2.4.3 Le percuteur et la masse percutante sont solidaires :
Le retrait du percuteur ne peut avoir lieu qu’au moment où la masse percutante recule.
Ex: PM MAT 49, UZI 9mm (Percuteur usiné dans la masse de la culasse)
2.5 L'armé de la masse percutante
L’armé est un état durant lequel la masse percutante est accrochée sur une pièce spéciale
nommée gâchette par l’intermédiaire de son cran d’armé, dans une position telle que le ressort de
percussion soit comprimé.
L’armé peut être réalisé à la main sur les pistolets à marteau apparent. En dehors de ce cas l’armé
est toujours mécanique et provoqué par le mouvement général des parties mobiles, soit :
• Par la culasse
• Par la pièce de manœuvre
• Par levier
On distingue également deux sortes d’armé :
• L’armé culasse fermée: La culasse peut être fermée sans entraîner la percussion.
Ex : FAMAS 5,56 mm F1.
• L’armé culasse ouverte: La fermeture de la culasse entraîne la percussion.
Ex : AA NF1
3 Mécanismes de détente
Le mécanisme de détente a pour but d’accrocher et de maintenir en position armé la masse
percutante ou les partie mobiles tant que le tireur ne donne pas l’ordre de feu. Son rôle est
donc de transmettre ce dernier au mécanisme de percussion.
Un mécanisme de détente est composé de 3 éléments essentiels :
- Une détente dont le rôle est de transmettre l’ordre de mise de feu du tireur
- Une gâchette ayant pour rôle de maintenir l’accrochage de la masse percutante
- Un ressort de gâchette qui permet le retour de cette dernière dans la position initiale.
3.1 Mécanisme simple de détente
3.1.1 Mécanismes de détente de type :
• Détente et gâchette.
Ex : MIT 31 ; fusil 36.
• Détente, relais gâchette.
Ex : MIT 50 M2HB
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
31/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
3.1.2 Gâchettes automatiques commandées
• Par un plan incliné:
Ex : MIT 30.
3.2 Mécanismes de détente des armes semi-automatiques
Ces armes doivent avoir un mécanisme qui interrompt le cycle de fonctionnement à chaque
coup : la gâchette doit être libérée à chaque coup pour permettre l’armé alors que le tireur a
toujours une action sur la détente, l’obligeant à relâcher cette dernière pour permettre un nouveau
coup.
3.2.1 Mécanismes à séparateur :
Séparateur commandé par les parties mobiles :
Ex : PA 9mm Mle50.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
32/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
3.2.2 Mécanismes à échappement :
Double échappement :
Détente – gâchette et gâchette
mobile.
Ex : FSA 49-56.
Mentonnet à échappement :
Il s’agit d’une détente sur laquelle est axé un mentonnet.
Ex : FM 24-29.
Echappement de gâchette :
Ex : Carabine M1 et M2
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
33/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
3.3 Mécanismes de détente des armes à tir mixte :
3.3.1 Un seul mécanisme de détente à sélecteur de mode de tir (coup par coup, rafale) à
tringle de liaison, assurant l'échappement de la gâchette commandée pour le mode de tir en
rafales.
Ex : FAMAS 5,56mm F1.
Percuteur
Marteau Tringle de liaison
Sélecteur de
tir
Gâchette automatique
Ressort de (cachée)
percussion et
sa tige guide
Gâchette commandée
Entraîneur de gâchette
commandée Détente
3.3.2 Double mécanisme de détente :
Deux mécanismes indépendants :
• Le premier réalise un armé culasse ouverte
• Le second réalise un armé culasse fermée.
Deux mécanismes de détente avec gâchette commune.
Ex : FM 24-29.
3.4 Mécanismes de détentes particuliers :
3.4.1 Double bossettes. Bossettes
Ex : FR F2
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
34/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
3.4.2 Déclencheur et repos de détente.
Ex : AA NF1
3.4.3 Limiteur de rafale à 3 coups.
Ex : FAMAS 5,56 mm F1.
3.4.4 Contrôleur de rafale :
Ce dispositif se présente sous la forme d’un boîtier et s’introduit aisément dans l’armature de
sous-garde. Son rôle est de limiter la rafale à 3 coups à chaque pression de la détente. L’arme
peut être également équipée d’un contrôleur de rafale spéciale qui limite la rafale à 4 coups.
Ex : Contrôleur de rafale à 3 coups du CAL 5,56 M3 belge.
4 Les sécurités
Dispositif enrayant le système de mise de feu durant la course des parties mobiles agissant à
l’insu du tireur. Leur action cesse dès qu’est assuré la fermeture ou le verrouillage.
4.1 Sécurité à la fermeture ou au verrouillage :
Un système doit constater la fermeture ou le verrouillage pour autoriser la mise de feu ;
4.1.1 Gâchette de sécurité.
Ex : Gâchette automatique du FAMAS
Levier amplificateur d'inertie
Gâchette automatique
Marteau
Commande de gâchette automatique
Poussoir de gâchette avec ressort
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
35/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
4.1.2 Rampe de sécurité.
Ex : rampes hélicoïdale de la culasse du FR F2
4.1.3 Usinage de sécurité.
Ex : En cas de rupture du cran d’armé
du marteau, l’usinage de la face
postérieure de la culasse du PA 9mm
Mle50, permet de retenir le marteau
afin d'éviter la percussion.
4.1.4 Séparateur :
Il désolidarise le contact barrette gâchette durant le mouvement de la glissière sur le PA 9mm
Mle50.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
36/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
4.2 Course de garde :
Course entre la fin du verrouillage et la percussion, en cas de rebondissement de la pièce de
manœuvre, le recul de celle-ci est inférieur à la course de garde.
5 Les sûretés
Mécanisme enrayant le système de mise de feu, quand l’arme est au repos et que celle-ci soit
chargée ou non.
Elles sont mises en œuvre :
- Soit par une action volontaire du tireur, ce sont les sûretés non automatiques.
- Soit par une action involontaire du tireur à la suite de la fin de l’action du doigt sur la
détente, de l’abandon de la poignée, l’enlèvement du magasin etc. ; ce sont les sûretés
automatiques.
5.1 Non automatiques :
Elles ont la forme d’un poussoir ou d’un levier à deux positions (feu et sûreté) ;
5.1.1 Par enrayage du mécanisme de détente
De la gâchette.
Ex : AA NF1 Cran d'armé
Butée de déclencheur
Déclencheur
Cran d'armé de
sécurité
Détente Poussoir de sûreté
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
37/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
De la détente.
Ex : FAMAS 5,56 mm F1
5.1.2 Par interposition entre le percuteur et le masse percutante.
Classiques dans les PA à Levier de sûreté en position feu
marteau apparent.
Levier de sûreté en position sûreté
5.2 Automatiques :
Elles entraînent directement l’immobilisation du mécanisme de mise de feu sous l’action
involontaire du tireur.
5.2.1 Poignée de sûreté (détente et culasse du PM MAT 49)
Poignée de sûreté Culasse
Sûreté de détente
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
38/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
5.2.2 Gâchette de sûreté.
Ex : mortier de 60 CS
5.2.3 Sûreté de chargeur (Barrette du PA 9mm Mle50).
5.3 Sûretés diverses :
• Lancé de percuteur et retrait de celui-ci. Ex : PA MAS G1.
• Rebondissement du marteau et accrochage sur la gâchette. Ex : PA 9mm Mle50.
Nota :
Sécurité électrique :
En électricité on parle toujours de sécurité électrique. L’effacement des sécurités électriques
de la poignée générateur du LRAC de 89 mm est provoqué indirectement par une action du
tireur.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
39/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
7. SYSTEMES D’ALIMENTATION
Alimenter une arme, c’est lui fournir dans des conditions susceptibles d’assurer son
fonctionnement normal, les munitions qu’elle doit tirer, et assurer l’évacuation des résidus de
tir (étuis).
En général, l’alimentation comporte :
• La manutention des munitions en vue d’assurer le chargement de l’arme. C’est à dire, la mise
en place successive dans la chambre du canon de chacune des cartouches à tirer.
• L’évacuation de l’étui de chaque cartouche tirée de manière à permettre la mise en place d’une
nouvelle cartouche.
1 Opérations à effectuer pour assurer le chargement
Le chargement des armes à répétition ou à tir continu nécessite les opérations suivantes :
- L’emmagasinage ou garnissage qui consiste à remplir à la main ou à la machine le
« magasin » contenant les cartouches,
- L’approvisionnement qui consiste à monter à la main un magasin amovible sur l’arme. Si le
magasin fait partie intégrante de l’arme, approvisionnement et emmagasinage sont confondus,
- Le transport qui assure le déplacement des cartouches à l’intérieur du magasin ou le
déplacement total du magasin quand celui-ci est mobile,
- La distribution dont le but est de régler le transport de manière qu’une seule cartouche à la fois
puisse être présentée,
- La présentation qui place la cartouche à utiliser dans une position telle que les parties mobiles
puissent la saisir pour l’introduction,
- L’introduction qui consiste à faire passer la cartouche présentée dans la chambre de l’arme.
Le transport et ses compléments : la distribution et la présentation, sont assurées dans les armes à
répétition et les armes à tir continu soit :
- Par le moteur principal de l’arme,
- Par un moteur auxiliaire (ressort).
Parmi l’ensemble de ces opérations, seule l’introduction est obligatoirement provoquée par le
moteur principal de l’arme.
Suivant le type de magasin utilisé, l’introduction est :
- Directe, ou Indirecte.
- Introduction directe : la culasse ou le doigt introducteur pousse directement dans la chambre
la cartouche qui est en position de présentation.
- Introduction indirecte : la culasse doit d’abord entraîner la cartouche vers l’arrière pour la
ramener ensuite en avant dans la chambre, après un changement de plan intermédiaire.
2 Opérations à effectuer pour assurer l’évacuation
2.1 L’extraction
L’extraction est l’opération qui consiste à retirer l’étui hors de la chambre.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
40/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
2.1.1 Classification des extracteurs :
A action normale
• Lame ressort à griffe.
Ex : FR F2
• Extracteur axé et poussé par ressort.
Ex : PA 9mm Mle50
• Extracteur à translation ;
Ex : AA NF1
A action forcée
• L'extracteur BERDAN
• L'extracteur ENT
A rainures de culasse
Rainure simple Rainure double
(MIT 50 M2 HB)
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
41/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
2.2 L’éjection
L’éjection est l’opération qui consiste à évacuer l’étui extrait hors de la boite de culasse.
Classification des éjecteurs:
2.2.1 Ejecteur projetant l’étui hors de l’arme immobile pendant l’action :
Fixe porté par la boite de culasse
Ex: UZI
Effaçable porté par la boite de culasse
Ex: MIT 31
Effaçable porté par la culasse
Ex: FSA 49-56
2.2.2 Ejecteur projetant l’étui hors de l’arme ayant un mouvement propre :
Ejecteur à ressort porté par la culasse
Ressort d'éjecteur Ejecteur
2.2.3 Ejecteur abandonnant l’étui hors de l’arme. Ex : MIT 50 M2 HB
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
42/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
3 Classification des magasins
3.1 Magasin faisant partie intégrante de l’arme
3.1.1 Magasin dans la boite de culasse
A chargeur introduit.
Ex: Mousqueton 1916
A chargeur non introduit à piles imbriquées en appui sur une lèvre.
Ex : Fusil 36
3.1.2 Magasin tubulaire dans le fût:
Ex : LEBEL
3.1.3 Magasin tubulaire dans la crosse.
Ex: Fusil Spencer 1860
3.2 Magasin indépendant de l’arme
3.2.1 Fixe pendant le tir
A pile unique en appui sur deux lèvres.
Ex: PA 9mm Mle50
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
43/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
A pile imbriquée en appui sur une lèvre de distribution
Ex: FAMAS 5,56 F1
A pile imbriquée en appui sur deux lèvres de distribution
Ex: PAMAS G1
A pivotement de la cartouche
Ex: P 90
Galet de pivotement
de la cartouche
Rampes de
pivotement
3.2.2 Mobil pendant le tir
A tambour tournant mû par un moteur auxiliaire (ressort)
Fausse cartouche
(Etui) Couvercle tournant
rappelé par ressort en spirale
Ressort spirale comprimé
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
44/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
A bandes chargeurs souples
• A maillons détachables ouverts ou fermés
- Fermés - Ouverts
MIT 50 M2HB CN 20F2
AA NF1
• A maillons indétachables ouverts ou fermés
3.2.3 Magasins particuliers
Magasins mu par le moteur général de l'arme
Barillet Crémaillère
Barrette
Détente
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
45/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
8. APPAREILS DE POINTAGE
On rencontre 2 types de pointage :
• Le pointage direct,
• Le pointage indirect.
1 Pointage direct
Le pointage direct utilise essentiellement la ligne de visée entre du but et l’œil du tireur.
Le projectile pesant, même s'il est stabilisé par rotation, ne suivra jamais une ligne parfaitement
droite. Il y a lieu, même dans l’hypothèse de la rigidité de trajectoire qu’admettent toutes les armes
légères à tir tendu, de modifier, grâce à une hausse, la direction de l’axe du canon par rapport à la
ligne de visée suivant l’angle AOB et éventuellement par une correction de dérivation suivant
l’angle BOC.
Ces 2 corrections se font l’une dans le plan vertical, l’autre dans le plan horizontal. Elles sont
complétées par une autre correction, dans chacune des 2 plans, destinées à tenir compte des
caractéristiques permanentes de l’arme, éventuellement du tireur, de la mobilité de la cible, des
répercussions dues aux conditions atmosphériques du moment.
2 Tir indirect
Le pointage indirect, plus long et plus difficile que le pointage direct, est rarement employé dans les
armes d’infanterie. L’emploi du pointage indirect est cependant normal dans les mortiers que leur
tir vertical fait placer de telle façon que le pointeur ne peut qu’exceptionnellement voir l’objectif.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
46/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
3 La ligne de lire
La ligne de mire est une droite fictive de l’arme, dans le prolongement de laquelle se place
l’œil du tireur et que ce dernier dirige sur le but, en tir direct ou, sur le point de pointage en
tir indirect.
On rencontre 3 types de ligne de mire :
• La plus simple est formée de 2 points : le plus proche de l’œil est un cran de mire ou un
œilleton, le plus éloigné est le guidon,
• Le collimateur, composé d’un repère lumineux (par transparence), observé à l’aide d’une
simple lentille. Le collimateur n’est utilisé que pour le tir indirect ;
• La lunette de pointage qui est la solution la plus soignée, mais aussi la plus fragile et la plus
chère.
3.1 Ligne de mire à cran de mire et guidon et ligne de mire à œilleton et
guidon:
3.1.1 Le guidon :
• Les guidons rectangulaires sont peu sensibles aux chocs mais ils se prêtent à une visée
moins précise que les guidons circulaires.
• Les guidons circulaires dits à « grain d’orge » sont extrêmement fragiles.
• Les guidons en V renversé ont les avantages et les inconvénients intermédiaires.
3.1.2 Le cran de mire :
Le cran de mire est une encoche rectangulaire, en V ou arrondie, faite dans une pièce
métallique.
3.1.3 L’œilleton :
Quand l’encoche (cran de mire) est un simple trou rond de diamètre
compris entre 1,8 mm et 5 mm, elle prend le nom d’œilleton.
Cette modification de forme est plus qu’un détail.
La véritable différence vient de ce que, dans le cas de l’encoche, l’œil du
tireur se tient à environ 30 cm du cran de mire et essaie d’examiner
l’ensemble cran de mire - guidon - objectif. Dans le cas présent, l’œil du
tireur se rapproche à 8 ou 10 cm de l’œilleton et essaie de voir non pas ce dernier mais
seulement le guidon et le but.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
47/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
3.2 Ligne de mire à collimateur :
Le collimateur est composé d’un tube métallique fermé à une extrémité par une lentille de
distance focale égale à la longueur de ce tube, et à l’autre extrémité par une plaque de verre
dépoli couverte de peinture noire, mais dans laquelle une raie très mince laisse passer la lumière.
De cette raie lumineuse striée, dans le plan focal de la lentille, le collimateur donne une image
virtuelle, située à l’infini. Cette image est fixée dans l’espace par la seule position du tube et non
par la place de l’œil. Le collimateur n’est utilisé que dans le tir indirect, pour la visée sur le point
de pointage.
Point de pointage
Collimateur
3.3 Ligne de mire à lunette :
La lunette de pointage est composée d’un corps de lunette droit ou coudé contenant un système
de lentille (objectif redresseur) donnant du but et du point de pointage et de ses environs une
image réelle, petite et droite qu’un système grossissant (oculaire genre loupe) permet
d’examiner.
Dans le même plan que l’image se trouve un micromètre (fil en croix, V ou T gravés sur un
verre, etc.) que le système grossissant permet d’observer avec l’image réelle.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
48/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
4 Dispositifs de hausse en pointage direct
La hausse est l’angle qui existe entre la ligne pièce – but et l’axe du canon.
On distingue trois grands types de hausse :
• Les hausses uniques
• Les hausses à visée multiple
• Les hausses réglables
Hausse du type de l'AA NF1
5 Dispositif de pointage en tir indirect
5.1 Pointage en direction
Le pointage en direction est assuré par :
• Ligne de mire (guidon et cran de mire, collimateur et lunette)
• Goniomètre (origine parallèle au plan de tir et permettant la lecture de l’angle de dérive).
5.2 Pointage en hauteur
Il s’effectue à partir de deux niveaux à 90° pour le plan horizontal de référence.
Un goniomètre à origine parallèle à l’axe du tube dans un plan lui-même en parallèle au plan de
tir et permettant la lecture de l’angle de niveau ou de site
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
49/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
6 Précision et réglage de l’appareil de pointage
Les qualités essentielles d’un appareil de pointage à tir direct sont la précision et le réglage et
la robustesse.
6.1 La précision :
Elle vient du type et de la fixité de l’appareil de pointage de l’arme, de la longueur de la ligne de
mire ou des qualités de la lunette (grossissement, champ de vision, netteté...).
• Le guidon: Généralement il est monté par queue d’aronde, vis ou soudure sur le canon si
celui-ci est fixe. Si le canon est mobile (exemple : MIT 50 M2HB), le guidon est monté soit
sur la partie antérieure de la glissière ou de la boîte de culasse.
• La hausse: Généralement elle est montée par queue d’aronde, vis, rivetage ou soudure sur
des pièces fixes pendant le tir : la boîte de culasse, le boîtier d’alimentation, le couvre -
culasse...
Cependant, il existe quelques armes où les organes de visée sont montés sur des parties mobiles :
c’est le cas de la quasi-totalité des PA où le cran de mire et le guidon sont montés sur la glissière.
Quant aux lunettes, elles sont fixées à la boîte de culasse par l’intermédiaire d’un support monté
à queue d’aronde, immobilisé par un verrou, une vis...
6.2 Le réglage :
Suivant les caractéristiques techniques de l’arme, le réglage en direction et en hauteur est
effectué en agissant sur le guidon et/ou le cran de mire ou l’œilleton.
7 Protection contre les chocs
Afin d’éviter le déréglage des armes qui résulte de ces chocs, 2 solutions existent :
• Soit diminuer la fragilité des organes de visée,
• Soit protéger ces organes contre les chocs.
7.1 Diminution de la fragilité des organes de visée :
Cette première solution conduit à des guidons et des systèmes de hausse aussi ramassés et
massifs que possible. Souvent, cette condition ne peut être réalisée qu’aux dépens de la facilité
d’emploi et de la précision du pointage.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
50/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
7.2 Protection des organes de visée :
Cette solution a donné 3 procédés:
• La protection proprement dite des organes de visée,
• Le rabattement des organes de visée pour le transport,
• La dépose de l’appareil de pointage.
7.2.1 Protection proprement dite des organes de visée :
Ces systèmes de protection sont indépendants de
l’organe de visée qu’ils doivent protéger. Ils se
montent directement soit sur :
• La boîte de culasse,
• Le canon,
• La grenadière.
7.2.2 Rabattement des organes de visée pour le transport :
Cette solution nécessite un montage très soigné pour que l’articulation
n’entraîne aucun jeu ou déréglage.
7.2.3 Dépose de l’appareil de pointage :
Cette solution concerne les lunettes de pointage qui sont systématiquement démontées pour le
transport et sont portées dans des étuis spéciaux en raison de leur fragilité.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
51/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
9. SYSTEMES ACCESSOIRES A LA PUISSANCE DE FEU
La puissance de feu d’une arme est essentiellement fonction de :
• La valeur balistique de sa munition (cet élément sort des limites de ce cours);
• La justesse;
• La vitesse pratique de tir.
1 Les accessoires à la puissance de feu
Ce sont les organes qui améliorent le rendement d’une arme, ils portent sur :
• Le refroidissement;
• La cadence;
• Les facilités d’approvisionnements;
• Les réductions des réactions dues au tir.
2 Le refroidissement
Le but du refroidissement est d’organiser l’évacuation de l’excès de chaleur, afin de maintenir une
température admissible pour conserver une capacité de tir appréciable. On rencontre :
• Canon étoffé : Long à chauffer mais également lent à refroidir. Ex : MIT 50 M2HB
• Manchon à circulation d’air. Ex : PM MAT49
• Echange rapide du canon.
Ex : AANF1
• Usinage particulier.
Ex : ailette sur la longueur du tube assurant une mise en contact avec l’air d’une plus grande
superficie de matière.
3 La cadence
Les constructeurs de certaines armes ont voulu améliorer la cadence de tir de ces dernières. Ils se
sont attachés à atténuer les frottements dus à l’extraction ou simplement au contact des mécanismes
mobiles.
3.1 Ralentisseur de cadence
Dans certains cas la cadence est jugée trop élevée pour l’organisation du canon, il faut donc
ralentir la cadence par adjonction d’un ralentisseur.
Ex : Ralentisseur de cadence à arrêt limité du FM 24-29.
3.2 Régulateur de cadence
Les régulateurs de cadence appliquent les mêmes procédés que les ralentisseurs, mais ils sont
réglables. Le tireur peut modifier la course ou la durée de l’arrêt des parties mobiles ou,
l’importance du travail supplémentaire demandé.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
52/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
3.3 Augmentation de la course des parties mobiles
Pour limité la cadence, l’arme est organisée de telle sorte que la culasse recule dans la crosse ;
Ex : PM 36
4 Facilités d’approvisionnement
Ces facilités ont pour but de diminuer le temps et les opérations de réapprovisionnement d’une
arme.
• Capacité du magasin plus grande
• Maintien de l’armé en fin du magasin par un arrêtoir porté :
- Par le magasin lui-même. Ex : FM 24-29
- Par la boite de culasse.
Ex : PA 9mm Mle50
Arrêtoir de glissière
4.1 Indicateur de chargement
L’indicateur de chargement n’est pas une sûreté. Il permet juste de contrôler qu’une munition est
présente dans la chambre.
Ex : PA 9mm Mle50
5 Les réductions des réactions dues au tir
Les réactions dues au tir sont de deux sortes :
• Les réactions sur le canon au départ du coup
• Les trépidations dues aux mouvements et aux chocs des parties mobiles.
5.1 Les réactions sur le canon au départ du coup
Elles sont dues :
• A l’action des gaz sur la culasse, et se traduit par une projection de l’arme vers l’arrière.
• Au relèvement. Il résulte du fait que lorsqu’une arme est pointée, l’axe du canon ne passe
que très rarement par le point d’appui.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
53/54
Titre du document : Généralités Armement CT1
Identification du document : BB 03 Ind.: a
5.2 Les trépidations
Elles sont dues aux réactions des parties mobiles sur la boite de culasse ou sur le canon lors du
mouvement arrière et avant.
5.3 Les réductions
5.3.1 Réductions des réactions sur le canon au départ du coup
• Diminution de l’angle de couche.
Ex : AA NF1
• Adjonction d’un compensateur de relèvement. Ex : AK 47/74
• Diminution du recul par adjonction d’un frein de bouche.
Ex : CN 20F2
Frein de
bouche
5.3.2 Réductions des trépidations
• Amortisseur à ressort et piston. Ex : FM 24-29
• Amortisseur à tampons plastiques. Ex : MIT 50 M2HB.
BOURGES – BP 24 18998 AVORD ARMÉES
Pnia : 821 181 74 99 – Tél. : 02 48 68 74 99 – Fax : 02 48 68 74 59
54/54
You might also like
- HK417 Mode D'emploi (FR) 968529 003.0209Document71 pagesHK417 Mode D'emploi (FR) 968529 003.0209celinetjeanmi.conte1968No ratings yet
- TITRE III - PDF PDFDocument140 pagesTITRE III - PDF PDFexcellence-aristote koungaNo ratings yet
- TITRE 00.pdf PDFDocument10 pagesTITRE 00.pdf PDFexcellence-aristote koungaNo ratings yet
- Titre 16 Du Mtc-Tirs Collectifs Et Tir DecaleDocument87 pagesTitre 16 Du Mtc-Tirs Collectifs Et Tir DecaleRone meneses100% (1)
- Carnet de Combat NGDocument49 pagesCarnet de Combat NGThemaskNo ratings yet
- Pamas G1Document13 pagesPamas G1E ggNo ratings yet
- Evolution de La Zone D'Impacts Selon La Distance de Reglage: 200m 300m 381m 25 M 25 MDocument1 pageEvolution de La Zone D'Impacts Selon La Distance de Reglage: 200m 300m 381m 25 M 25 MDmitri GorbatiucNo ratings yet
- Tac 4 Fonction Contact InfanterieDocument18 pagesTac 4 Fonction Contact InfanterieBamba Kader100% (1)
- Tta 150 TV I I I TransmissionsDocument49 pagesTta 150 TV I I I TransmissionsMohamed WadieNo ratings yet
- TTA150 Titre 20Document147 pagesTTA150 Titre 20ali78apNo ratings yet
- Inf 207 Te en Zone UrbaineDocument5 pagesInf 207 Te en Zone UrbainefigarooooNo ratings yet
- Armes Francaises Aa 52 Et N f1 1Document24 pagesArmes Francaises Aa 52 Et N f1 1Stanislas BrabantNo ratings yet
- TTA 207 (2013) Prescriptions Aux Tirs Particuliers, Emploi Systèmes D'armes Ou MunitionsDocument222 pagesTTA 207 (2013) Prescriptions Aux Tirs Particuliers, Emploi Systèmes D'armes Ou MunitionscantinimmoNo ratings yet
- NRBC 73800Document40 pagesNRBC 73800Thierry ClainNo ratings yet
- TTA 207 - Edition 2017Document228 pagesTTA 207 - Edition 2017mvillemin9No ratings yet
- Titre 19 - Prévention Et Lutte Contre L'incendieDocument102 pagesTitre 19 - Prévention Et Lutte Contre L'incendiecantinimmoNo ratings yet
- 12,7 ChinoisDocument7 pages12,7 Chinoisnassmomed12345No ratings yet
- Titre 10 - Mines Et ExplosifsDocument168 pagesTitre 10 - Mines Et ExplosifscantinimmoNo ratings yet
- Topo 4Document26 pagesTopo 4YansaneNo ratings yet
- FS MG3Document28 pagesFS MG3Sylvain YaroNo ratings yet
- TP04405 Tippmann M4 Carbine 68 Cal Owners Manual 0716Document90 pagesTP04405 Tippmann M4 Carbine 68 Cal Owners Manual 0716Sergio Alves NetoNo ratings yet
- R S A Discipline GeneraleDocument68 pagesR S A Discipline GeneraleAstou SamakeNo ratings yet
- TITRE XIV - PDF PDFDocument80 pagesTITRE XIV - PDF PDFexcellence-aristote koungaNo ratings yet
- PIA-207 MESSEC2022 VFDocument77 pagesPIA-207 MESSEC2022 VFMatthieu PoyaultNo ratings yet
- Ak 47Document19 pagesAk 47Colan VladNo ratings yet
- FR12,7Document41 pagesFR12,7akms1982No ratings yet
- Juin 1944 - Le Débarquement en Normandie Et L'opération BagrationDocument12 pagesJuin 1944 - Le Débarquement en Normandie Et L'opération Bagrationikilling01No ratings yet
- Titre 11 - Organisation Du Terrain - DissimulationDocument136 pagesTitre 11 - Organisation Du Terrain - DissimulationcantinimmoNo ratings yet
- Cours Glock17 Gen5Document36 pagesCours Glock17 Gen5Ra'i TeheiuraNo ratings yet
- Makarov: P19184: Pistolet MAKAROV Mod - PM Cal.9mm MakarovDocument1 pageMakarov: P19184: Pistolet MAKAROV Mod - PM Cal.9mm MakarovKeyser SözeNo ratings yet
- Balance Des Potentiels Sg12Document13 pagesBalance Des Potentiels Sg12Bamba Kader100% (1)
- Carte Plages Debarquement Et Bataille de NormandieDocument1 pageCarte Plages Debarquement Et Bataille de Normandiealexandre76260No ratings yet
- TAC 105 Actes Reflexes Du CombattantDocument5 pagesTAC 105 Actes Reflexes Du Combattantexcellence-aristote koungaNo ratings yet
- HK416Document12 pagesHK416Jean-Pierre cesarNo ratings yet
- TITRE XX - PDF PDFDocument51 pagesTITRE XX - PDF PDFexcellence-aristote koungaNo ratings yet
- Firearms - Ams Catalogue 24Document127 pagesFirearms - Ams Catalogue 24lovereptilesNo ratings yet
- Squad Leader A4 COIDocument55 pagesSquad Leader A4 COIguy saignesNo ratings yet
- AK47 BurkinaDocument29 pagesAK47 BurkinaNelcha OuobaNo ratings yet
- PKM 7,62 MMDocument9 pagesPKM 7,62 MMDoussowb12No ratings yet
- TAC 109 Les Actes Reflexes SuiteDocument5 pagesTAC 109 Les Actes Reflexes Suiteexcellence-aristote koungaNo ratings yet
- Guide MarocDocument58 pagesGuide MarocMustaphaDokkaliNo ratings yet
- Titre 17 - Connaissance Et Entretien Des Matériels DiversDocument177 pagesTitre 17 - Connaissance Et Entretien Des Matériels DiverscantinimmoNo ratings yet
- Titre 16 - Connaissance Et Emploi Des Matériels SICDocument71 pagesTitre 16 - Connaissance Et Emploi Des Matériels SICcantinimmoNo ratings yet
- Les Grenades Utilisées en Maintien de L'ordreDocument43 pagesLes Grenades Utilisées en Maintien de L'ordreFessard LouiseNo ratings yet
- LG 33Document59 pagesLG 33Uncle JoffeNo ratings yet
- Titre 01 - Connaissances Militaires GénéralesDocument498 pagesTitre 01 - Connaissances Militaires GénéralescantinimmoNo ratings yet
- Cours TransmissionDocument2 pagesCours Transmissioneve d100% (1)
- Ecriture MilitaireDocument103 pagesEcriture MilitaireGbaloujc100% (1)
- 1-VOCABULAIR DARMEMENT Malang 1Document12 pages1-VOCABULAIR DARMEMENT Malang 1djibril diatta100% (1)
- Armes A Chargement Par La Bouche - Manuel Des InstructionsDocument55 pagesArmes A Chargement Par La Bouche - Manuel Des InstructionsazaNo ratings yet
- Arm EmentDocument9 pagesArm EmentMalick ThiawNo ratings yet
- Fiche D'instruction Vierge OSDocument3 pagesFiche D'instruction Vierge OSexcellence-aristote koungaNo ratings yet
- Titre 18 - Matériels AutomobilesDocument55 pagesTitre 18 - Matériels AutomobilescantinimmoNo ratings yet
- Presentation Des Forces de Defense CamerounaisesDocument49 pagesPresentation Des Forces de Defense Camerounaisesmoussi25100% (2)
- TITRE I.pdf PDFDocument401 pagesTITRE I.pdf PDFexcellence-aristote koungaNo ratings yet
- Titre 08 - SIC - Systèmes D'informations Et de CommunicationsDocument94 pagesTitre 08 - SIC - Systèmes D'informations Et de CommunicationscantinimmoNo ratings yet
- Armement FCB Corrigé. OkDocument24 pagesArmement FCB Corrigé. OkYansaneNo ratings yet
- Dossier Bivouac Okouampi Esoa 17Document13 pagesDossier Bivouac Okouampi Esoa 17excellence-aristote koungaNo ratings yet
- Journal d'un soldat allemand: La Seconde Guerre Mondiale, #1From EverandJournal d'un soldat allemand: La Seconde Guerre Mondiale, #1No ratings yet
- Technologies Des Armes Légères Légères: Améliorer les balles pour qu'elles soient légères et mortellesFrom EverandTechnologies Des Armes Légères Légères: Améliorer les balles pour qu'elles soient légères et mortellesNo ratings yet
- Fs Pa HerstalDocument17 pagesFs Pa HerstalSylvain YaroNo ratings yet
- FS MG3Document28 pagesFS MG3Sylvain YaroNo ratings yet
- 06 Les Sous MunitionsDocument40 pages06 Les Sous MunitionsSylvain YaroNo ratings yet
- ft-2 HQDocument112 pagesft-2 HQSylvain YaroNo ratings yet