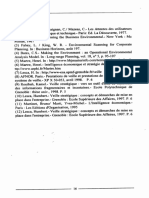Professional Documents
Culture Documents
Les Métiers de La Documentation Face Aux Nouvelles Technologies
Les Métiers de La Documentation Face Aux Nouvelles Technologies
Uploaded by
Abdoun Abdelkrim0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views4 pagesOriginal Title
Les Métiers de la Documentation Face aux Nouvelles Technologies
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views4 pagesLes Métiers de La Documentation Face Aux Nouvelles Technologies
Les Métiers de La Documentation Face Aux Nouvelles Technologies
Uploaded by
Abdoun AbdelkrimCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 4
ABSTRACT
With new technologies of information, documen-
tary units are being reversed in terms of organisa-
tion and professionnel qualifications that need a
constant updating with respect to innovations.
However, many obstacles can obstruct the adap-
tation of documentry duties.
2
Les bibliothéques ont fonctionné depuis des
miillénaires sur un méme modéle, celui d’Alexan-
drine et de quelques temples anciens de conserva-
tion du savoir. La premiére idee de «changement»
ne vit le jour que vers les débuts du 20eme siécle
avec l'introduction du terme «documentation» par
P. OTLET, dont le sens rejoignait celui de biblio-
théque, avec en plus, I'idée de la diffusion,
‘Avec quelques variantes, les concepts d’Otlet ont
nourri des generations de bibliothécaires-documen-
talistes (1) dont Jes premiéres formations Universi-
taires commencérent dans les années 1940,
Lintroduction des équipements audio-visuels et
de reprographie ont étendu, en les valorisant, les
services des unités documentaires sans menacer
Jeur aspect conservateur qui s'en trouvait au
contraire bien souvent renforcé.
L'explosion documentaire, conjuguée a des
moyens de plus en plus réduits, a eu pour
conséquence de scéléroser les bibliothéques. Les
traditions aidant, leur role de communication se
trouvait relegué & des rangs secondaires (2).
Un bouleversement, informatique.
Les quelques allusions que nous avons faites ont
permis de situer les contexte dans lequel se trouvait
Yunité documentaire lors de l'introduction de
Tinformatique en 1958 par un ingenieur H.P.
Lubn qui était chargé par 1.B.M de prospecter sur
les domaines possibles de l'utilisation des ordina-
teurs. :
Bien que mal préparée, la bibliothéque pouvait
tout a fait survivre en utilisant ordinateur comme
un équipement permettant un traitement rapide de
quelques opérations documentaires. Méme s'il
perdait une part importante de ses prerogatives, le
bibliothécaire était encore homme de la situation,
puisque pour obtenir l'information, il était toujours
nécessaire de recourir aux services des bibliothé-
ques et de surcroit ceux des bibliothécaires. En
fait, tout aspect de communication était préservé
‘comme du seul ressort du documentaliste.
LES METIERS DE LA
DOCUMENTATION FACE
AUX NOUVELLES
TECHNOLOGIES
A. ABDOUN
(Centre de Recherche sur l'IST)
La télématique.
Vers les années 1970 une nouvelle technologie
permet de fusionner I'informatique aux télécom-
munications, Ceci permettant I'accés 4 distance a
des bases de données situées parfois a des milliers
de kilometres du lieu de interrogation. C’est
précisément cette technologie (télématique) qui
bouleverse fondamentalement te monde de la
documentation, «L’informatique classique,... ne
changeait pas les relations avec leurs concur-
rents, partenaires et sous traitants. La teléma-
tique en revanche transforme la capacité concur-
rentielle des agents économiques. Elle améliore
la situation des uns, fait disparaitre les avantages
des autres» (3).
Il existe aujourd'hui de véritables entreprises
de diffusion de l'information : les serveurs.
Appuyés par une technologie de pointe, ces
onganismes desservent une clientéle de plus en
plus hétéroclite, qui reclame un accés non média-
tise. Les systémes experts permettent actuelle
ment cet accés en développant des langages
diinterrogation de plus en plus proches du
langage naturel,
On peut penser que le temps n'est pas loin, du
moins dans certains pays ot n'importe quel
uitilisateur pourra accéder a l'information sans
passer par un médiateur (bibliothécaire en gené-
ral).
Les retombées sur 1a documentation,
Hest aujourd'hui clair qu’une généralisation
de utilisation des technologies de l'information,
pour peu qu'elle se conjugue une politique
tenant compte de laspect culturel, est d'un
apport fondamental pour le fonctionnement et la
gestion des unités documentaires; nous citons a
titre purement illustratif|
= la réduction du temps d’aceés,
= Vol 1, n°1, 1991
= la réduction des délais de traitement et de
diffusion,
~ la multiplication des capacités de stockage grace
aux possibilités de l'archivage électronique,
- Voptimisation des systémes de recherche docu-
mentaire.
A un niyeau plus générique, nous relevons la
montée du produit «1.S.T» qui représente actuelle-
ment 10% du marché mondial en ligne.
Le bouleversement voire, la mutation existe
Toutes les notions jusque la admises de la bibliothé-
conomie sont appelées a étre reconsiderées, Ainsi il
en est de la notion de l'auteur, et plus encore, celle
du circuit du livre. On parle en effet d'une perte des
intermédiaires entre l'auteur et le lecteur, et d'une
lecture interactive possible de la presse.
Parallélement a la révision des anciennes idées,
de nouveaux concepts apparaissent : I'integration,
interactivité, la démassification, la synchronie, la
proximité, l'information fluid
7 Au niveau épistémologique, l'on reléve une
tendance vers la fusion des trois disciplines (Archi-
ves, Bibliothéques, et Documentation). Etl'on peut
penser une fin prochaine de «la petite guerre larvée
menée depuis des lustres entre les archivistes, les
bibliothécaires, et les documentalistes» (4),
/ L’onassiste en fait a une proliferation des profils
et des qualificatifs liés aux métiers de la documenta-
tion : analyste, analyste-rédacteur, informatiste,
information scientis
Toutes ces appellations sont relatives a une
tentative de redefinition du métier de 1a documenta-
tion face aux nouvelles technologies de l'informa-
tion et de la communication et ne signifient pas une
réelle adaptation des profils. Pour illustrer ceci,
nous commencerons par relever cette situation
paradoxale :
Tout le monde s'accorde en effet sur I'intérét de
Vinformation comme la nouvelle matiére premiére
de la Société moderne qu'on se presse déja d’appe-
ler «société d'information». Or, le bibliothécaire-
documentaliste qui serait le professionnel tout
indiqué de cette industrie naissante est resté bien en
dega des souhaits escomptés. Toutes les enquétes
font ressortir que l'image sociale du bibliothécaire
est empreinte de nombreuses perceptions péjorati-
ves.
Par ailleurs, la frustraction existe chez bon
nombre de bibliotécaires, qui tout en sachant les
bouleversements liés & l'automatisation Continuent
ravailler de la maniére la plus archaique qui soit.
Les bibliothécaires qui travaillent dans les unités
informatisées, sauf quelques cas individuels, ne sont
pas mieux lotis. Is ont de plus en plus de mal a
suivre I’évolution et se heurtent & quatre entraves ou
inadaptations essentielles :
L’inadaptation psychologique :
Die des facteurs tant subjectifs (inertie, paresse
intellectuelle,...), qu’objectifs (en exemple, le cor-
poratisme),
Surun autre plan, ta féminisation de la profession
participe d’une certaine maniére a cette inadapta-
tion. Les professions qui se féminisent se trouvent,
par ce fait méme, socialement dévalorisées.
L’inadaptation techniques :
Loutil informatique lorsqu’il est utilisé reproduit
eautomatiquement» des pratiques qui datent d'une
autre epoque. L’élément «gestion» est rarement pris,
en compte.
Linadaptation structurelle :
Contenue dans fe fait que les structures, es outils
et les organismes sont congus pour reproduire un
modéle largement dépassé de la gestion bibliothé-
conomique. On peut d'ailleurs se rendre compte que
méme dans ce modéle (ex. la chaine documentaire),
«il manque un maillon, l'utilisateur» (5).
L’indaptation de la formation :
L'idée Ja plus souvent admise est que I"unité
documentaire a plus performante est celle qui
posséde les plus gros volumes de documents. Or la
régle bien connue des 80/20 de Pareto, est dans ce
contexte, largement vérifiée. On arrive méme &
démontrer que dans de nombreuses bibliotheques,
seul 5% du volume documentaire disponible est
réguliérement utilise, Il importe done plus de savoir
retrouver l'information que de la posséder.
Les formations dispensées actuellement repro-
duisent cependant une conception documentaire
basée résolument sur I'idée du stockage.
Nous reviendrons plus loin sur ces éléments qui
représentent selon nous les points clés que devrait
prendre en compte toute tentative de redressement.
Par ces faits, les bibliothécaires-documentalistes
se trouvent dans l’incapacité a faire valoir leur droit
au statut de professionnel du traitement et de la
gestion de l'information. Statut que revendique
Vinformaticien d’autant plus aisément que dans la
RIST - Vol 1,
1991
pratique le dialogue tant relaté de Vinformaticien
documentaliste a rarement existé,
L’informaticien maitrisant trés vite les opérations
documentaires classiques, congoit son systéme ow le
documentaliste se transforme d'expert supposé en
simple technicien.
Outre, I'informaticien, des praticiens et théori-
ciens de tous bords investissent le domaine docu-
mentaire, qui n'est plus du seul resort du bibliothé-
caire-documentaliste. Ceci posant de fait ta ques-
tion cruciale de l’existence d’un métier bibliotheco-
nomique :
De nombreux spécialistes de la sociologie des
professions ont essayé de définir les attributs a
méme de déterminer si une occupation peut-étre
définie comme une véritable profession. Parmi ces
attributs, on peut relever : la base théorique, I'auto-
nomic professionnelle, la conscience collective
(association), le code de l’éthique, le systéme de
récompenses, le sens de la vocation... Hest possible
pour ce qui est de la bibliothéconomie de discuter
de chacun de ces critéres. «Le point faible» relevant
de l’attribut de la base théorique, et plus encore, de
celui de l'autonomie professionnelle,ll n’existe rien
selon L. Housser «that librarians do or know that
cannot be done or know by people with intelligence
and practical experience who have not studied
library at the graduate level» (6).
Cette affirmation est méme dans ordre actuel
des choses, discutable, mais de nombreux éléments
dont précisément, entrisme (7), tendent a la
confirmer,
Ce phénoméne (entrisme), bien, qu'il soit sou-
vent d’un apport certain, présente I'inconvénient de
créer l'incohérance faute d'une formation de base
unifiée.
‘A ce point de notre propos, nous pouvons
préciser que le «danger» qui guette les bibliothécai-
res-documentalistes est moins celui des change-
ments, que celui du risque de l'inadaptation aux
changements «La menace de l'environnement» (8)
existe, et la nécessité d’une conception nouvelle des
métiers de la documentation se précise de plus en
plus.
Les solutions possibles.
Onassiste depuis quelques temps a une prolifira-
tion des profils qui semblent se substituer aux
appellations classiques de bibliothécaires, archivis-
tes, et documentalistes. Ainsi, peut-on citer : infor-
mation scientist, informatiste, rédacteur, ingenieur
documentaliste, analyste rédacteur.
a ™
Toutes ces appellations sont li¢es une tentative de
rédéfinition des métiers de la documentation face
aux nouvelles technologies de l'information et
de la communication. On cherche le plus souvent
une valorisation par sémantique interposée du
meétier documentaire. De nombreuses études mon-
trent en effet les connotations lourdement péjorati-
ves liges aux mots documentation, archives et
bibliotheque.
On sent la nécessité du changement, voire les
moyens d’y parvenir, mais l'on se heurte toujours au
manque de préparation des professionnels tout
éventuel changement
Des Solutions ? Attributs,
Ces derniéres années, l'on a pu constater que le
monde bibliothéconomique était en train de bouger.
Des réformes en profondeur sont entreprises, parti-
culigrement dans le domaine de la formation qui
reste la base a tout essai d'amorce d'un veritable
changement. Mais, faut-il rappeler que ces change-
ments se heurtent a de réels blocages. Disons
simplement que l'unique solution réside a notre
sens dans la «mise sur le marché» d'un bibliothé-
caire, (le terme est-il encore approprié?), veritable-
ment professionnel, c'est a dire produisant des
services qui ne peuvent étre produits par aucune
autre corporation. Done des services relevant d'une
réelle compétence. Ceci reposant sur une base
théorique aujourd'hui favorisée par la mise en
évidence de «lois» et de concepts spécifiques aux
sciences documentaires.
Le bibliothécaire-documentaliste peut tirer de
l'introduction des nouvelles technologies un avan-
tage essentiel, celui de sa fibération des taches
répétitives au profit des taches de gestion et de
contact avec l'utilisateur. Ceci allant de paire avec le
fait de considérer ces technologies comme un outil
utilisé ici en documentation comme il I’a été dans
d'autres disciplines, de la gestion ou autres.
La part, de la formation aux nouvelles technolo-
gies n'est qu'une partie d'une formation bien plus
riche qui viendrait mettre sur le marché de véritables
professionnels de l'information spécialisée. Ceci est,
pratiquement possible, mais bien difficile a deman-
der a une discipline, qui évoluant dans un environ-
nement véritablement «patchwork», trouve toujours
bien du mal a définir son épistémologie.
RIST - Vol 1, n2 1, 1991
u
.IOGRAPHIE :
‘Nous employons indifferemment les termes bibliothécai-
res, documentaliste, e¢ bibliothéeaire-documentaliste.
2.~ CF. Fondin., Hubert. L'évolution des systémes et métiers
du traitement de information : Ia crise du monde docu-
mentaire (et bibliothécaire). In : Documentaliste, vol. 24,
n° O1, 1987, p. 3-10
formatisation de Ia
jon frangaise, 1978.
thologiques et quantitatifs : implica.
tions pour la gestion des systémes d'information en milieu
universitaire et de recherche. Thése univ., Bordeaux 111,
1988, P. 5,
Fidt
5. Housser |. «ls librarians!
mai-aoiit 1979, P. 20.
4 profession» ? In: argus,
6.~ Irruption dans un secteur, de chercheurs et praticiens
7. Cf ce sujet Vouvrage de Kotler, Philip.- Marketing,
‘management, planning and control.~ Englewood Cliffs :
Printice Hall, 1972.
8. Clee sujet l'article de Le Coadic, Yves.- L’évolution des
‘meétiers de la communication de 'IST a V'étranger. In:
Documentaliste, vol. 25, a® O1, 1988, P. 23-28.
12
RIST - Vol 1, n°1, 1991
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Le Concept de Veille Et Son Application Dans La Gestion de I'information SpécialiséeDocument14 pagesLe Concept de Veille Et Son Application Dans La Gestion de I'information SpécialiséeAbdoun AbdelkrimNo ratings yet
- Mise en Oeuvre D'un Intranet - Aspects Lies A La Circulation de L'information Scientifique Et TechniqueDocument8 pagesMise en Oeuvre D'un Intranet - Aspects Lies A La Circulation de L'information Scientifique Et TechniqueAbdoun AbdelkrimNo ratings yet
- La Lexicometrie Documentaire - Contribution A L'utilisation Des Techniques Documentaires Comme Methodologie D'etude en SciencesDocument7 pagesLa Lexicometrie Documentaire - Contribution A L'utilisation Des Techniques Documentaires Comme Methodologie D'etude en SciencesAbdoun AbdelkrimNo ratings yet
- Autoroutes de L'information - Quels EnjeuxDocument5 pagesAutoroutes de L'information - Quels EnjeuxAbdoun AbdelkrimNo ratings yet