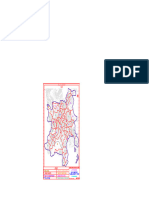Professional Documents
Culture Documents
Le Projet Urbain Patrizia Ingallina Que Sais-Je
Le Projet Urbain Patrizia Ingallina Que Sais-Je
Uploaded by
Polarr Bearr0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views66 pagesOriginal Title
Le Projet Urbain Patrizia Ingallina Que sais-Je
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views66 pagesLe Projet Urbain Patrizia Ingallina Que Sais-Je
Le Projet Urbain Patrizia Ingallina Que Sais-Je
Uploaded by
Polarr BearrCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 66
4 ue Que
Baise? satis-je?
LE PROJET URBAIN
Pee nga
(saul Kerns den pees rc rae
irene neo rns
-spécifique, cchiie! touche, par son Naar eans
lied ps ene
syopsata: a etecd a ced
ein Ga aimee Aah
chacun, qui haite une grande vil,
tne banleve ce zone rurale
JINN) somes
Psi SSM
PREFACE DE MARCEL RONCAYOLO
La notion de projet urbain a fait flores en France,
depuis les années 1980, au point de couvrir parfois des
marchandises moins homogénes, signe de succes et
Parfois d'alibi. Mais la notion reste importante, histo-
Fiquement significative. L'urbanisme sortait quelque
peu disqualifié de la période de planification spatiale,
Tonetionnaliste et «technocratique», disait-on, des
années 1950-1960, des Trente Glorieuses, en comptant
pilus large. Le projet urbain se proposait de requali-
fier les espaces urbains, atteints par les changements
sociaux et économiques ct par le ralentissement de
économie & partir du milieu des années 1970, démo-
nétisés par les excés du zoning et les dangers des quar-
tiers difficiles ~ ou des grands ensembles ; il voulait
aussi requalifier le travail de Purbaniste, la dignité de
son intervention. Et d’abord le r6le de Purbanisme
dans le processus de développement. A répoque des
fortes eroissances, il devait en quelque sorte accompa-
gmer, profonger lessor de économie, le mouvement
des populations, le changement des modes de vie, la
transformation Jes techniques. Il était « induit » ow
simplement cortectif effets territoriaux non maitri-
sés. A. partir des années 1980, dans des conjonctures
plus difficiles, d'introduction de technologies porteu-
ses de rupture, de mondialisation approfondie, la
concurrence s’aggrave non sculement entre les entre-
prises mais aussi entre les lieux, les sites. Dans cette
‘compitition (qui est aussi communication et mobilit8),
établissement urbain, le territoire et son aménage:
ment deviennent facteurs de développement (ou de ré-
session) par leurs capacités & attirer les activités, les
3
investissements ct les hommes. Les qualités de
Taccessibilite, de 'équipement, des environnements de
toute nature, des aménités commancdent lattractivite
Le traitement du terrain devient facteur majeur de
expansion ow simplement du maintien de Tetat so-
ial Le discours sur le marketing’ urbain souligne,
peut-ére, 4 Pexeés, ce phénoméne. La notion de pro”
Jet urbain.répond, en principe, aces nouvelles condi
tions. A lire Pavrizia Ingallina, les earacteres propres
qu'on lui accorde, s‘ordonnent autour de trois the-
res: introduction du temps, Ia mutidiseiplinarite, la
participation, Introduction du Temps : compte. tent
du sytme des changements et des diffcultés de
Vanticipation, Je projet est pensé comme stratéxie ot
non fixation rigide d'un plan i doit fixer des objec-
ifs larges sans aspirer& construire un schema defini
et déterminer « prior la succession des proscammes
Si le mot projet fait partie du «capital de
architecture et de sa tradition (projet et projection);
le projet dit urbain est englobant. L’objet de le dé
marche est a la fois social, économique, cultuel ;
Parchitocture et Pesthétique références majeures mats
subordonnées, en quelque sorte, i une volonté plus
‘générale. Le projet n'est pas, non plus, projection en
Table rase mais soucieux de jouer avec les temporalités
présentes dans Tespace urbain, les héritages, Part
ulation entre continuité et innovation, quil sagisse
de structures matérielles, de pratiques ou de représen-
tations. D’oit Ia multdisciplinarité: Purbanisme est
sans dovte moins tne diseipline qu'un damaine de =
eexion et d'action au carrefour de savoirs multiples,
qui vont du contexte naturalist, géographigue aux
Usages et meme aux idéologies. Rencontre du savoir,
mais aussi des acteurs, des institutions publiques et or-
‘anisations. privées, des. « décideurs », des « concep-
{eurs », mais aussi de celui que Ton nomme Mal
4
uitte a trop le confondre avee le résidant. Par qui,
our qui? Quel est Phabitant, dans une société qui est
aussi de mobilité ? Qui parle en son nom ? Par quelles
D’oi obligation de sinterroger
sur le role et le statu cles médiateurs. Si lon veut don-
ner quelque consistance 4 fa notion, sans doute eriti-
quable, de gouvernance, cette démarche est indispen-
fable, Mais c'est rappeler uss que le projet urban,
stinet du seul projet architectural, est politique, au,
Sens plein du terme, a
Inteodvetion
LE PROJET URBAIN,
UNE NOTION FLOUE
La notion de plan, autrefois largement employée
ppar les acteurs ~ décideurs de Taménagement et ‘de
Purbanisme, en France, a été actuellement sup-
plantée par la notion’ de projet. urbain. Cette
expression était déja fi la mode dans les années 1970,
principalement employée par les architectes comme
synonyme de «composition urbaine ». Ils y asso-
Giaient aussi Tidée d'un projet d'architecture «a
grande échelle ». Autrement dit, la notion de « pro-
jet classique, ‘processus technique duu ressort de
Yarchitecte, emportait sur celle, plus large, d? « ur-
bain » qui se réfere & la ville et qui renvoie de ce fait
‘des compétences multiples et done pas uniquement
aux problémes d'organisation spatiale. Cette double
énomination de « projet» et d’« urbain » a favorisé
tune certaine ambiguité de la notion,
Quelques expériences ont marqué ce passage, inspi-
rées de fa réflexion architecturale menée en Italie, vers
la fin des années 1960. Le cas de Bologne, ot lieu
une expérience de planification qui intégre Tidée de
projet en ouvrant aussi la voie & la participation des
citoyens, devient presque mythique. Aussi, le travail
fin analyse typo-morphologique qui y est effectué
contribue a Ptablissement d’une culture du projet qui
aurait conduit la nouvelle notion. En France, oit le
relais sétablit entre une planification technocratique
démonétisée et de nouvelles formes ¢'intervention de
Ip traitement difficile du quartior des
“Hulls @ amoreé Ie débat. Ce livre tends compre de
ces actions préliminaires. Dans i litrature urban
Aigue, cest Ch, Devils, auquel on doit auss une
production déterminante pour a fixation des concep
Gs typotogie et de morphologic en France, qu ie,
clenche un vértable dsbat sure projet urban ‘Dis a
Fin des années 1970, it plaide pout Padoption un ute
banisine de projet contre une logique de programme
Tide. IS refere, en particule, a méthode de Pur,
banisme opérationnet dont in zone d'aménagement
concertée (zac) st Texpression la pls significative
Elle a condut 4 une certainesyslématisation dans
production des espaces urbaing,fondée sur Timpost,
tion au projet d'un maximum de contrantes progran
matigues afin den assurer la faistion dans des de
luis Viables (Cesc sulfisimment courts pour ne
Das entruiner des deficits dans le bilan de Tame
1 permettre de mete en évidence les dysfonctionne.
ments, 1s limites possbles Jun tel proje) L'xpace
Public, qui est expression principale dela vie socal,
gn, sor ameindr dans son role de ew de meme
Féchanges, pensé désormuis en népatif par rapport a
des formes ties #fpondant souvent aus interes nd
duels des promoteurs. ins, le projet urbain oie
occasion a Ch. Devillers deffectuer une eriggue
pls large sur la manire doot on produit espace ur,
bain en France, sans tenit compte des dievenions
Le zoe famdnzenent cone ten prota
& Femeaagomen, ous iso Ge Metin Cia Pa
Sap we,
ronda ts coals connie mis amtnager) ox es aes
fondamentax de Parbane et coubartcus rides ds cae
its oes ul pesentent pour i -comnes Tavantage se
Sci anonyme de rot comuhrial , Vor Distal de ih.
biomes op ee BTS
«conventionnelles », c'estdire de la manitre dont
les habitants entrent en relation avec ext espace.
B. Huet, H. Raymond contribuent a Fenrichissement
de cette approche qui associe choix spatiaux et com-
portements sociaux. Les écrits de Ph. Panerai et
J, Castex vont dans le méme sens. A partir de la dé
centralisation (1983), la. critique de Devillers assume
presque une dimension éthique face a la demande des
Imaires, de plus en plus pressunte, de lancer des « pro-
jets urbains » comme démonstration (et parfois aussi
comme caution) d'une politique de Paction. La lutte
des villes pour s‘affirmer (notamment sur le plan de
implantation des entreprises) conduit a devoir affi-
cher de manigre «éelatante » que Ton a une claire
stratégie de développement dont le projet urbain est
garant. Ainsi, ce mot est vidé de son sens en se ref
rant a des actions tr8s disparates et qui restent pariois
au simple stade d'intentions dont le seul but est de
faire réver les habitants par des images attrayantes
des aménagements de vastes territoires, no man’s land
que le projet urbain devrait aider i metire en valeur,
ais impossibles & réaliser faute de moyens techniques.
et financiers, aux actions ponetuelles (comme Ni-
mes) dont on recherche ensuite par le projet urbain &
Gtablir la cohérence. Devillers, qui_enire-temps a
donné une démonstration dans sa pratique protession-
nelle de la logique du projet urbain avec la recomposi
tion du quartier Saint-Saéns a Saint-Etienne (zur de
Montreynand, initige en collaboration avec P. Cheme-
tov entre 1979 et 1982), avance In nécessité de cadrer
le concept contre ces derives et cette inflation de la no-
lion. Utilisée 4 tous bouts de champ par les maites,
“approprige par les architectes qui la considérent essen-
tiellement dans son aspect formel, discutée par les
chetcheurs des sciences sociales et d'autres intellec-
lucls qui en soulignent le caractére plus vaste que la
>
seule dimension spatiale, cette notion devient de plus
en plus confuse.
Ieroit done nécessaire de faite une mise au point et
de fixer les principes sur lesquels doit se baser un projet
urbain. En tout premier lieu, il doit tre clair qu'un pro-
Jet urbain ne se fait pas en un jour, mais il accompagne
Je processus de transformation urbaine dans la durse :
ii ne peut done pas répondre a la logique de Purgence
souvent invoquée par les maires. doit réunir des com-
pétences multiples, carils’applique a la ville qui est une
rEalité complexe, pas unique out formes matérieles et
formes sociales sont liges dans des relations qui se sont
‘tablics dans le temps et dont il devra rendre compte. Il
se référe aussi di une multiplicité de techniques dont la
maitrise ne peut étre confige aux seuls architectes ou in-
aénicurs, mais demande, selon les eas, d'autres comps
iences spécifiques et nécessaires pour sa faisabilté (y
compris financiére). Puisau'l a une visée large, il doit
permettre le débat et l’Schange avee la population dont
avis est dterminant, Dans sa conception, il demande
‘un savoir spéeifique sur la ville son processus de trans-
formation, les lois qui réglent ses formes, les analyses &
ener et les outils conceptuels & mettre au point afin
‘tablir une médiation entre les différentes écheles, de
Ja pareelle‘ la ville, par’ « embrayage » (agencement),
‘Crest une pensée de la relation, avant tout. Il porte sur
des tssus constitués qu'il doit permettre de valoriscr, en
particulier & travers la prise en compie de Fespace pu-
blic (ou espace ouvert) qui constitue le lien, la
connexion aussi bien avec histoire quavec les espaces
de la villeen leur donnant du sens, En ce sens, le projet,
urbain reconstitue la globalité de la ville par ia recons-
iruction d'un discours dont les espaces publics tiennent
Je il conducteur (continuité) En tant que projet global,
il oppose & une pensée sectorielle de Paménayement
ui a caractérisé les réseaux avec la eréation deffets de
0
coupure tres nets entre villes et parfois & lintérieur
une méme ville avec toutes les difficultés que cela
‘comporte.
Le projet urbain se situe comme un projet d’ou-
verture qui impose une Evolution des. mentalités.
D'abord, il demande davantage de partenariat entre
institutions publiques (a intérieur des services muni-
cipaux dune méme commune, mais aussi entre com-
‘munes), c’est-i-dire une volonté de s'inscrire dans
cxlte logique de la globalité et de la durée. Les études
pour le développement de La Plaine Saint-Denis, me-
nées en collaboration entre les communes de Saint-
Denis et Aubervilliers (associées dans un syndicat in-
{ercommunal, Plaine-Renaissance, créé en 1985 et qui
comprend aussi la commune de Saint-Ouen), sont fa
démonstration de cette ouverture. Il s'agissait de frei
ner les effets néfastes qu’aurait pu avoir la désindus-
(rialisation sur cette zone, & dominante industriel
avec le risque de se retrouver avec des terrains vite
duits & Pétat de friches. Ainsi, aprés um travail appro-
Fondi de diagnostic et 'élaboration une charte inter=
ccommunale, ces communes sont a méme de fixer Ies
objects et les moyens précis (en matiére de dévelop-
pement économique, de formations, de déplacements,
habitat, ete). Le projet urbain est ainsi assis sur des
bonnes bases ct une consultation peut étre lancée
és 1991 a Taide de P, Riboulet, & laquelle Ch. Devil-
Jers est invité & participer (ainsi que d'autres équipes)
Son projet urbain (réalisé en collaboration avec
P. Germe et M. Corajourd) se fonde sur la recherche
de constituer ua tissu urbain avec ses caractéristiques
lraditionnelies (des places, des voies, etc.) dans un ter=
ritoire trés étendu (700 ha) qui posait un grand
nombre de contrainte,
Diautres actions sont engagées, ds In moitié des
années 1980, sur les espaces publies (pour Paris on
"
peut citer les régménagements de In place Stalingrad
des Champs-Flysées effects par B, Hust) ql de-
Viement aussi un theme porteur des politiques de
cette pariode. Des projets pls spéfiques, de recon
quéiclurbaine (canal de Roubaix, toujours par Devil-
ier) de lsisoninterquartirs (tramways de Nantes ou
de Strasbourg appelés aussi « lien de ville»), voient
ainsi le jour, sagt certs de projets qui diferent par
deur type, par leur tlle, etc, mais qui ont en commun
Je fad atégrerla'méme logique, qui ex elle dt pro-
jet urban, la posture avec laqueliil se stue pe rap-
port a son champ d'action, Ele pend en compte di
rents facteurs eonomiques, soctau, spatiaus, et elle
est complexe, car elle releve de Tintret general.
es derth sur le projet urbain sont souvent assez
courts mais importants (ceux de Devillers arrivent trés
tt, ds la fin des années 1970, et sont suivs par les
écrits d'autres architectes. IIs révélent un intérét crois-
Sant Pégard de ce sujet, de la part autres domaines
aque Tarchitecture, tels que les sciences sociales ou
Fanthgopolosie, par exemple
Etat aus, dans une tentative de réafliemer son
role central, S@st appuye sur ces réestons en les Te
Drenant danse cadre des séminaires, organises pat le
Ininistre de !Equipement (Facelir projeturbatn),
partir du début des années 1990,
‘Mime 3 les debats ont contribué & une pus grande
ouverture et surtout & la prise en compte de a globa-
Hid de Ia notion de projet urbain, un décalage existe
toujours entre les énonces et Ia pratique, Cette dif
eulié est bien illustre dans la realisation des projets
de morceau de ville (projets urbains complexes) qu
sont consderer comme des projets urbains, cat leur
Dortée es large. Les experiences montrent qu les (ris
dimensions deja mentionnées (&eonomique, sociale et
spatiale ne sont pas toujours prises en compte de ma-
2
nigre 6gae. Crest le as d'Euralill_ (premiére tranche)
oi la dimension prépondérante a &t@ Economique (at-
tirer des investisements), alors que la dimension so-
ciale n'y appara qu’en partie (augmentation des em-
los), les habitants n'ayant pas &t6 consuls, mais
Seulement informés fe projet une fois are
‘Le projet urbain peut étre aussi bien une action
coneréte qu'une démarche méthodologique. L’exem-
ple de fa ville de Rennes se présente partculiérement &
propos, Le projet urbain s'est manifesté sous forme de
émarche qui vise la mise en commun des savoirs, des
Savoir-faire, des compétences, des désirs, ete. Son tra-
vail a ét6 i) d'établi une « transversalité», de soigner
les articulations entre T'échelle locale et’ cell, plus
vaste, de Fagglomération en traduisant les stratéyies
congues ces échelles dans des projets portant sur des
Secteurs urbains identifiés et dont la realisation a été
confige & des ZAC.
Chapitre 1
LES PROBLEMATIQUES
LIEES AU PROJET URBAIN
Les « valeurs » (ou dimensions dominantes)
du projet urbain
1. La valeur politique. ~ Elle s'accompagne des
mutations du cadre juridique et institutionnel, En
France, les lois de janvier et juillet 1983 ont prévu le
ansfert de compéiences en’matitre d'urbanisme de
Etat aux communes: les maires ont regu le pouvoir
de fixer les regles de Foccupation des sols & travers le
plan d'occupation des sols (POS) et ils n’ont plus be-
soin d'avoir recours aux structures de Etat (sauf sls
ne disposent pas des moyens techniques et financiers
nécessaires). Cela a modifié radicalement les modalités
de la planification urbaine, car les outils dévalorisés
de 'urbanisine opérationnel ne leur permettent pas de
régler les problemes auxquels ils doivent faire face,
comme le chémage, la baisse de Factivité économique
ou encore l’exclusion sociale. De nombreux maires es-
sayent alors de relancer leurs communes ; dans Te cas
de grandes municipalités, ils choisissent la méthode
dite de la planification stratégique, oi Ie projet urbain
‘occupe une place centrale. Cette expression est en effet
uilisée pour simplifieret rendre apparemment clas &
tous des processus en réalité trés complenes, liés aux
activités de planification désormais renouvelées inté-
1, Lees en document rani en nel ihe ue
coumne Vor Beate de Nhe. oS a,
grant la notion de projet, La figure traditionnelle du
mire céde le pas & colle du maire-manager qui gére sa
ville comme une entreprise. Cette approche s'est al-
fiemée pour sépondre au chimage croissant de la po-
ulation, en grande partie des plus jeunes, et elle
considére aspect économique et Social ‘comme
Pobjectif principal de la planification.
La ville apparait comme un liew favorable au main-
tien ou la création d’emplois et d’entreprises. Les en=
{reprises apparaissent ainsi des acteurs essentiels non
seulement de la croissance économique, mais encore
du développement urbain, et elles sont aussi porteuses
un modele de gestion qu’on tend a appliquer a la
ville. Il faut aussi considérer que les méthodes
déaboration dun plan d'urbanisme s'adaptent aux
conditions économiques et sociales d'un pays : jus-
qu’au milieu des années 1970, le plan d’urbanisme ac-
‘compagnait la croissance en s'efforgant de donner une
rationalité spatiale aux mécanismes impliqués par
celle-ci. A partir de la fin des années 1970, la crois-
sance démographique a fléchi et la croissance écono-
migue, n’ayant plus de facteurs propres aussi cons-
tants que dans les années précédentes, devient un
‘enjeu. dans une compétition entre pays, entre régions,
entre villes et entre sites. L'urbanisme est désormais,
devenu un factcur indispensable pour attirer les activi
{és et les investissements, et un préalable a Texpansion
économique. Ainsi, d'une part, Ie recours a la notion
de projet urbain, en substitution & celle de plan, in-
dique leffort pour rendre plus attractive une ville vis-
Avvis des entreprises susceptibles de s'y_implanter.
Diautre part, c@ projet se décline & travers une série
actions conerétes (et non seulement spatiales) obtis-
sant 4 une stratégie globale, supracommunale. Ce
double objectif est poursuivi a travers introduction
de démarches de concertation-négociation préalables
5
{la procédure juridique des instruments ¢urbanisme.
Lutilisation de ce terme au lieu de eslui de «plan »
‘yout done indiquer qu’on est passé dune planification
fechinocratique, imposée, une planification plus dé-
mocratique, négociée entre acteurs sociaux pour
iaboutir a un « projet collect»
Des contradictions, — Cette affirmation se heurte &
les. contradictions évidentes dues principalement &
slou causes = les regards (et done les intérets) différents
jue les maires ont sur leur trritoire, chacun pour leur
propre comple ; Ie rythme de la vie municipale, beau
‘coup plus courte qu'une stratégie qui se situe & moyen
formic. Le projet urbain, dans ce cas, ne peut pas étre
suratégique et se situe parmi Tes actes d'un maire qui
‘eguaye de négocier avec ses électeurs et de se Kégitimer,
‘Crest le cas du maire qui, n’ayant pas les moyens effec
lifs pour réaliser une quelcongue intervention sur son
lerritoire, mais voulant se montrer actif, demande a un
‘uohitecte de réfiéchir & un projet & échelle du terri
{wire, sans lui fournir de programme préeis. Cette de-
imande assez floue « traduit d’abord Ie désir avoir un
projet, C’est-A-dire une vision prospective plus globale
Ot plus coneréte que celle du POs »!. Ce projet est rare-
, mais il utilise Pimage comme moyen de
communication ditecte avec les habitants sur le deve-
ir possible de certains Tiewx de leur ville, Cette ap-
pptoche spatiale et globale, aprés l’échec de la planifica-
lion, vise a leur montrer que finalement une action
‘concrete va étre menée pour leur ville. Le but du maire
“apparait done clair : Sassurer d’abord un électorat.
2. La valeur économique et financidre. ~ Elle est
lige & Vidée de ville comme produit & commercialiser
[Ch Devils, Le projet arbei, Pais, Ba dy Pavillon de
Anal, 1
16
et sinscrit dans la démarche concurrentielle de villes
rivales qui cherchent a s'affirmer. Différentes initiati-
ves peuvent alors étre lancées (parfois sous le nom de
« projets urbains ») pour en valoriscr certains aspects,
le but étant de capter un eertain nombre de visiteurs,
de touristes ou de nouveaux actifs. Cette démarche se
réfere aussi a logique du « montage » des opéea-
tions durbanisme, dont Tquiibre financier est ts
base et In condition indispensable de_réalisation,
Vaménageur public effectue les études de faisabilité
technique et financiére gui doivent montrer d'une part
«que Popération envisage tient la route, autrement dit
qu'il y-a un marché preneur, done une demande, et
autre part qu'il y a les moyens techniques (et juri-
diques) pour préparer, réaliser et gérer operation, ce
ui fait ire a Philippe Genesticr! que le projet urbain
est « une démarche opérationnelle ayant pour objet kt
ville qui répond @ une logique de marché ». Cette cri
tique ne porte pas tant sur les « projets urbains »
en eux-mémes, mais sur la maniére dont ils sont
conduits. Le projet urbain résulte donc d'une série
@actions qui stenchainent comme dans un méeanisme
dont la premiére étape consiste& tester Ia capacité du
« produit-projet » a slinsérer dans le marché. Cette
approche est nécessairement partielle, car elle tient
‘compe principalement : de Pattrativité pour les pro-
‘moteurs et les commergants, due la valorisation fon-
igre et immobilitre des licux concernés par le projet,
et d'une demande « solvable », autrement dit dela ea.
pacité de Fusager futur a payer les services offerts. La
négociation a laquelle on se référe toujours comme &
tun moment de democratic et d’échange se déroulerait
centre deux catégories principales : les entrepreneurs et
1. Ph. Genesies, Que veut ln notion de. projet urbin ia
LeAveitconre Pano, W288, spterbee 1983.
7
les « riches ». Cellesci représenteraient, pour les amé-
nageurs, les groupes sociaux « fortement. Kgitimes
conformément aux impératifs propres des acteurs soi-
‘ables, Cesta-dire ceux qui ont les moyens d'imposer
leurs intéréts dans la négoviation initiale et dans les
renégociations permanentes »!. Le statut de Pusager,
sclon cette approche, est tansformé en celul de
‘client » ou de « codécideur >, révélant que le projet
Urbain reléve complétement d'une « idéologie pragma-
tigue contextualiste (ibérale)» qui vise-prinipale-
‘ment la valorsation économique. Cette approche, trés
critique et un peu réductrice, ne tient pas compte des
efforts récents des aménageurs publics qui mansfestent
tune plus grande ouverture a aspect social, princ-
palement 4 cause de la montée du chémage et de
Finsécurité de certains quartirs qui se vident progres-
sivement
3. La valeur architecturale et urbanistique. - Les
architectes revendiquent la notion de projet urbain &
Iaguelle ils attribuent essentiellement une dimension
spatiale, Ths associent souvent 4 cette notion celle
de forme urbaine: le projet urbain serait un outil
‘organisation de la forme urbaine par Vimposition de
régles d’ordonnancement spatiales bien détinies. Le
projet urbain, en somme, tournerait autour d'une pro-
blématique : Particulation de formes et de normes. Les
publications écrites des architectes sur ce théme sont
rares, mais dans la plupart de leurs déclarations appa-
rail cette approche sectorielle du projet urbain qui est
encore lige 4 une tradition dans laquelle Parchitecte
«décidait » de la forme urbaine dun quartiet. Les
ouvrages consterés au projet urbain?, pas trés nom-
1. Bit
2 Ph. Panemi, ©, Mangin, Projet whuin, Marie, Parties,
1990 Bina, Prot wun $70, 199, pout en er ques
18
brews en rélite, montent un intértessenteiement &
Pégard ‘de son’ apect formel (analyses morpholo=
sey feo)
Cetie approcte, un pew déalée par rapport & le
situation ‘actuelle mangue aussi gn reel eitique
‘sev des modcs opertoites actuels en matire de
Création des expaoes ‘urbains, modes qui tndent &
marginaiser de plus en plus intervention de Tarchi
teole Les raisons de oe cimutisme crtuque des archi
tects frangais» sont expliquees par Jacques, Lucan
{an des raves archtecteverigues de architecture en
France)': @nbord, ies architects sont obligs de se
plier au systéme de la commande qui set developpe
fea demniéres années A travers une pénéralisation des
concours qui leur inferdisait tacitement de etquet
Teursconfrtres, Le syteme comporatise des archer
tes exten effet encore en vigueur! i Sapit Cun mi
lew ferme. qui entetient Je raes telatons ayes Te
miliew universitaire, par exemple, De-ce fai 0
trouve tres peu arhitects qu souhaitent sexpr
ter en publ pour manfeste leur point de ue sur
Iss questions Gaménagement ct architecture. Ce
Gqi expigue Je mangue de itteature en ce sons. I
ois coe fase gus ox marge Ue hora
opératoite>, selon Texpression de B. Huet, ext lie
Stasi au manque outs d'analysepour eectuer
cette mnie enique d fait que Tareitecte rest plus
Ie chet dorcheste de ces operations, mais un supple
rallon de la chaine de production de espace, Ine
pet done pas developper une reflexion global sur
projet urbain en tant que, processus” Dans oes
conditions, i kext dificie @asramer une position
thiorique elaire, On peut remarquer toutfoi soem
1. J, Lacan, Jusqfod eacerber ndvideslome des architects
in Le Vater 2 118,
ment des approches théoriques nouvelles et plus ou-
vertes de In part de certains architectes-urbanistes.
Parmi ceux-ci, Christian Devillers, Grand Prix
‘'Urbanisme 1998 et auteur d'un petit ouvrage, Le
projet urbain, dans lequel il le définit comme « une
démarche ayant pour but de rendre espace a
Pusige », démarche gui implique « une multiplicité
acteurs gui ne peuvent pas étre maitrisés par une
seule pensée ». Aspects sociaux et aspects spatiaux
sont alors également importants, gestion et eréativite
doivent coexister. C'est une approche qui dépasse les
oppositions classiques : entre Turbanisme entendu
comme gestion urbaine et Parchitecture considérée
‘comme tne production artistique ; entre les spécialis-
tes des sciences sociales, qui pensent espace comme
Sil était déterminé par les usages et les architectes,
‘qui pensent a une société type a situer dans un es-
pace préconstitué en tenant compte des contraintes
environnement
Conclusion
La notion de projet urbain a une portée global
Dans la mesure oii elle ne détermine pas de schémas
striets, mais s‘inscrit plutét dans une finalité plus
large, économique, sociale, culturelle et dans un
concours de compltences, elle peut alors se diviser
‘entre une perspective générale conomico-sociale~
caulturelle et les choix spatiaux : organisation de la
frame, des espaces publics, du paysage en relation
avec la ville existante, édification ct affectation des bi
timents. La notion de projet urbain renvoie aussi 2
une multiplicité de techniques, parce quill se rapporte
4 plusieurs competences d'aménagement, de construc-
tion, d'écologie. Cette multiplcité de techniques n'a
de sens que si elle a une Iégitimation globale (dans la
20
conception méme des choses et dans les mayens
articuler toutes ces techniques) de nature politique.
Le projet urbain renvoie done i une notion globale : i
Sidentifie avee un ensemble d’actions inserites dans Ta
durée et Légitimées par le pouvoir politique!
1. P, tnguling, M. Rosesyols, Projet urbn, in Ditonae de
arbi pp BHP
Chapitte T
Les ECHELLES
DU PROJET URBAIN
1. ~ Projet urbain et planificat
Nous avons déja vu que la notion de projet urbain
est désormais largement employée en planification od
elle tend a se substituer a la notion de plan, La ques-
tion de échelle du projet urbain renvoie done directe-
ment a celle de la planification. Autrement dit, pour
savoir a quelle échelle de départ se situe le projet ur-
bain (et & quelles autres il renvoie), il fauda savoir &
‘quel niveau les politiques d’aménagement des espaces
urbains sont décidées, La remise en cause du territoire
communal en tant qu’échelle de définition et de mise
fen euvre des politiques urbaines date depuis long-
temps. La loi du 14 mai 1932, qui prescrivait pour les
656 communes de la Région parisienne un unique pro-
jet P'aménagement, est un exemple de la tentative
'elargissement de ia planification au-deld du cadre
‘communal. Pourtant, cest au niveau de la commune
qu’ont été décentralisées les compétences en matiére
pour Ie
long terme,
A) Gestion privée et gestion urbaine. ~ La gestion
urbaine hirite des méthodes et des techniques de Ia
gestion privée qui ont subi une double transfor
mation :
~ on passe d'une vision quantitative a une vision qua-
litative du management afin de s'adapter aux turbu-
lences eroissantes de environnement, ce qui a pour
conséquence de remplacer le eyele classique de la
planification et du contréle de gestion par la dé-
marche. stratégique «dominée “par li poursuite
une ambition globale et sous-tendue par Pair-
mation d'une identité forte»! ;
— om assiste & un progressif développement des dé-
marches partenariales entre concurrents
Ces mémes. principes, appliqués a la gestion ur-
baine, conduisent a deux ordres de considérations
~ La nécessité dintroduire une certaine souplesse
dans la maniére dont on concevait la planification
afin de adapter aux aléas des situations et a la diver-
sité de la demande sociale : Ia notion de projet strat&
sique s'y préte bien, Le terme de « projet », en effet,
|, d, Boulos, B, Beonils, Le geton angen der wi, Pass
‘A alin 99593. Bounot” La fle compan Pas, Bemore
22,
2
permet d'intégrer les idées de flexiblité dans la pro-
grammation, tandis que celui_de «plan» revét en
droit de Turbanisme une signification plus précise et
déterminge a priori, Ce projet doit obéir & une stra-
tégie de développement économique et social fondée
sur la reconnaissance de Pidentité d'une ville, le earac-
tere distinctif d'une ville devenant un facteur détermi=
nant dans la compétition pour attier les entreprises
sur son terrtoire, Le projet stratégique sous-tend donc
tune logique concurrentielle entre viles essayant de mon-
ter leur spécifcité
= La nécessité de réussir une planification cohé-
rente d une échelle plus large que eelle de la commune.
Lintérét de la démarche stratégique est, en effet, dans
son aspect global, Cela conduit & reconnattre que
échelle de la commune n'est plus satisfaisante, mais il
faut chercher le partenariat entre communes qui par~
tagent les mémes intéréts économiques. Ainsi, fa plan
fication stratégique implique te dépassement des. logi-
‘ques locales et largissement de Véchelle d prendre en
compte a celle de Fagglomération (ow d'ensemble de
villes plus ow moins étendu).
2B) Une logique supracommnnale nécesaire mats dif
‘iil & conor avge ler Togiqus locates. ~ Ces deux
Considerations soutevent une contradiction evidente
entre dune part Ia seessie de 2vslopper une dyna:
migue conctrrentele entre vies vale et d'antre
part la volonté d’effectuer une planification a échelle
Supntcommale asociant les memes ves, Cea rete
toujours an poi tres dlc cr les maires qu adop-
tent la méthode de ia panlicaion stratépque, en
Fabsenoe. dune pottique itercommunal, se basent
fur lor intértts leur comme, me posta ph (Ot
jour attention any communes yoisines, Leu vision
Feste souvent limites, Be pis ss ont d&vcloppe tne
2%
approche concurrentielle ils n'ont, pas intérét A « dé
voller» d'avance leur stratégie. L’individualisme des
communes et la difficulté & mettre en place des straté-
gies de développement communes constituent encore
un frein dla mise en euvre d'une démarche de planifi-
cation a ’échelle supracommunale.
Pourtant, les problémes de la ville ne se situent plus
uniquement 4 T'échelle de Ia commune, Transports,
habitat, développement économique, services se dé
ploient'a une échelle plus vaste qui coincide avec celle
de agglomération. Il faut done penser leur program-
mation a cette échelle. Le probléme de intercommu-
nalité en milieu urbain se pose et se présente comme
tun passage obligé pour garantir une cohérence dans
établissement des. politiques sectorielles et dans Ia
mise au point de stratégies communes,
©) La démarche « projet d'entreprise». ~ La d&-
marche « projet d'entreprise» constitu le premier des
‘maillons » du systtme autour duguel les organisa-
tions fnalisent leur aetion, et consiste dans Ia form
lation d'une «ambition globale de. long. terme »'
Ensuite, ilsagit de raduire le projet d'entreprise dans
des orientations (ou axes) stratéziques, de fixer des
objeetifs pour chacune des oricatations et enfin de
defini les politiques & mener afin de réaliser ces objec-
lis (« pobtiques sectoielles»). Le couple objectifs
politiques, qui occupait une piace centrale dans le
yele classique de la planification, est remplace par le
couple « ambition-options stratégiques ». La caracté-
Hstigue principale de cette démarche est sa soupesse
agrice a laquelle les entreprises ont pu répondre aux
aléas et aux incertitudes dus & la « volatlité » du mar-
chs. Elle se fonde aussi sur la notion d” « identité », en
1.4. Bovinot, B, Berm, op. et
a
tat que caractéristique spécifique d'une entreprise
qui la rend aussi competitive. Le recours a cette dé-
marche projet d'entreprise s'effectue particulitrement
dams des situations de crise. C'est dans ee cas que les
entreprises font un bilan global (diagnostic) de leur si-
‘wsttion et sont aussi obligées de repenser leur « patri-
tpoine de valeurs acquises », afin de les faire évoluer si
nécessaire. L’examen de Ia situation suit un certain
‘eschéma » de routine qui leur permet d'envisager les
risques éventuels sous forme d’autant de « menaces »
tettant en danger leur survie. Ces risques peuvent
aire de différente nature, mais ils peuvent aussi porter
st la possibilité de perte de leur « identité » a la suite,
par exemple, d'une opération de fusion.
D) De Fentreprise la ville. ~ L’application de cette
démarche & la ville correspond ala volonté des maires
dattirer sur leur territoire les entreprises. La mobilité
(roissante dont elles bénéficient, favorisée par la rela
tive liberté de mouvement au-dela des frontitres, a
‘exacerbé en partie les rivalités urbaines qui n'ont cer
tainement pas fléchi du fait de lélaboration de PActe
‘unique européen « portant création dun grand mar-
che Unifig entre les membres de TUnion européenne, &
Js SUlte encore de la création d'un espace économique
‘eufopéen (EEE) entre l'Europe communautaire et des
pays, fiers de TAELE »!. Ces mobilités des entreprises
font &té élargies & T'échelle mondiale suite aux aceords
Gu GATT (aujourd’hui omc), ce qui place Ia compéti
gon entre villes largement au-dela des frontiéres 1a-
tonales. L’enjeu principal des villes est @augmenter
tur potentiel fiscal par le biais de Ia taxe profession-
jelle (premidre ressource des collectivités), ce qui leur
1 ie
permet de se développer. Ainsi, es villes ont recours &
des consultants en « marketing» les aidant & expliciter
fLamettre en valeur leur « identité » en tant que « ca-
factére distinctif » par rapport aux autres ville consic
Uérées comme ivales, Hintéret principal pour elles
Giant dese placer a Péchelle aussi bien nationale
quintemationale. La démarche du diagnostic global
stictuée pour les entreprises en erise est adaptée & la
ville Elle est suivie de la cémarche prospective qui
cssaye d'anticiper Tavenir de la vile Sur la base des
tendances dégagies par le diagnostic.
E) « Projet de ville » «projet wbain » et « projet
Anairie» Tes eleftnitionsw techniques » d'me logigue.
Usilsée d"abord en alternance avec Vexpression « pro-
jet urbain », Mexpression «projet de ville» Pa demnis-
ement remplacee dans le langage des mares. Cola
Sexplique, peut-étre, par Texigence pour un maire
Gaificher ia volonté de mettre en place la construction
Pun projes collecf pour sa vile un projet souple et
Soumis a-des étapes continuelles de validation par la
population. En ee sens, Pexpression « projet de ville»
Est beaucoup plus parlante pour les habitants que
celle de « projet urbain ». D'autant plus que le mot
‘Cull est valovisé par rapport aux formes usbani-
sation qui ont entrainé la fragmentation du teritore.
Ans, un grand nombre de villes petites et moyennes,
sieuses d'émerger sur Ie plan national etiow inter:
‘ational ou d'uffimer leur role au sein d'une agglo-
mération, ont cu recours & ce concept. En réalié,
expression « projet de ville» a éte introduite en pax
nification par’ les consultants en marketing et les
et le « projet mairie ». $i Ton fait effort détablir un
langage precis, ces trois projets sont censés représenter
>
la triple réalitg d'une ville: tervitoire socio-écono-
mique, espace constfuit et structure institutionnelle.
Ensemble, ils devraient se référer & Méchelle supra.
communale, notamment celle de Vagglomération, en
permettant la définition du projet stratégique ds cette
Echelle. Nous appellerons ce projet stratégique, qui se
‘veut global au sens ov il tient compte de différents ay.
pects (économiques, sociaux, spatiaux), « projet ur-
bain global » (« projet de ville », « projet urbain » et
«projet mairie » éant ses eomposantes)..
1) Le «projet de ville». Le « projet de ville» ext
appelé aussi «plan stratégique » par référence & Pun
Ges. premiers. plans de ce type, celui de « Barce-
one 2000 ».
Il présente deux eatactéristiques principales :
— son caractére flexible, qui pousse a T'incitation, par
Opposition au plan d'urbanisme réglementaire,
rigide ;
son aspect de participation ouverte aux acteurs pu-
blics et privés, contrairement au plan d’urbanisme,
labors exclusiventent par des acteurs publics.
Liexpérience de Barcelone a permis de retenit en
tout prem Fe Ia ners de Imende en compte
les aspects socio-Sconomiques (« ambition » ), préa-
Tablement aux enoix SPaUaux (aisations des Sol)
Le « projet de ville » doit done se situer en amont de
tous les choix spatiaux et il doit porter sur la fini.
tion d'une ambition socio-
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- 06 - La Conférence D'athènes Sur La Conservation Des Monuments D'art Et D'histoire (1931)Document10 pages06 - La Conférence D'athènes Sur La Conservation Des Monuments D'art Et D'histoire (1931)Polarr BearrNo ratings yet
- 09 UnescoDocument9 pages09 UnescoPolarr BearrNo ratings yet
- Etude Des Instruments D'amenagement Urbain EntreDocument76 pagesEtude Des Instruments D'amenagement Urbain EntrePolarr BearrNo ratings yet
- Pdau ModelDocument1 pagePdau ModelPolarr BearrNo ratings yet