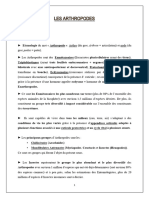Professional Documents
Culture Documents
gf5 3 1998
gf5 3 1998
Uploaded by
Wijdene Sassi0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views14 pagesOriginal Title
gf5-3-1998
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views14 pagesgf5 3 1998
gf5 3 1998
Uploaded by
Wijdene SassiCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 14
Vile de Moorea (Société) :
édification rapide
d’un volcan-bouclier polynésien
Alain LE DEZ ()
René C. MAURY (1
Hervé GUILLOU @
Joseph COTTEN
Sylvain BLAIS @
Gérard GUILLE
Moorea (Society Islands): rapid build-up of a Polynesian shield volcano
Géologie de la France, n? 3, 1998, pp. 51-4, 8 fig, I tabl
Mots-clés ; Volean-bouclir, Caldera, Série aaline, GEochronologie K-Ar, Polynésiefranaise
Key words: Shield voleano, Caldera, Alkali baal soros, K-Ar Gaochtonology, French Polynesia
Resume
Moorea (ites du Vent) est une ile de
forme subtriangulaire qui représente le
‘sommet d'un volcan-bouctier basatsique
alcalin (volcan de Tohiea, culminant &
1207 m), fortement disséqué par 'éro-
sion, Ce volean est affeeté par un grand
effondrement caldeirique hémicirculaie,
isolant fe mont Roti qui représente un
pan du flane nord de I'édifice. Son acti
vite est datée de 1,/2 a 1,91 Ma
Immédiatement aprés ta formation de la
grande dépression caldetrique, qut a da
éire trés rapide (dans la marge d'erreur
des datations K-Ar), se mettent en place
trois massifs : le massif de Papetoai au
nord ow
tiques, dont Uactivité est datée de 1,53 a
1.47 Ma
Paveo et de Paopao (1,52 Ma), caractér
sés par des épanchements basaltiques.
Engin, Vactvité magmatique prend fin par
a mise en place de Vintrusion trachstique
de Paopao datée é 1,36 Ma, L’abondance
des laves intermédiaires (mugéarites et
benmoréites) dans la série alcaline de
Moorea est due au
fiques qui sont intervenus fors de la réin-
Jeetion de magmas basaltiques dans le
réservoir sous-jacent a I'éifice.
t eonetitud de laves benmordi
Jee massife de la pointe de
mélanges magma-
Abridged English version
Moorea (Society Islands) is a roughly
triangular shaped island (16 km long and
12 kim wide) which represents the summit
of an eroded alkali-basaltie shield vol:
cano (Fig. 1). It lies on 4000m-deep
Pacific oceanic crust of Maastrichtian
‘age and reaches an elevation of 1207 m
‘above sea level at Mt, Lokiea. The mor-
phological particularity of the island lies
in the presence of a sharp peak
(Mt Rotui) close to the centre of the cal-
dora (Fig. 2). The Moores volcanic suite
ranges from predominant alkali basale to
nackyphonolite (ith a single sample of
quartz-normative trachyte) through
hawaiite and very abundant mugearite
and benmoreite (Fig. 3 and Table I).
Geology and chronology
The Mt. Tohiea shield voleano, which
was built-up between 1.72 and 1.51 Ma, is
made up of five units shas, by ardor of
emplacement, are: (i) the Afareaiatu
lahar breccias. (ii) the Belvédere zeoli-
tized basaltic flows, (ii) a thick pile of
composite basaltic lava flows belonging
1 the Mouaputa Formation, which makes
up most of the Tohiea shield, (Iv) the
Me. Rotui benmoreite units, and finally (v)
the uppermost Tohiea columnar-jointed
basaltic flows, which were emplaced
within depressions on the flanks of the
main shield.
The northern part of the shield col-
lapsed immediately atthe end ofthe building
stage, leaving an isolated remnant form-
ing Mi. Rotui (Fig. 4). We interpret this
event as @ gravity collapse involving a
décollement ofthe northern shield units at
the level of the lahar breceias (Fig. 5a)
This décollement was possibly triggered
by the intrusion of numerous sills and
dykes below the future caldera floor
(Fig. 5b). Three massifs were emplaced
along the caldera rim immediately afier
the collapse event: the Pavpao (1.52 Ma)
and Paveo Point basaltic voleanoes and
the more complex Papstoai massif
(1.53 10 1.47 Ma) made up of benmoreite
and trackyphonolite. Voleanie activity in
Moorea ended 1.36 Ma ago witk the
intrusion of the Paopao trachyte,
Petrology
The dominant rock type on Moorea is
«an alkali basalt characterized by consider
able enrichment In the most incompat-
ible elements (Fig. 6) and fractionation
(1) UMR N° 6538, « Domaines Oeéaniques », Université de Bretagne Occidentale, BP 809, 20285 Brest E-mail: maury@univ best fe
(2) Laboratoire des Sciences, du Clima etd Environement, Unité mite CEAICNI
=, 35042 Rennes Cade,
(4) CEA DASE, Laboratoire de Detection et de Geophysique, BP 12, 91680 Brayéresl-Chite
12, Domaine dy CNRS, 91198 Gifsur¥ vet
GEOLOGIE DE LA FRANCE,N'3, 1998 st
ILE 0c MOOREA (SOCIETE) : EDIFICATION RAPIOC D'UN VOLCAN-BOUCLICR POLYNESIEN
of light rare earth elements (LREE) with
respect to heavy rare earth elements
(REE), indicative of the occurrence of
residual garnet’ in the source.
Intermediate wd evutved lavas are cha
acterized hy increasing concentrations of
the most incompatible trace elements
together with selective depletions in Ba,
Sr, P and Ti with respect to basalts
(Fig. 6). These features are consistent
with a fractional erystallization process
involving separation of five, elnops
rovene, enleie plagioclase. Fe-Ti oxides.
apatite and finally anorthoctase. Cryst
fractionation accounts for most of the
progressive increases in incompatible ele-
iments (Fig, 7), but some mugearites and
brenmoreites that are abnormally vich in
transition elements (eg. Cr, Fig. 7) ds-
play testural evidence for magma mixing
they contain maf alas globules together
with numerous xenocryss of basaltic or
gin (Mgerich olivine, Cr-bearing spinel
dnd diopside). The particularly high
abundance of termediate lavas (mugear-
ite and benmoreite)n the Moorea atkat
Fasalt suite is likely due to magma mixing
events whieh followed me reftting of the
upper reservoir, at frst containing tra-
Chyphonaliie magnus, hy wring sale
sic magmas (Fig. 8).
Introduction
Lalignement de la Société (fig. 1) qui
s'étend sur prés de 700 km, eat constitue
par les iles dur Vent au sud-est (Mehetia,
Tahiti, Moorea, Maiao, Tetiaroa) et lee
sous le Vent au nord-ouest (Huahine,
Raiatea, Taha, Bora Bors, Maupiti
‘Tupai, Mopelia, Scilly, Bellinghausen). 1
a une direction générale N110-120°F,
paralléle au vecteur local de déplacement
de la plaque Pacifique. II présente les
caractéristiques majeures d’une ehaine
volcanique de point chaud. Ainsi, on note
une évolution morphologique, des vol-
ceans-boueliers presque totalement immer-
‘26s de la zone surmontant le point chaud
(Mehetia) aux énormes boucliers encore
peu érodés de Tahiti Nui et de Taiarapu
(Tahiti i), puis @ des voleans-bouctiers
disséqués par érosion (Moorea, Huahine,
Raiatea, Tahaa), a des édifices volca~
iques residuels enserres dans un vaste
Jagon (Bora Bora, Maupiti), et enfin a des
atolls (Tupal, Bellinghausen, Mopelia,
Scilly). Ces variations de morphologie
‘out corrélées aux ages des voleans , ht
52
vitesse moyenne de derive de Ia plaque
Pacifique, 11,1 em/an au niveau de la
Société, est conforme aux variations des
‘ges en fonction des distances au point
‘chau (Guillow e¢ ad, 1998),
Toutes les laves de Ia Sovieté sont de
type alcalin (basaltes alealins, hawaiites,
mugéatites, benmoréites, tachytes et tra-
chyphonolites). Les évolutions géochi-
‘miques temporelles, du stade bouelier au
stade post-bouclier, se caractérisent par
une diminution de la contribution du com-
posant enrichi EMIT au profit d'un man-
teau appauvri d'origine profonde (Cheng
et al, 1993 ; Duncan et al, 1994 ; White
et Duncan, 1996). Les iles de Moorea et
Ratatea se distinguent des autres par la
présence de volumes exceptionnels de tra-
cchytes et benmoréites (Blanchard, 1978 ;
Bellon et Blanchard, 1981 ; Blanchard er
dal, 1981 ; Blais etal, 1997).
Discenerte ainsi qe Tahiti par Wallis,
le 19 juin 1767, Moorea est une ile de
forme triangulaire aux dimensions
modestes (16 x 12 km pour 136 km? de
superficie environ) eélébre pour ses
falaises verticales qui culminent au mont
Tohiea (1207 m) et découpent les zones
sommitaes de Mile en pitons inaccessible,
La vue cavaliére de Iile permet d’indivi-
dualiser différents ensembles morpho-
structuraux (fig. 2)
+ le volcan-bouclier de Tohiew forme
ile, 11 est affecté aw nord
Messentiel de I
pat un effondrement caldeirique en forme
fe cxoissant, limité est par Ia aie de
Paopao (dite aussi baie de Cook) et a
ouest par le massif de Papetoai
- le mont Rotui (899 m) est un relief
sole separant les baies de Paopao et
'Opunobu ;
- Ie nord-ovest de Pile est formé par le
massif de Papetoai, caractérisé par un
ensemble de erétes ramifiges dégagées par
erosion
- le plancher de fa caldeira constitue la
seule cone plane de Mile, prupice aun cule
tures eta Pélevage ;
~ enfin le récif-barriére, interrompu
par quelques passes, délimite un étroit
Jagon qui le sépare de la zone cdtiére &
forte densité d'habitation.
Les surfaces planes sont trés rares Sur
Pile & exception dune petite plaice
‘nes dissequee situee entre 300 et /00 m
altitude au nord-est du Tohiea, La prin-
cipale ligne de crete est formée par le mur
de la caldeira, coupé de rares échancrures
(vols de Vaiate et des Truis Cocoticss),
Les basses pentes sont souvent encom=
bbréss de blocs de basalte provenant des
tres nombreux pitons (Mouaputa, Tama-
rutoofa, Mouaroa, Mouapu, Tastuapac)
qui contribuent a la célébrité touristique
de Vile,
Geologie des formations
volcaniques de Moorea
Travaux antérieurs
Les travaux de H. Williams (1933) ont
mis en évidence le earactéesingulir de la
‘morphologie du volean de Moorea. Selon
cet auteur, prés un ters de In partie nord
de le auraitbasculé sous lamer suite an
rojeu une faille normale de direction
[N80°E, G, Deneufbourg (1968) réalise la
premitre canographie de Ile 41/40 000,
qui met en évidence les unités géologiques
joues. Les Gules ullticues se Foali-
sent principalement sur la géochronologic,
aves les travaux de D. Krummenacher et
J. Noetzlin (1966) (cing datations K-Ar
‘entre 2,6 et 1.2 Ma, puie de J, Dymond
(1975) (22 datations K-Ar entre 2,12 et
1,58 Ma) et RA. Dunean et 1. McDougall
(1976) (dix dataions K-Arallant de 1,68 &
1,53 Ma) et enfin ceux de H Rellon et
F. Blanchard (1981), précisés par
C. Ditaison (1991) et C. Diraison et al
(1991) (neuf datations K-Ar comprises
centre 2.18 et 1.61 Ma.
F. Blanchard (1978), puis H. Bellon et
Blanchard (1981) et F. Blanchard er al
(1981) réalisent la premigre étude
derallée de Ile, alliant cartographic &
1/40 000, géochronologie, pétrologie et
séochimic.
Ces travany ahoutissent anny camel
sions suivantes
1) la morphologic de Moorea résulte
de Weffondrement de la partie nord de
File sous la mer, diiau jeu dune faille
normale de direction est-ouest. Cet épi-
sode conduit ata preservation d'un dem
volean a caldeira centrale, comportant en
son centre un massif intra-caldeira tres
érodé, le mont Rotui, bordé par deux fos-
és, les buies Ue Paopay et e’Opunvliu
GEOLOGIE DE LA FRANCE, N° 3, 1998
VILE DE MOOREA (SOCIETE) : EDIFICATION RAPIDE D'UN VOLCAN-BOUCLIER POLYNESIEN
GEOLOGIE DE LA FRANCE, N° 3, 19950 =
LILE DE MOOREA (SOCIETE) : EDIFICATION RAPIDE D'UN VOLCAN-BOUCLIER POLYNESIEN
utés morpostruturaes(égende voir ig. 1).
Fig, 2- Sheth view of Moorea showing the main
mmorphostrctural unt (legend refer fig 1.
2) Vile de Moorea comporte deux
lignées distinetes de laves emises simulta
nément lors des deux stades successifs de
edification du volcan : une part un
‘groupe de basaltes et hawaiites ; d'avtre
part, des laves intermédiaires et évoluées
{mugéarites, benmorétes et trachyphono-
lites), anormaloment abondantes et riches
cen xénocristaux d'origine mantllique. Un
movie de fision feactionnée dy mantean
est proposé pour expliquer la coexistence
des deux groupes. Suivant ce modéle, le
‘manteau subit en premier lieu une fusion
sgénérant des liquides basaltiques. Par la
suite, le manteau résiduel & partir duquel
ont 68 extraits les liquides basaltiques
subit un nouvel épisode de fusion, & des
taux considérablement plus faibles, don-
nant naissance aux mugeantes. Les deux
lignées magmatiques ainsi formées évo-
Juent ensuite par différenciation a basse
pression, les basaltes vers les hawaiites et
es mugéartes vers les benmoréites et tra
chyphonolites
Les travaux de W.H. White et
R.A. Duncan (1996) sur Ia géochimie
(Gléments en traces et isotopes radiogé-
niques) des voleans de la Société démon-
trent le caractére hétérogene de la source
des laves de Moorea. Les differences de
signature mantellique enregistrees resul-
tent de la contribution variable, au cours
du temps, de deux poles imantelliques
EMIT au stade bouclier, tandis que Ie
stade post-bouclicr est caractérisé par
emission de laves ayant une signature
inotopique reflétant wn manteau profond
variablement appelé « C », « PHEM » ou
encore « FOZO » (Farley et al. 1992
Hanan ct Graham, 1994 ; Hart er al.
54
2 Vue cavaliée de Moorea montane les principales
1992). En particulier, ces travaux indi-
quent pour Moorea que les basaltes, les
aves de composition intermédiaire
(anugearites) et évoluges (trachyphono-
lites) présentent des signatures isoto-
piques t28s contrastées, impliquant des
sources mantelliques différentes.
Le substratum de I'lle
Liile de Moorea repose sur un plan-
cher oosanique
Ja profondeur avoisine 4000 m (Duncan et
MeDougall, 1976). La partie immergée de
edifice posséde une morphologic d'en-
semble simple, conique. avec des flanes
dont la pente varie entre 15 et 20°. En
dépit de labsence de données bathymé-
ttiques récentes, cette régularité rend pew
probable Phypothése suivant laquelle ta
moitié nord de ile aurait dispara sous la
mer a la suite d'un effondrement majeur
(Blanchard, 1978).
.e Maastrichin, dont
Nature des laves de Moorea
Les roches volcaniques de Moorea
varient en composition depuis des
basaltes alealins usqu’a des trachyphono-
lites et trachytes quartziféres (tabl. 1),
L’ensemble des laves se caractérise par
une signature alcaline franche, Des
Drasales aux tuclyplonolites, Meusemble
des échantillons se distribue dans un dia-
‘gramme alealins-siliee (fig. 3) sclon une
tendance cohérente, compatible en pre-
mite approximation avee leur apparte-
nance i une méme série magmatique,
laves intermédiaires (mugéarites et ben-
‘moréites) sont beaucoup plus abondantes
BY
LA LSU
t 5
~~ ZK eee
que dans les autres fles de la Société, a
exception de Kaiatea,
Les unités pré-caldetra
+ Los briches Iahariques d”Afareaitu
(br,) représentent la plus vieille unite
reeannne sur Pile Ce sont des dépits
polygéniques, non stratifigs, & blocs basal
tigues de texture variée, plus ou moins
arrondis, et matrice brunatre, qui se p
sentent en passées de puissance métrique &
décamétrique, et montrent frequemment
des figures de remplissage de chenaux
creusés au sommet des niveaux sous-
Jacents, Les bréches lahariques alternent
Tocalement avec quelques mveaux pyto-
clastiques stromboliens de nature basal-
tique, et sont recoupées par de nombreux
dykes et sills, On note aussi la présence de
raies coulkes basaltiques sousejacentes aux
bréches (Afareaitu), ou intercalées au sein
de celles ei (col de Vaiare.
La puissance de cette formation reste
difficile a estimer car sa base n'a pas &é
observée, Cependant, ses affleurements
discontinus indiquent qu'elle peut atteindre
deux cents & deux cent cinquante metres
Ce type de bréche volcanoctastique existe
aussi sur Vile voisine de Tahiti (Brousse er
at, 1985). Sa présence Indique un episode
de remaniement d'un édifice émengé anté-
scat & la fouation des partes afMleurantes
des empilements de coulées du bouclier de
‘Tohiea, Les premiéres phases de Mhistoire
g6ologique de la partie émergée de Vile
demeurent done inconmes
cexclure Phypothése d'une évolution beau-
coup plus longue que celle enregistrée par
les unités actuellement affleurantes
‘on ne peut
GEOLOGIE DE LA FRANCE, N” 3, 1998
LILE DE MOOREA (SOCIETE) : EDIFICATION RAPIDE D'UN VOLCAN-BOUCLIER POLYNESIEN
+ Tos conlées hacatiques zéaliisées
du Belvédre (0%) ont été observes dans
trois secturs dela bordure sud de la cal-
dina +a col des Trois Cocotiers (3 est
«du Mouaroa) ; au col de Vaiare; et enfin
auedessus di Beliédie oi elle a &¢
nic. II s'agit de coulées massives, de puis-
sance melrique & plurimétrique, parfois
spares par des niveaux de bréchesauto-
sigs. les sont nudes par de nom-
broux sis et dykes. La caractéristique
ijeure de ces cules ext be présence de
nombreuses vacuoles pouvant attendse
tne taille eemimétigus, tapisatea de 250
lites. Ce sont des laves peu differences,
souvent tris riches en olivine, variant en
composition de basalts des havaites
Les coulées zéolitisées constituent
ensemble effusif le plus ancien daté sur
Moorea (1,72 Ma ; MO 3a), Leur mise en
place correspond a une intensification de
activité voleanique effusive au début de
Pédification de I'empilement de coulées
‘du bouclier de Tohiea. Leur zéolitisation
est probablement lige i la circulation
intense de fluides: dans les plane de faille
délimitant la caldeira,
+ Les coulées basaltiques vacuoles
du bouclier (formation du Mouaputa)
(C83), qui constituent Messentiol de edi
fice de Tohica sont des coulées fides
aeniennes de type composite, vacuole
@ surface pahoehoe. On note aussi la pré-
sence de semeles de
tiques et plus rarement de tubes de lave
pahochoe, comportant des tunnels de dia
mitre généralement décimétrique. Les
épaieseurs des coulées individuelles
varient du meire & la vingtane de metres
11 s'agit de laves peu différenciées
(basaltes et rates hawaites), qui présen-
tent fréquemment des Faciés cumulatifs en
phénocrstaux d’olvine (Foy Fo) et de
clinopyroxéne centimétrique de composi-
tion intermédisire entre diopside et augite
Ces derniers peuvent constituer jusqu’s
{60 70 % du volume dela lave par accu
‘mulation gravitate en base de eoulée
Eclies autvelase
Les coulées basatiques du Mouapata
lve des Ages pas réents que esi dea
formation sous-jacente 8 : 1,55 Ma
(MO 11) 6152 Ma (MO 92), La grinds
regula de la superposition des cules de
ext fmaion, ans re Paha de pale
sols intraks, sugaérent un rythm soutena
des épanchements de avs et une éifcation
rapide da volen-bouclir dy Tobie.
GEOLOGIE DE LA FRANCE, N° 3, 1998
Basaltes
Hawaites
Mugéarites
Benmorertes
Trachyphonolites
Trachyte
Gabbros
Na 9+ Kyo
50
Fig 3 -Digyramme de vation de (Na,0*X,0) en
Fs er su-aieatns (Miyashr, 13}.
Fig. 3 Alkalstiea plot The boundary between
(575,
+ Les coulées benmoréitiques du
Rot (une puissance de deux a wois
métres, alternent avec des niveaux de
brgchesautoclastiques, les ne sont sépa-
18s de la formation sous-acente (1) par
aucun paléorol. La puissance de Pempile-
‘ment lavigue peut ée estimée & un mini-
sum de 150-m, Pérosion ayant probable-
ment fat disparate les coulées sommitales
La disposition en bandes erites et dies
des afMleucements de la formation des cou-
lees de benmoréitesindique que cellesci
ont rempli des paléodépressions, Par la
suite," rosion importante du volean a peo-
‘voqué une inversion des relief, expliquant
en particulier la position somite de oes
‘oulees au mont Kotul
LL'examen microscopigue: des benno
reites met en évidence des caractéistiques
texturales ct minéralogiques anormales,
Ces laves se caractérisent par la présence
de passées plus sombres discontinues ot
de globules de liquides figés, infracenti-
‘métriques, & texture microlitique ou
vitreuse. Elles contiennent également des
xénoeristaux provenant d'un magma
basaltique (spinelles, olivines et clinopy-
55
SiOz
60 65 70 75
fonction de SiO, La courbe spare es champs a
the albaline and subalkaline lls i om SAvashivo
roxénes), montrantclaiement des traces
de désequilbre et enwourés d'auréotes de
réaction caractéristiques de phénoménes
de resorption, L'ge K-Ar de 1,52 Mo
(MO 20) du mont Rotui est identique &
ceux dos couldes basaltiques du Tobiea
(8) dans la limite des incertitudes
(£002 Ma.
+ Les coulées basaltiques prismées
du Tohiea (83) constituent les reliefs
escarpés des sommets de la bordure de fa
caldeira (monts Tohiea, 1207 m et
‘Tamarutoofa, 916 m) ainsi que fa eréte de
le partie nord-est de Vile (monts Paariti,
7AL m ot Tearai, 772 m). It s'agit d’un
cempilement de coulees d’epaisseur deca-
étrique, massives et prismées, avee une
quasi-absenve de niveaus de bideles
interstratifiés, correspondant a d'anciens
comblements de palgovallées dispoases
sur les flancs de Pédifice principal. Parla
suite, cos unités ont subi une inversion de
relief, lige & Maction conjuguée de la for-
‘mation dela caldera et de I’érosion.
Les laves échantillonnées sont exclusi-
vement de nature basaltique, et géochimi-
55
VILE DE MOOREA (SOCIETE) : EDIFICATION RAPIDE D'UN VOLCAN-SOUCLIER POLYNESIEN
{quement arse similares celles de Ta For-
‘mation du Mouaputa. Elles comportent
los phinacristane millimétriques dolivine
‘magnésienne (Fo,,) contenant des inelu-
sions de spinelles chromiféres (Cr,0, = 29
2126 %), des cristaux d’augite et des
microcristaux de bytownite. Leur méso-
tase contient une association d’olivine
(Fog, & Foc) de cristaux de diopside, de
labrador et de titanomagnétite (Usp75 a
Usp78),
Lage K-Ar déterminé pour un basalte
dl cette formation est de 1.51 Ma (MO 37),
dlans la marge d’erreur des plus jeunes ages
mesunés des formations senssjaventes des
ccoulées du Mouaputa et du Roti
Les unites post-caldeira
+ Les coulées henmoréitiques de
Papetoai (F,) ont recouvert et moulé le
mur de la ealdeira du volcan de Tohiea
lors de leur épanchement en direction de
la bate d'Upunohu. Cette unite comprend,
4 sa base, des coulées visqueuses tubu-
laies de 2 & 10 m de diane, qui ales-
nent avee de rares coulées de 2 8 3:m de
puissanee,d semeles de bréches autolas
tiques. Les coulées échantilonnées sont
des bonmortes et quelques rares tachy-
phonolites (ne > 5%). Les benmoréites
sont aphyriques et possédent
trachytique, La mésostase de ees laves se
distingue par une grande richesse en
microlites de sanidine et saniine sodique,
des oxydes de Fe-Ti, quelques clinopy
roxénes et de petites olivines (404m +
Fo,s) xénomomphes. Les trachyphonolits,
different és peu des benmorétes. Elles
possédent une texture trachytique Nuidle.
On note la présence de merocnstaux de
sanidine maclés Carlsbad
1 texture
Les ages K-Ar détermings sont de
1.58 Ma (MO 72) et 1,47 Ma (MO 63). Si
Te premier se situe dans la marge d’erreur
des des des unités du bouelie, le second
cconfirme la formation post-caldeira du
massif de Papetoai, dont les laves ont
vraisemblablement été émises 2 partir des
fractures limitant la zone effondrée
‘’Opunchu.
+ Les coulées benmoréitiques du
Fautuapae (,F,) forment le sommet da
massif do Papctoai (mont Tautuapae,
769m). I s°agit de coulées d°épaisseur
Acamétrique, hion prises, et earactéri-
sées par une extension tr limite.
56
Décrites par F. Blanchard (1978)
comme des basaltes, en raison de leur
richesse en olivine, ces raches sont on fit
des laves de composition hawaitique &
mugéaritique, trés riches en xénocristaux
Caugite déstabilisés et olivine (Fog, 4
Fo,,) contenant des inclusions de spinelle
chromifére (Cr,0, = 30 %). La mise en
place de ces épanchements, datée &
1,53 Ma (MO 117), se situe elle aussi
dans la marge d’erreur des ages de la fin
de Fedihcation du boucler du Totes.
+ Les couldos basaltiques riches on
enclaves de la pointe de
sant dos cones Mtides de type palnehoe,
oii l'on reconnait de nombreux orteils
pahochoe. des passées cordées et des
tubes de lave. Riches en enclaves de
ddunites et de wehrlites & texture de eumu-
Tat, elles constituent un petit massif qui
masque la bordure est de la caldera
L'analyse morphologique de cette région
de Tile met en évidence que les laves de
ce massit ont un pendage plus accentue
30-40") que celles du volcan-bouclier
(10-15 et résuleent done d'épancherents
ultéricurs a Ia formation du volcan du
‘Tohica, Un niveau bien lité de hyaloclas-
tites, compose de fragments de laves
vitrous ot akténés on palagonite, opt inter
stratifié entre deux coulées. 11 comporte
dle nombres: nodules phuricentimétriques
de webrlite et de gabbro (clinopytoxtne,
olivine, plagioclase et oxyde de Fe-Ti)
ainsi que des agerégats centimétriques de
clinopyroxenes et des mégacristaux de
plagioclase
+ Les coulées busaltiques du snaysit
de Paopao (63)
de Cook, sont des coulies dépaisseur
imetrique alternant avec des bréches auto-
clastiques. On observe aussi localement
es bréches stromboliennes (par exemple
au niveau du point coté 203 m)
L’ensemble du massif, recoupé par un
réseau dense de dvkes, repose sur le
plancher de Ia caldeira du volcan du
Tohiea,
Les coulées échantillonnées sur les
anes du cone sont principalesneut dey
hasaltes. L’age de 1,52 Ma déterminé
pour une coulge de basalte (MO 115) est
identique a celui de Ia fin de I’éification
du bouolier, en dépit de la position sus le
plancher de Ia ealdeira de ce céne strom=
holien, qui s'est mis en place en position
plus centrale que les autres épanchements
Similaires des massifs de la pointe de
Paveo (es) et de Papetoai (Fe F).
“+ Le neck trachytique de Paopao (0),
cculminant & 207 m, recoupe les coulées
basaltiques dela formation 1 agit un
‘achyte quartzifore & phénocristaux de bio-
‘ute anclustons dapatite, d'anorthose, de
titanomagnétite (Usp, et d’augite.
Lage de 1,36 Ma (MO 108), déter-
mniné pone ints eonfime sa mise en
place tardive, nettement postérieure a
celle des coulées basaltiques du Massif de
Paopao (8)
Evolution chronologique
Les datations K-Ar nouvelles des
laves de Moorea sont présentéer par
H. Guillow e¢ al. (1998). L'activité
magmatique adrienne de Tile a, selon
ces résultats, eu lieu de 1,72 Ma a
1,36 Ma, Cette fourehette de
0,36 + 0,02 Ma est plus large que celle
de R.A, Duncan et I, MeDougall (1976)
sur un échantillonnage limité et vrai-
semblablement incomplet de Mile (dix
datations K-Ar de 1,68 1,53 Ma),
mais nettement plus restreinte que celle
déterminge par H, Bellon et F. Blan-
chard (1981), puis précisée par
C. Diraison (1991) et C. Diratson et a.
(1991) (neuf datations K-Ar comprises
entre 2,18 et 1,61 Ma). Ces demniers
auteurs ont montré que les dges les plus
ancicus corresponds:
tillons prélevés a la base du mur interne
de la caldcira (comme dans notre
Etude), et ont mesuré un Age relative:
ment ancien 4 la base du mont Rotui
1,79 Ma), qui pose «ailleurs probléme
par rapport Pinterprétation de ce mas-
sif donnée par F. Blanchard (1978).
a des éch
Le bouclier de Tohiea. La construction
de la partie émergée de Tile de Moorea a
ddebute par la formation des breches lana
riques de la série d°Afareaitu, qui témoi-
agnont de existence dun edifice emerge
antérieur dont ge demeure inconnu.
Lage de 1,72 Ma (Mo 3a; ,8}) des eoulées
basaltiques zéoltisées du Belvédére fixe
le début de Mactivité effusive dans la
partie actuellement émergée de Mile. Par
aillou, les autres sults obtenas pour le
volcan de Tohiea, 1,55 Ma et 1,52 Ma
(MO 11 et MO 92 : 2% : coulées basale
tiques vacuolaires du bouclier), 1,52 Ma
GEOLOGIE DE LA FRANCE, N° 3, 1998,
LILE DE MOOREA (SOCIETE): EDIFICATION RAPIDE D'UN VOLCAN-BOUCLIER POLYNESIEN
(MO 2M; Fs cuties henmoeitiques da
Rotui) et 1,51 Ma (MO 37 ; BF ; cules
basaltiques prismées du Tohiea) conf
rment I'édification trés rapide de ce bou-
clier. Enfin, a similitude entre les ges
K-Ar des laves du mont Rotui et de celles
de Médifice principal confirment Pappar-
tenance du mont Rotui au bouclier de
Tohica
Les éruptions post-caldeira sem-
blent synchrones dex stades finaux de
V'édification du bouclier dans la plupart
des localités oi elles ont été datées
(Papetoai, MO 72 : 1,53 Ma ; Tautuape,
MO 117: 1,53 Ma ; Paopao, MO 115
1,52 Ma), en dépit des relations de terrain
ui montrent qu’elles se sont épanchées,
en scellant le mur de la caldeira voire sur
le plancher de celle-ci. A Papetoai (F2 et
oF.) ainsi qu’ Paveo (9h) s’agit Pun
Yolcanisme fissural, issu des failles bor-
digres deta caldeira, Par contre, le Massit
de Paopao (8) se distingue par une posi
tion plus interne. Lors de cette période
@activité on observe également une dus-
Tité entre basaltes (983 et 82) ot laver
évoluses (F, et yF,)- Deux ges confir-
ment le caractire prst-ealdeira de ces
unités (Papetoai, MO 63 : 1,47 Ma et
Pagpao : 136 Ma pour intrusion trachy-
tique MO 104),
Lonigine principale des divergences
centre Tes ges obtenus lors de la présente
Gude et ceux déwermings antésiewement
par H. Bellon et F. Blanchard (1981),
C. Diraison (1991) et C. Diraison er al
(1991) réside trés vraisemblablement
dans le fait que nos datations ont été
effectuges sur mésostase séparke et celles
des auteurs précédemment cités sur
roches totales. En effet, les laves de
‘Moorea sont riches en phénocristaux et
parfois en xénocristaux d’olivine et de
Pytoxéne, minéraux qui contiennent sou
vent des excés dargon conduisant & une
surestimation des Ages correspondants
(Laughlin er af, 1994). Ainst, dans les
basaltes des ies intra-océaniques, les
pphenocristaux d"olivine peuvent présenter
des raports #Ar/3Ar variant de 300 a
1000, et les aénovvistaux de 300 8 4000
(Kaneoka ef al, 1983), Les datations Ar-
[Ar ont par ailleurs démonteé des dil
rences importantes entre les rapports ini-
tiny “9AR3¢Ar des feldspaths et des
pyroxénes et le rapport atmosphérique
(Zeitler et Fitzgerald, 1986 : Lamphere et
Darymple, 1976).
GEOLOGIE DE LA FRANCE, N°3, 1998
Evolution voleano-structurale :
la formation de la caldeira
De par ses caractéristiques morpholo-
ssiques, la grande dépression du volean du
Tohiea rappelle les structures d’effondre-
ment décrites en de nombreux autees
grands volcans-boucliers océaniques
(Ancochea et al. 1994 : Carracedo, 1994 :
Filmer et al, 1994 ; Gillot et al, 1994 ;
Le Dez et al, 1996 ; Wolfe et al, 1994)
Suivant ces travaux, les dépressions vol-
ccaniques sont identifiges comme des glis-
sements gravitaires associés & un plan de
faille ayant une morphologie en cuillére,
qui implique un mouvement & compo-
sante vertcale fla téte du détachement et
des mouyements transcurrents sur les
cdtés (Gillot et al, 1994), Dans Tile de
Moutea, Ie plan Ue faille entourant ta
dépression monte dans sa partie sud une
forme hémivirculaire, et semble ae refer
mer vers le nord a la pointe de Paveo.
ans ce ons, les dewy bras latérany 9
vant lesquels doivent s‘effectuer les mou
verents transcurrents se rejoindraient au
nord de Mile, Cette géométrie semble
‘compatible avec un glissement gravitaire
mais la convergence des failles Iatérales
suggére un blocage rapide du systéme
vers le nord, Le mont Rotui, faisant partie
intégrante du bloc déplacé, doit avoir subi
tun deplacement vers le nord de table
amplitude, lié & un plan de décotlement
Fig, 4 Coupe nord-sud de Moorea
Fig. 4 North-sout erase section of Moorea,
wraisemblablement pen pind. Fn eet
i est probable qu'un plan de rupture pro-
fond aurait provoqué des effondrements
d'une plus grande ampleur, Par ailleurs,
tes plans de falle prennent généralement
nalssance dans les niveaux de fablesse
des appareils voleaniques (Ancochea
et al., 1994), A priori, les caractéristiques
lthologigues déerites sur Mile montrent
«que la formation des breches «'Ataeaity
(br), de par sa nature peu consalidée, a
yu vemplir ly fouction even de fair
blesse mécanique dans lequel s'est initié
Ie elasement.
Le modéle envisage est un glisse-
‘ment gravitaire, ayant pris naissance
‘dans un niveau peu profond, de faible
résistance mécanique. Cette hypothése
nécessite estimation des rejets des
‘mouvements. Le marqueur choisi est ls
formation dos brdches d°Afareaitu (br),
en raison de son existence de part et
Aantre di plan de faille ot sa positian
basale au sein de I'édifice. Si l'on
considére que le niveau supérieur de
cette formation était & la méme altitude
de part et d'autre du plan de faille, une
estimation des déplacements du mont
Rotui livre des valeurs de 800 & 1000 m
pour le rejet horizontal et quasi nulle
pour le rejet vertical. La figure 4, pré-
sente deux coupes N-S. La premiere,
basée uniquement sur les relations de
57
LE DF MOOREA (SOCIETE) : EDIFICATION RAPIDE O'UN VOLCAN-BOUCLIER POLYNESIEN
1 a
Stade bouclier
0
Eruption
Marni de Popetoa
Eruption laterte
res Suit de Pope
FED) 8 tose memtine
oT eA stain
Fig $- Model devolution structure du volcan de Moorea en os tapes a) En plan ;b) En coupes N-S.
Fig. 5- Three step nese forthe srctural evan of Moorea: plane view :) NS eros sections.
58
terrain, respecte aw micn Ia epartition
spatiale, les épaisseurs et les pendages
des formations. L’autre, interprétative,
suppose un plan de faille situé dans un
niveau superficiel de P’édifice, a la
limite d’érosion actuelle de la dépres-
sion centrale causée par l'effondrement.
De subvertical dans les formations a
comportement mécanique cassant (,8},
16 et"), le pendage du plan de rupiure
diminue progressivement pour acquerir
tune inclinaison quasi nulle dans les
bréches (br).
Parmi les facteurs déclenchants envi-
sageables, il convient de citer les intru-
sions de dykes (Elsworth et Voight,
1995) ainsi que le fluage de cumulats
riches en olivine (Clague et Denlinger,
1994) a des niveaux superficiels du vol-
can, La derniére hypothése est pour le
moins discutable dans le eas des édifices
polynesiens. En effet, il est généralement
admis que Ia différenciation magmatique
‘se produit dans des ehaubres proFondes
situges & Pinterface eroite océanique’édi-
fice ou dans la croiite oeéanique sous
Jacente, Les chambres magmatiques loca-
lisées dans Pédifice correspondent alars &
es niveaux de stockage superficiels oit
les magmas s‘accumulent avant les érup-
tions. Tl existe de nombreux indices
témoins de la différenciation profonde,
Ainsi a Eiao, archipel des Marquises
(Caroff er al., 1995), on observe Pem-
preinte de la contamination des roches
intermédiaires (hawaiites*mugéartes) par
lun matériel de type MORB lors de la dit=
férenciation des laves. Ces caractéris-
tiques ne peuvent s‘expliquer que par des
chambres magmatiques relativement pro-
fondes
Le tole de intrusion des dykes dans
la d&stabitisation des flanes des édifices
pparait done comme un élément essentel
4 prendre en compte. Ainsi, a Moorea,
activité effusive n’est pas terminge
lorsque se produit leffondrement du flane
nord, Selon D. Elsworth et B. Voight
(199), la destabilisation des flanes des
Edifices est susceptible de se produire &
pani Ue plans de facture super ices. La
fracturation est alors initige par la force
hydraulique exerege par le magma sur
Pencaissant environnant, Les schemas de
la figure § présentent un modéle d’éval
tion en trois étapes montrant conjointe-
ment I'évolution en plan et en coupe du
volean de Moorea
GEOLOGIE DE LA FRANCE, N° 3, 1998
ILE DE MOOREA (SOCIETE) : EDIFICATION RAPIDE D'UN VOLCAN-BOUCLIER POLYNESIEN
«La premidne étape (2) correspond & la
fin de ta période d’édification du volean-
bouclier du Tohiea.
- La deuxitme étape (H) correspond &
Ja fracturation nie Ja faveur de trae
sion d'un systéme de sill et de dykes & un
niveau superficie! de Médifiee voteanique.
Le plan de décollement se forme dans les
Uéches lahatiques (br,) et présente une
forme en cule, Le déplacement du flane
nord de Médifice permet ouverture d'une
dépression. Conjointement & a facturation
tau déplacement di comparsiment vers le
nord, ee demies subit un démantélement
important qui permet la mise & Patfleure-
rent des bréchos de lohars. Cette phase de
facturation et de démantélement est rapi-
ddement suivie par les épanchements laté=
raux, a partir des filles décrochantes, &
Papetoai et Paveo, et plus centraux a
Paopao.
Entre les stades (II) et (IIL: Actuel),
Jes Sruptions latérales ce poursuivent,
notamment & Papetoai, Durant cette
période, Vérosion jone anssi un rile pré-
pondérant, comme en témoignent les
baies de Paopao et d’Opunohu de part et
autre du mont Rotui ainsi que la dépres-
sion centrale
Pétrogenase des magmas
Généralités
Les basaltes de Moorea se caracté-
risent par un enrichissement marqué en
4000)
100
10
Echantillon /Manteau Primitif
éléments incompatibles (fig. 6
tabl. 1), typique des basaltes alcalins
intra-océaniques (Sun et McDonough,
1989). Tis présentent également un
fractionnement marqué entre terres
rares légeres et terres rares lourdes,
© MO 14 Rassite
¢ Mos: Hawaite
15 MO 100: Benmoréite
= MO 72: Trachyphonolite
Rb By Th K Nb La Go Ge Nd Pe Sm Eu T Gd Dy ¥ Er Yb
Fig. 6 - Spectres mul-léments normalisés au manteauprimiif de quelques laves representatives de
“Moorea, Les valeurs de omalisation sont de SS, Sun et W. MeDonoush 1989).
Fig, 6 Primve-mame normalized mulvelemon plots of select Moorea lavas. Normalization values
rom Sun and SeDoncugh (198).
‘abl, |= Analyses {CP-AES d'échanllons de Moore. Rb a été mesur par spectrométie d'émission atomique. Methods anal
i, (1993), BA Base ; HAW Hawai» MUG» Moyéuite » BEN
Gabbe
Table 1
BA: Basal; HAW. Hawaite; MUG: Mugeoite: BEN:
GEOLOGIE DE LA FRANCE, N° 3, 1998
HCP AES analyses of More lavas. Rb was meatured by atomic absorption spectromeny: Analytical methods desribed
Bemircie TRPH Teaaplonlic » TRA.Q
igus brits dans Coen et
These quatieie , GAD
‘Benmorvite: TRPH: Trachyphonolte: TRA Q: Quarts-normaivevacyte; GAB: Gabbro,
LILE DE MOOREA (SOCIETE) : EDIFICATION RAPIDE D'UN VOLCAN-BOUCLIER POLYNESIEN
2r
Cr
Fig. 7 = Diggenancy de vata csoninlnn ia et eutnnius de aves de Mane Le ics
‘Ge mélange ientfiges sont iniquéee en tes, Les symboles semi-vides ainsi que Te tingle plein
1800
1600
1400
1200
1000
600
400
9
of
veep ee a
40
Haswaites
Mugéariee
Benmoedtes
Teachyphonslies
TrachyeQ
abros
50 60
Trera
Haveaites
Muptartes
Benmsies
‘Trachyphonolies
‘TrachyieQ
anos
pointe en bas correspondent ax analyses ds laves tres de W, M. White et R.A Duncan (1996)
Fe?
Zirconlum thorium ond chromiumthovum los. Dashed lines corespond to mixing rend,
interpréné comme nisultant de ba rétan-
tion des terres rares lourdes par du gr
nat résiduel lors de Ia fusion partielle
de la source péridotitique (Liotard er
al, 1986 ; L 1996). On
observe aussi une évolution réguliére
des concentrations, des basaltes aux
hhawaiites, puis de ces demiéres aux
benmoréites et trachyphonolites de la
formation de Papetoat (F). Celles-e1
montrent également des anomalies
négatives prononcées en Ba, Sr, P et
Ti, compatibles avec des fractionne-
Dez er al.
Bien que le type pétrolagique domi-
nant a Moorea soit les basaltes alealins
‘comme dans toutes les autres iles de la
Société), cette ile se singularise par la
sgrande abondance de laves de composi-
tion intermédiaires (mugéarites, benmo-
reites) et évoluées (trachyphonolites),
Elles constituent les formations ,F,, F, et
«yF > Contrairement aux laves de la forma-
tion F,, les coulées benmorétiques échan-
tillonnges au Rotui (,F,) et au Tautuapae
(F.) © distinguent par des caractéris-
tiques atypiques
ighesse en aénucristaua basaltigues,
Lexamen de l'importance relative des
textures de mélange et
processus de eristalisation fractionn:
des mélanges magmatigues permet de dis-
outer 1
observées & Moorea,
La cristallisation fractionnéc
Des basaltes aux hawaiites, les ten.
dances évolutives des éléments majeurs
ef éléments en traces des laves (tabl. 1)
coincident avec ordre dapparition des
principaux phénocristaux observés : oli
vine, clinopyroxéne, plagioclase cal-
cique, oxydes de Fe-Ti et apatite. On
observe ainsi une augmentation r
des concentrations en éléments en traces
incompatibles (Zr en fonetion de Th
fig. 7) concomitante aver la déeroissance
des teneurs en compatibles (Cr, Ni, Co et
Se). Ces variations, trés semblables a
celles décrites pour d'auties voleans-
boucliers de Polynésic francaise (Caroff
1903, 1095 ; Maury er al, 1978,
1992) sont compatibles avec un proces-
sis dévolutian par cristallisation frac-
tionnée, Cette hypothése a été confirmée
par des caleuls basés sur la méthode des
moindres carrés, ainsi que par des tests
etal
GEOLOGIE DE LA FRANCE, N° 3, 1998
LILE DE MOOREA (SOCIETE) : EDIFICATION RAPIDE D'UN VOLCAN-BOUCLIER POLYNESIEN
[Emission de ales Emission des laves hybrides
By 2 3B
som? Emission de laves évoluée
Conduit latéral Conduit principal
it~ gabbroique
‘Conduit d'alimentation
| NS
ou
Zone de fusiv
(ig 8 Representation schmatigus de évolation
turbulente rovogue le melange di magia ena (
‘pose base de chante en raison de lur dens supércure elle dex magmas siden (,P, stg).
Fig. 8 - Carton depicting the formation of Moore
Fy hasalte magmas uarising from the lower chamber
Invi lavas. Benmore and trachphono
sur les éléments en traces (Blanchard er chimiques en accord avec leur degré
al, 1981), Aw niveau des hawaiites évo- d°évolution (tabl. 1) : diminution des
luges (Th > 10 ppm), les évolutions des tencurs en K,O, ainsi qu’en Ba, consécu-
concentrations présentent une rupture tives au fractionnement des feldspaths
tres nette, En effet, les hawaiites, mugéa- alealins. L’ensemble de ces caractéris
rites et Denmoreites des formations du tigues suggere que Je grand volume de
Rotui et du Tautuapae (yF, et iF.) se laves évoluées du massif de Papetoai
eaructérisent par des cumventiations (F,) «ésulte d'un processus d'évolution
anormales en éléments compatibles (tabl. par cristallisation fractionnée partir
1), st comportent également des indices dune couche bacatique.
et de nombreux,
texturaux de méla
xénocristaux. Un unique processus Les mélanges
évolution par cristallisation fractionnée magmatiques
est done 4 exclure pour ces laves. Par
contre, les laves évoluées (benmoréites _I] existe de nombreux exemples
et trachyphonolites) de la formation de d'études de mélange magmatique en
Papetoai (F,), présentent des variations contexte intraplaque océanique. On peut
GEOLOGIE DE LA FRANCE, N°3, 1998
Chambre magmatique stratifiée,
contenant des benmoréites et des
Magma hybride,
contenant des fragments
ri de cumulat basaltique
(figurés en blanc).
Chambre transitoire basaltique
Cumulat gabbroique
sya Raa ows Women wecypotes FL maghes sf
trachyphonolites
ie magmas are store inthe apper reservoir which i refiled
citer les cas particuligrement démons
tratifs de larchipel d’Hawaii (Rudeck et
al., 1992 ; Fodor et al., 1993), et des
ies Canaries (Wolff, 1985 ; Arafa et
al,, 1994 ; Freundt et Schmincke, 1995)
ar contre, dans le cas de la Polynesie
frangaise, aucune étude antérieure n'a
smentionné le role de ce processus dans
les évolutions magmatiques. Les laves
intermédiaires et
svoludes (mugéarites
cet benmoréites) des formations du Roti
GF) ef div Tantiapae (QF) présentent
ds concentrations anormales en Cr, Ni,
Co et Sc (tabl. 1) et comportent ézale-
ment des indices texturaux de mélange
et de nombreux xénocristaux en cours
de résorption, Dans les diagrammes de
6
LILE DE MOOREA (SOCIETE) : EDIFICATION RAPIDE MUN VOL CAN-ROIIC! IER POL YNESIEN
variation des éléments majours ot on
traces, les points représentatifs des laves
des formations yF, et 4F, définissent
deux tendances évolutives linéaires
centre un pile de composition basaltique
et un péle de composition évoluée,
constitué par des benmoréites et des tra-
chyphonolites identiques & ceux de la
formation de Papetoai (F,) (diagramme
Cr-Th, fig. 7). De plus, les calculs de
moindres carrés, ainsi que les tests sur
les éléments en traces (Wright et
Doherty, 1970) valident dans I’en-
semble de facon cohérente la posstbitté
suivant laguelle les laves des formations
Fy 8g; Uériveraient Wun provessus
de mélange magmatique (Le Dez,
1996)
Modéle
de réservoir
Le modéle proposé suppose une
chambre magmatique stratifiée compos
tant, & sa base des benmoréites et & son
sommet des trachyphonolites (fig. 8). A
‘un niveau plus profond, serait situge une
seconde chambre magmatique périodique-
‘ment réalimentée par des magmas basal-
tiques primitifs, qui seraient soit émis
directement en surface via un conduit
Tatéral, soit injectés dans la chambre sus-
Jacente, Le magia basaltique dense serat
alors injecté sous forme d'une «fontaine
‘urbulente» (Campbell et Turner, 1986),
ayant une hauteur suffisamment impor-
{ante pour provoquer son mélange avee
les magmas du sommet de la chambre.
Loe magmas hybrides formés, de par leur
densité supérieure 4 celle des magmas
risidents, viendrnient se placer en hase de
la chambre. Suite aw mélange, leo érup
tions échantillonneraient soit les magmas
hhybrides (Ft gF.) soit les laves résie
dentes (,F,) (Blake et Ivey, 1986). lest &
noter que, dans le modéle présenté. les
énocristaux des laves hybrides provien-
nent du fractionnement des liquides basal-
tiques lors de leur stockage dans la
chambre inférieure, Lors de lémission
des basaltes vers la chambre oi rsident
les magmas évolués, les cumulats seraient
desagreges et incompores dans les basaltes
ascendant. La postion de ces cumulats &
fa base de Ia chambre magmatique stat
fige peut constituer une alternative au
schéma propose. Suivant cette disposition,
les cumulats seraient désagrégés lors de
injection des magmas basaltiques et
incorporés dans la «fontaine turbulente.
Ce schéma relativement simple rend
‘compte de la simultanéité des émissions
de laves hybrides (formations du Rotui,
Fp et du Tautuapae, ,jF3) ou évoluées
(benmoréites et trachyphonolites de la
formation de Papetoai, F) et de celles de
basaltes (formations du Tohiea, 67, de
Paopao, B3, et de Paveo, 3), en des
lieux différents du volean
Conclusions
ile de Moorea présente par rapport &
ses voisines de Marchipel de la Société et
(une facon générale par rapport aux
autres iles voleaniques de Polynésie fran-
aise trois singularités:
- la premiére réside dans I’édit
tion particuliérement rapide, en 0,25 Ma
seulement si Ton exclut Punigue intru-
sion tardive (trachyte de Paopao. mis en
Références
place 0,11 Ma apris los autros massifs
post-caldeira) de la partie effusive du
valean de Tahies ge de Meffondre-
rent de la caldera, 1,52 Ma, est fourni
par le fréquent recoupement de ceux des
unités sommitales du bouclier (MO 37,
MO 20, MO 92) et de la plupart des
laves post-caldeira (MO 72, MO 117,
MO 115), gui sont quasi identiques
compte tenu des erreurs analytiques
Guillow et al, 1998). Le déplacement
de Vactvite vers File voisine de Tahiti
(Le Rey, 1994) a pu contribuer & cette
fin soudaine du voteanisine 5
la deuxiéme particularté de Moorea
réside dans son effondrement caldeitique
atypique (massif du Rotui), interprétable
‘comme un stade précoce de glissement
gravitaire, dont nous n'avons trouvé
aucune description d’équivalent proche
dans la littérature ;
~ enfin, abondance inhabituelle des
lavorintormédiaires (benmorsitos et mugéa-
rites) est largement due & intervention des
iélanges magmatiques, qui Wavaient jus-
au'ici pas t€ mis en évidence en Polynésie
francaise.
Remereiements
Les auteurs ont beneficié des eousells
de M, Caroff et C. Hémond (modeles géo-
chimiques), A. Coutelle ot O. Merle
(modele d’effondrement de ta caldeira).
Liarticle 4 &t8 considérablement amélior’
igrdce aux critiques et commentaires de
J. Rourdier et de J.L. Schneider. ainsi
4qu’a ceux de J. Demange sur la carte géo-
logique correspondante.
Ancochea E., Herman F., Cendredo A., Cantagrel J M., Fuster. M,, Ibarola E., Coello J. (1994) - Constructive and destructive episodes inthe
building ofa youg uccai sland, La Pana, Canary Islands, and genesis of the Caldera de Taburiente. J. Fole: Geotherm, Res
60, 243-262
‘Arrafia V., Mart J, Apaticio A., Garcia-Gacho L., Gareia-Garela R, (1994) - Magma mixing in alkaline magmas: an example from Tenerife,
‘Canary Islands. Lthos, 32, 1-19.
Rellon H, Blanchard F (1981) ~ Aspects géochronologiques (K-Ar) de Wactivité voleanique dans
Tectonophysics, 72, 33-43.
Blais S., Guille G., Maury R.C., Guillow H., Misu D., Cutten J. (1997) - Géulogi et pétlugie de
aise). CR. Acad, Sci, Pars, 324, (2a), 435-442,
Blake
de Moorea. Pacifique central,
le de Raiatea (Société, Polynésie fran-
wey GN. (1986) - Magma-mixing and the dynamies of withdrawal ftom stratified reservoirs. J. Vole. Geotherm. Res.,27, 153-178
Blanchard F_ (1978) - Pérrngraphie ot pénchimie de ile de Moorea, Archinel de la Société, Pacifique central. Thése 3° cycle. Université de
Paris Sud, Orsay, 196 p.
a
GEOLOGIE DE LA FRANCE, N°
LILE DE MOOREA (SOCIETE) : EDIFICATION RAPIDE D'UN VOLCAN-BOUCLIER POLYNESIEN
Blanchard F...Liotard 1M. Brousse R. (1981) - Origine mantellique des benmoréites de Moorea (ies de la Société, Pacifique) Rull Vale,
444, 691-710.
BrousseR., Bout G., Eisenscin A, Ghugne P. (1985) - Nove explicate de a care geologie 6 Ia France (1/29 O00), fle Lat =
Papcct, Ministre de I Bquipement, de Amenagement, de Energie et des Mines
Campbell I. HL, Turmer J. $. (1986) -The influence of viscosity on fountains in magma chambers. J. Petrol, 27-1, 1-30.
Coroff M., Maury RLC., Letcrrce J, Joron JL, Cotten J, Guile G, (1993) ~ Trace clement behavious ia die alkali baallcuneinltc aelyte
series from Mururoa Atoll, French Polynesia. Lithos, 30, 1-22.
Caroff M., Maury R.C., Vidal Ph, Gulle G., Dupuy C., Cotten J., Guillow H., GillotP.Y. (1995) - Short Temporal Changes in Oceanic
Island Basalt Series: Evidence from a 800m-Deep Drill Hole in Eiao Shield (Marquesas). J Petrol, 36-4, 1333-1365,
Carracedo J.C, (1994) ~ The Canary Islands : an exemple of structural control on the growth of large aceanic-island volcanoes. J. Vole:
Geotherm. Res. 60, 225-241
Cheog Q.C., MeDougall J.D., Lugmair G.W. (1993) - Geochemical studies of Tahiti, Teahita and Mebeti, Society sland chain J. Vole
Geotherm. Res. 58, 135-188,
(Clague D.A., Denlinger RP. (1994) - Role of olivine cumulates in destabilizing the flanks of Hawaiian volcanoes, Bull Voe., 56, 425-434,
Cotten J, Le Dez A., Bau M., Caroff M., Maury R.C., Dulski P., Fourcade S., Bohn M., Brousse R, (1995) - Origin of anomalous rate-carth
You might also like
- 12 Arthropodes Sve1 2023Document35 pages12 Arthropodes Sve1 2023Wijdene SassiNo ratings yet
- Microbiologie GénéraleDocument36 pagesMicrobiologie GénéraleWijdene SassiNo ratings yet
- Chapitre2 Texte PlanchesDocument34 pagesChapitre2 Texte PlanchesWijdene SassiNo ratings yet
- Dev Embryonnirre OiseauDocument23 pagesDev Embryonnirre OiseauWijdene SassiNo ratings yet
- Syllabus Entier de SVTDocument81 pagesSyllabus Entier de SVTWijdene SassiNo ratings yet
- Dev Embryonnirre CHIENDocument3 pagesDev Embryonnirre CHIENWijdene SassiNo ratings yet
- BA CriquetDocument19 pagesBA CriquetWijdene SassiNo ratings yet
- Rep HommeDocument9 pagesRep HommeWijdene SassiNo ratings yet
- BC MembranesDocument35 pagesBC MembranesWijdene SassiNo ratings yet
- Dev Embryonnirre OursinDocument17 pagesDev Embryonnirre OursinWijdene SassiNo ratings yet
- Physio - Reproduction - PDF ImportantDocument17 pagesPhysio - Reproduction - PDF ImportantWijdene SassiNo ratings yet
- Cours Reproduction FéminineDocument32 pagesCours Reproduction FéminineWijdene SassiNo ratings yet
- Rep FemDocument7 pagesRep FemWijdene SassiNo ratings yet
- La Régulation de La TestostéronmieDocument3 pagesLa Régulation de La TestostéronmieWijdene SassiNo ratings yet
- Méiose Detaillé Comparaison GamétogenesesDocument10 pagesMéiose Detaillé Comparaison GamétogenesesWijdene SassiNo ratings yet
- Endometre Et TemperatureDocument1 pageEndometre Et TemperatureWijdene SassiNo ratings yet
- Brassage Genetique Bilan 2023 - Copie ÉlèveDocument3 pagesBrassage Genetique Bilan 2023 - Copie ÉlèveWijdene SassiNo ratings yet
- Contrôle Hypophysaire Des Fonctions TesticulairesDocument1 pageContrôle Hypophysaire Des Fonctions TesticulairesWijdene SassiNo ratings yet
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)