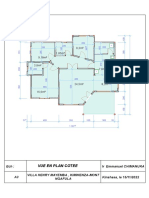Professional Documents
Culture Documents
Chap22 24
Chap22 24
Uploaded by
Emmanuel0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views12 pagesOriginal Title
chap22_24
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
4 views12 pagesChap22 24
Chap22 24
Uploaded by
EmmanuelCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 12
Salmonella
SAGTAT
TRANSMISSION
POUIOIR PATHOGENE
FACTEURS DE PATHOGENICTE
IDIAGNOSTIC BIOLOGIQUE
SEROLOGIE
BASES DU TRAITEMENT
Introduction
}) Les salmonelles ont été dlassées en fonction de leurs antigenes O et H et éventuellement
-epsuleires. On connait une soixantaine d’antigenes O différents. Une bectérie peut en pos:
‘séder un ou plusieurs. Les entigénes H sont également trés variables et peuvent exister chez
‘a méme bactérie sous deux formes différentes, en raison du phénomene de variation de
3c (Fig. 5.2). Enfin quelques sérovars peuvent présenter un antigene capsulaire, lanti
1 Vi. Cest la combinaison de ces différents antigénes qui permet de définir un sérovar.
en connatt plus de 2 000.
Dans un premier temps on a attribué un nom d'espéce aux principaux sérovars, par
mple Salmonella typhi, Salmonella enteritid’s. Les études taxonomiques basées sur des
stzres génotypiques ont montré qu’en fait les salmonelles rencontiées en_ pathologie
partenaient toutes a une méme espéce que fon a appelée Salmonella enterica (3 Vinté-
r de laquelle on peut distinguer plusieurs sous-espéces). Le nom de espace est sui
nom du sérovar (qui commence par une majuscule et qui n'est plus en italique). Ainsi
;onella typhi devient Salmonella enterica sérovar Typhi. Actuellement les deux modes
Zcriture sont utilsés. Nous utiliserons la terminologie la plus récente, en omettant (comme
‘est habituel) le nom de la sous-espéce.
La classification des salmonelles ne présente pas qu/un intérét taxonomique, cer Thabitat
le pouvoir pathogine des salmonelles varie selon les sérovars.
D rssirar
Les salmonelles sont des bactéries de lintestin. Chez de nombreux
sujets elles peuvent étre présentes sans entrainer de symptOmes (por-
teurs sains).
Quelques sérovars sont spécifique ment humains : Typhi et Paratyphi.
Diautres ne se rencontrent que chez animal, comme le sérovar Pul-
lorum. Mais la majorité des sérovars ont un spectre dhéte assez large
et peuvent infecter aussi bien l'homme que diverses espéces animales.
D rRansmission
La contamination humaine se fait habituellement par ingestion d'eau
‘ou daliments contaminés. Ces demiers sont le plus souvent dorigine
33
CCONNAISSANCES
animale (coguilleges, viande hachée, ceufs). La contamination des al
ments peut aussi étre d'origine humaine et lige & des manipulations
par un personne! porteur de salmonelles.
D POUVOIR PATHOGENE
Dd Fiévre typhoide
Elle est due aux séiovais Typhi et Paratyphi A, B au C. La maladie est
devenue rare dans les pays industielisés, ol! la plupart des cas sont
importés Elle reste trésfréquente dans les pays & bas niveau d’hygitne
(plus de 10 millions de ces par an). Apres une incubation de 7
10 jours, elle se traduit par un syndrome infectieux sévére accompagné
de troubles cigestifs et d'un état d obnubilation (‘uphos). En absence
de traitement, lévolution se poursuit pendant plusieurs semaines et
peut se compliquer dhémorragies ou de perforations intestinales. La
mortalté est de 10 & 20%,
D Infections intestinales
Flies sont dues 8 des sérovars autres que ceux impliqués dans la favre
typhoide, Dans nos régions S. enterica sérovar Typhimurium et sérovar
Enteritidis sont fréquemment impliques.
Ces maledies se rencontrent dans tous les pays et semblent augmenter
de fréquence dans les pays industrialisés. Ce paradoxe apparent est
6 8 la place croissante que tiennent les produits d'origine industrielle
dans notre alimentation. Si un produit d'origine industrielle est conta-
iné, le nombre de sujets infectés peut étre considérable (des miles,
vwoire des dizaines de millers).
La maladie survient 12 & 48 heures aprés lingestion de Valiment
contaminant. Ele se traduit par de la diarrhée, des vorissements, une
fiévre modérée. En général la guérison survient en quelques jours. La
maladie peut cependant étre grave sur un terrain fragile.
Les infections intestinales 8 salmonelles peuvent se présenter sous la
forme de cas sporadiques ou bien dépidémies pouvant revetir Faspect
d'une intoxication alimentaire collective. Les infections & salmonelles
figurent paimi les principales causes de diarthées origine
bactérienne.
D Localisations extradigestives
Vinfection intestinale (par des sérovars non impliqués dens la
typhoide) est parlois suivie d'une bactériémie lorsque le terrain est
fragile (jeune enfant, sida). Diverses localisations secondaires peuvent
observer : osseuses (en particulier chez les drépenocyteires), ménin-
gées (chez le nourrisson), artérielles (chez le sujet égé). On peut
observer également des cholecystites, des infections urinaires.
Les infections intestinales peuvent aussi étre suivies parfois d'une com
plication aseptique, l'arthrte réactionnelle.
ansap
sus (229
D Facteurs DE PaTHOGENICITE
En utiisent des sérovars adapiés 4 'animal on peut étudier les infec-
tions & salmonelles sur le plan expérimental. Lavoie naturelle
infection est digestive, Une partie des bactéries est détruite par Vaci-
dité gastrique. La dose infectante est plus faible en cas d'achlorhydrie.
Les bactéries pénétrent dans la muqueuse intestinale, au niveau de
Hiléon et du colon. Sur Vléon la pSnétration se fait principalement au
niveau des plaques de Peyer, a travers les cellules IM. Les bactéries se
mmultiplient dans les plaques de Peyer et dans les autres tissus lym-
phoides assocés au tube digestit. Elles gagnent ensuite les ganglions
mésentériques. Vinfection saréte & ce stade lorsqu'l s'agit d'une
infection intestinal.
Lorsqu'll sagit d'une infection systémique (comme dens le cas de la
figure typhcide) les bactéries migrent par voie lymphatique jusqu’au
systéme circulatoire et vont se répandre dans organisme. Les bactéries
seront fisées par le systéme réticulo-endothélial principalement au
niveau du foie et de fa rate ot leur multiplication se poursut. A partir
du foie, des bactéries gagnent les voies bilaires et peuvent réense-
mencer Fintestin,
Pour infecter leur hate les salmonelles utilsent différentes armes :
D Adhésines
Les salmonelles posstdent plusieurs types de fimbriae qui jouent
probablement un rdle dans leur adhésion a la muqueuse
intestinale.
Db Invasion des cellules épithéliales
Pour traverser le muqueuse digestive, les salmonelles utilisent un
groupe de genes chromosomiques (réunis dans un flot de pathogé-
niicité) qui leur permettent d’envahir des cellules épitheliales. Les
genes de cet ilot de pathogénicité présentent des homologies avec
des genes appartenant a d'autres entérobactéries (Shigella, Yersinia)
Au contact d'une cellule Spithéliale, ces génes sont activés. Certaines
des protéines produites vont tre exportées et induire au niveau de
la cellule épitheliale des remaniements du cytosquelette qui aboutis-
sent & Tingestion de la bactérie par la cellule épitheliale. Autrement
dit, la bactérie transforme une cellule épithélicle en une cellule
Phagocytaire.
D Survie et multiplication
dans les macrophages
Une propriété importante des salmonelles est leur capacité de se mul
tiplier dans les macrophages et éventuellement dans des cellules
Epitheliales. Lorsqu’elles sont phagocytées par des macrophages, les
salmonelles restent dans fe phagosome. Elles peuvent induire la mort
du macrophage par apoptose. On connaft au moins deux groupes de
sgknes impliqués dans la multiplication intramaciophagique, Tun est
situé sur le chromosome (dans un autre lot de pathogénicité), Feutre
41350
‘CONNAISSANCES
‘sur un plasmide, dit plasmide de virulence, qui est présent chez tous
les sérovars pathogtnes, & Yexception notable du sérovar Typhi.
En raison de leur localisation intracellulaire les salmonelles sont peu
sensibles a action des anticorps, Limmunité contre les infections sys-
témiques est principalement due aux lymphocytes T CD4*. Cola
‘explique la fréquence et le caractere persistant des infections a salmo-
relies cher les sujets ayant un deficit de Timmunité cellulaire (sida)
d DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE
D Isolement de Ia bactérie
‘Au cours de la fiéure typhoide, hémoculture est la méthode de choix.
Elle est surtout positive pendant la premiére semaine de la maladie.
Elle gagne a étre répétée, car la densité de bactéries dans le sang est
faible. On peut aussi rechercher la bactérie dans le liquide biliaire (par
tubage duodénal) ou dans la moelle osseuse. La bactérie sera égale-
ment recherchée dans les selles pendant la meladie et apres la
‘guérison pour détecter un éventuel portage (le portage est parfois favo-
tisé par la présence d'une lithiase vésiculaire).
‘Au cours des infections intestinales la bactérie sera recherchée dans
les selles. Pour cette recherche, le laboratoire utilise des milieux d’enri-
chissement et des milioux sélectifs. En cas de syndrome infectieux
sévere, des hémocuitures permettent de détecter une bactériémia
éventuelle. Aprés fa guérison on siassurera de Tabsence de portage.
DP seRoLocie
Elle est utilisée uniquement pour le diagnostic de la figvre typhoide.
On recherche les anticorps anti-O et anti-H des sérovars Typhi et Pare-
typhi A,B, et C. Llascension des anticorps est souvent tardive (B*-
12 jour). Dans les cas typiquos, le malade développe des anticorps
contre les antigenes O et H dun soul sérovar. Dans les autres situa-
tions, rinterprétation des réponses sérologiques peut dire délicate en
raison des possibiités de réaction croisées avec d'autres bacténes.
D BASES DU TRAITEMENT
Dd Curatif
Les salmonelles nont pas de résistance naturelle aux antibiotiques,
mais les résistances acquises sont devenues fréquentes, d'oui la néces-
sité d'un antibiogramme, Toutefois les antibiotiques actifs in vitro ne
‘sont pas toujours actifs in vivo, en raison de la localisation intracellu-
ire des salmonelles. Les eminosides per exemple sont inactits in vivo.
Pour le traitement de la fidvre typhoide, le chloramphénicol ou le cotri-
moxezole sont généralement actifs et utilises actuellement surtout
36d
samoneun (22
dens les pays en voie de développement (en raison de leur feible
coGi). Dans les pays industiialisés on préfére utiliser soit les fluoroqui-
nolones, soit des céphalosporines de 3° génération (& posologie
élevée). Des rechutes 4 lerét du traitement sont possibles.
En ce qui conceme les infections intestinales, Findication d’un traite-
ue est discutée, car ['évolution spontanée est
xgénéralement bénigne et le traitement pourrait favoriser le portage. On
tient compie en pratique de importance des signes cliques et du
terrain.
D Préventif
Il tepose c'abord sur le controle bactériologique des eaux et des aliments,
sur le contidle des personnels de cuisine (@ la recherche de porteurs
sains). U'éradication des salmonelles contaminant les élevages de volilles
(Getovar Enteritis) se heurte cependant & de grendes difficultés,
la fitvre typhoide et les intoxications alimentaires collectives sont &
dédaration obligatoite et font donc objet d'une enquéte épidémioto-
sique. Des précautions d'hygitne doivent etre prises pour éviter une
transmission nosocomiale,
I existe un vaccin constitué par Iantigéne Vi qui protege contre les
typhoides dues aux sérovers Typhi et Paratyphi C. 1! posséde une effi-
cacité de ordre de 60%.
Des souches vivantes atténuées (administrées per os) sont en cours
détude.
Salmonella enterica est une espece qui comprend de trés nombreux sérovars
pouvant avoir des spécifictés dhhote différentes. Les sérovars Typhi et Peratyoii sont
spécifiques de homme et provaquent une infection systémique, la flévre typhoide.
lls se comportent comme des pathogenes intraceliulaires. Parmi les autres serovars,
beaucoup sont pathogenes pour I'homme et 'animal. Ils figurent parmi les princ-
aux agents responsables d'infections intestinales chez homme.
Pour en savoir plus)
Darwin KH, Miler VL. Molacuar basis of the interac. Pagues DA, Miler SL Salmonellosis, including
fon of Salmonella vith the intestinal mucosa. Clin typhoid fever. Curr Opin infect Dis,, 1984, 7: 616=
Vicobiol Rev, 1999, 12: 405-428. 625
Marcus SL, Brumell JH, Pfeiter CG, Finlay BB. Salmo.
nella pathogenicity lands: big vitlerce in smal
sckages, Microbes Infoct, 2: 185-156.
37)
-ACTEURS DE PATHOGENICITE
AGNOSTIC BIOLOGIQUE
(ASES DU TRAITEMENT
) Cette entérobactérie a la particularité d'etre immobile, On distingue, dans le genre Shi-
ella, 4 especes : 5. dysenteriae, S. flexneri, S. sonnel et 5. boydli. Les deux premieres sont
les plus pathogenes. Chaque espéce est subdivisée en sérotypes.
D Hosier
Ce sont des bactéries spécifiques de homme, pouvant s'implanter
dans lintestin.
D transmission
La contamination se fait par voie digestive. La transmission interhu-
maine Sopére facilement, car la dose infectante est faible. Elle peut
‘tre directe, par les mains, ou indirecte par ingestion daliments ou
eaux contaminés. De grandes épidémies peuvent survenir lorsque
des populations importantes sont rassemblées dans de mauvaises con-
ditions d'hygiéne (troupes en campagne, camps de concentration,
camps de réfugiés).
D pouvoir paTHOGENE
D Dysenterie bacillaire
Cest la foie la plus sévére des infections & Shigella. Eile est due &
S. dysenteriae, sérotype 1. Aprés une bréve incubation de 1 & 2 jours,
elle se taduit par des douleurs abdominales, de la fire et ’&mission
de selles afécalos faites do glaires mucosanglantes. Des perforations
coliques peuvent se produire, La maladie peut se propager sur le mode
€pidémique et entrainer une mortalite apprécable sur des terrains
fragiles.
«1390
CCONNAISSANCES
D Syndrome diarrhéique
Les infections a Shigella se traduisent plus souvent par une diatrhée
dallure plus commune. Elles surviennent surtout chez fenfant. La diar-
thée peut étre sanglente et suivie parfois d'un syndrome hémolytique
ct urémique. Les infections a Shigella sont ties fréquentes dans les
Pays en voie de développement, mais s'observent aussi dans nos
régions, avec une incidence beaucoup plus faible. Les shigelles sont
responsables d'une partie des diarrhées des voyageurs.
D FACTEURS DE PATHOGENICITE
D Pouvoir invasif
Les shigelles envahissent le célon (surtout dans sa pattie distale) et
rovoguent une intense réaction inflammatoire au niveau de la
uqueuse et de la lamina propria, ainsi que des ulcérations. Les bac-
teries n’ont pas tendance a se propager au-dela du célon.
Les shigelles ont la capacité d’envahir des cellules épithéliales grace &
lun groupe de genes plasmidiques (ipa). Elles provoquent au niveau
de la cellule épithéliale des remaniements du cytosquelette qui per-
‘mettent leur ingestion par un processus analogue a la phagacytose,
Les shigelles lysent ensuite la vacuole de phagocytose et se multiplient
activement dans le cytoplasme. Elles peuvent se déplecer dens le
cellule ct méme dune cellule & autre en provoquant une polymér
sation de factine @ un de leur pale (gréce a un autre géne
plasmidique). Lorsqu‘elles sont phagocytées par des macrophages
elles provoquent la mort cellulaire par apoptose et la libération de
Cytokines pro-inflammatoires, comme ['l-1p. Les lésions semblent
résulter a la fois de fa proliferation bactérienne intracellulaire et de la
réponse inflammatoire tres intense.
D Toxines
S. dysenteriae produit une toxine de structure complexe, faite d'une
chaine polypeptidique A et de 5 chaines B. Les chaines 8 assurent
la fixation de la toxine sur son récepteur cellulaire. La chaine A
pénetre dans la cellule et clive un résidu adénine au niveau d’un
ARN ribosomal. Cette altération entiaine V'arrét des syntheses pro-
téiques et la mort cellulaire. La diffusion de la toxine de Shiga
semble impliquée dans le syndrome hémolytique et urémique. Elle
est trés proche de la Shigalike Toxin des Escherichia coli
entérohémorragiques.
Deux entérotoxines (1 et 2) ont été décrtes. Elles jouent un réle dans
la diarrhée. Ventérotoxine 1 est produite par S. flexneri, entéro-
toxine 2, codée par un gene plasmidique, peut sire produites par
différentes especes de shigelles.
41400
‘Sansonetti Pd, Tran
the inectiral bare =
fexneri. Cin Infect
sacaa (23
DP dacnostic sioLocique
Il repose sur fisolement de la bactérie dans les selles. II seffectue sur
les milieux sélectifs utilisés en routine.
D eases bu TRAITEMENT
En dehors du traitement symptomatique (séhydratation), il comprend
administration d'un antibiotique. Les shigelles n'ont pas de résistance
naturelle vis-a-vis des antibiotiques actifs sur les bactéties a Gram
égatif, mais les résistances acquises ne sont pas rates, d’oil la néces-
sité d'un antibiogramme. En premiére intention, le cotrimoxazole, une
fluoroquinolone ou une péniciline A peuvent étre utilisées.
Les Shigella sont des bactéries spécifiquement humaines, capables d’envahir les cel-
lules de la muqueuse intestinale et de provoquer une diarthée plus ou moins sévére
Lespéce 5. dysenteriae est la plus pathogane. Elle peut provoquer une dysenterie
se propageant sur un mode épidemique.
Pour en savoir plus ’)
Sznsonott Pl, Tran Van Nhiow G, Egle C. Rupture of
intestinal barierand mucocalinasion by Shigella
2, Clin infect Dis, 1999, 28: 456-475,
Yersinia
Introduction
» Ce genre bactérien comprend 5 esp&ces pathogenes : Yersinia pests, ¥. enterocolitica et
¥. pseudotuberculosis. Ces bactéries ont une croissance un plus lente que celle des autres
-entérobactéries. Elles ont toutes un tropisme pour les tissus Iymphoides. On les rencontre
dans diverses espéces animales et plus particuliérement chez les rongeurs.
D YERSINIA PESTIS
agent de la peste est un bacille court, immobile, dont la température
optimele de croissance est de 28 °C.
D Habitat
Uhabitat habituel de la bactérie est le rat. La transmission entre les
animaux se fait par fintermédiaire de la puce du rat. Des foyers endé-
miques existent sur tous les continents hormis Australia.
D Transmission
La transmission du rata "homme, par la puce du rat, est un événement
rare 2 Forigine de la peste bubonique. Lorsque la transmission est inte-
thumaine, par voie aérienne, le maladie peut prendre un aspect
épidémique. Le demigre grende épidémie européenne date du
ont side.
D Pouvoir pathogéne
Peste bubonique
Aprés quelques jours d'incubation, la maladie se traduit par une adé-
nopathie inflammatoire dans le ‘terrtoire de la piqdre infectante
(souvent passée inapercue) et un syndiome infectieux severe. Des
localisations secondaires, notamment pulmonaires, peuvent survenir.
La mortalité est importante.
Peste pulmonaire
A partir dun sujet ayant une aticinte pulmonaire, la transmission par
‘oie respiratoire entraine d’embiée une localisation pulmonaire. L'évo-
lution est rapide avec une mortalité pratiquement ce 100 Us.
agg
‘CONNAISSANCES
| D Facteur de pathogénicité
La fraction 1 est une structure capsulaire (un complexe protéine-
polysaccharide) qui inhibe la phagocytose. D’autres constituants, les
| antignes V et W, codés par un plasmide interviennent également dans
; fa virulence. La résistance a la phagocytose permet a la bactérie de se
repandre dans Vorganisme a partir du foyer inital
B Diagnostic biologique
La bactérie pourra étre recherchée par ponction ganglionnaire (en cas
ddénite), par hémoculture ou dans les crachats. Le laboratoire doit
tre prévenu de la suspicion de peste en raison du risque encouru par
le personnel et également pour adapter les conditions de culture & ¥.
pestis
BD Bases du traitement
Curatif
II doit étre mis en couvre durgence. Le traitement classique est la strep
| tomycine ou a défaut un autre eminoside. Les tetracyclines. sont
également actives. Les fHlactamines sont déconseillées.
Préventif
La maladie est 2 déclaration obligatoire. Les malades doivent étre
isolés. Il existe un vaccin pour les personnes exposées. En région endé-
mique, la lutte contre les rats en milieu urbain est un element de
prévention.
D versinia enTEROCOLITICA
D Habitat
On trouve la bactérie dans 'intestin de nombreuses espéces animales,
en particulier chez le pore.
D Transmission
Le maladie humaine résulte habituellement de l'ingestion d’aliments
contaminés (d'origine animale). La plupart des cas sont sporadiques,
mais quelques épidémies ont été décrites.
D Pouvoir pathogéne
Infection digestive
La maladie se traduit le plus souvent par une diarthée fébrile qui peut
se prolonger une a deux semaines, en absence de traitement. Elle sur-
aay
versus (24
vient volontiers chez l'enfant. Elle peut aussi se présenter parfois sous
aspect d'un syndrome pseudo-appendiculaire.
Dans certains cas, 'épisode digestif est suivi darthrites réactionnelles
‘ou d'un érythéme noueux.
Septicémies
Biles ont rares, Elles surviennent sur des terrains particuliers : immu-
nodéprimés, patients ayant une surcharge en fer. Exceptionnellement,
Finfection fait suite & une transfusion de seng contaminé (accident
favorisé par la capacité des Yersinia de se multiplier & basse
température).
D Facteurs de pathogénicité
Les bactéries ingérées. atteignent Iiléon terminal. Elles traversent la
muqueuse au niveau des cellules M recouvrant les plaques de Peyer.
Files proliférent surtout dans les tissus lymphoides associés au tube
digestif et gagnent généralement les ganglions mésentériques. Elles
‘ont une localisation principalement extracellulaire.
¥. emeroiitica a la capacié denvahir des cellules épithetiales (ce qui
lui permet de traverser la muqueuse intestinale). Deux protéines,
situées dans la membrane externe, sont impliquées dans ce processus
«et sont codées par des genes chromosomiques. La premitre, Vnvasine,
est produite que vers 28 °C. Elle intervient probablement @ la phase
Initiale de Vinfection et se lie & une intégrine de la cellule eucaryote.
La seconde, produite par le géne cil (Attachment/Invasion Locus),
sfexprime 8 37 °C, La bactérie posséde également un plasmide de viru-
lence qui porte un gne pour une adhésine et les genes des protéines
Yop (Yersinia Outer Membrane Proteins). Les genes plasmidiques per-
mettent & la bactérie d'injecter dans les cellules eucaryotes certaines
protéines Yop qui ont pour elfet de désorganiser la signalisation intra-
cellulaire et le cytosqueletie. il en résulte une incapacité des
macrophages 4 phagocyter les bactéries (d’o1 leur localisation extra-
cellulaire habituelle).
D Diagnostic biologique
Isolement de la bactérie
La bactétie sere recherchée dans les selles ou éventuellement par
hémocuiture.
La bactérie cultive sur les milieux usuels, mais plus lentement que les
autres entérobactéries. II est done nécessaire de prendre des disposi-
tions particuliéres, au niveau du laboratoire, pour détecter les Yersinia.
Les résultats des recherches dans les selles peuvent tre améliorés par
ln enrichissement & froid. La fréquence avec laquelle infection sera
reconnue va dependre des conditions de recherche des Yersinia.
Sérologie
Les méthodes d'agglutination (utilisant différents sérotypes) sont peu
fiables en raison du risque de réactivités croisées avec dfautres bacté-
«as
‘CONNAISSANCES
ras. Des techniques ELISA utilisant des antigénes définis sont en cours
devaluation.
D Bases du traitement
La bacteria produit des B-lactamases qui la rendent résistante aux péni-
tillines et aux céphalosporines de 1” génération. Les céphalosporines
de 3°génération et les fluoroquinolones sont généralement actives.
D YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS
Elle est trés proche de ¥, enterolitica. Elle joue un réle important en
pathologie vétérinaire. Chez homme elle provoque surtout une
adénite mésentérique (qui peut simuler une eppendicite), plus rare-
ment une septicémie.
Patmi les trois esp&ces de Yersinia pathogenes pour homme, on trouve ¥. pestis,
agent de la peste, affection que fon robserve pas en France. ¥. enterocolitica est
surtout responsable de diairhées dont la fréquence est probablement sous-estimée.
¥, pseudo-tuberculosis peut provoquer des adénites méseniériques réalisant des
tableaux pseudo-appendiculaires.
Pour en savoir plus
Bottone El Yersinia enterocolitica: the charisma con- _Pety RD, Fetherston JD. Yersinia pests Biologic agent
‘inves. Gla Microbiol Rev, 1997, 10: 257-276. of plague Gin Micabiol Rev, 1997, 10: 35-66.
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Foot Descriptif CCTPDocument9 pagesFoot Descriptif CCTPlot4No ratings yet
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Syllqbus Bilogie Cliniaue PDFDocument352 pagesSyllqbus Bilogie Cliniaue PDFEmmanuel100% (2)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (347)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Les 24 Communes de KinshasaDocument5 pagesLes 24 Communes de KinshasaEmmanuel80% (5)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- TP BioClinDocument28 pagesTP BioClinEmmanuelNo ratings yet
- Zaina Myriam UccDocument67 pagesZaina Myriam UccEmmanuel100% (1)
- SITESDocument5 pagesSITESEmmanuelNo ratings yet
- Projet Exc. Mbutamutu R1Document1 pageProjet Exc. Mbutamutu R1EmmanuelNo ratings yet
- Projet Villa Peter - BiandaDocument5 pagesProjet Villa Peter - BiandaEmmanuelNo ratings yet
- Apres Avoir Examiné Le DosDocument1 pageApres Avoir Examiné Le DosEmmanuelNo ratings yet
- Rodrigue 3Document14 pagesRodrigue 3EmmanuelNo ratings yet
- Henry ProjetDocument1 pageHenry ProjetEmmanuelNo ratings yet
- Projet r1 Ema BiandaDocument1 pageProjet r1 Ema BiandaEmmanuelNo ratings yet
- Devis Des Travaux de Peinturage Du Bureau Du Pere SamuelDocument1 pageDevis Des Travaux de Peinturage Du Bureau Du Pere SamuelEmmanuelNo ratings yet
- AbreviationDocument2 pagesAbreviationEmmanuelNo ratings yet
- Calendrier BondekoDocument2 pagesCalendrier BondekoEmmanuelNo ratings yet
- Anapath GénéraleDocument159 pagesAnapath GénéraleEmmanuel100% (2)
- Pathologie Non TumoraleDocument59 pagesPathologie Non TumoraleEmmanuelNo ratings yet
- TP Morpho PDFDocument15 pagesTP Morpho PDFEmmanuelNo ratings yet
- Wisdom Kuzamba Chacun À Sa Place PDFDocument3 pagesWisdom Kuzamba Chacun À Sa Place PDFEmmanuelNo ratings yet
- Ballade Des Pendus Villon PDFDocument1 pageBallade Des Pendus Villon PDFEmmanuelNo ratings yet
- Liste de Presence 2Document2 pagesListe de Presence 2EmmanuelNo ratings yet
- Concours Math PDFDocument10 pagesConcours Math PDFEmmanuelNo ratings yet
- Concours ChimieDocument12 pagesConcours ChimieEmmanuel100% (1)
- Liste D1 UpcDocument8 pagesListe D1 UpcEmmanuelNo ratings yet
- Chap35 42 PDFDocument33 pagesChap35 42 PDFEmmanuelNo ratings yet