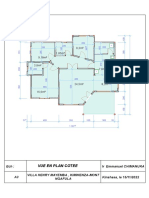Professional Documents
Culture Documents
Chap16 18 PDF
Chap16 18 PDF
Uploaded by
Emmanuel0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views17 pagesOriginal Title
chap16_18.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views17 pagesChap16 18 PDF
Chap16 18 PDF
Uploaded by
EmmanuelCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 17
“arGes?r
Neisseria
NEISSERIA MENINGITIDIS
NEISSERIA GONORRHOEAE
D AUTRES COCCI A GRAM NEGATE
Introduction
) le genre Neisseria est constitue de cocci a Gram négatif groupés par paires, aéro-
anaérobies facultatfs. ll comprend différentes espéces dont deux sont pathogénes :
N. meningitidis et N. gonorrhoeae.
) NEISSERIA MENINGITIDIS
N, meningitidis, ou méningocoque, est une bactérie fragile ne cultivant
que sur des milieux riches, sous une atmosphere enrichie en CO,. Elle
posséde une capsule polysaccharidique dont il existe plusieurs varietés
Permettant tne classification en sérogroupes. Les groupes les plus fré-
quents sont les groupes A, B, C, ¥ et W135. Le groupe B est largement
prédominant en France, le groupe A en Afrique. Divers antigenes de la
paroi permettent aux centies de réigrence de distinguer, a fintérieur
des strogroupes, des types et des sous-types. Ces antigsnes servent
de marqueurs épidémiologiques.
Dd Habitat
La Bactérie est présente dans le rhinopharynx dun grand nombre de
sujets (porteurs sains). Elle est spéciiquement humaine.
DB Transmission
La transmission se fait par voie aérienne. Elle peut étre ropide dans
les collectivités (miliew militaire ou scolaire.
DB Pouvoir pathogéne
Chez un petit nombre dindividus, la bactérie frenchit le bacritre
mugueuse et gagne les meninges par voie hématogéne, ou bien
Produit une septicémi
Méningite
La méningite & méningocoque (ou méningite cérébro-spinale) survient
surtout chez l'enfant et I'adulte jeune. Elle s‘accompagne parfois d'un
eo
ae
CCONNAISSANCES
purpura pétéchial. L’évolution peut étre rapide, d’ou une mortalité de
Fordre de 5 8 10%.
La maledie peut provoquer des épidémies dans certaines collecivités
(en milieu scolaire ou militaire), mais dans nos régions la plupart des
as apparaissent sporediques. On dénombre quelques centaines de cas
par an en France. De grandes énidémies peuvent survenir dans les pays
en voie de développement, en particulier en Afrique sub-saharienne.
Septicémie
Elle se traduit par un syndrome infectieux plus ou moins sévére et
souvent la présence de pétéchies. Une forme particuliére est le purpura
fulminans ott le purpura est rapidement extensif et s'accompagne ¢'un
état de choc et de signes de coagulation intravasculaire cissémis
Son pronostic est trés severe.
D Facteurs de pathogénicité
Adhésines
Elles permettent 'achésion de la bactérie aux muqueuses et sont donc
impliquées dans le processus de colonisation. La principale adhesine
est constituée par les pili, mais des protéines de la membrane externe
imerviennent également.
Capsule
Si le bactétie franchit la muqueuse, la capsule lui permet de résister &
Faction du complément et a la phagocytose. Les anticorps dingés
contre la capsule (spécifiques de sérogroupe) permettent au complé-
ment d'exercer une action bactériolytique. Les anticorps anticapsulaires
sont donc protecteurs. ls peuvent apparaltre en réponse 8 un portage
au niveau du thinopharynx ou a une vaccination. Le capsule du sér0-
groupe B est melheureusement trés peu immunogéne.
Les sujets ayant un déficit génétique portant sur la production des
immunoglobutines ou du complement ont une sensibilite accrue aux
infections 8 méningocoques.
Lipopolysaccharide
Il est appelé lipooligosaccharide en
saccharidique. On pense quil est impliqué dans les phénomenes de
choc qui peuvent survenir au cours des infections a méningocoques
et dans leur forme majeure, le purpura fulminans.
Autres facteurs
Le méningocoque posséde une ig protéase.
Les épidémies sont générelement dues & des clones particuliers. On
ne sait pas bien reconnaitre actuellement les facteurs qui permettent
4 ces clones d'étre plus pathogénes.
Db Diagnostic biologique
Le diagnostic repose sur 'isolement de la bactérie & partir du LCR ou
du sang. Les piélevements doivent étre acheminés rapidement au
1029
essen
laboratoire, en évitant leur exposition au froid. L'examen direct du LCR
ne montre que trés inconstamment des diplocoques a Gram négatif.
Lorsque Ia culture est positive, il faudra confirmer Identification, pré-
ciser le sérogroupe et vériffer la sensibiité aux pénicillines en mesurant
la CMI de la pénicilline G.
administration antérieure d'antibiotiques entraine souvent une négatvité
des cultures. On peut tenter de rechercher les antigénes solubles (capsu-
laires)libérés por la bactérie, mais cette recherche est souvent décevante.
La recherche de méningocoques au niveau du pharynx n'a que peu
de valeur en raison de la fréquence du portage.
D Bases du traitement
Curatif
Le méningocoque est sensible eux S-lactamines. Il est resté longtemps
‘res sensible aux pénicillines, mais ces demiéres années un pourcen-
toge appréciable de souches ayent une sensibiité diminuée aux
pénicilines sont apparues. Ces souches ont subi des modifications au
niveau des génes des PLP (chapitre 10). Leur CMI 8 la pénicilline G
este cependant en régle inférieure @ 1 g/mL La sensibilité aux
céphalosporines de 3° génération n’est pas modifiée. La précocité du
traitement est un éément essentiel du pronostic. La constatation d’un
4ément purpurique de plus de 3 mm de diamétre chez un sujet pré-
sentont un état infectieus, impose d'administrer sens délai une
lactamine par voie parenterale.
Préventif
Méningite et septicémie 2 méningocoque sont a dedaration obliga-
tite. On conseille de traiter entourage immédiat du malade par la
rifampicine pendant 48 heures, car le risque de survenue d'un autre
cas dans entourage est beaucoup plus élavé que dans la population
générale. Signalons que de reres souches résistantes & la rifampicine
Ont ete decites.
ll existe en France un vaccin contre les groupes A et C. Ce vaccin peut
etre propose aux sujets ayant été au contact d'un patient infecté par
un de ces sérogroupes. Il est également conseillé aux voyagours se
rendant dans des régions oli ces sérogroupes sont prédominants
(Aftique sub-saharienne). Il est peu immunogéne avant 'age de 2 ans.
D NEISSERIA GONORRHOEAE
N. gonorrhoece ou gonocoque est une bactérie trés fragile, ne cultivant
que sur un milieu riche, spécifique et sous une atmosphére enrichie
en CO,,
D Habitat
La bactérie est présente dans les voies génitales, uniquement dans
espace humaine.
e103
(46
CONNASSANCES,
=
om
ee
Se
DB Transmission
La transmission est vénérienne. La fréquence de la maladie a diminué
lorsque lépidémie de sida a induit des changements de comportement.
DB Pouvoir pathogéne
La bactérie envahit les cellules de la muqueuse et engendre une réac-
tion inflammatoire. Dans de rares cas linfection locale est 4 l'origine
dune dissémination par voie sanguine.
Tun des génes sien
Sax 0152) permet
seiant de la pine
Infection urogénitale
Appelée aussi blénorrhagie, Cest une des infections vénériennes les
plus fréquentes.
Chez homme, la maladie se traduit habituellement par une urétrite
aigué survenant classiquement 2 a 5 jours aprés la contamination,
mais la durée dincubation peut étre plus longue. En absence de trai-
tement, une extension ascendante peut se produire entrainant
prostatite ou épididymite. Dans un faible pourcontage de cas Vinfection,
peut rester inapparente.
Chez la femme, les symptomes sont généralement moins évocateurs.
infection peut se traduire par une cervicite (pouvant entratner une
eucorrhée) ou plus rarement par une urétrte, une bartholinite. Dans
prés de la moitié des ces, linfection passe inapercue. Des complica-
fions ascendantes peuvent survenir: salpingite (dont les séquelles
peuvent étre cause de stérilité ou de grossesse extra-utérine), inflam
mation pelvienne, périhépatite
Localisations extragénitales
‘On peut observer des infections pharyngées, rectales ou conjonctivales.
Ges demigres peuvent survenir chez le nouveau-né lorsque la mére ast
infectée. atteinte oculaire peut entratner une ophtalmie, cause de cécté
Des bactériémies ou das septicémies peuvent parfois survenir, entrat-
nant volontiers des arthtites septiques.
D Facteurs de pathogénicité
Pili
Ils jouent un role important dans Tadhésion du gonocoque aux
mugqueuses génitales et sont indispensables a expression du pouvoir
pathogéne. Les pili sont constitués principalement d'une protéine
appelée piline. A leur extrémité se trouve une protéine PiIC qui est
impliquée dans Vachésion aux cellules épithéliales. Pour échapper aux
effets de la réponse immunitaite, le gonocoque dispose d'un systéme
complexe. expression des pili peut étre interrompue par un méca-
niisme de variation de phase. Per ailleurs la spécificte immunologique
de la piline peut étre modifiée. Cette variation antigénique résulte de
recombinaisons entre le géne de la piline (pile) et des genes silencicux
pilS. (Fig. 16.1). Les genes pilS intervenant dans la recombinaison
peuvent provenir de la méme bactérie ou d'une autre bactérie (par
transformation).
e104
> Fig, 16.1. Variation antigénique des pil. >
te gine ple est te oe
nf dexpression tO. 1st 4 :
Siisant Paulas pis pils2 pit pil Se
genes ps1 ps2, ete | |§ —SSSS- ZZ} —//§ a —
Ber das gil sere
Bx Couns ce |
oa
Brn care par a
Fin des, ges sien. 1 |
‘Geux (pis?) permet la
Synthese Gun noweau|)|§ yy) _// {remy
‘Griant de la piline
Protéines de la membrane externe
Certaines de ces protéines interviennent dans l'adhésion et invasion
de cellules épithétiales. Parmi elles, les protéines Opa jouent un rdle
important. Elles sont codées par une famille de genes qui peuvent
s‘exprimer ou non de maniére indépendante. Selon la protéine Opa
exptimée, la spécificité antigénique et le tropisme cellulaire peuvent
varier chez la bactérie.
Autres facteurs
Il existe, comme chez A. meningitidis, un lipooligosaccharide qui joue
un 1dle dans les lésions cellulaires que peut provoquer la bactérie. 1!
est lui aussi le siége de variations antigéniques. Le gonocoque posséde
par ailleurs une IgA protéase.
‘Au total, le gonocoque dispose de multiples moyens pour échapper &
{a réponse immunitaire : variation de phase et variation antigénique con-
cemant plusieurs de ses facteurs de pathogénicité, production d'iga
protease, capacité a envahir les cellules épithélales. Cela expiique que
Finfection évolue de manidre chronique en 'absonce de traitement, que
des récidives soient possibles et que la mise au point d'un vaccin se
heurte & des diffcultés qui n’ont pu jusqu’a présent étre surmontées.
Db Diagnostic biologique
La méthode de choix repose sur I'solement de la bactérie par culture
sur des milieux spécifiques. Chez homme, le prélévement porte habi-
tuelloment sur I'Scoulement urétral. Chez la femme, les préléverients
portent sur Iurétve, endocol, la marge anale. En fonction du contexte,
les prélvements pourront porter sur dautres localisations. Le gono-
coque étant une bactérie trés fragile, il est impératif d'ensemencer
immédiatement les préléverents ou bien de les acheminer au labo-
ratoire dans un milieu de transport adapté. Lorsque les prélévements
Proviennent d'une surface muqueuse (qui n'est pas stérile) les prélé-
vements sont ensemencés 8 Ia fois sur des milicux sélectifs et non
sélectifs. La culture permet identification (par l'étude de caractéres
biochimiques) et la réalisation d'un antibiogramme.
examen direct du prélévement permet souvent un diagnostic pré-
somptif chez fhomme, en mettant en évidence des cocci 2 Gram
négatif dans certains polynucléaires.
1059
CONNAISSANCES:
Les autres méthodes de diagnostic reposent, soit sur des méthodes
immunologiques, soit sur des méthodes de biologie moléculaire
(hybridetion, amplification génique).
Notons que la recherche de gonocoque est souvent coupiée a celle
de Chlamydia trachomatis.
D Bases du traitement
Curatif
Les souches sauvages de gonocoque sont sensibles & la pénicilline G,
mais des résistances a cet antibiotique sont devenues fréquentes, soit
par modification des PLP, soit plus souvent par l'acquisition dune B-
lactamase plasmidique. La spectinomycine (un aminoglycoside) a été
utilisée dans le traitement des infections génitales & gonocoque, mais
des souches résistantes sont également apparues. La résistance & la
tétratétracycline est assex fréquente. Le traitement habituel repose
actuellemient sur les céphalosporines de 3* génération ou les fluoro-
auinolones. Cependant de rates souches de sensibilité diminuée ou
résistantes aux fluoroquinolones ont été observées.
Préventif
identification et le traitement du (ou des) parteneire(s) est indispen-
sable si fon veut prévenir les récidives, car la maladie ne paraft pas
induire d'immunité de protection.
Par ailleurs usage du préservati est un moyen de prévention dassique.
Ladministration systématique d’un collyre contenant des agents anti-
bactériens, au nouveau-né, est destinée @ prévenir une éventuelle
contamination conjonctivele.
D auTRES COCCI A GRAM NEGATIF
D Autres Neisseria
Les autres espéces de Nelsserio sont des commensales des voies res-
Piratoires. I est exceptionnel quielles produisent des infections
profondes.
D Moraxella
Les bactéties sont arrondies ou ovoides (cocco-baxiles).
Morexolla catarrhalis, désignée aussi sous le nom de Branhamella
catarrhalis, est un commensal des voies aériennes superieures. La bac-
thrie est responsable dotites et de sinusites, surtout chez l'enfant. Ciest
aussi un agent de surinfection dans les pathologies bronchiques chro-
Tiiques. La bactérie produit souvent une Blactamase qui la rend
résistante & la péniciline G et aux aminopénicllines. Elle est par contre
sensible a association d'une aminopéniciline et d'un inhibiteur de
Prlactarase.
Diautres espéces de Moraxella (M. nonliquetaciens) sont
dans des infections oculaires. Elles sont sensibles & la pénicilline G.
D Kingella
Ce sont des commensales des voies aériennes supérieures. K. kingae
est une bactérie trés fragile, impliquée parfois dans des infections
ostéo-articulaires de enfant, et plus raremient dans d'autres infections
profondes (endocarcite). La bactérie est irés sensible aux antibiotiques.
| Les Neisseria pathogenes sont des germes fragiles. /V. meningitidis est 'un des prin-
cipaux agents impliqués dans les méningites bactériennes. Cas méningites peuvent
parfois se propager sur un mode épidémique. 1. gonorrhoeae tient une place domi-
+ nante dans les maladies sexuellement transmissibles.
Moraxella catarrhalis peut provoquer des otites ou des surinfections bronchiques.
Pour en savoir plus)
Murphy TM. Branhamella catarrhalis: epidemiology, Van Deuren M, Bxandeacg P, ven der Meer JVM,
sutface antigenic structure, and immune resporse Update on meningococcal disease with emphasis on
Microbiol Rev, 1998, 60, 267-279. pathogenesis and clinical management. Gi Micro-
Riou IY, Guibourdenche M. Aspects actuels de la biol Rev, 2000, 13: 144-166.
sistance aux entbiotques de Neisseria goror Ven Duynhoven Y. Te epidemiblogy of Nesseria goo
shoene, Rey Fr Lab, 1997, 294: 31-37. rhoeae in Europe Microbes infect. 1999, 1: 455-454.
( Bacilles a Gram positif
Corynebacterium
D CORMNEBACTERIUM DIPHTERINE
D AUTRES CORYNEBACTERIES
troduction
} Le genre Corynebacterium est fait de bacilles Gram positif, a¢robies (et généralement
anaércbies facultatifs) dont le graupement « en lettres chinaises » est caractéristique. 1
comprend une espéce trés pathogéne, C. diphieriae, agent de la dightérie, ainsi que des
espéces commensales pouvant parfois se comporter comme des bactéries opportunistes.
D CORYNEBACTERIUM DIPHTERIAE
La bactérie doit son pouvoir pathogene a la sécrétion d'une toxine tres
puissante. On peut s‘en prémunir par la vaccination.
D Habitat
Le bactérie est présente dans le pharynx et parfois sur la peau. Dans
les régions ot la diphtérie est presente a état endémique, les porteurs
seins sont trés nombreux.
D Transmission
La bactérie se transmet par voie eérienne ou per contect direct
La fréquence de la diphtérie dépend essentiellemient de état immunitaire
de la population. Lorsque la vaccination antidiphtérique est insuffisante
ou abserte, la maladie se propage par épidémies touchant surtout les
enfants, Dans les pays ott la vaccination est bien appliquée (comme en
France), la maladie est devenue exceptonnelle. Un relachement dans les
mesures de prévention peut permetire Ie retour de la maladie, comme
cela s'est produit récemment dans l'ex-Union soviétique. La population
adulte (qui nentretient pes son immunité) savére vulnérable.
D Pouvoir pathogéne
Angine diphtérique
Crest une angine & fausses membranes, Cest-i-dite constituée d'un
‘exsudat blanchatre, adhérent, de nature fibrineuse. Elle est de caractére
extensif et tend a déborder ies loges amygdaliennes.
Elle peut se compliquer secondairement de signes toxiques divers
(troubles du nythme cardiaque, paralysies s‘installant suivant une
am
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (347)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- SITESDocument5 pagesSITESEmmanuelNo ratings yet
- Projet Exc. Mbutamutu R1Document1 pageProjet Exc. Mbutamutu R1EmmanuelNo ratings yet
- Foot Descriptif CCTPDocument9 pagesFoot Descriptif CCTPlot4No ratings yet
- Projet Villa Peter - BiandaDocument5 pagesProjet Villa Peter - BiandaEmmanuelNo ratings yet
- Apres Avoir Examiné Le DosDocument1 pageApres Avoir Examiné Le DosEmmanuelNo ratings yet
- Rodrigue 3Document14 pagesRodrigue 3EmmanuelNo ratings yet
- Les 24 Communes de KinshasaDocument5 pagesLes 24 Communes de KinshasaEmmanuel80% (5)
- Henry ProjetDocument1 pageHenry ProjetEmmanuelNo ratings yet
- Projet r1 Ema BiandaDocument1 pageProjet r1 Ema BiandaEmmanuelNo ratings yet
- Devis Des Travaux de Peinturage Du Bureau Du Pere SamuelDocument1 pageDevis Des Travaux de Peinturage Du Bureau Du Pere SamuelEmmanuelNo ratings yet
- AbreviationDocument2 pagesAbreviationEmmanuelNo ratings yet
- Calendrier BondekoDocument2 pagesCalendrier BondekoEmmanuelNo ratings yet
- Syllqbus Bilogie Cliniaue PDFDocument352 pagesSyllqbus Bilogie Cliniaue PDFEmmanuel100% (2)
- Anapath GénéraleDocument159 pagesAnapath GénéraleEmmanuel100% (2)
- Pathologie Non TumoraleDocument59 pagesPathologie Non TumoraleEmmanuelNo ratings yet
- TP BioClinDocument28 pagesTP BioClinEmmanuelNo ratings yet
- TP Morpho PDFDocument15 pagesTP Morpho PDFEmmanuelNo ratings yet
- Zaina Myriam UccDocument67 pagesZaina Myriam UccEmmanuel100% (1)
- Wisdom Kuzamba Chacun À Sa Place PDFDocument3 pagesWisdom Kuzamba Chacun À Sa Place PDFEmmanuelNo ratings yet
- Ballade Des Pendus Villon PDFDocument1 pageBallade Des Pendus Villon PDFEmmanuelNo ratings yet
- Liste de Presence 2Document2 pagesListe de Presence 2EmmanuelNo ratings yet
- Concours Math PDFDocument10 pagesConcours Math PDFEmmanuelNo ratings yet
- Concours ChimieDocument12 pagesConcours ChimieEmmanuel100% (1)
- Liste D1 UpcDocument8 pagesListe D1 UpcEmmanuelNo ratings yet
- Chap35 42 PDFDocument33 pagesChap35 42 PDFEmmanuelNo ratings yet