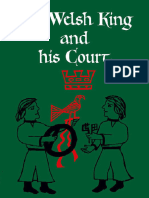Professional Documents
Culture Documents
Bovon Bouvier Étienne Première Martyr BHG 1649d Without Quotations
Bovon Bouvier Étienne Première Martyr BHG 1649d Without Quotations
Uploaded by
Basil Lourié0 ratings0% found this document useful (0 votes)
25 views22 pagesOriginal Title
Bovon Bouvier Étienne première martyr BHG 1649d without quotations
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
25 views22 pagesBovon Bouvier Étienne Première Martyr BHG 1649d Without Quotations
Bovon Bouvier Étienne Première Martyr BHG 1649d Without Quotations
Uploaded by
Basil LouriéCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 22
E-TIENNE LE PREMIER MARTYR:
pu LIVRE GANONIQUE AU RECIT. APOCRYPHE
Frangots Bovon Ev Bertranp Bouvier
reckhardl Plamacher t fait connaitre par la monographie qu'il a
ee A 8 ae *
sonsacrée au livre des Actes des apétres et par Particle quill a rédigé
cosa
aur es Actes apocryphes des ap6tres.' En s'associant a Phommage qui
jujest rendu ici, les auteurs de ces pages partagent ce double intérét: ils
aitirent Pattention sur la fin de la vie d’Etienne dans le canon et au-dela
du canon; du livre des Actes aux narrations apocryphes,
Outre les chapitres du NT (Ac 6,8-8,3),? il existe en effet, relative au
premier martyr, une abondante littérature de la fin de Pantiquité et de
repoque byzantine. Il y a d’abord les références au martyre d’Etienne.
Dés le récit des martyrs de Lyon et de Vienne, par exemple,’ la mort
dEtienne sert de modéle aux victimes des persécutions. Il y a ensuite
les sermons qui sont prononcés en son honneur, par Hésychius de Jéru-
salem, Grégoire de Nysse, Pierre Chrysologue et Maxime de Turin en
particulier! Stimulée enfin par la découverte des reliques que fit un
prétre de Palestine, Lucien Caphar Gamala, en 415 aprés Jésus-Christ,
la vénération du saint se développe de fagon fulgurante. Que ce soit &
'E. Phimacher, Lukas als hellenistischer Sc
schichte (SUNT 9),
(1978) 1-70,
Voir la bibliographie sur Ac 6-8 dans les commentaires de J. Jervell, Die Apostel-
(hich dbersetzt und erklart (KEK 5), Gottingen 1998, 223-257; et de C.K. Barrett
Critical and Exegetical Commentary on the Acts of the Apostles (ICC), 2 vols., Edin-
a 1994-1998, 1: 318-88; voir aussi Particle de F Bovon, La figure de Moise dans
igh Luc, dans: R. Martin-Achard (éd.), La figure de Moise (PFTUG 1), Genéve
18, 47-65,
Référence &
1 ce & c
Tere as
ifisteller. Studien zur Apostelge-
Gottingen 1972; idem, art. apokryphe Apostelakten, PRE.S 15
-xte préservé par Eusébe de Césarée, Hist. eccl. V,2,5; voir aussi
“en, De patientia 14,1
+
Voir BD, . : :
AUBoll 86 (ygggre, 4¢ Panégyrique de saint Etienne par Hésychius de Jérusalem,
sen, oh 12) 81725 M. Aubineau, Les homes festales d’Hesychius de Jéru-
ne Dead * homélies LXV (SHG 59), Bruxelles 1978, 289-350; il s'agit de lho-
M Sanctum Stace dition et du numéro BHG 16576; Grégoire de Nysse, Encomium
hen mit apps AME Protomartyrem, Griechischer Text, cingeleitet und herausge-
TENG (gba crticus und Ubersetzung von Otto Lendle, Leiden 1968; il s'agit
Ten, Homily ge Chrysologue, Sermo 154 (PL 52, 608-609); Pseudo-Maxime de
Mls etitge tL 57, 379-384), aujourd'hui considérée comme Pccuvre de Césaire
‘comme Sermo 219 (CCSL 104, 867-870).
310 FRANGOIS BOVON & BERTRAND BOUVIER
Jerusalem ou en Occident, les restes sacrés du chrétien helléniste pro.
‘voquent des miracles et suscitent des récits de miracle, convertisens
Minorque® et provoquent admiration d’un Augustin d’Hippone.’ La
révélation des reliques, racontée en grec par Lucien," est aussitat ime
duite en latin par Avitus, un compagnon de Paul Orose envoyé a FEst
pour grossir les rangs des adversaires de Pélage.’ Outre le grec et le
latin, elle est préservée en diverses langues dont le syriaque, le géorgien,
Ie slavon et Parménien."” C’est cette révélation surtout qui a retenu Pat.
Voir les sermons d’Augustin, Sermo 50,9,10 (PL 38,325); Sermones 314-319 (PL.
38,1425-1442); Sermones 320-324 (PL 38,1442-1447), et les articles de H. Delehaye, Les
premiers «Libelli miraculorum», AnBoll 29 (1910), 427-434, et Les recueils antiques
de miracles des saints, ibid. 43 (1925) 5-85 et 305-325, particuliérement 74-85; R.
Etaix/B. de Vregille (éd.), Le «libellus» bisontin du XI° siécle, ibid. 100 (1982), 581—
605; B.A. Clark, Claims on the Bones of Saint Stephen: The Partisans of Melania and
Church History 51 (1982), 141-156; P. Force, La spiritualité des miracles de
snne, dans: Studia Patristica go, E.A. Livingstone (éd.), Leuven 1997, 183-190.
© Voir le récit contemporain rédigé par Sévére de Minorque dans V’édition critique
de J. Amengual i Batle, Els origens del cristianisme a les Balears i el seu desenvolupa-
ment fins a Pépoca musulmana, vol. 2, apéndix (fonts, bibliografia i index), Majorque,
1992, 10-64; voir E.D. Hunt, St. Stephen in Minorca: An Episode in the Jewish
Christian Relations in the Early 5 Century A.D., JThS NS. 33 (1982), 106-123,
7 Ouuze les sermons signalés ci-dessus & la n. 5, voir De civitate Dei, 22,8; P. Brown,
Augustine of Hippo, Londres, 1967, 413-418.
I s'agit des numéros BHG 1648x, 164By et 16482. Seule la pice BHG 1648y a
été éditéc, dans une publication critiquée par H. Delehaye (Quelques dates du marty-
rologe hiéronymien, AnBoll 49 [1931] 25): N. Franco, L’Apocalisse del prete Luciano di
Kaphar Gamala e la versione di Avito, ReO 8 (1914), 293-307. Nous espérons publier
la version BHG 1648x en tenant compte principalement du manuscrit en onciales,
Sinaiticus graecus 493. A propos de ce récit, on lira avec profit les remarques métho
dologiques de P. Peeters, Le tréfonds oriental de Phagiographie byzantine (SHG 26),
Bruxelles, 1950, 53-385 voir aussi F: Nau, Notes sur les mots nohruxés et nobirevouevos
et sur plusicurs textes relatifs saint Etienne, ROG 2 série, 1 (1906), 198-216,
Tl existe deux recensions latines qui ont été éditées critiquement: voir E, Van-
derlinden, Revelatio sancti Stephani (BHL 7850.6), REByz 4 (1946), 178-217; la relax
tion entre ces deux recensions a provoqué dintenses discussions; voir H. Leclercq, art
Etienne (martyre et sépulture de saint), DACL 5,1 (1922) 624-671, qui offre aux col.
641-646 une traduction frangaise de la recension A.
™ BHO 1087a pour le syriaque; voir H. Leclercq, art. cit., 640-641; il existe des frag-
ments christo-palestiniens (BHO 1087b), voir F. Schulthess, Christlich-Palaestinische
Fragmente aus der Omajjaden-Moschee zu Damaskus, AGWG-PH NE. 83 (1905),
102-106; pour le géorgien, voir M. van Esbroeck, Jean Il de Jérusalem et le culte de
s Brienne, de la Sainte-Sion et de la Croix, AnBoll 102 (1984), 99-127, particuliérement
101-105, qui renvoie aux éditions; pour le slavon, voir I. Franko, Beitrage aus dem Kir-
chenslavischen zu den neutestamentlichen Apokryphen, III, Revelatio sancti Stephani,
ZNW 7 (1906), 151-171; pour Parménien, voir B-Ch. Mercier, L'invention des reliques
de saint Etienne, édition et traduction de la recension arménienne inédite, ROC 30
(1946), 341-369.
ETIENNE LE PREMIER MARTYR
gut
tention des chercheurs, Placé en téte de cette dxoxddvyg ou circu
fagon indépendante, un récit des detniers jours d’Etienne de a
aye et de ss funcralles se répandl abondamment a Vépequetenae
tine. II existe sous diverses formes en grec." Un autre récit est ae
parlois 4 ces deux documents dans les manuscrits byzantins, celui de la
translation des reliques du saint de Jérusalem & Constantinople. Ce den.
nier texte peut lui-méme s’achever, suivant certains témoins, par un ser-
mon prononcé par ’évéque Métrophanés a larrivée des reliques dans
de
la capitale."
‘Tant que le dossier d’Etienne n’aura pas été examiné dans sa totalité
iI ne sera pas facile de dater le récit non canonique de la passion, ni de
décider de sa relation a la révélation du prétre de Caphar Gamala,"
Pour y parvenir, il faudra en particulier rechercher les souvenirs que le
martyre d’Etienne a laissés dans la littérature chrétienne des deuxiéme
et troisiéme siécles pour constater si le récit de la passion s’appuic
sur des données traditionnelles anciennes. En attendant, il est possible
déditer les diverses formes grecques que ce récit a prises au cours des
siécles, Certaines ont été éditées il y a longtemps par C.Ch. Douka-
kis en 1893 et A. Papadopoulos-Kerameus en 1898."* D’autres l’ont été
récemment par A. Strus.'° I] en est une qui, 4 notre connaissance, est
restée inédite jusqu’a présent. Elle porte le numéro 164gc dans la Biblio-
theca Hagiographica Graeca éditée par F. Halkin. C'est Pédition de cette
"Tl s‘agit des numéros BHG 1649, 16492, 1649b, 1649¢, 16494, 1649f, 1649h. Ces
rélérences sont & prendre avec précaution, car il ya des variations non seulement d'un
numéro a autre, mais un manuscrit a Pautre, Certains documents, classés parm les
passions, peuvent contenir aussi le récit de la translation des reliques.
"= Ts'agit des numéros BHG 164ge, 1650, 1651, 1651b, 1651c et 16514. La remarque
faite & la note précédente vaut ici aussi. Sur ces divers textes, voir la présentation de
_ Abel, art. Etienne (saint), DBS 2 (1934) 1134-1139-
Ged, A Strus, Lotigine de Papoeryphe grec de la Passion de s. Eien ;
lux manuscrits récemment publiés, Ephemerides liturgicae 112 (1998), 18-57 SY es
"sué de fagon aventureuse a notre sens.
iva nee Doukakis, Méyag Zuvagagueriig névtww vv
‘Awan TOURTOY Eogratonévan, Athénes 1894 28-451 A.
ang itt Hoooci yung oravohoyias, vol. 5, Saint Péte
Phqu iu 54-69, cet éciteur publie la piece BH 165,
1864, tn «Jerusalem 4 Constantinople, voir aussi 418-4205 ¢
1b pn loge a )
Sime ¢ pike BG i6ggb a été éditée par A. Sirus, Una Hoag
Santa ete Ing re Stefi Prana Sale 98
se "ces, ' et 1 lans , La pa
mi sage MaMoscritt led. 38 (1996), 21-61. Nous remercions
ui a attiré notre attention sur ces travaux.
1. A propos de
dey vay xo" Gravee TOY
Papadopoulos-Kerameus,
rsbourg 1898, 28-33: vor
a savoir la translation des
aux 70-73, la pice BHG
familiare sulla pas”
1-96; le meme
rassione di santo
Je B. Marek
312 FRANGOIS BOVON & BERTRAND BOUVIER
recension telle que la reproduit le
nous souhaitons offrir en homn
que deux autres manuscrits 3
A 83) et Athos, Laura 15}
contentons de pré
Bibliotheque vati
manuscrit Vaticanus graecus 679 que
¢ A Eckhard Plimacher. Nous savons
tu moins la transmettent, Athos, Lavra 459
> (A 70). Pour Pheure, toutefois, nous nous
nter le texte fourni par le manuscrit conservé a la
ane." Nous le désignons par le sigle A dans apparat,
A\ la lecture de ce document, ce qui frappe, c'est la combinaison
elements canoniques et apocryphes. Le récit commence par une pre-
miere partie, en-deca du livre des Actes des apétres. Il cherche a expli-
quer Vorigine d'une opposition qui, tout en épargnant les apétres, se
manifeste a Vencontre d’Etienne (Ac 6,8-15 et 8,1-3). Pour ce faire,
il décrit le risque pris par Helléniste qui simmisce dans une dispute
au sujet de Jésus-Christ, dispute qui met aux prises divers groupes
juifs. Par ailleurs, alors que la christologie occupe une place limitée
dans le discours d’Etienne, tel que le transmettent les Actes canoniques
(Ac 7.52), elle occupe ici la premiere place dans l’intervention initiale
du saint. Celui-ci souligne en effet les étapes de la vie de Jésus dés
son enfance, ainsi que le caractére providentiel et salvifique de l'incar-
nation. Aprés ce premier discours d’Etienne, le récit rejoint, en une
deuxiéme partie, le texte canonique moyennant une transition: sila
présentation d’Etienne (Ac 6.8), qui a déja été faite, s'avére inutile, 'op-
position face au témoin du Christ est formulée, mais elle lest en termes
plus généraux que dans le texte canonique (Ac 6,9); le cadre solennel,
le sanhédrin, est mentionné avant affirmation du succés rhétorique
d’Etienne (Ac 6,12 et 10) et Pénoncé des griefs fusionne deux données
canoniques distinctes (voir Ac 6, 11 et 13-14). I faut noter surtout que
auteur ne dit pas qu'il cite, ni ne rédige aucune introduction, dés qu’il
cite Ecriture.”” Aprés avoir repris de fagon libre Ac 6,8-13, il cite doré-
navant le texte canonique de fagon littérale dés Ac 6,14 (il y a certes
de menues variantes). Ce sont ainsi le visage rayonnant d’Etienne que
contemplent les participants aux débats (Ac 6,15), la bréve intervention
‘© Voir P. Franchi de” Cavalieri et hagiographi Bollanciani, Catalogus_codicum
hagiographicorum graecorum Bibliothecae vaticanae (SHG 7), Bruxelles 1899, 22°";
S. Eustratiadis, Souxdijooua dnogernxéy xaraksyov Barozediov xai Aavgas. Mvnneta
Gnohoyud (Aynopertaxi BiBuoPipen, 4), Paris-Chenneviéres-sur-Marne, 71; A. Ehrhard,
Uberlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der
griechischen Kirche (TU 50-52), Leipzig 1937-1952, Il, 487" et 4874,
© Le scribe, toutefois, dés qu'il reconnait l'Ecriture sainte, surtout les Actes des
aptres, le signale par des guillemets dans la marge. Il s'agit de la marge des lignes 35
36. 38-44. 46-129 et 132-135, Les guillemets que nous avons retenus ne correspondent
pas & ceux du scribe: ils encadrent non les citations bibliques, mais les discours tenus.
seme F
4 beso!
du Fils
et laP
Jes mot
priére «
“Accent
questic
retomt
enlevé
port at
prendt
Crest
cruelle
du sob
confes
canon
yn Q
une p
quil
suit Pp
NNE LE PREMIER MARTYR
étre (Ac 7,1) et surtout le long discours @Etien
53) quii sont cités intégralement. Les lectern
Mipris de lire la forme dite byzantine ow impe "
as surpris de : :
a ides apatres, ce qui fournit un indice de
AdEeS Fqussi que de fagon quas
ici le
sont
riale du texte des
1 datation du texte." Is
ystématique auteur rapporte
notent aussi ee tout ce
guia trait a Tsraél a la deuxiéme personne du pluriel (par exemple
vos peres» a la ligne 5 de la page 322), 1a oi le livre des Actes porte
ta premiere personne du pluriel (par excmple, «nos péres», Ac 7.1) la
rupture avec Israél est consommée au temps oi notre auteur écrit,
‘Arrivé a ce point du récit, auteur songe déja a donner, en une troi-
seme partie, une suite apocryphe au texte canonique et pour cela il
a besoin d'une nouvelle transition. Il cite Phostilité des Juifs, la vision
du Fils de Phomme (Ac 7,54-57a) ainsi que la condamnation d’Etienne
et la présence de Saul (Ac 7,57b-59a); mais il garde pour plus tard
les mots «Seigneur Jésus, regois mon esprit» (Ac 7,59b) et la derniére
priére du martyr: «Seigneur, ne leur impute pas ce péché» (Ac 7,60).
‘Accentuant opposition au judaisme, il ajoute au texte des Actes une
question rhétorique du martyr, qui se référe a Mt 27,25 (que son sang
retombe sur nous), et une exclamation des grands prétres (qu'il soit
enlevé de la terre). Vient alors, presque entiérement nouvelle par rap-
port au livre des Actes, la fin de histoire. Gamaliel y surgit pour s’en
prendre a Saul, son ancien éléve. Le portrait de Saul y est noirci.
Crest lui qui dirige l’exécution capitale, une lapidation particuligrement
cruelle («les jets de pierre étaient si drus qu’ils masquaient les rayons
du soleil»),'” alors que Gamaliel prend le parti d’Etienne de fagon plus
confessante qu'il ne V’a fait en protégeant les apétres dans les Actes
canoniques (Ac 5,34-40): il souhaite partager lui-méme le sort du mar-
tyr. Quant a Etienne, a cette heure qui est sa derniére heure, il ajoute
une prophétie A sa double priére (Ac 7, 59-60): il prédit a Saul le sort
qu'il lui fait subir, a savoir le martyre. Le récit apocryphe se pour-
suit par la mention de la persécution contre PEglise de Jérusalem et
de Fensevelissement d’Etienne (Ac 8,1-2). Il contient toutefois certains
Deux exemples: notre manuscrit porte dwooev en Ac 7,17, 14 oft le texte feppicn
4 Guokéynoey; il a &yyehos xugl ‘Ac 1a of le texte égyptien a simplement
; il a &yythog xugiov en Ac 7,30, zyptien
Sritios. On note également quelques legons propres au texte dit occidental (par ex.
WSN. 24, 34 et 37 d’AC
q ‘Ac 7): :
dee LY lt reprise d'un motif qui remonte & Hérodote dans le contexte de la bats xe
s Thermopyls, Enquétes 7,226, Quand on annonce au valeureux guervies Spar
Abe les féches des ennemis, en raison de leur nombre, cacheront les rayons dt S010
Poste avec fierté qu'il pourra ainsi se battre a l'ombre.
314 FRANGOIS BOVON & BERTRAND ouVIER
détails non canoniques tls la localisation de la tombe, i .
dtu cercucil employe et Vinseription qui y figurait Le fy ce
tion comprend la requéte de Gamaliel aux apotres Coffin a f
tune sépulture sur ses terres, ainsi que le baptéme de Nic ‘ed
2), baptéme qui risque de le conduire au martyre
par la mention du décés naturel du visteur noche
puis par une référence curieuse & Lucien, le prétre
liel possédait ses terres, et enfin par la date du man
décembre.
devenu chrétien
du lieu ot Gama,
re d' Etienne, le 35
Toutes les recensions greeques de ce récit, nous Pavons 1
as encore éditées. En comparant celles qui sont access
vons dire ce qui suit: BHG 164gb est un récit différent du nowe (@HG
1649¢): Etienne y comparait devant Hérode. BHG 1649h est paralléle
A notre texte, a ceci prés que le premier discours Etienne s'achéve par
tune envolée apocalyptique. Il en différe aussi par la présence de Pilate,
de sa femme et de ses enfants aux cétés d’Abibos, Nicodéme et Gama.
Hel. Il sen distingue enfin par la mention d'un Alexandre, qui garde
Etienne en prison (un personage de ce nom tient le réle de gardien
de la tombe d’Etienne dans le récit de la translation, BUG 1650), BHG
164o¢ est lui aussi proche de notre texte, mais il s'en distingue par la
Présence, encore plus forte, de Pilate, la mort, sous les jets de pierres,
@Abibos, Nicodéme et Gamaliel, soucieux de s'interposer pour pro.
téger Etienne, et l'affirmation que les reliques, 4 la demande expresse
du protomartyr, resteront cachées jusqu’a leur révélation. Cette recen-
sion présuppose donc la Revelatio (BHG 1648). Quant 4 BHG 164gt, la
Page du Synaxaire de I’Eglise de Constantinople, il parait étre un agence-
ment de diverses parties essentielles de notre récit sous forme d’extraits
cités avec précision. Notons que notre texte ignore Abibos, présent dans
autres recensions et, surtout, dans la Revelato,
Une comparaison rapide avec les versions donne le résultat suivant:
Ie slavon et le géorgien transmettent Phistoire du martyre, tandis que
le latin et le syriaque traduisent la Revelatio.” Curieusement, le slavon
correspond souvent mot pour mot & notre texte, pour s’en éloigner
subitement, aller son propre chemin ou rejoindre d'autres recensions
greeques. Quant aux différents documents coptes et arabes relatifs &
Etienne, ils n'ont que peu ou pas de points communs avec notre texte:
loté, ne sont
bles, nous pou-
& Les références aux publications relatives & ces versions se trouvent ci-dessus ax
n.getio.
* Voir BHO 1086 et 1093; M. Geerard, Clavis apocryphorum Novi Testament!
Nott
ont nef
Jus tot
yaphic
parler
sait Or
dignes
ter abs
yenéra
nautait
transm
docum
Btienn
statut
critere
récit ©
sainte
conna
tuait
quilr
Papoc
distinc
Vhisto
ETIENNE LE PREMIER MARTYR
document posséde un statut que les exége
Notre Baerae .
é jusqu’a ce jour. Ni totalement canonj Ct les historiens
ont néglig
een HL corr
ier, Il corres aes
ee Origéne ct qu’admettait Eusébe de Camry
diqnes ce la lecture publique a Péglise, et les textes batards, ann
ter absolument. Font partie de cette troisieme categorie dive a reje-
weperables, propres A la piété individuelle et a la venératon en
‘autaire, en un mot des documents qui, a cdté de IReriture sata
tranamettent la tradition de PEglise. Les scribes qui ont recopié un tel
document le reconnaissaient utile la célébration de la fte de seint
Etienne, le jour anniversaire de son martyre. Ils lui conféraient donc un
statut hagiographique. Mais pour l'auteur d’un tel document, d'autres
crittres et d'autres caractéristiques entraient en ligne de compte: le
récit complétait la narration des Actes canoniques, relevait de histoire
sainte et permettait d’en savoir plus sur le premier martyr. Une telle
connaissance n’était pas avant tout historique, car le document consti-
tuait un écrit d’édification et de piété. Certain de la valeur de Phistoire
quil racontait et du statut intermédiaire possible entre le canonique et
Papocryphe, il se souciait de la qualité de Pécriture et du choix judi-
cieux du genre littéraire, plus qu'il ne vouait un respect aveugle aux
limites du canon. Dans le cas de la mémoire d’Etienne, ni inspiration
de Esprit saint, ni le souvenir des épisodes sacrés ne se confinaient,
ses yeux, aux trois chapitres du livre des Actes des apétres (Ac 6,8-8,3).
Lauteur se situait aux cétés de l’évangéliste Luc, auteur des Actes des
apétres, et rapportait un chapitre de Phistoire de Dieu avec son peuple.
I louait la foi du premier martyr autant qu'il honorait sa mémoire, Nos
distinctions du canonique et de ’apocryphe, de 'hagiographique ct de
historique ne Vintéressaient guére.
que reconnais-
les textes sacrés,
[COts),Turhout 1992, ns 3oo-gors ¥. Abd ‘Al-Masih, A 7
Stephen the Archdeacon, Le Muséon 70 (1957), 329-3473 J. Gea
Zu cinem Topos der koptischen Martyrerliteratur (mit zwei ‘Anhangen), dans: G. Kod
r des Orient,
(¢d., Studien 2ur spatantiken und frihchristlichen Kunst und Kultur des Or!
: , sur Etienne Ie
Wiesbaden 1982, 31 Lucchesi, A propos d'un rd aM aah/A. Khater,
Protomantyr (BHO 1 422; i
y |, AnBoll ro1 (1983), 421-422) Ct 13 Studi-
an Arabic ‘Apocryphon 3 Saint Stephen the Archdeacon, dans: Collectanea 15
ecumenti (SOG.15), Le Gaire 1968-1969, 163-199 ‘tre opinion
2 faut se mee plusieurs passages de 50 rune pout corer (ed New
‘Origéne; voir W. Schneemelcher, Haupteinleitung, in: W ae vines, 5¢ edition de la
‘stamentliche Apokryphen in deutscher Ubersetzungs 2 VOWS
‘optic Apocryphon of Saint
Horn, Der erste Martyrer
—=—
6 FRANGOIS ROVON & BERTRAND BOUVIER
1 fallait pourtant que le credo centré sur le Christ, la litungie bapy
ale et cucharistique, Pautorité épiscopale et la régle monastique soem
fermement établis pour qu'un auteur se permette une telle liberté face
A Micriture sainte, En osant continuer laeuvre de Luc, compléter le
des Actes, combler Ies lacunes du canon scripturaire, il prenait des
risques. Ce qui compiait a ses youx n’était pas la lettre de 'Ecriture,
mais le contenu d'un message qui articulait le foi en Jésus-Christ et la
communion des saints pass¢s et présents. Dans le cas d’Etienne, comme
dans celui de Paul ou de Jean, cette communion prenait une valeur par-
ticuliére, car il s‘agissait d’un chrétien de la premiére génération, d’un
témoin privilégié du Christ.
Il se trouve qu’une telle liberté ne plut pas a chacun. Le Décret de
Geélase (en fait un Pseudo-Gélase), document originaire de Gaule, sans
doute a la fin du V- sidcle, condamne une Revelatio sancti Stephani, apo-
cryphus.* On ne sait pas avec certitude quel texte relatif 4 Etienne
cette inscription condamne. Il peut s'agir de Panoxdhuyps, de la Reve-
Jatio de la sépulture d’Btienne que regut Lucien, le prétre de Caphar
Gamala. On voit mal pourtant, en le comparant a d’autres inventions
de reliques, ce qui aurait poussé les auteurs du Décret & rejeter un tel
document comme apocryphe. Gomme il sert de prélude a la Revelatio
en de nombreux manuscrits, le récit de la Passion d’Etienne peut avoir
été A lorigine de cette condamnation, De tels textes, mi-canoniques,
mi-apocryphes, ont da finalement inquiéter les consciences picuses.” Il
n’a jamais été facile de s'entendre sur le contenu de la tradition chré-
tienne,’ qu'elle s'appelle apostolique ou ecclésiastique.”*
collection fondée par E, Hennecke, Tubingen 1987-1989, 23-25. Pour Eusébe, voir
Eustbe de Césarée, Hist. eccl., 3,25
2 EB, Preuschen, Analecta, Kiirzere ‘Texte zur Geschichte der alten Kirche und des
Kanons, 2 volumes, 2" édition, Tubingen 1909-1910 (reprint Francfort 1968), 2, 60 (26°
titre; voir B. von Winterfeld, Revelatio sancti Stephani, ZNW 3 (1902), 358.
% Jusquiiei, parmi les auteurs de collections d’apocryphes chrétiens, seuls MJ.
James, The Apocryphal New Testament, Oxford, 1969, 564-568, ct M. Erbetta, Let-
tere ¢ Apocalissi (Gli Apocrifi del Nuovo Testamento 9), Turin 1969, 397~408, ont prété
attention a notre texte, ainsi qu’a la Revlato.
® Noir E Bovon, Réception apocryphe de Mivangile de Luc et lecture orthodox
des Actes apocryphes des apatres, Apocrypha 8 (1997), 137-146.
“4. faut signaler deux contributions qui ont paru depuis la rédaction de ces pages:
Sirus et al. Khirbet Fatti-Bet Gemal, Two Ancient Jewish and Christian Sites in
Israel (CNR-Progetto finalizzato Beni Cultural), Rome 2003, particuliérement 535°
558% F Bovon, The Dossier on Stephen, the First Martyr, HTAR 96 (2003), 279-315-
By
£188"
Mantyre ’Etienne (BHG 1649¢)
Vaticanus graecus 679, £. 187191" (sacc. XI)
pagrioror 108 dylow mearoudorugos Srepdvon [rigue eiAbynaov]
dyévero nari vov naugdv Exeivoy Herc EmtaeTi XQOvOY TOD avaingtva,
Tov migiov HGv ‘Inaodv Xowovdv Lrjmors werakd “lovdaiow xai Fad ov-
xaiov xai daguoaiwy dua d& xai Ehdnvorav xegi tod xvgiou Hav
‘InGod Xeuotod, 1 nédg EyevvizOn xa nd dvergden xara aeQxa al ne 5
Boravgdiy xai axéBavev xai avéom mQWrtonos &x TOV vExOGV. xai of
nev adtdv Eeyov Stu xis dvepevn méyas: AOL dé Zheyov bu obyi,
GA mhavG tov xdopOV: Eegor dé St vids deod got xali Hv AdovBos ev
to Syd nOKIS.
ovvifginoay dé éxi 1 aitd dvdges Emoripoves xai opoi dtd Alt.
oniag xai Onaidog xai “AreEavdgeiag, ‘Agias te xal Mavgitaviag xai
‘TeQoookipwv xai BopukGvos. xai dnd dgag nQdrns Eas dag sxmms ave-
xovero 4 Hégupios dv Todnov Beovtijs Biaias.
rote oraiels tv [dow tod dydov éni tivos ténov Hymhod Erépavos
vig yeapareds, cops xai tiptos navti 1 hag, yevous ABQ, PURE
Beniapiv, xai xaraceioas abtots th xe1gl Exqake Pavs| ueyday Ayov"
«divdges adekpol, moeoPitar xai veo, ivati éxhntivinoay tyav al
Gpovai xai ovyxéxutar xaoa “legovoadiin; waxdguos &vbguxos &¢ ob%
Biotaoev ekg Xquordv Inoody, thy &lzida tig tod xdopov cwrngias.
obtos yag gow 6 Ev téxvy GrAavOgurias xaTaBas & ovgavod duc tig 20
auagtiag xai tiv éyvouav tod haod, xal eloekOiv eig pifreav magdévou
dying xai xadagas xai éxdekeypévnc med xataPodtig xdopov. xarbiirg 8&
Exddeoey “AdAL 6 TOD xdoHoU marie Thy yovaixa adtod Zuiy yor
airy wmP}oeta prime xai Cow, obtws xai airy viv H aagdévos H}
wie tot Inood éxdain Zor xard rae yoampac: Ev f xvogogndeis ds 25
dvbqumos 6 Xoiotds EyewwiiOn xa” Suordthta HGv. cs yee HOEANOEY
(revéodar) éxi tig yiig, oftws xal ayngdvin th obpxavea. 6 88 80035
navto duéBohos éxivnoev xal tov “Hoddny eig Liyrnow xav’ avtod: SGev
drrowyiw dvehetv vd Boégn TOV tore yeyewnuévov év ByOhedy (éxéhev-
Gey) dnd dwerods xati natwréow. °
«éyévero 88 xai Toit a
geo
0
5
at Tob ads Guhavoowmiav xai oixovoniay Heob, iva
Sovow xai Gye nadia baéy Hav. et 8¢ Svomoreite xeoi t08
1 in margine superiore ante
bxraétovs y6vou A
titulum + pnvi SexeuBol xt 2 Eraeri) 79610"
xeeoBeiwowv?
29°30 txéhevoey ; addidimus 32 xgeoPevovar : legend:
A te mes eA
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Dimitru Stăniloae - The Experience of God (Orthodox Dogmatic Theology, Vol. 1)Document299 pagesDimitru Stăniloae - The Experience of God (Orthodox Dogmatic Theology, Vol. 1)Basil Lourié100% (1)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Polemis - Theophanes of Nicaea. His Life and Works (WBS-20)Document220 pagesPolemis - Theophanes of Nicaea. His Life and Works (WBS-20)Basil LouriéNo ratings yet
- Christ Came Forth From India Georgian Astrological Texts 2020Document485 pagesChrist Came Forth From India Georgian Astrological Texts 2020Basil Lourié100% (1)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Cyrus Ioannes Fernandez Marcos 1975 Thaumata SofronioDocument90 pagesCyrus Ioannes Fernandez Marcos 1975 Thaumata SofronioBasil LouriéNo ratings yet
- Uncovering Ancient Footprints - Armenian Inscriptions and The Pilgrimage Routes of The Sinai - Michael E. StoneDocument184 pagesUncovering Ancient Footprints - Armenian Inscriptions and The Pilgrimage Routes of The Sinai - Michael E. StoneBasil LouriéNo ratings yet
- Studia Patristica-104, 2021 (1 - Historica)Document193 pagesStudia Patristica-104, 2021 (1 - Historica)Basil Lourié100% (1)
- Dimitru Stăniloae - The Fulfillment of Creation (Orthodox Dogmatic Theology, Vol. 6)Document247 pagesDimitru Stăniloae - The Fulfillment of Creation (Orthodox Dogmatic Theology, Vol. 6)Basil Lourié100% (2)
- Novaes Taxonomy of Mediaeval Approaches To The Liar 2008Document36 pagesNovaes Taxonomy of Mediaeval Approaches To The Liar 2008Basil LouriéNo ratings yet
- The Welsh King and His Court - Charles-Edwards, Thomas.,Owen, Morfydd E.,Russell, Paul, University of WalesDocument614 pagesThe Welsh King and His Court - Charles-Edwards, Thomas.,Owen, Morfydd E.,Russell, Paul, University of WalesBasil LouriéNo ratings yet
- Agachi, Staniloae PalamismDocument103 pagesAgachi, Staniloae PalamismBasil LouriéNo ratings yet
- Paul Werth. Georgian Autocephaly and The Ethnic Fragmentation of Orthodoxy. Acta Slavica Iaponica, Iss. 23 2006, Pp. 74 - 100Document28 pagesPaul Werth. Georgian Autocephaly and The Ethnic Fragmentation of Orthodoxy. Acta Slavica Iaponica, Iss. 23 2006, Pp. 74 - 100Basil LouriéNo ratings yet
- Θεόδωρος Μετοχίτης - Ἠθικὸς ἢ περὶ παιδείας (Πολέμης, 1995) (ΚΒΛ-1)Document295 pagesΘεόδωρος Μετοχίτης - Ἠθικὸς ἢ περὶ παιδείας (Πολέμης, 1995) (ΚΒΛ-1)Basil LouriéNo ratings yet
- Norelli Avant Le Canonique Et Apocryphe 1994Document21 pagesNorelli Avant Le Canonique Et Apocryphe 1994Basil LouriéNo ratings yet
- Theodorus Metochites - Orationes (Eds. Polemis, Kaltsogianni) (BT, 2019)Document796 pagesTheodorus Metochites - Orationes (Eds. Polemis, Kaltsogianni) (BT, 2019)Basil LouriéNo ratings yet
- Tchekhanotits DevtubaniDocument9 pagesTchekhanotits DevtubaniBasil LouriéNo ratings yet
- Heinz Fahnrich. Geschichte Georgiens. Brill Academic Publishing, 2010Document589 pagesHeinz Fahnrich. Geschichte Georgiens. Brill Academic Publishing, 2010Basil LouriéNo ratings yet
- Strus Haggada StephaneDocument16 pagesStrus Haggada StephaneBasil LouriéNo ratings yet
- Hirschfeld Monastery Chariton Excavations 2000Document48 pagesHirschfeld Monastery Chariton Excavations 2000Basil LouriéNo ratings yet
- Strus Calendrical Aspect of A Recently Discovered Christian ApocryphonDocument17 pagesStrus Calendrical Aspect of A Recently Discovered Christian ApocryphonBasil LouriéNo ratings yet
- Bouvier - Bovon 2007, Invention Des Reliques D'etienne, Le Saint Premier MartyrDocument27 pagesBouvier - Bovon 2007, Invention Des Reliques D'etienne, Le Saint Premier MartyrBasil LouriéNo ratings yet
- Clark Claims On The Bones of St. Stephen 1982Document17 pagesClark Claims On The Bones of St. Stephen 1982Basil LouriéNo ratings yet
- Strus La Passione Santo StefanoDocument41 pagesStrus La Passione Santo StefanoBasil LouriéNo ratings yet
- Michael Psellus - Orationes Funebres - 1 (BT, Polemis) PDFDocument285 pagesMichael Psellus - Orationes Funebres - 1 (BT, Polemis) PDFBasil LouriéNo ratings yet
- Marius Victorinus - Commenta in Ciceronis Rhetorica (BT)Document291 pagesMarius Victorinus - Commenta in Ciceronis Rhetorica (BT)Basil LouriéNo ratings yet
- Suciu - 2019a - A Coptic Text Attributed To John of Jerusalem On StephanusDocument8 pagesSuciu - 2019a - A Coptic Text Attributed To John of Jerusalem On StephanusBasil LouriéNo ratings yet