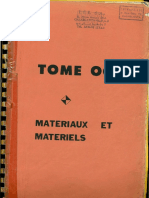Professional Documents
Culture Documents
INRS MCI Aout2012
INRS MCI Aout2012
Uploaded by
Amakhand Eloye0 ratings0% found this document useful (0 votes)
23 views35 pagesOriginal Title
INRS_MCI_Aout2012
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
23 views35 pagesINRS MCI Aout2012
INRS MCI Aout2012
Uploaded by
Amakhand EloyeCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 35
Murs a coffrage
intégré (MCI)
Prescriptions minimales
a intégrer a la conception
du procédé constructif MCI
pour une mise en ceuvre
en sécurité
Auger = OPFBTP Ars.
HSS POFESSONNELS Ta prévention are
institut national de recherche et de sécurité {INRS)
Dans le domaine dela prévention des risques profession:
nels, IINRS est ua organisie scientifique et technique
ul travaille, au plan institutionnet, avec la CNAMATS,
les Carsat, Cram, CSS et plus ponctuellement pour les
services de Etat ainsi que pour tout autre organisme
Soccupant de prévention des risques professionnels.
ldéveloppe un ensemble de savoir faire pluridisciplinaires
quil met la disposition de tous ceux qui, en entreprise,
sont chargés dela prévention : chef d'entreprise, médecin
du travail, CHSCT, salariés. Face ala complexité
des problémes, institut dispose de compétences scienti
fiques, techniques et médicales couvrant
tune trés grande variété de disc plines, toutes au service
de la maitrise des risques professiannels.
Aisi INRS élabore et diffuse des documents intéressant
(hygiéne et la sécurité du travail: publications (périodiques
‘ou non}, affiches, audiovisuels, multimédias, site internet
Les publications de FINRS sont distribuées par les Carsat.
Pour les obtenir, acressez-vous au service Prévention de la
caisse régionale ou de la caisse générale de votre circons-
cription, dont 'adresse est mentionnée en fin de brochure,
LLINRS est une association sans but lucratif loi 1901)
‘constituée sous légide de la CNAMTS et soumise au controle
financier de "état. Géré par un conseil dadministration
cconstitué 2 parité dun collage représentant les employeurs
et dun collage représentant
les salaris,ilest préside alternativement
par un représentant de chacun des deux colleges.
Son financement est assuréen quasi-totalité par
le Fonds national de prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelies,
Les caisses d'assurance retraite et de la santé
au travail (Carsat), les caisses régionales
d'assurance maladie (Cram) et caisses générales
de sécurité sociale (CGSS)
Les caisses c'assurance retraite et de la santé au travail, les
calsses régionales dassurance maladie et les caisses géné
rales de sécurité sociale disposent, pour patticiper
4 la diminution des risques professionnels dans leur région,
un service Prévention composé d'ingénieurs-consils,
fet de contrdleurs de sécurité
Spécifiquement forrés aux disciplines de la prévention
des risques professionnels et sippuyant cur lexpérience
quotidienne de fentreprise, ils sont en mesure de conseiller
et, sous certaines conditions, de soutenir les acteurs,
de lentreptise (direction, médecin du travail, CHSCT, etc)
dans la mise en ceuvre des démarches et outils
de prévention tes mieux adaptés 8 chaque situation,
lis assurent la mise 2 disposition de tous,
les documents édltés par IINRS.
asm Aahrs a ANE D
LOrganisme professionnel
de prévention de la branche
du batiment et des travaux publics
(oPPBTP)
HOPPBTP est fOrganisme professionnel
de prévention de la branche du bitiment
ct des travaux publics. Sa mission est
de conseller, former et informer
les entreprises de ce secteur 3 la prévertion
des accidents du travail et des maladies
professionnelies, eta amelioration
des conditions de travail Grace 4 son réseau
de 320 collaborateurs wépartis dans
418 agonces en France, /OPPBYP accom
pagne les chefs d'entreprise dans analyse
des risques de leur métier, dans la alisation
du document unique, dans la mise
en ceuvte de leur plan de formation,
LOPPBTP propose aux entreprises
des services et des formations person:
nalisés répondant a leurs besoin.
met & disposition sur son site Enternet
diverses publications, outils pratiques,
fiches conseils pour aider les entreprises
dans leur gestion de la prevention,
ED 6118
aout 2012
Murs a coffrage
intégré (MCI)
Prescriptions minimales
a intégrer a la conception
du procédé constructif MCI
pour une mise en oeuvre
en sécurité
Bagprance OPPSTP an nrs.
Res mOrESANES “Ta préventior
Got ourage 2 été élaboré au sein d'un groupe national
‘*INRS: Alin Pamios, Philippe Sordollot
+ CNAMTS / CARSAT: Daniel Autrt, Patrick Baboulet, Marc Bury, Francis Lemire,
‘Guy Magniez, Michel Tourtior
+ OPPBTP: Gwonaclle Keraval, Giles Parard, Helene Schwab
‘+ CERIB:Frangois Fernandez
“+ ENTREPRISES & ASEBTP : Karine Bastice (Eitiago), Geraldine Cahors (Vine),
‘Thierry Deola (Geo), Laurent Fajnhole (Vinci), Daniel Imbert (Vine
Eric Lambart (Bouygues), David Maciojewski (Vinci, Jean-Luc Vu (SPIE SCGPM)
‘= FOURNISSEURS: Frederic Dubois (Rector), Berard Escaliere (Seac-Guiraud),
‘Michel Escourrou (KP1), Daniel Gilmann (Rector) Philippe Jacauir (Feh-technologies),
‘Mare Lenges (Sourgin), Jean-Pierre Milet (Rector), Stephan Beugnot (Rector)
‘
Cee aman CERO ARIS
et la Federation de Findustre du béton
Sommaire
Préambule
1. Généralités sur les murs
a coffrage intégré
1.1, Caractéristiques
1.2, Retérentiol technique et certification
1.8, Réle des différents acteurs
1.4, Risques liés & la mise en ceuvre des MCI
2. Etude technique de la solution MCI
21, Projet structurel et dimensionnel
2.2, Dossier technique d'exécution du BET
(bureau d'études techniques)
2.8. Etude de faisabilité de la solution MCI
par le fournisseur
2.4, Dossier technique d'exécution
‘du fournisseur
3. Prescriptions minimales
a intégrer lors de la conception
du procédé constructif MCI
3.1. Généralités
3.2. Conditionnement, transport et stockage
3.3. Levage, mode de préhension des MCI
84, Retournement
3.5, Pose
3.6, Mise en place des aciers de liaison
87. Coulage
3.8. Retralt des éléments de stabilisation
provisoire
8.9. Fintions
Naaao
©
4. Contenu minimum
de la notice d'instructions
4A. Généralités
4.2. Conditionnement et transport
4.3. Déchargement et stockage
4.4, Levage et mode de préhension
48, Retournement
4.6, Pose
47. Coulage
4.8. Retrait des éléments de stabilisation
provisoire
49. Firitions
5. Compétences requises
5.1, Formation a destination des opérateurs
5.2. Formation a destination des prescripteurs
53. Formation a destination des transporteurs
6. Note générale
Annexe. Rappel sur les principes
généraux de prévention
Glossaire
Bibliographie
23
23
23
24
24
25
25
ar
ar
a7
28
28
29
29
30
31
32
Préambule
Les murs & coffrage intégré (MC) sont des éléments en béton armé fabriqués industrielle-
‘ment en usine et destinés a la réalisation de parois verticales.
Ces produits modifient les techniques traditionnelles de construction en supprimant la
majeure partie des opérations de cottage du béton, élément préfabriqué tenant lieu de
anche pendant le coulage du béton. Ils intégrent les fonctions qui sont habituellement
assurées par des équipements de travail tels que les systémes de cotfrage classique.
Les MCI dovvent rempiir les mémes exigences de sécurite que les modes de construction
habituols,
Ce document a été élaboré par tous les acteurs de ce domaine. I dentilie les risques et
propose des mesures intégrer dés la conception du produit pour permettre d’assurer
lune mise en couvre en sécurité
Crest le document référence des différents acteurs. Il fixe le rétérentiel minimal & mettre
en ceuvre, a chaque étape des processus de conception, de fabrication et de construc
tion, pour
‘+ le fournisseur qui respectera les prescriptions minimales dés la conception du procédé
constructif MCI pour une mise en cauvre en sécurité;
* Vutilsateur qui respectera la notice diinstructions & deux niveaux:
au niveau décisionnel afin d'avoir les informations pour effectuer le choix du procédé,
au niveau du chantiar pour réaliser a mise on couvre par du personnel formé ot se rék
rant au guide de pose, & la notice d’instructions et aux modes opératoires spécifiques,
ecole nrc
Généralités sur les murs a coffrage intégré
1.1. Caractéristiques
Les murs & coffrage intégré (MCI) sont des produits
préfabriqués en usine, Ils se composent de deux parois
minces en béton armé ayant chacune une épeisseur
de 4,5 a 7,5 cm, généralement sans acier en attente,
maintenues espacées par des raidisseurs métaliques
verticaux, et servant de-coffrage (figure 1).
lls comprennent les dispositions constructives ‘elles
{que des inserts nécessarres a leur mise en ceuvre en
sécurité (manutention, stabilisation...) ot & la miso on
place o'équipements de travail (plates formes, protec-
tions complémentaires de type garde-corps)
Une fois positionnés et stabiisés, les panneaux MCI font
office de coftrage. On y insére des armatures au droit
des joints entre panneaux puis on coule du béton entre
les deux peaux.
Cette technique peut-atre employée pour réatiser:
+ desléments essentielloment solicitéspar des charges
verticales paraliéles & leur plan (exemples: murs,
poteaux, poutres, pouttesvoles, acrotéres, murs
péripnériques, murs de cage dascenseurs et
Glescaliers, murs de fagade et de refend, murs contre
exstants);
+ des éléments solicités en flexion simple ou compo-
960 par des charges perpendiculsires & leur plan
(exempies: murs de souténement soumis aux pous-
sées des terres en phase défnitve, des eaux, des
surcharges rouiantes, murs de silos de stockage).
Cotte technique est adapiée a la réalisation de murs
mitoyens en élévation, Elle peut étre mise en ceuvre
depuis un seul e6té de la paral
Le risque cinstabilté des terres, lorsqulil existe, doit
voir été pris en compte au préalable par des mesures
adéquates de maintion du terrain (exemple: talutage,
blindage, clovage) pour assurer la protection du chan-
tier de pose des MCI (voir chapitre 2.3).
prétabriquses (peau)
Maintnues espacées
par un fevallagespectique
Figure 1. Constitution
dun MCI
En aucun cas, le MCI ne peut étre utlisé comme biin-
dage pour soutenir des terres en phase provisoire ou
‘comme protection contre le risque d'ensevelissement.
Cette technique, comme les techniques de préfabrica-
tion en général, ne permet pas les modifications de der-
nigre minute et nécessite une planification précise des
travaux et des approvisionnements,
1.2. Référentiel technique
et certification
Les MCI sont des produits de construction non
tracitionnels, relevant de la procédlure davis technique,
Ces avis techniques étabis par le CSTB (Centre
scientifique et technique du batiment) ont une durée de
valilté imitée dans le temps,
Les fournisseurs de MCI peuvent, de fagon volontaire,
slinsorire dans la démarche de certification des produits
proposés par le CSTB,
LLexistence d'un avis technique permet de s'assurer de
la garantie du produit, notamment des aspects soliité
et durabiite.
Lacertiication CSTBat est un processus de contréle de
production qui permet dapporter la preuve du respect
des oxigonces du référentiol
Cette démarche est une garantie supplémentaire du
respect du rétérentiel de fabrication, concrétisant 'obli-
gation de résultats du fourissour (voir chapitre 3).
‘Tout dysfonctionnement au niveau de la fabrication a
fen effet des répercussions sur la qualité intrinséque
{du produit et sur la sécurité des utlisateurs (exemples:
léments fissurés, point dancrage défaillant),
1.3. Réle des différents acteurs
A partir d'un ouvrage défini par le MOE (maitre c'couvre)
et le BET (bureau d'études techniques) de lutlisateur,
les MCI sont commandés au fournisseur et mis en
ceuvre par Tutlisatour apras une étude de faisabilt6,
Rlemarque: Voir glossaire pour les différentes défintions.
1.3.1. Role du fournisseur
Le fournisseur applique les principes généraux de pré:
vention (code du travail art L. 4121-2) ds la conception
du MCL. Ces principes sont intégrés dans la phase de
fabrication on usine pour une mise en cpuvre en sécurité
sur le chantier. Le fournisseur étabilt et ciffuse sa notice
diinstructions (voir chapitre 4).
LLors d'une étude de faisabiité technique, avant chaque
pération (voir chapitre 2), le fournisseur vérifie a la
demande de lutiisateur que le produit MCI est réelle
ment adapté a fouvrage & construire. Sila solution MC!
est retenve, Il fourit a lullisateur le dossier technique
fexécution MCI (voir chapitre 2.4)
Le fournissur doit étre force de proposition pour inté-
grer les équipements de séourité dés la fabrication du
MCI (voir chapitre 3)
1.3.2. Réle de l'utilisateur
Lutlisateur doit réaliser fouvrage en respectant les
plans architecturaux. ll migsionne un bureau d'études
techniques, qui réalise une étude structurelle, pour
dimensionner ouvrage. Le résultat se traduit par la
production de notes de calouls et de plans d'exécution
(coffrage et ferrallage) qui, le plus souvent, ne com-
portent pas diindication spécitique MCI
Le choix de la technique de construction (oéton banché
ou MCI) est générelement effectué par lutlisateur apres
cate étape,
Si la technique des MCI est choisie, Fétude technique
du BET de 'utisatour st transmise au fournissour avec
ensemble des informations décrivant les contraintes
du chantier pour lui permettre diélaborer le dossier
technique MCI.
Il est fortement consellé A Tutlisateur de faire réte-
rence & une certification de qualité type CSTBat dans
les documents contractuels le ant au fournisseur, pour
1,5 Mr) sous les solicitations de service,
Les principes constructifs & appliquer pour la concep-
tion de ETS sont les suivants:
* les ETS sont congus autostables. Sila stabilté de
formes rvest pas suffisante, une stablisation com-
piémentaire automatique ou contrainte est néces-
saire lors du déchargement. Si les stabiisateurs
sont nécessaires, alors ils doivent étre indissociables
de la structure (les piéces rapportées & TETS ne sont
pas admises, étais trants-poussants par exemple);
gure 1.
Bxemple de traverse de stabits
3. Prescriptions minimiales&intégrer lors dela concéption du procédé construc MCL
* une note de calcul jusife la stabillé et la résistance
de IETS dans les conditions les plus défavorables;
laplate-formeréalsée par utisateurdoitétre conforme
aux hypotheses minimalas qui seront dans la notice
instructions (voir chapitre 4.3.1);
“VETS dot etre stable sur la plate-orme du chan-
tier sans que les éléments de stablisation ne créent
e risques supplémentaires (chute de hauteur et chute
6 piain-piog)
‘les elements permettant la stabilté des MC! dans
les ETS doivent aire partie intégrante des ETS
{pour empécher leur enléverent intempest, a chute
lobjat ot la possibilté de blocage du MCI dans
TETS) le systeme de flasques répond a ces exigences;
* si des stablisatours sont nécessaires pour la stabi-
lisation de VETS, chaque stabiisateur dovra résister
une charge minimale de 4500 daN a 'ELU (état
limite time). Pour information, une charge ponc-
tuelle environ 4500 daN sur un sol de 6 bars & "ELU
nécessite une plaque de répartition de 750 cm? sot
tn disque de 30 em de diamétre (figures 12 et 13).
Ine faut pas utliser d’élément métalique indépendant
ermettant la stabilisation du MCI dans ETS.
b. Levage des ETS
SSilelevage sur chantier de ETS avec des MCI est pros-
crit, los anneaux de levage sont inaccessibles lorsque
ETS est chargé, a exception du type 1. Les anneaux
de levage sont identitiés avec une peinture de couleur
ou autre moyen équivalent de fagon & permettre le dé-
placement de ETS vide.
¢. Manutention des MC! depuis "ETS.
Lobjectit du fournisseur est de concevoir un ETS
de fagon & supprimer ou éviter le risque de chute
de personne dans le vide, notamment dans la phase
dingage ou désélingage. II doit combattre ce risque
{la source et doit donc fare en sorte que Fopérateur
‘sléve le moins possible et travaille depuis le solou a dé-
faut depuis une plate-forme de travail sécurisée intégrée
aleTs.
d. Marquage
Chaque ETS a un marquage visible par utiisateur avec
fe nom du fournisseur, le type d’équipement (transport
et stockage, stockage uniquement, retourneur), le Nu-
méro de série de IETS, le poids a vide de "ETS.
Figure 13.
Exempla de fasque
3.2.3.3. Verification des ETS
La verification de ETS se fait lors de la mise sur le mar-
cché et & chaque retour en usine par une personne com:
pétente. Les points de verification porteront principale-
ment sur les organes de sécurité (anneaux de levage,
flasques, systéme de fixation, stabilsateurs s'il y en a)
et fossature (structure, soudures).
3.2.3.4. Notice diutilisation des ETS
Le fournisseur transmet la notice dutiisation des ETS a
Vutlsatour via la notice dinstructions des MCI
Elle précise notamment:
+ usage prévu;
* es limites d'emploi (vent maximum, etc);
* ls instructions pour lutiisation et entretn;
+ les mesures organisationnelles éventuelles & prendre
sur le chantier concemant le périmétre de sécurité
autours des ETS (coup de vent, etc);
* Temprise au sol minimale lige aux éventuels dispostits
de stabilisation des ETS:
+ la résistance et la tol6rance admissibles pour la pente
et le dévers de aie de stockage;
‘les conditions c'autostabiit
3.2.4, Transport et stockage a plat
Le stockage a plat est a proserir il est recommandé
lutilser un ETS,
Le transport a plat est exceptionnellement autorisé
pour les dimensions suivantes:
auteur
15
Longue
frceptometenen | Eacepsomelerent | Non
trceptomdlenen | Excesomelerent | Non
Escepiomelenen | Non Non
Ercepiomelenen | Non Non
Non Non Non
Non Non Non
‘Oui = petit élément ivrable & plat car plus stable que debout
dans PETS
Exceptionnellement = ivraison ponctuelle de quelques MC!
{de compléments: «queue de banche»
'Non = élément trop grand ne permettant pas une lvraison &
lt et un déchargement en sécurité
Dans le cas exceptionnel do transport ot de stockage
a plat, les neuf risques suivants doivent notamment
avoir été pris en compte:
* instabiité en pied lors du relevage de MCI: faut pré-
voir un équipement spéciique sabot ou autre éauipe-
ment 6quivalent (figure 20);
+ endommagement de insert de levage par contact sur
le bord du MCI;
‘rupture des bords du MCI au relevage en l'sbsence
do dispositis spéciaw
* chute de opérateur depuis la remorque lors de
Vaccrochage;
+ déchargement «sauvage» sur la voie publique (hors
‘emprise chantier) avec risque d'6orasement des opé-
rateurs par un véhicule crculant sur la vole publique
* ordre de chergement incorrect impliquant lanécessité
<'un stockage provisoire non anticip.
* pour los MCI plus épais, insuffsance de résistance
des raidisseurs internes au MCI lors du stockage
et du transport;
+ insutfisance de résistance du ferrailage (ellis soudé)
et des points de manutention lors du relevage;
‘fragilté du MCI lise aux owvertures qui doit avor
fait fobjet d'un traitement particulier par le bureau
d'études du fournisseur lors de la conception du MCI
Pour palier ces risques, le transport et le stockage
a plat des MCI sont acceptables exclusivement dans
les conditions suivantes:
* stockage @ plat sur quatre hauteurs maximum sans
dépasser 0,8 m;
‘+ dimensions maximales conformes au tableau ci-contre ;
*calage de faible épaisseur entre chaque MC! pour
@viter le glissement et la prise en berceau';
* quatre crochets de levage obligatoire par MO! (deux
en téte et deux en pied) (igure 15).
Figure 14. ngage
des petits éléments
Figure 16. Utilisation
de quatro crochots de lovago
1 Binaage de Tlimant sans inser les crochets ot levage.
Muscogee 15,
16
3.2.5. Conditionnement en usine
Lors du concitionnement, le fournissour s'assure de
la stabilté de ETS. Il charge ETS de fagon & garentir
sa stabilté en usine et sur chantier quel que soit ordre
de déchargement.
‘Sault justifications contraires par note de calcul du four-
nisseur, les MC! les plus grands et les plus lourds sont
positionnés au cenire de I'ETS afin d’éviter son bascu-
lement.
Dans le cas d'un syst8me d'ingage depuis le sol
‘et pour favoriser le respect d'un ordre de déchargement
prescrit, les accessoires de levage peuvent par exemple
‘tre ramenés sur le bord des MCI avec une cordelette
(figure 16).
3.2.6, Stabilisation du MCI dans son ETS
Le MCI ne doit pes étre détérioré lors de 'utlisetion de
ETS et conserver son intégrité. Chaque MCI doit étre
stable indépendamment des autres dans I'ETS et peut
tre souris aux mémes solicitations que ETS en cas
de choc. I! peut étre admis que le MCI se détériore, en
revanche il ne doit pas créer de risque supplémentaire
et doit rester dans ETS,
En conséquence la stabilisation sera assurée dans les
conditions suivantes:
faut au minimum deux points de maintian superpo-
‘868 verticalement (ou un seul sur toute la hauteur et
repos par adhérence sur une ligne d'appui (bois, néo-
ppréne ou equivalent);
‘chaque MCI est maintenu indépendamment des
autres par des systémes qui ne doivent pas étre
éplaces et démontés sur le chantier;
‘+ los MCI sont manutentionnables sans action complé-
mentaire des opérateurs en dehors de l'accrochaga
es élingues a rappareil de levage;
‘es flasques sont & privilégier. Ces dispositfs de main-
tien sont inamovibles sur le chantier. lis se trouvent
de part et dautre de chaque MCI et leur conception
ne permet pas de les placer entre les deux peaux
(figure 17).
$3{PFEeptIons minimises 8 Intdgier lore db la conception du procédé constnieti MOI
3.3. Levage, mode de préhension
des MCI
3.3.1, Points de levage des MCI
La manutention se fait uniquement au moyen des in-
sorts de lovage anorés dans le MCI.
Pour les inserts, les fournisseurs peuvent se reporter au:
rapport technique CEN/TR 15728 qui est le document
de référence,
Les boucles jumelées en un point de levage sont inter-
cites. Les boucles de levage ne sont pas en acier haute
adhérence HA, mais en acier dour (suivant la documen-
tation technique FD CEN/TR 15728).
Les points d'élingage sont de préférence accessibles
depuis le sol ou a défaut depuis une plate-forme de tra-
vail sécurisée intégrée & ETS,
A céfaut, usage c'une PEMP (plete-forme élévatrice
mobile de personnel) est nécessair.
Le levage en deux points est & priviégier, sinon un
moyen adapté pour assurer un lovage équilbré doit étre
mis en ceuvre par Iutlisateur suivant les prescriptions
du fournisseur qui sont déciinées dans la notice dns
tructions. Dans le cas du stockage & plat, le levage se
fait en quatre points.
Le fournisseur doit placer les inserts de levage de fagon
€& positionner le centre de gravité centré entre les points
d'élingage. La verticalté et horizontalité des bords des
MCI seront recherchées, ce qui suppose la parfaite
connaissance da la position du centre de gravité
Cas diinserts type cables métalliques: Les élingues
posées en usine seront de longuour adaptée afin
Ge facilter la pose tout en garantissant la verticalité
et Thorizontalté des bords. Elles doivent aussi étre
indissociables du MCI
Figures 16 et 17 Dispositts de maintion par fasques
INTERDICTION e'utiser one poutle
Brin de tonguour tae
Eégulbrage oe fst par action surtepalan
our raceourr ou alongerla ongueur
‘du bin regio,
Veller&respecter un ang inféraur & 60"
ene ls deux ras 6 alngue
(CMU de Vensembie: 16¢
Pour un polds du mur = 121
‘= angladinainaion = 115°
d= cistance ene la pont ia plusheut ete point
Jeplustas < 20% delalongueur du mat
Figure 18. Dispositt o'équiibrage par palan
Une éingue & palan peut, dans certains cas, étre utlisee
pour aseurer la verticalté des MCI (igure 18).
Méthode de dimensionnement
des inserts de levage
* Respect des prescriptions de avis technique (CSTB}*
* Lovage en deux points a privitégier
* Prise en considération du type de appara de levage
utilsé sur chantier (capacité, hautour libre sous crochet,
cffet dynamique)
* Prise on compte des accessoires standards de l'entr:
prise (En cas o’ancrages spéciiques, ils seront spécifiés
danslanoticed'instructionset dans edossier technique.)
‘* Juxtaposition de ceux boucles en un méme point de
levage interlt (Ne pas confonate avec fe lavage en 2 x2
points.)
* Efforts dus au retourement et/ou au redressement
du MONA plat
Lorsque le poids du MCI nécessite un levage en plus de
deux points, la répartition des efforts dans les élingues.
impose l'utilisation d'un palonnier d'équilibrage.
Dans ce cas, l'ensemble des accessoires de levage (p3-
lonnier, élingues, poulie, ec.) est fourni et mis en ceuvre
par [utlisateur suivant les prescriptions du fourrisseur:
la notice dinstructions, les plans de pose et les divers
documents associés.
Lorsquiune opération de retournement est nécessaire
(voir chapitre 3.4), le MCI est pourvu de quatre points
de levage:
‘+ deux a utliser pour le déchargement de IETS et le po-
sitionnement sur le retourneur, ces deux points étant
sur le bord le plus long;
‘+ deux autres permettant le retoumement et la pose,
situés le bord le plus court.
Las nseris 6 accessoires de evago uti doivent avoir été privus dans avis tachnique CSTE.
is covet avo fat objet oscars sous fa syparision dune loroe parbo quaUte et dans les conations ctisetion réeles sen le prot
Cole essa eabore parle G83 de la commission chargee de fornuler des avis techniques et ube par fe CSTE. Gas assais pormettont do
bir fa CMU do neart testo en valdant simulianémant fous les compesants concourant au lovage, y compre dans les phases do
‘etoumement si est aren,
are seotago igre 17
Brine longueuréclable parpalan
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Devis ClotureDocument1 pageDevis ClotureAmakhand EloyeNo ratings yet
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Projet Villa DuplexDocument5 pagesProjet Villa DuplexAmakhand EloyeNo ratings yet
- Flyer PERI UP HDDocument2 pagesFlyer PERI UP HDAmakhand EloyeNo ratings yet
- Offre Ouverture Supeco Toit RougeDocument4 pagesOffre Ouverture Supeco Toit RougeAmakhand EloyeNo ratings yet
- Toyota Chariot Elevateur Electrqie 6 A 8TDocument2 pagesToyota Chariot Elevateur Electrqie 6 A 8TAmakhand EloyeNo ratings yet
- Ami BRT Etude Aps ApdDocument2 pagesAmi BRT Etude Aps ApdAmakhand EloyeNo ratings yet
- RCI Code Des Marches Publics 2009Document73 pagesRCI Code Des Marches Publics 2009Amakhand EloyeNo ratings yet
- PDF - 20150225161959 PDF EnteteDocument12 pagesPDF - 20150225161959 PDF EnteteAmakhand EloyeNo ratings yet
- Pythagore DocDetailleeDocument40 pagesPythagore DocDetailleeAmakhand EloyeNo ratings yet
- Longueurs Des Chapeaux Sur Appui IntermeDocument7 pagesLongueurs Des Chapeaux Sur Appui IntermeAmakhand EloyeNo ratings yet
- Note de Calcul CaniveauDocument7 pagesNote de Calcul CaniveauAmakhand EloyeNo ratings yet
- nf384 Document Technique N 384 01 Rev01 290420Document17 pagesnf384 Document Technique N 384 01 Rev01 290420Amakhand EloyeNo ratings yet
- NDC Dalot 70x70 Rev0 PDFDocument42 pagesNDC Dalot 70x70 Rev0 PDFe155159No ratings yet
- Descriptifs Et CCTP de Projets de Constructions (WWW - Livre.tk)Document208 pagesDescriptifs Et CCTP de Projets de Constructions (WWW - Livre.tk)Amakhand EloyeNo ratings yet
- Matériaux Et MaterielDocument87 pagesMatériaux Et MaterielAmakhand EloyeNo ratings yet
- FeuilletageDocument25 pagesFeuilletageAmakhand EloyeNo ratings yet