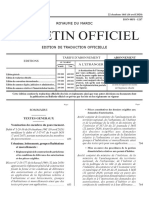Professional Documents
Culture Documents
Decret N 2-14-499 Approuvant Les Règles de Sécurité Contre Les Risuqes D'incendie
Decret N 2-14-499 Approuvant Les Règles de Sécurité Contre Les Risuqes D'incendie
Uploaded by
Abdellah NACIRI0 ratings0% found this document useful (0 votes)
66 views177 pagesOriginal Title
decret n 2-14-499 approuvant les règles de sécurité contre les risuqes d'incendie (1)
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
66 views177 pagesDecret N 2-14-499 Approuvant Les Règles de Sécurité Contre Les Risuqes D'incendie
Decret N 2-14-499 Approuvant Les Règles de Sécurité Contre Les Risuqes D'incendie
Uploaded by
Abdellah NACIRICopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 177
4270
BULLETIN OFFICIEL,
306
Décret n° 2-14-499 du 20 hija 1435 (15 octobre 2014) approuvant
te reglement giuéret de construction fixant les régles dle
sécurité contre les risques incendie et de panique dans
les constructions et instituant le comité national de la
prévention des risques incendie et de panique dans les
consteuctivas,
Ee CiteY DU GOUYERNEMEN
Vala fain? 12 0 ectatn
Te dahir n° 1.9231 du 1S hija
ses articles 59 Ui:
4Vusbanisme, promatguée par
12 17 juin 1992), notamment
vat Ja relative tay iotisse nents, groupes
Whamations 6 morcellements. promulguge par te dabie
n° 192-7 du 15 nia 142 (17 juin 1992)
Vu le dahir n? 160-063 du 30 fia 1379 (25 juin 1960)
relatif au deveiopnement des agglomérations rurales :
Vu la loin? s%-t selatived la chartecomimunale, promulguée
par le duhir n* 1.022297 du 25 reieb M23.G octobre 2X02, teile
quielle 4 éte maditice et complet
Vu le iécret uP 2-92-8382 die 27 1ubil H 1414 (4 octobre 1993)
pris pour f ‘on de ta lo}? 12-90 relative a Purbanisme,
notamment son article 39 5
Vu ledcrvi n® 2.92.88
pris pour Vapi
75 eabii 11 1414 (12 cetabre 1993),
tion de ka foi preeicée n? 25-90
Sui proposition du ministre de Turbanisme et de
Taménayeinent da territoire
Apiés deliberation du Conseil de gouvernement,
Dkaacla HIS C8 septeinbre 2014),
pecréte
PITRE PREMIER,
DU REGEEMEN TGF NER AL DE CONSTRUCTION FIXANT PS
RPGLES DESECURITE CONTRE LES RISQUES DINCENDIE BT
DF PANIQUE DANS LES CONSTRUC LIONS
ARTICLE PREMIER, Es(approuvé (el quill est annexe au
présent déeret fe réghement général de construction fixant les
régles de sécurité contre les risques J incendie et de panique
dans les constructions,
TITRE H
DU COMITE NATIONAL DE LA PREVENTION DES RISQUES
D'INCENDIE EE Db PANIQUE DANS LES CONSTRUCTIONS,
ART, 2. Hest eréé un comité dit « Comité national de
Ja prevention des risques incendie et de panique dans les
\Sévalacr la misc en arvvre des dispositions du réglement
général deconstruction fxant le regles de sécurité contre
fesrisques d incendie ct de paniquedans es constructions
ete normes et mesures qui y sont contenues
de proposer et de donner sor avis sur les modifications
& apporter aus norms et mesures contenues dans ledit
reglement
12 moharsem 1436 (6-11-2014)
~ examiner ies modifications et propositions
améligration a apporier av seglement weneral de
construction ‘ixant les régies de securité conte les
rixques¢incenices de panique annexe au présentdécret,
en fenant conte du progres scien fiqueet des nouvelles
techpigue: de ks prevenicay des risqttes Cincendie et de
paniqe dans lesconstructions abs! qu'a ka humiere des
Incidents et des experiences internation’
Ant, 3, Le Comité national de la prevention des risques,
incerdiieet de panigue cans fas constructionsest composé, sous kt
présidence de Fautor té gouverneitensale chargéedieTintérieur de
Famtorite geuscraementate chargée de Murbanisme
Tautoned ge fe Phabisat
ernumentisle una
youversersoatsh: cor age de Hequipement
Tautorité gouves iementale ehurgés te Findustrie 5
Vautorité gouvernementle charrée de Vénergie ;
Fantorté gousernesemats tian lela sscherche scientifique:
la direction génccale de Ja protection eivile :
Finstiqut marecain de ls noraralisation
= FOrdre uational d
Ledit comté peut, sur demande de son président,
Sadjoindre toute instance ox expert dont if juge Pavis utile
chnectes,
Ledic com
Fis que cela est neces
une fois par anet & chague
de son président.
Le seerétariat du comiié national de la prévention des
risques incendie et de panique dans tes constructions est
assuré parla dire ale le 1 protection civil.
PORT
DISPOSTHONS DIV ERSES
ART. 4, Les dispositions Jy réglement général de
construction visé a Varhcle premier ciedessus prennent effeta
compter dela publication du présent dgcret au Bullevin officiel,
ARTS. Leministrede Purbanisme oi de Taménagement,
du territoire, fe iw'nistre vie Materieur, le ministre de Paabitat
et de ta politique de la yitle ete mintsire de Péquipement, dit
transport et dela logistique sout charges, chacumn en ce qui le
concerne, de Vexgeation du présent décret
hij 1435 (1S octobre 2014),
ANDI -ILAH BENKIRAN,
Feito Roba, te 2
Pour contreseing
Le ministre de Furbanisue ci de
Taménagement di iervioire
MOHAND LAENSER
Le ministre de Vintévieur
MOHAMED Hassan,
Le ministre dle ‘abtar e7 de ha
olirique de fa vil
MoHaMMeD NagiL BeNasDALt Att
Le mainisive de PSypup 98
du transport et de la hegestique
AZI7 RABBAL
N° 6306 — 12 moharrem 1436 (6-11-2014) BULLETIN OFFICIEL a7
—————
PREFACE
Le présent document est destiné @ la fois aux institutionnels et aux professionnels. I se veut un
outil de travail car il renferme un ensemble d’orientations pratiques et d’exemples illustratifs qui
touchent de trés pres les différents aspects de la Sécurité Incendie.
La méthodologie générale adoptée s’attache a anticiper et a identifier les risques et @ proposer
des actions ciblées et concrétes.
Le document est articulé en six livres auxquels s‘ajoutent des annexes :
Connaissances générales de base;
Les batiments d’habitation;
Les établissements recevant du public;
Les immeubles de grande hauteur;
© Les lieux de travail;
= Les établissements et installations classés.
Pour chaque type de batiment, sont décrits et commentés : les principes de sécurité, le
classement, les dispositions constructives, le désenfumage, les régles d'aménagement, les
installations techniques ainsi que les moyens de secours et de lutte contre incendie. L’ensemble est
illustré par des schémas et tableaux de synthéses.
an BULLETIN OFFICIEL N? 6306— 12 moharrem 1436 (6-11-2014)
_————————————
LIVRE 1
‘CONNAISSANCES DE BASE
1- CONNAISSANCES DE BASE
41 Prévention contre I'incendie
sat Généralltes
Le développement rapide de !a société staccompagne forcément d'une expan
coeur de nos préoccupations,
ion des risques qui, aujourd’hui, est au
Dans ia diversité des risques, celui de incendie se situe & une place tristement privilégide. Depuis la nuit des temps, il est
la cause de pertes humaines importantes et de dégats matériels irréparables. Uinterpénétration de toutes sortes
dactivités conjuzude aves dle fortes concentrations de population concourent 3 l'aggravation des sinistres.
Contrairement «le nombreux risques traités & Vaide de méthodes et outiis probabilistes, incendie, est un phénomene
identifié sclentifiquement et moftrisable dans son éclosion et son développement.
Pour se prémunir de incendie, la réglementation en matiare de construction évolue en permanence. Eile vise un double
objectif :
@ PREVENTION; PREVENIR rincendie en rendant trés improbable son éclosion
@ _PREVISION : PREVOIR ies premigres mesures & prendre spar hasard, ilprencit nalssance afin delimiter son
développement
4.2 Laprévention
tena Définition
Diune manidre générale, prévanir un risque c'est l'empécher d'exister ou tout au moins, essayer par tous les moyens
possibies d'arriver 8 ce résultat. Prévolr un risque, c'est penser qu'll pourra exister 4 un moment donné et prendre, en
conséquence, des mesures en vue de son apparition.
saa Lesbuts
© Assurer ta sécurité des personnes;
@ Limiter es pertes matérieles
@ _permetzce Mengogement des secours
La sécurité humaine doit atre lobjectif prioritaire. La prévention doit mettre a "abri des risques d'accidents les occupants
d'un établissement
Les pertes matérielles visent les destructions ou détériorations des blens immobitiers, soit par I'action immédiate du feu,
soit par ses conséquences directes (écroulements des batiments),
per ailleurs, les pertes d'exploitation et les dommages indirects sont 3 fols plusdlevés que les codts directs de incendie
par suite de larrét ou de la diminution de fa production, de la perte des marchds et des emplois.
enfin, e gage de réussite d'une intervention cest assurance que les cours pourront combattre le sinistre « au plus
pras » en penctrant a intéreur de Mélablissement dans le but de maltriser Fincendle au plus vite. C'est pourquoi les
DBatiments doivent etre accessibies eux sapeurs-pomplers et les structures, posséder un minimum de stablté au feu.
2.3 Les objectifs
© Eviter'écosionde incendie:
@ Evacuer tes personnesen danger
@ Limiter la propagation de incendie;
© Facliter intervention des secours.
43. Laprévision
21 Généralltés
Quelle que scit la perfection des mesures de prévention édictées, auss! viglants que soient ceux qui sont chargés de les
faire appliquer, certaines causes sont imprévisibles.
Une surveillance constante des risques et 'élaboration des mesures 2 prendre en cas d'apparition d'un sinistre sont es
principes essentiels de la prévision,
La prévision vise done :
© leddécouverte devincendie des se nalssance;
@ otteque immédiate du feu pour obteni Pextinctionrepide.
La prévision prend donc le reiais de la prévention lorsque celle-cl est mise en échec et son action est done complémentaire
de la s€curite tout en Is renforgant.
N* 6306 _ 12 moharrem 1436 66.
BULLETIN OFFICIEL 4273
3.2 Définition
La prévision comporte toutes les mesures préparatoires destinges & déceler un risque dés son origine et & assurer, avec le
maximum de rapidité et c'efficacité, Ja mise en action des moyens d'intervention.
On voit dla lecture de cette définition, importance du facteur * Temps " dans la découverte et 'extinction de incendie.
1.1.3.3 Masures de prévision
Elles sont aux nombre de deux :
@ leprévision technique:
© la prévision tactique ou opérationnelle.
4.1.3.3.1 La prévision technique
Elie consiste &
© dézvler "incendie (dévection)
& svertirqussitOt les occupants (alarme);
@ _prévenir cu plus tdt le personnel devant combettrele snistre (alerte) ;
© Bteindre (mise en ceuvre des moyens de secours).
1.1.3.3.2 Laprévision tactique ou opérationnelle
Elle comprend :
@ iebonne connaissance du secteur d'intervention
© la vérification permanente des moyens dlintervention :
@ laiaison télephonique : « on sattacherc & ce que Fappel des secours extérleurs soit diffuse le plus rapide ment possible,
soit en créant le ” réflexe 15 "ou" 150 ", solt por la mise en place de lignes directes entre les établisserents jugés
angereix et les centres de secours
2 Le comportement au feu
124 Définitions
Le comportement au feu
Le comportement au feu d'un matériau ou d'un assemblage en cas d'incendie est apprécié & partir de deux critare :la
résistance au feu et de la réaction au feu.
Combustibieé
Caracttre de ce qui est combustible. La combustibilité d'un matériau dépend de sa température (énergie d'amorsage
ndcessalre), de son degré hygrométrique (un matériau sec se consume plus rapidement qu’humige), de son pouvoir
calorifique, de sa stabilité chimique, de sa forme présentée (une Feuille de papier collée sur un mur brate plus difficilement
que libre), ce sa position (une aliume téte en bas brale plus vite qu'horizontale), du rapport volume/surface (un matériau
divisé en plusieurs parties brOle plus facilement que compact), etc
Incombustibtité
Propriété d'un mat
1u a résister A Yignition.
Un matériau incombustible ne brOle pas et ne dégage pas de vapeurs inflammables en de chaleur.
Inflamenabititg
Propriété d'un matériau & braler avec production de flames.
tnnftamena pies
Propriété d'un matériau dont la décamposition s'effectue sans production de gaz inflammable nide flamnme en présence de
source de chaleur et cesse dés la disparation de cette demiére.
Ignitugation
Ensemble de* techniques ayant pour but d'améliorer le comportement au feu des matériaux jugés dangereux en cas
incendie. Elle consiste, soit 8 déposer un ignifugeant en surface d'un matériau (peinture, vernis, enduit), soit 2
Mimprégner dignifugeant (trempage du bois), soit 2 incorporer Iignifugeant dans la masse du matériau (matigres
plastiques la fabrication), soit & combiner ces techniques.
Liignifugation retarde ou supprime la mise & feu, dirninue la vitesse de combustion et de propagation, modifie fa nature et
la formation des fumées et vapeurs, permettant ainsi aux secours dintervenir pour sauver les personnes et limiter les
dégats matériels. Elle modifie le classement au feu du matériau mals ne le rend pas incombustible. Seule son infiammabilité
est modifige. La durabilité de gnifugation est variable.
4274 BULLETIN OFFICIEL, N* 6306 12 moharrem 1436 (6-11-2014)
Le pouvoir calorifique
Cesta quantité de chaleur dégagée par un kilo d'un matériau lors de ca combustion complete exprimé en Kifke de
combustible ou en ki/ny (gaz)
© Exempla: 1g de bois 17 Méga-Joules (M1)
© shaice foul gs Mg Joules (4).
Le potentlel calorifique
Crest lo quantité de chaleur dégagée lors de le combustion comoléte de ensemble des materiaux contenus dans un
volume conn.
22 Larésistance au feu
La résistance au feu est le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer le rdle Gui leur est dévolu
malgré action d'un incendie.
La résistance au feu concemne les éléments de construction.
Les éléments de construction sont tous les composan”s dont Vassembinge particioe Aun éullica. ty sent répert
dalies, poteau, cloisons, portes, faux plafonds, charpentes, toitures ete
Trois niveaux de résistance au feu sont définis : résistance mécanique, étanchéité, isolation. On y associe une durée de
résistance
La résistance au feu des éléments de construction se décompose selon lev caracteristiques suivantes
* stable au feu (SF): respect du critare de résistance mécanique
+ paresflamme (PF): respect des critéres de resistance mécanique at d'étanchéité aus flammes et gar;
+ coupe-feu (CF): respect des critares de résistonce mécanique, d'étanchéité aus flammes et p02 et disolation
thermique,
's par:
‘ace ar aero
Le classement doit précis
2,2, 3h, 4h, 6 he
la durde du respect des cttves, cette durée est expriee en temps normalisd ah 2h 1h, 1h
SF 1H =#R6omn
CE tH = RIEGomn
lanchers bole protégés en sous face par une plague de pidtre de tem B'épalsseur
Dale peiveenbéton ard de 14cm elépalceurprotégée en soc tace par un end plete spc ce
semdepaisseur
Dlancher enhourcis et pouirelies en béton p ouvert de bétan,protége en Sous face par
lun end pdtre de em eepasseur
a nae Saatca nee ee
Briquespltrvesprotégees rur chaque face par un enduit pare deo cm dépasseut
‘lolsons en careaux de plate de 5 cm Pépalseur plein
ss ur es de “aces
Cllsons en carresux de pltre cle 7 em df plsseurauéoids sss surles dou aces
Cltsons en carreaux de ple de 7 oma éplsseur pins ss sur les ceux
Clisons en biquespieines de 6 cm épalsseur
lolsons en briques pleinesde 2 amd'épasseur
N° 6306 — 12 moharrem 1436 (6-11-2014) BULLETIN OFFICIEL,
ssenur protégéer sur chaque face par un endult de 5 ematépalsseur
“lolsonscamnportant 2 plaques de patre sur chacue face porées sur os
Test admis une éguvalence entre 'épalsseur dune perteplne an bois masa ete depré de |
| eedstanceau feu (épasceur 39 rm pour de ots pei).
La réaction au feu
1.23
La réaction au feu d'un matériau est 'aliment qui peut étre apporté au feu et au développement de l'incendie.
Elle concerne les matériaux de construction qut sont les matigres ou produits qui permettent de préparer les éléments de
gros et second ceuvre d'une construction : plerre, brique, platre, acier, verre, etc.
Laréaction au feu des matériaux est établie en fonction de criteres de comportement au feu:
@ la combustibilité, donc la quantité de calories (d’énergie) susceptible de se dégager par combustion,
(reférence au pouvoir calorifique) ;
© Tinflammabilité, liée au dégagement de gaz plus ou moins infiammables au cours de la combustion.
Le classement officiel ou classement M de réaction au feu est
Mo incombustible
M1 Inflammable difficilement
M2 Inflammable moyennement
M3 inflammable facilement
M4 inflammable.
(On peut, dans certains cas, ameliorer ta réaction au feu d'un matériau, par ignifugation,
Crest un procédé qui, chimiquement, permet de diminuer Iinflammabilité d'un matériau ou de diminuer la vitesse de
propagation de la flamme & sa surface. Mais 'ignifugation ne diminue pas a combustibilté,
‘Autrement dit, un matériau combustible classé de M1 A M4 ne pourra pas, par ignifugation, étre classé MO.
De plus, le traiternent parignifugation augmente la teneur en prodults halogénes des gaz de combustion, notamment en
chlore, ce quien augmente la toxicité.
Réaction au feu de quelques matériaux courants
Produits dela construction
Taine de Roche, panneavx ou rowlcaun nus Gu val
Dalle deplafond en|aine deroche
{ Laine de roche sur plaque de platre
Polystyrene sur plaque de platre
Polyuréthanne sur plague de piatre
{ Panneau de particules, ignitugé
Papier peint vinyique sur plaque de platre
Panneau de mousse ohénolque
Panneau de particules, non ignifugd
Lambris sapin non vernt
Cantreplagué ordinaire
Papier pent sur panneau de panicules a ‘wou Ma
Polystyrene extrudé ov exponsé,igafug’ mi
Polytyréne extrudé ov exparsé, non igifuge My non cases
Polyurdthanne,igifuge ~ MM
Polyuréthanne, non ignfage ‘a non clase
4276 BULLETIN OFFICIEL N° 6306 ~ 12 moharrem 1436 (6-11-2014)
ed
.3 La conception des batiments
134 Lisolement des batiments
isolation des batiments les uns par rapport aux autres constitue un moyen de prévention efficace qui permet d’éviter
qu'un incendie ne puisse se propager entre eux.
Dans la mesure ol! la séparation de certaines activités s'avére possible, une premiére apprache de lisolement peut étre
faite. Elle consiste lors des études dlimplantation sur le tetrain, & concevoir des batiments distincts suivant les activités
tout en maintenant entre chaque construction, un espace libre.
I s'agit d'un élément majeur de prévention. En cas d'insuffisance, il donne lieu & des exigences supplémentatres ou a des
mesures compensatoires.
Afin de protéger les batiments des incendies susceptibles de provenir de l'extérieur et d'éviter Ia propagation & Iintérleur
des immeubles, les régles de sécurité prévolt, pour chaque type de construction, des mesures d'isolement.
13.2 Lastabilité au feu des structures
Concernant I'aptitude & l'usage des produits de construction, ceux-l doivent présenter des caractéristiques telles que les
ouvrages dans lesquels ils sont utilsés répondent & six exigences essentielles. Parmi ces exigences, deux concernent
particuliéreient la stabilité des structures:
Exigenc
ssentille de résistance mécanique et de stabilité.
louvrage doit étre congu et constrult de maniére que les charges susceptibies de s'exercer n'entrainent ni Veffondrement,
nila déformation, nila détéricration ou dommages disproportionnés par rapport & leur cause premiere,
Exigence essentielle de sécurité en cas d'incendie,
Llouvrage doit étre congu et construit de manire que, en cas diincendie, fa stabilté des éléments porteurs de ouvrage
puisse étre présumée pendant une durée déterminée, que''appartion et la propagation du feu et de a fumée & Iintérieur
de ouvrage soient limitées, que extension du feu & des ouvrages voisins soit limitée, que les occupants puissent quitter
Vouvrage indemne ou etre secourus d'une autre manigre, et que la sécurité des’ équipes de secours soit prise en
considération
Des dispositions particulléres sont précisées par les régles de sécurité, tant surle plan de la stablité des structures & froid que
sur leur comportement au feu. Toutes les constructions doivent en outre respecter les rdgles antlsismiques prévues par la
réglementation les concernant (RPS 2000).
13.3 Llaccessibilité des batiments
Afin d'assurer aux personnes une protection efficace, lest exigé, pour toutes les constructions, des dispositions minimales
permettant laccés aisé et lintervention des services de lutte contre incendie. Les voies d'accés permettant cette
intervention comprennentlles « voles engins » et les « voles échelles » dont les caractéristiques sont les suivantes:
1.3.3.1 Voles engins
Voie utlisable par les engins de secours (en abrégé vole engins) : d'une largeur minimale de 8 m, comportant une chaussée
répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée & partir de la
vole publique:
Largeur, bandes réservées au stationnement exclues
© ampourune voie dont la largeur exigée est comprise entre & et 12m;
© 6 mpour une vole dont lalargeur exigée est égate ou supérieure 312,
Toutefois, sur une longueur inférieure 8 20 m, Ia largeur de la chaussée peut étre réduite 8 3 m et les accotements
supprimés, sauf dans las sections de voies utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au ci-dessous «
voir voie échelle »
Force portante catculée pour un véhicule de 160 kilo newtons avec un maximum de ge kilo newtons par essieu, ceux-c}
tant distants de 3,60 m au minimum.
@ Resistance au poingonnement : 60 N/cm' sur une surface minimale de 0,20 m.
& Rayaninteteur minimal 11
© surorgeurS = 57 dares veges de rayon intreurinféreura som. (Set surlargeur et rayon intérieur, dant exprimés
enmatres)
@ Hauteur libre: 3,50 m.
© Penteinferieure ds
N° 6306 — 12 moharrem 1436 (6-11-2014) BULLETIN OFFICIEL, 4277
ee
1.3.3.2 Voles échelles
Section de voie utlisable pourla mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie échelle):
Partie de voie utllisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifides comme
suit
fa longueur minimate est de 10 m
(a largeur libre minimale dela chaussde est portée 8.4m;
la pente maximale est Inferleur 10;
la disposition par rapport 2 la fagade desservie permet aux échelles aériennes d'atteindre un point dlacces (balcons,
coursves, ete), & partir duquel les scpeurs pomplers dolvent pouvoir atteindre toutes les bales de cette facade, (a distance
‘maximaie entre deux points dacces ne devant jamats excéder 20 m.
O00
Si cette section de vole n'est pas surla voie publique, elle doit lui tre raccordée par une voie utilisable par les engins de
secours.
Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est
portée 47 m, avec une chaussée libre de stationnement de7mde
large au moins.
134 Les facades
<1 Généralieés
Les facades peuvent propager un incendie suivant tr
is processus
@ parrayonnement d'un immeuble volsin ou d'une partle de batiment adjacente
© partransmission d'un feu d'origine extérleure (chaussée, par exempie) vers Vintérieur
par transmission aun feu intérieur d'un niveau aun autre d'un meme batiment, parles cuvertures des fagades,
Les risques sont différents selon la constitution de la facade : une parol traditionnelie en maconnerie ne sera vulnérable
(que par ses ouvertures, alors qu'une facade en matériaux combustibles sera vuinérable 3 tous les phénomenes de
propagation.
Dans le cas particulier des facades en verre, I importe d'étre assuré que la colle ne cédera pas avant la rupture du verre
‘et quill n'y aura pas risque de chute d'un élément entier,
1.3.4.2 La Regle du «C+D»
Laragle dite du « C+D » conceme la création d'un obstacle au passage du feu d'un étage & l'autre.
4278 BULLETIN OFFICIEL N°6306
(2 moharrem 1436 (6
distance verticaie en métres entre le haut d'une bale et le bas de la bale superposée.
D : distance horizontale en metres entre le pian du vitrage et le nu de I'obstacle résistant au feu falsant sailie (plancher,
balcon...)-
‘M:masse combustible mobilisable, exprimée en Mi/m2, Eile est nuile pour les facades en magonnerle traditionnell.
Les valeurs (C) et (M) sont normalement fournis par les fabricants de panneaux de facade.
C+D >stm,siM <=80 Milm2
C40 254,30, si M> 80 MJ/m2
4 Le compartimentage (cloisonnement)
1.4.1 Objectifs du compartimentage
Le compartimentage est l'ensemble des mesures constructives quill y a lieu de prendre pour lutter contre la propagation
de Iincendie en créant des obstacles 8 cette propagation. Ces obstacles, verticaux ou horizontaux, en empéchant ou en.
ralentissant "incendie, vont permettre =
© assurer ou aumoins de faciter Pévacuation rapide des personnes vers 'extérieur ou vers les lieux de recuel par des zones
‘ou passages protéges;
© delimiter teplus possbte le volume des zones présentant des sques particullers pour les personnes Ou pour les blent:
© de faciiter intervention des secours extérieurs en leur permettant d'accéder au sige du snitre
© delimiter fampleur des dégats sur les blens.
1.4.2 Principes du compartimentage
Les principes du ciolsonnement ou du compartimentage découlent naturellement des objectifs visés ci-dessus. Les
obstacles dressés pour contenir le feu ont un degré de résistance qui est fonction du type de feu prévisible, du risque
‘encouru par les occupants et les biens, du temps nécessaire a I'évacuation, etc. En pratique, ce degré de résistance est
‘exigé par les ragies techniques de sécurité, pour les parois et pour les ouvertures.
Les murs et cloisons peuvent étre en maconnerie (parpaings, briques, carreaux de platre, etc.) ou en éléments
préfabriqués. Lorsque l'utilisation d'un matériau de base seul ne suffit pas 8 conférer 3 I'élément le degré de résistance au
feu requis, on lui ajoute des matériaux de protection rapportés.
1.5 Le désenfumage
A Oblectifs du désenfumage
© rendre praticables es locaux en contact avec lelocal incenclié;
© _Empécher a propogation du feu.
Atravers les actions suivantes :
© mointentrune visible suffisante;
© Diminuer 1a teneur en goz toxiques;
© Conserver un toux d'oxygene acceptable;
© Emplcher !éiévation de température
1.5. Principes du désenfumage
~ Assurer un balayage de I'espace par l'amenée de Pair frals et extraction des furnées pour permettre I"évacuation rapide
des occupants et intervention des secours.
-Etablir une higrarchie des pressions entre le local siistré et les locaux agjacents de maniére 4 réaliser un équilibre
sTopposant 8 la propagation des fumes.
1.5.3 Conditions du désenfumage
Le compartimentage : Les volumes 3 désenfumer doivent avoir des volumes raisonnabies
N doit respecteria stratification naturelle des fumges.
N°.6306.- 12 moharrem 1436 (6-11-2014) BULLETIN OFFICIEL, 4279
Larépartition judicieuse cies amunées (air et des extractions de fumée.
Protection de escalier
Lescalier est la vole de communication naturelle entre tous les étages. Ilse trouve automatiquement en depression par
rapport au niveau incendié et fes mouvements des fumées s’établissent vers les dtages inféricurs ou supéreurs suivant le
niveau incendi¢ et les conditions atmospheriques extérieures.
Son encloisonmement oct don: indiepentable. Et en désenfurnage naturel, le tirage thermique de la cage descaller est
généralement micux «nse celul des conduits et ouvrants en facades et louverture des portes au niveau sinistré provoque
Penfumage de t'escal,
Deux solutions sone possibies pour le protéger
La mise en pression * Cette solution consiste & souffler de Vair frais dans V'escalier de maniére & assurer une surpression de
celui par rappert aux cireulations horizantales,
Le balayage de la cage d’escalier : On réalise le balayage & travers un exutolre (1m!) en partle haute etune amenée o’ait
située au niveau inférieur. Cette ouverture est commandée du niveau d’accés au ROC.
1.6 Lesdégagements
164 Généralités
Par « dégagement », on entend, toute pertie de la construction permettant le cheminement dévacuation des occupants :
erculation horizontate, zone de circulation, escalier, ascenseur, couloir, ampe, porte, sortie, issue.
Ligtude des dégeremsnts prend en compte la conception des dégagements, leurs nombres, les largeuts, les distances &
parcouri, etc.
Lranalyse des risques incendie et panique tent compte des particularités du type de batiments. Si, dans fes batiments
habitation et les linc de travail, les locaux, sont généralement connus des Occupants, ce n'est pes toujours le cas des
établissements recevan du puvbe, les risques sont liés & la configuratior. des btiments, (Leur hauteur, ia densité...) et
Févacuation des personnes 8 mobilité réduite,
1.6.2 La conception des «esegements, des escaliers et des portes
Les dégagements sont ats « protdgés » lorsque les personnes s'y trouvent 3 'abri des flammes et de la funde, soit parce que
les parois offrent un degré réslementaire de résistance au feu (dégagements encloisonnds), seit parce quills sont 2 Mair
Nore,
4.6.2.2 La conception des aéganements
Les degagements doivent étre anicnages et répartis de manire & permeitre Pévacustion rapide et sire des personnes. De
ce principe decoulens de preccristicrs selon fe type de batiment, parmilesquelles :
@ Les culsviesus dowent fire évités dans tous les Ioeaux de travail sinon limités 8 19 mndtces pour Jes Jocuux nowwvellement
cconstruits ou umenages. bans les ERP, les portes des locaux accesses au public donnent sue des dégogements er cul-de sac
heslowant pas 274-8 pus de 19 in du deBouche de ce cul-de-sac. Dons les IGH, la distance maxims este (a porte aun loge
fen cul de-sac st Pemibrancl eniant de deux creuistions menent chacune dun escalicr ne doi pas exc Jer 10.
La distance A oarcourir pour gagner un degagement doit etre linitée
© 8.20.0 maximum en erage oon sous satpour gagner un escalor dans ies ieux de travel;
© a0 m dunsie cas général des FRP, partir dlun point queleangue d'un lee, pour gegre un escaier ow une circulation
tae proces, 2015 escaller Net pas protege Ou sian se trouve dans une partie formant eulde:sce sout
Sispoutions aggravantas su uteénsante préwes dans leprésent régiement
© 8 Jorn marimar pour gage” un etedlier dans un IG, sauf alspositiens particuliéres srévues rs Jaren
vt
Les escaliers et issues doivent étre jucicieusement répartis: de maniére & desservir facile ment toutes fes parties sun ERP ot
déviter que phisiour sorties soient soumises en meme temps aux effets du sinistre; de maniére & permettre une
Evacuation rapide, Les iates et les escaliers doivent satisfaire la distance de 5 m au minimum Pun de autre jour les ERP et
les locaux de travai; et les uceatiers des IGH doivent etre d'une distance minimaie de 10 met Maximate de 30m "un de Vautee;
© lodisterce & pveauri entre le débouché dun escaler ou ree de-chaussée et une sortie sur Vextérieur est imitée elle doit
tr nferieyin 1 20 m das ls locoux de travel, les EAP et les batiments d’hobitation. Dans les (GH, une sortie directe doit
Sorespenitrea shaque escoier, suf ceux! débouchent sur un ha auvrant largement sar Pextévier
© dans les “wculionn principaies, West interGit de placer une ou deux marches isoides et ies differences de niveus peuvent
tre atin por des pentes egeles au pls 10 4;
@ dans tous les types de botimente, les exeaiars desservant les Stages doivent tre cantinus usqutau nivemy \'evtcuct:on sur
Vertéricur i tuivent dire diasuciés des escaliers desservent les sous sol, afin d'éviter que les occupants ne cy dirent sans
wenzendro compte.
1.6.2.3 La conception des escaliers
Les dimensions ces marches des escaliers doivent étre contormes aux régies de l'art et, saut exceptions (gradins), les
volées ne doivent pas compter plus de 25 marches. En autre, fes paliers doivent avoir une largeur égale a celle des escaliers
et, dans le cas de voides non contrariees, leur longueur doit etre supérieure a 1 matve.
Ua protection ces exeatiors ut des ascenseurs par encloisonnement, ou par ouverture Vair bbre de la cage, s'oppose a 1a
propagation cu ie leurs er permet V'évacuation des personnes 3 Wrabri des ‘umées c: deo gnz
chaudes,
S58
4280 BULLETIN OFFICIEL IN? 6306 — 12 moharrem 1436 (6-11-2014)
= Tous les escallers, mécaniques ou non, et les ascenseurs doivent étre protégés, c'est-ddire encloisonnés ou & Mair libre
sauf cas menticnnés dans ce raglement.
exemple des escallers tournants notmaux.
Escallers et ascenseurs enclolsonnés :
Lencloisonnement d'un escalfer ou d'un ascenseur est constitué par une cage continue jusqu'au niveau d'évacuation vers
Pextérieur.
Le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas @tre en communication directe avec te
volume d'encloisonnement des escaliers desservant les étages.
Liescalier encioisoriné doit tre maintenu a l'abri de la fumee. Désenfumé par un exutoire d’sm? au plancher haut de la
cage d’escalier et manceuvrable par une commande manuelle depuls d'acces au RDC.
Les parcis d'encloisonnement doivent avoir un degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu de la structure du
batiment.
Liescalier ne doit comporter qu'un seul acces & chaque niveau.
Les portes des escaliers doivent étre PF ¥h avec ferme parte pour les ERP, ERT, et batiments d'habitation, saut
atténuations ou aggravations mentionnées par ie présent réglement. La hauteur maximale de la porte est de 2,20 metres.
Le volume d'enclaisonnement ne doit comporter aucun condult présentant des risques d'incendie cu d'enfumage &
exception des canalisations électriques propres & l'escaller. En outra, ce volume ne doit donner accés & aucun local
annexe (sanitaire, dé pdt, etc.).
Les parois des cages d'escalier doivent étre réalisées en matérlaux incombustibles.
Le volume des escaliers doit étre isolé et indépendant de celui de l'ascenseur ou du monte charge pour tous les types de
batiments,
Tere coronene
cage d'escalter enclotzonnée ‘Dissoclation des escaliers
Escallers et ascenseurs 3 lal libre:
Un escaller ou une cage d'ascenseur & lair libre doit avoir au moins une de ses faces ouverte sur W'extérleur les autres
patois et les partes d'acces répondant aux dispositions ci dessus.
De plus, le volume des cages dascenseurs au escaliers doit satisfaire les conditions définies ci- dessus.
Danses locaux de travail et dans les ERP :
© les excaliers tournants doivent étre 6 balancement continu sans autre poller que ceux desservant les étages: Les dmensions
des marches sur la ligne de foulée dolvent etre con formes aux régles de Fart et le giron extérieur des marches dolt fire
Inferieur& 42em;
© lesmarchesne doivent pas ttre lssentes et es marches sucessves doivent serous des ems'tny @ pas de
contremarches
Les escaliers doivent etre munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale 3 deux unités de
passage, soit 1,40 m, (ou d’au moins 4,50 m dans les focaux de travail existants) en sont munis de chaque cbté,
1.6.2.4 La conception des portes
Les portes faisant partie des dégagements exigés pour les locaux de travail, ERP et IGH doivent satisfaire les
N° 6306 ~ 12 moharrem 1436 (6-11-2014) BULLETIN OFFICIEL 4281
dispositions suivantes
@ _svouvrir dans fe sens de la sorte lorsqu'elles desservent des établissements, ou locaux pouvant recevolr plus de se
personnes;
@ Sfouvrir par une manceuvre facile (simple poussée, manceuvre
tournante, crémone ou barre anthpanique normalise).
jun seul disposi par vantall tel que bec-de-cone, polgnée
Les portes et portails en va-et-vient doivent, au minimum, comporter une partie vitrée & hauteur de vue, les couleurs
rouge et orange sont prohibées.
Eclalrage de sécurité:
Les dégagements: Issues, escaliers, circulations et cheminements dolvent étre dotés de I'éclairage de sécurité; aussi tous
les locaux contenant des occupants, afin d'assurer une circulation facile, de permettre Wévacuation sre et facile du
public et d'effectuer les manceuvres interessant fa sécurité; et ce, selon les Conditions sulvanes
= Lidclairage de sécurité doit étre a 'état de veille pendant I'exploitation de Hétablissement.
> Lidclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défalliance de I'éclairage normal.
+ En cas de disparition de I'alimentation normallremplacement, l'éclairage de sécurité est alimenté par une
source de sécurité d'une autonomie d's heure au moins.
Ucomporte :
= soit une source centralisde constituée d'une batterie d'accumulateurs
~ _ solt des blocs autonomes
-ntant des luminaire
Liéclairage de sécurité 2 deux fonctions :
Liéclairage d'évacuation : L'éctairage d’évacuation doit permettre a toute personne d'accéder 8 l'extérleur, en assurant
éclairage des cheminements, des sorties, des indications de batisage, des obstacles et des indications de changement
de direction
Cette disposition stapplique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure
2 300 ma en étage et au rez-de-chaussée at 100 m2 en sous Sol
Les indications de balisage visé aux dispositions constructives du présent titre doivent étre éclairées par M'éclairage
d'évacuation, s\ elles sont transparentes par le luminaire qui les porte, si elles sont opaques par les luminaires situés 9
proximité
Dans ies couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas etre espacés de plus de 15 metres.
Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné ¢'au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement,
assignee.
L’éclairage d'ambiance ou ¢'anti-panique : doit étre installé dans tout local ou hall dans lequel t'effectif du public peut
atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-s0!
Liéclalrage d’amblance ou d'anti-panique doit étre allumé en cas de disparition de I'éclairage normal replacement.
Cet éciairage doit étre basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par matre carré de surface du local pendant la
durée assignée de fonctionnement.
Le rapport entre fa distance maximale séparant deux foyers tumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit étre
inférieur ou égal 4.
1.7 Moyens de secours :
17 Généralleés
Les moyens de secours peuvent comporter:
des moyens d'extinction ;
es dispositions visant & faciliter action des sapeurs-pommpiers ;
wun service de sécurité incendie ;
-un systéme de sécurité incendie (SSI) pouvant comprendre :
© unsystéme de détection automatique dincendi,
& unsysteme de mise en sécurte incendie,
& unsyseeme detarme:
© unsystime daterte
.2 Moyens de lutte contre "incendie
1.7.2.1 Bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau
La bouche d'incendie est un appareil de robinetterie, raccordé 4 un réseau d'eau sous pression enterré ou protégé et
permettant le branchement au niveau du sol du matériel mobile des services de lutte contre lincendie.
Un poteau d'incendie est une installation analogue 4 la bouche d'incendie mals dont les prises sont disposées au-dessus
du sol
Les bouches et les poteaus d’incendie peuvent étre alimentés soit par un réseau de distribution publique dea, soit par
un réseau d'eau sous pression privé.
4282 BULLETIN OFFICIEL N° 6306 — 12 moharrem 1436 (6-11-2014)
Les bouches et poteaux d'incendie sant normalisés.
Les bouches d'incendie
La bouche d'incendie normalisée est incongelable ;
pour étre utilisée sur les circuits hydrauliques sous pression maxi
prise doit &tre de 60 m'th.
lune prise de 100 mm de diamétre ; elle est prévue
jale en service de 16 bar. Le débit nominal mesuré 8 la
La bouche diincendie est désignée par le diamatre nominal de la prise, le mode de raccordement (bride fixe ou
orientable) et le diamatre nominal de raccordement de Vorifice dientrée et la profondeur de raccordement. La
profondeur de raccordement est [a distance en mm entre le niveau théorique du sol et 'axe de l'erifice d'alimentation de
la bouche diincendle.
Les poteaux d'incendie
Les poteaux d'incendie normalisés sont incongelables, ils possdent selon fe modele
© poteou de 100: une prise centrale de 190 mm et deux prises latéraies de 65 mm; leur débit nominal est de 60 m'jh;
© poteau de2 x 100 : deux prises iatéraies de 120 mm et une prise centrale de 65 mm; leur débit nominal est de 0 mh;
@ poteou de 65 une prise centrale de 65 mm; leur débie nominal est ce 30 fh:
@ ils sont prévs pour étre utilisé sur des crcults hydrauliques sous pression maximate en service 8 ¥6 bo.
Hormis leurs caractéristiques dimensionnelles, les poteaux d'incendle peuvent se distinguer de la maniére suivante,
lis peuvent atre munis d'un systéme de vidange soft automatique solt semi-automatique.
Les prises peuvent étre exposées & vue et le poteau est dit « prises apparentes ». Lorsqu’elles sont protégées par un
capotage, ll est dit « sous coffre ».
Les poteaux peuvent atre équipés d'un dispositit emp&chant a rupture des canalisations en cas de renversement
(accident de circulation par exemple), dans ce cas ils sont dits « renversables » ; dans le cas contraire, ils sont « non
renversables »
Les poteaux a
\cendie doivent atre peints en « rouge incendie » normalisé et porter
© lamarque ou te sigie du fabricant;
@ surle couvercie, le sens et le nombre de tours ouverture;
© les deux dernies chiffres de Vannée de fabrication.
Implantation et installation
Un poteau dlincendie doit étre situé 8 une distance comprise entre + et 5 m du bord de la chaussée accessible aux
vehicules des services d'incendie et de secours, de maniére 2 ne pas gener la circulation des piétons. Il peut tre mis &
bri des chocs éventuels lids 4 la circulation automobile par un systtme de protection (murette, barriére). Le poteau
doit étre orienté de maniére a faciiter la mise en place et la manceuvre des tuyaux.
Une bouche d'incendie doit tre située au plus 2 5 m du bord de la chaussée accessible aux véhicules des services
diincendie et de secours, sur un emplacement le moins wulnérable possible au stationnement des véhicules. Cet
‘emplacement est signalé par une plaque normallsée. Un espace libre de 0,50 m de rayon doit &tre ménagé autour du
careé de mancauvre.
Les bouches et les poteaux d'incendie sont évalués en fonction des risques.
4.7.2.2 Robinets d'incendie armés
Les Robinet d'incendie armés doivent Btre:
conformes aux normes en vigueur et maintenus al'abe du gel;
places a 'interieur des batiments, le plus prés possible et a extérieur des locaux a protéger;
Instllés pour que toutes les parties des locaux puissent étre attelntes par unjet de lance (au par deux jets dens ies locaux
8 risques importants);
slgnaiés sis sont placés dans un recoln ou unplacard (non verroullé), et constamment dégegés;
entourds d'un volume de dégegement suffisant pour que le déroulement et'enroulement pulssent se falresans
dlifficutés;
aliments de préférence parle réseau de distribution d'eau publique
60 m'fh sousune pression de 4,5 88,5 bars, per surpresseurs et réservoirs si
nnecessaires, pendant ta durée ‘reotfv eure au minimuen) ;
4 pouvoir atre réalimentss qu nivaaiu'- Ae des sepeurs poirplers @partk de deux raccords de 65 mm nar colonne humid,
pplacés moins de 60 m d'une bouche ou d'un pateau diincendie (ernplacementsigralé par une pancarte).
1.7.2.5 Installations ¢'extinction autor=tique
Eau Sprinklers »
Une installation d'extinction automatique 3 eau (sprinklers) peut étre imposée dans tout ou partie d'un batiment.
Les locaux ainsi protégés doivent étre Isolés du reste du batiment dans les mames conditions que les locaux & risques
particullers.
‘installation dcit étre conforme aux normes, et réalisée par des entreprises spécialisées et qualifies.
Les sources d'eau, les pompes ou les surpresseurs, doivent étre eonformes aux normes. L'alimentation électrique de
sécurité pour lesdits surpresseurs doit tre conforme aux dispositions des Installations de sécurité
Les vanes de barrage doivent étre signalées et accessibles aux sapeurs-pompiers. Les débits aux points fes plus
défavorisés doivent pouvoir étre contrélés.
Autres agents extincteurs
Des installations fixes ou mobiles mettant en aeuvre divers agents extincteurs peuvent étre prévues pour ia défense de
tout ou partie des iocaux accessibles au public ou non d'un établissement.
Elles doivent étre conformes aux normes en vigueurs,
17.2.6 Apparells mobiles
Les établissements doivent étre dotés d'appareils mobiles tels que :
Seaux-pompes diincendie,
-Extincteurs portatifs,
sExtineteurs sur roves,
Pour permettre au personnel ot éventuellement au public d’intervenir sur un début d'incendie.
es appareils doivent étre conformes aux normes les concernant.
Implantation des extincteurs
‘Afin de facilter sa localisation tant par le personnel que par le public, il doft atre de couleur rouge.
Un extincteur doit faire Vobjet d'une vérification annvelle. i doit étre marqué d'une étiquette
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Recueil Des Circulaires 2023 17x24cm - 1 - 230907 - 182142Document331 pagesRecueil Des Circulaires 2023 17x24cm - 1 - 230907 - 182142Abdellah NACIRINo ratings yet
- Avp Loi 88.12 ArDocument12 pagesAvp Loi 88.12 ArAbdellah NACIRINo ratings yet
- Méthodologie D'élaboration de L'approche Participative-FrenchDocument4 pagesMéthodologie D'élaboration de L'approche Participative-FrenchAbdellah NACIRINo ratings yet
- Bilan Coopération Internationale DGCTDocument10 pagesBilan Coopération Internationale DGCTAbdellah NACIRINo ratings yet
- REMAGP - Manuel Gouvernance FRAR WebDocument78 pagesREMAGP - Manuel Gouvernance FRAR WebAbdellah NACIRINo ratings yet
- Guide Benchlearning VFDocument31 pagesGuide Benchlearning VFAbdellah NACIRINo ratings yet
- GuideElaborationReceuils desAA - VF - 24122020Document81 pagesGuideElaborationReceuils desAA - VF - 24122020Abdellah NACIRINo ratings yet
- BO - 6874 - FR Régularisation Des ConstructionsDocument184 pagesBO - 6874 - FR Régularisation Des ConstructionsAbdellah NACIRINo ratings yet
- Rapport Activité 2018 AMDL FRDocument50 pagesRapport Activité 2018 AMDL FRAbdellah NACIRINo ratings yet