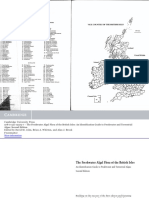Professional Documents
Culture Documents
Les Pelouses Calcicoles (Festuco-Brometea) Du Domaine Atlantique Français Et Ses Abords Au Nord de La Gironde Et Du Lot - Essai de Synthèse Phyto-Sociologique (Boullet 1986)
Les Pelouses Calcicoles (Festuco-Brometea) Du Domaine Atlantique Français Et Ses Abords Au Nord de La Gironde Et Du Lot - Essai de Synthèse Phyto-Sociologique (Boullet 1986)
Uploaded by
guillaume canar0 ratings0% found this document useful (0 votes)
15 views457 pagesOriginal Title
Les pelouses calcicoles (Festuco-Brometea) du domaine Atlantique français et ses abords au Nord de la Gironde et du Lot - Essai de synthèse phyto-sociologique (Boullet 1986)
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
15 views457 pagesLes Pelouses Calcicoles (Festuco-Brometea) Du Domaine Atlantique Français Et Ses Abords Au Nord de La Gironde Et Du Lot - Essai de Synthèse Phyto-Sociologique (Boullet 1986)
Les Pelouses Calcicoles (Festuco-Brometea) Du Domaine Atlantique Français Et Ses Abords Au Nord de La Gironde Et Du Lot - Essai de Synthèse Phyto-Sociologique (Boullet 1986)
Uploaded by
guillaume canarCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 457
50316
AI
THESE 36-4
PRESENTEE A
L'UNIVERSITE DES SCIENCES BT TECHNIQUES DE LILLE
POUR OBTENIR
LE GRADE DE DOCTEUR DE TROISIEME CYCLE
PAR
V. BOULLET
LES PELOUSES CALCICOLES (FESTUCO-BROMETEA)
DU DOMAINE ATLANTIQUE FRANCAIS
ET SES ABORDS AU NORD DE LA GIRONDE ET DU LOT
ESSAI DE SYNTHESE PHYTO SOCIOLOGIQUE
SOUTENUE LE 26 MAI 1986
DEVANT LE JURY =
M. PORCHET : PRESIDENT
J.M. GEHU + RAPPORTEUR
R. JEAN : RAPPORTEUR
M, BOURNERIAS : EXAMINATBUR
J.R, WATTEZ : EXAMINATBUR
- LIMINAIRE ~
Un itinéraire scientifique, quet quiit soit, est objet de rencontres
et d'échanges ok Vamitié et ta sotticitude se eétoient agtéablement. Sans
elles, Verrance et le doute nous fussent certainement échus. A ceux qui
nous ont accompagnés, quel que fat Le chemin parcouru ensemble, ixa notre
premibte pensde, lorsque dervidre soi te regard embrasse le trajet accompli.
Plus spéciatement, nous voudions témoigner notte reconnaissance,
aux Professeuts J.M. GEHU et J. GEHU-FRANCK, entre
autres pour taccuedt quits ont toujours su nous réserwer dans leur’ station
phytosociotogique de Bailleul, d'od. est issu Hessentiet de notre documentation,
4 J.M, COUDERC, B. DE FOUCAULT, J. GUITTET, M. KER-
GUELEN, J.M. ROVER, G. SULMONT, A. et J. TERRISSE, F. et
J. VIGNON, J.R. WATTEZ et J. H.’ WILLEMS, cotlaborateurs et conscitlers
sedentigiques,
& B. CARLE, M. DUQUEF, A. PACUTA, J.B. ZAZAK et
fe Service photographique des Archives du département de Oise, pour f'illus-
tration phatographique,
4 F. VANGHELUWE, pour son aide préciouse et indispensable,
& B. LEBOIS, sans qui ce travail ne serait peut-etre pas,
engin, & F. BOUL
pour leur soution de tout instant.
>) R. BOULLET et Reine DEFASQUELLE,
INTRODUCTION
It y a pres de soixante ans maintenant, étaient posés tes premiors
jatons phytocoenotogiques sux tes pelouses caleaires du domaine attantique
francais au nord deta Gixonde avee "les études socéotogiques” de R. de LITAR-
DIERE. Du Blane-Nez @ Séche-Bee (Charente-Maritime), le Festuceto-Brachy-
podietum caleicolum de Litardiire 1928 allait ainsi durant plusieurs décennies
tubvenit & nos incuries phytosocictogiques. Plusieurs travaux tocaux ou ségionaux
étaient pourtant venus enrichix depuis, tes esquisses de P. ALLORGE (1922)
et R. de LITARDIERE (1928) ; mais tensemble, avec d'immenses tacunes (Cha-
tentes, Poitou, Normandie, Touraine, Anjou, We-de-France) ne pouvait constituer
fes bases solides d'une synthése & grande échelle dont partait R. de LITAR-
DIERE dans les premidres lignes de son introduction : "Bien que nous possddions
déja d'assez nombreux documents phytosocictogiques sur la végétation eurosi-
bérienne et méditevranéenne, ce n'est sans doute encore que dans un temps
assez Cloigné qu’it sera possible de songer ad effectuer, aut des bases sotides,
de vénitables syntheses ;",
Si ce temps parait dévotu, que ton en juge pat ta muttiptication
dos synthdses synsystématiques, certaines, trop hatives, en cublient tes gaits
phytosociologiques nécessaites a four établissement.
Désitant répondre 4 Uappet du_pionnier, nous nous sommes attetés
4 ta téche depuis 1960, d'abord pour tes Festuco-Brometea Bt,-Bl. et Tx. 1943
des seules formations crétacées, puis, étendant Vaire de ta dition, & ensemble
du domaine attantique francais, au nowd d'une timite 1000mm/an) jusqu’a
tot de sécheresse du secteur tigérien (Touraine, Beauce, We-de-France) (500
& 600 mm/an, pargois moins en quelques points)’ qui se prolonge au nord de
fa Seine par ta vallée de BOie jusquiau sud-est Amiénois ; clest un couloir
Ty ene eréeate mmiases (en 8)
SH Unite de Textension ayntictique
7
quiont emprunté de nombreuses thetmophites (Quercus pubescens, Linum tenui-
folium, Geranium sanguineum, Limodowm abortivum, etc.). Comme Pont souti-
gné G, PLAISANCE (1968) et J.M. ROVER (1973), "la pluviosité augmente
Tequlidrement avec Ualtitude” : tes cartes des précipitations moyennes annuetles
et hypsométrique se superposent pratiquement, a quelques exceptions prds
(Landes, Gaseogne, Limagne). Diauttes renseignements sont goutnis par les
précipitations mensuctles moyennes (fig. 1.6).
1.3.1.2 Températures
La température moyenne annuetle (températures vraies) varie entre
12 et 8, sans jamais atteidre ces valeurs (fig. 1.7]. On temarquera la situation
du couloir squanien que suit Mésotherme 10°. Les temperatures moyennes
mensuelles mettent en évidence certains gradients, de thetmophitic pour te
mois de juillet (4g. 1.8), dMocéaniame” pour fe mois de janvier.
Liingtuence maritime se retrouve de méme dans tes variations
des amplitudes annuelles des températures moyennes mensuetles (M. BOUR~
NERIAS, 1979 ; VU. BOULLET, 1980). Engin, Uaction limitante des températures
extrémes sut extension de nombreuses especes ne doit pas tre oublige, (J.M.
ROYER, 1973).
1.3.1.3 Indice d'aridité de de MARTONNE
Liindice diaridité est une expression pratique du climat. L'indioe
daridité annuel, de formule 1 = P/T#10 0X P est ta pluviosité moyenne annuetle
en mm. et T la température moyenne annuctle, ne nous apprend gudre plus
que fa. pluviosité moyenne annuetle (fig. 1.9).
Liindice diatidité de juillet (1 juillet = P juillet. x.12/ T juillet
+ 10) est peut-dtre plus expressis 3 ses variations (fig. 1.10) montrent te couloit
migtatoie aquitanien des subméditerranéennes et méditeranéennes, Pilot
thermophile tourangeau avec Fumana ericoides et Lavandula latifolia, te secteur
frais art€sio-boulonnais.
1.3.1.4 Humidité relative
Parmi tes cartes présentées (fig. 1.11 & 1.13), cette de Hhumidité
relative en été & 13 H lustre Pingluence maxitime. Dans Uensemble, ces don-
nées n'ont quiun faible intérét, car fe méctoclimat tes modifie profondément.
De méme Mintervention de ta nébulosité est difficitement appréciable.
1.3.1.5 Evapotranspitation
Les indices de THORNTHWAITE, de catcuts complexes, sont fonc-
tions des Cvapotranspixations potentiate et elle. L. RALLET (1960) a utilisé
avec suceds deux d'entre eux, Mesgicacité thermique (need of water) et te
déficit annuel (water desicience), pour établir tes rapports entre ckimats et
flor méditéuandenne.
1.3.1.6 Synthdse mactoctimatique
Cotte synthdse peut stexprimer pat a réaction de ta végétation
au macroctimat, illustrée classiquement pat ta cartographic des époques mo-
yennnes de geuillaison du chéne commun et de début de moisson du blé d'hiver
Sig. 1-14 et 1.15).
Fig. 1.14 = Epoques moyennes du début de 1a feuiliaison
au chéne comin
Ligne d'égale époque moyenne (en jours)
Limite de Ltextension aynthétique
tl
Fig. 1315 =
dm blé datver
Epoques moyennes du début de la motsson
Ligne’ atégale ézoque moyenne (en jours)
Limite d'extension aynthétique
fl
9
5 zones climatiques, cortespondant grosso modo aux secteuts phyto~
géographiques reconnus sur le territodte, sont discernables avec tensemble
des informations sur te climat général :
= une zone aquitanienne de la Gitonde au Seuit du Poi -
tou ; une température moyenne annuctle avoisinant les 11° ou les dépassant,
tes températures moyennes de juillet dépassant 15°, celles de janvier 3°, un
Indice diatidité annual compris entwe 30 et 40 en sont les principaux deter
manants climatiques. 201 jours suggisent pour ta maturité du bIE d'hiver. A
Poitérieut de la zone aquitanienne on déstinguera deux secteurs : fun, plus
chaud, dattitude basse et d'ingluence maritime (pluviosité ingérieure & 600
mm fe plus souvent, indice dlaridité de juillet ingérieur & 20, température
‘moyenne annuelle supérieure 2 11°C, temperatures moyennes de janvier supé-
aieutes & #C), Uautte, dialtitude plus élevée (100 & 200 ml, se ptotongeant
jusquian Bory, & tendance ovoméditerrangenne (température moyenne annuetle
ingerieure & 11°, indice diaridité de juillet supérieur a 20°, humidéte relative
matirale dété plus Clevée, pluviosité moyenne annuetle de 00 & 1000 mm.
= une zone sche de ta Touraine & ile-de-France, se proton
geant dans ta basse-Seine jusquiaux environs de Vernon, se supernosant presque
fu secteur ligérien des phytogéographes. Les principales caractéristiques sont
te déficit pluviométrique annuct fptaviosité moyenne inférieure & 600. mm par
an et indice diaridité annuel ingérieut & 30) et une température moyenne an-
muelle supérieute & 10°. On distinguera un tot tourangeau plus aride Mere
(indice dlaridité de juillet inférieur @ 20). Le chéne commun reverdit en moins
de 120 jours et fa moisson du blé d'hiver débute au plus tard 217 jours apres
fe 01 janvier.
= une zone picardo-normande la Pexception du secteur arté-
sio-boutonnais) plus fraiche, avec une températuce moyenne annuetle ne dépas-
sant pas fos 10°, des températures moyennes de juillet inférieures @ 16°, un
indice dlaridité annuel supérieur & 30° génératement, etc. «
= une zone” champenoise qui diggexe de ta précddente par
des températures estivates plus dlevées Ithexmocontinentatité) et hivernates
plus froides (température moyenne de janvier inférieure a 2). La moisson
Ta ble d'hiver y est en avance par rapport & ta. zone picardo-normande,
= une zone arrosée et sroide attésio-boutonnaise, ainsi carac-
térisée : température moyenne annuetle arférieure & 9, précipitations annuetles
‘avoisinant les 1200 mm, ptécipitations qutomnales tds Clevées (supérieures
E100 mm), température moyenne de juillet descendant sous tes 16% indice
diaridité annul dépassant focalement fes 50, ete. . Une partie du Pays de
Caux présente des conditions climatiques similaires.
1.3.2 Le mésoctimat
son action est déterminante sur tambiance ctimatique des groupe-
ments végdtaux et nous eiterons M. BOURNERIAS (1979) @ ee propos, dapres
F. MORAND [1977] : "Comme le souligne Pauteut, it existe, pour fes tempera
tures, plus do differences entre Les valeurs observées au sein des diverses
stations (ond de vallée et hauts de pente) & Cessidres (Aisne), qu'entre Les
données des stations météorologiques pour te Nord de ta France et la région
de Toutouse !".
Pylnitido
foetus (1) Fogetun | a
Fig. 1616 ~ Dtonyadtste de wégétation aur les coteaux de 2A Broate aux environs
‘Sénazpont. (80).
= erate aneuse turonlenne
FE Mane argliens rouger b atiex
(1) tragnentaize set
24
Les effets métriques du climat focal ont été enregistrds au niveau
de petouses caleaines de ta vallée de Cessidres, dans te Laonnois, pat F. MO-
RAND (1971). Les données theamométriques montrent & 5 cm du sol, un téchaus-
fement de ait, hiver comme été, par tapportt aux formations végétales environ—
fantes alors quiinversement te sol est plus sensible au {roid et plus long &
fe réehaugger (le nombre de jours de gel du sol a 5 cm pout tes pelouses cal-
eaites dépasse méme trois fois celui de ta tourbiere sous-jacente].
Un autre exemple nous est gourni par A. LUQUET (1937) qué ente-
gistra, un 9 féurier 1927, 34° 4 la surface du sot dans une potouse abvitée
au Puy de Crouetle ators qu'il y avait 5° & Clermond-Fertand sis 4 une tieue
de fi.
Les éléments intewenant dans ta déf{érenciation du mésoetimat
sont principalement de nature topogtaphique ; cétons :
= les variations du degré éolimétrique depuis tes plateaux
tabulaites plats jusquiaux pentes fos plus raides, permettant une plus ou moins
grande récoption des photons et de ta chaleur qu’éts véhicutent. Ainsé d'aprds
Si. BOURNERIAS (1979) Uéclaitement est maximal pour des pentes fortes
de 49° oxposées au sud aux équinoxes de ptintemps et d'automne, et pour
es pontes sud de lordre de 26° seulement au solstice d'été ol,d cette date,
Yes pentes de 49° sont soumises au méme flux lumineux que des pentes de
3
= les oppositions de versants de type adtet-ubac, dont impor
tance & fétage planitiaite a été souvent invoquée (M. BOURNERIAS, 1979
j JM. ROVER 1973). Un bon exemple se situe dans fa vallée de te Breste
itimite des départements de ta Seine-Maritime et de ta Somme] entre fe versant
diadspection sud-ouest oc Hon rencontre la pelouse méso-theamophile de 'Ave-
mulo-Festucetum lemanii dans une potentiatité de Daphno-Fagetum Durin et
Géhu 1963 et fe versant exposé au nord-est oi se situe ta petouse du Parnas~
sio-Thymetum praccocis dérivée, si la pente est suffisamment raide, d'une
frénaie caleicole & affinité submontagnarde du type Phyltitido-Fraxinetum
Durin et alii 1967 (gég.1-16)-
tes concavités des vallées, constituant parsois de véritables
pidges mésoctimatiques : boucte de Moisson dans ta basse valtée de fa Seine,
Poteau du Forested, prds de Courtemanche (80) oi se maintient en exposition
sud ta sesiérie.
= les effets des targes vatlées (Seine et Somme), pargois
tes tourbeuses [Somme] ; elles induisent, pat une forte evapotranspiration,
par ta gréquence et Ia persistance des brouittards, une hygrométrie élevée
Fe ait ambiant qui coincide avec fe maintien de communautés déatpines et
fa remontée dhygrophytes depuis tes parties basses marécageuses lEpipactis
palustris, Angelica sylvestris, Eupatovium cannabinum, et meme Parnassia
palustris dans ta vatiée de fa Somme (1).
(1) dans un contexte synfloristique différent du Parnassio-Thymetum
ou du Sueciso-Brachypodietum.
|
|
Mig: 1.17 > Hoguiase phytogéographique de la dition (a'aprés P. ROISIN, 1969
et Ju, ROY, 1975).
—— Mumite dea Donaines atiantique et médio-europsen
=.=. Limite de Seotear
‘tte Limite de Lextension synthétique
ATA 45 + Sous-donaine eucatlantique ; A1 1 Secteur aquitanien ; 42 +
Ligézien ; A3 : Secteur amoricain
MM # Soue~donaine nédio~stlantique, Secteur normando~ploarto-belge
BI ot B2 : Domaine médio-ouropéen j Bt: Secteur baltico-mhénan | 32 ;
Secteur alpin
Secteur
23
= La protection de massifs forestions ; tel est fe cas des
potouses de ta lisidee wud de ta forét de Compidgne, par exemple.
1.3.3 Le méctoetimat
A une échelle plus grande, selon fa nature de ta roche-mdxe et
du sot, ta structure et la répartition de ta végétation aux influences modéra-
trices, on pout définér un climat stationnel cu microclimat (2) incluant tes
composantes macto- et mésoclimatiques. Son approche reste tres déticate
et tr2s ponctuelle.
1.4 APERCU PHYTOGEOGRAPHIQUE
De nombreux travaux de gdographie botanique intéressent ta dition
et, patmé tes plus réeents, coux de H. GAUSSEN in Atlas de France, 1950-1959],
P. DUPONT (1962), L. RALLET (1960) et P. ROISIN (1969).
Diapt2s H. GAUSSEN, Uensemble de notre tenitoie est inclus
dans te domaine attantico-européen avec deux sectours : boréo-atlantique et
ftanco-atlantique. Ces conceptions ont été contestées par ta suite notamment
avec P. DUPONT (1962), P. ROISIN (1969) et J.M. ROYER (1973), qué ont
démontré entre autres :
= la place ilégitime du district champenois qué_appartiont
de fait au domaine médio-eutopéen et au secteur battico-thénan IP. ROISIN,
1969 ; J.M. ROVER, 1973 ; M. BOURNERIAS, 1979].
- Habsence du secteur boréo-atlantique dans te nord-ouest
de la France ; son aite, plus septentrionale, n'atteint pas nos limites [P. ROISIN,
1969). ‘
Nous tetiendtons es syst2mes phytogéographiques de P. ROISIN
(1969) pour te domaine atlantique et de J.M. ROYER (1973) pout fe domaine
médio-européen ({ig.1.17) ; fours subdivisions se superposent relativement bien
avec les zones climatiques définies précédemment. Sans tes discuter plus tong-
temps, nous introduitons cependant tes observations suivantes :
= si les divisions et subdivisions phytogéographiques s'appuient
aut les faits chorologiques de Pensemble de ta flor, Uétude d'un milieu écolo-
gique précis, les pelouses calcaires présentement, montre qu'un aystdme baté
fut Vensemble spécibique des Festuco-Brometea et végétations satellites (our
lets, dalles, groupements thérophytiques) ne coincideratt pas exactement avec
Jes ‘précédents, Ce résultat est diautant mieux comprchensible que ta tocati-
sation mésoctimatique des petouses est tts spécialisée. On remarquera de
méme ta pauvieté spécifique du contingent subatlantique des Festuco-Brom
tea eu égard au nombre le sarmatiques, de médio-européennes et de subméd
tetranéennes au sens large. Bornons-nous & deux exemples qui seront discutés
par ailleurs. Le secteur notmando-picatdo-belge du sous-domaine médio-atlanti-
que n'est que difgicilement décetable en ce qui coneerne ta végétation des
pelouses caleicoles, et tes pelouses picardo-nowmandes des Avenulo-Festu-
cetum lemani et Parnassio-Thymetum praccocis représentent plus des irradia~
tions occidentales de communautés médio-européennes (Lino teonéi-Festucetum
femaniil ; leur caractere atlantique y est tds discret. De méme, tes affinites
(2) On donne aussi couramment un sens différent a ces termes (cf M.
BOURNERIAS, 1979).
24
du Suceiso-Brachypodietum axtésio-boutonnais sont avec fs associations britan-
niques et boréo-atlantiques du "groupe nord-ouest européen” de J.H. WILLEMS
(1982). Liaére de tassociation wecouvre ta zone arosée et froide définie plus
haut ; tout cect rappetle topinion de H. GAUSSEN (1950-1959) sur Pextension
du secteur boréo-atlantique & cette tégion.
- Festuca timbalit (Hackel) Kerguéten est génératement
quatigiée de subattantique (J.M. ROVER, 1973) (3). Son aire tecouvre tes see-
teuts aquitanien ot ligérion du sous-domaine eu-atlantique, d'oi elle transgresse
quetque peu en Basse-Bourgogne dans des groupements plus continentaux (Inulo-
Brometum principalement) ; cette rgion parait d'aillewts pattagée entre les
influences "atlantiques" et médio-ewropéennes, tantdt inctuse dans te domaine
atlantique (P. ROISIN, 1969], tantét rapportée au domaine médio-eutopéen
(.M. ROYER, 1973). Festuca timbalit semble étre en déginitive un excellent
téactis du domaine eu-atlantique.
It rdsulte des observations précédentes qu'un systéme phytogéo-
graphique gondé au moins on partic sur ta phytosociotogée sigmatiste, et plus
exactement sur ta synchorotogie des syntaxons, serrerait de plus pres et d'une
manidte mieux pondérée ta réponse de ta végétation et de ses composants
au ctimat.
(3) Non distinguée & 1'époque de F. hervieri (St-Yves) Patzke.
CHAPITRE I
HISTORIQUE ET METHODOLOGIE
25
2.1 LES ETAPES DE LA CONNAISSANCE PHYTOSOCIOLOGIQUE DES PELOU-
SES CALCAIRES DU DOMAINE ATLANTIQUE FRANCAIS, AU NORD DE
LA GIRONDE
2.1.1 Les documents antérieuts
La connaissance fforistique et phytogéogtaphique s'appuie sur
une vaste documentation au socle gorgé par ensemble des lores et catalo-
gues départementaux et régionaux de ta fin du xIXdme sidcte et début du
Xxame sidele, dont la mise & jour sesgectue tantét d'une manidre sporadique,
tantat ttds activement @ Wexemple du Centre-Ouest de ta France sous tes
auspices de & dynamique équipe de ta Société Botanique du Centre-Ouest.
‘Ainsi, ai ta flore des pelouses caleaires est bien connue, ta science phytosocio-
Togique ne se targueta pas de Péquivalence. Depuis tes études sociologiques
entreprises pat R. de LITARDIERE (1928), un seul travail de synthése (P.
MAUBERT,1978) de portée testreinte, en raison d'un apport modeste de matériel
phytosociotogique, concerne notre dition, a fon excepte fa partie méridionate
de fa Champagne inetuse dans tes travaux de J.M. ROVER (1973, 1978) et
tes deux essais de synthése, prémices & ce travail, portant Yun sut tes Charentes
(UV. BOULLET, 1984) et Pautre réalisé en collaboration avec J.M. GEHU sut
te Notd-Ouest de ta France (J. BOULLET et J.M. GEHU, 1984).
Les publications phytosocéotogiques {avec relevés ou tistes synthé-
tiques eggectivement publics) intéressant ta classe des Festuco-Brometea dans
nob limites chorographiques sont donc essentieltement ponctuetles et ségionales.
En voici une liste chtonologique par région (1) +
* Plateau picard et Boutonnais
= R. de LITARDIERE et G. MALCUIT (1928) : Cap Blanc-Nez.
= R. de LITARDIERE (1928) : Boulonnais.
- Le DURIN et R. LERICQ (1956) : Cambrésis, Thigrache.
= L. DURIN et R. LERICQ (1959) : environs d'Headin.
- 1M, GEHU (1959) : Boulonnais.
~ R. LERICQ (1964) : Ternois.
- PA. STOTT (1971) (2) : Ectusier-Vaux (60).
- P. FOCQUET (1979) : Somme,
= P. FOCQUET et J.R. WATTEZ (1979) : Picardie occidentale.
= VU. BOULLET (1980) : secteur allant de ta Seine & ta Somme.
- JM. GEHU, J. GEHU-FRANCK et A. SCOPPOLA
(1984) : Boulonnais et Artois [voir aussi J.M. GEHU, J. FRANCK et A. SCOP-
POLA (1981) : Boutonnais et Artois ; JM. GEHU, J. FRANCK et A. SCOPPOLA
(1982) : Boulonnaés et Artois].
— D. VAN SPEYBROECK (1984) (2) : vallée de ta Somme.
- JR. WATTEZ (1984): Picardic occidentale \groupements
pionnions).
< JR. WATTEZ (1982a) : Plateau picatd (petouses avec Tetra
gonotobus maritimus).
~ JR. WATTEZ (19626) + Picardie (pelouses avec Eryngium
campestre).
(1) les travaux antérieurs A 1965 ou utilisant la méthode des quadrats
Sont en caractéres normaux, les autres en caractéres gras.
(2) ces travaux utilisent la méthode des quadrats dans la réalisation
des relevés, méthode qui nous parait peu fiable pour une végétation
aussi mosaiquée et aussi complexe que les phytocoenoses calcicoles.
26
* Haute-Normandie
~ R. de LITARDIERE (1928) : vatlée de ta Seine.
= J. LIGER (1952) : vatlée de ta Seine.
J. LIGER (1959) : estuaire de ta Seine.
- J. LIGER (1961) : vatlée de ta Varenne.
- JM. GEHU (1963) : Hénouvitle |Basse-Seine).
- C. de BLANGERMONT et J. LIGER (1964) : vatlée de
ta Breste.
~ P.N. FRILEUX (1966) : environs des Andelys.
~ C. de BLANGERMONT, J. CLERE et J. LIGER
(1968) : vatlée de la Breste.
~ PN. FRILEUX (1969) : Haute-Normandie.
P.N. FRILEUX (1973) : for8t de Lyons.
~ P.N. FRILEUX (1977) : Pays de Bray.
* Champagne
- JM. ROYER (1973) : Champagne métidionale.
- J. DUVIGNEAUD (1984) : Champagne septenttionate.
* He-de-France - Beauce
- P. ALLORGE (1922) : Vexin francais.
~ P. JOUANNE 11925} : Laonnoss.
- M. BOURNERIAS [1949] : forét de Beine.
~ M. BOURNERIAS [1961] : Laonnois.
~ R. PRELLI (1969) : Laonnoés.
~ S. DEPASSE (1969) : Laonnois.
- J. GUITTET ef R. PAUL (1974) : Massif de Fontainebleau.
~ P. MAUBERT (1978) : Beauce.
- C. ARLOT et J. HESSE (1981) : Beauce.
C. GAULTIER (1983) : vailée de #Essonne.
- C. FOURNET (1984) : vaitée de ('Essonne.
* Bey
~ P. MAUBERT (1978) : causse de La Chapelle.
* Touraine
- R. CORILLION et J.M. COUDERC (1974) : Chinonais.
*Perche
- G. LEMEE (1938) : Perche.
* Poitou
- R. de LITARDIERE (1928) : Les Jumeaux (Deux-Sevtes).
* Charentes -Aunis
- R. de LITARDIERE (1928) : Séche-Bec.
- _ LAURENCEAU (1950) : Séche-Bee.
- R. DAUNAS (1954) : Séche-Bec.
27
~ R. DAUNAS (1954) : Seche-Bec.
- TM. ROVER (1982) : Séche-Bec, Cognac, Juilté (Deux-Se-
vies).
- J.M. GEHU, J. FRANCK et A. SCOPPOLA (1984) : envitons
de Meschers-sut-Gitonde.
* Perigord
= JM. ROVER (1962) : Perigord meridional,
* Querey
~ J.M. VERRIER (1977) : causse de Gramat.
- J.L. VERRIER (1979 et 1982) : Quercy.
~ FiL. VERRRIER (1984): Quercy blanc.
* autres régions
G. LEMEE (1932 et 1933) : plaines jurassiques basses-
notmandes.
L. DURIN et J. DUVIGNEAUD (1957) : Avesnois.
JM. GEHU (1961) : Avesnois.
G. LAPRAZ (1962) : Entte~Dewx-Mers,
- JM. ROVER (1973, 1976 et 1981) : Basse~Bourgogne.
- JM. GEHU et J. GEHU-FRANCK (1984) : Liftotal nord-
armotieain.
2.1.2 Notre propre contribution
Liinsuggisance des données phytosociotogiques actuetles apparait
avec cette.liste, et la composition sloristique des pelouses cafeaires de vastes
tertitoites nous était encore méconnue voit inconnue (Aquitaine, Poitou, Tou-
raine, Anjou, Nowmandic, Ile-de-France, Champagne, marges ” berrichonnes).
Une ‘synthese sut le domaine attantique’ graneais au nord de ta Gironde ne
pouvait done @tre ratisée sans un apport conséquent, d'autant que Putilisation
de sources multiples pour Uétablissement d'une synthese eat entrainé dans
sa talisation une relative hétérogéndité, a ta fois :
= coneeptuette, du fait de tétatement tempore des travaux
utilisés paraltétement & Pévolution et a Pasginement des conceptions phytosoeto~
logiques ; celles-ci ont, avec fos ouvtages de T. MULLER (1962), J-L. VERRIER
11979), amoted un tournant. Suite a fa reeonnaissance des ourlets et la désim-
brication des Thero-Brachypodion et Xexobromion, beaucoup de travaux ancions
sont devenus depuis diffictlement exploitabtes d'un point de vue phytosocio-
fogiques, bien qu'éls conserwent une indéniable valeur descriptive des phyto-
coenoses.
= taxonomique car te niveau de détermination des idiotaxons
varie seton les auteurs, en particulier pour le gente Festuea, sans parler des
méconnaissances pour certains taxons critiques, auxquelles fos progres de ta
biosystématique permettent aujourd'hui de paltier’ en partic.
Crest dans cet esprit dhomogéndité et de prospection éotatée
que nous avons efgectud dans Pensemble dela dition, principalement en 1982
et 1983, pres de 1100 relevés de pelouses caleaites, pelouses-curlets, talus
caleicoles et pour une petite partic de dattes, de gtoupements thérophytiques,
d'éboutis, de griches, diourlets, de gourtds et de goréts, tous milieux lies par
28
fa dynamique aux pelouses ptoprement dites. Leur sépattition apparaitra dune
manidre indgale, testet de ta distribution actuelle imégutiére des individus
des Festuco-Brometea, que la géologie, le climat ou fes pratiques humaines
en soient ta cause.
2.2 METHODOLOGIE DE LA PHASE DESCRIPTIVE
2.2.1 Prospection
La techerche d'individus des Festuco-Brometea s'est apouyée dans
un_ptemiet temps sut la documentation cartogtaphique de PIGN (cartes topogta~
phiques au 1/25000) et photographique pour certains secteurs (couverture photo-
graphique agvienne de IGN), tes cartes gdologiques du B.R.G.M. (aux 1/50000
et 1/8000), tes indications ‘tirées des flores, articles de floristique, travaux
phytosociotogiques, compte-rendus d'excursion, etc., tes informations éerites
et crates de nombreux botanistes, parmé lesquels nous citerons volontiers tes
membres de ta S.B.C.0. let en particulier Messiours Andté et Jean TERRISSE].
Dans une deuxiéme phase, la prospection sur te terrain fut com-
plétée par un quadritlage presque systématique des stations éventueltes selon
ta topographic, incluant ta weeherche optique & partir des sites panoramiques
selon un itindraire peédtabli.
2.2.2 La réalisation du releve
Les relevés phytosociotogiques ont été ctablis selon ta méthode
sigmatiste bien connue de Pécole zuricho-montpelliéraine. Les variations d'in-
terprétation des deux coedgicients utilisés, abondance-dominance et sociabitité,
setont fortement minimésées par ta seule utilisation de nos proptes releves,
en dehors de quelques exceptions pour tes matges de ta dition.
L'homogénéité du matériet phytosociotogique intervient encore
dans Happrchension des surfaces mosaiquées, quielles soient homotopiques
ou hétérotepiques, qu’ stagisse de mécrohétérogéndité sociale ou de mactohe-
terogéndité phytocoenotique ; nous reviendtons plus spéciiquement sur cos
notions, mais disons, des lors, que ta techerche des surfaces les plus homogdnes
possible en regard de ensemble ftoristique et de sa physionomie fut notre
perpétuel souct. Ces surfaces cortesgondent au "sous-ensemble homogene opti-
mat" de B. de FOUCAULT |1980), qui te déctit de la manidre suivante : "suf-
fatamment grand pour avoir a quasi-totalité des éléments, pas ttop étendu
pout que les effets de contact avec tes ensembles contigus puissent étte consi-
déxés comme négligeables".
La muttiptication des televés dans un méme individu d'assceiation
constitue une déviation de Yensemble floristique d'un gtoupement portant
notamment sur ta présence des taxons. Mais ta notion méme d'individu d'asso-
ciation possdde une connotation de subjectivité et d'actualité qué ne préjuge
en tien, né d'éventuottes limites ardates, né de sa dynamique et de son his
toire ; ainsé plusieurs relevds dressés sux des chaumes de plusieurs hectares,
représentant un seul individu du Sideritido-Koelerictum vallesianae, ne nous
semblent guére plus entachés de déformation syngtoristique qu'un lot de releves
aut différents individus actuellement séparés mais ayant possédé autresois
une solution de continuité,
ee
le
29
Liaixe minimum ne seta pas atteinte paxfois, pour certains tambeaux
relictuels de pelouses ou pout des mictosurgaces a Evolution diggérée par ta
persistance ou la rapparition d'un facteut limitant a faible rayon d'action
Wapin par exemple * J.
2.2.3 Elaboration de la fiche synoptique de retevé
2.2.3.1 Principe
En raison du nombre élevé de relevds a établit, nous avons cherché
une reptésentation graphique dvitant ta fastidieuse copie des especes nom-
breuses t) des inventaires synfloristiques de pefouses caleaires. Si de nombreux
modétes de relevés méthodiques de ta végétation existaient, aucun & notre
connaissance n'était diessence phytosociotogique et propte aux Festuco-Bto-
metea. Nous avons donc congu une giche de relevé spécdique a la classe des
Festuco-Brometea et accessoiement aux pelouses-ourlets basictines des Trigo-
lio-Geranietea ; elle devait sépondre aux trois exigences suivantes :
= permettre un welevd rapide d'une pefouse seton un modéte
toujours identique et dont Pexploitation ultérieure sien trouverait facilitée.
= ingormet, toujours dans une mame unité aynoptique, sux
fa locatisation, Hécotogie, ta dynamique, ete.
- ventiter {es especes selon un schéma synsystématique et
une disposition permettant une présélection des relevés avant analyse statis-
tique.
Nous avons utilisé fos synsystemes de J.M. ROVER (1973) et de.
OBERDORFER et D. KORNECK in E. OBERDORFER (1978) ainsi que tes
premiers résultats de nos syntheses partioties (V. BOULLET, 1984 5 V. BOULLET
et JM. GEHU, 1984) pout ordonner la liste des taxa. Le champ d'utilisation
de la fiche recouvre notre temitoire.
2.2.3.2 Description de la fiche synoptique hidrarchisée
La fiche se compose des sous-unités suivantes (fig. 2.1) +
1: numéxo du televé donnant ta date du relevé, fa commune
et son département, un numéro d'ordre dans ta commune ; exemple : 84/02/21-
SAUME0/01 -
2+ cotection ; indique ta date d'un deuxidme passage éven-
tuel.
3: Echantitlon ; des renvois & divers prétevements |slore,
faune, sol y sont inscxits,
4: tocatisation administrative et topographique ; date du
relevé.
5: localisation géographique précise lcartoyage Lambert
zone Ml) ; cattoyage LF.F.B. utilisé dans le tortitoire couvert par &e ptogramme
LF.F.B. ; tenvot & un index photographique. On peut aussi y indiquer Pattitude.
| i oe tots G3)
Ee @ ®
os cons 8
i cua cELaNaTon
oe bene
mer @) | @ ©
os 7 ——
eee @ wou
w ous | [uote | [wom] Jaw] fe
mo | rome | lemon] ome | fate] Sesser] | em
srw | finn | fect] fBE ween | fess | [es
Ey Ca TA Glu ‘Av Pub Anh E Tax sp Cer See FE ®
mau | [avem| Juve Lolmo | fate) ferse] |e,
soe lore |e On | lea | fee |e
sivmr (1) mero} form | Jamem | fear | [mete | [on
erie |Trene| form | [tees | fomet | fees] /em,
aria | al eee alee 2] pat (| vain | cena a one
tei) al ven |e) oe 22 | cow (ae Veayer [er |e ane
sor | [imor| [om] lan | fet | fam] |e
ree | nee perme ee) ace elem | ae
sae | five’ War] fas] fo) jas) ias@ |
= ptf | et | ee | &
two | [eum | [ace | | toc! (ag) tes bop
| ana] | 2) eee || news JO) ow nee
| Seco ansa | [ose | [temp] — | Seda (2) ta
mer | [ise | ince | [ct] | Sess che
re eer sae eS real ea prt oe
term | [om | [Cumsq(®) natn] | Ato fev
Sime | [etm | [vecved | eccen’| [me 7
e aau| [tar] epee] [cate °
| ote af esaal a |uera| | ate |e ee Ms
tre | [eseer| oste| face] {| |@ | [ton
an @pene y—|tcta| [atone | [tae ne
tee he Drow | [ect | [Sot me
teow | [mse | [enna [rnea | [te on
tose | fee Wen| James | | soar Pao
Neale S| thm tue] | oma roe
(Sn ta | [eum | mem) [oor rosea
SE Frae | fee | |See | [mea) fea roe
“aw | fim | fim | pat oe fn
mar | [cere] fice | [mem] |S fone
eae |) ere || eee] fee | ee
iia ema ewe | eee | ace
Pri Lac GeGe Voter @) Ca Rot Trl Sea {
fa | fom | lon Wynn | [tua
om | Jaane | fecre | ees | fama ®
tae | [ewe | [ese | [Sim (aon
Meter | fem] fmm | [ten SO) ee
= Ow | fence | [tel | ore
fear [alors | | tery [ocve | {eran
tno KDJocm | [ecm five | fis
ma” PTs | [ouee’) fimo | fie |
‘Symtanon ] mene: (py Tsp,
Fig. 2.1 - Fiche synoptique hiérarchisée
Demet
7 : caractdres édaphiques.
& + observations syndynaméiques (cotonisation
]
|
6 + description topogtaphique et physionomique.
Evolution en cours ou prévisible, activités biotiques).
9
urgace du tefevé.
10: nombre d'espdces du relevé.
11: tenvoé aux travaux utitisant te releve.
12 : nombte ordinal d'un inventaire global.
34
arbustive,
13 : especes caractéristiques de ta classe des Festuco-Bto-
metea ; tes abtéviations utitisent les premidres fettres signigiantes
des noms
de gente et d'espdce, parfois réduites aux seules initiates exemples : BP =
Brachypodium pinnatum et As Cy = Asperuta cynanchica).
15 : groupe diggérentiet déatpin.
16 : taxons caractéristiques et difgcrentiots de
du Xerobtomion.
bromion.
18 : caractéristiques et difcrentiettes d'associations.
19
especes des Trifolio-Geranietea.
20 : mésophytes prairiates (Arthenatheretea).
14: especes caractéristiques de tlotdte des Brometatia.
attiance
17 : caractéristiques et différentieltes de Pattiance du Meso-
| 21 : compagnes, dans un ordre de fréquence décroissante.
| 22 : cotonne libre, pour Padjonction de taxon non inventori¢,
& Pexception des phanérophytes.
23 : phan€cophytes (ptantules, getminations).
24 : colonne libre, pour ajouter tes phanérophytes non réper-
toriées,
25 + colonne réserde aux bryophytes, Lichens et diverses
thallophytes.
26 : rang synsystématique (alliance, ordre, classe).
27 : nom de Passociation ou du groupement.
28 : renvoé au recto pour d’éventuelles prdécisions complé-
mentaires lingrataxonomiques, ccologiques, zootogiques, ete.
wre tg o2/34 SAV BOfot | cu
[_ tension
onnana bint Gadnt_ Rabin = Tlatoneg (Comms)
Moston taal!
Lewd
Cond tame $7¥,05 [48,3
ts afm
a
Lecston: Coles See
paw: 24 Penin ASEG Photo
Pane: §5°" ‘Gilg Samtrnien ‘coLonsaTion pre corms
Em: £0 ‘Péol, Profil at
Rect: 38 Te Rendgine trae
Het: 35 PH Dynamique Leaping +
mevat fot pt (eer phen le
dein: AS nh Spee 3264 /et)| atin tare: O6 Neowd
wd ]w ous | ane | [awun) Jaw | foe to
sem Ty Jonom | [rams 42 [insur | jttenac| —|-caman) | crate
teed ae) agpese| att) eameaat| | meta tl sees |e] cerca |e ce
mrad [imi | fomu | foo veca | jens | es
tyes Tat] tecm | arr | [anne | [tome] [ews] [re
wove LE | ancm| rave | fens racer | |crGom) | rss
sake crore | fort | | era Parey | | vmare | | ea
sovPat | | conrcn| forest | | asrsio | [ecnve | | amuse | [ome
ete tear | focus | [ture | Jowse | | acman| | aneor
owt medw | faens | [shat | fuerte! fieam | | pa
ctim | |reom| Jemnoa [usw | foave | [iat | or
Bop rwot | [orm | | aa Pi Cntw | [rs
Pune | |rtoa | [sere |—]omts | [rim | |aquve | | veean
sis | | tee pian] foucs ] lomce | eran | | Rowe
ae ant | [ateemn | foounr | fcoey | [leatam Lp] cB
teow tagfetn | rues | [rar | [rocon| frmiaiel | Yeo
rane | [aus cucee | |anhou | — | rap ve sa\cep
sac Ly |aism | |ooss Lt | Solace Pa
nace Tat] ase | |urus | | twee | | antson oy
on aucoat| [rece | [autre | | anni wv
Fone: sie? | |Cumsed |tctan| | pirat cen v
seve Faq | |veoPed | sentm | | priser ne
we Ly lowe] fuse |. fempcan | | canta ce
ome Tep}sacu | Juca | |raseme| | arr sen et
swhet| fone | [Has | | even 55.0%
GAC ta | tomate | am ac | | Doe mea
au Lua} ovon | |cemmi | | sonny Rise
ase 1, | ens Fann | | ucre Oli
aler TZ [wen] famen | | stom Past
a LA por Himoad| | Ora Pa No
ua cern | [rate | | Oram Rom Can
toc ta}sava | |Rnaee| | coe en Row Et
au tate [sl anke | PRR LAE] Acneen oa Aor
Black P Ono Rep (2 Ins Co Thy Pra LA4 | Tat Com Rosa Tom|
coe || Poe water | | tayet | | cre are
nee fi feace | gfsets | [tam] [ante
mute | force 4! von | fesra | | tase
ao orp |” foen wre Tuan
owt | fame | facte baforco | |avay
Use. Pamet | |oesua| [ore ta. | ormae
seein |_| arcane | | Rese ead Lat | dave
i Ou caicin | [ounce ” | esinttt
Pot owt | | rminm| [rata | | Fas Ve
rer | lore | | Roatied pve | | vesn
tan | [osm | fareusn aum | | ves
Powe ositea| twse| furor | | Hatter
Semon Thpobravntmion 730
| ‘Ass, Grnt. : Fetal tree Teatucckonn
Germanic palggal
ion
33
2.2.4 Exploitation de ta fiche synoptique hidrarchisée
La feetute optique immédiate du relevé nous renseégne sur ta repré-
sentativité des différentes unités synsystématiques et groupes de taxa. Les
agsinités phytosociologiques pourtont etre évaluées de méme tees rapidement
de visu ; voiced quelques exemples :
retevé 84/02/21SAUM80/01 décrit un individu du Meso~
bromion bien caractérisé (toprésentativité des groupes 13, 14 et 17! |.
= le wlevé $4/05/29ROCH24/01 concerme une petouse du
Xerobtomion (représentativité des groupes 13, 14 et 16! |
= fe relevé §3/09/04F OUQ6O/07 décrit une petouse-ourlet
des Trigotio-Geranietea ; on temarquera la quasi-absence d’éléments des Bro-
metalia et des Festuco-Brometea.
= te relevé 84/02/21SAUMS0/03 donne l'ensemble spécifique
diun facies bryo-tichénique, & comparer avec te relevé &4/02/21SAUMSO/01
voisin ; les astérisques indiquent fes plantes visiblement broutées par les tapins
(aire ‘minimum n'est certainement pas atteinte dans ce relevé de facids |
i.
Diautte part, fa fiche facilite ta transcription dans les tableaux
phytoscciologiques buts. Ce travail est encore accéleré si la succession des
eapeces-lignes du tableau est semblable a ta liste floristique de la fiche synop-
tique.
Un deuxidme modéle de fiche suévra ptochainement, entérement
remanié selon tes résultats synthétiques et analytiques présentement rappor-
tés ; devrait permettee ta détermination directe des associations des Festueo-
Brometea.
2.3 METHODES D'ANALYSE ET DE SYNTHESE
Lianalyse statistique des relevés a été séatisde avec la méthode
désormais classique des tableaux. Une injection globale d'un miltier de relevés
n'etait pas réalisable pratiquement sans un recours & un vaste traitement infor
matique selon un algorithme de cafeul (analyse factorietle des cotrespondan-
ces) ; aussi, nous avons di nous astreindte, en son absence, & procéder pat
analyses partiottes.
Les lots de relovds destings & ces analyses proviennent de ta présé-
lection synoptique des fiches de relevé en quatre contingents :
contingent afgin du Xerobromion.
contingent afgin du Mesobtomion.
contingent & affinites déafpines.
contingent afgin des Origanetatia.
Les relevés, pour tesquels nous hésitions entre tetle ou telle caté-
goric, ont été tour & tour injectés dans tes analyses particttes concerndes.
mera £45123 Roch 24 fot
Low
oor La Reckebanieeak cr FeyenBin Bes] Ga tamer 499 08/3954, 385
ord “ies Geewcselter” Nhs dst
Location: vee fa Mlombe abot cae
ove 29 maa 434 oo
Paves 3° ‘Goloe COLONISATION Tsp Commumia, Rhamne
ee 5 ‘Pd, Prof a Bawaba anf ao
Rec: 30 Tye farm azine oie
He: BO PH Dynamique
Mase: 30% ae, fete] Art gana
hacia AS Nase 134 (30/rt)] wet Sod
or w Tipfous | [acm | [rman] aw ] lx abe
sev owe | nase | |imsoe | [erie] | coman} | carte
soy | [tere dn |emmee| [oot | [seu | fume) few
retai La [imme Lat fomu| foe ween | [ewes | [es
txce LE [team | |arne | fame | [tem | |wson) |e
anveat ce) ancon | [rave | | rar ret | [ewcm| | rsp
Sue Got | forcr | | ren rate | [rnin | | cx
sitar | [comet form | [rare | few | laine] fora
pate | ear tej /oron | /tmrn | [esse | [aman | [amon
cate | [meow [I |nets | [sme | [veorm| |neam | | roan
ctim 433 [room| lomeos] um | fore | fim | | or
tor | [wor] forme | [aa nie cnaw | [rs
pune | rtun | [SvPm]—jrats | [remit | Jac | | btn
tase ty [te Lat Dce ] | Omcm | [team | | Rote
ie pou tmute| emer | foc cs
roo fanfeiat | Jrurs | rem | |racm| ESS < | oe
essio Lag | nots cxc| [ammo | [rmeve | fT" T S| Ses,
sac |" 'Jatsm | [oss | [Uspa| | scgace| Pay 38/42 om
race fag) tysio +) untae | | tatrep | | ambsia! bp Cac a| ere
com Tez focccou |” [rece | [aeire | | anon av
sem? | | emma] | cin | | iris Conv
Fm 22] Voorod | seen | | ren ne
Goss) [ussie | «|e | | conn &
sica | |uce | [oar] | xen sen) a
toner] [ote | frmsn | even 5x00
Gine | —| tamcen] [oma | | are Rex
ao twon | [ecm | | Sonne Rise
ms eevRon! [Pad | | tc er ane
co tow | [rman | | stom Past
i FT| —| Heo] | Oo Pate
tice be een | fratem | | Oman Roa en
toco J” |sava | [ranacw| | ences fom
tm | fam | fame eneon fo Ne
Own | |imco | | mwpelfe-+| recon rae
peat | | Ynewoe | | tore} | cme aa
exce | [ste | | twame | | dente
cee | [von | come | | Taree
orm | oem | fame | | taran
amt | [aste | force | favay
Pavia: | [esi] one bo. [orn
‘ann | rae | |e L] ve
Om | feacm | forroe] | eretin
one | [rain| frou | | Feave
of | | rom] mvs | | vesn
oss | fortum awa | [ves
Osea | twee | fumor | | tattoo
‘Syatanen n : tx.6me: Gdoikde- Kecloictim [rsvp
Xerobremenion ee
Lan,
2%
ena, 83 109/04 FOU be fo*
Genming big Pon qat oven lontonille, (08)
Lewd WR Vega e | Vamenien,
Locaeaon? emdm Femasn de. Mobo.
owe 0} Aeptembre A323
[co
| eeentn
Cond tanner 595 [118354
coo 8 TL SH
Prato
4
Pee 2S ‘ce ocheien coxotsaTion Vebuanam epatun, Bee enpetrs,
Be Wea | Pet Pete Catatyererngugon) Brnat 1gicet, Ramm
pets ee. Be | Rendyine gue be siecleece teases
Heit: doe Pa Dyraninse
Now 50 dea gal
Aleta: 20 Wb. Seéc 27/24/09) | wise tov rs 06. Nord
w da3]aw ou atta a, [iw une] [anv 7 [eicar,
sam Lia fonor | | ree treser | | tersec| | conan] | Camo nat +
Ko] [rere | [ewe] [oein | | see uncen| [iv ha
ara] [tmnt | fom | [oa ade] vce | fone | | cs a
twee tram | Jarre | lame Tuy| time | [onsen| [re ee
ae ancan | | Pave far |e [pact | | carci) | ese a
sane orote | | cect wea Ly | ramen | |mintse | fa [een
svat | | conv can] | or et pose | fzmve | fatnvee | | apa
Dente eae orn | [turn | jouse ba acnae | | ane ov
ists rwbw || mete seid | [cote] [team | | Pron
Cen macnm| | cymnoe] fumve | orve La | tem a
op remot | Lorie aa bt] pie cmhw | [rs
Pagan | [rtm | [Serer] | Pate Hintte | | agave | | vibtan bd
fs Hee Damar] [Dues] [own | [samy | | Rome
Be aatn | [Herta | [omar | [emer leet «| ce
two | feta | frae | [ture | | Poa con Voor Li
Tao nu Cree | fieeoe | emo | fH Sic
santa nish | | dose tas Pat| | Sed Ace ”
wes wiiyse | | untio | | tarzep | | Ant Sa ane,
cont scoa| | Poco sare | | Ante ev
Poke sem | |ctamsof | eietan | | rips len
seme Fea | |VeoPrd [soem | — | priser ne
ro Gael] | use eupcan | | Cotes @
Cha? secu | | ucw Tagen] | ArnSen ma
ute tenet] [ont | fHesm te | even SHO
poe Tae Tamcta| | Romae | | Bera Race fa.
Hens =u twyom | |cetma | | Senso Rasa
weoke | [se Lal esented) [rant | | tacPer Qe
ces lat |e uew | fanaa | | sow Pai
cent B TITTY | Hiro Ree] | Ow Ab Pane
m ue ccerion Tg | PuiPat | | Oo An ex Cn
once: Loco +2 | saiva Lat |pinaoa| | cmc ea em Bl
cave Li pnt aA evn Ren At
Bae? Owe |ico | | yee | | Ta can om To
cork te || Poet veaioe || tryeat | | cre Are
setts cece | | eum Tira | | Aen
Ptae cece vor Leo] cana | | tase.
cece ore | |cen Hype Taw
orn | [amie | faces | 4| orc a
Uses Paves || Gesieg | | cara Orvis
ction |_| acans | | rar eas | | uve
ke Ole stein a. co oer | Ese Ht
PiyTe Oat mate | [eeaun [| Fea ve
Porme | | OFet fawn | pmve | | wes
tna | [oset | |cutimm | muna vesep
Pow Osema | [tase | [uno | | ratte
symtaron Oucgametatca— ‘Aas, Gent: CEmbaunto momnaled — ‘rsvP
4 Onbgaresetien,
wera, £4 [02 [24 SAUM Bo /03 | cs | eehanuton ALE
Cenmans Oi’ Gent Babin Fenteney (Somme) Cont stander SV 09/4232, 75
ests Montene Ale: 20m
| Lanta Gta tous fe fallen” Gooed FBS 24. Gh B
be 9A fen. ASRS Pion” 252
feos 40° | cise Santenien COLONSATON Jusipeus Commnunde
Be: On. 0. | Pt Pet
eek: 400 Te | Readying gta
tee: 9S | pt ey yaicn Lapin ov (*)
vee Joo __| Ansgar Pals bajo - Bekcnigue.
wea: 5 Ne sete: 20 wena 06 ee
ow * fapew ous | [ame | [reruns] Jaw %e Gennalf +E
sam [al omn | ree tres | | Hrte| [omar] femme | [aCe | 45
GL afrre | fenmox} login | |seue | [use| |v Guid. wa
meta] lime | fomeu | fee veem | fewge | es wcll
ncn Taam | [aves | [ame | [tum] [csen| | re aes
ans avcem | | Pave Fa paccst | |cwoim| | esa f
i sie crota | | ove Pe ractep | [rinse | | ca flue
saivpat | | Coméaa) | ora rose | fenve | frimvic] fare | faadlL e2
Deke Here orus | [mn] forse | | acnan| | aneov a
cots | [imo | [mer | [Ema | [emote] [eee | jtae | Pra
thm RaGam | —[omnos] fimve | | cave tam | lar
ecm Hot | [orto |_| adn ris cman | [es
fmgon | | r.Bom | [Safa || Pate Himtte | [eave | | vitan
tuser_| | ea Decne] [oe | [own | [sam | | Row Re
i Be pou | [wren | keane! — | cone cs
i tees Laci | fewest | | tara | | roa com bop
' Tone nu caen | [armor | | rip ve ssleap
i sace ta|aisn | | pose Ganpa| | see Ace Pa
i face Lag} Hays | fami | | tatrey | | Anbsie ape
| com ico | | poco sat sabe By
Pore 4 2 | ster | | chomsieq | retctan | | Prien lm
seve Faq | | VeroPrq |Smtm | | tse ne
i we afoul) | use eipcas | | conta @
come Ly [staat | | scar TwaPat| | Ann Se Ha
ute tmnet| [owns | frase | | even SHO
doers Lad [eras ta] tome cod | Rumac | | Bue Phew
Hen awe La|mvom | [comma | | Sena PhS
i teome |. [ase tented [ranma | | tere ate
cese ti fer* Ly [ucn | emer] | sso Past
con rt Ta poru—]— spore) | Oo ae Pata
m ues conn | [eaten | | oman Roatan
Ode taco | |scva | [ranrcte| | cnet Rom
av tem to | ante TR pw] Arcos Rom oe
baa P Ono |” [ime | | type La | ta com fom To
cart va | | Poot Vosoe | | ty Pal | | Cre ane
Tete cxce | | seu ty aca || aenien
Patae cece vows | [cere | | tase
ace orm | [oon Wore Salas
orora | fame | [acre ta oreo re)
Uses Panes | [esis | fare | | ortiae
fue tin |__| cand | | Rabe tafe] 4 ot | Gave
i Ot cicin | fostits| | ee tet
Fiyte ont | | marin] | reste
perm | [ote | | RowPind | Pus
saa | fosai | |ceewom [Rumi i
Fove ose | [tase | pmo
aS o
Swine Pha baeen NS [Amor Roem pratensis T30F
Grhatctiom lomnumid | poly alebrrwm
be
stone coana any
37
Le tableau synthétique générat des Festuco-Brometea du domaine
atlantique francais au nord de ta Gironde résulte d'un processus inductif réunis-
sant outte nos propres résultats d'anatyses et leur expression statistique, difsé-
rontes listes synthétiques obtenues & partic des tableaux publiés par plusieurs
auteurs ; ces istes intéressent soit la dition méme, soit un territoire voisin
et souvent a titre de comparaison.
Liingérence nous a permis de caractériser tes diffcrentes unites
et sous-unités synsystématiques des Festueo-Brometea. Elle a également vorigié
Wopportunité de ta présdiection synoptique. Par ailleurs, plusieurs tableaux
aynthétiques partiots compldtent te tableau général ou préetsent tes agginités
aynsystématiques de plusieurs associations ou groupes d'associations,
Quant au contingent des Trigotio-Geranietea, runissant petouses-
ourlets (Mourlets en nape", Yourlets extensifs"), son exploitation syntaxonomique
et aynsystématique sera Vobjet d'un travail ultériour. Néanmoins, de nombreux
gtoupements seront évoqués ou présentés, par anticipation, dans la partic ana~
Tytique et descriptive des syntaxons, ou, encore, tow de tétude phénoménologique
de ta dynamique.
CHAPITRE II
STRUCTURES ET DEFINITION DES PELOUSES CALCAIRES
38
31 STRUCTURE HORIZONTALE
La stucture horizontale d'une petouse est génératement complexe
et le terme de mosatque couramment usité le trappelle. Son interpretation
& lentement évolué depuis fes premiers travaux phytosociologiques. Successi-
Cement sont appatues tes notions de daltes, d’ourlets, de tonsures & thérophytes
qui ont toutes largement émendé tes tongues Ustes sloristiques des phytocor-
Roses caleicoles préalablement décrites et ainsi conginé ta notion meme de
petouse caleaite. Un des problémes gondamentaux séside encore dans fa sempi-
Fernelle distinction entre mécrohétérogéndité de individu d'association et ma-
erohétérogindité duc & existence dindividus d'associations diggérentes. Mais
WL sagt dune description d'actualité, fugace & (échelle du temps cat la dyna-
mique, souvent sous Uingluence des” facteurs biotiques, asgecte progondément
Yes types stuctutaux. On observe ainsi sréquemment des mosaiques de dewieme
ordte entre "complexe pelousaite” et pelouse-ourlet ; elles corespondent a
des gormes dialtérations des sttuctures primitives qui tes précedent, et qué
sont, elles, propres aux pefouses en état de maintenance. Ce sont ces assem-
blages primitigs qui nous intéressent seuts, ci.
Nous déstinguerons parmi eux trois organisations structurales, selon
un gradient de complexité polycoonotique décroissant :
- la stucture tricoenotique
- la stucture dicoenotique
~ fa stucture monocoenotique
3.1.1 La structure tricoenotique .
3.1.1.1 Organisation
Cette structure se dévetoppe complétement sut fes plateaux tabu-
faites des cateaites durs au sein des petouses du Xerobtoméon. J.L. VERRIER
(1979) concluait ainsi & propos de fa steucture des phytocoenoses : "... dans
Toutes fes petouses sur les cafcaites durs compacts des plateaux caussenards
ily auait intrication d'un audividu d'association se tapportant au Thero-Brachy-
podion avec un second s'assgitiant aux Brometatia". Mais, auteur ne semble
bas cependant avoir dégagé ta nature tripartite de ta phytocoonose, inctuant
kpparemment les gtoupements de dattes dans fe Thero-Brachypodion ; i notait
(7982) que "les chaméphytes 42 focatisent pour a plupart dans ta brancke droite
(Xetobtomion) & Uexception des chaméphytes cxassutescents, qui voisinent
es thérophytes dans la branche gauche (Thero-Brachypodion) " et, plus {oin,
ndans cortaines dientie elles (stations), le Thero-Brachypodion est conginé
aux datles cateaites ot & leur pourtour immédiat, ..."
Nous sommes redevables & R. BRAQUE et J.E. LOISEAU (1984)
de ta promidte desctiption de cette structure tripartite + "nous avons constaté
en fait trois types de situations +
~ petouse xérophite a hémictyptophytes et chamaephytes
dominants sut sot de type tendzine avec de gros éléments [eaitloux).
- végétation thétophytique des tonsures sur sot semblable.
~ végétation thérophytique des tables rocheuses sur mince
couche de terre gine."
sls sa vn or bw t a wa ei og
ae eee ae
40
La figute 3.1.2 montre un agencement des différents composants
structuraux d'un complexe coenotique sut caleaire tabutaire angoumois. Mais
four structure triccenotique peut encore se compliquet par evolution inégate
de ta petouse elfe-méme en petouse-curlet, ou par Mévolution propre des grou-
pements de dalles conduisant & des mosaiques multicoenotiques de deuxime
ordte (fig. 3.1-b)-
3.1.1.2 Ecotogie, physionomie, biologie
La microgcotogie de ta tricoenose varie selon ta coenose (R. BRA-
QUE et JE. LOISEAU, 1984). Sut la datle od se dépose une mince couche
de tere fine, le sot est de type "tithosot des calcaites durs”, alors que tes
gtoupements de tonsures et fes petouses viaies stmontent Pargile de décateisi-
cation d'une rendzine touge plus ou moins profonde. It existe bien évidemment
entre ces trois Elements des zones de transitions (loristiques graduetles (J.L.
VERRIER, 1979], zones qué doivent soigneusement etre évitées low de eta
blissement des televés ; feux développement et four sréquence paraissent ties
& ta défection des usages pastoraux. La maille des mosaiques et Pémportance
des disérents éléments communautaies varient de méme, seton la taitle des
tables caleaites et de Uimpact pastoral.
Le spectre biologique de ta tricoonose présente une distribution
des types bictogiques sefon association (fig. 5.2] qué teslete, comme fa souti-
gné J.L. VERRIER (1979), fe rte discriminant des réserves en eau.
= hémictyptophytes et chaméphytes dominants dans ta pelouse
du Xexobtomion.
- thérophytes dans fs tonsures du Theto-Brachypodion.
= thétophytes et chaméphytes crassulescents (ici & leur
optimum, mais trasngressant quelque peu dans les tonsures} sur les dalies.
Ltotganisation biologique des trois communautés est, on fe voit,
tout & fait digférente et tes consequences d'ordre phénologique non négtigeables,
concernant enite autres ta date de relevé. La stucture tripartite, bien visible
au printemps, stéclipse en partic Pété pour téanparaitre quelque peu en automne
(Sloraison de Scilla autumnatis)
3.1.1.3. La place des etyptogames dans la structure tricoenotique
Les bryophytes et tes tichens sont d'exceltents réactifs de ta stue-
ture tricoenotique jes ensembles spécigiques varient en effet nettement
seton ta coenose, comme Pont indiqué R. BRAQUE et J.E. LOISEAU (1984),
Citons d'apr2s ces auteurs :
- sut_tes daftes, Encalypta vulgaris Hedw., Barbula vineatis
Brid., Tortula intermedia (Brid.) De Not., Trichostomum brachydontium Bruch.,
Grimmia trichophylla Grev., Grimmia orbiculars Buch., Bryum tadicutosum
Brid., Schistidium apocarpum |Hedw) B.S.G., Orthotrichum anomalum Hedw.,
Squamarina crassa (Huds.) Poelt ; beaucoup de ces espdces sont diailleurs
telictuatles dun stade pionnier de colonisation (R. BRAQUE et J.E. LOISEAU,
1984).
mare enpes 39 EnonsToxyoo Epes Y quouadnoss :
42
= dans fes tonsures, Psora decipiens (Hedw.) Hostm., Derma-
tocarpon trapeziforme (Koenig) Trevis., Comicutaria aculeata (Schteb.) Ach.
Parmelia stenophylla (Ach.) Heug., ainsi que Trichostomum crispulum Buuch.,
Hymenostomum mictostomum |Hedw.) R.Bt. et & Seche-Bec [17] le rarissime
Aschisma catniolicum (Web. et Moht.) Lindb. (R.B. PIERROT, 1955). Sut fa
cétiere de fa Dombes, d'aptés H. PABOT (1940), une minuscule hépatique &
thalle, Riecia bischogbii Hiib., caractérise les ouvertures des pelouses du Teu-
crio-Fumanetum.
= engin, la pelouse hémictyptophytique est généralement
fe sige du dévetoppement de mousses pleurocarpiques (Hypnum cupressigorme
Hedw. var. elatum Schimp., Entodon concinmus (De Not.) Pat., Camptothecium
lutescens (Hedw.) B.S.G., ete.) quaccompagnent quelques grandes acrocarpes
(Plewtochaete squartosa |Brid.) Lindb., Ditrichum flexicaule (Schw.) Hampe
et des lichens trds agressigs (Cladonia rangijoumis Hosiim., Cladonia endiviae-
folia (Dicks.| Fx., Cladonia impexa Harm., Cladonia teucophaea des Abb., Cla-
donia meditevanea Duv. ot des Abb., cte.]. Dans des stades dégradés de ta
pelouse, ces espdces particivent a ta formation de {acids byyolichéniques,
recouviant fe sol entidrement et souvent d'une manidre dense et compacte.
3.1.1.4 Dynamique
Le maintion de ta stwcture optimate dépend étroitement de ta
pérennité d'un aystdme pastoral traditionnel (J.L. VERRIER, 1979) ou de substi-
tution. Un sutpaturage introduit une surcharge de nitrates et une augmentation
du tassement qui se soldent par ta déstabilisation de la phytocoenose au progit
dlun gtoupement thérophytique nitro-xérophile plus rénitent comme fa observe
J.L. VERRIER, dans te Quercy (1979).
Dune autre manidre, abandon du paturage conduit & ta détériora-
tion du maillage, et fe groupement thérophytique des tonsures x€trécit, pout
Ginit par disparaitre, d'autant que Pactivité du lapin paratt souvent insusfisante
pour maintenic cette structure. De vastes facids bryolichéniques en resultent
coutamment, greinant temporaitement fa colonisation arbustive. On passe done
rapidement ‘dune stueture tricoenotique a une structure monocoenotique,
elle-méme en mosaique avec tes pelouses-curlets, par suite d’évolutions disgé-
160s (Gig. 3.3).
3.1.2 La sttucture dicoenotique
3.1.2.1 Organisation
La stucture dicoenotique remplace ta précédente sur cateaires
tendres, eatcaires sabloux et sur fes pentes des caleaires durs. R. TOMASELLI
(1948), JL. VERRIER (1979) ont mentionné fabsence d'annuetles et de commu-
nautés thétophytiques sur tes substrats de catcaire tendre. Cependant tes vides
de ces polouses, ok subsistent parsois quelques thérophytes (Scleropoa rigida,
Iberis amara, Alyssum alyssoides, ctc.J, ont une population bryotichémique (dt
faudiait plutét parter de cryptogames cetlulaires au sens large, cat les afgues,
Fes cyanophycdes, tes champignons sont également particutiers) bien digserente
des parties herbues de ta pelouse. Cette obsewation nous amene a dissocier
deux’ types de communauté dans ls pelouses du Xerobtomion |calcaines tendres
ou sableux, pentes des calcaires durs) et du Mesobroméon (ta plupart d'entre
ettes) =
‘Aw}00 ea2 5 RYSTOK 5 WHOS ¢ RUASH
Hysenontomn tortile (Sohw.)2.5., 34
Barbula fallax lied.
Ephemerun recurvifoliua (Dieko.)B0ul.
Fissidens crigtatua Mitt.
Bryun of radiculosua Brid.
Peeudosoleropoaiue purun (Ked.)P.
Hypnun cupresaiforse var. elatun
Catex flacca Schred.
Heraciun pliosella 1.
Leontodon hiapidue. Le
Sanguisorba ainor Scop.
Yolygala asarella Grant
Brachypodiun pinnatun (I+) Beauv.
ccc
gar les cailioux de craie existe un groupenent
A Seligeria paucifolia (Dicks. Carr.
ig. 5.4 - Dicoenoce A Avonulo-Festucetus lenanii (pelouses a'Zangest~sur-Somme, 80)
GS) ae
‘Teichostoaua erispulus Bruch. 2
Weiasa controverea Heaw, var. contr. +
Barbula fallax Hedy. +
Bryum torquescens Hruch, re
2
OK 5 Pago* 5 Bxp.sS.E
Fleeidene cristatus Mitt,
Ditrichum flexieaule (Schw.)iampe
Ey Bryum sp.
Collena ap.
Fig. 3.5 - Dicoenose & Stachelino~Teucrietum avemuletosus (Juillaguet, 16)
44
une coenose constituée pat ta petouse proptement dite.
= une coenose cryptogamique oi singiftrent parcimoniew
sement quelques thérophytes dans les vides ("stades régressifs" des auteurs)
du tapis herbacé.
Un exemple typique (fig. 3.4) stobsetve avec tAvenulo pratensis-
Festucetum lemanii (Boullet 1980) Boullet et Géhu 1984, association du Meso-
bromion de la Picardie, appattenant en fait d une dicoenose dont tautre été-
ment est un groupement ctyptogamique & Hymenostomum mécrostomum (Hedw.]
R.BL, H. tortie (Schw.) B.S.G., Weisia controversa vat. crispata \Nees et
Hous.) Nyh., Barbula fallax Hedw., Ditrichum flexicaule (Schw.| Hampe,
Bryum ‘radicutosum Brid., Ephemewm recurvigotiam (Dicks.) Boul. (muscinée
tds tare et fugace), Fissidens cristatus Mitt., Cephatozietla baumgartneri
Schifg., Leiocotea turbinata Raddéi plus tarement, Collema pl. sp., Nostocales,...
«Dans la pelouse méme, & Uexception de Ditrichum flexicaule, tes acrocarpes
disparaissent devant des ‘plewrocarpes [Hypnum cupressigorme Hedw. var. elatum
‘Schimp., Entodon concinnus (De Not.) Pat., Abietinella abietinalHedw.) Fleésch.,
A. hystricosa (Mitt. Btoth., Camptothecium lutescens (Hedw.) B.S.G., Callier-
gonella cuspidata (Hedw.) Locak., Campytium chrysophytlam (Bréd.) J. Lange
et de lichens (Cladonia rangigomis Hoggm. var. pungens [Ach.) Vain., 6. aberrans
des Abb., Cladonia endiviaegotia (Dioks.| Fr.J. La siqute 3.5 iktustre un deuxidme
exemple de dicoenose, "dicoenose a Staehelino-Teuctietum avenuletosum"
sur caleaites matneux charentais.
It existe bien Cvidemment, comme pour la stwctute précédente,
des secteuts de transition entre fs deux coenoses, qui sont te sige d'une
dynamique acctescente et traduisent ta colonisation centripete des ouvertures
de ta petouse en Labsence de systdme de maintenance opérant. Quand ce dernier
subsiste par Pentremése du fapin, on observe aux débouchés des terriers, places
§réquentées de présérence par tes conins, un tot de taxons & tendance nitrophite,
qui pourrait évontuellement constituer Uébauche d'une troisieme coenose.
Notons que la coenose cryptogamique est elle-méme complexe
et i faudrait distinguer {es cryptogames du sol lui-méme et celles cotonisant
fes caitloux et gtaviors qué parsement te scl (Cephatozéella baumgartneri Schis{.,
Seligeria pauciolia (Dicks.) Cart., Southbya nigrella {De Not.) Spt., lichens
ctustacés). Des variations interes existent selon fa microtopographie et ta
microdcotogie. des "vides".
3.1.2.2 La sttucture tricoenotique & etyptoggames
Sut caleaizes durs septentrionaux (Bourgogne, Beauce) et ratement
sur certains caleaites tendtes quelque peu iidurés (vallée de fa Seine, ta struc
ture décoenotique se complique avec Fapparition de véritables dalles caleaires,
souvent marginales et congindes aux corniches et ressauts rocheux ; la structure
de la phytocoenose se tapptoche afors de ta structure tricoenotique type, ot
Je gtoupement thérophytique des tonsures serait templacé par un groupement
cryptogamique. Cette situation intermédiaée ctablit ta Kinison entre tes deux
moddtes struturaux.
Pig. 366 = Orpanteatione vecticales des pelousos ot yelouses-ousiete
stmecture sonoatcate
tr cuvette A sryptoyanes
Df polouse caleatre groprenent dite
2 fonmure A enésopntes
memcture diatrate
46
3.1.2.3 Dynamique
La stwcture dicoenotique stestompe rapidement lorsque ta petouse
niest plus paturée ou broutée par fes tapins ; elle désparait auttement par
extension des pleurocarpes de ta petouse proptement dite, en raison apparem-
ment dune chatge cuniculigene croissante, contituant les facies bryotichéniques.
Diautre part, une transgression permanente s'instaure entre petouse et "vide"
pat Mintermédiaire d'especes pionnibres, identiques & celles nduisant sue
substeat neug des acids pionniers.
3.1.3 La stueture monocoenotique
Clest fa structure ta plus simple, qui parait résutter dans nombre
de cas, de ta déstabitisation d'une sttucture di- ou tricoenotique ayant dépassée
fa phase optimate. Plus tarement, elle est fagencement optimal d'une phyto-
coenose réduite & ta seule pelouse ; ainsi en serait-it de certaines sesteriaies
de pente, dont la microtopographie tres partioutidre et fe flux des graviers
de craie nuitaient au développement d'une communauté bryolichénique pionnidxe.
3.1.4 Etiotogie stucturale
Les facteurs édaphiques et biotiques sont les détorminants essenticts
des types structutaux des phytocoenoses caleicoles. La toche-mere détermine
fa potentialité structurale : .
= trieoenotique sur calcaites duts avee tables rocheuses
aggleurantes, de formule syntaxonomique Xexobroméon/Theto-Brachypodion/Alys-
40-Sedion.
= tricoenotique & ctyptogames, vicariant septentrionat du
précédent, limité souvent aux comiches et ressouts tochoux, «moins xérique
et de formule Xetobtomion (Mesobtomion)/ gtowsement ctyptogaméque/Alysso-
Sedéon.
= dieoenotique, sur caleaies tendres ou sableux avec une
mosazque Mesobtomion ou Xexobromion/gtounement cryptogamique.
= monocoenctique sur éboutis de ponte (Sesterio-Mesobrome-
rion). La dynamique naturelle de ta végétation tend & simpligier la structure
de ta phytocoenose, au moins dans un premier temps, puisque, nous le vertons
plus loin, a dynamique avat est un facteut de complication structurale.
3.1.5 Implications méthodotogiques
Il resort des observations précédentes ta non signification de Pin
clusion intempestive (sinon & échelle de la phytocoenose) des bryophytes
et lichens dans tes fistes flovistiques des releves de pelouses catcaétes. En
eget :
= es cryptogames se tépartissent en deux yoire trois ensem-
bles dont un seut est inhdtent & fa petouse méme. Cet ensemble associé appar
tient au cortege floristique des Brometalia oi i constitue une ou plusiours
synusies, seton Pexpression de nombteux auteurs (J. BARKMAN, 1968 et1970
; W. BRAUN, 1968). Son démembirement ne devrait pas théoriquement etre
distinct de celui des phanérogames.
BeLosToTEO MOTTE sop onbrydwsdryexys YosNTOAT = LF “91g
wexos pamoy yetmo-senotad asnored
syesiehiod y e393 oyenieesays & 1a oyeayerp
POLITIES
48
= Haire du relevé est souvent disproportionnée & téchette
des ctyptogames qui ne peuvent tre cotrectement appréciées quid des surfaces
bien moindtes. On tapptochera, & ce propos, les observations méthodologiques
de JM. WILLEMS (1973) : "The cryptogams were only partly identisied in the
field. 1. Aba consequence it was impossible to assess the abundance and domi-
hance of a considerable number of species”.
Nous avons done exclu tes cryptogames cetlulaires de ce travait
par souci de véracité et d'homogénéité de tensemble prdsenté, bien que les
mmousses, fed hépatiques et tes fichens aient été notés dans nos relevés, et
souvent” assortis des coegsicients d'abondance-dominance et de sociabitité,
tant-pour fa pelouse méme, que pour tes "vides" qui ont fait Yobjet de releves
particulier. Les résultats de cette mictoanalyse seront publics ultérieurement.
3.2. STRUCTURE VERTICALE
3.2.1 Organisation verticale des pelouses et petouses-ourtets
Les petouses cateaites, les groupements de dattes, tonsures, coenoses
eryptogamiques mosaiquées sont de type monostrate (fig. 3.6]. Les phanérogames
et ctyptogames ne peuvent nettement y étre séparées dans un plan vertical.
Nous avons indiqué toutegoi dans nos relevés es surfaces relatives occupées
respectivement pat fes phanérogames et les ctyptogames, essentiettement
quand ta sttucture de ta pelouse était monocoenotique.
Quetques arbustes pionniers épars crdent momentanément wn aspect
bistrate, dont nous avons toujours négligé Uélément supérieur dans tétabli
sement dun tlevé, les inventoriant & part st la fiche synoptique. Tres rapi-
dement, ces atbustes modifient ta stucture de la petouse, mous & vertons
plus loon. :
Les pelouses-ourlets ont une stucture verticale distrate (ig. 3.6).
Sous amoncellement des feuilles seches du brachypode et entre tes tousges
des plantes, on trouve une strate muscinate hémé-scéaphite dont le micto-
climat et plus globalement ta microdcotogie sont assutément digcrents de
Ya strate herbacée surplombante hétiophile ; on y rencontre pat exemple Pseu-
doscleropodium purum |Hedw.) Fledsch., Fissidens cristatus Mitt. et F. taxifolins
Hedw., Oxythynchium practongum |Hedw.) Watnst., Plagiomnium affine (Funck.)
Kop., Lophocotea bidentata (L.) Dum., ete. «
3.2.2 L'évolution stratigtaphique des mitioux calcicotes
Le degté dlorganisation stratigraphique s'éleve parattdtement au
déroutement de ta série dynamique. Crest une observation classique pour les
mitioux caleicotes depuis ta pelouse secondaire jusqu'au climax forestior (fig.
3.7).
3.3 EVENTAIL RELATIONNEL ; LIMITES ET AFFINITES AVEC LES AUTRES
UNITES SYNSYSTEMATIQUES
3.3.1 L'éventait relationnel des atfiances du Mesobromion et du Xerobto-
mion dans te domaine attantique srangais
Nous entendons par & fa somme des tions synftoristiques, synécolo-
giques, ayndynamiques, synstructuraux et spatiaux entre tes gtoupements du
Mesobromion et du Xerobtomion ct les représentants des autres unités synsys-
Pig. 3.8 ~ Byentail relationel den alliances du Kerobroaion et du Hesstronion
ina Te domaine atiantique frengaie
‘hi
Wn
Lene etmuotursux doninante
Mans dymamiquee dominant
beng fieristiques cosinanta
Lene éeolegiquen doninante
|
50
tématiques de végétation, & Uintériout de nos limites chorogtaphiques. Ces
agfinites ont souvent été évoquées sommaitement dans de nombreux travaux
intéressant es petouses calcaires ; quelques tiaisons ont été plus partioulic-
Tement approgondies, citons celles avec les Ononidetatia striatae \J.M. ROYER
1973, 1982 et 1984), avec tes Sedo-Scleranthetatia |T. MULLER, 1962 5
J.M. ROVER, 1973] cu encore avec [es Brachypodietatia distachyae [P. MAU-
BERT, 1978 ; J.L. VERRIER, 1979). Tout récemment, JM. ROVER (1985)
a iltustré les ‘principales variations Eeotogiques au sein du Mesobtomion exectié
suivant cing dixections : Authenatherion elatiowis sur sols progonds, le Naxdion
et te Calluno-Genistion sur sols acidisids (ce gradient synsystématique, sréquent
en altitude, n'a pas été observe dans notre territoce), fe Molinion coeruleae
sur sols buns caleaites des toches maineuses, &e Xetobromion et te Sesterion
variae, ce dernier sur tendzines en climat montagnard.
De nombreux exemples afferents aux relations Mintersyntaxons"
ittustreront plus loin Uétude anatytique des Brometalia. Nous nous borerons
maintenant & sumer tes principales afsinités synsystématiques inventoriées
dans un syst2me relationnel organisé en huit spheres, isoldes sefon une domi-
nante climatique, édaphique, stucturale ou dynaméque, feut volume dans un
espace muftifactoriel pouvant sintorpendtrer en partic (fig. 3.8) :
~ sphdre relationnelle d'ingluence dynamique amont.
~ sphere relationnelle d'ingluence dynamique avat.
= aphdre relationnette diingluence médétertanéenne,
= sphére relationnelte d'ingluence alpine.
= sphere telationnelte d'ingluence maritime.
= sphdte relationnelte d'ingtuence mésophite.
= sphere telationnelle d'ingluence psammephite.
sphOre relationnetle dingluence hygrophile.
3.3.2 La sphere dingluence dynamique amont
Ik pout sagit de Kens & ta fois streucturaux et syndynamiques avec
fes groupements thérophytiques du Theto-Brachypodion Br.~Bl. 1925 em. Rivas
Martinez 1977 et les groupements de dattes de fAlysso-Sedion Ob. et Miller
1961. Is ont été étudiés plus en détail & propos de ta structure horizontate
du tapis végétal.
Les ens peuvent n’étre que dynaméques avee tes groupements
d'éboutis mobiles du Leontodontion hyoseroidis J. Duvigneaud et al. 1970 et,
en Bourgogne, du Stépion catamagrostidis Jenny-Lips 1930 (fig. 3.8), cette
dernidre alliance pourrait se retrouver au sud de ta dition (Perigord, Quercy).
Notons que les pelouses déatpines du Sesterio-Xerobromenion et du Sesterio-
Mesobromenion succddent fe plus souvent tant en Bourgogne |J.M. ROVER,
1973) quien domaine attantique a ces éboutis mobiles, & Hexeeption cependant
du Teucrio-Gatictum fleurotié J. Duy. 1965 champencis qué préedde une petouse
du Mesobtomenion, {2 Lino leonii-Festueetum femanii. Cette association n'est
cependant pas démunie d'éngtuences montagnardes.
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The Freshwater Algal Flora of The British Isles (2nd Edition)Document485 pagesThe Freshwater Algal Flora of The British Isles (2nd Edition)guillaume canar100% (1)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Gehu - Symphytosociologie en PicardieDocument8 pagesGehu - Symphytosociologie en Picardieguillaume canarNo ratings yet
- Initiation À La Phytosociologie Sigmatiste (Lahondère 1997)Document22 pagesInitiation À La Phytosociologie Sigmatiste (Lahondère 1997)guillaume canarNo ratings yet
- Royer 1987Document641 pagesRoyer 1987guillaume canarNo ratings yet
- SujetDocument6 pagesSujetguillaume canarNo ratings yet
- Handbook of European Sphagna (Daniels & Eddy 1990)Document284 pagesHandbook of European Sphagna (Daniels & Eddy 1990)guillaume canarNo ratings yet
- Essai Pour La Classification Des Landes Atlantiques Françaises (Gehu 1973)Document9 pagesEssai Pour La Classification Des Landes Atlantiques Françaises (Gehu 1973)guillaume canarNo ratings yet
- Typologie Descriptive Des Principaux Habitats Des Cévennes Siliceuses (Bissardon 1998)Document342 pagesTypologie Descriptive Des Principaux Habitats Des Cévennes Siliceuses (Bissardon 1998)guillaume canarNo ratings yet