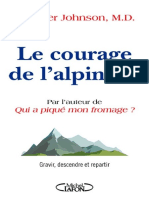Professional Documents
Culture Documents
Rapport NIE Koulwéogo VF
Rapport NIE Koulwéogo VF
Uploaded by
armel simpore0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views57 pagesNie rapport du barrage C'est en Afrique
Original Title
Rapport-NIE-Koulwéogo-VF
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentNie rapport du barrage C'est en Afrique
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
8 views57 pagesRapport NIE Koulwéogo VF
Rapport NIE Koulwéogo VF
Uploaded by
armel simporeNie rapport du barrage C'est en Afrique
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 57
EMERGENCE
INGENIERIE
01 BP 6478 OUAGADOUGOU OT
TELIFAX/ 50 36 36 19
E-mail: emergence@fasonet.bf
PROJET D’AMENAGEMENT DU BAS FOND DE KOULWEOGO
ETUDE D'ELABORATION D'UNE NOTICE D'IMPACT SUR
ENVIRONNEMENT
(VERSION DEFINITIVE)
OCTOBRE 2017
SOMMAIRE
RESUME TECHNIQUE...
INTRODUCTION,
1*“* PARTIE: CONTEXTE GENERAL ..
1. CONTEXTE ET METHODOLOGIE,
L.L. DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET.
1.2. Ons CTHFS DE LA NOTICE D'IMPACTSUR L'ENVIRONNEMENT
1.3. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE,
13.1 Législation nationale
1.3.2 Conventions internationales
14 MeTHODOLOGtE.
2*"© PARTIE : DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL ....
. DESCRIPTION DU MILIEU a 8
2.1 LOCALISATION ET LIMITE DE LA ZONE D'ETUDE 8
2.2. MILIEU BIOPHYSIQUE 8
221 Climat 8
222 Hydrologie et hydrogéologie de la zone. 9
223 Ressources en eaux souterraines 9
224 Sols. 5 9
225 Flore et vigétation.. 10
TABLEAU N°H : ESSENCES EXISTANTES ET LEURS UTILTES. 10
22.6 Fane u
2.3 MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE N
23.1 Démographie i
233 Organisations sociales. 2
234 Aetivités socio-économiques.. B
2341 Agriculture B
234.2 BlevAage woonnn 1B
TABLEAU N°? : EFFECTIF DU CUEPTEL DE LA PROVINCE... Cs ina cacmascmcaca
2.3.44. Hydraulique et assainissement 15
23.45 Tourisme.. 15
ILL IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS.....
3.4 ENTIFICATION.. a 16
32 EVALUATION DES IMPACTS. : ; 16
3.2.1 Evaluation des impacts significa 16
3.2.1.1 Impact sur le elimat. 16
3.2.12 Impacts sur les eaux de surface et souterraines.... : : _ iy
3.213 Impact sur les 5018.nnsesnnnne . - vo 7
3.2.14. Impact sur le paysage "7
3.2.1.5. Impact sur flore et la végétation 18
32.16. Impaet sur la faune 18
3.21.7 Impact sur la santé. an Soe 18
32.18 Impact sur le foncier 9
3.2.1.9 Impact sur agriculture .cccrnonsnennonnnnnnnun 19
32.110 Impact sur 'élevage scons
32.1.11 Impact sur la péche 20
321.12 Impacts socio-économiques et socioculturels eee 21
3.2.1.11, 1 Impacts positifs mt
3.2:1.11.2 Impacts négatifs... 2
3.2.2 Matrice des impacts m4
3)" PARTIE: LE PLAN DE
STION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL.
IV. MESURES ET ACTION
4.1 MILIEU BloPHYSIQUE : 26
4.1.1 Climat de ta zone 26
4.1.2 Eaux de surface. : 26
4.1.3 Eaux souterraines — 26
4.14 Sols aa ee 26
4.1.5 Flore et végétation 27
4.1.6 Faune a 27
42 MILIEU socio-ECONOMIQUE.. eh 28
42.1 Agriculure. ee 5 28
4.2.2 Blevage oon. 28
42.3 Péche ane 28
4.24 Santé
42.5 Commerce
V. MISE EN QEUVRE DU PLAN..
5.1 CONSIDERATIONS GENERALES.
53.2 PRINCIPES DE MISE EN EUVRE DES ACTIONS ..nesnnnsnnn ce 29
5.3 CADRAGE INSTITUTIONNEL... 29
54 ACTEURS ET LEURS ROLES... ae eee a o 30
54.1 Les acteurs tocaux 30
5.4.2 Les autres acteurs 30
5.5 STRATEGIE DE MISE EN EUVRE 31
5.5.1 Information, Education, Communication (IEC). 32
$5.2 Formation on 32
5.5.3 Apu institutionnel. 32
5.6 SYSTEME DE CONTROLE ET DE SUIVL 32
5.6.1 Les indicateurs 33
5.6.2 Cots 33
5.7 CONDITIONS DE SUCCES DE LA MISE EN GUVRE... - 33
VI. PLANNING DE MISE EN (2UVRE ET EVALUATION FINANCIERE...
6.1 PLANNING DE MISE EN (EUVRE..... 35
6.2 EVALUATION FINANCIERE so o asian 37
6.2.1. Evaluation des concessions perdues. 37
6.2.2. Devis estimatif du cout du PGES. enicieae 39
6.3. CONDITIONS DE SUCCES DE LA MISE EN (EUVRE meena 4t
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE...
ANNEXES...
ANNEXE 1 : DEVIS ESTIMATIF DETAILLE DES COUTS DU DEDOMMAGEMENT DES
PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET DE CONSTRUCTION DU BARRAGE
ANNEXE 2 : MODALITES D°EXPROPRIATION/INDEMNISATION ET DE SUIVI DES
PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET DE CONSTRUCTION DU BARRAGE DE,
KOULWEOGO
ANNEXE 3 : LISTE DES PROPRIETAIRES DE CONCESSIONS SUR LE FUTUR SITE DU
BARRAGE DE KOULWEOGO..
RESUME TECHNIQUE
Dans sa volonté politique d'augmenter la production vivriere en vue de renforcer la sécurité alimentaire et
contribuer a la réduction de la pauvreté en milieu rural, le gouvernement burkinabé a travers le Ministére de
'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) via I’Agence d’Exécution des Travaux Eau et
Equipement Rural (AGETEER), a entrepris un projet de construction de deux barrages, de reconstruction de
deux barrages et d’aménagement de deux bas-fonds dans la province du Ganzourgou dont celui de
Koulwéogo dans le village du méme nom, département de Zorgho.
La présente étude est une composante de celle plus globale conduite par le bureau EMERGENCE et destinge
4 Pélaboration d'un dossier technique APS/APD pour l’aménagement du bas-fond de Koulwéogo a partir de
la construction d'une retenue d’eau. Elle vise élaboration dune notice d’impact sur l'environnement du
projet construction et d’aménagement hydroagricole.
L*étude est faite & partir d’un diagnostic participatif de Venvironnement "naturel", social et économique ;
suivi d'une analyse des impacts potentiels du barrage et de ses ouvrages.
Elle comprend essentiellement trois parties. La premiére partie est une description du diagnostic
environnemental et social du site, la deuxiéme présente les impacts potentiels identifiés ainsi que I’analyse
des causes et des origines de ces impacts avec des propositions de mesures d’atténuation ou d’optimisation et
des modalités de controle de leur application. La demniére partie décrit les mesures et actions constituant le
plan de gestion proposé assorti d'une évaluation des coits et la stratégie de mise en ceuvre des actions.
Le projet consiste en la construction d’un barrage en terre d’une profondeur maximum de 5,75 m ; une digue
en terre compactée de 1 079 m de long avec une largeur en créte de 3,50 m. Le volume du lac, a la céte de
déversement, calée 4 297,75 m, est de 2 707 716 m’. Il drainera & cette e6te, un bassin versant de 73 km?
et couvrira une superficie correspondante de 120 ha. 1! iriguera un bloc de terre de 69 ha SAU dont 27,5 ha
en rive gauche et 41,5 ha en rive droite.
La réalisation des ouvrages ainsi déctits devrait permettre la mise en valeur agricole grice au prélévement
eau pour l'itrigation des terres en aval par gravité aussi bien en culture de saison pluvieuse (irrigation de
complément) qu’en culture de contre saison (riziculture et maraichage notamment).
La réalisation du barrage telle que décrite, aura des incidences aussi bien sur l'environnement biophysique
que socio-économique. De ce fai, il s'agit de limiter, autant que faire se peut, les impacts négatifs du projet
sur environnement, en identifiant les impacts négatif’s et en proposant des mesures d’atténuation qui seront
rises avant, pendant et aprés les travaux de construction du barrage.
Aprés un descriptif des milieux biophysique et socio-économique de la zone devant abriter le futur barrage,
Vétude a procédé a l'identification des impacts que pourrait engendrer la construction de la retenue, de ses
annexes et son exploitation.
Plusieurs impacts positifs du projet de construction du barrage ont été identifiés parmi lesquels se trouve en
bonne place intensification ct la diversification des activités agropastorales et halicutiques, grice a : (i)
Vamélioration des techniques et des systémes de production par le biais notamment de l’amélioration de
Vappui-conseil (techniques culturales adaptées & la nature des sols, techniques de maintien / reconstitution de
la fertlité des sols, maitrise de I’érosion éolienne et hydrique, amélioration de la gestion de l'eau dans les
périmétres irrigués,...) :(i) l'amélioration des revenus et des conditions de commercialisation ; (iii) une
meilleure valorisation de la production par la transformation ; (iv) ’élargissement de la gamme des
productions ; (v) le renforcement des compétences des différents acteurs intervenant dans les production
végétales et halieutiques (producteurs, commergants, transporteurs, opérateurs économiques) ; (vi)
Vinformation et la formation en matiére de bonnes pratiques (qualité, normes sanitaires et
environnementales),
Malgré les impacts globaux du Projet jugés positifs pour le développement économique et social de la zone
du barrage, la construction de la retenue et du périmetre irrigué vont avoir des incidences négatives certaines
sur le cadre de vie des populations, M'habitat, les infrastructures sociogconomiques et les. ressources
naturelles, non seulement du fait des aménagements et infrastructures prévues, mais surtout avec lafflux des
populations migrantes dans la zone la recherche d’emplois et de bien-étre.
Les facteurs de risques environnementaux et sociaux majeurs identifiés & ce sujet sont principalement : la
pression démographique dans la zone, risquant d'induire une altération des zones humides, des berges du lac,
tune demande forte en produits ligneux, de créer la détérioration progressive de l'environnement en absence
de réalisation d'un programme de conservation et de polluer le milieu par le rejet des déchets ; des pertes de
biens individuels et collectifs.
Le projet de construction de la retenue et du périmeétre irrigué va occasionner un déplacement involontaire
de populations relevées dans 14 concessions et situées sur le site du barrage
Les occupants agricoles saisonniers recensés sur le site sont estimés a 51 personnes. Les pertes encourues par
les Personnes Affectées par le Projet (PAP) concernent surtout les terres, les habitations, les habitats des
animaux, les plantations et des infrastructures socio-Economiques.
Crest pour résoudre tous ces problémes qu’un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) a été
proposé. Celui-ci intégre plusieurs mesures d’optimisation et de compensation parmi lesquelles
- Le dédommagement des personnes affectées par le projet de construction du barrage et de ses
ouvrages ;
L’aménagement des berges (bornage de ta bande de servitude,
ete.) 5
- La protection des berges notamment par des actions d'information et de sensibil
populations riveraines, des actions de CES/DRS sur les sols contigus aux berges ;
~ Lereboisement ev/ou lenrichissement des berges, l'appui a la création de pépiniézes villageoises ;
- L’appui aux activités pastorales avec les ouvertures de pistes pour le bétail ;
- Et la protection sanitaire des populations par la construction de latrines et la promotion des
‘moustiquaires imprégnées.
ise en place d’une haie vive, ,
jsation des
Tous ces objectifs ne peuvent cependant étre atteints que par l’implication d’un certain nombre d’acteurs
définis dans le PGES. Pour s‘assurer que toutes les activités. retenues seront bien coordonnées et exécutées il
1 été proposé la mise en place d’un Comité technique comprenant les différents démembrements des services
du développement rural dont en particulier les services départementaux de I’Agriculture, de l'environnement
et des ressources animales.
Le cofit estimatif du PGES est de 95 501 000 FCFA.
INTRODUCTION
Dans sa volonté politique d'augmenter la production vivriére en vue de renforcer la sécurité alimentaire et
contribuer A la réduction de Ia pauvreté en milieu rural, le gouvernement burkinabé a travers le Ministére de
Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) via Agence d’Exécution des Travaux Eau et
Equipement Rural (AGETEER), a entrepris un projet de construction de deux barrages, de reconstruction de
deux barrages et d’aménagement de deux bas-fonds dans Ia province du Ganzourgou dont celui de
Koulwéogo dans le village du méme nom, département de Zorgho.
La présente étude est une composante de celle plus globale conduite par le bureau EMERGENCE et destinée
I’élaboration d’un dossier technique APS/APD pour l'aménagement du bas-fond de Koulwéogo a partir de
la construction d'une retenue d'eau. Elle vise I’élaboration dune notice d’impact sur l'environnement du
projet construction et d'aménagement hydroagricole.
L’étude est faite & partir d’un diagnostic participatif de Tenvironnement "naturel", social et économique ;
suivi d'une analyse des impacts potenticls. du barrage et de ses ouvrages.
Elle comprend essentiellement trois parties. La premiére partie est une description du diagnostic
environnemental et social du site, la deuxiéme présente les impacts potentiels identifiés ainsi que l'analyse
des causes et des origines de ces impacts avec des propositions de mesures d’attnuation ou d’optimisation et
des modalités de contréle de leur application. La demiére partie décrit les mesures et actions constituant le
plan de gestion proposé assorti dune évaluation des cofts et la stratégie de mise en ceuvre des actions.
4°°© PARTIE
CONTEXTE GENERAL
1, CONTEXTE ET METHODOLOGIE,
1.1. Description technique du projet
Le projet consiste en la reconstruction d’un barrage en terre d'une profondeur maximum de 2 m. Le volume
du lac, a la céte de déversement, calée a la cdte 305,50 m est de 49 897,63 m3. Il couvrira a cette céte, une
superficie de 5,75 ha. 1! drainera un bloc ittigué de 5,85 ha SAU.
La reconstruction du barrage et de ses ouvrages annexes devrait permettre la mise en valeur agricole grace au
prélévement d’eau pour V'irrigation des terres en aval par gravité aussi bien en culture de saison pluvieuse
{irrigation de complément) qu’en culture de contre saison (riziculture et maraichage notamment),
1.2. Objectifs de la Notice d’Impact sur l'Environnement
La réalisation du barrage telle que décrite plus haut, aura des incidences aussi bien sur l'environnement
biophysique que socio-économique. De ce fait, il s'agit de limiter, autant que faire se peut, les impacts
négatifs du projet sur environnement, en identifiant les impacts négatifs ct en proposant des mesures
@atténuation qui seront prises avant, pendant et aprés les travaux. Pour répondre a cette préoccupation
majeure, et conformément a l'article 20 de la loi n°00S/97/ADP du 30 janvier 1997 portant Code de
Environnement au Burkina Faso, les promoteurs de louvrage ont retenu d’élaborer une Notice d’Impact
sur Environnement (NIE).
L’étude vise ainsi a
- Identifier les répercussions négatives importantes de certaines activités ou caractéristiques de la
retenue d”eau sur environnement ;
= Definir les alternatives adéquates pour I’élaboration du projet ou des mesures datténuation qui
pourront étre intégrées au projet afin de minimiser, voir éviter toute répercussion négative
potentielle.
1.3. Cadre législatif et réglementaire
1.3.1 Légistation nationale
Au Burkina Faso, la constitution de Juin 1991 fait de la gestion rationnelle de Yenvironnement une
préoccupation de 'tat. Ces dispositions ont notamment favorisé d'une part, l'adoption de textes Iégislatifs et
réglementaires et d'autre part, Ia ratification de conventions au niveau intemational. Lénumération suivante
n'est pas exhaustive car elle se limite essentiellement aux instruments ayant un lien avec la présente étude,
Les principaux sont:
= la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Reorganisation Agraire et Fonciére (RAF) dont le
décret d’application porte le n° 97-054/PRES/PM/MEF du 6 février 1997
= la loi n°006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant Code forestier adopté par le Parlement burkinabé le
31 janvier 1997
- la ioi n? 005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant Code de l'environnement et le décret d application
n° 2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ d’application, contenu et procédure
de ’étude et de 1a notice d’impact sur l'environnement
= Ia loi n° 002-2001/AN du 8 février 2001 portant orientation relative a la gestion de eau basée sur
approche gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).
Diautres dispositions légales et réglementaires contribuent a la préservation de Tenvironnement et a
Tamélioration du cadre de vie des populations. Ce sont:
+ la Loi n® 23/94/ADP du 19 mai 1994 portant code de santé publique
+ Ia Loi n°62/9S/ADP du 14 décembre 1995 portant code des investissements et des formalités
. Ja Loi n° 023/97/11/AN du 22 octobre portant code minier
* la Loi n® 014/99/AN du 19 avril 1999 portant réglementation des groupements et sociétés
coopératives
. les Textes d'orientation de la décentralisation (TOD)
* les décrets n° 97-598 et 98-365/PRES/PM/MEE précisant les mesures d’une utilisation
équilibrée, écologiquement rationnelle et durable des ressources en eau
. la Loi dorientation sur le pastoralisme adoptée le 24 juillet 2002.
1.3.2. Conventions internationales
Certaines conventions internationales signées evou ratifies par le Burkina Faso participent également a la
gestion durable des ressources naturelles. Ce sont entre autres:
= Ia Convention de Ramsar sur les zones humides
- la Convention sur la Diversité Biologique (CDB)
- la Convention cadre sur les changements climatiques (CCC)
~ la Convention sur ta lutte contre la désertification (CCD)
- la Convention Internationale sur les espéces menacées dextinction (CITES)
~ le Code de conduite pour une péche responsable.
~ Laconvention de Stockholm sur les polluants organiques.
Si tous les instruments légaux et réglementaires ci-dessus cités sont nécessaires pour définir les objectifs et
valider les mesures d’atténuation préconisées, force est cependant de constater que la grande majorité des
acteurs, si elle ne les ignore pas, ne les connait pas. Dans ces conditions, il est trés difficile de parler de leur
application. Des procédés simples et souples devront étre mis en place pour amener progressivement les
différents acteurs a les respecter pour une meilleure gestion des ressources naturelles et un développement
durable.
1.4 Méthodologie
(NIE) de Koulwéogo est
a démarche adoptée pour I"élaboration de la Notice d’Impact sur I'Environneme
bbasée sur lapproche participative.
Elle a consisté en:
= une analyse bibliographique de la documentation disponible sur le projet, notamment le Mémoire
technique et des documents administratifs et techniques sur le département de Zorgho et le village de
Koulwéogo) ;
~ des entretiens (sur base de questionnaires semi-ouverts élaborés a cet effet) avec les populations de
Koulwéogo, les services techniques basés pour l’essentiel & Zorgho ;
= un diagnostic participatif sur les impacts environnementaux basé sur des entrevues collectives et
individuelles et des observations participantes directes.
2™© PARTIE : DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
Il. DESCRIPTION DU MILIEU
2.1 Localisation et limite de la zone d’étude
Le village de Koulwéogo qui abrite le site du barrage de Koulwéogo est situé sur l'axe Ouaga-Zorgho, a
environ 20 km au nord-est de Zorgho dans la province du Ganzourgou. L’accés au site est possible griice &
une route en terre reliant le goudron au village de Koulwéogo.
La zone de l'étude est limitée aux alentours immédiats du site du futur barrage et des aménagements qui
subiront Vinfluence de la présence des aménagements hydro-agricoles pour ce qui est des aspects
biophysiques.
Le site de barrage est limité par les coordonnées géographiques ci-aprés
Coordonnées UTM : Abscisse : 756017,24 mE
Ordonnée : 1364687,55 mN
En ce qui conceme les aspects socio-iconomiques, les limites couvrent la zone diffuse du barrage et des
‘ouvrages annexes.
2.2. Milieu biophysique
2.2.1 Climat
La zone de Koulwéogo, a Iinstar de la commune de Zorgho, appartient a la zone climatique nord
soudanienne, marquée par une saison pluvieuse et une saison séche.
La saison pluvieuse s’installe entre mai-juin et se termine entre septembre et octobre avec une durée
moyenne de quatre (04) cing (05) mois en fonction des années, Au cours de la saison pluvieuse,
les vents sont d'origine atlantique et sont appelés « mousson ». Les températures en hivernage sont
généralement douces avec des maxima oscillant entre 29° et 32° et les minima autour de 22° au
mois d’aoiit.
Quant a la saison séche, elle est longue (7mois au moins) et est dominée par les vents d'origine
saharienne appelés «harmattan » chaud et sec dont Ia vitesse peut atteindre 2 méttes a la seconde.
Ces vents transportent souvent les poussigres transsahariennes qui envahissent la zone de
8
brouillards, On assiste alors a une amplification de I’érosion éolienne ott les terres nues sont
balayées et les fins éléments emportés. La saison séche qui commence dés la fin des pluies,
comporte une période froide de novembre a février et se caractérise par de grandes amplitudes
thermiques. En effet, selon les relevés météorologiques de Ouagadougou dont les données couvrent
la commune de Zorgho, on a enregistré entre 2000 et 2006 une moyenne des maxima autour de
39,5°C au mois d’avril et une moyenne des minima autour de 33°C au mois de décembre. La saison
séche est également ’époque oit sévissent les épidémies de rougeole et de méningites (période
chaude). Les vents frais sont a l’origine des bronchites et des pneumonies.
Les précipitations annuelles varient entre 500 et 900 mm et sont trés réguligrement caractérisées
par une mauvaise répartition spatio ~ temporelle, Les mois les plus pluvieux sont généralement
ceux de juillet et daoiit. De 2000 & 2007 la moyenne annuelle de la pluviométrie était de 628,68
mm dans la Commune. La plus faible pluviométrie a été enregistrée en 2000 avec seulement 505,2
mm tandis que la plus forte a été enregistrée en 2007 avec 916 mm a la date du 15/ 09/2007. Quant
aux nombres de jours de pluies, ils varient entre 40 et 52 jours. Le nombre moyen de jours de pluie
des huit derniéres années est de Pordre de 47 jours.
2.2.2 Hydrologic et hydrogéologie de la zone
Le Nakanbé et le Siriba gouroundi (Niger) sont les bassins versant sur lesquels se composent les,
principaux cours d’eau de la commune et leurs nombreuses ramifications. Ils appartiennent au
réseau d régime sec. Le tarissement en saison séche en est la caractéristique essentielle.
La Commune compte de nombreux plans d’eau dont les plus importants sont : les barrages de Tuiré
(1 800 000 m3), le barrage de Zorgho (400 000 m3), de Paalé (280 000) et de Bougré (180 000). La
présence de ces multiples eaux de surface, quoique temporaires, constitue un potenticl pour le
développement des activités pastorales et des cultures irriguées notamment le maraichage.
2.2.3 Ressources en eaux souterraines
Le type d’aquifére d'eau souterraine exploitable par des ouvrages hydrauliques (forages et puits) est fonction
du contexte géologique. Les formations géologiques rencontrées au niveau de la commune de Koulwéogo
sont essentiellement des granitoides,
L’analyse des données liées & la réalisation de points d’eau modemes et a leurs caractéristiques révéle de
bonnes potentialités en eaux souterraines pour la Commune. En effet le taux de succés des forages de lordre
de 84% est largement au-dessus du taux généralement admis dans un tel contexte (70%). Les niveaux
statistiques sont peu profonds avec une moyenne se situant autour de 14 m. Le débit moyen est de Sm3/h et
31% des ouvrages concemés ont un débit de plus de Sm3/h.
2.2.4 Sols
Dans la zone de Koulwéogo, selon la morpho pédologie on y rencontre deux types de sols :
Des sols ferrugineux tropicaux lessivés en prédominance dans la Commune de Zorgho. Ce type de
sols couvre entiérement le Nord et le Nord:
Ouest de la Commune. Du point de vue
taxinomique, nous distinguons
Les sols gravillonnaires constitués de plus de 90% d’éléments grossiers, sont en grande partie
occupés par les lotissements successifs qu’a connus la Commune. Les quelques portions restantes
sont soit utilisées comme aire de paturage avec un tapis d’herbacées appétibles (zones en jachére),
soit cultivées en sorgho rouge, blanc, en mil, en arachide et legumes locaux comme le gombo et
Voseille malgré leur fertilité initiale médiocre, afin de pallier un tant soit peu a la pression fonciére
de plus en plus sévissant. Les sols gravillonnaires résistent assez bien a P’érosion hydrique car
composés de blocs de cailloux rouge et autres éléments grossiers.
Les sols sableux sont localisés un peu partout sur le territoire communal. De texture sableuse, ils
conticnnent une forte proportion de silice et trés peu d’humus, retiennent peu d'eau et sont trés
perméables. Ils sont exploités pour la culture du mil, et de arachide. Autour des cases et des
concessions, les sols sableux améliorés par l'apport des ordures ménagéres sont transformés en
champs de case ot sont labourés le mais hatif, l’oseille, le gombo ... Ces champs offrent en période
normale de bons rendements.
Les sols argilo sableux occupent d'importantes étendues au niveau des villages de la Commune et
de petites dans la zone périurbaine de Zorgho. De perméabilité moyenne, leur exploitation est
dominée par la monoculture céréaliére. Ces sols sont recherchés par la population.
Les sols argileux se rencontrent dans les bas-fonds et dans certaines dépressions de la commune
sous forme de sols allomorphes de dépéts sédimentaires favorisés par le ruissellement. On y
Pratique de la culture maraichére pendant la saison séche et du riz pendant ’hivernage.
2.2.5 Flore et végétation
La savane arbustive est prédominante. Selon la DPH, la commune de Zorgho dispose d’un capital
de végétation ligncuse assez importante, en ce sens que la franche féminine parcourt environ 10 km
comme rayon moyen d’approvisionnement en source d’énergic. Cependant, P'état actuel de la
végétation révéle une augmentation de plus en plus accrue des exploitations et partant la
fragilisation du potentiel existant. Cette fragilisation résulte d’une dégradation d'origine climatique
(sécheresse) mais surtout anthropique (cultures extensibles, coupe abusive du bois, feux de brousse
..). La plupart des espéces épargnées sont celles qui revétent un aspect utilitaire pour les habitants;
laquelle utilité provient de leurs racines, leurs feuilles, leurs fruits ou leurs fleurs.
Tableau n°I : Essences existantes et leurs utilités
Tout | Noasanacu ea franpal | Noma & Tisation
scientinques een
er STaange | Prods Ga cosliidis; Alimentation,
anecera Ombrage Bois de chauffe;
Fourmtoepie sce sev’
Khaya Caileedrat ‘Kuka_ Bois de chauffe Fourrage
seooplensis 7 os
Boni cosiaran | Rapotierrouge | Vonka | Allmenunon (mmoe); Ardrama
| Tiaras
[Cannes acida Sabtulga [Fruits comestibles
‘Sclerocaria binrea ————}Nobga | Fruits comestibles ; Bois de:
servise; Pharanconie
a 3p | ris omens; Ban ia;
Bois de service; Pharmacopée
anion [aaa Dong — | Phacmncapee | Bol ao canfte iamaion
Pilosigma Bagende | Pharmacopée Alimentation (0)
reticulotum ey | |
Tamarindus ties [Tomar Fog [Alimeciatin Pammamopls [Bots dosevioo=|
Source : SPERH Ganzourgou et Diagnostic terrain
La strate herbacée est dominée d’espéces annuelles telles que : Loudetia togoensis, Penmisctum
pedicallatum, Andropogon gayanus, Cymbopogon. Les paturages sont composés des herbacés ci-
dessus cités. On y trouve aussi des ligneux tels: Khaya senegalensis, Ficus gnaphalocarpa,
Sclerocaria birrea, Acacia albida, Pterocarpus erinocus et autres épineux dont les feuilles ou les
fruits suppléent au manque de piturage en saison séche.
2.2.6 Faune
Les investigations menées au cours de l'étude n'ont pas permis d’effectuer des observations poussées sur les,
ressources de faune sauvage ; les données collectées sont le fruit d’informations recueillies auprés de certains
habitants riverains de la zone.
Le patrimoine faunique de la zone du site se compose essentiellement, aux dires des villageois, de la petite
faune et de la faune aquatique. La faune terrestre se réduit & quelques espéces : liévre, écureuil et de petits
rongeurs. L’avifaune composée essentiellement de tourterelles, de hérons, de calaos et de fagon saisonniére
des aigrettes. La faune aquatique qui n’est présente que quelques mois (2-3 mois) regroupent quelques
reptiles et des poissons de trés petites tailles. Les reptiles sont composés de crocodiles et de serpents.
Sur le plan piscicole, le plan d’eau de Zoungou et Mogtédo fournissent & la commune de Zorgho,
quelques poissons. Les espéces généralement péchées sont des carpes et des silures. Cette faune
piscicole est cependant résiduelle du fait de Passéchement des mares. I] n’existe pas de pécheurs
professionnels dans la Commune. Les quelques rares activités de péche que se ménent sont le fait
enfants qui s'y adonnent pendant les périodes d’asséchement de la mare. La péche se fait avec des moyens
rudimentaires dont des amas de branchages, de paille, des nasses, ete.
2.3. Milieu socio-Geonomique
23.1 Démographie
Zorgo est le chef-lieu du département du village de Koulwéogo. Selon les résultats provisoires du
Recensement Général de la Population et de Habitat de 2006, la population résidente de la
Commune de Zorgho était de 46 898 habitants en 2006 contre 23 299 habitants en 1996. Il en
résulte un accroissement moyen de 23 599. Cette population représentait en 2006 environ 14,66%
de la population résidente de la province du Ganzourgou et 6,76% de la population de Ia région du
Plateau central, Elle était globalement composée de 24 983 femmes (53.27%) et 21 915 hommes
(46,73%). Avec une superficie de 453, 405 Km? (IGB), la commune avait en 2006 une densité de
103 habitants au Km? tandis que la moyenne provinciale était de 76 habitants au Km’,
La répartition par sexe de la population résidente montre qu’il y a plus de femmes que d’hommes
dans la commune de Zorgho. Les femmes représentent plus de la moitié (53 % de la population en
2006). Elles constituent de ce fait un groupe dont le rdle dans le processus de développement
devrait étre prépondérant.
2.3.2. Régime foncier
La gestion du domaine foncier national, urbain et rural, était régie jusqu’d présent par la Loi portant
réorganisation agraire et fonciére (RAF). En juin 2009, le Burkina a adopté une loi fonciére rurale
spécifique qui « détermine le régime domanial et foncier applicable aux terres rurales ainsi que les principes
de sécurisation fonciére de ensemble des acteurs du foncier rural »'. Cette loi n’est cependant pas encore
opérationnelle, tous les décrets d"application et autres textes réglementaires pour son application n’ étant pas
encore adoptés. Nonobstant cette situation, sur le terrain, occupation de lespace épouse encore les traits
caractétistiques de lappropriation traditionnelle
On note dans la pratique un hiatus entre l'appropriation moderne et l'appropriation coutumiére des terres.
Selon la premiére toutes les terres appartiendraient a I’Etat et selon Ia seconde, la terre est la propriété des
familles ow des lignages. A Koulwéogo, la terre est une propriété du lignage et chaque famille assure la
gestion de ses terres. Les principaux modes traditionnels d’accés 4 la terre sont I’héritage et l'emprunt. Ces
modes d'acquisition donnent lieu a deux types de droits fonciers qui sont le droit de propriété et le droit
usufiuit. Cette situation n'est pas sans conséquence sur la gestion des ressources naturelles. Les
populations enquétées relévent en effet la présence de nombreux conflits notamment entre agriculteurs et
éleveurs. Les zones de piturages sont progressivement occupées par des champs et & l’opposé, les espaces
cultivés font l'objet de dégats causés par les animaux. On enregistre par ailleurs quelquefois des conflits
entre autochtones et migrants.
Pour les producteurs interrogés, il n'existe pas actuellement dans le village de Koulwéogo, un probléme de
disponibilité ou d’accés a la terre, les jachéres étant jusque-la assez respectées. Toutefois, avec la
construction du barrage, cette situation va s'exacerber si des mécanismes préventifs de confits ne sont mis
en place.
2.3.3 Organisations s
La population de Koulwéogo, a instar de celle de la commune de Zorgho est en grande majorité
constituée de mossé et assimilés (yareé, marencé) qui sont a ’origine dune société trés organisée
et higrarchisée, Cependant, on y rencontre certaines ethnies comme les Peubls et les Bissa
Lorganisation sociale moaga repose sur une organisation de type clanique. Ainsi, on compte les
notables, les griots, les fossoyeurs et les forgerons.
Les principales religions pratiquées dans la commune sont Panimisme, le catholicisme, le
protestantisme, les témoins de Jéhovah et "islam.
La parenté a plaisanterie joue un rdle dominant dans organisation sociale et la régulation de
Vordre social, La structuration clanique ou lignagére des groupes ethniques permet de dégager a la
téte de chaque clan un responsable qui est I’ainé du clan ou du lignage. Pour la régulation de l'ordre
social, on distingue trois niveaux de prise de décision : l'administratif, le chef de terre et le conseil
des anciens.
* Loi N° 034-2009/AN portant régime foncier rural
2.3.4 Activités socio-économiques
Les principales activités exereées par la population de Koulwéogo sont I’agriculture, I’élevage, le petit
commerce et ’artisanat,
2.34.1 Agriculture
Les principales cultures céréaliéres dans 1a province du Ganzourgou sont : le mil, le sorgho, le riz,
et le mais. Les céréales les plus cultivés sont le mil et le sorgho dont les aires cultivées en moyenne
atteignent respectivement 32 733 et 30 340 ha ; ensuite vient le mais avec une aire moyenne de 3
097 ha et enfin le riz avec seulement 1 112 ha.
Les principales cultures de rente dans la province sont : le coton, Parachide, le sésame et quelques
fois le soja. Parmi ces cultures de rente seuls Parachide et le coton sont cultivés sur de grandes
superficies et de fagon permanente sur toutes les campagnes passées. Quant au sésame et au soja,
leurs cultures sont irréguliéres et les superficies exploitées sont trés petites par rapport a celles
consacrées 4 la culture du coton et de I’arachide
Les principales cultures maraichéres dans la province sont : la tomate, l’aubergine, les oignons, les
carottes, le piment, le concombre, laitue et la pomme de terre.
Il faut signaler que ces cultures occupent de petites parcelles individuelles aménagées pour ces
cultures. La tomate, le choux, aubergine et les concombres sont les plus cultivées et occupent plus
de superficies.
2.3.4.2 Elevage
L’activité pastorale vient en seconde position aprés l’agriculture dans la zone de Koulwéogo. L’élevage
dans la zone est de type extensif caractérisé par une faible utilisation d’intrants zootechniques et
vétérinaires et l'exploitation des piturages naturels pour I’alimentation des animaux. L’analyse de
la place de Iélevage dans les stratégies des ménages, conduit & distinguer quatre grands types de
systémes de production qui se présentent comme suit :
Y Les systémes agropastoraux : c'est le systéme dominant dans la commune de Zorgho ; dans
ces systémes, I’élevage extensif constitue la principale source de revenus des ménages et
contribue de maniére importante 4 la sécurité alimentaire a travers l'autoconsommation du
lait. Le cheptel est dominé par les bovins souvent associés & un élevage de petits ruminants
et ade la volaille. Dans ce type d’élevage, les activités culturales sont limitées & des cultures
vivrigres autour des campements ou des habitations. Les liens de complémentarités entre
agriculture et élevage sont limités au transfert partiel de fumure a partir du parcage des,
animaux et la vaine pature (exploitation des résidus de cultures).
Y Les systémes sédentaires mixtes en situation précaire : ces systémes sont également tres
présents dans la commune de Zorgho ; dans ces genres de systémes, l"élevage ne constitue
pas ’activité principale des ménages mais il apporte néanmoins un revenus indispensable
visant a combler le déficit céréalier et & couvrir les dépenses monétaires essentielles (santé,
scolarité), Les complémentarités entre élevage et productions végétales sont encore limité
un transfert de fumure organique des parcs a bétails vers les surfaces agricoles et a
utilisation des résidus de cultures dans l’alimentation animale, Dans ces types de systemes,
Vélevage occupe essentiellement les enfants et les femmes (élevage de basse-cour) ; certains
animaux sont parfois configs 4 un berger
Y Les systémes sédentaires mixtes en voie d’intensification : trés frequents dans la commune
de Zorgho, ces systémes d’élevage permettent avant tout de pérenniser, voire d’étendre les,
cultures a travers la traction attelée et la valorisation du fumier et des sous-produits agricoles
notamment l'embouche bovine qui permet de valoriser la main d’euvre en période de contre
saison. Les cultures offrent réguligrement des excédents qui sont réinvestis dans
V’équipement puis a l’acquisition d’animaux (capitalisation/épargne). Les complémentarités
centre productions végétales et productions animales sont de plus en plus importantes et
impliquent souvent la réalisation de fosscs fumiéres pour la production d’un fumier bien
dégradé.
Y Les systemes intensifiés : ce genre de systéme est encore rare dans la commune de Zorgho.
Dans ces systémes, I’élevage constitue un investissement destiné a valoriser un capital priv
et a générer un revenu complémentaire a celui déja garantie par ailleurs (commerce, salariat,
retraite etc.),
Les effectifs du cheptel les plus importants sont la volaille et les petits ruminants.
Tableau n°2 : Effectif du cheptel de la province
Espéces |Bovins |Ovins |Caprins |Porcins |Equins | Asins | Volailles
Année
2010 29797 _|43509_|511172 |3874 _|230 5389 _|136 105
2011 30393 [44815 |52708 [3952 |232__|5497_|140 188
Source : ENC IL
2.3.4.3 Administration, commerce et artisanat
L’activité commerciale dans la commune se déroule dans les marchés qui se tiennent généralement
tous les trois ou sept jours. Généralement deux types de commerce se juxtaposent dans ces
marchés : le commerce général et le commerce des produits agricoles et du bétail. Le commerce
général est organisé de deux fagons
Le commerce de subsistance
Ise détermine par une faible quantité de produits de vente, une discontinue des stocks, un niveau
de capital faible et un taux de profit bas. Toutes ces caractéristiques contribuent 4 une forte
compression du revenu et a son irrégularité provoquant chez les acteurs une incapacité financiére
dassurer la satisfaction de leurs besoins. Les actifs de ce secteur répondent aux exigences de la
clientéle dont le pouvoir d’achat demeure faible. Le commerce de subsistance comprend
> les petits commergants ambulants ou sédentaires avec un étal, vendeurs a la. sauvette, les
vendeurs de friperies, les vendeurs de petits aliments, de légumes, fruits, et de poissons
> les vendeurs ambulants ou sédentaires de cacahuétes, de beignets, gateaux, bonbons.
¢ Le commerce de transition
I conceme I’alimentation générale dans les boutiques de quartiers ou de marchés, les debits de
boissons, les effets vestimentaires. Les profits dégagés restent substantiels
Le commerce des produits agricoles et pastoraux est dominé par un réseau d’intermédiaires
spécialisés dans la collecte des produits (céréales, produits maraichers, bétail) sur les petits marchés
et licux de production ct leur revente sur les marchés de plus grande importance.
2.3.4.4. Hydraulique et assainissement
La répartition des ménages selon le mode d’approvisionnement en eau potable montre que 64,5 %
des ménages de Zorgho ont accés a une eau potable car s’approvisionnant dans les bones fontaines
ou forages. Plus d’un tiers (1/3) de la population de la commune, utilise toujours de Peau des puits
souvent impropre a a consommation. Si Paccés a eau est souvent considéré comme un acqui
dans les pays développés, au Burkina Faso en général et 4 Zorgho en particulier, les zon
habitation sont rarement connectées au réseau d’eau potable et dépendent presque entiérement des
revendeurs.
Les femmes et les filles sont les plus touchées par la rareté de l'eau, puisque ce sont elles qui sont
chargées de rapporter I’eau au ménage. Ce qui les oblige soit marcher davantage ou a dépenser
plus de temps et ’énergie pour aller chercher I’eau soit au puits ou a la borne fontaine
L'accés & un systéme d’assainissement fait partic des indicateurs de suivi du bien-étre des
populations qui doivent étre réguligrement étudiés tant au plan national qu’au plan local.
Dans la commune de Zorgho, seulement 1/3 des ménages évacuent les eaux usées dans des
puisards ; les 2/3 les jettent soit dans la rue soit dans la cour, exposant ainsi la population aux
maladies infectieuses.
Autant les eaux usées sont jetées dans les rues et dans les cours, autant les ordures ménagéres sont
déposées a lair libre sans aucun traitement ni mesure de sécurité. Cette pratique donne libre cours
la prolifération des maladies liées aux problémes d’assainissement,
L’absence d’assainissement est un probléme de santé publique. Outre son impact sur la santé,
V'amélioration de l’assainissement a également des répercussions importantes sur le développement
économique.
2.3.4.5 Tourisme
La Commune de Zorgho abrite des centres d’intérét touristique comme 4 Zorgho la tombe de Naba
Trikoum, la case sacrée de Tollingui, a case sacrée de Tiibin, la case sacrée de Guiloughin, les
teinturiers de Zorgho,
En matigre d’hotellerie, Pauberge Boulboundri, constitue le liew pouvant recevoir des touristes et
des passagers.
En effet, la construction du siége du musée & Zorgho, pourrait faire du warba une manifestation
touristique et culturelle 4 grande échelle, pour peu que ce festival soit mieux organisé
IIL. IDENTIFICATION E’
VALUATION DES IMPACTS,
Cette partie conceme essentiellement les conséquences sur environnement de la zone créées par la
construction du barrage, ses annexes et I’exploitation des ouvrages.
La méthode retenue est celle des inventaires et la technique celle de la matrice actions-impacts. La matrice
actions-impacts permet d’appréhender les domaines particuligrement sensibles lors des travaux de
construction et d’exploitation du barrage et met en exergue l'ensemble des problémes potentiels. Les
relations de causes a effets y sont identifiges et évaluées. En outre, sur la base de telle matrice, des mesures
Peuvent étre échafaudées de maniére a atténuer voire supprimer les incidences néfastes du projet sur le
milieu récepteur.
L'identification des impacts met en relation les sources d’impacts du barrage avec le milieu naturel.
Les impacts des aménagements sur les différentes composantes du milieu sont soient positifs, soient négatifs,
cela étant fonction des résultats réagissant sur le domaine considéré. Les visites de terrain et les différents
entretiens avec les riverains ont permis de révéler les conséquences ainsi que leurs impacts sur les différentes
composantes du milieu.
On distinguera & cet effet deux types d’impacts : les impacts durant les différentes phases des travaux d'une
part et ceux résultant de l’exploitation du barrage d’autre part.
3.2 Evaluation des impacts
L’évaluation des impacts significatifs retenus permet de rechercher leurs origines ou leurs causes éventuelles
et d’envisager dans quelles mesures des actions peuvent étre envisagées de fagon pratique et efficace dans le
cadre de la mise en ceuvre du présent plan. L’évaluation a consisté & examiner les effets des impacts et a les
apprécier en termes d’ampleur. L’évaluation est basée sur trois critéres qui permettent d’attribuer une valeur
raisonnable et objective aux différents paramétres qui sont
* valeur de Pimpact
+ intensité de Pimpact
© durée de impact
La pondération des critéres constitue le traitement des données et sert également d’outil a la décision. Le
tableau ci-aprés récapitule la pondération des eritéres.
‘Tableau n°3 : Pondération des critéres d’évaluation des impacts.
Valeur Intensité Durée
Positive Majeure Permanente
- a Moyenne ot périodique
Négative Mineure ‘Temporaire—
Tout impact peut étre classé selon la valeur qu’il offre. Un impact positif entraine une plus-value a la
composante du milieu considérée et il est négatif quand il la détériore
Lintensité de I'impact est lige au degré de modification de la composante du milicu. Elle est majeure pour
lune modification sensible, moyenne pour une modification relativement faible et mineure pour une
modification atténuée de la composante.
En terme de durée, un impact peut avoir des incidences permanentes, périodiques ou encore temporaires, Un
impact permanent peut affecter la composante du milicu définitivement ou a long terme et peut étre
naturellement ou artificiellement irréversible. Un impact temporaire est limité sur une courte période
(quelques mois) et est réversible.
3.2.1 Evaluation des impacts significatifs
3.2.1.1 Impact sur le climat
Pendant les travaux de construction du barrage et du périmétre irrigué, I’air sera pollué temporairement par la
concentration de poussiére ct de fumée dégagée par les engins. L’impact sur le climat (microclimat local)
16
sera négatif, temporaire et d’importance mineure. Cet impact disparaitra avec l’arrivée des pluics. Une fois
{que la mise en cau est effectuée, la présence des ouvrages contribuera A augmenter la ventilation dans la
zone. L’insolation combinée a effet du vent augmentera l’évaporation au niveau de la retenue. Par ailleurs,
Pexploitation du périmétre irrigué en aval suscitera utilisation de produits chimiques (pesticides,
herbicides, etc.) nécessaires pour le traitement des cultures. Cela engendra des odeurs notamment en période
séche qui affecteront la qualité de I’air dans la zone. L’impact sur le climat sera 4 ce moment négatif,
permanent et importance moyenne.
3.2.1.2 Impacts sur les eaux de surface et souterraines
Durant les travaux, la présence de nappes phis ou moins discontinue dans le sous-sol aura des effets sur la
stabilité des ouvrages, en particulier pour les fondations de l'ouvrage. Par contre les effets sur les eaux de
surface seront négatifs, majeur et permanent durant les travaux. L’installation de camps de travaux, la
construction des infrastructures, i’utilisation des engins motorisés et la présence de main d’ ceuvre temporaire
auront des impacts sur le débit des marigots, 1a qualité des eaux et sur le nuissellement. Seul le déboisement
de ta cuvette aura un impact positif car diminuant le taux de matigres organiques pouvant se décomposer
dans la retenue (phénoméne d’eutrophisation). Les sites de carriéres,s'ils ne sont pas correctement exploités,
pourront contribuer a la dégradation de la qualité de l’cau et favoriser |’ érosion des sols.
La création de la retenue va modifier I’écoulement naturel du cours d’eau. Cette modification se traduira sur
le plan écologique par la partition du cours d’eau en trois parties différentes 4 savoir ; l’amont, le réservoir de
stockage de Peau, et l'aval. A I'amont de ta retenue, la partie située en amont sera la moins affectée par Ia
construction du barrage. Cette partie conservera probablement ses caractéristiques originelles ; ce sera
toujours un cours d’eau intermittent soumis & des crues et inondant périodiquement des zones marginales. La
diminution du débit d'étiage du marigot a aval du barrage entrainera l’asséchement de zones humides. A
contrario, la mise en place des canaux d’imrigation et a mise en eau des parcelles agricoles va contribuer & la
recharge des nappes phréatiques. Ces impacts sont souvent différés et évolutifs & moyen et & long terme.
‘La mise en eau de Ia retenue permettra aux populations, de disposer d'une grande quantité d’eau pour les
différents usages. Cet impact est positif, permanent et importance majeure.
La présence du barrage va cependant consacrer la séparation de plusieurs terroirs liés auparavant par
histoire et la culture, Trois blocs de terroirs vont se constituer & savoir les villages relégués désormais a la
rive droite du barrage en opposition & ceux de la tive gauche et ceux situés en aval séparés par Ia digue du
déversoir. Cet impact est négatif, permanent et «importance moyenne. L’utilisation de pirogues et autres
embarcations pour la navigation permettra d’atténuer cet impact.
3.2.1.3 Impact sur les sols
Les travaux de construction du barrage et d’installation du périmeétre irrigué, l’ouverture et l’exploitation des
zones d’emprunt, la destruction de la végétation liée aux multiples passages des engins vont inévitablement
dégrader les sols en profondeur. Les facteurs de dégradation des terres se manifestent entre autres en termes
de salinisation et/ou d’engorgement de sols ; de submersion d’espéces végétales au droit des sites de retenus
eau ; de réduction des surfaces cultivables et pastorales ; d’accroissement de la population aux environs de
la retenue d'eau.
L’impact sur le sol sera négatif, permanent et d°importance majeure.
3.2.1.4, Impact sur le paysage
La construction du barrage et I’aménagement du périmétre irrigué, des ouvrages annexes et des différentes
zones d’emprunt vont modifier le paysage de la zone. Les effets seront cependant limités car peu sensibles ct
peu perturbant pour les habitants de la zone.
3.2.1.5. Impact sur la flore et la végétation
Les impacts concerneront surtout le déboisement pour d’une part l’emprise de la retenue, la construction du
barrage et d’autre part la construction du périmatre irrigué et des pistes. En outre, des déftichements seront
nécessaires pour installer les divers chantiers de dépdt de matériaux sans oublier tes zones d’emprunt.
L’impact sur la flore et la végétation sera négatif, permanent ct d’importance majeure,
3.2.1.6, Impact sur la faune
Les effets sur la faune seront essenticllement liés au déboisement. II convient a cet effet de souligner que les
espéces animales seront atteintes de fagon différente selon leur taille et leur mobilité. Les mammiféres et les
‘oiseaux ont dans l'ensemble la capacité de fuir assez rapidement ce qui limite la mortalité immédiate et
raméne l'impact & une transformation de Vhabitat. Les petites espéces (en particulier des reptiles ot des
batraciens) seront beaucoup plus touchées le méme que les invertébrés. Le bruit causé par les travailleurs et
Jes engins de chantier provoque un éloignement de la faune. Si les travaux sont bien menés, l’impact sur la
faune sera négatif, temporaire et d’importance mincure. Cependant, une fois le barrage construit et exploité,
Vutilisation incontrélée des produits chimiques pour la production agricole pourrait avoir des effets aussi bien
sur la microfaune que sur la pédofaune car les spectres d'action de la matiére active de la majorité des
pesticides généralement utilisés sont larges. Ils agissent soit par contact, par ingestion, par inhalation, soit par
répulsion. Ce qui n'est pas sans effet sur Tavifaune (cas des espéces migrateurs) et les rares rongeurs qui
existent encore dans la zone. En tout état de cause, il y aura perte de diversité biologique.
3.2.1.7 Impact sur la santé
Il s'agit ici identifier les principales nuisances qui pourront survenir suite & la création du barrage, du
périmétre irrigué et des ouvrages annexes.
Les nuisances peuvent s’analyscr en rapport avec les situations sanitaires et nutritionnelles qui prévalent
actuellement dans la zone de Koulwéogo en insistant particuliérement sur les principaux domaines
susceptibles d’étre influencés par le futur plan d’eau. Le village de Koulwéogo, bien que moyennement
peuple se caractérise par la présence d’un certain nombre d’endémies susceptibles de se développer suite aux
nombreuses transformations environnementales qui surviendront avec Ia construction du barrage. Des
enquétes menées & cet effet auprés des populations, il ressort que la situation sanitaire est caractérisée par la
présence du paludisme, des diarrhées et autres maux de ventre, des infections des voies respiratoires et des
problémes de hemies notamment chez les personnes agées.
Les fiéquences de certaines de ces maladies (hydriques) seront accrues avec la construction du nouveau
barrage ; il s‘agit en particulier du paludisme.
Certains comportements & risques des exploitants du barrage tel la consommation directe de l'eau du barrage,
ou l’absence de latrines dans le village augmenteront également au sein de la population surtout sa frange
Jeune les maladies diarthéiques. Les affections respiratoires sont également courantes particuliérement chez
les enfants fréquentant le plan d’eau (baignades prolongées, péche, etc.)
La présence également des animaux toute année autour du plan deau favorisera l'apparition de certaines
pathologies telles que les bilharzioses, la dracunculose et certaines zoonoses (tuberculose, charbon, etc.)
Les activités de commercialisation des produits maratchers et de la péche aménent les producteurs surtout
les jeunes (sexuellement actifs) 4 fréquenter différents marchés ce qui peut favoriser la propagation des
maladies sexuellement transmissibles. Par ailleurs au niveau de la retenue, des cas de noyades peuvent
intervenir.
Plus particuliérement, la mise en valeur du périmétre agricole en aval du barrage peut étre source d'une
utilisation accrue de pesticides pour lutter contre les ravageurs. Aussi, les activités agricoles (maraichage,
riziculture) pourraient, entre autres, accroitre "impact de l'utilisation des pesticides et fertilisants qui sont
sources de plusieurs impacts négatifs dés lors que leur utilisation n’est pas raisonnée : pollution de la nape
et des cours d’cau ; contamination du bétail par labreuvage ; mauvaise gestion des emballages pouvant
oceasionner des risques divers notamment lorsqu'ils sont réutilisés pour contenir d'autres produits
alimentaires, ete.
D’autres maladies peuvent provenir de la pénibilité du travail: le mal de dos, la hemnie. Les vagues de chaleur
{que subissent les maraichers pendant leurs activités ne sont pas sans rapport avec les maladies cardio-
vasculaites, respiratoires et autres. La morbidité et la mortalité dues 4 ces facteurs pourraient augmenter, en
particulier chez les personnes Agées. Un accroissement de la fréquence des journées chaudes ou torrides et
des inversions thermiques (phénoméne météorologique qui peut retarder la dispersion des polluants) peut
provoquer une dégradation de la qualité de Tair et causer des maladies respiratoires
L'impact sur la santé est négatif, permanent et d’importance majeure.
3.2.1.8 Impact sur le foncier
La création du plan d'eau, linstallation du périmetre irrigué, des carrigres et autres zones de dépét de
‘matériaux vont occuper plus de 12 ha d'espaces de culture et de paturage, ce qui va déposséder certains
habitants de leurs domaines de culture. Interrogés sur la question, les habitants déclarent en étre conscients et
sont collectivement préts a libérer leur terre pour peu qu’ils (les propriétaires terriens et occupants actuels)
soient pris en compte dans les nouvelles allocations de parcelles aménagées. Cette prédisposition des
Populations bien que salutaire pourrait cependant étre source de nombreux conflits si des dispositions ne sont
pas prises effectivement & cet effet. Limpact sur le foncier est négatif, permanent et d’importance majeure.
Cet impact pourrait étre atténué avec une approche participative et une distribution equitable des parcelles
aménagées et avec lintensification des productions suite a la mise en valeur agricole des terres en aval de la
retenue,
3.2.1.9 Impact sur Pagriculture
Les impacts de Ia construction du barrage et des aménagements hydro agricoles sont multiples. Ils vont de
Vintensification du systéme de production agricole a exacerbation des inégalités sociales en passant par
Vaceroissement des rendements, augmentation des revenus, I’accroissement de Foffre d'emploi agricole et
les changements alimentaires.
La mise en valeur du périmétre aménagé en aval et des plaines inondables en amont va marquer dans la zone
de Koulwéogo et des villages riverains le début de I'intensification de la culture du riz et du maraichage. La
présence de I’eau en amont et surtout en aval a travers les canaux irrigation va permettre aux nouveaux
exploitants agricoles de faire une double récolte, voire une triple récolte annuelle sur la méme parcelle.
Ensuite cette double voire triple culture se fera non seulement grace a lirrigation qui permet de supprimer les
temps morts qu’impose le rythme des saisons mais aussi grace a l'utilisation de variétés & haut rendement
telles les NERICA (New Rice of Africa) qui sont des variétés a haut potentiel. On passera dune agriculture
pluviale reposant sur l'exploitation des bas-fonds avec un outillage archaique (pioche, houe. daba. machette,
faucille,... ) une agriculture irriguée avec des rendements plus significatifs (4 ha 5 tonnes de riz par ha et
par an contre 2 3 tonnes actuellement), Ces rendements élevés seront atteints grace a l'utilisation de fortes
doses dengrais (8 sacs de 50 kg, soit 400 kg/ha) et de produits de traitement tels que les herbicides et les
insecticides (au total, 7 kg/ha), mais aussi du fait de V'adoption d'un nouveau systéme de mise en place de la
culture qu'est le repiquage du riz suite a la mise en place de pépiniéres rizicoles.
L’augmentation des rendements induiront un accroissement de la production et par voie de conséquence une
augmentation des revenus et des conditions de vie des producteurs,
Lintensification la production contribuera par ailleurs A la eréation de nombreux emplois agricoles
notamment dans les opérations de repiquage du riz, de désherbage des parcelles, de labour, d’épandage
d’engrais et de pesticides, les opérations de récolte et de post récolte, etc.
L'impact sur agriculture est positif, permanent et d’importance majeure.
Les disponibilités alimentaires vont cependant entrainer chez de nombreux riverains un changement voire
une modification des habitudes alimentaires. Ces changements d'habitude alimentaire vont aussi se
manifester par adoption d'autres produits alimentaires importés. En effet, l'acquisition de Vargent grace a la
vente du riz et autres produits maraichers va permettre lachat de produits étrangers de toute sorte parmi
lesquels des vivres (lait, sucre, condiments importés, biére, ete.)
Tout cela va contribuer & une exacerbation des inégalités sociales. En effet l'introduction de l'économie
monétaire dans la zone du barrage notamment par le développement de la riziculture irriguée et du
maraichage va contribuer a laltération de la structure sociale des communautés villageoises. Si aujourd’hui
ddans le village ce sont les plus vieux qui régentent les familles, il est & craindre qu’avec la monétarisation
des rapports, le nouveau pouvoir ne soit détenu demain par ceux 1a qui détiennent le pouvoir financier. Cet
impact est négatif, temporaire et d’importance mineure.
3.2.1.10 Impact sur Pélevage
«L’élevage ne vaut que s'il existe de eau pour le bétaily dit un agro-pasteur. Cet adage résume le
soulagement exprimé par les populations de Koulwéogo au regard des nouvelles possibilités dabreuvement
des animaux. Le développement de I’élevage devrait induire la promotion de la traction animale (culture
attelée, transport, etc..); d'intensifier les productions animales par l'embouche et la production laitigre ;
faméliorer Vaviculture traditionnelle ; d'améliorer les circuits de commercialisation des produits et de
valoriser les sous-produits agricoles.
Les activités dembouche (bovine ; porcine ; ovine; caprine) et Ia disponibilité de sous-produits agricoles
permettront d’alléger la pression du bétail sur les ressources végétales et réduiront la dégradation des habitats
naturels,
Cet impact est positif, permanent et d’importance majeure.
L’amétioration de ta disponibilité en eau, et surtout le fait que le point d’eau sera permanent, va entrainer une
augmentation des concentrations de bétail autour de la retenue, qu’il s’agisse d’animaux venant du terroir ou
de ceux qui viendraient d'autres zones et méme d'autres régions du pays. L'importante concentration du
bétail pourrait entrainer la dégradation de la végétation, la destruction des ressources en sol, l'accélération du
processus d"érosion, la dégradation de Vhabitat de la faune sauvage suivie de sa disparition, la destruction
des cultures et méme des ouvrages hydrauliques et agricoles. La également, des aménagements sont a
cenvisager pour assurer une bonne protection de la retenue d’eau, de ses fonctions et des ressources naturelles
dans les alentours du site
Cet impact est négatif, permanent et d’importance majeure.
3.2.1.11 Impact sur la péche
La construction de Ia future retenue d’eau de Koulwéogo va contribuer au développement de la péche qui
apparait comme une source de revenus pour les populations et de diversification de l'alimentation. Le
barrage contribuera a l'augmentation de la production piscicole et la pérennisation des activités de péche.
Dans la retenue, la construction du barrage va induire des changements quantitatifs et qualitatifs dans la
ressource halicutique. Les populations riveraines pratiquant sporadiquement une péche de ri
soumises & une péche lacustre et devront adapter en conséquence leur technicité. En effet, contrairement a la
rivigre, les lacs présentent des réserves d'eau plus importantes et plus stables. Le développement de la péche
dans le nouveau lac nécessitera en conséquence l'emploi d’autres technologies, a savoir surtout l'emploi de
filets maillant, de palangres, de filets éperviers (notamment dans la partie amont du lac) et certainement des
embarcations. Dans la retenue et compte tenu des premiéres informations disponibles sur la composition des
espéces et tenant compte des expériences vécues sur d’autres petites et moyennes pécheries, on prévoit une
‘modification dans la composition faunistique des différentes espéces. Cette modification est la conséquence
des changements qui interviendront dans I’éventail des ressources alimentaires présentes dans le lac. Suite &
ces changements écologiques, les poissons vont devoir opérer des adaptations. Ainsi, les espéces
microphages et macrophages mangeuses de végétaux comme Saratherodon, Oreochromis, etc. trouveront de
bonnes conditions dalimentation.
Les changements les plus attendus sont l’augmentation de la production et une plus grande pérennisation des
activités de péche, Au licu done d'un role trés secondaire, la péche, jouera certainement un role prépondérant
et plus stable dans la vie sociale et l'économie des terroirs concemés. Selon nos estimations le tonnage
maximum susceptible d’étre prélevé annuellement dans la retenue de Koulwéogo sans nuire au stock
ichtyologique renouvelable est estimé 4360 kg environ en bonne saison pluvicuse. A cette production
20
pourrait s'adjoindre celle de la pisciculture en aval dans des étangs ou dans les casiers rizicoles
(vizipisciculture). La péche contribuera au développement économique de la zone.
Cet impact est positif, permanent et d’importance majeure,
Il convient cependant de prendre certaines précautions d’aménagement lors des travaux de déftiche.
Plusicurs options sont envisager dont
Option 1 : statu quo ante
Il s’agit ici de garder le barrage tel qu’il se présente actuellement et d’effectuer la mise en eau avec toute la
biomasse végétale. L’intérét d'une telle option est qu'elle permet de réduire considérablement les coiits
financiers des travaux. L'inconvénient majeur est que la présence d’une grande biomasse végétale dans le lac
est défavorable a la vie des poissons et done a la production piscicole. Bien que l’impact de la présence de la
végétation varie avec sa densité il peut s'en suivre une forte dégradation de Ia physico-chimie de l'eau ayant
pour conséquence une mortalité prématurée du stock ichtyologique renouvelable.
Option 2 : déforestation totale
Dans la zone du barrage tout comme au Burkina Faso le combustible est rare et provoque une déforestation
Progressive de toutes les régions périurbaines, La coupe du bois et sa transformation en charbon pour la
consommation ménagére, lors de T'installation du barrage, ne doivent done pas étre envisagées uniquement
ou point de vue rentabilité. On peut concevoir qu’on exploite systématiquement le bois de toute la surface
inondable. Ce point de vue n'est cependant pas réaliste, A moins d’utiliser des méthodes trop cotiteuse
(emploi de bulldozers notamment), d’envisager une coupe a blane permettant ultérieurement l'emploi de
filets sur n’importe quelle surface du lac.
Une telle coupe présenterait, d’autre part, inconvénient d’exporter une quantité de matidres végétales, de
supprimer des abris et une source de nourriture pour les poissons. Cette option ne devrait done pas étre
envisagée.
Option 3 : Déforestation partielle
La déforestation partielle semble la solution la plus appropriée, c’est d’ailleurs celle qui est généralement la
plus utilisée et done la plus recommandée.
est proposé 4 cet effet de faire abattre la végétation arbustive occupant la vallée jusqu’a hauteur de la cote
‘moyenne du futur plan d’eau (305 m) c’est dire la zone permanemment noyée dans l'eau. Aprés cette zone la
coupe pourrait étre alternée tous les 50-100 m par des bandes boisées. Cette option a l'avantage de fournir
une certaine quantité de bois de cuisine, de fournir nourriture et abris pour le poisson et de réserver des zones
ott les activités de péche n’empécheront pas la reproduction des poisons (zones frayéres).
3.2.1.12 Impacts socio-économiques et socioculturels
3.21.11. I Impacts positifs
Les impacts positif's des activités du projet de construction du barrage, pour l’essentiel, concernent les points
suivants : intensification et la diversification des activités agropastorales ct halicutique, grice a : (i)
Vamélioration des techniques et des systémes de production par le biais notamment de l'amélioration de
Vappui-conseil (techniques culturales adaptées & la nature des sols, techniques de maintien / reconstitution de
la fertilité des sols, maitrise de I’érosion éolienne et hydrique, amélioration de la gestion de l'eau dans les
périmétres irrigués,...) ;(ii) 'amélioration des revenus et des conditions de commercialisation ; (iii) une
meilleure valorisation de la production par la transformation ; (iv) ’élargissement de la gamme des
Productions ; (v) le renforcement des compétences des différents acteurs intervenant dans les productions
végétales et halieutiques (producteurs, commergants, transporteurs, opérateurs économiques) ; (vi)
Vinformation et la formation en matiére de bonnes pratiques (qualité, normes sanitaires ot
environnementales),
Les impacts globaux du Projet sont positifs et participent au développement économique et social de fa zone
du barrage en particulier et du Burkina en général. Parmi les impacts positifs qui pourraient résulter de la
construction du barrage peuvent étre cités :
~ l'approvisionnement des populations humaines et animales en eau : le village est actuellement dépendant
des forages installés pour l’approvisionnement en eau potable des populations humaines, du moins pendant
la saison séche au cours de laquelle les cours d’eau tarissent systématiquement. La construction de la retenue
eau va non seulement augmenter les niveaux de satisfaction des besoins des populations en eau aussi bien
pour les animaux domestiques que pour les activités agricoles de contre saison ; on assistera également & une
diversification des sources d’approvisionnement en eau aussi bien dans le temps que dans I’espace,
diversification qui pourrait entrainer I’émergence de nouvelles espéces animales et végétales dans les
villages avec le retour de certaines espéces animales a cause de I’amélioration des conditions de vie dans
Vhabitat naturel, et du développement de certaines espéces végétales consécutif Ia remontée de la nappe
phréatique dans les environs immédiats de la retenue deau.
- La diversification des sources d’approvisionnement en eau des populations va contribuer & I"émergence de
nouvelles spéculations allant des cultures maraichéres & I’élevage en passant par l'arboriculture fruitiére, 1a
production ligneuse, la valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux, des ressources halieutiques
et de la faune aquatique.
~ La présence pendant toute l'année de l'eau sur Ie site du barrage aura pour conséquence l’amélioration du
phénoméne d'infiltration qui pourrait a terme entrainer la remontée de la nappe phréatique, remontée qui
aura pour effets l'amélioration et la diversification des sources d’approvisionnement en eau, qui pourrait
son tour donner une impulsion aux activités économiques aussi bien dans le village de Koulwéogo et les
villages riverains et partant, améliorer les conditions de travail et de vie des populations en particulier les
femmes, traditionnelles pourvoyeuses d’eau en milieu rural.
- L'amélioration des conditions dapprovisionnement en eau des populations humaines animales et végétales
dans les villages bénéficiaires de Ja retenue oussi bien que dans les villages voisins, 'augmentation des
opportunités de production et de transformation, I'amélioration de I’habitat dans les villages bénéficiaires
que chez. leurs voisins, !’amélioration des conditions d’hygiéne consécutive & Ia disponibilité en eau, etc, sont
autant de facteurs d’amélioration des revenus et des conditions de vie, donc un dispositif cohérent de lutte
contre la pauvreté, a condition que des mesures d’accompagnement soient mises en ceuvre.
- La population de Koulwéogo surtout sa frange jeune qui migre vers les villes a la recherche d’un mieux-
€tre sera plus ou moins sédentarisée 4 la faveur des nouveaux emplois créés par la construction du barrage.
Sans doute la réalisation du barrage et Ia valorisation des terres par le développement de l'agriculture
irriguée contribueront & stabiliser la frange de la population de Koulwéogo.
‘Tous ces impacts sont positifs, permanents et d’importance majeure.
~ Pendant les travaux de construction des ouvrages, le petit commerce et la restauration connaitront un
accroissement certain. Aussi le recrutement de la main d’uvre locale améliorera la situation de emploi
dans la zone. L’impact sera positif et temporaire pour I’Gconomie de la zone.
~ Aprés la mise en eau, le développement des ressources aquatiques, avinires et le retour de Ia petite faune
terrestres devraient favoriser la promotion de I’écotourisme dans Ia zone, eréer des emplois (guides, etc.) ct
_générer des ressources pour les collectivités locales.
3.21.1, 2 Impacts négatifs
De fagon globale, la construction du barrage et du périmétre irrigné vont avoir des incidences négatives
certaines sur le cadre de vie des populations, habitat, les infrastructures socioéconomiques et les ressources
naturelles, non seulement du fait des aménagements et infrastructures prévues, mais surtout avec l’afflux des
populations migrantes dans la zone a la recherche d’emplois et de bien-étre.
2
Les facteurs de risques environnementaux et sociaux majeurs sont principalement : la pression
démographique dans la zone, risquant d'induire une altération des zones humides, des berges du lac, une
demande forte en produits ligneux, de créer la détérioration progressive de l'environnement en V'absence de
réalisation d'un programme de conservation et de polluer le milieu par le rejet des déchets ; !'occupation non
autorisée de terres appartenant aux autochtones.
S'agissant de habitat, l'accroissement démographique va se traduire par des exigences de besoins en terres
habitation, mais aussi de gestion des déchets solides ménagers solides et liquides pour éviter les risques de
pollution du cadre de vie.
Cet afflux se traduira aussi par des besoins en infrastructures eau potable, d’écoles et de centres de santés,
‘mais aussi de forces de sécurité (police et gendarmerie notamment) pour garantir la sécurité des biens et des
personnes.
Parmi les impacts les plus significatifs peuvent étre cités
~ les pertes de concessions : 14 concessions relevant du village de Koulwéogo ont été répertoriées dans
Vemprise du barrage.
~ les pertes de terre agricole et de paturage : une superficie de 12 ha de terres sera concemée par
installation du barrage, du périmétre irrigué et des ouvrages annexes. Les investigations réalisées &
VVintérieur de ces terres dénombrent 51 personnes exploitant actuellement le site. Ils sont originaires
de Koulwéogo et des villages environnants.
= les pertes de verges et de plantations
Plusieurs plantations ont été répertoriées lors de V'inventaire participatif tout le long du cours d’eau.
Ces plantations comprennent des espéces a dominante fruitiéres (Mangifera indica essentiellement).
Ces arbres peuvent étre regroupés en deux types: les plantations de types vergers 4 dominante
uiilitaire au nombre de 59 dont 41 manguiers et 18 goyaviers. Les non utilitaires sont estimés a 146
dont des neemiers (113), des accacias (19) ct des Eucalyptus (14). Toutes ces plantations qui se
trouvent dans I"emprise du futur lac seront noyées et donc perdues ds la mise en eau du barrage. On
dénombre toujours au titre des ouvrages qui seront noyés 2 forages fonctionnels.
~ les risques d’inondation du village
Les risques d"inondation peuvent étre de plusieurs ordres. Ils sont d’abord d’ordre technique et/ou
conceptuel liés notamment au mauvais calibrage des évacuateurs de crues, au mauvais calage des
canaux d'irrigation, & la détérioration des réseaux d’irrigation et ayant pour conséquences une
augmentation des débits découlements en aval, I’inondation des berges et des terres contigiies, des
pertes de cultures, I"inondation des parcelles irrigables non dominées. Les inondations sont ensuite
d'ordre anthropique liées a la mauvaise gestion des terres agricoles, l'ensablement / ensablement de
la retenue, Ia déforestation, ete. Les risques d’inondations sont enfin d’ordre climatique lié
notamment aux phénoménes des changements climatiques.
Pour parer & aux risques notamment techniques, les études techniques ont calé le plan d’eau normal
(PEN) 4 la c6te 305 m permettant ainsi de stocker suffisamment d’eau sans inonder le village. Quant
aux risques anthropiques, ils pourront étre levés par le biais des renforcements des compétences des
communautés riveraines, la promotion des bonnes pratiques agricoles et la lutte contre la
déforestation,
2B
3.2.2 Matrice des impacts
Tableau n°4 : Matrice des impacts
Phases du projet | Impacts ‘Causesforigines Zone deVimpact ‘Carsctérisaion | Mesures d'aitGnuation/optimisation
ATB TC
Pollution de Pair ‘Concentration de poussiere et de fumée | Zone emprunt ct zone des | - | Min | Te | ~Anosage des pistes de passage des engine
prociuites par les engins ‘ava
Dégraditon des sole ‘Le passage des engins rendra Te sol purulent ct | Zone — emprant, de] - | Maj | Te | ~resiauratfon des zones W'emprunt
Travaux le présence de crevasses augmententI'éosion | circulation et des travaux enuetien des pistes
| hydrigue
“Aceroissement des revenus | Le eréation de nouveaux omplois sur le chanter | Villages accueil + | Moy [Te | -Favoriser Te ecrutement de a main d'euvre
et Maccrvissement des activités marchandes | (Koulwéogo) Tocale
avec la présence du personnel de I’entreprise
Portes de Giens individuels et | L'inondation de 189 ha de terre engendrera des | Zone influence du | Maj | Per | ~ compensation en terre amEmapée
collects pertes de cultures et de plantations barrage et villages
riverains
Disponible une grande | Presence Sun weewvoir Teva de 2,7 milions | Zone di barrags at [> | Maj | Per e Poumage de
quant d'eau dem d'eau i
Existence d'une zone humid | Inondation dune superiie de 120 fa par Te [May [Per de Touwage de
plan d'eau dela retenue
‘Améliration de la recharge | L'accvoissement des debits @inflation GUA la | alentours du barrage | + _| Maj | Per de Powmage de
des nappes aquiftres localisées_| charge erée parle bamage
Constitution d'un casystéme | Le microclimat eré par l'eau dela retenue etla | Réservolr et alentour du [+ | Moy [Per | Suivi) Enirtien de" Touage de
riverain végétation ripicole et aquatique qui sera | plan d'eau ‘mobilisation
constituée = protection des berges et de la végtiation
Existence de sies Fintret | Les futurs amfnageanents hydroagricoles de fa | Alentour du plan et dex [+ | Moy | Per | -miseen valeur des teres
paysager zone ‘ouvrages
‘Accroissement des productions | La disponibiite de Teo touie Pannée, Ta | Zone du bamage + | Maj] Per | ~ promotion de nouvelles technologies
egro-pastorlc et halicutique | possibilité de faire des cultures de contre saison = organisation, formation et.
et la pratique de nouvelles technique culturale responsabilistion des acteurs
Garigation), utilisation des sous produits ~empoissonnement
agricoles pour Valimentation du bétail élimitation de couloirs de passages des
contribueront & augmenter les rendements et animaux,
Vexistence de conditions propices pour la ~ extation de zones pastoales
ak reproduction des poissons
Exploitation [Diversification des productions | U'intwoduction de nouvelles varies de | Zone dnfluence du | + | Maj] Per | ~ Préservation des resources Rydrauiques
spbeulations gréce& 'imigation barage + enforcement des compétences techniques
des producteurs
Développement Cracivités | Disponibiiné des produits et existence de | Zone _GTalluence du] + | Maj | Per | - organisation des fildres de production et d=
Eonomiques rmarchs de consommation barrage, Département de commercalisation
Koulwéogo et ville de
Manga
‘Aceroissement des rovenus des | L'intensifcation de la production agricole ct] Zone influence du | * | Maj_| Per | soutien a la production
ménages augmentation de la production piscicole | barrage ~ appui dla commercialisation
permeitront aux producteurs de vendre ue + développement activites géntratrices de
parte de leur production revenus
24
‘Amelioration de la sitwation | Dispomibiité des produits variés (legumes, | Zone d'influence du] * | Maj] Per | Information, Education et Communication
nutritonnelle fiuits) pour alimentation barrage a (EC) sur la nu
Modification des coulements | L'existence de la digue va diminuer Tex | Aval du barrage May] Te | Protection du cours aval de Ta Fvigre,
et diminution des zones | écoulements A Iaval du barage enforcement des berges
inondables
Destruction du paysage Te dSfichement des zones Cemprans, de Ta | Cuvetie du barge. Maj_| Per |= protection et resturation du couvert
cuvette du barrage et de I'emprise des ouvrages | emprise des ouvrages ct végétal
va détériorer le paysage de la zone des zones d'emprunt = planation d'espéces locales adaptées
= appui & la création de pépiniéres |
villageoises |
Dégradation del faune Ta destruction des quelques rares Tormations | Zone du barrage Maj__| Per | - restauration du couver végeal
forestiéres, implantation des _périmétres - protection des berges |
rmaraichers autour du plan d'eau et la pression
émographique
Porte de surfaces wiles Linondation permanente d'une grande | Emprise des ouvrages et | - | Maj_| Per | Intensification dela production agricole
superficie de teres cultivable et des zones de | du plan d'eau Développement de plates fourragéres
piturage
Pollution des eaux ‘La non maitise de Tutiisation dei produits | Reservoir du barage Moy_| Per | - utilisation de produits homologues 1
chimiques dans agriculture, les déchets ~entretien du plan d'eau
humains, animal et autes déchets solides ~ construction de latrines
= TEC sur Mutlsation des produits agro-
| chimiques
Pression foncigre Ta pression démographique et Tinsuffisance de | Zone d'nfluence du |- | Maj_| Per | - défense et conservation des sols
terres arables et de paturages barrage + promotion de la fumure organique
Dégradation des sols La destruction du couvert végétal, cevtaines Maj_| Te | ~ realisation d’ouvrages de DRS-CES
‘mauvaises pratiques eultraes et le pitinement = vulgarsation de techniques agrcoles
des animaux augmente lérosion hydrique des = restauration du couvert végétal
sols = délimitaion de couloirs de passage des
Prévalence Glevée di | La proliferation de moustiques du fat des eaux | Zone du _bamage et |- | Maj | Per | -IECsurla same
paludisme ct de maladies | siagnantes, le déficit d'hygigne et | surtout chez les enfants - utilisation des moustiquairesimprégnées
siarthéiques. 'assainissement, la consommation directe de = consommation d'eau potable et d’aliments
| Neau du barage et des aliments soils. ropres
| "= utilisation de latrines
Réduction de Ta diversité | La dificult de remonter Te cours eau. Ia | Rvervoir du barage et’ |- | Moy] Per ] Création passe d poisson
spécifique du peuplement | diminution de la vitesse du courant & I'aval a | aval + Protection des berges
ichtyologique réduit le développement des espéces rhéophiles = Aménagement pissicole de zones fayéres
au profit des espéceslentiques
25
3° PARTIE: LE PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET
SOCIAL
IV. MESURES ET ACTIONS
Lilaboration des mesures environnementales dans le cadre de la construction du barrage hydro
agricole, tient compte des lois et réglements en vigueur au Burkina Faso ayant trait a environnement.
Elles ont été élaborées a partir d'une démarche participative, tenant compte des préoccupations réelles
des populations locales. Par ailleurs, la liste de ces mesures n'est pas exhaustive et pourra étre
améliorée au fur et & mesure de la mise ceuvre des actions sur le terrain, Concernant certaines
situations de compensation, de dédommagement ou d'indemnisation reconnues dans ce genre de
situation ct évoquées par les populations lors des entretiens de groupe, il convient de remarquer
qu’elles sont prises en compte dans les évaluations du PGES ci-dessous établies..
4.1 Milieu biophysique
4.1.1 Climat de la zone
Pendant les travaux de réhabilitation, pour diminuer 1a pollution de lair, le cahier de charges &
Ventreprise devra étre explicite et strict quant a l’arrosage des pistes qui seront empruntées par les
‘engins afin de diminuer la concentration de poussiére lors de leurs passages.
Pour atténuer l’effet de la ventilation lors de l'exploitation du barrage, il est nécessaire de planter des
brises vent tout au plus le long du plan d'eau. Cela peut étre facilité par la création d'une pépiniére
villageoise pour produire les plants qui seront composés pour lessentiel de plantes locales utilitaires.
4.1.2 Eaux de surface
Les risques de colonisation rapide du bassin versant par des champs et parfois méme dans la cuvette
devront étre prévenus par la délimitation dune bande (boisée) de 100 m au moins au-dela de laquelle
aucune parcelle de culture ne pourra étre mise en valeur. Les produits agrochimiques qu’ uiliseront les
producteurs devront étre contr6lés surtout leur provenance et les dosages par les services techniques
compétents. La construction de latrines dont le village est actuellement dépourvu et la délimitation de
zones d'aceés des animaux au plan d'eau permettront d’éviter les risques de concentration parasitaire
de l'eau de la retenue. Il est indispensable de sensibiliser les populations afin qu’elles évitent de
consommer directement I’eau de la retenue.
4.1.3 Eaux souterraines
La pression démographique qu’engendreront les mouvements de populations suite a la mise en valeur
du plan d'eau et les nombreuses activités anthropiques qui s’en suivront menaceront en permanence la
qualité des eaux souterraines avec des risques élevés de pollution de ces eaux. Les nappes souterraines
sont alimentées par linfltration des eaux de surface et si des mesures sont prises temps pour ne pas
polluer & la surface, les eaux souterraines seront épargnées. Une analyse périodique de la qualité des
eaux de forages et des puits devra a cet effet étre entreprise.
4.1.4 Sols
L’érosion hydrique qui pourrait survenir suite a exploitation du barrage et des ouvrages annexes
diminuera la fertilité des sols et les rendements. Des actions de défense et de restauration des sols
(DRS) ainsi que de conservation des eaux et des sols (CES) devront étre menées par la réalisation de
seuils antigrosifs qui peuvent étre
26
~les diguettes en terre
~ les cordons pierreux ou diguettes isoypses en pierre (les plus répandus)
les digues filtrantes (peu utilisés pour leur coat élevé)
= les techniques végétatives (peu fréquentes).
La vulgarisation de techniques agricoles notamment l'utilisation de furmure organique (réalisation de
fosses fumiéres) devrait remplacer 'utilisation intempestive d’engrais minéraux qui a Ia longue
augmentera [a salinisation et I'acidité des sols. Lorsque les aménagements en aval seront mis en
valeur, les ouvrages d’évacuation des eaux résiduelles d’irrigation devront étre fonctionnels. Lors des
travaux de construction entreprise évitera de rendre les sols purulents (arrosage des pistes de
chantier) et remettra en I’état les zones d’emprunt (Etalage de la terre végétale).
4.1.5 Flore et végétation
La mise en place de ia retenue d’eau va étre précédée du déftichement des sites, ce qui va occasionner
une destruction d’arbres. Ce défrichement doit étre scientifiquement réalisé pour permettre la
valorisation des produits qui en seront issus. Les formations forestiéres & défricher sont relativement
importantes et nécessiteront l'utilisation d’engins lourds pour le dessouchage des arbres de trés gros
diamétres. Vu la proximité de la ville de Tenkodogo, grande consommatrice d’énergie, l’écoulement
des bois de faible diamétre ne devrait pas poser de problémes particuliers ; toutefois, la valorisation
des gros sujets pourrait nécessiter une carbonisation préalable pour laquelle, des producteurs villageois|
devraient étre formés. En tout état de cause, la valorisation du bois des différentes défriches devrait
tre assurée par les communautés villageoises de Koulwéogo avec l’appui institutionnel des services
techniques de "Environnement.
Tout au long des travaux, des actions devront étre prises pour préserver la végétation : on essayera de
remettre les sites dans un état proche de origine (nettoyage du chantier, enlévement des remblais,
remise du sol au niveau initial, etc...). Toutefois, les superficies naturelles détruites pour la
construction du plan d’eau, linstallation des périmétres amont et aval, a coupe de bois de chauffe et
de construction, etc. seront difficiles 4 compenser intégralement par des plantations forestiéres.
Pourtant cet impact majeur doit étre compensé par la restauration des couverts détruits ou dégradés par
la plantation d’espéces utilitaires adaptées (forestiéres ou fruitiéres). Il faudrait pour cel
- limiter le déboisement au strict nécessaire lors de la réalisation des ouvrages
+ planter le long du plan d’eau
+ planter autour des futurs périmétres
- aménager/restaurer des bosquets villageois
Pour la production de plants, il est préférable d'appuyer les communautés villageoises de Koulwéogo
a créer leur propre pépinitre, cela facilitera leurs approvisionnements et contribuera & leur formation.
Les ressources ligneuses doivent faire l'objet de protection surtout par les populations riveraines qui
en sont les premiers bénéficiaires.
4.1.6 Faune
Lors des travaux, des actions de sensibilisation/information devront étre développées pour préserver la
faune terrestre. Les animaux devront étre protégés en interdisant la chasse et le braconnage par le
personnel du chantier durant tous les travaux. Pendant la phase exploitation du barrage, des actions de
reforestation de la zone créeront des habitats pour les espéces aviaires locales et migratoires. La
plantation d’espéces ripicoles sur les berges créera des zones frayéres pour les géniteurs de poissons ce
qui entrainera le repeuplement des niches écologiques manquantes.
7
4.2 Milieu socio-économique
4.2.1 Agriculture
‘intensification de agriculture sur le périmétre isrigué par Ia promotion de nouvelles technologie
permet d’améliorer les rendements et du méme coup les revenus des populations. Cependant il est
nécessaire de former les producteurs aux techniques de production de la fumure organique, de les
appuyer pour Ia construction de fosses fumiéres, d’appuyer et de responsabiliser les organisations des
producteurs. L’appui des producteurs pour Macquisition de petits équipements de travail s'avére
nécessaire pour les accompagner, ceci a un double avantage savoir la mécanisation de l’agriculture et
allégement du travail des femmes dans les champs.
42.2 Elevage
L*étroitesse des paturages dans la zone fait que certains éleveurs dont des femmes se tournent vers
Vembouche bovine et ovine. L’octroi de petits crédits et la formation des promoteurs pourront
développer d’avantage cette pratique. La délimitation des couloirs de passage facilitera l'accés des
animaux 4 l'eau du barrage. La création et la délimitation de zones pastorales contribueront & sécuriser
davantage I’élevage dans la zone.
4.2.3 Péche
La péche dans le futur lac de barrage de Koulwéogo va changer positivement les conditions de vie et
de travail des différentes communautés de pécheurs évoluant dans la zone d’influence du barrage. Pour
ce faire il est nécessaire
- de procéder dés la mise en eau du barrage, a une interdiction totale de la péche dans le site pendant
‘une durée d’au moins un an. Cette mesure vise a assurer la reconstitution du stock ichtyologique et
permettra par la suite une exploitation piscicole soutenue et durable.
~ de mener des actions de sensibilisation / information des populations riveraines afin de faire prendre
conscience de importance de la péche pour I’amélioration de leur état nutritionnel et pour l'économie
familiale et villageoise d'une part, et d’autre part de porter 4 leur connaissance des dispositions
réglementaires en matiére de péche, Cette information / sensibilisation sera une occasion de les
responsabiliser dans la gestion de la ressource halicutique et la nécessité pour eux de protéger le plan
eau contre les dégradations physiques et les pollutions induites par leurs activités.
- organiser les acteurs de la filigre, afin de mettre en place des organisations professionnelles
Teconnues avec les pécheurs autochtones, au sein desquelles pourront s’intégrer les allochtones. Tout
ceci devra permettre de prévenir les éventuels conflits et de mieux controler et gérer l'activité de péche
dans le plan d’eau,
~ de former les bénéficiaires afin qu’ils s’adaptent aux conditions créées par la péche lacustre. Ainsi,
les pécheurs seront formés en technologie de montage, et de réparation des engins de péche.
+ de réaliser des opé
retenue.
ions dempoissonnement du barrage et soutenir la productivité piscicole de la
4.2.4 Santé
La vulgarisation de utilisation de moustiquaires imprégnées atténuera considérablement la
prévalence élevée du paludisme. Un programme d’imprégnation & moindre cot devra étre mis en
place. L'utilisation des latrines, l'éducation sur les régles d’hygiéne surtout au niveau des femmes qui
28
s'occupent de l’approvisionnement en eau et de la nourriture dans les foyers aura pour conséquence
@ atténuer les maladies diarthéiques notamment chez les enfants.
La prise en charge des cas au niveau des formations sanitaires (dispensaires, CSPS notamment)
doublée des actions de sensibilisation et d'information sur le mode de transmission des maladies
hydriques, les IST et le SIDA (fréquentations de plusieurs marchés par les producteurs) devront etre
effectives sur le terrain,
Tout cela pourra étre fait en étroite collaboration avec l'appui des formations sanitaires.
4.2.5 Commerce
De nombreuses femmes de Koulwéogo font du petit commerce pour subvenir & leurs besoins et a ceux
de leurs familles, Pour elles l'accés a de micro-crédits grace a ’appui de partenaires (banques, ONG,
etc.) serait un avantage pour le développement d'activités génératrices de revenus (AGR) surtout au
profit des femmes,
V. MISE EN EUVRE DU PLAN
5.1 Considérations générales
D’une maniére générale, le PGES comprend cing composantes (cau, flore et végétation, péch
agriculture, élevage) qui s'imbriquent fortement les unes aux autres ; ce qui suppose une cohérence
es différentes activités retenues. Les objectifs principaux du PGES étant d’atténuer & court, moyen et
long terme les effets des impacts négatifs du barrage et de ses ouvrages sur environnement, la
stratégie retenue associe les premiers bénéficiaires & l'ensemble du processus de mise en ceuvre.
5.2 Principes de mise en ceuvre des actions
Les grands principes qui guideront la mise en aruvre du PGES sont principalement axés sur:
= la mise en place d'un dispositif de communication et le développement d'outils de
communication de proximité, étant entendu que la problématique de la gestion durable des
Fessources naturelles de la zone est lige & des questions de mentalités qui nécessitent
d’énormes efforts d'information, de formation et de sensibilisation des populations
~ _laparticipation des bénéficiaires 4 la mise en ceuvre des actions
~ Ia programmation a la base et ’élaboration conjointe des programmes d’atténuation des
impacts
~ la contractualisation des actions (V'approche faire faire) et leur cofinancement (humain,
matériel et/ou financier) avec les principaux bénéficiaires
~ le développement du partenariat et la concertation avec les différents parten:
régionaux au développement
~ la flexibilité dans la démarche c’est-i-dire I'adaptation a I’évolution des contextes
- la préparation des principaux bénéficiaires a la prise en charge des actions a la fin des
interventions du PGES.
's locaux et
5.3 Cadrage institutionnel
La gestion et la coordination du plan devront étre assurées par une structure a deux niveaux.
Niveau _1: Une cellule technique de coordination comprenant les différents démembrements des
services du développement rural dont les services départementaux de I’Agriculture, de
environnement et des ressources animales. Cette cellule sera chargée de gérer au quotidien la mise en
euvre du plan et de coordonner les activités sur le terrain. La cellule est chargée du suivi des activités
et des rapports financiers. Elle entretient des relations avec l'ensemble des acteurs. Cette cellule est
placée sous la tutelle de la Mairic de Koulwéogo a qui elle rend périodiquement compte de l'état
davancement de la mise en ceuvre du plan.
29
‘Niveau 2: Un comité technique ou comité de gestion regroupant les différents partenaires locaux
(bénéficiaires, services techniques déconcentrés, ONG, etc.) sera mis en place et chargé de sassurer
de implication de tous les acteurs, de la répartition des r6les, de la cohérenee et de l'harmonisation
des activités exéeutées et de la bonne utilisation des ressources (humaine, matérielle et financiére),
5.4 Acteurs et leurs roles
Les principaux acteurs de la zone du barrage devant étre impliqués dans la mise en ceuvre des actions
du PGES ont été identifiés lors de l"étude.
‘Tenant compte des structures répertoriées, des problémes et contraintes identifiés dans la zone du
barrage, les rdles et responsabilités des acteurs associés a la mise en auvre du PGES peuvent étre
établies ainsi qu'il suit
SAT Les acteurs locaux
Us regroupent l'ensemble des organisations de producteurs évoluant sur le site du barrage & savoir les
groupements maraichers, de riziculteurs, d’éleveurs, de femmes, de jeunes, etc... Ces acteurs étant les
premiers bénéficiaires des actions du PGES, la mise en ceuvre impliquera fortement les organisations
des producteurs. Ce faisant, avec l'aide des autres acteurs, les producteurs devront
~ prendre conscience a travers leur structure faitiére, de leur responsabilité en matiére de gestion
durable des ressources naturelles de la zone
~ _ développer un partenariat efficace avec les autres acteurs économiques (services financiers,
artisans, commergants) et institutionnels (services techniques, administration, projets,
programmes et ONG ete...)
~ développer leur capacité de maitrise du marché des intrants ainsi que des produits agricoles,
d’élevage et de péche
~ développer leur capacité d'amélioration des systémes de production (rizicole, maraichére,
piscicole, etc.)
~ jouer efficacement leur réle dans application des politiques liées & la protection de
Menvironnement, a la gestion de I’cau, a l'utilisation des engrais et pesticides, etc.
54.2 Les autres acteurs
Ils sont répertoriés dans le tableau n°4 ci-dessous.
‘Tableau n°§ : Les acteurs et leurs rales.
Autres Acteurs
Riles / Prestations attendues
Structures Etatiques
~ Eneadrement technique des producteurs
Animales et Halieutiques
DRAAH - Formation en techniques de CES (digues filtrantes)
Office National “de TEau et de|- Controle de la qualité des eaux
MAssainissement - Entreticn du barrage
= Surveillance sanitaire du bétail
Direction Régionale des Ressources | - Formation des producteurs en techniques de confection du
fourrage
~ Création et balisage des pistes daceés a eau
Direction Régionale de Economic et de la
Planification
~ Appui a la définition des indicateurs du S.E.
Appui A la mise en place de la composante suivi évaluation
‘Administration Territoriale _ (Haut-
Commissariat du Ganzourgou -Préfecture de
Zorgho
~ Appui a la sensibilisation des populations sur la gestion des |
fonds de terre de la zone du barrage
~ Appui a la gestion des conflits
Direction Régionale de Enseignement de
Base et de I'Alphabétisation
~ Appui i la mise en euvre des opérations dalphabétisation
30
Direction Régionale de la Promotion de la
Femme
- Appui 4 la mise en cuvre des activités favorisant la
promotion de la femme
DREEVCC - Formation des producteurs en techniques de production de
plans, d’installation de haies vives
~ Techniques de protection des sols,
~ IBC sur les conséquences de utilisation des engrais et
pesticides
Domaines ~ Appui 4 la mise en auvre de la réglementation du domaine
foncier
Santé ~ Education sur Phygiéne alimentaire et du milica
~ Soins curatifs des malades
Direction Générale des Ressourees |- Appui a la mise en auvre du volet Péche et Pisciculture
Helicutiques
‘Services Financiers: FAARF, FAFPA,
FAW, FAPE.
~ Appui a la satisfaction des besoins en crédits des acteurs
ONG, Projets et programmes
~ Appui & Plaboration et au financement de micro-projels
~ Appui_ au enforcement des capacités des acteurs par
information et la formation
= Appui au développement du partenariat entre tous les acteurs
Autorités coutumiéres et religieuses
~ Appui a Ta sensibilisation des populations sur la gestion des
fonds de terre
~ Apu d la gestion des conflits
5.8 Stratégie de mise en wuvre
La stratégie qui sous-tend la préservation et la
gestion durable des ressources de environnement de la
zone du barrage est dictée par la nécessité d’associcr les populations a la base A la gestion rationnelle
des ressources de leurs terroirs ; c’est pourquoi la mise en
ceuvre du PGES se traduira par la
Participation effective des populations tout au long du processus. Il s'agira de ce fait, d’assurer aux
Principaux acteurs une participation consciente, responsable et permanente, ceux-ci devant jouer un
role primordial dans la restauration de l"environnement du barrage tant au niveau individucl, familial
que collectif.
La démarche qui semble la
plus indiquée pour permettre une grande mobilisation des populations est
obtenir d’abord leur accord et leur adhésion sur le processus & initier et ensuite les associer & toutes
les étapes de la mise en czuvre des actions du PGES. Cette démarche s’articule autour de trois
principales phases :
- Ja premiére a trait & l'information et Ja sensibilisation des acteurs qui consistera & organiser des
stances de restitution du PGES. Ces séances seront l'occasion de revenir sur les causes et les effets de
la dégradation de l'environnement suite & la création du barrage,
annexes, les solutions préconisées et le r6le qu
datténuation des effets. Ces actions d’information et
du périmétre irrigué et des ouvrages
st Ie leur dans Ia mise en ceuvre des actions
de sensibilisation devront viser 4 les rendre plus
sensibles aux effets négatifs et & les motiver pour les actions & entreprendre pour les résoudte,
z, la seconde phase consistera & accentuer leur prise de conscience sur la nécessité absolue de
S‘organiser en structure faitiére pour améliorer
premier dans la mise en ceuvre du PGES.
jeur cadre et conditions de vie et jouer un réle de
~ la troisiéme phase consistera a la mise en place de mécanismes légers de communication entre la
Structure faitiére des acteurs locaux, les structures techniques, la Maitic et la Préfecture, a instauret le
dialogue ; toute chose qui facilitera un nouvel aménagement
antigrosives ; reboisements, aménagements irrigués, etc.),
faisant ressontir les activités retenues dans le cadre du PGES
tun calendrier saisonnier.
de Ia zone du barrage (zones d'actions
Ta négociation d’um planning villageois
et les périodes de leur réalisation suivant
31
Comme on le constate, Pobjectit de cette démarche est de partir du dynamisme propre aux populations
turales et de la cohésion sociale villageoise, pour favoriser la mise en @uvre d'activités de
développement et de préservation de l'environnement reflétant les besoins individuels et collectifs et
assurant la pérennité des actions d’autopromotion,
Au terme des entretiens organisés avec les populations de Koulwéogo, il est ressorti que si le projet de
création du barrage voyait le jour, il faudrait élever leurs compétences dans les divers domaines
activités. La réussite des actions nécessite dés lors un renforcement des capacités structurelles et
organisationnelles des producteurs. Les domaines d’appui retenus sont les suivants
5.5.1 Information, Education, Communication (LEQ)
I couvre deux aspects fondamentaux que sont l'information et la sensibilisation. L'information et la
pré-sensibilisation déja entamées au cours des assemblées villageoises sont des actions a privilégier et
4 poursuivre dans le cadre de la mise en ceuvre du PGES. Celles-ci sont justifies par les contraintes et
difficultés ayant trait a:
= Ia dégradation des sols et Ia divagation des animaux
~ laméconnaissance des regles élémentaires de santé et d’hygiéne
~ _ laméconnaissance des problémes environnementaux causés par l'exploitation des berges
Ja mauvaise utilisation des intrants et des pesticides
= ete,
Des programmes d'information et de sensibilisations des populations peuvent étre organisés selon les
compétences des partenaires soit a leurs lieux de travail (Poste de santé) soit sur le terr
5.5.2 Formation
Le renforcement des capacités en matiére de formation couvre les aspects suivants :
= Ia formation a la vie associative
~ Ia formation a la gestion des fonds des groupements
~ a formation en techniques de production du compost
~ Ia formation en technique de production de plants et gestion des pépinires
~ Ia formation en gestion de l'eau
~ Ia formation en techniques de péche et de pisciculture
~ Ia formation en montage de dossiers de financement.
Tous les acteurs, chacun dans son domaine, doivent étre pris en compte dans le cadre de l'organisation
de ces formations.
5:
3 Appui institutionnel
I s‘agit de l’appui dans les domaines divers devant permettre une bonne mise en ceuvre du PGES. Le
artenaire privilégié de cet appui institutionnel est Ia Mairie de Koulwéogo. On peut citer également
d'autres acteurs pouvant appuyer les organisations sur le terrain particuliérement les projets et
programmes locaux. Face au faible niveau d’intervention des acteurs la base et la nécessité de les
impliquer pleinement dans la mise en auvre des actions d’atténuation des impacts environnementaux
et sociaux, le renforcement de leurs capacités organisationnelles, institutionnelles, juridiques, de
négociation, etc. par des actions de formation, d’alphabétisation ainsi que des voyages d’échanges
dexpériences s’avérent nécessaires.
56 Systéme de contréle et de s
Les mesures de contrdles et de suivi environnemental visent dune part, la vérification de la justesse
des prévisions et des évaluations de certains impacts, et dautre part, lefficacité des mesures mises en
ceuvre.
Le suivi environnemental permettra de suivre l'évolution de l'état de 'environnement, notamment les
éments environnementaux sensibles et les activités exploitation significatives, a partir d'indicateurs
32
environnementaux et durant les premiéres années (5 ans) de mise en service du barrage. La démarche
adoptée permet de suivre cette évolution a travers certaines composantes des milieux naturels ct
humains affectés par la réalisation du projet. Ainsi, les éléments de suivi identifiés sont mesurables par
des méthodes adaptées et les résultats du suivi refléteront les changements survenus.
5.6.1 Les indicateurs
Cette liste est indicative. Elle constitue une base de paramétres pour le suivi environnemental de la
ise en ceuvre du plan.
Tableau n°6 : Liste indicative des indicateurs environnementaux a suivre
Secteur — Indicateurs i Fréquence | Structure
Hydrologie | Pluviométrie Joumaliére | Direction de la
Débits de crues Jouralier Météorologie
Evolution du niveau de la nappe, 2 fois paran | DGRE
Résultats des analyses (qualité des 2 fois paran | ONEA
= eaux) | |
Erosion et ‘Charge solide 11 fois par 2 DGRE
sédimentation | Superficies aménagees ans DPEEVCC
Z 1 fois par an
Flore, Couverture du sol Tfois paran | DGEFFC
végétation et | Superficies régénérées/restaurées 1 fois par an
faune Richesse floristique, 1 fois par 2
Peuplement en présence, ans
Existence de plantes envahissantes | 1 fois par an
= 2 fois par an
Ressources | Nombre de pécheurs, Tfois par2 | DGRH/DRRAH
halieutiques | Nombre d’étangs ans
| fois par 6
Taille et composition des captures, | mois
1 fois par an
‘Santé Suivi épidémiologique, 1 fois paran | CMA
a Enquétes ménages | fois par an
‘Socio- Enquétes ménages Tfois par2 | Bureaux d'études
économie ans
5.6.2 Cons
Le coat de la mise en ceuvre du suivi/contréle (audit) environnemental sera de 15% du coiit global des
‘mesures du PGES,
5.7 Conditions de succés de la mise en ceuvre
La mise en cuvre du PGES est tributaire d'un certain nombre de conditions a remplir pour latteinte
des objectifs a savoir que :
+ ensemble des acteurs soit sensibilisé pour s’approprier le PGES et impliqué totalement ds sa
mise en ceuvre.
‘+ un suivi constant des actions soit réalisé par les bénéficiaires 4 travers leurs organisations
locales (CVD, Coopérative maraichére, Groupements, ete.). Aussi des mesures de contrale et
de sanction doivent étre appliquées. En effet de maniére consensuelle ces mesures devront étre
33
arrétées et exécutées par les Comités Villageois de Développement ou les bureaux des
groupements sectoriels.
Venvironnement social se maintienne & un niveau favorable qu’il ne connaitra pas de
détérioration significative qui tendrait a annihiler le climat consensuel qui semble régner dans
la localité
M4
Vi.
PLANNING DE MISE
6.1 Planning de mise en euvre
N QEUVRE ET EVALUATION FINANCIERE
La durée du Plan telle que proposée est de cing (5) ans. Le planning ci-dessous préconisé tient compte des enjeux des actions mener dans la zone du barrage
qui doivent faire autant que faire ce peut, 'objet d’actions concertées.
Tableau 7: Planning des activités
1
‘Aménagement des berges
Délimitation et matérialisation d'une bande de protection
Matérialisation visuelle de la bande de protection (haie
vive)
Délimitation et bomage de pistes d'aceés
Restauration et protection du milicu naturel
Défense et restauration des sols (CES/DRS)
‘Reboisement/reconstruction des couverts forestiers
‘Appui aux activités agricoles
Formation en techniques de CES/DRS et fosses fumiéres
Formation en gestion des OP
Acquisition de petits matériels agricoles
Construction de fosses fumiéres
Appui aux activités pastorales
Formation en techniques d’embouche
[Délimitation de couloirs de passage des animaux
[Appui a 'aménagement de zones pastorales
Appui aux activités forestidres
Appui a la création de_5 pépiniéres villageoises
Appui aux activités piscicoles
hangar
Matériel de pesées
feane
wapedeaen
8 Santé
‘Appui pour la construction de latrines familiales et/ ow
publiques
Promotion et appui pour Vimprégnation des moustiquaires
Dédommagement des populations
9 [Suivi
Suivileontrole
Par nécessité
one
36
6.2. Evaluation financiére
6.2.1, Evaluation des concessions perdues
La politique de compensation est basée sur les biens affectés. L’estimation de la compensation des biens perdus
consiste &
+ inventorier les maisons et & les catégoriser notamment ceux qu'on ne peut pas éviter ;
‘© recenser les propriétaires des maisons effectivement touchés (Annexe 3) ;
* négocier avec les personnes affectées des barémes de compensation ou d’indemnisation sur la base
d'une indemnisation ou compensation au cost plein de remplacem
* sur la base de ce baréme, calculer les valeurs des préjudices et dommages subis par les personnes dont
les biens pourront étre affectés ;
estimation des habitations Koulwéogo repose sur les don
ngulaires avec des murs en banco et des toits en tales ;
© les maisons rectangulaires avec des murs en ciment et des toits en tiles
les cases rondes eVou carrés qui se présentent avec des toits en paille
Tableau 8 : Situation des biens perdus
[Tress ~ = Nombre | Cout | Tota
He unitaire
Cases rondes 0 | 75000 3000000
[10 téles 2 200000 | _-400000
| 20 tales | 3 | 300000 900000
22 téles 1330000 | 330000 |
26 téles 2] 360000 | __720000
1] 380000 | __380000 |
“1 [400000 | 400000
36tdles | | 460000 [460000 |
38 téles 1[480000[ 480000
40tdles | 1 | 500000 500000
tg tales | __1{ 1120000{ 1120000 |
oe i s690000 |
| Type de bier
Nombre
Cont
unitaive
Total
sons en dur
f 300000
10 téles = 1400000 400000
12 toles oe 1] 500000 500000
[ 16 téles il ___ 600000
| 20 téles 2| 700000 1400000
| 58 toles | 1{ 2000000 2000000 |
60 tales Eee eee ene eee _1| 2100000 | 2100000 |
115 téles 1 [4200000 “4200000
Total ie 11500000
Totaux 20 190 000
38
6.2.2. Devis estimatif du coat du PGES
‘ableau 9 ; Détail estimatif des coats
ij Coit | Total
RUBRIQUES Unité | Quantité unitaire | And Anz /An3 And Ans (« 1000)
(x 1000)
|tmptantton del etemue 00 0 wo
Travaux de déftiche barrage et fh é = So % 900
ourages annekes,
Amdnatement 236] 138 Q ams
| Bornage de la bande de servitude km 1 13 M3 113. 0 225)
Meza vince aeieato as| | 250 20] 250 0 500
Deion bomage towered | | veo | 2000) 100) 3.000
Poteton des hermes 1900] 100 Q ow
easels ieee|) 300 a a 0
Défense ct restauration des sols
(CES/DRS) contigus aux berges 2 * {08 00 o cai
Retobomentewichnenent des a @ 100 60) a 0 200
Cidatonde ppinigesvitageoises |u| a 1000 1000 0 o| 100
(Appi aux activités pastorales 2000 0 0) 2000
imitation de couloirs de ze
Remeeseere [ely 500 so] af af 500
39
eee eset ese tf cn tI) foe fet fa Je ||) |||brsoof | bol alll o| saa
Sand sa0[ 0] 0 a0
aoe a construttion de latins u s 3 2 o jo |o 1500 4500 3.000 0 0 0 7500
‘Appr pour la promotion des u 50 25 |25 |o |0 100 2500 2500 0 0 0 5000
ite pepe
Dédommagement ** ff 61919)
TOTAL PARTIEL 76 082 6963 oO 0 o 83044
Subeonnde A5 1a
TOTAL GENERAL 98501
** : Voir détail du dédommagement en annexe
40
6.3. Conditions de succés de la mise en @uvre
La mise en ceuvre du PGES est tributaire d'un certain nombre de conditions a remplir pour l’attei
des objectifs & savoir que
* ensemble des acteurs soit sensibilisé pour s’approprier le PGES et impliqué totalement des sa
mise en ceuvre,
© un suivi constant des actions soit réalisé par les bénéficiaires a travers leurs organisations
locales (CVD, Coopérative maraichére, Groupements, etc.). Aussi des mesures de contréle et
de sanction doivent étre appliquées. En effet de maniére consensuelle ces mesures devront étre
arrétées et exécutées par les Comités Villageois de Développement ou les bureaux des
groupements sectoriels.
+ Tenvironnement social se maintienne un niveau favorable qu'il ne connaitra pas de
détérioration significative qui tendrait & annihiler le climat consensuel qui semble régner dans
la localité
CONCLUSION
Liétude d'élaboration d'une NIE du barrage de Koulwéogo et de ses ouvrages a permis, & partir du
diagnostic environnemental, d'identifier et d'évaluer les impacts tant négatifs que positifs des
aménagements sur le milieu environnemental. Ces impacts qui ont &é mesurés pendant la phase des
travaux et exploitation des ouvrages, ont été classés en fonction de leur valeur, intensité et durée.
Elle a aussi permis de montrer que tous les impacts négatifs identifiés sont compensés par les
retombées positives des aménagements notamment en terme socio-économique, d'emplois et
d’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations concemées. C’est pourquoi si les
‘mesures et actions d’atténuation préconisées sont mises en ceuvre, les aménagements constitueront un
péle important de développement du village de Koulwéogo et de la zone d’ensemble du barrage.
Les mesures et actions telles que présentées devraient cependant étre dynamiques et flexibles en ce
sens qu’elles devront étre sujet & des révisions et a des mises a jour périodiques pendant les différentes
Phases de vie des ouvrages. La démarche étant l'approche participative, les populations riveraines
devront étre au centre de chaque étape de leur mise en ceuvre. Des enseignements et des informations
pourront étre tirés réguligrement en vue de recentrer les actions chaque fois que de besoin, ce qui du
reste permettra d'améliorer les méthodes de prévision des impacts a moyen et long terme du projet sur
le milieu naturel et social.
al
BIBLIOGRAPHIE
ADP ; 1996, Réorganisation agraire et fonciére
BALJOT E. et al ; 1994, Aspects hydrobiologiques et piscicoles des retenues d’eau en zone soudano-
sahélienne. Publ. CCE/CTA Wageningen. Pays Bas.
GIRE, 2001. Dossier technique sur la pollution du Massili, Présenté a la réunion du Comité aval du
bassin hydrographique du Nakanbé.
MAHRH ; 2005, Programme d’Appui au Développement du secteur Agricole aur Burkina Faso,
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE INITIALE (« Environmental screening ») version finale.
MARA, Plan d’Action pour le Financement du Monde Rural, 1997
MEE, Code de I’ Environnement, 1997
MEE, Code Forestier, 1997,
MEE, La loi d'orientation relative a la gestion de l’eau, 2001
MEE, Politique et stratégie en matiére d’eau, 1998
MEE, Politique Forestiére Nationale, 1998
MEF, La Lettre de Politique de Développement Rural Décentralisé (LPDRD )
MEF, Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, 2000
MEF, CSLP, Rapport de mise en ceuvre 2001, 2002
MEF, La Lettre d’Intention de Politique de Développement Humain Durable (LIPDHD) ;
OUEDRAOGO S. M. ; 2002. Avant Projet Détaillé de I’Etude d’Impact sur |"Environnement a la
V'aval du barrage de Ziga ; ONEA - AGRER / SOCREGE.
OUEDRAOGO S. M. ; 2003. Etude d’un programme de réhabilitation et de mise en valeur de petits
barrages. Etude additionnelle d'un plan de gestion de l'environnement. Aspects terrestres et
aquatiques.
OUEDRAOGO S. M. ; 2002. Réalisation d’études de barrages et d’aménagements hydro-agricoles.
Elaboration de Notice d’impact sur l'environnement. Ministére de I’ Environnement et de I’Eau /
Direction Générale de I'Hydraulique. Bureau-conseil EMMERGENCE
UICN, 2000. Vers une gestion durable des plaines d'inondation sahélienne. Groupe d’experts sur les
plaines dinondation sahéliennes (GEPIS).UICN, Bureau régional pour l’Afrique de |'Ouest.
PNLP ; 2001: Plan Stratégique pour la Lutte contre le Paludisme au Burkina Faso 2002-2005
OMS ; 2001: Initiative « FAIRE RECULER LE PALUDISME »,
Ministére de P Environnement ; 1999 : Etude d’impact sanitaire du barrage de Bagré)
UNESCO ; 1987 : Evaluation environnementale intégrée du développement des ressources en eau: directives
‘méthodologiques. PNUE. Paris, 196 p.
42
ANNEXES
Annexe 1 : Devis estimatif détaillé des coats du dsdommagement des Personnes
Affectées par le Projet de construction du barrage
Colt total
ons 20 190 000
Cases de voutenubicane (Greners, magasins et cuisines) 0 800000 800 000
HangarsHabitas gros ruminants 10 30-000 300 000
Poalallers 3 30.000 150-000
Enclos 3 20000) 100-000
i 5 70.000) 350 000
Sous-oial 1 21 890 000
Manguicrs 30 15.000 450 000
‘Arbes non utlitaires (acemirs, accacias, evcalypes) 40 10 000 300 000)
Papayers 10 15000 150 000
Sous ttal2 1000-000
Dotation en engrais 100 17500] 1750000
Foumiture de semences améliorées 1000 1500[ 1500000
Location de camion pour déménagement 18 60 000 900 000
Appui aux familles vulnérables (AGR) 20 150000] 3.000.000
‘Sous-total 3
Puits
50 000
7.130 000
250.000
Forages
{6.000 000
6 000 000
us-total 4
Prise en charge opérateur
|
10 000 000
6 250.000
10.000 000.
Renforcement des eapacités des acteurs
10-000 000
10-000 000,
Sous-total 5
Imprévus (1
|
10 000 000)
5629 000,
‘Total Global
61919 000
44
Annexe 2: MODALITES D’EXPROPRIATION/INDEMNISATION
ET DE SUIVI DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE
PROJET DE CONSTRUCTION DU BARRAGE DE
KOULWEOGO
|. PRINCIPES DIRECTEURS
1. Eviter ou minimiser les déplacements involontaires autant que possible ;
2. Eviter la destruction de cultures sur pied ou de tout autre bien et la réquisition de
terres dans toute la mesure du possible, en étudiant toutes les options viables
pour la conception du projet, par exemple, en modifiant le tracé des routes ;
3. Concevoir et mettre en ceuvre des activités de recasement et de compensation
dans le cas oti l'acquisition ou la réquisition de terres et le déplacement ne
pourraient étre évitées ;
4. Les personnes déplacées et compensées doivent étre effectivement consultées
et avoir 'opportunité de participer a la pianification et a la mise en pratique des
programmes de déplacement forcé et de compensation financiére ; ce qui a, par
ailleurs, lavantage de contribuer @ assurer la transparence des transactions et
celle des rapports entre les populations et les exécutants du projet ;
5. Dans le cas ot la compensation consisterait en l'octroi d'une nouvelle terre, celle-
ci doit étre une terre sécurisée non grevée de colits, taxes ou autres surcharges
financiéres pour les populations affectées ;
6 Les personnes déplacées et compensées doivent étre assistées dans leurs
efforts pour améliorer leurs moyens d'existence et leurs niveaux de vie ou du
moins les rétablir, en termes réels a leur niveau d’avant le déplacement ou a celui
d'avant la mise en ceuvre du projet, selon le cas le plus avantageux pour elles ;
7. Labsence de droits légaux concernant les biens perdus ne doit pas priver les
populations affectées de compensation et de mesures de réhabilitation ;
8 Le recasement et/ou la compensation s'applique a toutes les composantes du
projet, @ toutes les personnes déplacées, quel que soient leur nombre total, la
sévérité des impacts ;
9. Une attention particuliére doit étre portée aux besoins des groupes vulnérables
parmi ces personnes déplacées : particuliérement ceux vivant sous le seuil de
Pauvreté, les personnes sans terres, les personnes agées, les femmes et les
enfants, les personnes isolées et sans soutien, les minorités ethniques ;
10. Ne pas commencer les travaux de génie civil avant la fin du recasement et de la
compensation des personnes affectées.
TEXTES ET PROCEDURES REt
COMPENSATION AU BURKINA
ANT L’EXPROPRIATION ET LA
2.1. Textes régissant l'expropriation et la compensation au Burkina
Au Burkina Faso, l'expropriation a des fins @'utilité publique, comme c'est le cas de la construction et
de aménagement des retenues d’eau, est régic par les textes législatifs suivants
‘+ Laconstitution du 2 juin 1991, révisée par Ia loi n°001-2002/AN du 22 janvier 2002 : en tant que
loi supréme pose le droit a la propri ndemnisation en cas d’expropriation. Elle dispose
«le droit de propriété est garanti. Nul ne saurait étre privé de sa jouissance si ce n'est pour cause
dutilité publique et sous la condition d une juste indemnisation fixée conformément d la loi».
+ Laloi n°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation Agraire et Fonciére au Burkina Faso
€t ses textes d'application : pose les principes généraux, les modalités de expropriation, le
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Johnson Spencer-L'alpinisteDocument77 pagesJohnson Spencer-L'alpinistearmel simporeNo ratings yet
- 3.1. FAO Arbre A SolutionsDocument11 pages3.1. FAO Arbre A Solutionsarmel simporeNo ratings yet
- 202 5-16757Document81 pages202 5-16757armel simporeNo ratings yet
- Sam Raksha N 2021Document2 pagesSam Raksha N 2021armel simporeNo ratings yet
- Suivi Passe A Bassins 2011Document37 pagesSuivi Passe A Bassins 2011armel simporeNo ratings yet
- Manuel DartDocument81 pagesManuel Dartarmel simporeNo ratings yet
- Trajec3D Manual and GEM4D Training: Oscar WildeDocument4 pagesTrajec3D Manual and GEM4D Training: Oscar Wildearmel simporeNo ratings yet
- GEM4D Building Map3D Models in GEM4DDocument5 pagesGEM4D Building Map3D Models in GEM4Darmel simporeNo ratings yet
- GEM4D Comparing Hydraulic Radius and Radius FactorDocument5 pagesGEM4D Comparing Hydraulic Radius and Radius Factorarmel simpore100% (1)