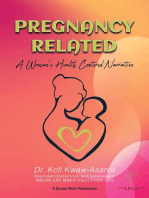Professional Documents
Culture Documents
These Final Laryngomalacie Baziemo 12.0
These Final Laryngomalacie Baziemo 12.0
Uploaded by
BAZIEMO Auguste Magloire AristideCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
These Final Laryngomalacie Baziemo 12.0
These Final Laryngomalacie Baziemo 12.0
Uploaded by
BAZIEMO Auguste Magloire AristideCopyright:
Available Formats
BURKINA FASO
**********
Unité-Progrès-Justice
*********
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
**********************
UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SCIENCES
DE LA SANTE (UFR/SDS)
***********
SECTION MEDECINE
ANNEE UNIVERSITAIRE : 2022-2023 THESE N° : 153
LARYNGOMALACIE :
ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES, DIAGNOSTIQUES ET
THERAPEUTIQUES DANS LA VILLE DE OUAGADOUGOU
Thèse présentée et soutenue publiquement le 23/03/2023 à 10h30 mn
Par
BAZIEMO Auguste Magloire Aristide
Né le 06/09/1995 à Ouagadougou (Burkina Faso)
Pour l’obtention du grade de Docteur en Médecine (Diplôme d’état)
Directeur de thèse PAGE DE GARDEdu jury
Présidente
Pr Moustapha SEREME Pr Yvette Marie Chantal GYEBRE
Co-Directrice de thèse Membres du jury
Dr Christine MEDA Pr Moustapha SEREME
Pr Solange OUEDRAOGO/YUGBARE
LISTE DES RESPONSABLES ADMINISTRATIFS ET DU
PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’UFR/SDS
LISTE DES RESPONSABLES
ADMINISTRATIFS ET DU PERSONNEL
ENSEIGNANT DE L’UFR/SDS
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans II
la ville de Ouagadougou
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans III
la ville de Ouagadougou
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans IV
la ville de Ouagadougou
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans V
la ville de Ouagadougou
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans VI
la ville de Ouagadougou
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans VII
la ville de Ouagadougou
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans VIII
la ville de Ouagadougou
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans IX
la ville de Ouagadougou
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans X
la ville de Ouagadougou
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XI
la ville de Ouagadougou
DEDICACE
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XII
la ville de Ouagadougou
DEDICACE
Nous dédions cette thèse :
▪ A DIEU le père tout puissant
Je rends grâce pour le souffle de vie et pour tous ses bienfaits. Mon parcours, loin
d’être parfait, est une bénédiction et je ne cesserai de louer le Seigneur pour ce
qu’il a déjà fait, ce qu’il fait et ce qu’il fera. Puisse t’il bénir ce travail afin qu’il
porte fruit pour la gloire de son nom.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XIII
la ville de Ouagadougou
▪ A mon père Alphonse BAZIEMO
Un homme intelligent et intègre qui m’a transmis, au-delà de ses traits de
caractères génétiques, des valeurs qui guident ma vie. Vous n’avez ménagé aucun
effort pour que je puisse arriver à ce stade de mon parcours. Mon souhait est que
vous soyez fier de votre fils. Puisse le Seigneur vous donner longue vie afin que
vous puissiez profiter des fruits de votre labeur.
▪ A ma mère Marie Simone YAMEOGO
A ma chère et tendre mère, une femme battante, altruiste et bienveillante. Vous
m’avez inculqué l’amour du travail bien fait, la modestie et le don de soi pour la
famille. Merci pour cet amour dont vous m’avez bercé depuis votre sein. Je
n’imagine pas ma vie sans une mère comme vous. Que le Seigneur vous comble
de ses grâces et vous permette de voir grandir votre progéniture.
▪ A ma tante Marie Rose BAZYOMO
Une mère n’est pas uniquement celle qui donne vie, mais c’est aussi celle qui aime
et prend soin d’un enfant. Vous avez été cette mère et je n’ai pas les mots justes
pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Seul DIEU vous le
rendra au centuple et je vous en serai éternellement reconnaissant.
▪ A ma grande sœur Patricia KOALA
Une sœur bienveillante qui est une véritable source d’inspiration pour moi. Une
femme battante, courageuse et audacieuse dont le parcours a été parsemé de
beaucoup d’obstacles. Tu as su relever tous ces défis et je te remercie d’être ce
modèle vivant qui m’inspire à toute épreuve. Je suis fier d’être ton frère cadet et
je prie le Seigneur pour qu’il nous accompagne dans tous les projets familiaux
que nous allons réaliser ensemble.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XIV
la ville de Ouagadougou
▪ A mon frère Lionel Gildas BAZIEMO
Un frère, un ami, un complice, tu l’as été et tu l’es toujours. Une personne très
intelligente, pleine de vie et de qualités pour qui la vie n’a pas toujours été un long
fleuve tranquille. Même si je ne l’exprime pas, je te témoigne un grand amour.
Puisse le Seigneur t’accorder ses grâces pour que nous rendions nos parents fiers
de nous.
▪ A mon parrain Maurice BAZEMO
Vous qui, par votre parcours universitaire, avez été une source d’inspiration pour
moi, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Cette œuvre vous est
également dédiée car vous n’avez cessé d’être présent à mes côtés. Vos conseils
ont été inestimables dans l’aboutissement de ce travail. Que le Seigneur vous
bénisse abondamment.
▪ A mes oncles et tantes
Vous avez été d’un soutien énorme dans mes moments difficiles malgré vos
propres difficultés. Je pense tout particulièrement à mes oncles Appolinaire, Igor,
Euloge, Joseph, Paul, Grégoire, Vincent et à ma tante Christine. Soyez-en
remerciés du plus profond de mon cœur. Que le Seigneur bénisse abondamment
vos progénitures respectives.
▪ A mes cousins et cousines
Vous avez été à mes côtés tout au long du parcours par vos encouragements et vos
soutiens multiformes. J’ai une pensée particulière pour Micheline, Anani et Jean
Noël. Que le Seigneur nous donne la grâce de rendre notre grande famille
prospère.
▪ A ma fiancée Aicha GANEMTORE
Pour tes sacrifices consentis, je te suis reconnaissant. Merci pour tout l’amour que
tu me portes. Que le Seigneur préserve notre attachement mutuel..
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XV
la ville de Ouagadougou
▪ A mes amis
Vous, avec qui j’ai partagé des moments de joie, de tristesse, de désespoir et de
désespérance, je ne saurai vous exprimer la fierté que j’ai de vous compter parmi
mes amis. Tous, aussi dynamiques que compétents, je n’ai aucun doute sur vos
capacités individuelles à accomplir de grandes choses. J’ai une pensée particulière
pour Arthur, Caleb, Christian, Enoch, Modeste, Rodrigue, Romaric, Salomon et
Stéphane. Puissions-nous renforcer nos liens d’amitié.
▪ A mes promotionnaires du Groupe Scolaire Saint Viateur en Médecine
Tous issus de la promotion du BAC D 2014 au Groupe Scolaire Saint Viateur,
nous avons entamé ensemble ce parcours parsemé d’embûches. Nous avons su
compter les uns sur les autres pour avancer ensemble dans les moments difficiles.
Que le Seigneur accorde à chacun une carrière professionnelle prospère et
accompli.
▪ A notre famille d’internat
Partager la période la plus importante de notre formation médicale a été une
occasion pour moi de connaître davantage de personnes exceptionnelles,
dévouées et qualifiées. Nous avons relevé des défis ensemble durant ce parcours
et j’espère qu’on gardera cette confraternité dans l’exercice de nos futures
fonctions.
▪ A mes camarades, collègues et connaissances
A toutes les personnes dont les noms n’ont pu être cités, soyez convaincues que
je ne vous ai pas oubliées. Pour vos encouragements durant toutes ces années,
soyez-en remerciées.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XVI
la ville de Ouagadougou
REMERCIEMENTS
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XVII
la ville de Ouagadougou
REMERCIEMENTS
Nos remerciements vont :
▪ Au corps enseignant et au personnel administratif de l’UFR/SDS
Nous avons une profonde gratitude pour votre dévouement dans
l’accomplissement de vos tâches respectives. Puissiez-vous poursuivre cette
noble mission dans la formation des futurs médecins à venir.
▪ A notre Directeur de thèse Pr Moustapha SEREME
Nous sommes très sensibles à l’honneur que vous nous avez fait en acceptant
diriger cette thèse malgré vos multiples postes de responsabilités et occupations.
Par votre rigueur scientifique et votre parcours, vous nous inspirez à bien d’égard.
Recevez cher Maître, nos sincères remerciements et notre profond respect pour
tout ce que vous incarnez.
▪ A notre co-directrice de thèse Dr Christine MEDA
Nous ne saurons avoir les mots justes pour vous exprimer notre gratitude à vous
qui avez accepté utiliser votre temps et votre énergie pour nous permettre
d’achever ce travail. Que le Seigneur vous bénisse et vous rende au centuple vos
bienfaits.
▪ A tout le personnel du service d’ORL/CCF du CHU de Bogodogo
Nous vous adressons collectivement nos sincères remerciements. Votre
professionnalisme et votre accueil nous a permis de mener à bien cette étude dans
un environnement convivial. Nous avons une pensée particulière pour Mme
BALIMA. Puisse le Seigneur vous accompagner dans l’accomplissement de vos
tâches quotidiennes au profit des patients.
▪ Aux DES du service d’ORL/CCF du CHU Bogodogo
Vous nous avez apporté votre disponibilité et vos conseils en tant qu’aînés. Merci
à tous et tout particulièrement à Dr KABA.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XVIII
la ville de Ouagadougou
▪ A tous nos enseignants du primaire et du secondaire
Vous qui nous avez fourni les bases nécessaires afin que nous parvenions à ce
niveau de notre parcours, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour la
qualité de l’enseignement reçu. Nos remerciements s’adressent plus
spécifiquement au Père Jocelyn DUBEAU, à Mr KINDA (in memorium), à Mme
GUIGMA et à Mme TRAORE.
▪ A tous ceux qui n’ont ménagé aucun effort pour nous accompagner
d’une manière ou d’une autre
Que le Tout puissant vous le rende au centuple.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XIX
la ville de Ouagadougou
A NOS MAITRES ET JUGES
A
NOS MAITRES ET JUGES
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XX
la ville de Ouagadougou
A notre Maître et Présidente de jury, le Professeur Yvette Marie Chantal
GYEBRE
Vous êtes :
▪ Professeur titulaire en ORL/CCF à l’UFR/SDS de l’Université Joseph KI-
ZERBO ;
▪ Médecin ORL et Chirurgienne Cervico-Faciale au Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado OUEDRAOGO ;
▪ Chef de service d’ORL/CCF du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado
OUEDRAOGO.
Cher Maître,
Nous sommes touchés par l’honneur que vous nous faites en acceptant de présider
ce travail malgré vos multiples occupations.
Vos grandes qualités humaines, votre gentillesse, votre disponibilité, votre rigueur
et votre compétence font de vous une éminente femme de science, ayant fasciné
et continuant de nous fasciner. Soyez rassurée de notre profonde gratitude. Que
Dieu vous protège et vous bénisse abondamment ainsi que votre famille.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XXI
la ville de Ouagadougou
A notre Maître et directeur de thèse, le Professeur Moustapha SEREME
Vous êtes :
▪ Professeur titulaire en ORL/CCF à l’UFR/SDS de l’Université Joseph KI-
ZERBO ;
▪ Chef de service d’ORL/CCF du CHU de Bogodogo ;
▪ Médecin Colonel des Forces Armées Nationales du Burkina-Faso ;
▪ Directeur Central des Services de Santé des Armées ;
▪ Médaillé d’honneur militaire ;
▪ Secrétaire Général de la société burkinabè d’ORL (SO.B.ORL) ;
▪ Chevalier de l’Ordre de l’Etalon.
Cher Maître,
C’est un immense honneur pour nous que de vous avoir côtoyer tout au long de
notre travail en tant que directeur de thèse. Nous vous exprimons de nouveau,
notre profonde gratitude pour avoir disposé de votre temps pour nous encadrer
malgré vos nombreuses sollicitations. Votre amour du travail bien fait et votre
rigueur sont des qualités que vous nous avez inculquer en tant que Maître.
En tant qu’érudit, reconnu de tous dans votre domaine, notre admiration pour vous
est encore plus grande au regard de vos qualités pédagogiques, vos compétences
professionnelles et managériales et votre grande modestie malgré votre rang.
Recevez nos sincères remerciements et que DIEU vous accorde une longue vie,
au vu de tout ce que vous consentez comme sacrifice pour la nation burkinabè.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XXII
la ville de Ouagadougou
A notre maître et juge, le Professeur Solange OUEDRAOGO/YUGBARE
Vous êtes :
▪ Professeur titulaire de pédiatrie à l’UFR/SDS de l’Université Joseph KI-
ZERBO ;
▪ Médecin pneumologue-pédiatre au Centre Hospitalier Universitaire de
Bogodogo ;
▪ Chef de service de Pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire de
Bogodogo
Cher Maître,
Nous sommes particulièrement sensibles à l’honneur que vous nous faites en
acceptant de juger ce modeste travail. Votre facilité d’approche, votre amabilité,
votre générosité et votre amour pour l’excellence, font de vous un Maître admiré
et respecté de tous. Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre profonde
gratitude. Puisse Dieu vous bénir abondamment ainsi que votre famille.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XXIII
la ville de Ouagadougou
AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT
« Par délibération, l’UFR/SDS a
arrêté que les opinions émises
dans les dissertations qui seront
présentées doivent être
considérées comme propres à
leurs auteurs et qu’elle ne leur
donne aucune approbation, ni
improbation »
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XXIV
la ville de Ouagadougou
SIGLES ET
ABBREVIATIONS
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XXV
la ville de Ouagadougou
LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS
% : Pourcentage
BF : Burkina Faso
C4 : Quatrième vertèbre cervicale
C7 : Septième vertèbre cervicale
CCF : Chirurgie Cervico-Faciale
CDD : Circonstance De Découverte
CHR : Centre Hospitalier Régional
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CHU-B : Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo
CHUP-CDG : Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de
Gaules
CHU-T : Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo
CHU-YO : Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO
CM : Centre Médical
CMA : Centre Médical avec Antenne chirurgicale
CMU : Centre Médical Urbain
CSPS : Centre de Santé et de Promotion Sociale
DES : Diplôme d’Etude Spécialisé
DG : Directeur Général
Dr : Docteur
EMC : Encyclopédie Médico-Chirurgicale
HD : Hôpital de District
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XXVI
la ville de Ouagadougou
HTA : Hypertension Artérielle
IAH : Index d’Apnées et d’Hypopnées
IC : Intervalle de Confiance
MCA : Maître de Conférence Agrégé
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
OR : Odds Ratio
ORL : Oto-Rhino-Laryngologie
Pr : Professeur
RDV : Rendez-vous
RGO : Reflux Gastro-Œsophagien
RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat
RPL : Reflux Pharyngo-Laryngé
SAOS : Syndrome d’Apnée Obstructif du Sommeil
SFORL : Société Française d’Oto-Rhino-Laryngologie
SLCE : Stridor Laryngé Congénital Essentiel
SUS : Surveillant d’Unité de Soins
TDD : Type De Description
TDM : Tomodensitométrie
UFR/SDS : Unité de Formation et de Recherche en Science de la Santé
VIP : Very Important Person
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XXVII
la ville de Ouagadougou
LISTE DES
FIGURES ET DES
TABLEAUX
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XXVIII
la ville de Ouagadougou
LISTE DES FIGURES
FIGURE 1 : LARYNX, FORME ET DIMENSIONS ......................................................... 6
FIGURE 2 : CAVITE LARYNGEE – VUE LARYNGOSCOPIQUE DIRECTE ...................... 7
FIGURE 3 : COUPE SAGITTALE PASSANT PAR LE LARYNX DE L’ENFANT ET DE
L’ADULTE ......................................................................................................... 9
FIGURE 4 : COMPARAISON DES FORMES ENTRE UN LARYNX ADULTE ET UN LARYNX
D’ENFANT ....................................................................................................... 10
FIGURE 5 : VUE ENDOSCOPIQUE DU LARYNX DE L’ADULTE ET DE L’ENFANT ....... 11
FIGURE 6 : CARACTERISTIQUES D’UNE LARYNGOMALACIE : EPIGLOTTE EN OMEGA,
REPLIS ARY-EPIGLOTTIQUES COURTS .............................................................. 16
FIGURE 7: CLASSIFICATION DES DIFFERENTS TYPES DE LARYNGOMALACIE ......... 17
FIGURE 8 : ASPECT DE LA SUPRAGLOTTOPLASTIE AU LASER THULIUM ................ 29
FIGURE 9 : DIAGRAMME DE FLUX. ....................................................................... 47
FIGURE 10: REPARTITION DES CAS DE LARYNGOMALACIE CONFIRMES PAR
NASOFIBROSCOPIE EN FONCTION DE L’ANNEE ................................................ 48
FIGURE 11: REPARTITION DES CAS DE LARYNGOMALACIE CONFIRMES PAR
NASOFIBROSCOPIE SELON LES TRANCHES D'AGE ............................................. 49
FIGURE 12: REPARTITION DES PATIENTS EN FONCTION DES SIGNES FONCTIONNELS
....................................................................................................................... 50
FIGURE 13: REPARTITION DES CAS DE LARYNGOMALACIE EN FONCTION DU
CRITERE DE GRAVITE ...................................................................................... 53
FIGURE 14: IMAGE D'UN NASOFIBROSCOPE ................................................. XXXVI
FIGURE 15: VUE ENDOSCOPIQUE PAR NASOFIBROSCOPIE D’UNE LARYNGOMALACIE
CHEZ UN NOURRISSON (14 MOIS) DE SEXE FEMININ MONTRANT UN COLLAPSUS
INSPIRATOIRE SUPRAGLOTTIQUE. ......................................................... XXXVII
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XXIX
la ville de Ouagadougou
LISTE DES TABLEAUX
TABLEAU I: REPARTITION DES PATIENTS SELON LES ANTECEDENTS .................... 50
TABLEAU II: REPARTITION DES CAS DE LARYNGOMALACIE EN FONCTION DES
SIGNES PHYSIQUES .......................................................................................... 51
TABLEAU III: REPARTITION DES CAS EN FONCTION DES SIGNES ENDOSCOPIQUES
RETROUVES A LA NASOFIBROSCOPIE ............................................................... 52
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XXX
la ville de Ouagadougou
TABLE DES
MATIERES
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XXXI
la ville de Ouagadougou
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION ET ENONCE DU PROBLEME........................................ 2
PREMIERE PARTIE : GENERALITES ......................................................... 4
1. Rappels ..................................................................................................... 5
1.1. Embryogénèse du larynx .................................................................... 5
1.2. Anatomie du larynx ............................................................................ 5
1.3. Physiologie du larynx ....................................................................... 11
1.4. Physiopathologie de la laryngomalacie ............................................ 12
2. Signes...................................................................................................... 13
2.1. Type de Description (TDD) : : laryngomalacie mineure du nouveau-
né et du nourrisson ..................................................................................... 13
2.2. Formes cliniques............................................................................... 19
3. Diagnostic .............................................................................................. 23
3.1. Diagnostic positif ............................................................................. 23
3.2. Diagnostic différentiel ...................................................................... 23
3.3. Diagnostic étiologique ...................................................................... 26
4. Traitement ............................................................................................. 27
4.1. But .................................................................................................... 27
4.2. Moyens ............................................................................................. 27
4.3. Indications ........................................................................................ 29
4.4. Résultats et pronostic........................................................................ 29
4.5. Surveillance ...................................................................................... 30
DEUXIEME PARTIE : NOTRE ETUDE ...................................................... 31
1. Objectifs .................................................................................................... 33
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XXXII
la ville de Ouagadougou
1.1. Objectif général ................................................................................... 33
1.2. Objectifs spécifiques............................................................................ 33
2. Méthodologie ............................................................................................ 35
2.1. Cadre de l’étude ................................................................................... 35
2.2. Type et période d’étude ....................................................................... 40
2.3. Population d’étude ............................................................................... 41
2.4. Collecte de données ............................................................................. 41
2.5. Variables d’étude ................................................................................. 42
2.6. Saisie, traitement et analyse des données ............................................ 42
2.7. Considérations éthiques et administratives ......................................... 42
2.8. Définitions opérationnelles .................................................................. 43
3. Résultats .................................................................................................... 46
3.1. Données épidémiologiques .................................................................. 46
3.2. Données cliniques ................................................................................ 49
3.3. Données paracliniques ......................................................................... 53
3.4. Données thérapeutiques ....................................................................... 54
3.5. Données évolutives .............................................................................. 54
4. Discussions et commentaires ................................................................... 57
4.1. Limites et contraintes de l’étude.......................................................... 57
4.2. Aspects épidémiologiques ................................................................... 57
4.3. Aspects cliniques ................................................................................. 60
4.4. Aspects paracliniques .......................................................................... 64
4.5. Aspects thérapeutiques ........................................................................ 65
4.6. Aspects évolutifs.................................................................................. 66
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XXXIII
la ville de Ouagadougou
CONCLUSION .................................................................................................. 67
SUGGESTIONS ................................................................................................ 69
REFERENCES .................................................................................................. 72
ICONOGRAPHIE ..................................................................................... XXXV
ANNEXES .............................................................................................. XXXVIII
SERMENT D’HIPPOCRATE ................................................................. XLVII
RESUME ................................................................................................... XLVIII
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XXXIV
la ville de Ouagadougou
INTRODUCTION
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 1
la ville de Ouagadougou
INTRODUCTION ET ENONCE DU PROBLEME
Les malformations congénitales sont des défauts de morphogénèse d’organes ou
de zones corporelles identifiables. Elles sont relativement fréquentes avec une
prévalence globale à la naissance d’environ 2 à 3% [1]. La topographie laryngée
de ces malformations présente un intérêt au regard de leur potentiel gravité. En
termes de fréquence, la laryngomalacie est la malformation congénitale laryngée
la plus fréquente chez l’enfant [2]. Il s’agit d’une pathologie bénigne dans 80 à
90% des cas [3] qui se définit comme étant un collapsus à l’inspiration des
structures supraglottiques responsable d’un bruit inspiratoire appelé stridor [4].
Même si, l’étiopathogénie de la laryngomalacie reste à préciser, il faut noter que
son diagnostic et sa prise en charge ont bénéficié de l’apport de l’endoscopie au
fibroscope souple et de l’utilisation de laser ORL pour son traitement.
En dépit de la fréquence de cette pathologie difficile à estimer en population car
jugée le plus souvent bénigne et pouvant échapper ainsi à toute investigation,
plusieurs auteurs de la littérature occidentale s’accordent sur le fait qu’elle est la
malformation congénitale laryngée la plus fréquente [5,6].
Aux Etats-Unis, Klinginsmith [7] estimait l’incidence de la laryngomalacie en
population générale entre 1 sur 2000 et 3000 avec un risque de sous-estimation.
Simons [8] quant à lui, notait que la laryngomalacie représentait 58,4% des
anomalies du larynx, de la trachée et des bronches.
Montero en France [9] et Pokharel [10] au Népal notaient que la laryngomalacie
était la première cause de stridor chez le nouveau-né et le nourrisson avec une
prévalence respectivement de 65,7% et 66%. En Russie, Soldatskiĭ [11] retrouvait
des résultats similaires mais avec une prévalence plus élevée de 91,9%. En
Angleterre, Zubair [12] retrouvait une prévalence de 21% de la laryngomalacie
qui était la première pathologie la plus diagnostiquée au cours d’une
microlaryngobronchoscopie.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 2
la ville de Ouagadougou
En Egypte, Mandour [13] notait que la laryngomalacie était l’anomalie
congénitale laryngée la plus fréquente avec 58 cas sur 01 an dont 10% de cas
sévères. Au niveau sous-régional ouest africain, précisément au Mali, Koné [14]
a retrouvé 03 cas de laryngomalacie sur 01 an (2019). Traoré [15] quant à lui,
retrouvait 22 cas soit 2,6% de laryngomalacie parmi les résultats de
nasofibroscopie réalisés au CHU "Mère Enfant Le Luxembourg". Au Sénégal,
N’Diaye [16] notait que la laryngomalacie sévère représentait 3,45% des
urgences pédiatriques ORL et Bahinwa [17] dans une étude prospective retrouvait
50 cas de laryngomalacie sur 8 mois, soit une prévalence hospitalière de 0,6%.
Dans notre contexte, au Burkina Faso, Yélémou [18] dans une étude sur les
malformations congénitales ORL, notait que la laryngomalacie représentait la
malformation congénitale laryngée la plus fréquente (88,4%). Cependant, cette
étude ne précisait pas les caractéristiques socio-démographiques des patients, les
facteurs de risques associés à la survenue de la laryngomalacie ainsi que les
modalités thérapeutiques utilisées dans notre contexte. Ces différents aspects
n’ont pas été abordés par Sanon [19] et Nacoulma [20] dans les études qu’ils ont
menées.
Au vu de la gravité potentielle de cette affection pouvant mettre en jeu le pronostic
fonctionnel et même vital du nouveau-né, nous avons mené une étude sur la
laryngomalacie en milieu hospitalier dans la ville de Ouagadougou afin d’en
décrire les différents aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 3
la ville de Ouagadougou
PREMIERE PARTIE : GENERALITES
PREMIERE PARTIE :
GENERALITES
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 4
la ville de Ouagadougou
1. Rappels
1.1. Embryogénèse du larynx
L’embryon est composé de trois feuillets : l’ectoderme, le mésoderme et
l’endoderme. L’ectoderme donne les racines nerveuses correspondant aux nerfs
crâniens, le mésoderme produit les éléments du tissu conjonctif (os, muscle,
vaisseaux) et l’endoderme donne le revêtement épithélial des voies
aérodigestives. Durant la phase embryonnaire, soit à la 5ème semaine de
développement l’ébauche du larynx est une lame épithéliale laryngée délimitée
par trois éminences mésenchymateuses. D’une part, l’éminence hypo-branchiale,
médiane qui donnera naissance à l’épiglotte. La prolifération exagérée de cette
éminence, entraine un allongement et une extension latérale de la structure
mature ; ce qui donne un aspect en oméga de l’épiglotte fréquemment retrouvé
chez les patients atteints de laryngomalacie. D’autre part, on note deux saillies
latérales dites aryténoïdiennes qui vont se différencier en cartilages aryténoïdes,
cartilages corniculés et en replis ary-épiglottiques primitifs. Une anomalie dans le
développement de ces derniers peut être à l’origine d’un raccourcissement des
replis ary-épiglottiques qui est un signe de la laryngomalacie. Au cours de la phase
fœtale, une immaturité du contrôle neuromusculaire peut être notée avec comme
conséquence un prolapsus aryténoïdien qui est observé dans la laryngomalacie
1.2. Anatomie du larynx [21]
1.2.1. Situation
Organe impair et médian, le larynx est situé dans la gaine cervicale à la partie
médiane et antérieure du cou, en avant du pharynx, en dessous de l’os hyoïde et
au-dessus de la trachée. Sa situation par rapport à la colonne cervicale est variable
en fonction de l’âge et du sexe, il est plus haut chez l’enfant que chez l’adulte.
Son extrémité inférieure se situe en regard du bord inférieur du corps vertébral de
la quatrième vertèbre cervicale (C4).
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 5
la ville de Ouagadougou
1.2.2. Formes et dimensions
Le larynx a la forme d’une pyramide triangulaire à base postéro-supérieure,
répondant au pharynx et à l’os hyoïde. Il présente un sommet inférieur, répondant
à l’orifice supérieure de la trachée.
1.2.3. Constitution anatomique du larynx
Le larynx présente à étudier des cartilages mobiles unis par des articulations et
des ligaments, des muscles et une muqueuse qui recouvre l’ensemble de ces
structures.
Haut
Gauche
1. Os hyoïde ; 2. Membrane hyo-thyroïdienne ; 3. Cartilage thyroïde ; 4.
Membrane crico-thyroïdienne ; 5. Chaton cricoïdien ; 6. Trachée
Figure 1 : Larynx, forme et dimensions [21]
❖ Cartilages du larynx : il s’agit du cartilage thyroïde, cricoïde,
épiglottique, aryténoïde et les cartilages accessoires (cartilages corniculés
ou cartilages de Santorini, cartilages cunéiformes ou cartilage de
Wrisberg, cartilages triticés, cartilage inter-aryténoïdien, cartilages
sésamoïdes antérieurs et postérieurs).
❖ Articulations du larynx : il s’agit de l’articulation crico-aryténoïdienne,
crico-thyroïdienne et ary-corniculée
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 6
la ville de Ouagadougou
❖ Membranes et ligaments du larynx
Les différentes pièces cartilagineuses du larynx sont unies par des membranes
renforcées par des ligaments que sont : la membrane crico-trachéale, la membrane
et les ligaments thyro-hyoïdiens, la membrane et le ligament crico-thyroïdien, les
ligaments de l’épiglotte et les ligaments du complexe aryténoïdien.
❖ Muscles du larynx [22]
Il existe deux sortes de muscles. Les muscles extrinsèques qui vont du larynx aux
organes de voisinage et les muscles intrinsèques qui modifient la lumière de la
cavité laryngée et des cordes vocales.
❖ Configuration interne du larynx [21]
La partie interne du tube laryngé ou endolarynx peut être divisée en trois étages
par rapport au plan des cordes vocales :
- l’étage sus-glottique : il contient l’épiglotte, les replis ary-épiglottiques,
les aryténoïdes, les bandes ventriculaires et le ventricule laryngé.
- l’étage glottique : contenant les cordes vocales et les commissures,
antérieure et postérieure.
- l’étage sous-glottique : qui est limité par les cordes vocales jusqu’à la
partie inférieure du cartilage cricoïde.
Haut
Droite
Figure 2 : Cavité laryngée – Vue laryngoscopique directe [23]
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 7
la ville de Ouagadougou
1.2.4. Revêtement de l’endolarynx [23]
La muqueuse endolaryngée qui repose sur la membrane élastique est constituée
dans son ensemble d’un épithélium de type respiratoire, prismatique cilié.
Cependant, une métaplasie malpighienne occupe progressivement les « zones
d’usure » qui prennent le type pavimenteux stratifié (épiglotte sus-hyoïdienne,
bord libre des bandes ventriculaires et des cordes vocales, replis ary-
épiglottiques).
1.2.5. Vascularisation-Innervation
La vascularisation laryngée provient de trois pédicules : un pédicule supérieur et
deux pédicules inférieurs, tous trois dépendant du système artériel thyroïdien.
- Le pédicule supérieur est formé par l’artère et la veine laryngées
supérieures. L’artère laryngée supérieure est l’artère principale du larynx.
Elle naît de l’artère thyroïdienne supérieure, branche de la carotide externe.
- Le pédicule laryngé antéro-inférieur est formé par l’artère et la veine
laryngées antéro-inférieures. L’artère laryngée antéro-inférieure est une
branche terminale de l’artère thyroïdienne supérieure.
- Le pédicule laryngé postéro-inférieur provient de l’artère thyroïdienne
inférieure.
- Les veines laryngées supérieures se drainent dans la veine jugulaire interne.
Le drainage lymphatique du larynx peut se diviser en trois territoires : un territoire
sus-glottique très volumineux et très dense, un territoire sous-glottique moins
dense et un territoire glottique bien plus pauvre.
L’innervation quant à elle, est assurée par deux branches du nerf vague [23] :
- le nerf laryngé supérieur, nerf essentiellement sensitif, et classiquement
moteur pour le seul muscle crico-thyroïdien ;
- le nerf récurrent qui innerve tous les autres muscles intrinsèques du larynx
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 8
la ville de Ouagadougou
1.2.6. Particularités du larynx de l’enfant
❖ Topographie
A la naissance, le larynx est en position haute entre la première et la troisième
vertèbre cervicale (C1 et C3). Le bord libre de l’épiglotte se trouve très près du
voile du palais ou même à son contact ; ce qui impose une respiration nasale
jusqu’à 4 mois.
Haut
a b
Arrière
1
1
2 2
a) Le larynx de l’enfant 1.Epiglotte
b) Le larynx de l’adulte 2.Voile du palais
Figure 3 : Coupe sagittale passant par le larynx de l’enfant et de l’adulte [24]
❖ Formes
Le larynx de l’enfant a une forme grossièrement conique. Au cours de la puberté,
le larynx augmente rapidement de volume pour acquérir en quelques mois, un
développement presque complet.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 9
la ville de Ouagadougou
Haut
(a) (b)
=) =)
Cartilage Avant
thyroïde
Cartilage
cricoïde
(a) Larynx adulte ; (b) Larynx de l’enfant.
Figure 4 : Comparaison des formes entre un larynx adulte et un larynx d’enfant
❖ Configuration interne
Le diamètre de la filière laryngée varie chez l’enfant [23]. Ainsi, on note :
- Naissance :4 à 5mm
- 6 mois : 6mm
- 18 mois : 7 mm
- 4 ans : 8mm
- 7 ans : 9mm
- 14 ans : 10mm
En plus de l’épiglotte qui est plus haut située chez l’enfant, on note que, par
rapport à l’adulte, l’épiglotte est plus enroulée, les replis ary-épiglottiques plus
courts avec des aryténoïdes proportionnellement plus volumineux chez l’enfant.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 10
la ville de Ouagadougou
Avant
Droite
(a) Larynx de l’adulte : les replis ary-épiglottiques sont longs, l’épiglotte est
dépliée et se projette verticalement
(b) Larynx de l’enfant : les replis ary-épiglottiques sont courts, l’épiglotte est
tubulaire, la sous-glotte est plus ovalaire
Figure 5 : Vue endoscopique du larynx de l’adulte et de l’enfant [26]
❖ Histologie
Au niveau histologique, on note que le larynx, à la naissance, est avant tout
membraneux, plus souple et pliable. Il a tendance à se collaber facilement à
certaines inspirations du fait de pressions négatives endolaryngées importantes.
La partie endoluminale de chaque cartilage laryngé (thyroïde, cricoïde, face
antérieure de l’épiglotte) est recouverte d’une structure fibro-élastique sur laquelle
vient s’appliquer la muqueuse qui est d’une grande laxité, créant des plans de
clivage naturels entre muqueuse et cartilage. Ainsi les zones sus-citées sont le
siège électif des processus œdémateux du larynx de l’enfant.
1.3. Physiologie du larynx [25]
Le larynx intervient dans les fonctions de phonation, déglutition et respiration.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 11
la ville de Ouagadougou
- La phonation : la production de son est dépendante des cordes vocales et
les sons ont des caractéristiques de hauteur, de volume et de résonance.
o La hauteur de la voix dépend de la longueur et du degré de
rapprochement des cordes vocales.
o Le volume de la voix dépend de la force avec laquelle les cordes
vibrent.
o La résonance ou tonalité dépend de la forme de la bouche, de la
position de la langue et des lèvres, des muscles de la face et de l’air
dans les sinus paranasaux.
- La déglutition : le larynx s’élève pendant la déglutition, fermant son
passage avec le pharynx. Cela permet de protéger les voies respiratoires
inférieures en favorisant le passage de la nourriture dans l’œsophage et non
dans la trachée.
- La respiration : le larynx sert de voie de passage de l’air et relie le pharynx
au-dessus et la trachée en-dessous. Il contribue au conditionnement de l’air
inspiré par des processus d’humidification, de réchauffement et de filtrage.
1.4.Physiopathologie de la laryngomalacie
L’origine de la laryngomalacie ou stridor laryngé congénital essentiel est toujours
controversée. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer sa pathogénèse :
- la théorie dite « cartilagineuse » est une conception qui est à l’origine du
terme « laryngomalacie » et a été décrite en 1942 par Jackson et al. Elle
évoque des différences structurelles et de consistance dans les cartilages
des enfants présentant la laryngomalacie. Cette théorie est cependant
réfutée de plus en plus [26].
- la théorie dite « anatomique » suppose que la laryngomalacie est due à
des anomalies de la forme et de la structure du larynx (rapport entre la
longueur des replis ary-épiglottiques et la longueur de la glotte plus petite
chez les patients avec laryngomalacie par rapport aux contrôles sains) [27].
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 12
la ville de Ouagadougou
- la théorie dite « neurologique » suppose qu’une dysfonction
neurosensorielle conduit à un manque de coordination neuromusculaire des
voies aériennes supraglottiques. Une augmentation des seuils sensoriels
laryngo-pharyngés a été observée chez des patients avec une
laryngomalacie[28]. Cette hypothèse est étayée par l’hypotonie quasi-
constante des muscles sous-hyoïdiens entrainant une position basse du
larynx et un défaut d’ascension à la déglutition. Elle est aussi étayée par
l’association fréquente de troubles de la musculature intrinsèque de
l’œsophage avec reflux gastro-œsophagien (80% selon la plupart des
auteurs), et parfois par l’immaturité globale du carrefour aérodigestif avec
troubles sévères de la déglutition.
L’apparition de la symptomatologie résulte de la conjonction à des degrés
variables de plusieurs facteurs favorisants tels que :
- la morphologie supraglottique plus étroite chez le nouveau-né et le
nourrisson
- le défaut de contrôle du tonus des structures supraglottiques et des réflexes
laryngés
- l’œdème muqueux laryngé lié au reflux pharyngo-laryngé ou au
traumatisme des muqueuses lors de l’inspiration
- l’augmentation du débit aérien.
2. Signes
2.1. Type de Description (TDD) : : laryngomalacie mineure du nouveau-
né et du nourrisson
C’est la forme la plus fréquente dans 80 à 90% des cas [3].
2.1.1. Circonstances de découverte (CDD)
Plusieurs circonstances peuvent être à l’origine de la découverte de la
laryngomalacie :
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 13
la ville de Ouagadougou
- les parents qui amènent en consultation un nouveau-né pour respiration
bruyante isolée se manifestant dans les premiers jours de vie.
- une découverte fortuite lors du suivi pédiatrique de l’enfant.
- des complications telles qu’une détresse respiratoire et une dyspnée
laryngée mettant en jeu le pronostic vital du nouveau-né.
2.1.2. Signes fonctionnels
- Un stridor : c’est le signe fonctionnel le plus constant. Il s’agit d’un bruit
inspiratoire secondaire à l’obstruction des voies aériennes supraglottiques
et présentant les caractéristiques suivantes :
o date de début : dans les 10 premiers jours suivant la naissance
o mode de début : installation rapide
o tonalité : aiguë, musicale, vibrant, multiphasique
o facteurs aggravants : agitation, pleurs, alimentation, flexion de la
colonne cervicale, sommeil
o facteurs calmants : respiration calme, décubitus ventral, extension de
la colonne cervicale
- Une difficulté à téter
- Des régurgitations ou vomissements
- Une dysphagie
- Une difficulté respiratoire (dyspnée)
2.1.3. Signes généraux
L’état général est le plus souvent conservé avec des constantes hémodynamiques
stables. On peut cependant noter un retard de croissance staturo-pondérale.
2.1.4. Signes physiques
❖ Examen ORL
Condition de l’examen ORL et matériels : il se fera dans un cabinet de
consultation ORL, comportant au minimum : un siège pour le médecin, un
fauteuil pour le malade muni d’une têtière et orientable dans toutes les directions,
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 14
la ville de Ouagadougou
un meuble de consultation où sont rangés les instruments, une source de lumière
focale, une source d’aspiration, un miroir de gratzel, un spéculum nasal, un
spéculum auriculaire, un miroir laryngé, des abaisse-langues, la xylocaïne
naphtazoline et un équipement d’endoscopie au fauteuil.
Les suites de l’examen ORL comprennent :
- Examen de la peau cervico-faciale
L’inspection et la palpation de la face est tout à fait normal dans la majorité des
cas. L’inspection du cou permet de noter un tirage sus-claviculaire. La palpation
cervicale est normale et ne retrouve pas de masse suspecte.
- Examen rhinologique :
L’examen de la partie antérieure des fosses nasales à l’aide d’un spéculum
nasal et d’un miroir de Clar est le plus souvent normal. Toutefois, elle peut
montrer des fosses nasales congestives avec rhinorrhée d’aspect muqueux ou
muco-purulent.
- Examen de la cavité buccale et de l’oropharynx
A l’aide d’un abaisse-langue, cet examen apprécie au niveau de :
o la cavité buccale : l’état de la denture, des gencives, de la langue et
de la muqueuse buccale.
o l’oropharynx : l’aspect des amygdales et de la muqueuse
oropharyngée.
- Examen laryngoscopique (nasofibroscopie) [29]
La nasofibroscopie est un examen essentiel au diagnostic de laryngomalacie. Elle
utilise des endoscopes souples introduits par une des fosses nasales après
éventuellement une anesthésie locale. Les nasofibroscopes permettent une
analyse précise de la dynamique laryngée, l’examen du cavum, de l’ensemble du
pharynx, de l’étage supraglottique et dans la plupart des cas de la sous-glotte et
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 15
la ville de Ouagadougou
de la trachée jusqu’à la carène. Elle permet de retrouver les signes endoscopiques
suivants dans le cas d’une laryngomalacie :
o un collapsus inspiratoire plus ou moins complet de la sus-glotte
concomitant au stridor ;
o une épiglotte en « chapeau de gendarme » ou en « oméga » ;
o une bascule postérieure de l’épiglotte vers la paroi pharyngée ;
o une bascule antérieure des aryténoïdes ;
o un prolapsus aryténoïdien ;
o des replis ary-épiglottiques courts ;
o des aryténoïdes épaissis ;
o un excès muqueux de la margelle laryngée obstruant partiellement
ou totalement le vestibule laryngé.
Avant
Droite
Epiglotte
en oméga
Repli ary-
épiglottique
court
Aryténoïde
Figure 6 : Caractéristiques d’une laryngomalacie : épiglotte en oméga, replis
ary-épiglottiques courts [30]
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 16
la ville de Ouagadougou
Classification endoscopique
Il existe plusieurs schémas de classification de la laryngomalacie, mais nous
décrirons ici la plus couramment utilisée qui est la classification de Olney[31].
Les trois différents types de laryngomalacie sont décrits ainsi :
- Type I : prolapsus de la muqueuse recouvrant les cartilages aryténoïdes ;
- Type II : plis ary-épiglottiques courts associés à une longue épiglotte en
forme d'oméga qui s'enroule sur elle-même ;
- Type III : épiglotte qui surplombe le larynx et qui se collabe
postérieurement, obstruant l’orifice du larynx lors de l’inspiration.
Avant
Droite
1. Epiglotte ; 2. Corde vocale ; 3. Repli ary-épiglottique ; 4. Cartilage aryténoïde
Figure 7: Classification des différents types de laryngomalacie [31]
- Examen otologique
Il permet d’apprécier l’aspect du pavillon de l’oreille, du conduit auditif externe
et du tympan. Son appréciation est le plus souvent normal mais on peut cependant
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 17
la ville de Ouagadougou
retrouver une déformation du pavillon de l’oreille, un aspect congestif, voire
inflammatoire du conduit auditif externe et du tympan.
- Examen des glandes des aires ganglionnaires
Les aires ganglionnaires sont le plus souvent libres. On peut toutefois mettre en
évidence d’éventuelles adénopathies associées.
- Examen cardio-vasculaire
L’examen de l’appareil cardio-vasculaire recherche à l’inspection, une
déformation thoracique. Une déviation du choc de pointe à la palpation, et une
aire de matité cardiaque anormale à la percussion, doivent être recherchées. A
l’auscultation, la recherche d’une tachycardie ou d’une bradycardie, d’un souffle
cardiaque ou de bruits surajoutés peuvent orienter vers une malformation
congénitale cardiaque.
- Examen de l’appareil respiratoire
L'examen de l’appareil respiratoire recherche à l’inspection, des signes de tirage
intercostal, un entonnoir xiphoïdien, une polypnée ou une bradypnée. A la
palpation, on recherche une anomalie de la transmission des vibrations vocales. A
la percussion, des zones de tympanismes ou de matités anormales doivent être
recherchées. Une anomalie du murmure vésiculaire et la présence de bruits
surajoutés doivent être recherchées à l’auscultation.
- Examen des autres appareils et systèmes
En dehors de la recherche de malformations associées, l’examen des autres
appareils et systèmes (appareil digestif, urinaire, locomoteur, peau et phanère,
système nerveux, système endocrinien, système spléno-ganglionnaire) dans la
laryngomalacie mineure, est le plus souvent normal.
2.1.5. Signes paracliniques
❖ Radiographie du larynx [29]
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 18
la ville de Ouagadougou
La radiographie du larynx de face et de profil n’est plus effectuée
systématiquement, depuis l’apparition des endoscopes souples. Elle révèle dans
les cas typiques une distension des structures supraglottiques témoignant de
l’hypotonie pharyngée. Elle peut toujours avoir un intérêt chez un enfant
présentant un stridor atypique, en révélant une anomalie sous-glottique ou
trachéale (sténose).
❖ La laryngoscopie directe en suspension [3]
Il s’agit d’une intervention chirurgicale qui est réalisée au bloc opératoire, sous
anesthésie générale sur un patient en décubitus dorsal. Sa réalisation n’est pas
systématique et se fait dans les situations suivantes :
o absence de laryngomalacie lors de la nasofibroscopie ;
o existence d’une laryngomalacie avec signes de gravité : la recherche
d’une seconde lésion associée fait partie du bilan anatomique avant
réalisation d’un éventuel geste chirurgical ;
o discordance entre la gravité des symptomes et l’aspect naso-
fibroscopique ;
o symptômes atypiques faisant évoquer un diastème laryngé (fausses
routes au premier plan) ou une fistule oeso-trachéale.
Les signes endoscopiques morphologiques à la laryngoscopie directe en
suspension de la laryngomalacie sont identiques à ceux retrouvés à la
nasofibroscopie.
2.2. Formes cliniques [3,4]
2.2.1. Formes selon la gravité
❖ Laryngomalacie mineure : TDD
❖ Laryngomalacie sévère
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 19
la ville de Ouagadougou
C’est une forme grave de la laryngomalacie qui peut mettre en jeu le pronostic
vital du patient et nécessiter une trachéotomie d’urgence. Elle est retrouvée dans
10 à 20% des cas. Elle peut être identifiée par plusieurs signes.
- Signes fonctionnels :
o une difficulté respiratoire importante ;
o des ronflements ;
o une somnolence diurne excessive ;
o des épisodes d’apnées au cours du sommeil ;
o des épisodes de suffocation lors de l’alimentation ;
- Signes physiques :
o un retard de croissance
o des signes de lutte respiratoire : une bradypnée ou une polypnée
respiratoire, une désaturation en air ambiant, des battements des ailes
du nez, un balancement thoraco-abdominal, un entonnoir xiphoïdien,
un tirage intercostal ou un geignement respiratoire
- Signes paracliniques
o Laryngoscopie Directe en Suspension (LDS): on note un collapsus
complet sans visibilité du plan glottique.
o Polysomnographie : elle retrouve un index d’apnées et hypopnées ou
IAH (nombre d’apnées et d’hypopnées par heure de sommeil) ≥ 5
[32].
o Gaz du sang : on note une hypoxémie
La Société Française d’Oto-Rhino-Laryngologie (SFORL)[3] a défini les critères
de gravité suivants :
- un retard de croissance staturo-pondérale (élément sans le doute le plus
contributif) ;
- une dyspnée avec tirage intercostal ou xiphoïdien permanent et important ;
- des épisodes de détresse respiratoire ;
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 20
la ville de Ouagadougou
- des apnées obstructives du sommeil ;
- des épisodes de suffocation lors de l’alimentation ou une difficulté à la prise
alimentaire.
2.2.2. Formes selon la topographie
❖ Laryngomalacie : TDD
❖ Pharyngo-laryngomalacie
Il s’agit d’une forme clinique associant une laryngomalacie et une
pharyngomalacie, avec extension de l’anomalie au pharynx entrainant un
collapsus de la paroi pharyngée. Les patients porteurs de cette forme clinique
présentent plusieurs signes cliniques et paracliniques.
- Signes fonctionnels :
o une difficulté respiratoire qui se majore pendant le sommeil
o une respiration bruyante
o des troubles de la déglutition avec fausses routes
o des troubles de la coordination de la succion-déglutition
o des régurgitations
- Signes physiques
o une hypotonie axiale avec absence de tenue de la tête à la manœuvre
du tiré-assis chez le nouveau-né
o une glossoptose
o une muqueuse pharyngée inflammatoire
o un collapsus inspiratoire des parois latérales du pharynx
- Signes paracliniques
o Laryngoscopie Directe en Suspension : on retrouve un collapsus de
l’étage supra-glottique avec une bascule antérieure des aryténoïdes
et une bascule postérieure de l’épiglotte.
o Fibroscopie œso-gastro-duodénale : on note une muqueuse
œsophagienne inflammatoire.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 21
la ville de Ouagadougou
o pH-métrie œsophagienne : elle met en évidence un RGO (Reflux
Gastro-Œsophagien)
2.2.3. Formes selon l’âge
❖ Laryngomalacie du nouveau-né et du nourrisson : TDD
❖ Laryngomalacie d’apparition secondaire [33]
Il s’agit d’une forme de laryngomalacie qui est rapportée de façon occasionnelle
dans la littérature[3]. Elle survient chez le grand enfant et chez l’adulte. On
distingue ainsi plusieurs signes.
- Signes fonctionnels :
o troubles de l’alimentation avec dysphagie
o toux persistante
o difficulté respiratoire accrue lors de la déglutition
o absence de stridor au repos
o trouble du sommeil : pauses respiratoires, sommeil agité
- Signes physiques :
o retard de croissance
o altération de l’état de conscience
- Signes paracliniques
o LDS : prolapsus aryténoïdien très fréquent dans cette forme clinique
2.2.4. Formes associées [4]
La recherche de comorbidités associées est essentielle car celles-ci influencent
l’évolution de la symptomatologie de la laryngomalacie. On distingue :
• un reflux gastro-œsophagien : fréquemment associé à la laryngomalacie et
pouvant être confirmé par pH-métrie ;
• des malformations cardiaques ;
• un syndrome génétique : trisomie 21, syndrome CHARGE, séquence Pierre
Robin, micro-délétion 22Q11.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 22
la ville de Ouagadougou
3. Diagnostic
3.1. Diagnostic positif
Le diagnostic positif de la laryngomalacie est essentiellement clinique, basé sur
les signes fonctionnels et les signes physiques. Il est :
• suspecté devant un stridor :
o inspiratoire, de tonalité aiguë, musicale, vibrant, multiphasique ;
o constaté assez rapidement après la naissance ou dans les premiers
jours de vie ;
o avec une aggravation au cours de l’alimentation, des pleurs et de
l’agitation ;
o une majoration au cours des quatre premiers mois puis une
atténuation progressive ;
o une disparition vers 12 à 24 mois
• étayé à l’examen physique (nasofibroscopie) avec :
o collapsus plus ou moins complet de la sus-glotte concomitant au
stridor, à l’inspiration, pouvant gêner la visualisation du plan
glottique ;
o bascule antérieure des aryténoïdes ou replis ary-épiglottiques courts
ou bascule postérieure de l’épiglotte ;
o une épiglotte en « chapeau de gendarme » ou en « oméga » ;
o un prolapsus aryténoïdien ou des aryténoïdes épaissis ;
o un excès muqueux de la margelle laryngée obstruant partiellement
ou totalement le vestibule laryngé.
3.2. Diagnostic différentiel [29,34]
Le diagnostic différentiel se fait essentiellement avec les autres causes de
stridor.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 23
la ville de Ouagadougou
3.2.1. Stridor d’apparition aiguë
• Laryngite aiguë
Il s’agit d’une pathologie fréquente chez l’enfant dont le diagnostic est posé
devant une dyspnée laryngée, une dysphonie et un syndrome infectieux clinique
ou biologique. La nasofibroscopie permet de mettre en évidence une muqueuse
laryngée inflammatoire.
• Abcès para-pharyngé
C’est un abcès profond du cou qui survient le plus souvent au décours d’une
angine récidivante. Il comprend dans son tableau clinique une altération de l’état
général, une tuméfaction cervicale, une odynophagie, une douleur pharyngée, un
syndrome infectieux clinique ou biologique, voire un sepsis sévère. La TDM
cervicale est un examen essentiel au diagnostic.
• Inhalation de corps étrangers
Il s’agit d’une pathologie fréquente chez le jeune enfant entre 1 et 3 ans [35] . Elle
se caractérise par l’apparition brutale d’un syndrome de pénétration (toux
quinteuse, accès de suffocation, dyspnée, cyanose) avec détresse respiratoire
aiguë. L’endoscopie et la radiologie permettent de confirmer le diagnostic.
3.2.2. Stridor d’apparition subaiguë ou chronique
Il convient de rechercher des lésions glottiques, sous-glottiques et trachéales.
- Lésions glottiques
• Palmure laryngée
C’est une malformation congénitale rare du larynx. Elle est évoquée devant une
dysphonie, voire une aphonie chez le nouveau-né. L’examen clé du diagnostic est
la nasofibroscopie permettant de mettre en évidence une bride glottique.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 24
la ville de Ouagadougou
• Papillomatose laryngée
C’est une pathologie provoquée par le HPV (Human Papilloma Virus) types 6 et
11, qui se caractérise par une prolifération de papillomes bénins au niveau
laryngé. Cette pathologie, fréquente chez le petit enfant avant 5 ans est évoquée
devant une dysphonie chronique chez l’enfant (2ème cause de dysphonie). La
nasofibroscopie permet l’identification du papillome laryngé.
• Paralysie laryngée secondaire
Elle est le plus souvent secondaire à une atteinte du nerf pneumogastrique et du
récurrent et se manifeste par une dysphonie, une dyspnée ou des troubles de la
déglutition. L’endoscopie laryngée (nasofibroscopie ou laryngoscopie directe en
suspension) permet de mettre en évidence une immobilité des cordes vocales.
- Lésions sous-glottiques
• Hémangiome sous-glottique infantile
Il s’agit d’une lésion néoplasique congénitale bénigne, plus fréquente chez la
petite fille avant l’âge de 3 mois. Elle se manifeste par un stridor d’apparition
retardée (environ 2 mois) et la présence d’un angiome cutané dans 50% des cas.
La LDS permet de faire le diagnostic en identifiant une tuméfaction sous-glottique
élastique et dépressible. L’examen anatomopathologique de la tuméfaction après
biopsie confirme le diagnostic.
• Sténose sous-glottique congénitale
Elle représente moins de 10% des causes de stridor et se manifeste par une
dyspnée isolée sans dysphonie, ni trouble de la déglutition, avec des épisodes de
laryngite à répétition. La LDS permet la confirmation du diagnostic.
• Diastèmes laryngo-trachéaux
Ils sont rares (moins de 1% des malformations laryngo-trachéales). Ils se
manifestent par des fausses routes, une toux, des malaises lors de l’alimentation
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 25
la ville de Ouagadougou
et des infections pulmonaires à répétition. La LDS met en évidence une fente
laryngo-trachéale postérieure plus ou moins étendue.
- Lésions trachéales
• Trachéomalacie [36]
C’est une anomalie structurelle du cartilage trachéal induisant un collapsus
excessif de la trachée. Elle se manifeste classiquement par un stridor expiratoire
survenant dans les 4 à 6 semaines de vie, associé à une difficulté respiratoire et
une aphonie. L’examen clé du diagnostic est la bronchoscopie souple ou rigide
qui met en évidence un rétrécissement de la lumière de la trachée
• Papillomatose trachéale [37]
C’est une papillomatose dont la topographie est trachéale. La symptomatologie
est non-spécifique avec toux et dyspnée d’effort. La bronchoscopie permet de
poser le diagnostic avec confirmation par l’histopathologie après biopsie du
papillome trachéal.
3.3. Diagnostic étiologique [1]
3.3.1. Facteurs favorisants
Plusieurs facteurs de risque de malformations congénitales sont connus :
• Facteurs socio-économiques et démographiques (pays à ressources
limitées, faible niveau socio-économique) ;
• Facteurs génétiques (consanguinité) ;
• Infections maternelles (syphilis, rubéole, toxoplasmose) ;
• Etat nutritionnel de la mère (carence en iode et en folates, diabète
gestationnel, apport excessif en vitamine A, déficit en vitamine B3) ;
• Facteurs environnementaux (exposition à des pesticides, prise de certains
médicaments, consommation d’alcool, de tabac ou de drogues, exposition
aux radiations).
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 26
la ville de Ouagadougou
3.3.2. Causes
Différentes causes peuvent être à l’origine de la laryngomalacie :
• Causes endogènes (mutations génétiques ou anomalies chromosomiques)
avec différents modes de transmission des parents aux enfants ;
• Causes exogènes (infection, facteurs environnementaux, exposition à des
agents tératogènes) ;
• Causes multifactorielles (anomalies génétiques et facteurs
environnementaux).
4. Traitement
4.1. But
• Améliorer la qualité de la respiration spontanée ;
• Permettre une reprise de la croissance staturo-pondérale ;
• Permettre une évolution favorable du stridor ;
• Prévenir et traiter les complications et les pathologies associées.
4.2. Moyens
Mesures hygiéno-diététiques [38]
Ces mesures visent à traiter le reflux gastro-œsophagien au regard de sa fréquence
et de son rôle aggravant sur la laryngomalacie. Ainsi, on peut réaliser :
• un épaississement de l’alimentation (lait Anti-Reflux) en utilisant de
l’amidon (amidon de maïs, de riz, tapioca) ou de la caroube. Pour des
raisons nutritionnelles et de tolérance, il est préférable d’utiliser un lait
Anti-Reflux que de rajouter des céréales ou un épaississant dans le biberon
• une Suppression de l’environnement tabagique ;
• une éviction de toute cause de compression abdominale (vêtements,
couches trop serrées, bandage herniaire inapproprié, position assise dans un
siège rigide) ;
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 27
la ville de Ouagadougou
N.B : Le traitement postural autre que proclive (avec un angle de 30°, surélévation
de la tête du lit de 15 à 20 cm) n’est plus recommandé du fait de la relation entre
incidence de mort subite et sommeil en position ventrale ou latérale. On évitera la
position demi-assise.
Moyens médicamenteux [39]
Ces différents moyens médicamenteux contre le reflux-gastro-œsophagien sont :
• les médicaments antisécrétoires : ils ont pour principe l’inhibition de la
sécrétion gastrique. On note deux classes thérapeutiques : les inhibiteurs de
la pompe à proton (oméprazole, pantoprazole, ésoméprazole) et les
antihistaminiques H2 (cimétidine, ranitidine) ;
• les anti-acides : ils ont comme principe, la neutralisation du contenu acide.
Ce sont des gels d’hydroxyde ou de phosphate d’ion métallique
(phosphalugel®, Maalox®) ;
• les alginates : ils créent une nappe surnageant sur le liquide gastrique et fait
ainsi écran en cas de reflux (Gaviscon®).
Moyens chirurgicaux
- Supraglottoplastie [3,29]
Elle consiste en une résection endoscopique des excès muqueux et cartilagineux
de la margelle laryngée, essentiellement les replis ary-épiglottiques, les bords
latéraux de l’épiglotte et parfois les cartilages corniculés et le bord libre de
l’épiglotte. Certains auteurs recommandent une simple section des replis ary-
épiglottiques sans résection. Les instruments chirurgicaux utilisés sont variables :
micro-instruments froids (micro-ciseaux), laser CO2, laser thulium, laser diode,
micro-débrideur.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 28
la ville de Ouagadougou
Avant
Droite
Section de
l’aryténoïde et du
repli ary-épiglottique
au laser thulium
Figure 8 : Aspect de la supraglottoplastie au laser thulium [30]
- Trachéotomie
Elle consiste en une ouverture pratiquée de manière chirurgicale dans la trachée
haute, sous le larynx afin d’assurer une perméabilité permanente des voies
aériennes.
4.3.Indications
- Laryngomalacie mineure : le traitement peut consister en une simple
surveillance associée à un traitement médical anti-reflux, voire
antisécrétoire.
- Laryngomalacie sévère : le traitement sera chirurgical avec une
supraglottoplastie.
4.4. Résultats et pronostic
4.4.1. Résultats
- Surveillance simple [40] : on note un taux de résolution spontanée de 89%
pour les cas de laryngomalacie mineure avec un délai de résolution allant
de 4 à 42 mois.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 29
la ville de Ouagadougou
- Traitement anti-reflux [7,41]: son utilisation n’a pas systématiquement
démontré une amélioration des symptômes de la laryngomalacie
- Supraglottoplastie[42,43] : on note une amélioration rapide et durable
avec un taux de réussite allant de 70 à 100%. Le risque d’échec est plus
élevé chez les nourrissons présentant une maladie concomitante tel qu’une
trachéomalacie, une sténose sous-glottique ou une encéphalopathie. Une
étude sur les courbes de croissance après supraglottoplastie note que, trois
mois après chirurgie, il y’a une amélioration significative de la courbe chez
les patients traités par supraglottoplastie, par rapport au groupe traité par
traitement anti-acide ou au groupe sans traitement.
4.4.2. Pronostic
- Laryngomalacie mineure : le pronostic vital et fonctionnel est bon dans
cette forme clinique.
- Laryngomalacie sévère : le pronostic vital est réservé avec un risque de
décès, suite à une détresse respiratoire en l’absence d’un traitement
chirurgical.
4.5.Surveillance
- Clinique : elle se fait périodiquement en consultation (chaque mois), afin
de réévaluer la prise pondérale, le stridor, les troubles de la déglutition, la
dyspnée ainsi que le collapsus supra-glottique à la nasofibroscopie.
- Paraclinique : leur réalisation dépend de l’état clinique du patient. Il s’agit
de :
o Laryngoscopie Directe en Suspension : en cas d’aggravation de la
symptomatologie ou de manifestations atypiques
o Polysomnographie : pour réévaluer le SAOS
o pH-métrie : pour réévaluer le reflux
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 30
la ville de Ouagadougou
DEUXIEME PARTIE : NOTRE ETUDE
DEUXIEME PARTIE :
NOTRE ETUDE
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 31
la ville de Ouagadougou
OBJECTIFS
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 32
la ville de Ouagadougou
1. Objectifs
1.1. Objectif général
Etudier la laryngomalacie dans ses aspects épidémiologiques, diagnostiques et
thérapeutiques dans, les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) de la ville de
Ouagadougou, disposant d’un service d’Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie
Cervico-Faciale du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.
1.2. Objectifs spécifiques
1.2.1. Décrire les caractéristiques socio-démographiques des patients qui
ont présenté une laryngomalacie et qui ont été pris en charge, durant
la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, dans les CHU
de la ville de Ouagadougou disposant d’un service d’ORL/CCF.
1.2.2. Identifier les facteurs de risques associés à la survenue de la
laryngomalacie chez les patients présentant cette pathologie, dans les
CHU de la ville de Ouagadougou durant, la période du 1er janvier
2017 au 31 décembre 2021.
1.2.3. Déterminer les manifestations cliniques des patients présentant une
laryngomalacie dans les CHU de la ville de Ouagadougou, durant la
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.
1.2.4. Rapporter les modalités thérapeutiques de la laryngomalacie dans
les CHU de la ville de Ouagadougou, durant la période du 1er janvier
2017 au 31 décembre 2021.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 33
la ville de Ouagadougou
METHODOLOGIE
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 34
la ville de Ouagadougou
2. Méthodologie
Notre étude s’est déroulée dans les différents CHU de la ville de Ouagadougou
qui disposaient d’un service d’ORL/CCF fonctionnel, durant la période d’étude à
savoir : les CHU YALGADO OUEDRAOGO, de BOGODOGO et de
TENGANDOGO.
2.1. Cadre de l’étude
2.1.1. Centre Hospitalier Universitaire YALGADO OUEDRAOGO
(CHU-YO)
Créé en 1956 et fonctionnel depuis 1961, le CHU-YO constitue l’un des centres
hospitaliers de référence au Burkina Faso. Il est le premier grand hôpital depuis
l’après indépendance.
Situé dans la ville de Ouagadougou, le CHU-YO a une capacité d’accueil de 729
lits d’hospitalisation. En plus des services administratifs et l’antenne du Centre
régional de transfusion sanguine de Ouagadougou, le CHU-YO est organisé en 10
départements médico-techniques :
- le département de médecine et spécialités médicales ;
- le département de chirurgie et spécialités chirurgicales ;
- le département de gynéco-obstétrique ;
- le département de pédiatrie ;
- le département d’imagerie médicale ;
- le département d’anesthésie-réanimation ;
- le département d’odontologie stomatologie ;
- le département de laboratoire ;
- le département de pharmacie ;
- le département de santé publique.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 35
la ville de Ouagadougou
Notre étude va se dérouler dans le département de chirurgie et spécialités
chirurgicales en particulier dans le service d’ORL/CCF.
❖ Service d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie Cervico-Faciale
(ORL/CCF) du CHU YO
o Locaux : ce service comporte
- un bloc opératoire avec deux salles d’opération, une salle de stérilisation et
une salle de réveil ;
- cinq bureaux de médecins spécialistes en ORL/CCF ;
- un bureau pour les médecins en spécialisation en ORL/CCF ;
- un bureau du surveillant d’unités de soins (SUS) ;
- un bureau pour les attachés de santé en anesthésie
- un bureau et un box de consultation médical
- un secrétariat ;
- un box de consultation pour les attachés de santé en ORL ;
- une salle de réunion ;
- deux salles de garde ;
- une salle de soins externes ;
- une salle de soins internes ;
- une salle d’accueil ;
- un bloc d’hospitalisation avec une capacité totale de onze lits ;
- une salle d’audiométrie ;
- une salle d’orthophonie.
o Ressources Humaines
- un Professeur titulaire en ORL/CCF ;
- un Maître de Conférence Agrégé en ORL/CCF ;
- un Maître Assistant en ORL/CCF ;
- trois médecins spécialistes en ORL/CCF ;
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 36
la ville de Ouagadougou
- des médecins en cours de spécialisation en ORL/CCF ;
- un nombre fluctuant d’étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des
élèves infirmiers et attachés pour leur stage pratique ;
- dix-sept attachés de santé en ORL ;
- sept attachés de santé en anesthésie ;
- quatre agents de soutien.
2.1.2. Centre Hospitalier Universitaire de BOGODOGO (CHU-B)
Le CHU de Bogodogo, qui a absorbé l’ancien Centre Médical avec Antenne
chirurgicale (CMA) du secteur 30, a été créé le 14 Novembre 2016.
Ce centre, à l’instar des autres CHU, assure la formation des médecins
généralistes et spécialistes, des étudiants en médecine et en pharmacie, ainsi que
les élèves de l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) et des écoles privées de
santé.
Il comporte 02 sites à savoir le site nouvellement construit (site A) et le site de
l’ex CMA (site B) avec une capacité d’accueil de quatre cent (400) lits. Cet
établissement qui a une vocation d’enseignement, de formation et de recherche,
comprend en plus de la direction générale et des services techniques rattachés, les
départements suivants :
- un département de médecine et de spécialités médicales composé des
services d’urgence médicale, de médecine physique et Réadaptation, de
rhumatologie, de cardiologie, de néphrologie, de neurologie, d’oncologie,
de médecine interne et de maladies infectieuses ;
- Un département de chirurgie et de spécialités chirurgicales composé des
services d’ORL/CCF et celui d’orthopédie-traumatologie ;
- un département d’Odontologie et de Stomatologie ;
- Un département de gynécologie-obstétrique ;
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 37
la ville de Ouagadougou
- un département d’anesthésie-réanimation ;
- un département de pédiatrie ;
- une pharmacie hospitalière ;
- un laboratoire d’analyse médicale.
❖ Service d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie Cervico-Faciale
(ORL/CCF) du CHU-B
o Locaux : ce service comporte
- une unité consultation externe ;
- un bloc opératoire ;
- une unité hospitalisation ;
- une unité de soins externes ;
- une unité d’exploration des fonctions auditives ;
- une unité des explorations endoscopiques.
o Ressources humaines
- un Professeur titulaire en ORL/CCF qui est le chef de service ;
- trois médecins spécialistes en ORL/CCF ;
- treize attachés de santé en ORL ;
- un nombre variable de médecins en spécialisation ;
- un nombre variable de stagiaires externes ;
- une secrétaire ;
- deux filles de salle.
N.B : Il existe une collaboration entre le CHU-B et le CHU pédiatrique Charles
de Gaules (CHUP-CDG). Cette collaboration permet au médecin ORL présent au
CHUP-CDG de faire des interventions chirurgicales au CHU-B car le CHUP-
CDG ne dispose de bloc opératoire approprié pour pratiquer une CCF.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 38
la ville de Ouagadougou
2.1.3. Centre Hospitalier Universitaire de TENGANDOGO (CHU-T)
Le CHU-T a été officiellement créé le 24 mars 2011. Il comporte des bâtiments
de type semi-pavillonnaire, avec une capacité d'accueil de 600 lits. Il a été mis en
service le 1er septembre 2011 et la prise en charge des urgences ainsi que des
hospitalisations a débuté le 8 octobre 2012.
Le CHU-T est structuré en 11 services cliniques et médico-techniques :
- service de médecine et spécialités médicales (cardiologie, Pneumologie,
neurologie, hépato-gastro-entérologie, dermatologie, médecine interne,
néphrologie, kinésithérapie) ;
- service de chirurgie et spécialités chirurgicales (orthopédie-Traumatologie,
chirurgie générale et digestive, odontostomatologie, ophtalmologie, oto-
Rhino-Laryngologie/Chirurgie cervico-faciale, anesthésie réanimation,
grands brûlés, chirurgie thoracique et des vaisseaux, neurochirurgie,
urologie) ;
- service des consultations externes ;
- pool mère-enfant (gynécologie-obstétrique, pédiatrie) ;
- service VIP ;
- service des urgences ;
- service de la pharmacie hospitalière ;
- service de laboratoire d’analyses biomédicales ;
- service de l’imagerie médicale et des explorations fonctionnelles ;
- service de laboratoire d’anatomo-pathologie ;
- service d’hygiène hospitalière et de la stérilisation.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 39
la ville de Ouagadougou
❖ Service d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie Cervico-Faciale
(ORL/CCF) du CHU-T
o Locaux : il comporte
- une salle de consultation ;
- une salle d’exploration fonctionnelle auditive ;
- une salle de stérilisation ;
- une salle d’exploration endoscopique ;
- trois bureaux ;
- une salle de soins ;
- une salle de réunion ;
- une salle d’étudiant ;
- un bloc opératoire commun avec les autres unités du service de la chirurgie
et spécialités chirurgicales.
o Ressources humaines
- un Professeur titulaire en ORL/CCF ;
- un Maitre-assistant hospitalo-universitaire en ORL/CCF ;
- un médecin spécialiste en ORL/CCF ;
- un nombre variable de médecins en formation pour l’obtention du diplôme
d’études spécialisées (DES) en ORL/CCF ;
- deux attachés de santé en ORL/CCF.
2.2. Type et période d’étude
Il s’agissait d’une étude descriptive et analytique, à collecte de données
rétrospective durant 05 ans allant du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2021 dans
les services d’Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Faciale (ORL/CCF)
de trois CHU de la ville de Ouagadougou (CHU-YO, CHU-B, CHU-T).
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 40
la ville de Ouagadougou
2.3. Population d’étude
Notre population d’étude était constituée de l’ensemble des patients de 0 à 5 ans,
reçus durant notre période d’étude dans les services d’ORL/CCF des CHU de la
ville de Ouagadougou chez qui, le diagnostic de laryngomalacie a été posé.
2.3.1. Critères d’inclusion
Ont été inclus dans notre étude, les patients répondant aux critères suivants : être
âgé de 0 à 5 ans pendant la période d’étude, avoir été reçu dans l’un des services
d’ORL/CCF des CHU de la ville de Ouagadougou (CHU-YO, CHU-B, CHU-T),
avoir bénéficié d’une endoscopie ORL ayant permis de poser le diagnostic de
laryngomalacie.
2.3.2. Critères de non-inclusion
N’ont pas été inclus dans notre étude les patients atteints de laryngomalacie
disposant d’un dossier clinique non exploitable (absence de date d’entrée, identité
incomplète, examen clinique notamment, des résultats ORL non retrouvés,
absence d’âge ou absence d’endoscopie ORL confirmant la laryngomalacie).
2.4. Collecte de données
2.4.1. Source de données
Nous avons utilisé comme source de données, les dossiers cliniques des patients
consultant dans l’un des services d’ORL/CCF des CHU de la ville de
Ouagadougou (CHU-YO, CHU-B, CHU-T), les registres d’endoscopie ORL, les
registres de consultation, les registres d’hospitalisation et les registres de Compte
Rendu Opératoire.
2.4.2. Instrument de collecte de données
Nous avons utilisé comme outil de collecte, une fiche de collecte de données
comportant un questionnaire que nous avons remplie nous-même à partir des
sources de données identifiées.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 41
la ville de Ouagadougou
2.5. Variables d’étude
Les variables que nous avons analysées sont les suivantes :
▪ Variables socio-démographiques : identité du patient, âge, sexe, ethnie,
âge des parents, type de mariage des parents, lieu de résidence.
▪ Variables cliniques : antécédents personnels (post-nataux, médicaux,
chirurgicaux, allergiques), antécédents familiaux, examen clinique
(examen général, examen physique des appareils et systèmes, examen
ORL)
▪ Variables paracliniques : biologie, imagerie, endoscopie.
▪ Variables thérapeutiques : surveillance sans traitement, traitement
médical, traitement chirurgical
▪ Variables évolutives : modalité d’évolution (favorable, stationnaire,
défavorable, complication, décès), délai de suivi.
2.6. Saisie, traitement et analyse des données
Les données ont été saisies sur un micro-ordinateur. Elles ont été analysées à
l’aide du logiciel Epi Info version 7.0 pour la production de statistiques. Microsoft
Word 2016 sera utilisé pour la saisie de textes et Microsoft Excel 2016 pour la
production de graphiques.
L’analyse des données se fera à deux niveaux. Une analyse descriptive qui
consistera à calculer des pourcentages pour les variables qualitatives et des
mesures de tendance centrale (moyenne, médiane), et de dispersion (écart-type,
minimale, maximale) pour les variables quantitatives. Une analyse des facteurs
qui fera appel à l’Odds Ratio (OR) ou au test de Chi carré pour la comparaison
des pourcentages. Le seuil de signification retenu est p<5%.
2.7. Considérations éthiques et administratives
Pour réaliser notre étude, une demande d’autorisation de collecte de données a été
adressée, et un accord a été donné par la direction des Centres Hospitaliers
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 42
la ville de Ouagadougou
Universitaires de YALGADO OUEDRAOGO, de BOGODOGO et de
TENGANDOGO.
Spécifiquement au CHU de Bogodogo, un dossier de demande d’avis sur notre
protocole de recherche a été soumis et approuvé par le Comité d’Ethique
institutionnel pour la Recherche du CHU de Bogodogo.
L’exploitation des dossiers s’est faite dans un strict respect de la confidentialité,
et l’anonymat des patients a été conservé dans le traitement des données.
2.8.Définitions opérationnelles
• Détresse respiratoire : est définie par l’association d’au moins deux signes
parmi les signes suivants : battement des ailes du nez, balancement thoraco-
abdominal, tirage sus-claviculaire et intercostal, entonnoir xiphoïdien,
geignement (pour le nouveau-né).
• Perdus de vue : tout patient n’ayant pas été revu plus tard en contrôle après
la consultation initiale.
• Evolution favorable : toute évolution chez un patient, marquée par une
régression ou une disparition de la symptomatologie initiale quelque soit le
délai de contrôle du patient.
• Evolution stationnaire : toute évolution marquée par une persistance de la
symptomatologie initiale sans amélioration, ni aggravation quelque soit le
délai de contrôle du patient.
• Evolution défavorable : toute évolution marquée par une aggravation de
la symptomatologie initiale ou la survenue de complications, voire le décès
quelque soit le délai de contrôle du patient.
• Bon état général : tout patient classé stade 0, I ou II OMS
• Mauvais état général : tout patient classé stade III ou IV OMS.
• Délai de suivi : temps qui s’écoule entre une consultation initiale et le
rendez-vous de contrôle pour un patient.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 43
la ville de Ouagadougou
• Classification OMS de l’état général
- Stade 0 : Activité normale sans restriction
- Stade I : Patient limité pour les activités physiques importantes, mais
ambulant et capable de mener un travail
- Stade II : Patient incapable de travailler, alité < 50% du temps, capable de
prendre soin de lui
- Stade III : Patient alité > 50% du temps, capable de prendre soin de lui
- Stade IV : Patient incapable de prendre soin de lui
• Classification endoscopique
La classification endoscopique utilisée dans notre étude est celle de Olney[31] qui
distingue trois types de laryngomalacie:
- Type I : prolapsus de la muqueuse recouvrant les cartilages aryténoïdes ;
- Type II : plis ary-épiglottiques courts associés à une longue épiglotte en
forme d'oméga qui s'enroule sur elle-même ;
- Type III : épiglotte qui surplombe le larynx et qui se collabe
postérieurement, obstruant l’orifice du larynx lors de l’inspiration.
• Critères de gravité de la laryngomalacie
La SFORL[3] a défini les critères de gravité suivants :
- un retard de croissance staturo-pondérale (élément sans le doute le plus
contributif) ;
- une dyspnée avec tirage intercostal ou xiphoïdien permanent et important ;
- des épisodes de détresse respiratoire ;
- des apnées obstructives du sommeil
- des épisodes de suffocation lors de l’alimentation ou une difficulté à la prise
alimentaire.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 44
la ville de Ouagadougou
RESULTATS
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 45
la ville de Ouagadougou
3. Résultats
3.1. Données épidémiologiques
3.1.1. Fréquence globale
Du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2021, soit sur une période de 05 ans, nous
avons recensé 137 cas de laryngomalacie parmi 41132 consultants dans les
services d’ORL/CCF des CHU de YALGODO OUEDRAOGO, de BOGODOGO
et de TENGANDOGO, soit une fréquence de 0,33% des consultations. Parmi ces
cas recensés, on notait 36 cas (soit 26,28%) au CHU-YO, 62 cas (soit 45,26%) au
CHU-B et 39 cas (soit 28,47%) au CHU-T.
Nous avons inclus dans notre étude 55 cas de laryngomalacie confirmés par une
nasofibroscopie soit 40,15% de l’ensemble des cas recensés.
Le diagramme ci-dessous illustre le flux des patients avant et pendant leur
inclusion dans notre étude.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 46
la ville de Ouagadougou
Patients consultés
n=41132
CHU-YO=36 (26,28%)
Cas de laryngomalacie recensés
CHU-T=39 (28,47%)
n=137 (0,33%)
CHU-B=62 (45,26%)
Non inclus
- (Dossier inexploitable)
n=6 (4,37%)
- (Absence de nasofibroscopie)
n=76 (55,48%)
Cas de laryngomalacie inclus
(Confirmé par nasofibroscopie)
n=55 (40,15%)
Cas au CHU-YO Cas au CHU-T Cas au CHU-B
n=14 (25,45%) n=30 (54,55%) n=11 (20%)
Figure 9 : Diagramme de flux.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 47
la ville de Ouagadougou
3.1.2. Fréquence annuelle
La fréquence par année des cas de laryngomalacie est représentée par le graphique
ci-dessous (Figure 14).
30
25 25
20
18
Effectif
15
10 10
1 1
0
2017 2018 2019 2020 2021
Année
Figure 10: Répartition des cas de laryngomalacie confirmés par nasofibroscopie
en fonction de l’année (n=55)
3.1.3. Données socio-démographiques
3.1.3.1. Age
L’âge moyen des patients était de 3,97 mois avec un écart-type de 5,68 mois et
des extrêmes de 12 jours et 36 mois. La classe modale était celle de 0 à 1 mois
avec 17 cas (soit 30,91%). Dans notre étude, 39 patients (soit 70,9%) avaient
moins de 3 mois.
Le graphique ci-dessous illustre la répartition des patients par tranche d’âge.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 48
la ville de Ouagadougou
18 17
16
14 13
12
Effectif
10 9
6
4
4 3 3
2 2 2
2
0
0
[0-1] ]1-2] ]2-3] ]3-4] ]4-5] ]5-7] ]7-12] ]13-14] ]14-36] ]36-60]
Tranche d'âge (en mois)
Figure 11: Répartition des cas de laryngomalacie confirmés par nasofibroscopie
selon les tranches d'âge (n=55)
3.1.3.2. Sexe
Les patients de sexe masculin étaient au nombre de 31 (soit 56,36%) et ceux de
sexe féminin au nombre de 24 cas (soit 43,64%). On notait un sex ratio de 1,29.
3.1.3.3. Résidence
La résidence des patients était précisée dans 41 cas avec 35 cas (soit 85,36%) à
Ouagadougou et 06 cas (soit 14,64%) hors Ouagadougou. Les localités de
résidence hors Ouagadougou étaient Bobo-Dioulasso, Boussé, Léo, Kongoussi,
Zabré et Zorgho avec 01 cas chacun.
3.2. Données cliniques
3.2.1. Antécédents
Les antécédents ont été retrouvés chez 11 patients (soit 20%). Le tableau suivant
résume la répartition des patients par antécédents.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 49
la ville de Ouagadougou
Tableau I: Répartition des patients selon les antécédents (n=55)
Antécédents Effectif Pourcentage
Reflux (Reflux gastro-œsophagien /Reflux 06 10,9
pharyngo-laryngé)
Rhinopharyngite 02 3,63
Prématurité 01 1,81
Staphylococcie pleuro-pulmonaire 01 1,81
Empyème cérébral 01 1,81
3.2.2. Signes généraux
L’état général était jugé bon chez tous les 55 patients, soit 100% des cas. On
notait 01 seul cas de fièvre modérée.
3.2.3. Signes fonctionnels
Les signes fonctionnels étaient retrouvés chez tous les patients, avec une
association possible de plusieurs signes fonctionnels, pour un même patient. Le
graphique ci-dessous représente la répartition des cas de laryngomalacie en
fonction des signes fonctionnels retrouvés.
Stridor 55
Difficulté respiratoire 20
Cornage 7
Signes Fonctionnels
Respiration bruyante 5
Dysphonie 5
Vomissement 4
Toux 3
Ronchopathie 3
Apnée 1
Regurgitation 1
Dysphagie 1
0 10 20 30 40 50 60
Effectif
Figure 12: Répartition des patients en fonction des signes fonctionnels (n=55)
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 50
la ville de Ouagadougou
La durée d’évolution des signes fonctionnels était précisée dans 19 cas (soit
34,54%), avec 17 cas évoluant depuis la naissance. Dans 01 cas (soit un
nourrisson de 4,5mois), ils évoluaient depuis 02 mois. Concernant l’autre cas
(nourrisson de 6,6mois), les signes fonctionnels évoluaient depuis 01 mois.
3.2.4. Signes physiques
Les signes physiques étaient retrouvés chez 16 patients (soit 29,09%) avec une
possibilité d’association de ces signes chez un patient. Le tableau ci-dessous
résume la répartition des cas en fonction des signes physiques retrouvés.
Tableau II: Répartition des cas de laryngomalacie en fonction des signes
physiques (n=55)
Signes physiques Effectif Pourcentage
Signes de lutte respiratoire* 7 12,72
Bradypnée inspiratoire 3 5,45
Polymicroadénopathie 1 1,82
Râles bronchiques 1 1,82
Frein de langue 1 1,82
Syndrome polymalformatif 1 1,82
Syndrome trisomique 1 1,82
Autres* 4 7,27
Signes de lutte respiratoire*= 01 tirage sus-sternal, 01 tirage intercostal, 01
tirage sous-costal, 02 balancement thoraco-abdominal, 02 entonnoir xiphoïdien.
Autres*= 02 hypertrophie d’amygdale palatine, 01 rhinorrhée purulente, 01 lame
de cérumen bilatéral.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 51
la ville de Ouagadougou
3.2.5. Signes et classification endoscopiques
• Signes endoscopiques
Il s’est agi de la nasofibroscopie, réalisée chez 100% de nos patients qui a permis
de retrouver des signes endoscopiques de laryngomalacie dont, la répartition est
résumée dans le tableau ci-dessous (Tableau III).
Tableau III: Répartition des cas en fonction des signes endoscopiques retrouvés
à la nasofibroscopie (n=55)
Signes endoscopiques Effectif Pourcentage
Formes isolées
Epiglotte en oméga 17 30,90
Aryténoïde épaissi 14 25,45
Repli ary-épiglottique court 08 14,55
Bascule antérieure du massif aryténoïdien 03 5,45
Bascule postérieure de l’épiglotte 03 5,45
Formes associées
Epiglotte en oméga + repli ary-épiglottique 03 5,45
court
Aryténoïde épaissi + bascule antérieure du 03 5,45
massif aryténoïdien
Bascule postérieure de l’épiglotte + épiglotte 03 5,45
en oméga
Epiglotte en oméga + Laryngocèle 01 1,82
Total 55 100
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 52
la ville de Ouagadougou
• Classification endoscopique[31]
Dans notre étude, la classification endoscopique a concerné tous les patients (soit
100% des cas). On notait 28 cas (soit 50,9%) de laryngomalacie type I, 21 cas
(soit 38,19%) de laryngomalacie type II et 06 cas (soit 10,9%) de laryngomalacie
type III.
3.2.6. Gravité
Dans notre étude, nous avons noté 11 cas (soit 20%) de laryngomalacie sévère et
44 cas (soit 80%) de laryngomalacie mineure.
Le graphique ci-dessous illustre la répartition des cas de laryngomalacie en
fonction de la gravité.
13%
5% Détresse respiratoire
2%
Dyspnée laryngée
SAOS
Absence de signes de
gravité
80%
Figure 13: Répartition des cas de laryngomalacie en fonction du critère de gravité
(n=55)
3.3. Données paracliniques
Dans notre étude, aucun examen paraclinique n’a été réalisé par aucun patient.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 53
la ville de Ouagadougou
3.4. Données thérapeutiques
Concernant le mode de prise en charge, aucun patient n’a été hospitalisé pour
laryngomalacie dans l’un des services d’ORL/CCF des CHU-B, CHU-T et CHU-
YO. Tous les patients ont été pris en charge en ambulatoire soit 100% des cas.
Les modalités thérapeutiques étaient constituées dans 36 cas (soit 65,45%) d’une
surveillance uniquement. Dans 19 cas (soit 34,55%) une prescription
médicamenteuse a été réalisée avec possibilité d’association de plusieurs
médicaments chez un même patient. On notait ainsi un serum physiologique
(intranasal) dans 10 cas, un anti-reflux dans 05 cas, un corticoïde dans 04 cas, un
antibiotique dans 03 cas, un antitussif dans 03 cas et un antihistaminique dans 01
cas. Aucune prise en charge chirurgicale pour laryngomalacie n’a été réalisée dans
notre cadre d’étude.
3.5. Données évolutives
3.5.1. Suivi des patients
Dans notre étude, on notait 28 patients (soit 50,9%) perdus de vue. Le suivi des
cas de laryngomalacie a été réalisé dans 27 cas (soit 49,09 %). Il était uniquement
clinique dans 100% des cas, et aucun patient au cours du suivi n’a bénéficié d’une
nasofibroscopie de contrôle.
3.5.2. Délai de suivi
Le délai de suivi allait de 02 jours à 06 mois et un patient pouvait être revu à
plusieurs reprises au cours de cette période. Au-delà de 6 mois, aucun patient
n’avait bénéficié de contrôle dans le cadre d’une laryngomalacie.
3.5.3. Evolution au cours du suivi
L’évolution n’était pas précisée chez 28 patients (soit 50,9%), car ceux-ci ont été
perdus de vue. Parmi les 27 patients suivis, l’évolution était favorable dans 20 cas
(soit 74,07% des cas suivis) et stationnaire, dans 07 cas (soit 25,93% des cas
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 54
la ville de Ouagadougou
suivis). Aucun cas de décès dû à la laryngomalacie n’a été constaté dans notre
étude.
Concernant la laryngomalacie sévère, 04 cas parmi les 11 cas sévères ont été
suivis avec une évolution qui était favorable dans 01 cas et stationnaire dans 03
cas.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 55
la ville de Ouagadougou
DISCUSSION ET
COMMENTAIRES
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 56
la ville de Ouagadougou
4. Discussions et commentaires
4.1. Limites et contraintes de l’étude
Au cours de la réalisation de notre étude, nous avons rencontré plusieurs
difficultés et contraintes.
En effet, du fait du caractère rétrospectif de la collecte de données, nous ne
sommes pas parvenus à obtenir toutes les informations à cause du remplissage
incomplet et d’un archivage inadéquat des dossiers. Cette difficulté est accentuée
par le fait que nos principales sources de données étaient des registres. En effet,
les renseignements contenus dans les registres se font de manière synthétique ; ce
qui nous a empêché d’approfondir notre travail sur certains points car plusieurs
informations concernant le patient et sa pathologie n’ont pas été détaillées.
Par ailleurs, notre étude étant une étude hospitalière, une de ses limites est son
incapacité à être extrapolée à l’ensemble de la population burkinabé.
Malgré les contraintes et les limites auxquelles nous avons été confrontées, cette
étude a pu être menée. Ainsi, nous sommes parvenus à des résultats que nous
avons commentés et comparés à ceux de la littérature.
4.2. Aspects épidémiologiques
4.2.1. Fréquence
❖ Fréquence globale
Nous avons observé du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2021, soit sur une
période de 05 ans, une fréquence hospitalière de 0,33% de laryngomalacie. Ces
résultats se rapprochent de ceux retrouvés par Bahinwa [17] au Sénégal avec
0,6%, et Koné [14] au Mali avec 0,46%. Yélémou [18] au Burkina notait une
fréquence hospitalière de 0,03%.
De manière globale, cette fréquence hospitalière est probablement sous-estimée,
car la probabilité pour un patient d’avoir accès au niveau de soins le plus élevé de
notre système de santé est plus réduite. En effet, celui-ci doit passer par le niveau
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 57
la ville de Ouagadougou
primaire (CSPS, CMA) et secondaire (CHR) avant d’atteindre le niveau tertiaire
(CHU), sans oublier la crainte des populations de consulter les CHU en première
intention, car jugés budgétivores par rapport à leur niveau socio-économique.
Par ailleurs, l’évolution spontanée de la laryngomalacie mineure (forme la plus
fréquente) se faisant vers la guérison la plupart du temps, il est évident que moins
de cas seront recensés dans les CHU, surtout que cette forme est le plus souvent
suivie cliniquement par des pédiatres et peu diagnostiquée endoscopiquement [7].
Ce qui réduit encore les probabilités d’un patient d’être en contact avec un service
d’ORL/CCF d’un CHU.
❖ Fréquence par année
Nos résultats montrent que la courbe d’évolution des effectifs des cas de
laryngomalacie confirmés à la nasofibroscopie par année, est globalement
croissante entre 2017 et 2021. Cette tendance s’explique d’une part, par une
accessibilité accrue à la nasofibroscopie au fil des années dans notre contexte. En
effet, le CHU-B a acquis son matériel de nasofibroscopie en 2020, ce qui justifie
le pic des effectifs observé en 2021. D’autre part, on note un nombre croissant de
médecins ORL, avec une tendance de ceux-ci à demander de plus en plus
systématiquement cet examen, pour confirmer la laryngomalacie.
4.2.2. Age
Dans la littérature, l’âge moyen des patients est très variable dans les différentes
études. Montero[9] en France, a retrouvé un âge moyen de 2,7 mois avec des
extrêmes allant de 01 jour à 15,5 mois. Hariga [44] en Tunisie, et Mandour [13]
en Egypte, retrouvaient respectivement un âge moyen de 5,1 mois et 6,3 mois.
Bahinwa [17] au Sénégal a, quant à lui, retrouvé un âge moyen de 7,2 mois avec
des extrêmes allant de 15 jours à 26 mois.
Si dans la littérature [3,7,29], il est couramment admis que la symptomatologie de
la laryngomalacie débute dans les premiers jours de vie, dans notre étude, nous
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 58
la ville de Ouagadougou
avons retrouvé un âge moyen de 3,97 mois avec un écart-type de 5,68 mois et des
extrêmes de 12 jours et 36 mois.
Ces résultats s’expliquent par un retard de consultation observé dans notre
contexte de manière globale, qui fait qu’un patient peut être vu à un âge plus
avancé, par rapport à l’âge de début de la symptomatologie. Ils s’expliquent
également par le fait que, l’intensité du stridor dans la laryngomalacie a tendance
à s’aggraver dans les 06 premiers mois de vie. Ce qui peut pousser les parents à
consulter dans cette période malgré un stridor présent depuis la période néonatale.
4.2.3. Sexe
Notre étude retrouvait une prédominance du sexe masculin, avec un sex ratio de
1,29. Cette prédominance masculine est retrouvée par plusieurs auteurs de la
littérature [9,44,45]. Au Sénégal, Bahinwa [17] retrouvait des résultats similaires
avec un sex ratio de 1,27. Il en est de même pour Yélémou [18] au Burkina Faso.
Ces résultats quasi-unanimes aussi bien dans la littérature, que dans notre
contexte, peuvent tirer leurs explications dans la théorie neurologique [45] de la
pathogénèse de la laryngomalacie. En effet, certains auteurs [9,46] évoquent
l’hypothèse d’une immaturité neurologique plus importante chez les garçons,
contribuant à la survenue de la laryngomalacie.
4.2.4. Résidence
La majorité de nos patients (soit 85,36%) résidait à Ouagadougou. Nos résultats
sont similaires à ceux de Yélémou [18] au Burkina Faso, qui notait quant à lui,
74,1% des cas à Ouagadougou.
Ces résultats pourraient s’expliquer, par le fait que notre étude s’est déroulée dans
des CHU qui étaient tous implantés dans la ville de Ouagadougou ; ce qui facilite
plus l’accès des résidents de cette localité aux différents CHU.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 59
la ville de Ouagadougou
4.3. Aspects cliniques
4.3.1. Antécédents
Dans la littérature, les reflux constituaient les antécédents les plus fréquents, avec
une fréquence allant de 44 à 100% des cas [3,9,47,48,49,50]. Cette fréquence de
l’association du reflux (RGO/RPL) à la laryngomalacie s’explique d’un point de
vue physiopathologique. En effet, selon la théorie neurologique [45], la
laryngomalacie est due à une dysfonction neurosensorielle, qui entraine un
manque de coordination des voies aériennes supraglottiques, avec pour
conséquence, une hypotonie quasi constante des muscles sous-hyoïdiens, et une
hypotonie du sphincter inférieur de l’œsophage. Cette hypotonie sphinctérienne
est un facteur favorisant la survenue du RGO.
Toutefois, dans notre étude, nous avons noté une fréquence des reflux estimée à
10,9%. Ils étaient nettement plus fréquents que les autres antécédents dont la
fréquence cumulée (rhinopharyngite, empyème cérébral, prématurité,
staphylococcie pleuro-pulmonaire) était en deçà de celle des reflux (soit 9,09%
des patients).
Nos résultats s’expliquent par le fait que les reflux ont été diagnostiqués
cliniquement dans notre étude, entrainant une sous-estimation de leur fréquence.
En effet, la pH-métrie permettant le diagnostic de RGO non évident
cliniquement[38], était utilisée dans les différentes cohortes de la littérature pour
diagnostiquer le RGO. Par conséquent, il est évident que nos résultats soient
différents de ceux de la littérature en termes de fréquence.
4.3.2. Signes fonctionnels
Dans la littérature, le stridor est perçu comme le signe le plus constant de la
laryngomalacie. En effet, Montero [9] en France, et Bahinwa [17] au Sénégal,
retrouvaient dans tous les cas de laryngomalacie un stridor. Au Burkina Faso,
Yélémou [18] et Nacoulma [20] ont retrouvé des résultats similaires. Dans notre
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 60
la ville de Ouagadougou
étude, nous sommes parvenus aux mêmes résultats, soit un stridor dans 100% des
cas.
Ces résultats s’expliquent d’un point de vue mécanique. En effet, le stridor est un
bruit inspiratoire secondaire à l’obstruction partielle des voies aériennes laryngo-
trachéales. La laryngomalacie, entrainant un collapsus de la sus-glotte, est par
conséquent une cause d’obstruction laryngée, ce qui explique que le stridor soit
constamment retrouvé dans cette pathologie.
Concernant la fréquence des autres signes fonctionnels dans notre étude, nous
avons noté une difficulté respiratoire dans 36,36% des cas, suivie par le cornage
dans 12,72% des cas. Les autres signes fonctionnels à savoir, la respiration
bruyante, la dysphonie, les vomissements, les régurgitations, la toux, l’apnée, la
dysphagie et la ronchopathie, surviennent chacun d’eux, dans moins de 10% des
cas.
Dans la littérature [9,10,13,17,44,51], on note par ordre décroissant, une
fréquence des difficultés respiratoires, allant de 8 à 44¨% des cas. Celle des
troubles alimentaires (régurgitation, vomissement, dysphagie) va de 6,4 à 40,9%.
L’apnée et la dysphonie sont retrouvées dans moins de 10% des cas chacun.
Ces résultats s’expliquent par certains cas de laryngomalacie notamment sévère,
où l’obstruction quasi-complète de la sus-glotte peut être responsable de difficulté
respiratoire, d’apnée ou de dysphonie
4.3.3. Signes physiques
Au cours de notre étude, nous avons noté que les signes physiques n’étaient
retrouvés que chez moins de 1/3 de nos patients (soit 29,09%). Les plus
fréquents étaient représentés par les signes de lutte respiratoire (12,72%), les
malformations (5,45%) et la bradypnée inspiratoire (5,45%).
Nos résultats se rapprochent de ceux de la littérature [9,17,51–54] où, les signes
physiques les plus fréquents sont : le tirage (sus-claviculaire et intercostal)
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 61
la ville de Ouagadougou
retrouvé dans 7,2 à 48% des cas, les malformations retrouvées dans 8 à 20% des
cas, le retard de croissance retrouvé dans 7,2 à 19% des cas. Les autres signes
physiques tels que le pectum excavatum ou la bradypnée inspiratoire sont
retrouvés dans moins de 10% des cas.
La faible fréquence des signes physiques (en dehors des signes endoscopiques)
dans notre étude, traduit le fait que la laryngomalacie est une maladie dont le
diagnostic se fait le plus souvent à l’interrogatoire, à travers la découverte d’un
stridor pendant ou après la période néonatale. Dans la majorité des cas, l’examen
physique (en dehors de l’endoscopie) est le plus souvent pauvre avec des signes
physiques qui se rapportent soit, à une forme sévère soit, à d’autres malformations
associées.
4.3.4. Signes et classification endoscopiques
• Réalisation de la nasofibroscopie
Dans la littérature, tous les auteurs [3,29,55] s’accordent sur le fait que la
nasofibroscopie est un examen clé qui permet la confirmation de la
laryngomalacie. Toutefois, dans notre étude, nous avons constaté que cet examen
était peu réalisé dans notre contexte. En effet, sur 137 cas de laryngomalacie
recensés, moins de la moitié des cas (soit 40,15%) ont bénéficié de la
nasofibroscopie. Nos résultats diffèrent de ceux de Montero [9] en France, et
Bahinwa [17] au Sénégal, chez qui la nasofibroscopie a été réalisée
respectivement, dans 100% et 89,29% des cas.
Cette faible réalisation de la nasofibroscopie s’explique par plusieurs raisons dont
les responsabilités sont situées à plusieurs niveaux. D’abord, au niveau du système
sanitaire, notons une faiblesse de nos plateaux techniques en termes de réalisation
de nasofibroscopie surtout chez l’enfant. En effet le CHU-T était le seul CHU à
Ouagadougou à réaliser cet examen en 2017 (début de notre étude). Il sera rejoint
en 2020 (soit 03 ans plus tard) par le CHU-B. Ensuite, au niveau du médecin ORL,
on notait par le passé, une faible prescription de la nasofibroscopie, car au regard
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 62
la ville de Ouagadougou
de la relative bénignité de la laryngomalacie, et vu le niveau de vie de la
population d’une manière générale, le rapport bénéfice-coût était en défaveur du
patient la plupart du temps ; ce qui avait tendance à limiter la prescription de la
nasofibroscopie chez les cas suspects. Enfin, au niveau du patient, on note la non-
réalisation de la nasofibroscopie lorsque celle-ci est prescrite. En effet, cet examen
est coûteux et non-pris en charge par la gratuité des soins chez les enfants de
moins de 05 ans au CHU-T.
• Signes endoscopiques
Les signes endoscopiques de la laryngomalacie étaient précisés chez tous nos
patients, et les plus fréquents étaient, l’épiglotte en oméga et l’aryténoïde épaissi,
retrouvés respectivement dans 30,9% et 25,45% des cas.
Nos résultats sont similaires à ceux de Bahinwa [17] au Sénégal, mais diffèrent
de ceux de Montero [9] en France, qui a noté que les signes endoscopiques les
plus fréquents, étaient l’excès muqueux postérieur (60,8%), et les replis ary-
épiglottiques courts (32,8%).
Cette différence peut s’expliquer d’un point de vue racial, car certains auteurs
évoquent l’hypothèse d’une présentation de la laryngomalacie différente, chez le
sujet noir et le sujet caucasien [7,56].
• Classification endoscopique
En utilisant la classification de Olney [31] dans notre étude, nous avons retrouvé
28 cas (soit 50,9 %) de type I, 21 cas (soit 38,19 %) de type II, et 06 cas (soit
10,9%) de type III.
Nos résultats sont différents de ceux de Reinhard [57] en Suisse, qui a retrouvé
26,6% de type I, 62% de type II et 11,4% de type III. Ils sont également différents
de ceux de Kusak[58] en Pologne, qui a retrouvé 53% de type I, 5% de type de II,
7% de type III et 35% de types combinés (type I+II et type I+III).
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 63
la ville de Ouagadougou
Les différences de nos résultats avec ceux de la littérature peuvent s’expliquer par
une hypothèse, qui suggère que la morphologie de la sus-glotte dans la
laryngomalacie est différente chez le sujet noir que chez le sujet caucasien [7,56].
Toutefois, notons qu’il existe plusieurs systèmes de classification endoscopique
dans la littérature [29,45,51,59], qui limite la comparabilité des données. Nous
avons utilisé celle de Olney [31], car elle est la classification la plus couramment
utilisée [58]. Cette multitude de systèmes de classification endoscopique est le
témoin de l’absence d’unanimité des auteurs sur la classification la plus
appropriée.
4.3.5. Gravité
En nous basant sur les critères de gravité définis par la SFORL [3], notre étude a
retrouvé 20% de cas sévères avec, comme signe de gravité, la dyspnée laryngée,
la détresse respiratoire et le SAOS.
Nos résultats sont en adéquation avec ceux de la littérature où les cas sévères
représentent entre 0 à 20% des cas [3,9,17,45,60,61] avec la détresse respiratoire,
comme signe de gravité le plus souvent retrouvé.
Cette fréquence des cas sévères s’explique par le fait que le larynx acquiert sa
maturité avec l’âge, réduisant ainsi le nombre de cas sévères, le plus souvent
marqués par une détresse respiratoire.
4.4. Aspects paracliniques
De manière globale, plusieurs auteurs de la littérature [3,9,45,60,61] s’accordent
sur l’intérêt d’une LDS surtout dans les cas sévères. En effet, celle-ci permet la
recherche d’autres anomalies des voies respiratoires qui sont découvertes dans
18,9% de l’ensemble des cas de laryngomalacie [62]. Ces anomalies sont plus
fréquentes dans les cas sévères, avec une fréquence allant de 55,3% à 79% des cas
sévères [63]. La place de la polysomnographie est importante, car elle permet de
confirmer le SAOS dont la prévalence peut atteindre 77,4% [64]. Il s’agit d’un
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 64
la ville de Ouagadougou
critère de gravité qui est également utilisé comme critère d’évaluation de la
réussite de la supraglottoplastie [42].
Toutefois, dans notre étude, aucun examen paraclinique n’a été réalisé, ni LDS,
ni polysomnographie. Ces résultats pourraient s’expliquer par la faible
accessibilité à ces examens ainsi que par le rapport bénéfice/risque en défaveur
du patient dans notre contexte.
4.5. Aspects thérapeutiques
La prise en charge de la laryngomalacie fait appel à différentes modalités
thérapeutiques. Le traitement chirurgical par supraglottoplastie fait l’unanimité
dans la littérature [3,29,45,60], pour les cas de laryngomalacie sévère, avec des
taux de succès élevés allant de 70 à 100% des cas [43]. Cependant, dans notre
étude, aucun patient n’a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale, malgré
qu’on ait noté 20% de cas sévères. Les mêmes résultats, retrouvés par Bahinwa
[17] au Sénégal, s’expliquent par l’incapacité des plateaux techniques dans notre
contexte, à réaliser une supraglottoplastie.
Concernant le traitement médical, plusieurs auteurs [3,7,29,45,55] suggèrent un
traitement anti-reflux systématique, au regard de la fréquence de l'association du
RGO à la laryngomalacie pouvant atteindre 100% des cas [49], mais aussi parce
que le RGO a un potentiel aggravant sur la laryngomalacie. Toutefois, des études
tendent à remettre en cause l’effet thérapeutique du traitement anti-reflux dans la
laryngomalacie [7,41]. Dans notre étude, le traitement anti-reflux était utilisé dans
9,09% des cas contrairement à Bahinwa [17] au Sénégal, qui a noté 82% de
traitement anti-reflux. Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que les
médecins ORL dans notre contexte, ont tendance à préférer une surveillance
simple, en témoigne la fréquence de cette option thérapeutique estimée à 65,45%
des cas dans notre étude. En effet, cette modalité thérapeutique a tendance à
produire de bons résultats, vu que la laryngomalacie se résout spontanément dans
près de 89% des cas selon certains auteurs [40].
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 65
la ville de Ouagadougou
4.6. Aspects évolutifs
4.6.1. Suivi des patients et délai de suivi
Dans notre étude, environ la moitié des cas (50,9%) ont été perdus de vue.
Seulement 49,09% des cas ont bénéficié d’au moins une visite de contrôle. En
observant les effectifs en fonction du délai de suivi, on note une courbe
décroissante sur une période de 06 mois. Après cette période, aucun patient n’était
suivi dans le cadre d’une laryngomalacie.
Dans la littérature, les taux de perdus de vue sont faibles, voire inexistants, car la
majorité des patients bénéficient d’au moins 01 visite de contrôle après la
consultation initiale [9,17].
Ces résultats pourraient être expliquées par plusieurs facteurs. D’abord, dans notre
contexte de pays en voie de développement, on observe une tendance au non-
respect des RDV de contrôle pour la plupart des pathologies bénignes comme la
laryngomalacie. Ensuite, la distance serait un facteur limitant pour le suivi des
patients résidant hors de la ville de Ouagadougou. Enfin, l’évolution de la
laryngomalacie mineure (forme la plus fréquente) se faisant vers la guérison
spontanée la plupart du temps, les parents ne jugent pas nécessaire de venir à une
visite de contrôle en l’absence d’une symptomatologie.
4.6.2. Evolution au cours du suivi
Pour les 27 patients suivis, l’évolution était favorable dans la plupart des cas suivis
(74,07%). Elle était stationnaire dans 25,93% des cas et on ne notait pas de cas
d’évolution défavorable ou de décès dans notre étude.
Ces résultats sont conformes à ceux de la littérature où les cas de laryngomalacie
évoluent favorablement dans la majorité des cas [3,7,55]. Fattah [53] en Egypte,
et Bahinwa [17] au Sénégal, retrouvaient des résultats similaires, soit
respectivement 81% et 98% d’évolution favorable. Cela pourrait s’expliquer par
le fait que la structure laryngée acquiert sa maturité avec le temps chez l’enfant.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 66
la ville de Ouagadougou
CONCLUSION
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 67
la ville de Ouagadougou
CONCLUSION
La laryngomalacie est la principale malformation congénitale laryngée. Dans
notre étude, cette pathologie était peu fréquente et se manifestait principalement
par un stridor avec un examen physique pauvre le plus souvent. La
nasofibroscopie, essentielle au diagnostic de cette pathologie, était peu réalisée
dans notre contexte à cause de la faiblesse du plateau technique. Au niveau
thérapeutique, la majorité des cas de laryngomalacie étaient uniquement
surveillées et l’évolution était favorable le plus souvent. Toutefois, les cas sévères,
qui nécessitaient une prise en charge chirurgicale, n’en ont pas bénéficiées à cause
du manquement d’équipement approprié.
Notre étude a certes, permis d’augmenter le niveau de connaissance sur la
présentation de la laryngomalacie au Burkina Faso, plus spécifiquement en milieu
hospitalier, mais des études prospectives plus avancées devraient permettre
ultérieurement d’identifier des facteurs de risques associés à la survenue de cette
pathologie dans notre contexte.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 68
la ville de Ouagadougou
SUGGESTIONS
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 69
la ville de Ouagadougou
SUGGESTIONS
Dans une perspective de contribuer à l’amélioration de la prise en charge de la
laryngomalacie dans notre contexte, nous formulons les suggestions suivantes à
l’endroit de toutes les parties prenantes.
• Au Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique
o Opérationnaliser l’assurance maladie universelle afin que la
nasofibroscopie soit accessible à toute la population.
• Au DG du CHU-YO
o Mettre à la disposition du service d’ORL/CCF du CHU-YO le
matériel nécessaire à la réalisation de la nasofibroscopie surtout chez
l’enfant.
• Aux DG des CHU-B, CHU-T, CHU-YO
o Améliorer le plateau technique des services d’ORL/CCF
• A la Société Burkinabè d’ORL (SO.B.ORL)
o Définir un protocole de prise en charge consensuel de la
laryngomalacie mineure et sévère ;
o Uniformiser la classification endoscopique à utiliser dans notre
contexte ;
o Assurer une formation continue des médecins ORL pour une maîtrise
des techniques de supraglottoplastie avant l’acquisition d’un
éventuel plateau technique opérationnel ;
• Aux chefs de services d’ORL/CCF des CHU-B, CHU-T, CHU-YO
o Veiller au bon usage du matériel par le personnel de santé ;
• Aux médecins ORL
o Demander systématiquement la nasofibroscopie pour confirmer la
laryngomalacie ;
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 70
la ville de Ouagadougou
• Aux médecins pédiatres
o Référer immédiatement tout nouveau-né, ou nourrisson présentant
un stridor ou une dyspnée laryngée à un médecin ORL pour
diagnostic étiologique et prise en charge.
• Aux étudiants et stagiaires internes
o Rédiger et remplir correctement les dossiers cliniques et les registres.
• A la communauté
o Respecter les RDV de contrôle fixés par le médecin ORL ou
pédiatre ;
o Veiller à l’observance thérapeutique de leurs enfants.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 71
la ville de Ouagadougou
REFERENCES
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 72
la ville de Ouagadougou
REFERENCES
1. Corsello G, Giuffrè M. Congenital malformations. J Matern Fetal Neonatal
Med. 1 avr 2012;25(sup1):25‑9.
2. Collège français d’ORL et de Chirurgie Cervico-Faciale, éditeur. Les
reférentiels des collèges-ORL. 4è édition. Paris: Elsevier Masson SAS; 2017.
3. Société Française d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie de la Face
et du Cou. Recommandation pour la pratique clinique: Laryngomalacie de
l’enfant. Paris; 2011.
4. Ayari-Khalfallah S, Perrot C, Pitiot V. Laryngomalacie. In: ORL de
l’enfant. Paris: Elsevier Masson SAS; 2017. p. 334. (Collection Pedia).
5. Rutter MJ. Congenital laryngeal anomalies. Braz J Otorhinolaryngol. déc
2014;80(6):533‑9.
6. Daniel SJ. The upper airway: congenital malformations. Paediatr Respir Rev.
2006;7 Suppl 1:S260-263.
7. Klinginsmith M, Goldman J. Laryngomalacia. In: StatPearls [Internet].
Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022
8. Simons JP, Greenberg LL, Mehta DK, Fabio A. Laryngomalacia and
swallowing function in children. The Laryngoscope. 1 févr 2016;126(2):478.
9. Montero M. Stridor du nouveau-né et du nourrisson en consultation d’ ORL
pédiatrique: diagnostic et prise en charge. Thèse de médecine. Clermont-
Ferrand: Université Clermont Auvergne; 2018; n°164; 83p.
10. Pokharel A. Prevalence of Laryngomalacia among Young Children
Presenting with Stridor in a Tertiary Care Hospital. JNMA J Nepal Med
Assoc. 15 oct 2020;58(230):712‑6.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 73
la ville de Ouagadougou
11. Soldatskiĭ IL, Zaĭtseva OV, Striga EV, Onufrieva EK, Tilikina LG.
[Epidemiological aspects of congenital stridor]. Vestn Otorinolaringol.
2012;(3):26‑9.
12. Zubair A, Sutton L, Murkin C, Chioralia A, Bajaj G, Bajaj Y. The
changing face of paediatric airway endoscopic surgery: An 8-year single
surgeon review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. mai 2022;156:111104.
13. Mandour Z, Fattah HMA, Gaafar AEH. Laryngomalacia: Diagnosis and
Management. Pediatr Res. nov 2011;70(5):419‑423.
14. Koné D. Aspects épidémiologiques et cliniques des pathologies pharyngo-
laryngées dans le Centre de Santé de Référence de la Commune V du District
de Bamako. Thèse de médecine. Bamako: Université des Sciences des
Techniques et des Technologies de Bamako; 2021; n°85; 119p.
15. Traoré AM. Revues des indications de la nasofibroscopie dans le service
d’ORL du CHU « Mère -Enfant » Le Luxembourg. Thèse de médecine.
Bamako: Université des Sciences des Techniques et des Technologies de
Bamako; 2021; n°105; 96p.
16. Ndiaye AN. Les urgences ORL pédiatriques. Thèse de médecine. Dakar:
Université Cheikh Anta Diop de Dakar; 2010; n°10; 107p.
17. Bahinwa B. Prise en charge du stridor laryngée congenital essentiel: A
propos de 50 cas colligés au service d’ORL de l’hôpital pour enfants de
Diamniadio. Thèse de médecine. Dakar: Université Cheikh Anta Diop de
Dakar; 2018; n°311; 74p.
18. Yélémou M. Malformations congénirales oto-rhino-laryngoloqiue de
l’enfant. Thèse de médecine. Ouagadougou: Université Joseph KI ZERBO;
2022; n°190; 148p.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 74
la ville de Ouagadougou
19. Sanon SS. Endoscopie ORL au CHU Tengandogo: Aspects
épidémiologiques, indications et résultats. Thèse de médecine.
Ouagadougou: Université Joseph KI ZERBO; 2020; n°443; 127p.
20. Nacoulma MA. La nasofibroscopie dans l’évaluation du stridor laryngé.
Thèse de médecine. Ouagadougou: Université Joseph KI ZERBO; 2021;
n°444; 103p.
21. Céruse P, Ltaief-Boudrigua A, Buiret G, Cosmidis A, Tringali S.
Anatomie descriptive, endoscopique et radiologique du larynx. In:
Encyclopédie Médico-Chirurgicale (EMC)-Oto-rhino-laryngologie. Paris:
Elsevier SAS; 2017.
22. Kamina P. Anatomie Clinique - Tête, Cou, Dos - Tome II. 4è édition. Paris:
Maloine; 2009.
23. Drake RL, Vogl W, Mitchell AW. Gray's Anatomy for students. Vol. 3è
édition. Paris: Elsevier Masson; 2006. 1111 p.
24. Société Française d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie de la Face
et du Cou. Le larynx de l’enfant. Paris; 2011. (Rapport).
25. Waugh A, Grant A. Ross et Wilson - Anatomie et physiologie normales et
pathologiquess. 12è édition. Paris: Elsevier Masson; 2015. 546 p.
26. Chandra RK, Gerber ME, Holinger LD. Histological insight into the
pathogenesis of severe laryngomalacia. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 19 oct
2001;61(1):31‑8.
27. Manning SC, Inglish AF, Mouzakes J. Laryngeal anatomic difference in
pediatric patients with severe laryngomalacia. Arch Otolaryngol Head Neck
Surg. 2005;131:340‑3.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 75
la ville de Ouagadougou
28. Thompson DM. Abnormal sensorimotor integrative function of the larynx
in congenital laryngomalacia: a new theory of etiology. The Laryngoscope.
juin 2007;117(6 Pt 2 Suppl 114):1‑33.
29. Teissier N. Crozat, T. Van D abbeele. Malformations congénitales du
larynx. In: Encyclopédie Médico-Chirurgicale (EMC)-Oto-rhino-
laryngologie. Paris: Elsevier SAS; 2017.
30. Sauvage JP. Guide d’ORL - Clinique et thérapeutique. Elsevier Masson;
2016. 291 p. (Collection ORL).
31. Olney DR, Greinwald JH, Smith RJ, Bauman NM. Laryngomalacia and
its treatment. The Laryngoscope. nov 1999;109(11):1770‑5.
32. Collège français des Enseignants de Pneumologie. Trouble du sommeil.
In: Pneumologie. 5è édition. Paris; 2017. p. 439. (Referentiel ECN).
33. Richter GT, Rutter MJ, deAlarcon A, Orvidas LJ, Thompson DM. Late-
onset laryngomalacia: a variant of disease. Arch Otolaryngol Head Neck
Surg. janv 2008;134(1):75‑80.
34. Saroul N, Thierry M. Conduite à tenir devant un stridor. In: ORL de
l’enfant. Paris: Elsevier Masson SAS; 2017. p. 334. (Collection Pedia).
35. Le Gac M, Vazel L, Trendel D, Marianowski R. Corps étrangers laryngo-
trachéo-bronchiques. In: Encyclopédie Médico-Chirurgicale (EMC)-Oto-
rhino-laryngologie. Paris: Elsevier SAS; 2017.
36. Yang D, Cascella M. Tracheomalacia. In: StatPearls [Internet]. Treasure
Island (FL): StatPearls Publishing; 2022
37. Harris K, Chalhoub M. Tracheal papillomatosis: what do we know so far?
Chron Respir Dis. 1 nov 2011;8(4):233‑5.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 76
la ville de Ouagadougou
38. Bourrillon A. Pédiatrie. 6è édition. Paris: Elsevier Masson; 2011. 944 p.
(Pour le Praticien).
39. Somogy A. ECNi - le tout en un. 2è édition. Paris: Elsevier Masson; 2018.
1415 p.
40. Isaac A, Zhang H, Soon SR, Campbell S, El-Hakim H. A systematic
review of the evidence on spontaneous resolution of laryngomalacia and its
symptoms. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. avr 2016;83:78‑83.
41. Apps JR, Flint JD, Wacogne I. Towards evidence based medicine for
paediatricians. Question 1. Does anti-reflux therapy improve symptoms in
infants with laryngomalacia? Arch Dis Child. avr 2012;97(4):385‑7;
discussion 387.
42. Ayari S, Aubertin G, Girschig H, Van Den Abbeele T, Denoyelle F,
Couloignier V, et al. Management of laryngomalacia. Eur Ann
Otorhinolaryngol Head Neck Dis. févr 2013;130(1):15‑21.
43. Meier JD, Nguyen SA, White DR. Improved growth curve measurements
after supraglottoplasty. The Laryngoscope. juill 2011;121(7):1574‑7.
44. Hariga I, Abid W, Ben ghrib I, Zribi S, Ben gamra O, Mbarek C. Prise
en charge des laryngomalacies : à propos de 25 cas. Ann Fr Oto-Rhino-
Laryngol Pathol Cervico-Faciale. 1 oct 2014;131(4, Supplement):A137‑8.
45. Reinhard A, Sandu K. Laryngomalacie : cause principale de stridor chez le
nourrisson et le petit enfant [Internet]. Revue Medicale Suisse. 2014
46. Bent J. Pediatric laryngotracheal obstruction: current perspectives on stridor.
The Laryngoscope. juill 2006;116(7):1059‑70.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 77
la ville de Ouagadougou
47. Dobbie AM, White DR. Laryngomalacia. Pediatr Clin North Am. 1 août
2013;60(4):893‑902.
48. Hartl TT, Chadha NK. A systematic review of laryngomalacia and acid
reflux. Otolaryngol--Head Neck Surg Off J Am Acad Otolaryngol-Head
Neck Surg. oct 2012;147(4):619‑26.
49. Jain D, Jain S. Management of Stridor in Severe Laryngomalacia: A Review
Article. Cureus. sept 2022;14(9):e29585.
50. Luebke K, Samuels TL, Chelius TH, Sulman CG, McCormick ME,
Kerschner JE, et al. Pepsin as a biomarker for laryngopharyngeal reflux in
children with laryngomalacia. The Laryngoscope. oct 2017;127(10):2413‑7.
51. Avelino MAG, Liriano RYG, Fujita R, Pignatari S, Weckx LLM.
Management of laryngomalacia: experience with 22 cases. Rev Bras
Otorrinolaringol. juin 2005;71:330‑4.
52. Cooper T, Benoit M, Erickson B, El-Hakim H. Primary Presentations of
Laryngomalacia. JAMA Otolaryngol Neck Surg. 1 juin 2014;140(6):521‑6.
53. Fattah HA, Gaafar AH, Mandour ZM. Laryngomalacia: Diagnosis and
management. Egypt J Ear Nose Throat Allied Sci. 1 nov 2011;12(3):149‑53.
54. Thompson DM. Laryngomalacia: factors that influence disease severity and
outcomes of management. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. déc
2010;18(6):564‑70.
55. Garabedian EN, Monteil JP, Triglia J michel, Bobin S. ORL de l’enfant.
2è édition. Paris: Médecine Sciences Publications; 2006. 446 p. (Pédiatrie).
56. Edmondson NE, Bent JP, Chan C. Laryngomalacia: The role of gender and
ethnicity. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1 déc 2011;75(12):1562‑4.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 78
la ville de Ouagadougou
57. Reinhard A, Gorostidi F, Leishman C, Monnier P. Laser supraglottoplasty
for laryngomalacia; a 14 year experience of a tertiary referral center. Eur
Arch Otorhinolaryngol. 13 août 2016;274(1):367‑74.
58. Kusak B, Cichocka-Jarosz E, Jedynak-Wasowicz U, Lis G. Types of
laryngomalacia in children: interrelationship between clinical course and
comorbid conditions. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017;274(3):1577‑83.
59. Van der Heijden M, Dikkers FG, Halmos GB. The groningen
laryngomalacia classification system—based on systematic review and
dynamic airway changes. Pediatr Pulmonol. 1 déc 2015;50(12):1368‑73.
60. Ayari S, Aubertin G, Girschig H, Van Den Abbeele T, Denoyelle F,
Couloignier V, et al. Laryngomalacie : prise en charge. Ann Fr Oto-Rhino-
Laryngol Pathol Cervico-Faciale. 1 févr 2013;130(1):15‑21.
61. Bedwell J, Zalzal G. Laryngomalacia. Semin Pediatr Surg. juin
2016;25(3):119‑22.
62. Mancuso RF, Choi SS, Zalzal GH, Grundfast KM. Laryngomalacia. The
search for the second lesion. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. mars
1996;122(3):302‑6.
63. Dickson JM, Richter GT, Meinzen-Derr J, Rutter MJ, Thompson DM.
Secondary airway lesions in infants with laryngomalacia. Ann Otol Rhinol
Laryngol. janv 2009;118(1):37‑43.
64. Verkest V, Verhulst S, Van Hoorenbeeck K, Vanderveken O, Saldien V,
Boudewyns A. Prevalence of obstructive sleep apnea in children with
laryngomalacia and value of polysomnography in treatment decisions. Int J
Pediatr Otorhinolaryngol. oct 2020;137:110255.
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans 79
la ville de Ouagadougou
ICONOGRAPHIE
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XXXV
la ville de Ouagadougou
ICONOGRAPHIE
A
C
A. Fibre optique ; B. Câble de lumière ; C. Partie oculaire
Figure 14: Image d'un nasofibroscope
Source : Service d’ORL/CCF du CHU-TENGANDOGO
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XXXVI
la ville de Ouagadougou
Arrière
Gauche
A B
1
2
2
A. Expiration ; B. Inspiration
1. Aryténoïde épaissi ; 2. Epiglotte en oméga
Figure 15: Vue endoscopique par nasofibroscopie d’une laryngomalacie chez un
nourrisson (14 mois) de sexe féminin montrant un collapsus inspiratoire
supraglottique.
Source : Service d’ORL/CCF du CHU-BOGODOGO
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XXXVII
la ville de Ouagadougou
ANNEXES
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XXXVIII
la ville de Ouagadougou
ANNEXE
Fiche de collecte de données
THEME : Laryngomalacie : Aspects diagnostiques et thérapeutiques
Numéro de la fiche:…………………
Date: …………………..
I. CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
1) Patient 2) Père
a) Nom :…………
a) Age (en année) :........
b) Prénom :………
b) Profession : Agriculteur☐Eleveur☐
c) Age (en mois et en jour si <1
mois) :………. Fonctionnaire public ☐
d) Sexe : M ☐ F☐ Salarié privé ☐
e) Ethnie : Mossi ☐Peulh☐Samo☐ Profession libérale☐
Dagara☐Gourounssi☐ Etudiant ☐Chômeur ☐
Bissa ☐ Autres :….. Autres :……..
f) Lieu de résidence :Ouaga☐
Hors-Ouaga☐
3) Mère
a) Age (en année) :........
b) Profession : Agricultrice☐Eleveuse☐
Fonctionnaire public ☐
Salariée du privé ☐
Profession libérale☐
Etudiante ☐Chômeuse ☐
Autres :……..
c) Ethnie ; : Mossi ☐Peulh☐Samo☐
Dagara☐Gourounssi☐ Bissa ☐ Autres :….
d) Déroulement de la grossesse :
- Pathologie maternelle chronique
HTA☐ Diabète ☐ Drépanocytose ☐ Asthme ☐ Epilepsie ☐ Anémie ☐
Autre :………..
- Infections maternelles durant la grossesse :
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XXXIX
la ville de Ouagadougou
Toxoplasmose☐ Rubéole☐ Hépatite B☐ VIH☐ CMV☐ Paludisme ☐
Autres :………
- Prise médicamenteuse et de toxique durant la grossesse :
Alcool☐ Tabac☐ Anti-épileptique☐ Psychotrope ☐ Autre ☐
II. DONNEES CLINIQUES
1) Motif de consultation : Stridor☐ Dyspnée ☐ Autres :………..
2) Antécédents personnels
a. Antécédents post-nataux :
Prématurité ☐ Faible poids de naissance ☐ grossesse gémellaire☐ Autre :…..
b. Antécédents médicaux :
Malnutrition☐Cardiopathie congénitale☐Malformation associé☐ (préciser:.…)
RGO☐ Autres ;……….
c. Antécédents chirurgicaux : …………………
3) Antécédents familiaux :
Consanguinité ☐ Malformation congénitale familial☐ Autre :………….
4) Signes fonctionnels :
- Stridor ☐ Dyspnée ☐ Régurgitations ☐ Vomissement☐
Dysphagie☐ Pleurs incessants☐ Difficultés de téter ☐
Respiration bruyante☐ Autre :…………….
- Date de début :……………….
- Délai d’apparition des signes ……….
- Durée d’évolution des signes :……………..
- Facteurs déclenchants : Agitation ☐ Pleurs☐ Alimentation☐
Flexion de la colonne cervicale☐ Autre :…………..
- Facteurs calmants : Extension de la colonne cervicale☐
Respiration calme☐ Décubitus ventral☐ Autre :…………….
5) Signes généraux
- Etat général : Bon☐ Assez-bon☐ Mauvais☐
- Etat de conscience : altéré ☐ bon ☐
préciser si score de blantyre ou de Glasgow :……………
- Poids :…….
- Taille :…….
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XL
la ville de Ouagadougou
- Rapport P/T :……….
- Coloration cutanéo-muqueuse : Cyanose☐ Pâleur☐
-
6) Signes physiques à l’examen ORL :
- Peau cervico-faciale :…………….
- Rhinoscopie antérieure :……………..
- Cavité buccale :………..
- Oropharynx :………..
- Autre :……………….
7) Examen des autres appareils et système :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
8) Signes de gravité
- Détresse respiratoire☐ Retard de croissance staturo-pondérale☐
- Dyspnée laryngée☐ Rétraction thoracique évolutive☐
- Episode de suffocation lors de l’alimentation ☐
- Difficulté de prise alimentaire☐
- Apnée obstructive du sommeil☐
9) Sévérité de la laryngomalacie : Mineure ☐ Sévère☐
III. DONNEES PARACLINIQUES
1) Endoscopie ORL
a. Types d’endoscopie :
Nasofibroscopie☐Laryngoscopie directe en suspension ☐
b.Signes endoscopiques (identique pour nasofibroscopie et LDS)
- Collapsus inspiratoire de la sus-glotte : Partiel☐ Complet☐
- Replis ary-épiglottiques courts☐
- Bascule antérieure des massifs aryténoïdiens☐
- Bascule postérieure de l’épiglotte☐
- Aspect anormal de l’épiglotte :
Tubul aire☐ en « chapeau de gendarme »☐ en « oméga »☐
- Œsophagite ☐ Autres lésions associées :…………….
2) Imagerie :
- Radiographie du larynx :…………..
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XLI
la ville de Ouagadougou
- TDM laryngée :………………
3) Biologie :
- Gazométrie : …………………
- pH-métrie :…….
4) Polysomnographie :………………………….
5) Autre bilan réalisé :…………………
IV. DONNEES THERAPEUTIQUES
1) Mode de prise en charge : Ambulatoire☐ Hospitalisation☐
2) Surveillance médicale (sans traitement)☐
3) Mesures hygiéno-diététiques :
Eviter décubitus post-prandial☐ Eviter vêtement comprimant l’abdomen☐
Autres :………………………
4) Traitement médical
- Antisécrétoire (IPP ou Anti-H2) ☐ Anti-acide☐ Alginate ☐
Prokinétique☐
- Oxygénothérapie☐ Autre :………………
5) Traitement chirurgical
a. Gestes :
- Trachéotomie☐
- Supraglottoplastie : section des plis ary-épiglottiques☐
Résection des excès muqueux de la margelle laryngée☐
Autres :……………
b. Instruments utilisés :
Laser CO2☐ laser thulium☐ laser diode ☐ micro débrideur☐ Autre: …
V. EVOLUTION-COMPLICATIONS
- Favorable☐ Défavorable☐
- Si évolution favorable, préciser : réduction stridor☐
amélioration détresse respiratoire☐ Gain pondéral☐
Autres :……..
- Complications : spasme laryngée☐ Œdème laryngée☐
hémorragies ☐ bride cicatricielle☐ sténose supraglottique☐
Surinfection ☐ Arrêt cardio-respiratoire ☐
- Echec du traitement : ☐
- Décès :☐
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XLII
la ville de Ouagadougou
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XLIII
la ville de Ouagadougou
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XLIV
la ville de Ouagadougou
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XLV
la ville de Ouagadougou
-
SERMENT
D’HIPPOCRATE
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XLVI
la ville de Ouagadougou
SERMENT D’HIPPOCRATE
« En présence des Maîtres de cette école et de
mes chers condisciples, je promets et je jure
d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la
probité dans l’exercice de la médecine.
Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et
n’exigerai jamais de salaire au- dessus de mon
travail.
Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne
verront pas ce qui s’y passe, ma langue taira les
secrets qui me seront confiés et mon état ne
servira pas à corrompre les mœurs, ni à
favoriser le crime.
Respectueux et reconnaissant envers mes
Maîtres, je rendrai à leurs enfants l’instruction
que j’ai reçue de leurs pères.
Que les hommes m’accordent leur estime si je
suis resté fidèle à mes promesses. Que je sois
couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères
si j’y manque. »
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XLVII
la ville de Ouagadougou
RESUME
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XLVIII
la ville de Ouagadougou
RESUME
Titre : Laryngomalacie : aspects épidémiologiques, diagnostiques et
thérapeutiques dans la ville de Ouagadougou
Objectif : Etudier la laryngomalacie dans ses aspects épidémiologiques,
diagnostiques et thérapeutiques dans les CHU de la ville de Ouagadougou,
disposant d’un service d’ORL/CCF (CHU-B, CHU-T, CHU-YO).
Matériel et méthodes : Nous avons mené une étude descriptive et analytique à
collecte de données rétrospective durant 05 ans, allant du 1er Janvier 2017 au 31
Décembre 2021, dans les services ORL/CCF de trois CHU de la ville de
Ouagadougou (CHU-YO, CHU-B, CHU-T).
Résultats : Nous avons recensé durant cette période 137 cas de laryngomalacie,
dont 55 (40,15%) ont été confirmés par une nasofibroscopie et inclus dans notre
étude. L’âge moyen des patients était de 3,97±5,68 mois. Le sexe masculin
représentait 31 cas et le sexe féminin 24 cas (sex ratio=1,29). On notait des
antécédents dans 11 cas (soit 20%) avec parmi eux un reflux dans 06 cas (soit
10,9%). Le stridor était le symptôme constant chez tous les patients et on notait
11 cas (soit 20%) de laryngomalacie sévère. La nasofibroscopie retrouvait plus
fréquemment une épiglotte en oméga et un aryténoïde épaissi, avec 50,9 % de
type I, 38,19% de type II et 10,9% de type III La prise en charge se résumait en
une simple surveillance le plus souvent (65,45%), sans aucun traitement
chirurgical. La moitié de nos patients étaient perdus de vue. Pour les patients
suivis, l’évolution était favorable dans 74,07% et stationnaire dans 25,93%.
Conclusion : La laryngomalacie est bénigne la plupart du temps, avec une prise
en charge consistant en une surveillance le plus souvent. Son diagnostic nécessite
une nasofibroscopie, peu réalisée dans notre contexte.
Mots-clés : laryngomalacie, stridor, nasofibroscopie, CHU, Ouagadougou, BF
Auteur : BAZIEMO Auguste. Email : baziemo.auguste@gmail.com
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans XLIX
la ville de Ouagadougou
ABSTRACT
Title : Laryngomalacia: epidemiological, diagnostic and therapeutic aspects in the
city of Ouagadougou
Objective: To study the epidemiological, diagnostic and therapeutic aspects of
laryngomalacia in the university hospitals of the city of Ouagadougou, with an
ENT/CCF department (CHU-B, CHU-T, CHU-YO).
Material and methods: We conducted a descriptive and analytical study with
retrospective data collection over a period of five years, from 1 January 2017 to
31 December 2021, in the ENT/CCF departments of three university hospitals in
Ouagadougou (CHU-YO, CHU-B, CHU-T).
Results: During this period, we identified 137 cases of laryngomalacia, of which
55 (40.15%) were confirmed by nasofibroscopy and included in our study. The
mean age of the patients was 3.97±5.68 months. Males accounted for 31 cases and
females for 24 cases (sex ratio=1.29). There was a history of reflux in 11 cases
(20%), with reflux in 06 cases (10.9%). Stridor was a constant symptom in all
patients and 11 cases (20%) had severe laryngomalacia. Nasofibroscopy more
frequently found an omega-shaped epiglottis and a thickened arytenoid, with
50.9% of type I, 38.19% of type II and 10.9% of type III. The management
consisted of simple surveillance most often (65.45%), without any surgical
treatment. Half of our patients were lost to follow-up. For the patients followed
up, the evolution was favourable in 74.07% and stationary in 25.93%.
Conclusion: Laryngomalacia is benign in most cases, with management
consisting of surveillance in most cases. Its diagnosis requires a nasofibroscopy,
which is rarely performed in our context.
Keywords: laryngomalacia, stridor, nasofibroscopy, CHU, Ouagadougou, BF
Author : BAZIEMO Auguste. Email : baziemo.auguste@gmail.com
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans L
la ville de Ouagadougou
LARYNGOMALACIE : Aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques dans LI
la ville de Ouagadougou
You might also like
- Pre-NEET Obstetrics and Gynaecology (Sakshi Arora)Document321 pagesPre-NEET Obstetrics and Gynaecology (Sakshi Arora)sipra jagu100% (4)
- Supercharge Your Professional Learning: 40 Concrete Strategies that Improve Adult LearningFrom EverandSupercharge Your Professional Learning: 40 Concrete Strategies that Improve Adult LearningNo ratings yet
- The Efficacy of Sensory Integration Therapy On Children With Asperger's Syndrome and Pdd-NosDocument278 pagesThe Efficacy of Sensory Integration Therapy On Children With Asperger's Syndrome and Pdd-NosAbu FayyadhNo ratings yet
- ACKNOWLEDGEMENTSDocument2 pagesACKNOWLEDGEMENTSramil_sanchezNo ratings yet
- Application Letter For NursesDocument1 pageApplication Letter For NursesJerome Vergara100% (2)
- Valedictory SpeechDocument6 pagesValedictory SpeechMichael BudziNo ratings yet
- Akinbode Mosunmola OluwafunmilayoDocument331 pagesAkinbode Mosunmola OluwafunmilayoMëhâk AfzalNo ratings yet
- Indication NasoDocument92 pagesIndication NasoCréole GomezNo ratings yet
- Closing RemarksDocument1 pageClosing RemarksMary Rose Bantog100% (1)
- Mémoire de Fin D'études de MasterDocument83 pagesMémoire de Fin D'études de MasterEmmanuel AmoussouNo ratings yet
- LFD Med WardDocument2 pagesLFD Med WardCarey Jamille YadanNo ratings yet
- New Microsoft Word DocumentDocument3 pagesNew Microsoft Word DocumentCharles DoradoNo ratings yet
- To All of You Who Are Present Here TodayDocument4 pagesTo All of You Who Are Present Here Todayagramilo777No ratings yet
- PDFDocument390 pagesPDFUtsav SoniNo ratings yet
- Acknowledgement Psychia CasepresDocument1 pageAcknowledgement Psychia Casepreslouie john abilaNo ratings yet
- Tese Final Inês NogueiraDocument66 pagesTese Final Inês NogueiraCarolina AlvesNo ratings yet
- DVM Achu MercyDocument70 pagesDVM Achu MercynjonjichakunteoliverNo ratings yet
- DedicationDocument2 pagesDedicationNeils MicNo ratings yet
- Memoire Soumaila Ouedraogo, DefinitiveDocument163 pagesMemoire Soumaila Ouedraogo, DefinitiveOuedraogo SoumailaNo ratings yet
- Tes Is CristianDocument201 pagesTes Is CristianDiego Medina MoralesNo ratings yet
- Messages - DR Libre and Pres DoctoDocument3 pagesMessages - DR Libre and Pres DoctoALden Badango MacahiligNo ratings yet
- Talumpati Ni Renz B. Agal Sa Ika-42 Pagtatapos NG Cagayan State University - Sanchez Mira, June 21, 2020 (Virtual CeremoniesDocument2 pagesTalumpati Ni Renz B. Agal Sa Ika-42 Pagtatapos NG Cagayan State University - Sanchez Mira, June 21, 2020 (Virtual CeremoniesRheinz AgcaoiliNo ratings yet
- Citrullus Lanatus) TEA: Watermeon (Document31 pagesCitrullus Lanatus) TEA: Watermeon (MJ SantiagoNo ratings yet
- Ladies and GentlemenDocument1 pageLadies and Gentlemenjijifinn1No ratings yet
- School Based Feeding Program Milk & Nutritious Food Products Component Kick Off ActivityDocument8 pagesSchool Based Feeding Program Milk & Nutritious Food Products Component Kick Off ActivityCherry Mae David JakosalemNo ratings yet
- Vote of Thanks Newest VersionDocument1 pageVote of Thanks Newest VersionAlex BarrettNo ratings yet
- Final Chapter 1 3 Postpartum Beliefs Practices BurgosDocument96 pagesFinal Chapter 1 3 Postpartum Beliefs Practices BurgoscherryNo ratings yet
- ACKNOWLEDGEMENTDocument5 pagesACKNOWLEDGEMENTNesha SaripNo ratings yet
- A Vote of Thanks Speech Given by A Graduand at The 1ST Graduation Ceremony Held at Kwame Nkrumah University On The 7TH AugustDocument2 pagesA Vote of Thanks Speech Given by A Graduand at The 1ST Graduation Ceremony Held at Kwame Nkrumah University On The 7TH AugustJive LubbunguNo ratings yet
- MessagesDocument7 pagesMessagesreyclifford.marollanoNo ratings yet
- 19 MC TG-3796 - Arrivillaga HernándezDocument55 pages19 MC TG-3796 - Arrivillaga HernándezRoel ChameNo ratings yet
- A Technical Report of The Work Immersion ActivitiesDocument20 pagesA Technical Report of The Work Immersion ActivitiesMark Vincent JanoyogNo ratings yet
- Words of GratitudeDocument4 pagesWords of Gratitudelinn kimNo ratings yet
- DocumentDocument1 pageDocumentnwaladavid58No ratings yet
- Speech Ni PepoDocument2 pagesSpeech Ni PepoFerdinand Y. SilaranNo ratings yet
- ChacónF ADocument240 pagesChacónF AJoselyn HILARIO BENITESNo ratings yet
- Opening RemarksDocument1 pageOpening RemarksGlydel Joy GambeNo ratings yet
- Speech - 4Document3 pagesSpeech - 4cristhellositano09222005No ratings yet
- Honorato C. Perez SR., Memorial Science High School Senior High School DepartmentDocument20 pagesHonorato C. Perez SR., Memorial Science High School Senior High School DepartmentBeverly DatuNo ratings yet
- AckndmtDocument2 pagesAckndmtAvenilla Mhelchor ChristianNo ratings yet
- AKNOWLDEGEMENTDocument2 pagesAKNOWLDEGEMENTIcel Jean QuimboNo ratings yet
- To Accomplish Great Things, We Must Not Only Act, But Also Dream Not Only Plan, But AlsoDocument2 pagesTo Accomplish Great Things, We Must Not Only Act, But Also Dream Not Only Plan, But AlsoCynthia Luay100% (2)
- Stres NurseDocument137 pagesStres NursesbjnNo ratings yet
- Arfa Day 2Document4 pagesArfa Day 2Carey Jamille YadanNo ratings yet
- Presented To The Faculty of The College of Health Sciences University of Northern Philippines Vigan City, Ilocos SurDocument50 pagesPresented To The Faculty of The College of Health Sciences University of Northern Philippines Vigan City, Ilocos SurAlvarez StevenNo ratings yet
- Te Manu Tauira Handbook 2019Document40 pagesTe Manu Tauira Handbook 2019Anonymous 5RDfaHNo ratings yet
- Speech To PrintDocument5 pagesSpeech To PrintPirot CyFarNo ratings yet
- Narrative ReportDocument5 pagesNarrative ReportFratzlyn LaraNo ratings yet
- ACKNOWLEDGEMENTS PRTFLDocument70 pagesACKNOWLEDGEMENTS PRTFLJennifer Anciano MataNo ratings yet
- James Ouma FinalDocument268 pagesJames Ouma FinalsammarkkaggwaNo ratings yet
- Joseline Proposal Finale (RepairedDocument22 pagesJoseline Proposal Finale (RepairedMwebaza JoshuaNo ratings yet
- AcknowledgementDocument1 pageAcknowledgementKaren Serrano LadrilloNo ratings yet
- A Welcome Address Delivered by Shara Jane Tibon On Her High Graduation at SLSUDocument2 pagesA Welcome Address Delivered by Shara Jane Tibon On Her High Graduation at SLSUjetzon2022100% (4)
- Cover LetterDocument1 pageCover LetterZeshanNo ratings yet
- G12-TVL-ICT-Group-2-MANUSCRIPTDocument204 pagesG12-TVL-ICT-Group-2-MANUSCRIPTreyesmichiko15No ratings yet
- SpeechDocument2 pagesSpeechKeosha CimafrancaNo ratings yet
- Female Dentists: Their Professional Live and ConcernsDocument77 pagesFemale Dentists: Their Professional Live and ConcernsNoble LoveNo ratings yet
- SpeechDocument1 pageSpeechDaryll Jeremy VirtudesNo ratings yet
- 3 AcknowledgmentDocument2 pages3 AcknowledgmentJesha Carl Jotojot100% (1)