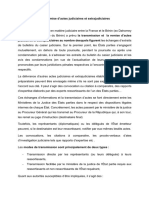Professional Documents
Culture Documents
La Qualité de La Justice 5
La Qualité de La Justice 5
Uploaded by
rwatzaCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
La Qualité de La Justice 5
La Qualité de La Justice 5
Uploaded by
rwatzaCopyright:
Available Formats
La qualité des décisions de justice. Quels critères ?
Hélène Colombet, Alice Gouttefangeas
Dans Droit et société 2013/1 (n° 83), pages 155 à 176
Éditions Éditions juridiques associées
ISSN 0769-3362
ISBN 9782275028781
DOI 10.3917/drs.083.0155
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
Article disponible en ligne à l’adresse
https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2013-1-page-155.htm
Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s’abonner...
Flashez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.
Distribution électronique Cairn.info pour Éditions juridiques associées.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le
cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque
forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est
précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
La qualité des décisions de justice. Quels critères ?
Hélène Colombet, Alice Gouttefangeas
Centre de recherches critiques sur le droit (CERCRID/CNRS), Université Jean Monnet, 6 rue Basse des Rives,
F-42023 Saint-Étienne cedex 2.
<helene.colombet@univ-st-etienne.fr>
<alice.gouttefangeas@univ-st-etienne.fr>
Résumé Les études au sujet de la qualité de la justice et de ses décisions sont relati-
vement récentes : elles portent sur une notion qu’il nous paraît essentiel
d’examiner de façon approfondie. Cet article se propose donc d’étudier deux
types de réflexions portant sur la qualité des décisions de justice. La première
analyse le discours de la doctrine, qui s’est attachée à déterminer un certain
nombre de critères. La seconde adopte une approche critique sur ceux qui
sont mis en place par l’État dans le cadre des réformes du service public de la
justice. La comparaison des deux discours révèlera l’existence d’un décalage
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
entre deux conceptions différentes de la qualité des décisions. En effet,
l’approche choisie par les pouvoirs publics se caractérise par une logique
gestionnaire et managériale qui ne se retrouve pas dans le discours tenu par
la doctrine. Dès lors, il sera question de rechercher de quelle manière se
traduisent ces divergences en termes de détermination de critères.
Critères – Décision de justice – Managérialisation – Qualité.
Summary The Quality of Judicial Decisions: Which Criteria?
Studies on the quality of judicial decisions are relatively recent and are
based on the fundamental notion needing thorough examination. There-
fore, this article will put forward two areas of reflection regarding the quality
of judicial decisions. The first one will analyze the discourse of the doctrine
which has so far endeavored to establish a list of criteria. The second one
will emphasize a critical approach concerning the standards selected by the
government within the limits of a reform of the judicial system. The com-
parison of those two types of discourse will reveal a gap due to a difference
of perceptions. They do not perceive the quality of judicial decisions in the
same way. Undeniably, the option chosen by the public authorities is main-
ly that of an administrative and managerial logic, in opposition to the dis-
course of the doctrine. We will therefore focus on how those oppositions
lead to different choices of criteria.
Criteria – Judicial decisions – Management movement – Quality.
Droit et Société 83/2013 155
H. COLOMBET, A. GOUTTEFANGEAS
Ce respect, cette sainte frayeur, et
cette espèce de religion, avec laquelle on
dirait que le timide plaideur y vient in-
voquer la puissance du magistrat […],
l’autorité suprême et le destin irrévocable
des oracles qui sortent de sa bouche, tout
semble l’élever au-dessus de l’homme, et
l’approcher de la divinité 1.
(Chancelier D’AGUESSEAU)
Le magistrat n’est plus, aujourd’hui, entouré d’une telle aura et les critiques à
l’égard de la justice sont abondantes. Nombreux sont les reproches à l’encontre de
sa lenteur, son coût, son manque de transparence, son éloignement, sa distance par
rapport aux individus… Des sondages ont révélé qu’elle avait, dans l’opinion pu-
blique, une image « rébarbative et incertaine » 2, au point qu’une rupture semble se
former entre les attentes des justiciables et la réalité de la justice 3.
La notion de qualité n’a fait son apparition dans le domaine de la justice que vers
la fin des années 1990 4. Ce terme de qualité peut être défini comme l’« ensemble des
caractères, des propriétés qui font que quelque chose correspond bien ou mal à sa
nature, à ce qu’on en attend » 5. Le terme de qualité est associé tantôt à la justice
elle-même tantôt aux décisions qu’elle rend. La notion de qualité de la justice est
difficile à appréhender. Elle est « la synthèse complexe de facteurs nombreux, rele-
vant de plans différents et qui ne peuvent tous être saisis par les mêmes outils » 6.
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
Celle de la décision de justice est plus restreinte. Elle constitue « une composante
majeure de la qualité de la justice » 7. Nous avons choisi de concentrer l’étude sur
l’analyse des décisions de justice entendues comme le résultat d’un processus à
l’occasion duquel le juge dit le droit. Sont ainsi visées toutes celles rendues par un
organe doté d’un pouvoir juridictionnel 8.
Si la notion de qualité est récente, les décisions de justice sont depuis longtemps
soumises à un contrôle. Toutefois, il est possible de constater une évolution dans celui-
ci. Benoît Frydman 9 a ainsi mis en évidence le fait que la manière dont nous appré-
1. Chancelier D’AGUESSEAU, « L’autorité du magistrat et sa soumission à l’autorité de la loi », in ID., Œuvres
complètes, Paris : Didot, 1858, p. 85.
2. Philippe ARDANT, Jean GICQUEL et Hugues PORTELLI, « La justice », Pouvoirs, 16, 1981, p. 3.
3. Guy CANIVET, Discours prononcé lors de l’audience solennelle de début d’année judiciaire, janvier
2002.
4. Antoine VAUCHEZ, « Les jauges du juge. La justice aux prises avec la construction de sa légitimité », in Pascal
MBONGO (dir.), La qualité des décisions de justice, Strasbourg : Éditions du Conseil de l’Europe, 2007, p. 60.
5. Définition du dictionnaire Larousse.
6. Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ), Check-list pour la promotion de la
qualité de la justice et de ses tribunaux, juillet 2008.
7. Conseil consultatif des juges européens (CCJE), avis n° 11 (2008), à l’attention du Comité des ministres
du Conseil de l’Europe sur la qualité des décisions de justice.
8. Gérard CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, Paris : PUF, coll. « Quadrige », 9e éd., 2011. (V° « juge »,
acception 1).
9. Benoît FRYDMAN, « L’évolution des critères et des modes de contrôle de la qualité des décisions de
justice », in Pascal MBONGO (dir.), La qualité des décisions de justice, op. cit., p. 18.
156 Droit et Société 83/2013
La qualité des décisions de justice. Quels critères ?
hendons la justice a évolué. Il identifie trois conceptions des décisions de justice et
considère l’hypothèse d’un « glissement progressif » d’une conception substantielle
vers une conception procédurale puis managériale.
La qualité des décisions de justice peut être évaluée selon une conception dite
« substantielle » et son contrôle est alors nécessairement confié à des juridictions
supérieures. Il s’agit de se pencher sur le fond de la décision. Ce contrôle de la qualité
substantielle de la décision a lui-même évolué. D’abord, le contrôle de légalité sup-
pose une décision conforme à la loi. Même si cette dernière semble injuste, elle doit
s’imposer sur la raison du juge. Ensuite, le contrôle de proportionnalité est apparu.
Avec cette conception, « le droit est désormais considéré comme un instrument de
régulation. La décision de justice a pour fonction de trouver la solution des conflits
d’intérêts qui surgissent dans la société 10. » L’objectif du juge n’est plus de rendre
une décision conforme à la loi, mais de rendre une décision qui privilégie l’intérêt
prépondérant : le résultat obtenu doit être équilibré. Se développe ensuite un con-
trôle de proportionnalité : « Par un tel contrôle, […] le juge supérieur n’entend pas
substituer son appréciation à celle de la décision contrôlée, mais il vérifie seulement
que le juge contrôlé n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation dans la
balance des intérêts en jeu 11. » Ce système a connu un grand succès sur le continent
européen et en particulier auprès des juges de la Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH) 12. Enfin, le contrôle de motivation suppose que : « La décision de
justice ne procède ni d’une démonstration, ni d’un calcul, mais bien d’un choix, qui
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
n’est pas pour autant arbitraire dès lors qu’il s’appuie sur une argumentation con-
vaincante. La qualité de la décision de justice ne se mesure donc pas à son exactitude
ni à ses effets, mais bien à la qualité de l’argumentation qui la soutient et que le juge
développe dans la motivation de son jugement 13. » La motivation devient un travail
d’argumentation. L’objectif est « de provoquer ou d’accroître l’adhésion d’un audi-
toire aux thèses qu’on présente à son assentiment » 14. Il convient de souligner que,
dans tous les cas et même assortie d’une motivation convaincante, la décision de
justice ne peut pas aller à l’encontre des ordres de la loi. Si le contrôle de la qualité
substantielle des décisions a évolué, la conformité de cette dernière à la loi demeure
essentielle.
Cette conception substantielle de la qualité de la justice précède la conception
procédurale, qui s’est développée dans la seconde moitié du XXe siècle, avec l’essor
de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon cette logique, « le ma-
gistrat est d’abord l’arbitre d’un débat contradictoire entre les parties à la cause, qui
doit permettre à celles-ci de développer, à l’appui de leurs thèses, des arguments,
10. Ibid., p. 21.
11. Ibid., p. 22.
12. Sébastien VAN DROOGHENBROECK, La proportionnalité dans le droit de la convention européenne des
droits de l’homme. Prendre l’idée simple au sérieux, Bruxelles : Bruylant, 2001.
13. Benoît FRYDMAN, « L’évolution des critères et des modes de contrôle de la qualité des décisions de
justice », art. cité, p. 23
14. Chaïm PERELMAN, L’empire rhétorique, Paris : J. Vrin, coll. « Bibliothèque des textes philosophiques »,
1997, p. 23.
Droit et Société 83/2013 157
H. COLOMBET, A. GOUTTEFANGEAS
auxquels le tribunal sera d’ailleurs tenu de répondre dans son jugement » 15. Une
décision de qualité devient donc une décision qui laisse la place à la discussion
contradictoire, c’est-à-dire au contrôle du respect des droits de la défense et des
garanties du procès équitable. Ce n’est pas la seule condition pour que la décision
soit de qualité, mais il s’agit d’une condition désormais nécessaire.
Selon B. Frydman 16, plusieurs facteurs vont contribuer à la montée en puissance
d’une vision managériale de la qualité des décisions de justice, fondée sur la perfor-
mance. Cette conception de la qualité se focalise sur l’évaluation de l’administration
et du fonctionnement de l’institution judiciaire. Il faut noter en particulier l’arrivée
de la doctrine du « Nouveau management public » 17, logique de gestion conçue
comme devant améliorer la qualité du service public. De manière plus ou moins
importante et sous des formes diverses, ce processus a touché l’ensemble des pays
de l’OCDE 18 et de multiples pays en développement. Cette doctrine tranche avec
les conceptions anciennes : alors que les secondes empruntaient la voie du contrôle
de légalité ou de proportionnalité, la première emprunte les méthodes du mana-
gement avec des normes de références, des indicateurs chiffrés, des procédures
d’évaluation périodiques, une définition d’objectifs de performance et de rende-
ment… 19. En 2008, Didier Marshall s’est penché sur l’impact de cette réforme sur
les juridictions. Ce texte controversé marque une volonté de l’État de « révolution-
ner les finances publiques en substituant une logique de performance et de résul-
tats à une logique de moyens » 20.
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
La question qu’il est possible de soulever est celle de savoir qui détermine les
critères de qualité des décisions de justice et dans quel objectif ils sont fixés.
Il ne s’agit pas ici d’identifier ce que seraient les critères objectifs de qualité mais
de rechercher et d’analyser les critères de qualité des décisions de justice, tels qu’ils
sont identifiés et déterminés par les divers travaux sur le sujet. Cette analyse nous a
permis d’identifier deux types de réflexion sur la qualité des décisions de justice, les-
quelles relèvent de deux logiques distinctes. En premier lieu, nous exposerons ce que
les auteurs étudiés considèrent comme constituant des critères de qualité des déci-
sions (I). En second lieu, nous verrons que la volonté de l’État d’améliorer les déci-
sions de justice se traduit par des critères tout à fait différents (II).
15. Benoît FRYDMAN, « L’évolution des critères et des modes de contrôle de la qualité des décisions de
justice », art. cité, p. 24.
16. Ibid., p. 18.
17. Voir les développements de Jonathan BOSTON, John MARTIN, June PALLOT et Pat WALSH, Public Manage-
ment: The New Zealand Model, Auckland : Oxford University Press, 1996.
18. Organisation de coopération et de développement économiques.
19. Cette démarche a également été adoptée en France, y compris dans le domaine de la justice. Nous ver-
rons, au cours d’une seconde partie, quels sont les critères et objectifs qui ont été retenus par la France.
20. Didier MARSHALL, « L’impact de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) sur les juridic-
tions », Revue française d’administration publique, 125, 2008, p. 121.
158 Droit et Société 83/2013
La qualité des décisions de justice. Quels critères ?
I. Les critères de la qualité des décisions de justice dégagés par les auteurs
L’étude de la qualité des décisions de justice ne se réduit pas à la décision telle
qu’elle est rendue par le juge à l’issue du litige. Cette étude est beaucoup plus large
et implique d’une manière générale l’ensemble des éléments qui concourent à la
production de la décision. Ainsi, l’analyse des travaux portant sur la qualité des
décisions de justice permet de constater que les auteurs consacrent au moins au-
tant d’importance à la décision en tant que telle qu’au contexte dans lequel celle-ci
a été rendue.
Dans un premier temps, il sera question d’identifier quels sont les éléments de
contexte nécessaires à la qualité des décisions de justice (I.1). Dans un second
temps, il conviendra de porter une attention particulière à la qualité du processus
juridictionnel qui conduit à la production de la décision (I.2).
I.1. Les éléments de contexte nécessaires à la qualité des décisions de justice
De nombreux travaux font apparaître l’importance qu’il faut accorder à ces
éléments de contexte. Un auteur souligne ainsi : « Une décision de justice intervient
toujours à un moment donné, dans un environnement donné et il faut constam-
ment avoir à l’esprit les interactions entre les différentes phases et composantes du
processus judiciaire 21. »
On retiendra ici que trois éléments de contextes sont présentés comme permet-
tant d’assurer la qualité des décisions de justice. Il s’agit d’abord des ressources
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
allouées au système judiciaire, ensuite de la qualité de la législation et enfin de la
qualité de la formation des acteurs du système judiciaire 22.
Des ressources suffisantes
Des ressources humaines et matérielles sont indispensables pour que la décision
rendue soit de qualité. Un nombre convenable de magistrats est nécessaire pour que
ceux-ci puissent porter l’attention nécessaire à chaque affaire. Par ailleurs, ils ne par-
ticipent pas seuls au processus conduisant à la décision de justice. Les magistrats
doivent être entourés par un personnel compétent et suffisant en nombre pour per-
mettre un déroulement satisfaisant de la procédure. En outre, la rémunération des
acteurs du système judiciaire doit être adéquate, afin de garantir leur indépendance.
Enfin, le budget alloué au système judiciaire doit permettre d’assurer l’organisation
du service public de la justice. Dans son rapport remis en 2012, la Commission euro-
péenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a évalué les systèmes judiciaires euro-
péens en se basant sur les données recueillies en 2010 23. Le budget annuel total que
la France a consacré au système judiciaire 24 est de 60,5 € par habitant, soit 0,20 %
21. Jean-Paul JEAN, « La qualité des décisions de justice au sens du Conseil de l’Europe », in Pascal MBON-
GO (dir.), La qualité des décisions de justice, op. cit., p. 30.
22. CCJE, avis n° 11, op. cit.
23. CEPEJ, Rapport d’évaluation des systèmes judiciaires européens, 2012, 4e rapport.
24. Le système judiciaire regroupe l’ensemble des tribunaux, l’aide juridictionnelle et le ministère public.
Droit et Société 83/2013 159
H. COLOMBET, A. GOUTTEFANGEAS
de son PIB par habitant 25. À titre de comparaison, il est intéressant de souligner
que l’État consacrant le budget annuel le plus élevé par habitant est la Suisse avec
167,10 € par habitant 26. La France se situe ainsi au 17e rang européen.
Le rapport conclut à une augmentation générale du budget consacré aux sys-
tèmes judiciaires, même si celle-ci est plus limitée que dans les périodes précé-
demment étudiées par la Commission 27. Le développement du système judiciaire
reste ainsi une priorité pour les États européens 28.
Une législation de qualité
Depuis quelques années, les critiques concernant la qualité de la législation sont
de plus en plus nombreuses. Elles sont connues : elles visent l’inflation législative, le
défaut de clarté et d’intelligibilité des lois, le manque de portée normative, l’impréci-
sion de certaines dispositions, l’existence de lois inefficaces, faute de décrets d’appli-
cation, ou supprimées avant même la date de leur entrée en vigueur 29… Toutes ces
critiques concernant la crise de la loi nous conduisent à nous interroger sur l’impact
que cette « dévaluation du droit » 30 peut avoir sur la qualité de la justice et de ses
décisions. La fonction juridictionnelle consiste essentiellement, et sous réserve des
débats sur la liberté du juge, à appliquer les lois aux affaires présentées. Une législa-
tion mal écrite, incohérente, trop changeante peut rendre le travail du juge plus diffi-
cile et, en conséquence, avoir une influence négative sur la qualité de la décision
rendue. Afin de garantir cette dernière, la loi doit être claire, accessible, intelligible et
avoir une portée normative 31.
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
La formation des acteurs du système judiciaire
L’ensemble des acteurs du système juridictionnel 32 participe à l’élaboration
d’une décision de justice de qualité. Ces acteurs sont nombreux 33, il s’agit non seu-
25. En ce sens, CEPEJ, Rapport d’évaluation des systèmes judiciaires européens, op. cit., p. 57 et 58. Il convient
cependant de relativiser ce dernier chiffre qui peut paraître faible. Les États les plus riches paraissent ainsi, à
tort, consacrer une faible part de leur PIB au système judiciaire en raison du niveau élevé de celui-ci.
26. Là encore, le rapport souligne la nécessité de tenir compte de la particularité des « micro-États peu
peuplés ». Plus la démographie est élevée, plus le budget par habitant est important. Il faut également tenir
compte, pour la Suisse, du taux de change qui amplifie le résultat. CEPEJ, Rapport d’évaluation des systèmes
judiciaires européens, op. cit., p. 57.
27. L’une des raisons réside dans les effets indirects de la crise sur les budgets. Les experts soulignent que
l’accroissement du contentieux causé par la détérioration de la situation économique (conflits sociaux,
faillites…) a provoqué des coûts supplémentaires pour la justice. Il en résulte que le constat de l’augmen-
tation du budget doit être relativisé.
28. CEPEJ, Rapport d’évaluation des systèmes judiciaires européens, op. cit., p. 63.
29. Un article dénonce les réformes stériles de la justice « Trois juges d'instruction au lieu d'un ? Parfait.
Mais le Parlement a déjà voté cette mesure en 1985 (loi Badinter) et en 1987 (loi Chalandon), par des lois qui
ont été abrogées avant même d'entrer en vigueur, parce que l'État ne voulait pas créer les emplois néces-
saires. » Valéry TURCEY, « Le juste prix de la justice », Libération, 15 février 2006.
30. Jean-Marc VARAUT, Le droit au droit. Pour un libéralisme institutionnel, Paris : PUF, 1986, p. 29.
31. Voir à ce sujet, SÉNAT, La qualité de la loi, note de synthèse du service des études juridiques, n° 3, le
1er octobre 2007, disponible en ligne <http://www.senat.fr/notice-rapport/2007/ej03-notice.html>.
32. Bien que cette étude porte essentiellement sur les décisions des juridictions judiciaires, l'ordre admi-
nistratif est aussi concerné par ces développements.
33. Jean-Paul JEAN, « La qualité des décisions de justice au sens du Conseil de l’Europe », art. cité, p. 30.
160 Droit et Société 83/2013
La qualité des décisions de justice. Quels critères ?
lement des magistrats du siège et du parquet mais également de la police, des gref-
fiers, des avocats, des huissiers… Chacun d’eux intervient dans la chaîne de produc-
tion de la décision de justice. Il n’est pas possible, dans le cadre de cette étude, de
s’interroger sur le rôle de chacun. Seuls le juge et l’avocat seront ainsi évoqués.
A priori, le juge occupe une place centrale puisqu’il est chargé de rendre la déci-
sion 34. Leur formation est essentielle à la qualité des décisions qu’ils rendent 35. Il
appartient à l’École nationale de la magistrature (ENM) d’assurer la formation ini-
tiale et continue des magistrats de l’ordre judiciaire français 36. Au cours de la pre-
mière, les périodes de formation à l’école et de stage s’alternent afin de permettre
aux futurs magistrats d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires à
leur activité (mener une procédure, conduire un entretien, motiver les décisions…).
De même, une formation continue est exigée afin, notamment, d’informer les ma-
gistrats sur les changements dans la législation 37.
Les juges doivent ainsi répondre à « des qualités de sérieux et de compétence. Il
revient à chaque État de mettre en place un système de recrutement et de forma-
tion des juges qui en assure la qualité intellectuelle » 38.
Le juge n’est cependant pas le seul acteur de la procédure, il n’est que l’un des
maillons d’une chaîne qui aboutit à la production de la décision de justice. L’avocat
joue également un rôle primordial : il formalise les demandes, développe un argu-
mentaire et rédige les conclusions qui vont permettre au juge de rendre sa déci-
sion. On pourrait ainsi considérer que le rôle de l’avocat est essentiel à la qualité
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
des décisions, dans la mesure où c’est lui qui apporte la matière à partir de laquelle
la décision est rédigée.
Parallèlement à ces éléments de contexte, la qualité des décisions de justice est
liée à celle du processus juridictionnel conduisant à l’élaboration de la décision.
I.2. La qualité du processus juridictionnel conduisant à la décision de justice
La décision de justice constitue l’aboutissement d’un processus complexe,
comportant différentes phases qui, selon les auteurs étudiés, doivent revêtir un
certain nombre de qualités pour que la décision de justice soit elle-même de quali-
té. Dans le processus conduisant à l’élaboration de la décision de justice, l’accès au
juge apparaît comme une condition préalable et nécessaire 39. Le caractère fonda-
mental de ce droit est reconnu par les textes 40 ainsi que par les juridictions natio-
34. CCJE, avis n° 11, op. cit.
35. Voir notamment, E. VEYSSIÈRE, « La formation du magistrat judiciaire et la qualité des décisions de
justice », in Pascal MBONGO (dir.), La qualité des décisions de justice, op. cit., p. 104.
36. Article 1er du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’École nationale de la magistrature.
37. CCJE, avis n° 11, op. cit.
38. Serge GUINCHARD, « Les normes européennes garantes d’un procès de qualité », in Marie-Luce CAVROIS,
Hubert DALLE et Jean-Paul JEAN (dir.), La qualité de la justice, Paris : La Documentation française, 2002, p. 64.
39. Jean-Marc SAUVÉ, « Les critères de la qualité de la justice », discours prononcé à l’occasion de la célé-
bration des vingt ans du Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE), Luxem-
bourg, 25 septembre 2009.
40. Article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et articles 2 et 14 du Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques de 1966.
Droit et Société 83/2013 161
H. COLOMBET, A. GOUTTEFANGEAS
nales 41 et internationales 42. Il apparaît donc que l’importance que les textes et les
juridictions accordent au droit d’accès au juge suffit à faire de ce droit un critère de
la qualité des décisions. Cependant, garantir l’accès au juge est insuffisant, d’autres
critères, de nature procédurale, doivent être respectés.
Il sera question d’examiner les critères de qualité de la procédure ainsi que les
critères de qualité intrinsèques de la décision. Par ailleurs, il convient de souligner
que la décision de justice doit être rendue dans un délai raisonnable.
Les critères de qualité de la procédure comme fondement de la qualité des décisions
Il n’est pas possible de traiter ici de l’ensemble des dispositions de nature procé-
durale contenues dans le Code de procédure civile. Il convient de s’attacher à
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui contient les
grands principes procéduraux garantissant le caractère équitable du procès. Ils sont
évoqués par Natalie Fricéro qui propose « une nouvelle grille de lecture de l’article 6
de la Convention » 43 expliquant que les droits de l’homme étaient conçus à l’origine
comme des « droits-résistance », destinés à protéger les individus contre l’arbitraire.
De ce fait, ces éléments procéduraux sont des critères essentiels de qualité des déci-
sions de justice. En effet, l’idée est que la solution adoptée par le juge « a de fortes
probabilités d’être juste sur le fond si le processus juridictionnel et le jugement lui-
même sont soumis à des exigences de qualité » 44.
Le premier principe est le respect des droits de la défense et le droit à la contra-
diction, qui constituent des éléments nécessaires au procès équitable. Le second
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
principe est le droit à un tribunal indépendant et impartial.
D’une part, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme exige
que le procès soit équitable. La Cour européenne a eu l’occasion d’indiquer que :
« Le principe de l’égalité des armes représente un élément de la notion plus large de
procès équitable qui englobe aussi le droit fondamental au caractère contradictoire
de l’instance 45. » La notion de procès équitable comprend donc le respect du con-
tradictoire et l’égalité des armes. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, le
respect du contradictoire « implique pour une partie la faculté de prendre connais-
sance des observations ou pièces produites par l’autre, ainsi que d’en discuter » 46 et
l’égalité des armes est une composante autonome de la garantie d’un procès équi-
table 47. Cette dernière est entendue par la Cour de Strasbourg comme la possibilité
raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne désavantagent pas l’une
41. Civ. 1, 1er février 2005, n° 01-13742 et 02-15237, Bull.civ. I, n° 53, p. 45 ; Simon HOTTE, « Droit au juge et
arbitrage international », Recueil Dalloz, 2005, p. 2727 et Conseil constitutionnel, voir not. décis. n° 93-
325 DC, 13 août 1993 et décision n° 99-416 DC, 23 juill. 1999 dans laquelle le Conseil constitutionnel lui
accorde valeur constitutionnelle ; Conseil d’État, 11 mai 1962.
42. CEDH, Golder c/ Royaume Uni du 21 février 1975, n° 4451/70.
43. Natalie FRICERO, « La qualité des décisions de justice au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne
des droits de l’homme », art. cité, p. 49.
44. Ibid., p. 50.
45. CEDH, Ruiz-Mateos c/ Espagne, 23 juin 1993, série A, n° 262, § 63.
46. CEDH, Ibid.
47. Serge GUINCHARD, « Les normes européennes garantes d’un procès de qualité », art. cité, p. 89.
162 Droit et Société 83/2013
La qualité des décisions de justice. Quels critères ?
des parties de manière appréciable par rapport à la partie adverse 48. L’attention que
la Haute juridiction accorde à ces principes démontre l’importance qui leur est ac-
cordée pour la qualité de la procédure et en conséquence pour la qualité de la déci-
sion qui en est l’aboutissement.
D’autre part, l’indépendance et l’impartialité du tribunal sont deux principes
indispensables à la qualité des décisions de justice. Les deux notions vont souvent
de pair mais ne sont pas équivalentes. L’indépendance s’apprécie par rapport à
tout pouvoir extérieur au pouvoir judiciaire. L’impartialité, quant à elle, fait réfé-
rence à l’organisation et au fonctionnement interne des juridictions 49.
La juridiction de jugement doit être indépendante. Selon certains auteurs 50, la
Convention et la Cour européenne des droits de l’homme exigent que le tribunal soit
indépendant par rapport au pouvoir exécutif et législatif, ainsi que par rapport à tout
autre pouvoir, comme, par exemple, le pouvoir des médias ou encore celui des par-
ties. La juridiction doit également être impartiale. Cette notion comprend, d’une part,
l’impartialité subjective, c’est-à-dire « ce que tel juge pensait dans son for intérieur en
telle circonstance » 51 et, d’autre part, l’impartialité objective ou fonctionnelle, c’est-à-
dire les situations dans lesquelles le comportement du juge n’engendre plus « la con-
fiance que les tribunaux se doivent d’inspirer aux justiciables dans une société démo-
cratique » 52. L’auteur ajoute : « Encore convient-il que l’impartialité ne soit pas com-
prise comme un idéal de neutralité désincarnée, qui relèverait de l’utopie et déshu-
maniserait le juge » 53. Il apparaît donc, selon la CEDH, qu’un tribunal doit être im-
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
partial et indépendant pour rendre une décision de justice de qualité.
Bien que la qualité de la procédure contribue à celle des décisions de justice, elle
ne suffit pas. La décision, elle-même, doit respecter certaines règles propres à assurer
sa qualité.
Les critères de qualité intrinsèques de la décision
Selon les auteurs étudiés, une décision de justice de qualité doit être claire, in-
telligible et motivée. Si l’on tient compte de l’importance des développements qui y
sont consacrés 54, la motivation constitue un élément primordial de qualité des
décisions. À l’inverse, les exigences de forme que les décisions de justice doivent
respecter n’apparaissent dans aucun des travaux recensés portant sur la qualité des
48. CEDH, Delcourt c/ Belgique, 17 janv. 1970, série A n° 11 ; CEDH, Borgers c/ Belgique, 30 oct. 1991, série A,
n° 214-B.
49. Sur la distinction de ces notions, voir Serge GUINCHARD, « Les normes européennes garantes d’un
procès de qualité », art. cité, p. 63.
50. Ibid., p. 65.
51. CEDH, Piersack c/ Belgique, 1er oct. 1982, n° 8692/79, § 30.
52. Ibid.
53. Natalie FRICERO, « La qualité des décisions de justice au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne
des droits de l’homme », art. cité, p. 53.
54. Jean-Marc SAUVÉ, « Les critères de la qualité de la justice », art. cité ; CCJE, avis n° 11, op. cit. ; dans le
même sens, voir aussi, Natalie FRICERO, « La qualité des décisions de justice au sens de l’article 6 § 1 de la
Convention européenne des droits de l’homme », art. cité, p. 49 et François MARTINEAU, « Critères et standards
rhétoriques de la bonne décision de justice », in Pascal MBONGO (dir.), La qualité des décisions de justice,
op. cit., p. 89.
Droit et Société 83/2013 163
H. COLOMBET, A. GOUTTEFANGEAS
décisions. Il semble cependant qu’il s’agisse d’un critère important. Une étude en
cours consacrée à la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants 55 a mon-
tré que cette exigence permettait de retracer la procédure suivie par une affaire : les
mentions obligatoires du Code de procédure civile participent à la compréhension
de la décision. Pour cette raison, il semble nécessaire de considérer que les exigences
de forme constituent un critère de qualité des décisions de justice. Il sera donc ques-
tion de présenter ce critère avant d’évoquer la clarté et l’intelligibilité de la décision
pour enfin porter notre attention sur la motivation des décisions.
D’abord, un certain nombre de mentions doivent obligatoirement figurer dans
la décision de justice. L’article 454 du Code de procédure civile dispose que le ju-
gement doit comporter l’indication de la juridiction dont il émane, le nom des juges
qui en ont délibéré, de sa date, du nom du représentant du ministère public s’il a
assisté aux débats, le nom du secrétaire, les nom, prénom ou dénomination des
parties ainsi que leur domicile ou siège social, et le cas échéant, le nom des avocats
ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties et, en matière gra-
cieuse, le nom des personnes auxquelles il doit être notifié. La Cour de cassation a
mis en ligne plusieurs fiches méthodologiques concernant la rédaction des déci-
sions dans lesquelles elle rappelle l’importance des éléments précités. Ces informa-
tions permettent à la Cour de vérifier « la régularité de la procédure » 56 et partici-
pent en ce sens à la qualité des décisions de justice.
Ensuite, l’exigence de clarté et d’intelligibilité des décisions se retrouve chez
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
plusieurs auteurs 57. Selon eux, le juge doit utiliser un langage clair, compréhensible
et adapté à des non juristes : la décision de justice s’adresse avant tout aux parties
et doit pouvoir être comprise par elles.
La clarté permet de garantir une meilleure compréhension et acceptation de la
décision. Certaines propositions ont été faites pour favoriser leur intelligibilité. Il est
possible de citer par exemple les travaux de l’Association syndicale des magistrats qui
propose une nouvelle présentation des jugements afin de les rendre plus accessibles
aux usagers du service public de la justice 58. Selon l’Association, « la complexité du
langage judiciaire est un des obstacles majeurs à l’accès du citoyen à la justice ». Ces
travaux doivent permettre aux usagers de mieux s’orienter dans la structure du juge-
ment (il est notamment proposé de placer le dispositif au début du jugement). Adop-
ter un langage clair et simple est indispensable à l’amélioration de la clarté et de
l’intelligibilité de la décision. Plus récemment encore, un rapport sur la rédaction des
55. Cécile BOURREAU-DUBOIS et Isabelle SAYN, « Évaluation de la mise en place d’une table de référence pour
le calcul de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants », Dossier d’études (CAF), 141, 2011
(journée d’étude organisée par le CERCRID).
56. COUR DE CASSATION, « Fiche méthodologique. La rédaction des arrêts », Bulletin d’information, 613,
15 février 2005.
57. Jean-Marc SAUVÉ, « Les critères de la qualité de la justice », art. cité ; CCJE, avis n° 11, op. cit.; Natalie
FRICERO, « La qualité des décisions de justice au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits
de l’homme », art. cité, p. 49 et François MARTINEAU, « Critères et standards rhétoriques de la bonne décision
de justice », art. cité, p. 89.
58. ASSOCIATION SYNDICALE DES MAGISTRATS, Dire le droit et être compris. Comment rendre le langage judiciaire
plus accessible ?, Bruxelles : Bruylant, 2003. Cet ouvrage propose de simplifier le langage judiciaire, placer le
dispositif au début du jugement, renforcer l’information les justiciables.
164 Droit et Société 83/2013
La qualité des décisions de justice. Quels critères ?
décisions de la juridiction administrative a proposé un certain nombre de réforme
afin d’améliorer les décisions du Conseil d’État 59. L’objectif affiché est « de les rendre
mieux compréhensibles à un public large, sans rien sacrifier de leur qualité » 60. Une
attention particulière est portée sur le contenu et le style de la décision. Parmi les
nombreuses propositions, l’abandon de la phrase unique et du considérant est l’une
des plus emblématiques. Il est, en effet, souligné que la multiplication des « que » et
des « points-virgules » ainsi que la longueur des phrases constituent « un obstacle à la
compréhension de la décision par les personnes non habituées à la lecture des déci-
sions de justice » 61. Il est ainsi proposé l’utilisation de phrases courtes, en style direct,
ponctuées de points 62. Toutefois, la forme et le style ne sont pas les seuls éléments à
prendre en compte pour apprécier la qualité de la décision.
Enfin, selon certains auteurs étudiés, « la qualité de la décision dépend princi-
palement de la qualité de la motivation » 63. La décision de justice doit comporter
une « motivation pertinente, suffisante et accessible. La motivation est la condition
de la lisibilité du jugement, de sa légalité et de sa légitimité » 64.
De nombreux développements sont consacrés à la motivation comme critère de
qualité des décisions de justice. Les éléments retenus par les auteurs sont divers. Il
a été choisi de les distinguer en trois catégories, selon la fonction qui est attribuée à
la motivation des décisions. La première fonction de la motivation est le contrôle de
légalité de la décision. Ainsi, la loi de 1790 65, qui imposait aux juges de motiver
leurs décisions, avait pour objectif d’éviter le retour des arrêts de règlement et ainsi,
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
« de faire triompher le syllogisme judiciaire » 66.
La motivation permet, encore aujourd’hui, d’assurer le contrôle de conformité de
la décision à la loi. L’objectif est de montrer que la solution résulte de la stricte appli-
cation des règles de droit et qu’elle ne constitue pas une solution arbitraire. Il s’agit de
la conception traditionnelle du rôle du juge. Même si la motivation des décisions
répond à d’autres fonctions que celle-ci, la conformité des règles de droit demeure un
critère de la qualité des décisions de justice. En ce sens, l’article 604 du Code de pro-
cédure civile dispose que : « Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour
de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit. » La
deuxième fonction est celle de la compréhension de la décision par les parties. Le juge
59. CONSEIL D’ÉTAT, Rapport du groupe de travail sur la rédaction des décisions de la justice administrative,
2012, p. 6.
60. Ibid., p. 9.
61. Ibid., p. 38.
62. Ibid., p. 39 et suiv. Proposition n° 14.
63. CCJE, avis n° 11, op. cit.
64. Natalie FRICERO, « La qualité des décisions de justice au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne
des droits de l’homme », art. cité, p. 56. Dans le même sens, un auteur relève que la motivation est « une
garantie essentielle pour le justiciable, car elle est destinée à le protéger contre l’arbitraire du juge », Jean-
Pierre ANCEL, « La rédaction de la décision de justice en France », Revue internationale de droit comparé
(RIDC), 1998, p. 852.
65. La loi des 16 et 24 août 1790 est une loi française, belge et luxembourgeoise sur l'organisation judi-
ciaire, adoptée par l'Assemblée nationale constituante le 16 août 1790 et sanctionnée le 24 août.
66. Pascal TEXIER, « Jalons pour une histoire de la motivation des sentences », in ASSOCIATION HENRI CAPITANT (dir.),
La motivation, Paris : LGDJ, 2000, p. 5, spéc. p. 15.
Droit et Société 83/2013 165
H. COLOMBET, A. GOUTTEFANGEAS
doit « répondre aux prétentions des parties » 67. Cet élément permet aux justiciables
de constater que leurs prétentions ont été entendues et donc qu’elles ont obtenu une
réponse. Par ailleurs, le juge doit expliquer clairement la solution qu’il a retenue. La
clarté de l’argumentation permet de convaincre le justiciable que, même s’il n’a pas
eu gain de cause, la position adoptée par le juge est juste 68. S’il n’est pas convaincu
de la justesse du raisonnement, la motivation des décisions lui permet « d’apprécier
les chances d’un éventuel recours et de l’exercer » 69. Certains auteurs vont plus loin
et considèrent même que : « La motivation doit porter sur chaque chef du dispositif.
Elle doit s’appliquer à tous les moyens invoqués. Rien n’est pire que de voir le client
revenir, après avoir lu le jugement et constater que le magistrat n’a pas répondu à
certains moyens auxquels il tenait 70. » La dernière fonction est d’expliquer la solution
à la société. Les décisions de justice participent à la compréhension du droit 71 et ont,
en ce sens, un « intérêt public » 72. La motivation des décisions « est indispensable à la
clarté du droit et à son progrès » 73. Son analyse par la doctrine permet d’obtenir des
informations sur la façon dont le droit est appliqué par les juridictions. Ainsi, la moti-
vation des décisions doit être suffisamment développée pour permettre cette analyse
et assurer la stabilité et la prévisibilité du droit 74. Certains auteurs se montrent très
critiques vis-à-vis des « attendus » lapidaires de la Cour de cassation dont la portée
reste souvent incertaine. Ils demandent au contraire que la motivation permette « au
juge de livrer le fond de sa pensée, d’expliquer vraiment pourquoi il statue dans un
certain sens, sans rien cacher des éléments qu’il prend en considération » 75. Le but
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
est que les magistrats puissent assurer l’égalité des justiciables devant les tribunaux
en appliquant à tous les mêmes règles.
La décision de justice ne peut pas être de qualité si elle ne reçoit pas, après son
élaboration, une application concrète. La qualité de la décision réside donc égale-
ment dans son exécution.
Le respect du délai raisonnable
Le critère du délai raisonnable semble être l’un de ceux qui apparaissent le plus
souvent dans les travaux relatifs à la qualité de la justice et de ses décisions. Plusieurs
67. Ibid. Dans le même sens, Natalie FRICERO, « La qualité des décisions de justice au sens de l’article 6 § 1 de
la Convention européenne des droits de l’homme », art. cité.
68. Michel BÉNICHOU, « La formation de l’avocat et la qualité des décisions de justice », in Pascal MBONGO (dir.),
La qualité des décisions de justice, op. cit.
69. Frédéric ZENATI-CASTAING, « La motivation des décisions de justice », Recueil Dalloz, 2007, p. 1553.
70. Michel BÉNICHOU, « La formation de l’avocat et la qualité des décisions de justice », art. cité, p. 119.
71. En ce sens, Christian ATIAS, « Une enquête nécessaire : les arrêts de non-admission du pourvoi en
cassation », Recueil Dalloz, 2010, p. 1374.
72. Henry SOLUS et Roger PERROT, Droit judiciaire privé, tome 1, 1961,§ 678.
73. Adolphe TOUFFAIT et André TUNC, « Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, no-
tamment celle de la Cour de cassation », Revue trimestrielle de droit civil (RTD. civ.), 1974, p. 488.
74. Jean-Marc SAUVÉ, « Les critères de la qualité de la justice », art. cité.
75. Adolphe TOUFFAIT et André TUNC, « Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, no-
tamment celle de la Cour de cassation », art. cité, p. 502.
166 Droit et Société 83/2013
La qualité des décisions de justice. Quels critères ?
études y sont même entièrement consacrées 76. L’article 6 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme exige que les jugements soient rendus dans un délai
raisonnable. Un rapport du CEPEJ 77 a été rendu en 2006, son but « est d’établir si la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme peut servir à tirer des
conclusions d’ordre général sur les délais judiciaires dans les États membres du
Conseil de l’Europe » 78. Aucun délai précis n’est fixé par la Cour européenne. Pour
calculer le délai raisonnable, le point de départ du décompte, dans les affaires ci-
viles, est normalement la date de saisine de la juridiction. Celle du terme du délai
correspond au moment où la décision devient définitive mais le tribunal tient éga-
lement compte de la durée de la procédure d’exécution qui est considérée comme
faisant partie intégrante de la procédure 79.
Elle prend en compte un certain nombre de critères pour définir le caractère rai-
sonnable ou non du délai de jugement. Le CEPEJ a identifié trois critères. D’abord, la
Cour examine la complexité de l’affaire. En effet, il faut tenir compte de la particula-
rité de chaque contentieux pour déterminer le temps nécessaire à la prise de déci-
sion 80. Ainsi, dans une étude réalisée en 2001 81, il a été constaté que la durée des
procédures dépendait étroitement de la nature du contentieux. Celui relatif au droit
des biens est le plus long et à l’inverse, celui relatif aux régimes matrimoniaux est le
plus rapide. Le recours aux expertises est un élément d’explication de la durée des
affaires. Ensuite, la Cour de Strasbourg prend en compte le comportement du requé-
rant. Enfin, l’enjeu du litige pour le requérant est également un élément qui entre
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
en ligne de compte. Certaines affaires exigent une célérité particulière (c’est no-
tamment le cas pour les affaires relatives à l’indemnisation des victimes d’accident,
les affaires de violence policière…). Toutefois, le rapport indique que la Cour pro-
cède également à une appréciation globale des circonstances de l’espèce. Elle peut
établir qu’un « délai raisonnable » a été dépassé si elle constate une durée totale ex-
cessive de la procédure ou de longues périodes d’inaction des autorités compétentes.
Cependant, il convient de trouver un juste équilibre dans le temps nécessaire au
traitement d’un dossier. En effet, il apparaît que « la qualité d’une décision juridic-
tionnelle ne se mesure pas seulement au temps qu’a mis le juge à la rendre : elle
n’est pas inversement proportionnelle à ce temps » 82. Selon un auteur, « le “délai
de qualité” est un délai prévisible, accepté par le justiciable » (puisque le calendrier
des procédures est fixé d’un commun accord entre le juge et les parties) 83.
76. Voir par ex. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Célérité et qualité de la justice. La gestion du temps dans le procès,
rapport de Jean-Claude Magendie, 2004 ; Voir les travaux du CEPEJ sur la gestion du temps judiciaire.
77. CEPEJ, Analyse des délais judiciaires dans les États membres du Conseil de l’Europe à partir de la juris-
prudence de la Cour européenne des droits de l’homme, rapport, décembre 2006.
78. Ibid.
79. Ibid.
80. Jean-Marc SAUVÉ, « Les critères de la qualité de la justice », art. cité.
81. Séverine ARNAULT, « La durée des affaires civiles dans les tribunaux de grande instance en 2001 »,
Infostat justice, 71, décembre 2003.
82. Jean-Marc SAUVÉ, « Les critères de la qualité de la justice », art. cité.
83. Natalie FRICERO, « La qualité des décisions de justice au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne
des droits de l’homme », art. cité, p. 55.
Droit et Société 83/2013 167
H. COLOMBET, A. GOUTTEFANGEAS
L’objectif poursuivi à travers la recherche du délai raisonnable correspond à la
perspective d’une meilleure gestion susceptible de faire gagner du temps aux justi-
ciables. Cependant, la volonté de retenir comme critère de qualité une administra-
tion judiciaire plus performante peut conduire, comme on le verra, à oublier les
critères plus traditionnels de qualité des décisions de justice.
II. La réforme de l’État et la volonté d’amélioration de la qualité des décisions
de justice
Avec l’élaboration de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), l’État a
souhaité organiser une optimisation des ressources, une plus grande efficacité par
une meilleure allocation des dépenses publiques en élaborant « une réforme qui […]
mobilise aujourd’hui sur le terrain l’ensemble des administrations autour d’un but
unique : doter notre pays d’une nouvelle gestion publique plus efficace, plus perfor-
mante » 84. Plus particulièrement, sur le plan judiciaire, les objectifs visés sont présen-
tés comme permettant une amélioration de la qualité de la justice française et de ses
décisions 85. L’étude de cette politique permettra de comprendre les voies choisies
par les pouvoirs publics. Ainsi, il nous faudra examiner les critères adoptés, qui ont
évolué au fur et à mesure des nouvelles lois de finances (II.1). Cependant, les critères
utilisés par les pouvoirs publics, qualifiés d’indicateurs dans une perspective ges-
tionnaire, peuvent être critiqués sur différents plans (II.2).
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
II.1. Les critères de qualité établis par les lois de finances
En France, la LOLF est la loi qui détermine le cadre juridique des lois de fi-
nances 86. Promulguée le 1er août 2001 et entrée en vigueur par étapes, elle s’applique
à toute l’administration française depuis 2006.
La LOLF a pour objectif affiché de répondre aux insuffisances prêtées à
l’ordonnance de 1959. Elle entend y remédier en faisant graviter la procédure bud-
gétaire autour de deux pôles-clé : une transparence de l’information budgétaire
propre à instituer un contrôle étroit par le Parlement, d’une part, et une logique de
performance de la gestion publique, d’autre part. Chaque année, un projet annuel
de performances (PAP) est élaboré par chaque responsable de programme 87 (jus-
tice judiciaire, administration pénitentiaire…) : ce sont des parties des « bleus bud-
gétaires » 88 par mission qui développent le montant des crédits et donnent des
éléments d’information. Plus précisément, les PAP de chaque programme com-
84. Alain LAMBERT et Didier MIGAUD, « D'une logique de moyens à une logique de résultats »,
<http://www.performance-publique.gouv.fr>, dernière mise à jour le 23 juillet 2012.
85. Voir Léonard BERNARD DE LA GATINAIS, « Présentation stratégique du projet annuel de perfor-
mance 2007 », <http://www.performance-publique.gouv.fr>.
86. C'est une loi organique, qu'on peut assimiler à une nouvelle constitution financière. Elle remplace le
précédent cadre, datant de 1959, et vise à moderniser la gestion de l'État.
87. Le responsable de programme est désigné par le ministre compétent pour assurer le pilotage du pro-
gramme.
88. Ce terme désigne usuellement le fascicule annexé au projet de loi de finances contenant une analyse
détaillée des crédits demandés par le gouvernement pour un ministère.
168 Droit et Société 83/2013
La qualité des décisions de justice. Quels critères ?
prennent la présentation du programme incluant sa stratégie, ses actions, les objec-
tifs poursuivis, les résultats obtenus et attendus pour les années à venir, mesurés au
moyen d’indicateurs précis et dont le choix est justifié.
Selon Alain Lambert et Didier Migaud : « L’objectif est de faire passer l’État d’une
logique de moyens à une logique de résultats. Jusque-là, on s’intéressait davantage au
volume des moyens consacrés à une politique qu’aux résultats concrets obtenus
grâce à ces moyens. Désormais, les discussions budgétaires portent non seulement
sur les moyens, mais aussi sur l’efficacité des dépenses, par rapport à des objectifs
définis pour chaque programme 89. »
Pour présenter le projet annuel de performances de la justice judiciaire de 2007,
Léonard Bernard de la Gatinais expliquait que, dans le contexte du perfectionnement
de la justice, plusieurs objectifs avaient été retenus. La maîtrise de la croissance des
frais de justice est par exemple visée, avec un « objectif d’efficience ». Un autre objec-
tif est celui de « réduire les délais de traitement des procédures dans des délais rai-
sonnables » 90. Il s’agit d’accélérer le traitement des affaires et de réduire les frais.
« L’institution judiciaire se doit de garantir l’État de droit, c’est-à-dire d’assurer
la sécurité des rapports juridiques entre les personnes privées, l’effectivité des déci-
sions rendues. Or, la réponse qu’elle apporte aujourd’hui reste perfectible ; il s’agit
en effet de mieux adapter la justice aux attentes des citoyens, par une réduction des
délais et une simplification des procédures 91. » Aussi, pour les pouvoirs publics à
l’origine de ces projets de finances découlant de la LOLF, la qualité de la justice et
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
de ses décisions correspondrait à sa rapidité (assimilée à son efficacité) et à son
coût réduit. Ainsi, la rapidité et le moindre coût deviennent des critères de qualité
des décisions de justice.
Le terme de « délai raisonnable » n’a alors pas la même signification dans la LOLF
que pour les auteurs cités précédemment 92. Dès lors que l’objectif est la réduction du
temps de traitement des procédures, un délai raisonnable est un délai le plus bref
possible, dans une logique d’économie. Au contraire, le délai raisonnable, au sens de
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, vise plutôt un « délai
de qualité » qui serait « prévisible et accepté par le justiciable » 93.
À ces objectifs sont associés des « indicateurs d’efficacité, de qualité de service
rendu à l’usager et d’efficience de l’activité judiciaire » 94. Il s’agit de rendre con-
crets les objectifs, en déterminant des indicateurs précis qui seront imposés aux
juridictions, suivis et analysés, afin que ces dernières améliorent leur fonctionne-
ment au regard des objectifs poursuivis.
89. Alain LAMBERT et Didier MIGAUD, « D'une logique de moyens à une logique de résultats », art. cité.
90. Léonard BERNARD DE LA GATINAIS, « Présentation stratégique du projet annuel de performance 2007 »,
op. cit.
91. Ibid.
92. Cf. première partie de cet article.
93. Natalie FRICERO, « La qualité des décisions de justice au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne
des droits de l’homme », art. cité, p. 55.
94. Léonard BERNARD DE LA GATINAIS, « Présentation stratégique du projet annuel de performance 2007 »,
op. cit.
Droit et Société 83/2013 169
H. COLOMBET, A. GOUTTEFANGEAS
Le projet de loi de finances pour 2008 concernant la justice comporte huit indi-
cateurs retenus pour rendre compte de l’objectif numéro 1 : « rendre des décisions
de qualité dans des délais raisonnables en matière civile » :
— (1) le délai moyen de traitement des procédures par type de juridiction ;
— (2) le délai théorique d’écoulement des stocks des affaires civiles terminées par
type de juridiction ;
— (3) l’ancienneté moyenne du stock par type de juridiction ;
— (4) le délai moyen de délivrance de la copie revêtue de la formule exécutoire ;
— (5) le taux de requête en interprétation, en rectification d’erreurs matérielles et
en omission de statuer ;
— (6) le taux de cassation des affaires civiles ;
— (7) le nombre d’affaires traitées par magistrat du siège ou par conseiller rapporteur ;
— (8) le nombre d’affaires traitées par fonctionnaire.
Ces indicateurs serviront donc à mesurer la performance de la justice, à partir
des performances des juridictions et de leur personnel. Sur les huit indicateurs
sélectionnés pour apprécier la qualité des décisions rendues en matière civile,
quatre sont des mesures de délais et de stocks (1, 2, 3 et 4), deux mesurent la pro-
ductivité des magistrats et des fonctionnaires (7 et 8) et deux évaluent le défaut
supposé de qualité (5 et 6). On voit donc immédiatement la place prise par les dé-
lais, la performance, aux dépens de critères plus substantiels. Ces indicateurs ne
correspondent pas aux analyses sur la qualité des décisions de justice développées
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
dans la première partie de cet article ; ils se limitent à une approche quantitative de
la « production » des juridictions. En revanche, le taux de requête en interprétation,
rectification d’erreurs matérielles et omission de statuer est un indicateur qui tente de
mesurer directement la qualité des décisions de justice, au regard des critères élabo-
rés par la doctrine. Il s’agit d’un indicateur de qualité du service rendu à l’usager. En
effet, l’effort de productivité demandé aux juridictions judiciaires ne doit pas se
traduire par des décisions juridictionnelles mal rédigées. Quant au taux de cassa-
tion des affaires civiles, il vise le nombre d’affaires faisant l’objet d’une cassation
partielle ou totale avec ou sans renvoi en matière civile, rapporté au nombre total
de décisions rendues par la Cour de cassation en matière civile. Cet indicateur se
fonde sur le postulat selon lequel une décision cassée est une décision de mauvaise
qualité. Les autres indicateurs ne regardent que les écoulements des stocks ou la
productivité des magistrats.
Il convient de se pencher sur les modifications de ces indicateurs. Le critère n° 2
a été transformé plusieurs fois, pour finalement devenir le « pourcentage des juri-
dictions dépassant d’un mois et plus le délai moyen de traitement » dans le projet
de loi de finances pour 2013. Ainsi, la notion de « délai seuil de traitement », qui
résultait de la prise en compte d’un écart par rapport au délai moyen de traitement,
est remplacée par la cible fixée dans le cadre de l’indicateur n° 1 en matière de délai
moyen de traitement. Cette modification permet de renforcer la cohérence entre
ces indicateurs 95.
95. Le délai à partir duquel les juridictions sont estimées en difficulté et doivent bénéficier prioritairement
d’actions correctives est fixé à un mois au-delà du délai-cible 2015 ; soit les délais « critiques » suivants :
170 Droit et Société 83/2013
La qualité des décisions de justice. Quels critères ?
L’indicateur portant sur le taux de cassation des affaires civiles (n° 6) a également
été modifié. Il ne se fonde plus sur le nombre d’affaires civiles ayant fait l’objet d’une
cassation, rapporté au nombre de pourvois portés devant la Cour de cassation, mais
sur le rapport entre le nombre d’affaires ayant fait l’objet d’une cassation et le
nombre d’affaires civiles traitées par l’ensemble des cours d’appel. Selon un rapport
déposé le 20 novembre 2008 96, cet indicateur pourrait être encore amélioré en
prenant en compte les seules cassations traduisant une erreur procédurale ou subs-
tantielle dans la décision attaquée et en écartant celles qui fixent une interprétation
jurisprudentielle. Une autre critique peut être adressée à l’encontre de cet indica-
teur. Le nombre d’affaires ayant fait l’objet d’une cassation dépend forcément du
nombre de pourvois portés devant la Cour de cassation ; or ce dernier est subor-
donné à la volonté des justiciables. Il n’y a pas nécessairement de lien entre la qua-
lité – ou le défaut de qualité supposé – et la contestation de la décision par un re-
cours en cassation. Il est donc impossible de savoir dans quelle mesure les déci-
sions du fond qui ne font pas l’objet d’un pourvoi seraient ou non susceptibles
d’être cassées. En effet, sauf à imaginer des justiciables purement rationnels qui
agiraient uniquement contre toutes les décisions dépourvues de qualité, et seule-
ment contre celles-là, le taux de cassation dépend de la décision des parties plus
que de l’appréciation de la qualité des décisions rendues par les juges du fond.
La loi de finances pour 2010 contient un changement notable : le « taux de requête
en interprétation, en rectification d’erreurs matérielles et en omission de statuer » a
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
été supprimé de la liste des critères observés, sans qu’aucun des rapports rendus sur
le sujet, que ce soit provenant de l’Assemblée nationale ou du Sénat, n’explique la
raison de cette suppression. Ces derniers se contentent d’affirmer que : « Les efforts
de maîtrise de la dépense seront poursuivis, voire intensifiés pour conforter les
résultats encourageants constatés sur certains postes et les inscrire dans la durée,
compte tenu du poids des frais de justice qui représentent plus de la moitié des
charges de fonctionnement du programme 97. » Quoi qu’il en soit, il faut considérer
que le taux de requête en rectification des erreurs matérielles n’est pas représentatif
de la réalité. Au cours d’une étude sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des
enfants 98, nous avons pu remarquer une multitude d’erreurs matérielles (dont par
exemple les erreurs sur le prénom des enfants) qui ne donnent pas lieu à demande en
rectification. En conséquence, l’absence de requête ne signifie pas l’absence d’une
erreur matérielle dans la décision de justice. De même que le recours en cassation, la
requête en rectification dépend de la décision des parties. C’est probablement la
raison qui a poussé le gouvernement à supprimer cet indicateur. Il s’agissait pourtant
là d’une tentative de trouver « un indicateur de qualité du service rendu à l’usager »,
11,5 mois pour les cours d’appels, 7,9 mois pour les tribunaux de grande instance, 6 mois pour les tribunaux
d’instance.
96. Rapport législatif du Sénat, avis n° 104 (2008-2009) de MM. Yves DETRAIGNE et Simon SUTOUR, fait au
nom de la commission des lois, déposé le 20 novembre 2008.
97. Mission ministérielle Justice, Projet annuel de performances, annexe au projet de loi de finances
pour 2010.
98. Cécile BOURREAU-DUBOIS et Isabelle SAYN, « Évaluation de la mise en place d’une table de référence pour
le calcul de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants », art. cité.
Droit et Société 83/2013 171
H. COLOMBET, A. GOUTTEFANGEAS
ce qui correspondait aux objectifs des auteurs étudiés en première partie de l’étude,
contrairement aux indicateurs restants qui ont pour vocation assumée de réduire les
coûts du système judiciaire.
Enfin, le critère de « délai moyen de délivrance de la copie revêtue de la formule
exécutoire » (n° 4) n’existe plus depuis le projet annuel de performances annexé à la
loi de finances pour 2012. Selon le rapport rendu à l’Assemblée nationale 99, cet
indicateur a été supprimé car la donnée était peu fiable. Peu de juridictions la sai-
sissaient et les résultats étaient par conséquent trop disparates.
II.2. La réflexion critique à propos de ce choix d’indicateurs de qualité
Sans être exhaustif, il est possible de relever certaines critiques portant sur la
liste des indicateurs dressée par les pouvoirs publics. En effet, plusieurs auteurs
s’accordent sur les inconvénients, les défauts et sur le sens politique des choix ef-
fectués par l’État français. Le système des indicateurs étant, à l’origine, utilisé dans
la sphère privée, nous verrons dans un premier temps que son transfert dans la
sphère publique est critiquable. Dans un deuxième temps, nous verrons que ce
choix d’indicateurs peut révéler un manque de dialogue entre les différents prota-
gonistes concernés par la qualité de la justice. Dans un troisième temps, il faudra
constater que le choix d’un outil – que l’on peut qualifier de gestionnaire – peut
sembler inadapté lorsqu’il est question de la qualité des décisions de justice.
Le transfert d’un outil de la sphère privée à la sphère publique
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
Comme l’explique Maya Bacache-Beauvallet 100, l’utilisation d’indicateurs de per-
formance n’a rien de nouveau dans le secteur privé. L’employeur veut amener l’em-
ployé à faire ce qu’il souhaite. Il va pour cela utiliser des mécanismes d’incitation
(primes, promotions…) qui présupposent de lier les récompenses à la mesure précise
d’une variable observable et vérifiable : l’indicateur.
Toutefois, cet auteur décrit les nombreux inconvénients engendrés par ces indi-
cateurs et révèle leurs limites. Il faut notamment se pencher sur l’écart entre l’effet
attendu de l’indicateur et son résultat réel : les indicateurs incitatifs entraînent des
conséquences insoupçonnées. M. Bacache-Beauvallet donne l’exemple d’un foot-
balleur lié par un contrat stipulant qu’il aurait une pénalité s’il donnait le ballon à
un adversaire. Le résultat fut efficace mais entraîna un effet non désiré : le joueur
passa beaucoup moins le ballon, même à ses coéquipiers.
Sans récapituler l’ensemble des effets inattendus des indicateurs dans la sphère
du privé, il existe aussi des difficultés spécifiques au domaine public.
Une première difficulté est celle de la définition des objectifs, et donc des indica-
teurs. En effet, la justice n’est pas un secteur marchand et il est difficile de savoir à
quoi correspond « une justice de qualité ». Contrairement à une entreprise privée
dont l’objectif évident est le bon fonctionnement pour l’augmentation des bénéfices,
99. Alain JOYANDET, Rapport fait au nom de la Commission des finances, de l’économie générale et du
contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n° 3775), annexe n° 28.
100. Maya BACACHE-BEAUVALLET, « Incitations et désincitations : les effets pervers des indicateurs », La vie des
idées, 22 août 2008, <http://www.laviedesidees.fr/Incitations-et-desincitations-les.html>.
172 Droit et Société 83/2013
La qualité des décisions de justice. Quels critères ?
le service public de la justice ne pourra jamais correspondre aux mêmes missions.
Ainsi, Anne Pezet et Samuel Sponem affirment, au sujet de la vague managériale, que
« l’entrée des méthodes de mesure de la performance dans toutes les sphères y com-
pris non marchandes, laisse un peu perplexes les professeurs et chercheurs en mana-
gement que nous sommes » 101. Ils connaissent bien les inconvénients des systèmes
de mesure mis en place trop rapidement. Trouver et créer des indicateurs permettant
de mesurer efficacement des objectifs clairement identifiés prend du temps. Il faut
pouvoir les tester sur une période significative. Enfin, un indicateur (ici un indicateur
de qualité de la justice) doit être analysé et interprété. Par conséquent : « La mise en
place d’indicateurs n’est pas la panacée des problèmes de performance. C’est une des
solutions possibles mais elle est à manier avec précaution 102. »
Une autre difficulté est celle qui naît de la multiplicité des critères : elle entraî-
nerait leur éventuelle contradiction. Les expériences menées aux États-Unis dans le
cadre de la réforme de la justice 103, ont permis de mettre en évidence que les ob-
jectifs de réduction des délais et de réduction des coûts n’étaient pas nécessaire-
ment compatibles : le management du début de la procédure par le juge réduit les
délais de 30 %, mais le coût par affaire augmente car les avocats font le même tra-
vail dans un délai plus court et assurent de nouvelles tâches 104.
Le manque de dialogue
Il est possible de critiquer la méthode utilisée par les pouvoirs publics pour éla-
borer les indicateurs de qualité développés jusqu’ici en ce qu’elle manque de con-
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
certation avec les autres acteurs du système juridictionnel : les justiciables, d’une
part, et les professionnels de la justice, d’autre part.
On constate aisément que les instruments de mesure choisis par la loi de finances
ne prennent pas en compte la prestation générale dont bénéficie le justiciable. Pour
ce dernier, la qualité de la décision tient surtout aux conditions de l’accueil par les
services du greffe et à l’écoute dont il a fait l’objet par le magistrat. De nombreux
sondages d’opinions ont pourtant été réalisés et auraient pu servir de base à une
réflexion prenant en compte les attentes concrètes des justiciables.
De plus, la motivation de la décision n’est pas évoquée dans cette liste de cri-
tères censés mesurer la qualité des décisions rendues. Le justiciable est pourtant
très attaché à « retrouver dans la décision attendue les arguments qu’il a dévelop-
pés, le fondement juridique retenu par le magistrat et un dispositif clair et exécu-
table » 105. Ainsi, l’opinion des justiciables eux-mêmes n’a que peu, voire pas, été
prise en compte dans l’élaboration de ces critères. L’impossibilité matérielle de con-
trôler les résultats d’un éventuel indicateur portant sur la motivation des décisions est
101. Anne PEZET et Samuel SPONEM, « Des indicateurs pour les Ministres au risque de l’illusion du contrôle »,
La vie des idées, 22 février 2008, <http://www.laviedesidees.fr/Des-indicateurs-pour-les-Ministres.html>.
102. Ibid ; voir aussi Peter F. DRUCKER, The Essential Drucker: Selections from the Management Works of Peter
F. Drucker, Oxford : Butterworth-Heinemann, 2001.
103. Les affaires civiles sont souvent coûteuses et fastidieuses. En août 1990, le Congrès des États-Unis
d’Amérique a adopté le Civil Justice Reform Act (CJRA) dans l’objectif de remédier à ces problèmes.
104. Maya BACACHE-BEAUVALLET, « Incitations et désincitations : les effets pervers des indicateurs », art. cité.
105. Didier MARSHALL, « L’impact de la LOLF sur les juridictions », art. cité, p. 121.
Droit et Société 83/2013 173
H. COLOMBET, A. GOUTTEFANGEAS
tout de même à relever. En effet, pour savoir si une décision de justice est motivée et
bien motivée, il faut la lire et connaître l’affaire en question. Cela n’est évidemment
pas possible concrètement, au regard du nombre de décisions de justice rendues en
France, ne serait-ce que dans la matière civile.
De la même façon, comment est-il envisageable de créer ces indicateurs sans
concertation avec les juristes ? La participation de certains magistrats à l’élaboration
des critères peut ne pas avoir été suffisante. Ainsi, une concertation avec un plus
grand nombre de professionnels aurait pu amener à soulever le problème de la « diffi-
culté différenciée des procédures » 106. Selon la juridiction, la structure du conten-
tieux sera différente, unique, et cette information ne peut que relativiser la portée des
indicateurs choisis. Didier Marshall cite l’exemple des juridictions corses, qui con-
naissent un contentieux successoral très important, alors que les juridictions de la
côte d’Azur ont un contentieux de la construction très pesant.
Certaines juridictions françaises ont fait le choix d’élaborer leurs propres cri-
tères, leurs propres indicateurs, au regard de leurs besoins, de leurs capacités et de
leurs objectifs. En se basant sur le travail réalisé par la cour d’appel de Paris, qui fait
partie des juridictions ayant engagé ce type de recherche, on peut constater que les
indicateurs choisis sont bien plus tournés vers les justiciables : « La décision statue-
t-elle sur les dépens ? Les modalités d’exécution sont-elles clairement définies 107 ? »
Il faut noter cependant qu’une telle recherche est envisageable au sein d’une juri-
diction alors que l’ampleur du travail est bien plus importante au niveau national.
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
Le choix discutable d’un modèle gestionnaire pour définir et améliorer la qualité de la décision
de justice
L’analyse managériale des systèmes judiciaires constitue un nouveau champ
d’investigation. Il semble bien que jamais auparavant la question n’a été posée sous
cet angle, alors même que cette approche entraîne une révélation spécifique des
conceptions de la qualité de la justice et de ses décisions.
Personne ne saurait rejeter d’emblée la volonté d’améliorer la gestion de
l’institution judiciaire : les deniers publics doivent évidemment être utilisés à bon
escient. L’optimisation de la dépense et la transparence des résultats obtenus sont
des objectifs qui ne sont pas en soi contestables. Mais l’approche gestionnaire ne
doit pas être « une fin en soi ; elle n’est que le moyen de rendre dans des délais
raisonnables une justice de qualité » 108. Selon Loïc Cadiet, ce n’est pas au moindre
coût, mais à un coût « adéquat » que la justice doit être rendue, or les instruments
d’analyse de la complexité de l’activité juridictionnelle n’existent pas encore. Comme
on l’a déjà vu, seuls des indicateurs de la qualité du jugement et de la charge de travail
sont utilisés et ils ne sont encore qu’à l’état d’ébauche, étant donné que la première
loi de finances sur le sujet date de 2007. En tout état de cause, la réflexion autour de la
mesurabilité de la production judiciaire doit encore être approfondie. La question de
106. Ibid, p. 124.
107. Ibid, p. 125.
108. Loïc CADIET, « La justice face aux défis du nombre et de la complexité », intervention à Paris pour les
50 ans de l’ENM, 2009.
174 Droit et Société 83/2013
La qualité des décisions de justice. Quels critères ?
savoir si les décisions de justice, en tant qu’actes intellectuels produits de manière
indépendante par les magistrats, peuvent être analysées à la lumière de critères quan-
titatifs de rentabilité n’est pas résolue. L’opposition évidente entre le choix gestion-
naire fait par les pouvoirs publics et l’analyse des auteurs en est l’illustration la plus
évidente.
C’est donc sur la définition de la qualité de la justice et de ses décisions que
porte le débat. Les pouvoirs publics ont aujourd’hui fait le choix de critères ges-
tionnaires et économiques avec les conséquences que nous venons d’exposer : les
critères d’une bonne décision de justice, de qualité, choisis par les lois de finances
récentes ne correspondent pas à ceux développés par la doctrine française et inter-
nationale qui s’est prononcée sur le sujet. « Il faut prendre garde à ce que les éco-
nomies recherchées en matière de justice ne conduisent à faire l’économie de la
justice elle-même 109. »
Pour consolider l’indispensable réforme de l’État, la culture du résultat doit
donc être réaffirmée devant les agents et les Français en renforçant la légitimité de
ses outils, les indicateurs, et de leurs usages. Comme l’appelait de ses vœux en 2009
le ministre en charge de la réforme de l’État : « Pour que les objectifs et les indica-
teurs soient utiles – car, admettons-le, ils ne le sont pas toujours – […] il faut qu’ils
aient une pertinence : qu’ils soient proportionnés aux enjeux financiers, qu’ils
soient compréhensibles pour le citoyen, pour les journalistes, pour le contribuable
ou l’usager des services publics 110. »
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
Anne-Lise Sibony écrivait en 2002 que « la réflexion sur la qualité de la justice
n’en est en France qu’à ses débuts » 111. Elle affirmait aussi : « Ce sera sans doute le
travail de plusieurs années encore que d’élaborer des outils d’évaluation à la fois
pertinents pour répondre [aux demandes de qualité] et acceptés par l’ensemble des
acteurs du système judiciaire 112. »
109. Ibid.
110. Intervention d’Éric Woerth, Assemblée nationale, 29 juin 2009.
111. Anne-Lise SIBONY, « Les éclairages des expériences étrangères », in Marie-Luce CAVROIS, Hubert DALLE et
Jean-Paul JEAN (dir.), La qualité de la justice, op cit, p. 149.
112. Ibid., p. 149. Voir aussi l’ouvrage sous la direction d’Emmanuel BREEN (dir.), Évaluer la justice, Paris :
PUF, coll. « Droit et Justice », 2002 ; l’article de Joël FICET, « Trajectoires de réforme de la carte judiciaire et
managérialisation de l’État. Analyse comparée des politiques de territorialisation de la justice en France et
en Belgique », Revue internationale de politique comparée, 4, 2011, p. 91 et l’article de Jean-Marc SAUVÉ, « Le
juge administratif face au défi de l’efficacité. Retour sur les pertinents propos d’un Huron au Palais-Royal et
sur la “critique managériale” », Revue française de droit administratif (RFDA), 4, 2012, p. 613.
Droit et Société 83/2013 175
H. COLOMBET, A. GOUTTEFANGEAS
Les auteurs
Hélène Colombet est doctorante contractuelle à l’Université Jean Monnet (Saint
Étienne) et allocataire de la région Rhône-Alpes (CLUSTER 12, devenu ARC 8). Elle est
membre du Centre de recherches critiques sur le droit (CERCRID). Ses recherches por-
tent sur l’obligation d’information sur la situation juridique des sujets de droit.
Alice Gouttefangeas est doctorante contractuelle à l’Université Jean Monnet de Saint
Étienne et allocataire de la région Rhône-Alpes (CLUSTER 12, devenu ARC 8). Elle est
membre du Centre de recherches critiques sur le droit (CERCRID) et travaille sur les
liens entre la solidarité familiale et la solidarité collective, particulièrement dans le
cadre du financement de l’hébergement des personnes âgées en structures spécialisées.
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
© Éditions juridiques associées | Téléchargé le 23/08/2023 sur www.cairn.info (IP: 197.234.221.16)
176 Droit et Société 83/2013
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- La Littérature Africaine Dans Son EssenceDocument226 pagesLa Littérature Africaine Dans Son EssencerwatzaNo ratings yet
- Le Montant Dans Le ContratDocument2 pagesLe Montant Dans Le ContratrwatzaNo ratings yet
- Les TIC Au ParquetDocument1 pageLes TIC Au ParquetrwatzaNo ratings yet
- La Certifification de La MarchandiseDocument2 pagesLa Certifification de La MarchandiserwatzaNo ratings yet
- Les Transmission Des Actes Dans La Coopération Bénino-FrançaiseDocument2 pagesLes Transmission Des Actes Dans La Coopération Bénino-FrançaiserwatzaNo ratings yet
- L'imperfection Dans La PreuveDocument1 pageL'imperfection Dans La PreuverwatzaNo ratings yet
- Qui Est Vraiment SenghorDocument11 pagesQui Est Vraiment SenghorrwatzaNo ratings yet
- La Matérialité de La PreuveDocument7 pagesLa Matérialité de La PreuverwatzaNo ratings yet
- Le Droit À La DéconnexionDocument23 pagesLe Droit À La DéconnexionrwatzaNo ratings yet
- Réussir Le DroitDocument6 pagesRéussir Le DroitrwatzaNo ratings yet
- Les Actes CognitifsDocument279 pagesLes Actes CognitifsrwatzaNo ratings yet
- Introduction Au Droit Public (F. Bouhon)Document241 pagesIntroduction Au Droit Public (F. Bouhon)rwatzaNo ratings yet
- La Responsabilité Du MagistratDocument21 pagesLa Responsabilité Du MagistratrwatzaNo ratings yet
- Que Doit Faire Le Magistrat ?Document27 pagesQue Doit Faire Le Magistrat ?rwatzaNo ratings yet
- L'Éthique Du MagistratDocument96 pagesL'Éthique Du MagistratrwatzaNo ratings yet
- Le Bon RobertDocument580 pagesLe Bon RobertrwatzaNo ratings yet
- AdministratifDocument4 pagesAdministratifrwatzaNo ratings yet
- Les Fondements Juridiques Du RécursoireDocument10 pagesLes Fondements Juridiques Du RécursoirerwatzaNo ratings yet
- Qu'en Pense Le SénatDocument261 pagesQu'en Pense Le SénatrwatzaNo ratings yet
- Tableau de DépouillementDocument3 pagesTableau de DépouillementrwatzaNo ratings yet
- Le Besoin de Communication Et de Reconnaissance Du Salarié en TélétravailDocument1 pageLe Besoin de Communication Et de Reconnaissance Du Salarié en TélétravailrwatzaNo ratings yet
- Les StartbDocument4 pagesLes StartbrwatzaNo ratings yet
- UntitledDocument1 pageUntitledrwatzaNo ratings yet
- Gérer Les Distances Psychologiques: Mudler, Power and Satisfaction in Task Oriented Groups, Acta Psychol, 1959, P 197Document1 pageGérer Les Distances Psychologiques: Mudler, Power and Satisfaction in Task Oriented Groups, Acta Psychol, 1959, P 197rwatzaNo ratings yet
- Le Genre de Manager D'Equipe Convenable Au Teletravail: Du Gestionnaire Au CoachDocument2 pagesLe Genre de Manager D'Equipe Convenable Au Teletravail: Du Gestionnaire Au CoachrwatzaNo ratings yet
- SommaireDocument84 pagesSommairerwatzaNo ratings yet
- Acte de Consécration À Lesprit Saint-9Document1 pageActe de Consécration À Lesprit Saint-9rwatzaNo ratings yet
- Saint JosephDocument33 pagesSaint JosephrwatzaNo ratings yet
- ReglementationDocument7 pagesReglementationrwatzaNo ratings yet