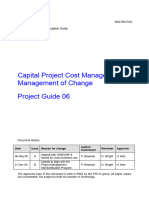Professional Documents
Culture Documents
Approche Processus 2
Approche Processus 2
Uploaded by
Nouredine Koufi0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views13 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views13 pagesApproche Processus 2
Approche Processus 2
Uploaded by
Nouredine KoufiCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 13
as
2.5. L’ECOLE DU MANAGEMENT MODERNE
Le management moderne issu de |'évolution d
systémique, a ete développé ces derni¢res année
chercheurs qui vont méme sinterroger sur 1 ori 4
management en tant que science ou art
La science, implique nécessairement
méthodes scientifiques avec les principales étapes sul
- Accumuler des faits et de donnés d'une fagon objective
~ Procéder a leur classement méthodique, pour permettre leur
utilisation.
- Emettre des hypothéses a partir de ces donnés.
Procéder a la vérification de ces hypothése:
Utiliser les hypothéses exactes dans les situations de gestion.
ces, l'expérience
L'art, implique beaucoup plus les connaissan
du manger,
ou T'observation personnelle. Les compétences
s'expriment a travers son art de réaliser les actes de gestion.
L'école moderne du management mettra emphase la science
et l'art pour améliorer les performances des organisations ou
entreprises, avec quatre principales approches: par processus,
systémique, situationnelle ou comparative.
2.5.1. L'APPROCHE PAR PROCESSUS:
va slintéresser a l'analyse des
différentes approches théoriques du management. Il mettra en relief
dans ces conclusions, une véritable confusion dans cet ensemble de
théories, qu'il qualifiera de "yéritable jungle".
Il admettra cependant que ces différentes approches ont
contribué a l'enrichissement des théories générales du management
et elles ont permis une meilleure gouvernance des entreprises, ainsi
que l'accroissement de leur performance.
Harold Koontz (1961)
59
PLANIFIC ATION
—— (Pal =
Y
ORGANISATION
a
Spree steed
CONTROLE
| | DIRECTION
Fic. N°04. LE PROCESSUS DE MANAGEMENT.
Cette approche par processus développée par Koontz,
fondée sur lI'exécution de ces principales fonctions du management,
n'a pas beaucoup convaincu les chercheurs, ni les professionnels
management, mais elle est plus tot considérée comme une synthése
pratique du Fayolisme.
2.5.2, LE MANAGEMENT SYSTEME OU L'APPROCHE SYSTEMIQUE-
dele La pohoniade, systéme est définie en tant qu’ensemble
ec organisé, avec une multitude de relations agencées ¢t
plexes, qui forment un tout cohérent. Dans un ensemble
60
I
P
i ase ee pe
E
ble
él
ple
organisé on retrouve plusieurs sot
interrelations qui font objet d°une gest Anite
1e gestion intégr
Il existe deux types de systémes: |
systeme fermé
Le systéme : SUF
ystéme ouvert, est un systéme
ent d'une facon dynamique
interagi ae
environnement, afin de transformer les ressou d il trai
essources qu
Le systéme fermé est composé d'éléments qui n'
pas avec ceux de son environnement et qui ne
Jeur influence. Quand il s'agit dentreprise ou d'o
référence au systéme ouvert, car les entreprise: ragissent
toujours avec les éléments de leur environnement et subissent leurs
influences.
Le management systéme basé sur l’utilisation des modéles
mathématiques et des sciences cybernétiques a été introduit dans
les années soixante. La notion d’entreprise va prendre une autre
dimension et sera considérée comme un systéme ou un ensemble de
sous systémes avec une multiplicité des centres de décision.
L’entreprise elle-méme, peut €tre un sous systéme d’un ensemble
plus large et plus complexe.
Dans les nouvelles structures de l’entreprise on retrouvera,
par exemple, des systémes appelées systémes opérationnels congus
autour des centres de décision et des systémes fonctionnels congus
autour des centres dactivités ou des ateliers de production.
Chaque fonction de Pentreprise est intégrée dans un sous-systéme
dans le but d’optimiser Pefficacité de l’ensemble du systéme.
Les fonctions du manger dans cette approche seraient en
premier lieu de coordonner et de combiner tout un ensemble
dlactivités au sein de l'entreprise pour que cette derniére en tant que
systéme réalise ses objectifs.
61
——_—_——-—~S”—rt—™~—O ?
ns un second temps Je manager assure le li
de son environn
Dar .
ene et Ce!
é| 3 du sy stame et ©
ce éments c “ : os ae
fournisseurs, les clients, les différents partenaires gou
ou sociaux)
Sorie du management systéme 1
em
Dans la the
humaines et matérielles conditionnent Je fonctionr
me en tant que facteurs intrants ou «inputs»,
ir transformation comme des produ
Jués en terme de performance
La boite noire «black box» est le processus de tran
des «inputs» en «outputs». La théorie du manager
s’applique pas Ace qui se passe dans cette boite no
uniquement sur tout ce qu’y rentre et ce qui en
appellation «boite noire».
syste!
obtenus par leu
«outputs» sont éval
Fig. N° 05. Black Box
Sous Systemes Sou
ous Systémes
> BOITE NOIR ou
J >} BLACK
3 BOX
ai (processus de
7 production)
Ss
>}
Cette théori: 6
et 1e :
optimiser fed Rate ei aussi la régulation des inputs pou!
; oemation en nombre est basée sur l’existence de res
I : nae
Mr isystéme, avec un irae qui régulent le fonctionner®™
i . sus de . . He
est intégré traitement contin ©
eré dans le sous-systéme et qu'on appel®
informatio:
mn
le esc
62
i i.
La maitrise de ces réseaux d’informatic
de gestion intégrée est done nécessair
repose essentiellement sur le postulat 1
\ chaque fois qu'un sou
systéme, entreprend action, |
touchent, 4 des degres divers, | en t 1
D’ot la necessite l
I
des résultats et leur har
implications possibles d
systéme
Ce qui a permis de dév elc
réseaux d’informations sur ordinateur
mathématiques, ou de recherche opérationn
cybernétiques. L’exemple classique de ce type de
est le systéme de réservation de compagnies de transport aerien
Mais, la théorie du management sy steme remet en question
limportance du facteur humain. Cette théorie va de nouveau
considérer le facteur humain comme un simple élément du systéme
de la méme fagon que les autres ressources.
On retrouvera les mémes conséquences de dépersonnalisation
du facteur humain examinées dans les systémes bureaucratique et
scientifique par exemple. D’ot la comparaison avec Ces systémes &
partir du moment ou ces deux théories ont pour objectif
l'efficience et pronent [utilisation de moyens rationnels pour y
parvenir.
2.5.3. L'APPROCHE SITUATIONNELLE OU LA THEORIE DE LA
CONTINGENCE:
L'approche situationnelle ou la théorie de la contingence,
développée dans le management moderne, a intégré ensemble des
théories du mangement, en remplagant certains principes qui
apparaissent simplistes.
63
approche est utilise
ésolu. Elle prone I'util a
situation spécifique px
ise ou de I'organi
nouvelle
En effet cette nov
probléme spécifique doit étre
concepts de management dans une
efficacement les objectifs de l'entrepr'
i accorde plus d'importance a
Il est done important pout le manager de cibler le
déterminent une situation, car pour chacune d'elle il doit
les principes qui lui conviennent le mieux.
tionnelle est donc une approc
management qui consiste a dire qu'il n'existe pas une th
qu'on doit appliquer, mais les méthodes ou principes éorigy
pour solutionner des problémes sont déterminés par le contexte
la situation rencontré. Mais il faudrait toujours compreng,
ce qui différencie une situation d'une autre pour pouvoir j
appliquer les concepts adéquats.
C'est une théorie qu
L'approche situat
Les différentes variables qui sont prises en consideération par
les théoriciens de cette approche sont appelées "Variables
contingentées" dont les principales sont: ge
s le manager, les travailleurs, la taille de l'entreprise, la
ay ication des technologies, le mode de production, |'incertitud:
Peiaerupgoement es variables contingentées influent sur |:
ni¢ gers de coordonner et de i g des
cn combiner l'ensemble de
Ise Bah :
oe mie fonctions a partir de son expérient
déterminés par les différentes . plusieurs autres facteurs qui so?
type de situation po S situations. II doit s'adapter a chaqu
Pour prendre des décisions efficaces, cel
capacité dadaptation
: et de réactivité sa :
mode de direction des ee aux événements détermine !
Les spécificités et
la Rela
compétences, de Personnalité des travailleurs en te™
to
lerance, de trait de caractére %
64
fk
déterminantes pour le choix des méthod 1
odes de
modeéle de commandement et de l'organ
ation du travai
La taille de l'entreprise, en termes d'effectif f
T'exercice des fonctions managériales dans |'e di Pl
[effectif est important et plus le travail de z
avail ¢ or
important.
eS technologiques utilisés —_ exi
organisation spécifique, des modes de gestion et des
contréle différents. 2 g
Le mode de production ou le travail lui méme détermine la
structure organisationnelle. Le type de travail, le degré de
subordination, le coefficient d'exploitation, le nombre de niveaux
hiérarchiques, sont liés au mode de production (mono production,
production de masse etc.), choisi et détermine la situation.
Liincertitude de l'environnement est liée aux différents
changements rapides sur le plan politique, économique, social,
culturel et technologique. Ce degré d'incertitude influe sur le
comportement des managers.
Plusieurs études ont démontré effectivement l'influence
importante de l'environnement en général sur le comportement des
manager et des organisations.
basée sur la situation, peut étre
illustrée par I'exemple qui explique comment la situation peut
influer sur la décision. Dans une entreprise donnée les dirigeants
ont décidé d'augmenter les salaires (action X), ils pensent que cett
augmentation entrainerait un accroissement des rendement
(résultat Y). On aura donc:
mS
Cette nouvelle approche
65
n Iaction X motive le résultat
condition de travail par
on doit introduire un
ail, pour obtenir Y
somparaiso!
Par comparalsc Hale
quvals
situation de mé
t escompte done
ditions de trav
‘on situationnelle suivante
res al
amélioration de con
On aura done une illustrati
Action X aso [ Résuta y
Variable Z
Dans cet exemple, la Z détermine la situation, influencera la décisioy
Cette nouvelle approche situationnelle ou de la contin
été développée dans le management moderne sur la base
théories universelles du management. A partir des co
développés par ces différentes théories (classique, scientifique, des
ressources humaines...), il est préconisé de les adapter ax
différentes situations particuliéres.
ini Ces situations ont des forces qui influent directement sur la
décision, et dont il faudrait en tenir compte. C'est une approche qui
a été adoptée, avec succes, i i
= aC par plusieurs entreprises ¢
organisation. : R ae
2.5.4. L'APPROCHE COMPARATIVE:
gat Pe ong tal de cette nouvelle approche 4!
management tel qu’ i side comparer les différentes théories
Pec chen quetes sont appliquées dans certains pays ¢t *
ncepts ou éléments Jes plus performants pour les
appliquer ou les adapter a une entreprise donnée
W.Ouchi ;
théorie qu'il a 1981), a été le premier a développer cette nowl®
appelée "théorie Pas ae ces trove es
66
ya RS
A
ngconomie Japonaise, oi il a ;
cette économie, la croissance de |
demi supérieure a c¢ lle des Etat
Pendant ces cing année
approches de management Amé
résultats développés dans sa nouveil tt
nou 1 Lk
symbiose des facteurs performants da
adopter dans plusieurs entrep
donnés des résultats significatifs ‘
14
Le tableau suivant illustre clairer
comparative,qui a été élaborée par W. Ouchi.
_ JAPON THEORIE Z ETATS UNIS.
1. Emploi a vie. 1. Emploi a long terme. 1, Emploi a cou
2. Evaluation 2. Evaluation personnelle 2. Evaluation personnelle et
personnelle et et promotion a long promotion rapide
promotion a long terme. 3. Cheminement de carriére
terme. 3. Cheminement de spécialisée.
3. Cheminement de carriére semi spécialisé. 4. Décision individuelle.
carriére non 4, Décision par consensus. 5. Responsabilité
spécialisé. 5. Responsabilité individuelle.
4, Décision par individuelle. 6. Contréle explicite et Formel.
consensus. 6.Contréle informel 7. Préoccupations sociales
5, Responsabilité implicite mais mesures Facultatives
collective. explicites.
6. Contréle informe! 7.Préoccupations sociales
implicite. limitées (famille)
7. Préoccupations
sociales globales.
Fig, N°06 Tableau de la théorie Z
Sources ; W. Ouchi, (1981),Theory Z; How American Business Can Meet the
Japanese Challenge. ‘Addison-Wesley, Don Mills (Ontario), p. 85.
i des théories
L'approche comparative est une adaptation aussi ;
universelles de management avec cette spécificité qui est de tenir
comptes des expériences des autres pays ct de choisir les concepts
les plus performants pour les appliquer dans les organisations ou
les entreprises.
67
ome! acne est donc
La théorie du management moderne iy
de concepts ou de principes per
és par d'autres nations ou entreprises pou
cher toujours
cipe est de recher les outils les plu
niverselles
3s performants a partir de théories un
2.6. CONCLUSION:
Les théories du management ont évolué rapi
le précédent siécle, en fonction des besoins
entreprises et des changements de l'environnement e
n général. Quatre grands courants de pensée ont été a
c
cette évolution.
Le courant de pensée classique qui dés le début de son
développement a préné l'utilisation d'instruments de logique et de
rationalité. L'école classique, a été initiée dés la fin du 19°™* sigcle
était composée de deux principales approches. :
L’approche bureaucratique ou administrative, labore
esseatiellement par Weber et Fayol. Cette théorie a été élaborée sur
- base d'une démarche systématique dans la gestion administrative
< entreprises et d'une definition de l'ensemble des fonctions de
‘entreprise, en préci 6 i j
pI précisant le réle que doivent jouer les managers.
Giecth ines, tie introduite par Taylor, Gantt ¢
ee, fe Sage edit vise: A développer des méthodes
sélection des ee peecene des travailleurs, des méthodes ¢
jee ‘avai leurs les plus performants pour un travail
différentes ae id pees pour effectuer rapidement Is
et équitable en fonction _ adil de rémunération adéqua’s
Ces deux théori .
Continuent toujours ee ont été universellement admises ¢t qui
appliquée dans certaines organisations
68
Chacune d'elle a influen
entreprise
RamenGdales de 5 the
que les modéles de gestion des ent
ains!
Le courant de pensée des r
ae ssources
mouvement des "behaviouristes", durant
Elton Mayo. Mansterberg et Follet. c
donné une autre dimension au ma
gimension humaine
Le facteur humain est particuligrement pr
en tant que nouvelle source de rons
motivation sont devenues la préoccupation majet
théoriciens. Cette approche a aussi influencée él
modéle de management basé sur la participation a facteur
dans les processus de prise de décision. ¢
Le courant de pensée quantitativiste, qui prone l'utilisation des
mathématiques et des méthodes quantitatives pour résoudre les
problémes complexes de management et aider 4 la prise de
décision.
Liécole quantitative est née durant la seconde guerre
mondiale, pendant cette période les ressources étaient plus tot
limitées, il fallait chercher 4 les optimiser et a étre plus efficace et
plus rapide dans les processus de réalisation que les forces
adverses. :
Des modéles calculables de mathématiques ou de recherche
opérationnelle ont été développés pour maitriser la gestion des
opérations, les systémes d'information et le management des
entreprises.
Et enfin, le courant de pensée du management moderne, ou
derniéres annees avait pour but
l'école moderne, qui a été lancé ces 4 maximiser
de synthétiser toutes ces théorie Guess ea uatre
lefficacité. Cette nouvelle approche sest développée Sut }
S pour
69
—E——LULULUlUlUl
axes différents, les processus, les systemes, la situ
comparative.
sont succédé ¢
généré des théories qi
théories ont au
Les courants de pensée qui se
siécle précédent ont
appliquées de nos jours. Ces
management moderne.
70
NOTES cHapitre 2
(1) Adam Smith, (1947), Recherches
nations., Dunod, Paris
(2) Max Weber, (1947), The Theory of Socia
Free Press, New York
(3) H. Fayol, (1966), Adminis
(4) F.W. Taylor, (1947), Sc
(5) H. L. Gantt, (1921), Industrial L
(6) H. Miinsterberg, (1913), Psychology and Ind
Mifflin, Boston.
(7) Maya Parker Follet, (1918), The New State: Group Oganization, the soluior
of Popular Government. Longmans, Green, Londres.
(8) Elton Mayo, (1933), The Human Problems of an Industrial Civilization
Macmillan, New York
(9) F.J. Roethlisberger & W. J. Dickson, (1939), Management and the Worker
Harvard University Press, Cambridge, MA.
(10) H. A. Simon, (1960), The New Science of Management Decisions. Harper
& Row, New York.
(11) H. Koontz, "The Management Theory Jungle", Journal of the Academy of
Management, Dec. 1961, pp.174-188.
(12) YK. Shetty & H. M. Carlisle, (1972), “A Contingency Model of
Organization Design.” California Management Review N°15, pp.36-44.
(13) W. Ouchi, (1981),Theory Z: How American Business Can Meet the
Japanese Challenge. Addison-Wesley, Don Mills (Ontario).
(14) W. Ouchi, (1981),Theory Z: How American Business Can Meet the
Japanese Challenge. Addison-Wesley, Don Mills (Ontario), p. 85.
S sur la natu
cas
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Supplier Document Requirement Listing (SDRL)Document23 pagesSupplier Document Requirement Listing (SDRL)Nouredine KoufiNo ratings yet
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- 03-02 Schedule Risk Analysis (SRA) - SRA For Planners Lunch and LearnDocument39 pages03-02 Schedule Risk Analysis (SRA) - SRA For Planners Lunch and LearnNouredine KoufiNo ratings yet
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- PG 06 Capital PRDocument47 pagesPG 06 Capital PRNouredine Koufi100% (1)
- Knowledge AreasDocument7 pagesKnowledge AreasNouredine KoufiNo ratings yet
- Approche Processus 0Document5 pagesApproche Processus 0Nouredine KoufiNo ratings yet
- 4TPFC-00D-400-0000-0001 Rev 3 Field Project Controls Procedure Rev 3Document12 pages4TPFC-00D-400-0000-0001 Rev 3 Field Project Controls Procedure Rev 3Nouredine KoufiNo ratings yet
- 02-02 Project Risk Assessment Scales - Integrated RAM Template (Upstream and Downstream)Document2 pages02-02 Project Risk Assessment Scales - Integrated RAM Template (Upstream and Downstream)Nouredine KoufiNo ratings yet
- Vendor Data Requirement Specification (VDRS)Document9 pagesVendor Data Requirement Specification (VDRS)Nouredine KoufiNo ratings yet
- Document Requirements For Suppliers - NEPTUNEDocument15 pagesDocument Requirements For Suppliers - NEPTUNENouredine KoufiNo ratings yet
- Oil & Gas Canadian CompaniesDocument3 pagesOil & Gas Canadian CompaniesNouredine KoufiNo ratings yet
- KPC SubsidiariesDocument1 pageKPC SubsidiariesNouredine KoufiNo ratings yet
- Work Breakdown StructuresDocument5 pagesWork Breakdown StructuresNouredine KoufiNo ratings yet
- AmazonDocument1 pageAmazonNouredine KoufiNo ratings yet
- Working For Oil and Gas Operator Vs Oilfield Service CompanyDocument7 pagesWorking For Oil and Gas Operator Vs Oilfield Service CompanyNouredine KoufiNo ratings yet
- TigiDocument1 pageTigiNouredine KoufiNo ratings yet
- SHAHATDocument1 pageSHAHATNouredine KoufiNo ratings yet
- ADCODocument1 pageADCONouredine KoufiNo ratings yet