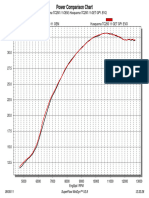Professional Documents
Culture Documents
La Preparation Des Moteurs Etai - 041 - A - 080
La Preparation Des Moteurs Etai - 041 - A - 080
Uploaded by
Loic Trocme0 ratings0% found this document useful (0 votes)
28 views40 pagesOriginal Title
la-preparation-des-moteurs-etai_041_a_080
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
28 views40 pagesLa Preparation Des Moteurs Etai - 041 - A - 080
La Preparation Des Moteurs Etai - 041 - A - 080
Uploaded by
Loic TrocmeCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 40
pour amincir d'environ 30% la cou:
fonne de démarreur, qui, par ses
multiples dents réparties sur un dia-
matte important, se comporte comme
tun véritable ventilateur & haut régime :
sur un volant de 300 mm de diamétre
fournant & 8 000 trimn, les dents de la
‘couronne brasse Fair & 450 kmih; ce
rest pas rien du point de vue résis:
tance aérodynamiquo |
Une autre solution, plus coiteuse
cella, consiste & usiner entidrement
tun autre volant beaucoup plus léger
— sot en acier si 'ancien est en fonte
par example ; il faut penser a traitor ot
rectifier la surface de friction surlaquelle
vient s‘appuyer lo disque ; le frettage
dela couronne de démarreur ne pose
pas de probleme majeur,
= soit en aluminium (AU4G et dérivés)
sion recherche un gain maximal ; mais.
ce cas pose des problémes pour rap-
porter la surface de fricion et la
couronne de démarreur : la friction en
aciet est généralament coliée et vissée
sur le volant tandis que des pions
‘lustés entre cuir et chair renforcent le
{ettage de la couronne dentée,
Tout travail sur le volant moteur doit
sachever par un équilibrage dyna-
mmique sur machine. Calui-ci sera d abord
‘quilibré seul (mise a « zér0 ») avant
distre associé au vilebrequin pour par
faire léquiibrage de rensemble.
Invest pas indispensable d’équilibrer
‘en méme temps le plateau d’embrayage
Le robutesse des bielles forgées en titane, dotées dune large
‘Section en » H, saute aux yeux (Mare V12)
Enmatiére dallegement de bell, certains préparateurs n/hésitent pas a essayer des belles
fn aluminium, entigrement usindes dans la masse. A lariére plan, Je bielle d'origine en
‘acier mairicé (au fond) et ete, la méme en acier forge. (Préparation Car-creff
qui est une piéce d'usure, ou alors on
fara équilibrer seul ce dernier si 'équil-
brage d'origine n'est pas satisfaisant
2.3. Les bielles
Les bielles font partie, avec le vile-
brequin et les pistons, des organes les,
plus sollictés du moteur. A chaque
explosion, une bielle regoit des efforts
— 39
de compression énormes :jusqu’ plus
de 5.000 daN (5 « tonnes ») sur un
moteur de 80 mm d'alésage et 10:1 de
rapport volumétrique (co qui corres-
pond A une pression maximale de
combustion de 95 bars si on suppose
un taux de remplissage de 1) ! Encore
faut-ll ajouter & cet effort la force
dinertio, maximale au PMH, et qui peut,
rment et le polissage des bielles, avant et apres : Triumph
yee chapeau rapporié par vis, t bielles de moto Yamaha a
Grolie avec chapeau rapporte par boulons (Préparation Racing
Dittusion).
comme nous avons vu, dépasser
largement la « tonne » suivant faces
ration et la masse du piston,
Plus que cette forte compression, i
ya risque de flambage (flexion brutale,
‘la maniére d'une regie plate en plexi
que Yon comprime & ses extrémités)
élancement de la bielle devient trop
important, c'est-a-dire grossiérement si
le rapport iongueur sur section moyenne
est trop élevé.
De ce point de vue des. bielles
Courtes seront en principe plus robustes.
Or nous venons de voir tout Fintérét de
monter des bielles longues.... mais
Coditeuses en poids et donc en tours
moteur. Il estrisqué de trop alléger des
bielles deja longues, aussi préfére-ton
mettre toutes les chances de son cbté
‘en faisant réaliser des bielles forgées
enalliage de titane, trés robustes, avec
des sections en «H » tres larges (au
contraire des sections en «I» ou
«double T» des bielles matricées
courantes) (ig. 30)
Le titane posséde une densité de
40 % inférieure a celle des aciers (4,5
contre 7,8) pour des caractéristiques
mécaniques voisines (&peine inférieures
aux aciers au chrome et molybdéne par
exemple). On imagine le gain de poids
possible qui, méme avec une section
de bielle plus large, peut avoisiner les
80 & 35 % 1 Seul inconvenient & cette
efficace et noble solution : son cob.
La société autrichienne Pankl est tres
ptisée en F1 pour ses bielles en titane
forge.
Des bielles en matériau composite,
type carbone-epoxy, sont également
envisagées. D’une densité comprise
entre 1,2 et 1,8, dune tésistance
‘mécanique comparable a celle de Tacier
pour les fibres haute performance, le
ccarbone-époxy offre surtout une tenue
cn fatigue 2,5 fois supérieure @ celle
des aciers et allages en ttane. Mais la
mise en ceuvte d'un tel matériau, avec
cuisson en autoclave, reste autant
délicate qu’onéreuse. Renault Sport et
FAérospatiale, pour ne citer queux,
collaborent pour la recherche de nou:
‘veaux matériaux sur le V10 Ft
Néanmoins, vous pouvez toujours
grignoter quelques grammes par ci par
[a sur des bielles classiques, assez
largement surdimensionnées dorigine.
Les schémas figure 29 montrent ot i
est souvent possible dienlever de la
‘matigre sans risque. On veillera autre
part, ot C'est trés important, a équilirer
les bielles, ce qui signitie
— égaiiser bien sdr leur poids (cha-
peau et vis ou boulons compris), i
existe de grosses diférences sur ies
bielles de grande production ;
aligner Jour centre de gravité afin
diégaliser d'un c6té les masses rota-
tives, de l'autre les masses oscilantes,
‘On commencera donc par travailler
la bielle la plus légére et on alignera le
poids des autres sur colle-ci.
La procédure de controle des hau-
teurs de centre de gravité est relative-
ment simple : & cBté du plateau de la
balance (précise a 0,5 g prés), prévoir
lun support fixe muni d'un axe horizontal
sur lequel on pourra enfiler soit la téte
soit le piod de la bielle, ceci afin de ne
peser sur la balance que la partie
‘opposée. II suffit alors d'égaliser sur
chaque bielle les valeurs mesurées.
ae I 4 ‘Axe vilebrequin |
Fig. 0: Sections de bielle en « | » (acl matrcé) et en » H » (titane forge).
Aron
4
bb
i enapeau
(apport par
euler at pl
cp a.
Fig. 29 : Schéma d'allegement d'une bielle (les zones noirci
‘représentent la matiore
enlevée).
—40 =
Cott te
eae
‘Quend ta préparation rejoint le conception pure dens ies Ets Danielson; L’srdinaleur et la CAO sont souvent de mises, per exemple ci
lorsquil ‘agit de détinir une nouvelle bielle (BX Turbo = Super Tourisme ») et de simuler son mouvement alin de villor sk oon cescih eat
‘compatible avec espace disponible dans fe carter
Bietles en titane pour moteur R21 Turbo
forgée au premier plan (version « Produc:
tion 88 »), ou usinee dans la masse (version
‘Super Tourisme 89»). Préparation Sodemo-
Motours
Un modéle du genre que ce piston de R21 Turbo « Super
Tourisme » fabriqué par Mahle : absence quasi totale de jupe, tele
reuse (calotte rapporiée soudée) permettant un refroidissement
‘por cireulalion chuile interne (erientés convenablement dans le
fee, des gicleurs o'hulle = erachent » dens l'un des deux orlices
Visibles au fond du piston) etpuis aussi gorges de dscompressian
ant-», sont alors actionnées par deux
ACT parailéles, un pour admission,
tun pour I'échappement. Par rapport &
tun seul arbre a cames, latéral ou en.
tte (rappelons-nous le moteur de la
Triumph Dolomite Sprint, premier moteur
de série & posséder 4 soupapes par
cylindre commandées par un seul
ACT..), ces deux ACT sont moins
sollcités en torsion et en flexion puisque
le nombre de leurs cames est réduit de
moitié. De ce fait leur rigidté est
supérieure. D'autre part, le principe de
Tattaque directe des soupapes (came-
boisseau-soupape) procure une com-
mande sans la moindre « élasticité »,
‘ce qui rvest pas le cas d'une commande
par_came-poussoir-tige-culbuteur-
Soupape ; cette « élasticité » nuit & la
précision de la distribution tout comme
elle favorise les phénoménes de réson-
anoe aux hautes fréquences.
‘Tous ces avantages conférent & la
distribution par ACT une meilloure
précision de commande et une énergie
‘consommée réduite, particuligrement
aux régimes élevés. Ceci n’empache
rnullement certains moteurs a ACL
etre trés performants ; implement, is
‘seront en comparaison toujours péna-
Ccuuteur
Distsuton aver are &cames ira
{x Renault meme e 8 GT Tatoo
Nz Abarh, WW Coceimele, 20)
Vis de réaaoe
cutter
Basculeu
seul
OF
Dietouton avec arre camas an ste
Tareave inareste ee sasoane
ee Ope, Honds.)
Dieriouton aves @ ara 8 cames en tie
(ex : 20 Gti Fat Pain, Uno,
ve ‘fa 38 Lancia Dena, Sot GT)
Fig. 82: ilustration de differents modes de distribution
— 43 —
lisés en régime maxi parce que beau-
coup plus sujets aux risques caffole-
ment des soupapes. Pour agrémentor
e propos, souiignons une nouvelle fois
le cas du moteur Cosworth 1 000 cm’
de F3 cité un peu plus haut: malgré
Lune distribution par arbre & came latéral
des plus classiques, il attelgnait des
régimes supérieurs & 10 000 t/mn |
ertes toutes les masss en mouvement
avaiont subi un allégement considé-
rable, mais ce moteur ne pouvait se
passer de ressoris de soupapes trés
se méchants ». Aussi, pour limiter la
déformation des axes de_culbuteurs
sous action de ces ressors trés raides,
coux-ci étaient guidés sur une rampe
spécifique & 9 paliers (2 par culbuteur),
tallde dans une barre daluminium et
repportée sur la culasse.
Gitons. aussi, pour les passionnés
de VEC (Véhicules de course d époque),
le cas d'un autre moteur au passé
prestigieux: le 6 oylindres en ligne
Bristol a chambres. hémisphériques.
‘Ses 12 soupapes (en V) étaient action-
nnées & partir d'un arbre & cames latéral
et d'un ensemble de... 18 culbuteurs et
tiges :6 pour tadmission, le double
pour Téchappement ! La commande
de ces demitres faisaient en effet
intervenit des culbuteurs de renvoi
(axes communs & ceux d'admission)
Qui, par lintermédiaire de 6 tiges hor:
Zontales, mangeuvraient tes 6 culbu-
teurs d'échappement. Ce moteur de 2
itres, congu en fait avant la seconde
‘guerre par la oélebre firme aéronau-
fique pour le compte de BMW, connut
ses heures de gloire dans les années
50 avec la marque AC... qui passa un
peu plus tard au moteur Ford V8 pour
ses Iégendaires et foles « Cobra ». Ce
codteux 6 cylindres Bristol atteignit
rnéanmoins & son époque la confortable
puissance de 150 ch & 6 500 trimn.
Demier exemple de moteur sportf
disposer d'un ACL, encore trés en
vogue aujourd'hui: celui de la RS GT
turbo, dont la base du bloc n’est guére
Gloignée de colle du moteur d'une RE.
Parier de allegement de la distibu-
tion, est passer en revue chaque
élément qui compose cette chaine plus
ou moins complexe qui assure la
commande des soupapes. Comme-
rngons si vous le voulez bien par ces
demiéres pour remonter dans ordre
chronologique vers arbre a cames et
sa commande.
* Les soupape:
Dificle de gagner beaucoup de
poids, dTautant plus que amelioration
du remplissage (voir ce chapitre) pas-
sera cerlainement par le montage de
soupapes plus grosses et par consé-
Fig. 32: Allegement possiblo(sur tour muni d'un manddin & pince calibrée) et polissage de
a tate des soupapes:
quent plus Jourdes. On notera dailleurs
A ce sujet lintérét de prétérer deux
petites soupapes a une seule plus
{grosse, justement pour cette question
de poids et dinertie. Ce qui explique
que les moteurs & 4 soupapes par
cylindre, oulre le fait quills solent mieux
«remplis » & haut régime, peuvent
tourer plus vite
Hest possible d alléger I6gérerent la
téte des soupapes en creusant en céne
Mintérieur de la forme tulipée (fig. 33)
Cet usinage doit étre exéouté sur un
tour muni d'un mandtrin & pince calibrée
(pour ne pas abimer la queue de
‘soupape). Le gain enregistré reste assez
faible, et il est préférable de n’effectuer
‘08 travail que sur les soupapes d’admis-
‘sion qui sont mieux refroidies,
A pleine charge, le métal des sou-
papes d'échappement est porté au
Touge sombre, et il ne faut pas oublier
que seul le sige de soupape permet
evacuation des calories verslaculasse
(lo refroidissement de la tige s'effec:
tuant par le guide de soupape).
Trop diminuer la masse de la téte de
soupape, c'est s'exposer & des risques
de grilage de calle-ci. Les soupapes &
tige creuse remplie de sodium (dont le
réle est d'activer la diffusion des calo-
ries de fa téte vers la tige) sont de ce
point de vue moins sensibles au gfil
age. On peut aussi élargir la portée
soupape-siége pour améligrer le trans-
fert de chaleur, mais dans ce cas
Fétanchéité devient plus difficile & réa:
liser. Mais nous aurons occasion de
revenir sur le travail des sieges.
Enfin il faudra tenir compte des
modifications de forme apportées aux
tétes de soupapes dans le calcul du
rapport volumétrique puisque le volume
de la chambre s'en trouvera affecté.
Le travail dallégement des sou:
papes est donc assez limité ; on n'en
‘oubliera pas moins, si ce n'est deja fait
sur les soupapes spéciales, de polir la
zone tulipée, toujours pour éviter tout
fisque de bris par concentration de
a
sdmission (3 gaucho) ot 'échappement (a droite)
contraintes aux amorces de rupture ;
écoulement du flux gazeux en sera
amélioré, et les dépots de calamine &
'échappement (poids en supplément)
retardés,
* Les coupelles de ressort
Liges aux soupapes par des cla-
vettes en demi-tune, les coupelies de
Tessort ajoutent aux masses alterna-
tives des soupapes.
Pratiquement, on ne peut les alléger
de fagon efficace... qu’en les réusinant
dans un autre matériau :le tane est
souvent usité (40 % de gain) mais on
rencontre aussi le « zicral » (ou équiva-
tent « fortal »), un alliage caluminium
‘dope de zinc et de magnésium (AZBGU)
parfois méme de tungsténe, dont les
‘caractérstiques mécaniques’ sont trés
levées (résistance & la traction 600
Njmm® minimum) ; dans ce cas, le gain
de poids obtenu par rapport & Vacier
atteint les 65 % (densité du «2
ral» : 2.8). Mais comme le ttane, cet
alliage nous vient de Vindustrie aéronau-
tique et son prix reste assez éleve:
Signalons que sur les moteurs F1,
depuis le début des années 90, les
soupapes et coupelles de ressort sont
en ttane. Les queues de soupape
regoivent un dépot de malybdéne (pro-
.céd6 plasma) tandis que les surfaces
dappui des ressorts subissent une
nitruration gazeuse.
* Les culbuteurs (ACL ou ACT)
et basculeurs (ACT):
A Ia différence du culbutour qi
articulé dans sa zone centrale, regoit
Faction de la came ou de la tige de
culbuteur a une de ses exirémités, le
basculeur, appelé aussi linguet, s'arti-
cule & l'une de ses extrémités sur un
pivot fixe (rotule) et subit action de la
came dans sa partie centrale, Vun
comme Vautre travaille la flexion avec
des contraintes maximales se situant
au niveau de laxe de rotation (culbu-
tour) ou au niveau de 'appul de la came
(oasculeur). Ces éléments, générale
‘ment réalisés en acier matric, compor-
© quale)
Fig. 34 Allégement d'un culbuteur ; fa nervure centrale (qui tai toute la rigidté on Hexion
‘du culbuteur) ne doit pas étre modilie en heuteur.
Vous avez ait cure damsigrissement ? Diticite de ttre mieux sur ces piéces préparées
Br itichel Gobert (Ets Pierre Ferry) pour un moteur de RS Turbo qul prendra 10.500 tin
A note, @ la base des poussoirs croux, le trou de percage incling permetianl évacualion
tent une nervure_médiane indispen-
sable & leur rigidté. Il faut impérative-
ment préserver collo-ci lors du travail
dallegement, méme si fon peut dimi-
‘Auer progressivement son épaisseur
comme le montre la figure 34. C'est
Surtout aux extrémités que Ton peut
fontablement dter de la matiére : amin-
Gissement du bec (cé1é soupape), du
Pourtour du trou taraudé (cété réglage
=)
iagas 3
Fee an rmtee a ces op
eee ented eee aa
‘solghent les conges de raccordement (valable
2 espaces entre cames, et les doubles ACT.
46
cube du diamdtre). Lors de lusinage,
pour limiter la aussi les concentrations
de contraintes, on veillera & pratiquer
des congés de raccordement (au niveau
des palers et cames), les plus larges
passibles (voir figure 38).
Du point de vue résistance méca-
nique, il serait moins nocif d'éter la
matigre la moins sollicitée, crest-a-dire
celle se trouvant au caeur. Cela s'est
deja fait, et Ton a vu des AC creux
percés dun bout & autre. Vu la
longueur de AC, on imagine la diffi
cute de operation.
* Lacommande de distribution :
Les organes qui assurent entraine-
mont de (ou des) larbre(s) & cames
consomment de I'énergie, Leur masse
Peut étre réduite, tout dépend du type
de transmission entre vilebrequin et
AC
— Par cascade de pignons :
Rare sur les moteurs de grande
diffusion, ce type de commande se
rencontre surtout sur les multcylindres
de forte cylindrée (V8, V12) ou sur
certains moteurs. sportifs (et anciens)
pour lesquels une transmission par
chaine ne pouvait satistaire a leurs
régimes élevés. En fait, c'est la trans-
mmission par courroie ctantée qui a peu
peu supplanté la transmission par
engrenages. L'alldgement de la pignon-
erie consiste essentiellement au
pergage de trous sur la périphérie du
voile de chaque rove dentée. Cotte
‘opération doit étre ettectuée avec préci-
sion au moyen d'un plateau diviseur
afin de ne pas déséquilibrer les roves,
cee qui engendrerait des vibrations dans
toute la pignannerie avec rupture pos:
sible de la denture,
— Par chaine :
Fiable, économique, robuste, ce type
de transmission est tres répandu. Géné-
ralement, les pignons comporient une
double denture ot la chaine deux
rangées de rouleaux. Si le pignon
diarbre & cames pout étre allégé par
percage comme précédemment, ci
tains préparateurs n’hésitent pas &
passer carrément & une transmission
Par chaine simple. Les pignons sont
alors soit changés, soit usinés on
conséquence (suppression dune den:
ture), La résistance d'une chaine simple
Plus de pastile, plus de jeu, plus
de réglage. Terminé Je jonglage des
clés, tournevis et jeu de cales. Co
ype de poussoir, comme son nom
Tindique, régle automatiquement le
Jeu de fonctionnement des sou-
apes par pression d'huile. Tout
beau dans le principe, pas si nou-
veau, le poussoir hydraulique ne
recueille pourtant pas les faveurs
des préparateurs. Rappelons son
fonctionnement. Tout se passe &
Fintérieur du poussoir. Ce dernier
‘contient un piston plongeur main-
tenu constamment en contact avec
la queue de soupape par un ressort.
Le piston, coulissant librement dans
le poussoir, forme avec ce dernier
une chambre d'huile dont !aceés se
fait par un clapet @ bille. Une
0,) permet aussi d'étendre la
surface d'encadrement surface hachurée) & intérieur de laquelle on deesinera un profil
‘Plus favorable, du point de vue aceélération. Un principe souvent mis en application dans
le retallage des cames d'origine (schéma du bas).
poussoir plan, rayon qui peut étre tres
faible pour un sommet de came
«pointu ». Pour information, la pres-
sion de Hertz au contact de deux pieces
statiques non lubriliées_se_calcule
‘comme suit rane
pmax = o,0a1¥ TT
(pmax en Nimm’) avec
26 €
- A mn’, E , et E,
ETE Niet, et
tant les modules d'élasticité longitudi-
ale des matériaux en contact (E =
210 000 Nimm’ pour racier ; = 100 000
Nimm? pour fa fonte) ;
RR.
= en mm, R, et R,
représentant les rayons de courbure
des piéces en contact (came-poussoit
ou came-patin de basculeur);
ns
— |: longueur du contact (largeur de
came), en mm ;
— Fmax ; effort au contact, en N.
Nota: dans le cas d'un contact
‘acier-acier entre came et poussoir plan
(‘ayon de courbure infin), nous avons
donc Eo = E (acier) et p = Re (rayon de
came), et la formule devient :
Fm:
E
pmax = 0,041
Notons bien que ce calcul est valable
cen « statique ». Dans le cas qui nous
intéresse, en dynamique et milieu lube,
il faut faire intervenir dautres para:
matres tels que vitesse de glissement
relative entre came et poussoir (ou
linguet), facteur défavorable, ainsi que
la qualité ‘de la lubrification et du
lubrifant, facteur favorable, Voict pour
fixer les idées, car de ce point de vue
les méthodes de calcul divergent.
Ajoutons encore que la. pression
peut s'avérer ctitique a deux niveaux
‘au point de levée maxi (Re faible
Sur les moteurs de course, les
_aceélérations maxi de soupape atte
4grent souvent des valeurs comple-
tement folles. A 10000 trim, les
soupapes du 8 cylindres a plat
Porsche de 1 500 cm” (1963) subis-
saient des décélérations de 11 500
mis’ alla lave, de 4 500 m/s’ & leur
Termature. Avec une masse en mou-
vement liée a la soupape de 135 9,
les ressorts devaient affronter des
forces dinertie proches de 160
«kilos ». La raideur des rassorts
avoisinait les 10 « kilos »/mm, et on
Jimagine aujourd'hui importance des
frictions au niveau des arbres 4
cames,
Ces fortes accélérations provien-
nent du fait que, sur les moteurs de
course destinés & la puissance pure
4 haut régime, on recherche des lois
de levée de soupape optimisant les
sections de passage. Non seule.
‘ment fa levée est importante (sou-
vent supérieure & 10 mm) mais la
ACCELERATIONS DE SOUPAPE ET COMMANDE DESMODROMIQUE,
soupape s‘ouretrés rapidement et trés
161, sa vitesse augmente donc tes vite;
pour lanéter & la levée maxi, la
Sécélération n’en est que plus forte.
Dans ces conditions sévéres, la
‘commande desmodromique, restée long
temps marginale avant d'étre apparem-
‘ment complatement oublide, a souvent
fait ses preuves drefficacité ot de
Viabilté. Son principe est, ce n'est plus
tun secret pour personne, d'éviter tout
atfolement de la distribution par sup-
pression des ressorts, lo rappel des
‘soupapes s‘effeciuant mécaniquement
‘par un second systame came-culbuteur
(voir schéma).
Installé sur le 8 cylindres Porsche
cité plus haut, ce type de commande
permit, avec les mémes soupapes
daceroitre de 15 % la surface de
diagramme, et ce grace & un profil de
‘came encore plus brutal et une levée
augmentée (11 mm au lieu de
10,55). Les décéiérations atteignaient
alors 15 200 m/s a la levée (9 000
la fermeture). Sans risque daifole-
‘ment bien sr. A.ce jour, le maximum
‘en matiére daccélération de sou-
pape semble avoir été atteint dans
los années 54-55, sur le fameux 8
oylindres Mercedes de FI, avec
17 000 m/s’. Co moteur était égale-
‘ment pourva d'une commande des-
‘modromique.
‘Aujourd'hui, la multiplication des
soupapes, (a meilleure maiirise des
Vitesses de gaz, conduisent & des
lois de levée unitaires (par soupape)
beaucoup plus « raisonnables », et
done & des accélérations et inerties
(masses unitaires réduites) modé-
60s. Ce que les ressorts tradition:
nels bien plus facies & installer
quiune tres complexe commande
desmodromique (lourde pour les
AC et sensible aux jeux de fin de
course) sont 4 méme de combattre
aisément,
puisque correspondant au sommet de
came), au point d'accéléralion maxi:
male de la soupape (charge Fmax tres
importante due a tinertie de la sou:
pape, mais rayon de courbure élevé
one favorable),
Si la. pression calculée venait &
dépasser la pression limite de matago
de Tun des matériaux (bien souvent on
majore cette pression par la limite
élastique dudit matériau), ot ce malgrs
un traitement de surface approprié
{nitruration ionique par exemple), il y
aura écrasement et écrouissage loca
lisé, puis. écaillage par fatigue des
surfaces. II faut alors, dans ces cas,
extrémes, revenir en arriére et recon:
sidérer le diagramme de levé
Dans notre exemple, nous avons
considéré pour nos deux profis des
tangles Cowertures identques. Lafigure
‘37 montre en encadré que l'augmenta-
tion de cette durée d'ouverture (angle
0) pormet do bénétieer, su" le pian
géometrque, d'une surface ¢'encadre
ment du profil de came plus étendue,
ce qui autorse plus de « iertés »
‘quant 8 la détintion de co. prot: i
deviant plus facile alors d'étabir des
rappors nite accéleations maxi el
écsleration & pleine ouverture plus
favorabies. Comme nous pouvons Ie
Constator, la datermination un profil
de came exige de prendre en compte
un grand nombre de paramétres qui
rebuteront fort logiquement l'amateur.
Dans ce domaine réservé aux spécia-
listes, si expérience joue encore un
rile certain, ordinateur. est devenu
depuis quelques années, méme chez
les préparateurs (surtout ceux qui ont
‘pignon sur rue »), un outil puissant
et terriblement efficace. Nous aurons
occasion d'en reparler dans l'étude
détalliée des diagrammes de distribu
tion, nous ne faisons qu'évoquer ici les
problémes liés au mécanisme de fer-
‘meture des soupapes. Disons simple-
ment quil existe des logiciels tres
performants qui déterminent, & partir
par exemple d'une levée maxi et d'un
temps ouverture donnés, plusieurs
lois de lavée possibles avec les dia~
grammes do vitesse ot diaccélération
correspondants, et calculent pour
chaque position angulaire de la came,
force d'inertie fléche de ressort, pres
sion de Hertz, etc... ls caiculent meme
les caractéristiques du ou des ressorts
de soupapes & utiliser suivant la loi de
levée choisia,
3.2. Les ressorts
de soupapes :
La déterminaton dun ressort de
sovpape exige de connate parate
ment les masses en mouvement (soU-
pape, coupele, cubteur, ete.) ainsi
~2
que la décélération maximale de la
soupape & la levée maxi.
A partir de cos données, on pout
alors déterminer etfort de rappel
maximal du ressort comme sut:
Fmax = Fixs, avec :
— Fi: force diinortio, dont le calcul
dépend du mode’ de distribution
(vor igure 38), Fi peut se metre
sous la forme suivante
Fi= mr xy, avec
Fien Newton (N), & diviser par 9,81
pour Favoir en « kilos »,
mmr : masse totale en kg,
"3 décélération soupape en mis"
$: confficient de sécurité (1,2 en
moyenne} majorant Fmax pour tenir
compte des incertitudes de mesures
éventulles, mais aussi des surré-
gimes possibies |
‘Appartir de Fmax on peut caleuler la
raldeur nécessaire des ressors.
* Laraideur des resorts,
Larraideur, exprimée en Newtor’nm
‘ou plus couramment en « kilos »/mm
SCobtient en faisant le rapport de la force
appliquée au cessor sur la valeur
décrasement (fdche) obtenue, La rai-
dour étant une caractérstique constant
du ressort, on peut donc la calculer en
divisant la valeur de effort de rappel
‘Hauteur libre
F(N)
kif
x
Fig 39:
Lit force de rappel dun ressort de soupepe varie linéelrement avec Ia valeur de son
écrasement (leche X): Ia earactéristique F fonction de X est done représentee par une
(uw) 9yoxe ewi6p1 €4 enbiowweH| ee'sL9y
(ww) 9119x0 ewii691 24. anbiuousser4| 00°0008
(awa) oox0 eui69: [| enbiuowsel| ps'bars
(uwia) e11ox8 euiiBe: Of anbiuowret4| 00'0009
(uw) ouox0 owi6e1 § enb\uowreH| 99'9999
{awin) suoxe owiBes 8 enbiuowuer|oo'o0s2
~ (uwia) exfoxe owiB9i 2 enbiuowseH | ey'iz58
“ (uw) eyoxe ewiBe1 9 enbiuowseH{| o0'00001
ses (uwia)
(ZH) erdoid souenbey; aiquesg
“{aiw) (ueisuos) uosses np seq
Soyow seuids op e:quioN,
sa]qn sauids ap aiqWON
ee Se faith eepras
(ww) 2ene7
eee * (wus) euuefow eBse49)
: + (uuu) aueano edednos 06:e45|
(ww) agua; adednos aB:e4D
: + (wu) eed ue anenBu0y] o8'ze
+ + “(tutu) e9ne) suleid-e sosids oxtue ner} 19's
(its) 9019 ¥ anenBue4 | 6e'ez
(wu) iy np eneweig| ory
+ sneupiut enleuseig| oo'zz
(wu) ineuipixe eneweig|oz-oe
uossiog ep ainpoy
(va) Bunda ap ainpow,
(uuu) uosses np ea) nenBuc7,
(usw) 80810 Ue esis ep e491
{sowuwiei6) yossa1 np ossoy
.WAu/NeG) BANBULOYE ajUIENUOD
(ww/Neg) 2014 ® aiuleu0D,
{,uuweq) euanno edednos auremuoy
1u/NBG) 89W10) edednos aureAueD
(uw) ey9*2 ewi691 $1 enbiuoweH
+ (usa) ay9x9 auui69: y1 enbruoweH
* (un) aijoxe euibe: 1 enbluoWweH,
(uw) guoxe ewi6es 21 enbiuowseH
+ (uw) 9uoxe ewi6e: 1 enbjuoWeH,
* (uuia) euoxe ewi691 04 enbluowseH
(uw) ausxe ewi6e: 6 anbiuowsey
(uw) auoxe ewi6a: g enbiuowseH
(uw) el1sxe ewiBa: enbiuoweH
* (ua) 9uoxe suii691.9 enbluowieH,
~* (uuin)
(ZH) aidoid souenbey erquieid
(duu) (ueisuo9) uossei np seq
sow seuids ep eQWON,
sojgn seuids op oxqWoN,
sett: (ww) sneprey
- nar
(ww) euuesow o5i249
(uuu) eyeano edednos e61e45
* (ww) e9uu9; edednos 961845
s+ 2+ +++ (wu) soejd ue snenBu0y
(ww) e9ne] suisid @ sauds enue ner
"= = (wu!) 201@ ¥ snen6uo7
* (ww) Iy np eneuerg,
2 aneugiu! enguieig
Fig 42.
_Déterminetion par calcul sur ordinateur, des caractéristiques d'un ressort de soupape, avec verification des régimes critiques de résonance
(Préparation Sodemo}.
—7-
loir réduire les frottements, sous-
entendu la puissance perdue par frotte-
ment, n'est pas chose aisée puisque
es pertes sont proportionnelies & la
fois aux charges transmises entre pi6oas
(qui seront plus fortes) et a la vitesse
de déplacement de celles-ci, donc du
régime moteur... régime que fon désire
précisément augmenter. Pas simple.
Mais rappelons quelques principes
de base sur le frottement.
Prenons une piéce 1 glissant sur une
pléce 2 fixe (voir schéma figure 43).
Ge peut étre par exemple un segment
de piston (1) coulissant dans. son
coylindre (2),
Fig. 43:
Pulssance perdue par trottement ontre deux
pléces en appui (orce F,glissant avec une
Vitesse relative V:P =F, =V=Fx > V.
Ces 2 piéces sont appuyées une
‘sur Tautre avec un effort F perpendicu-
laire & la surface de contact ; cet effort
F peut correspondre
— A la tension du segment, pour
reprendre notre exemple,
— mais aussi. effort latérai qu’exerce
le piston sur le cylindre a cause de
Fobliquité de la bielle (revoir le
chapitre concernant raugmentation
de la course),
— ou encore a la poussée de la bielle
sure maneton,
— ete...
ila pidce 1 se déplace & une vitesse
\V par rapport a la pice 2, la puissance
perdu par frottement s‘exprime ainsi
PaFiXV
oUF représente la force de frottement
naissant au contact et qui s‘oppose au
‘déplacement de 1
Cette force F; résulte en fait du
[produit de la force de pression F par le
Cconficient de frottement fexistant entre
les 2 piéces en contact:
Frater
dou: P=fxFXV
Lexpérience montre que le coefi-
cent f varie avec
— la nature des matériaux on contact,
(acier, fonte, bronze...),
— la qualité d'usinage de leurs états
de surface (f augmentant avec la
rugosité),
— le type de frottement : sec oulubrifié
(la qualité de la lubrification faisant
chuterf),
— la vitesse de glissement relative V
dans le cas d'un contact lubrifié.
On le voit, bien des critéres entrent
en ligne de ‘compte, et seule lex
‘ience permet de comprendre ce phé-
rnoméne complexe et d évoluer.
En ce qui nous concerme, on ne
pourra «limiter» la puissance perdue
ar frottement qu'on tentant de réduire
ce fameux coefficient f, puisque F et V
irontlogiquement en augmentant.
On remarquera que létendue des
surfaces de ‘contact nintervient pas
dans le calcu de ces pertes, Laite de
contact est quant elle directement lise
@ la pression de contact (p), cette
emigre conditionnant Tusure.. Nous
avons en effet :
Fpxs
ce qui signifie que diminuer S pour un
effort presseur donné F revient &
augmenter la pression de contact entre
les piéces. La puissance consommée
par les fictions reste théoriquement la
méme (Finchange), mais fusure acoé-
tere.
‘Toutefois, en milieu lubrifié, la modi
cation de la surface de contact peut
enirainer une variation du ccefcientf
une pression de contact élevée rend
plus dificil la formation du film aul,
elle tend done & augmenter
‘exemple des segments frottant dans
Jour cylindre ilustre parfaitement ce
propos. L'stanchéité de la segmenta-
tion dépend, outre de la qualité dusi-
nage des surfaces entrant en jeu, de
la pression de contact qu'exercent les
segments sur les parois du oylindre
Gette pression résute de a tension (F)
du segment rappartée & sa surface de
contact propre. Si fon diminue cette
surface par reduction dela « hauteur »
du segment (mesurée suivant faxe du
oylindre, T'« épaisseur » dun segment
correspondant ala différence entre ses
rayons extériour et intéieur..), fa pres-
sion deviont plus forte, ce qui ameliore
Tétanchéit... sans pour autant éduire
les frictions. Aussi ce que proposent
de plus en plus, les fabricants de
segments, ce sont des segments minces
@ tension réduite. Mais ces réductions
Daralléles de tension et de hauteur sont
elles definies conjointement afin
assurer une pression de contact seq-
meni/paroi identique, gage d'une étan-
chéité toujours satsfaisante, Malgré
Une formation du film dihuile rendue
plus dificil, de nombreux essais ont
— se —
prouvé que ces segments minces
« consommaient » moins 'énergie (voir
fig. 44). C'est une des raisons pour
lesquelles sur les moteurs préparés on
utilise désormais des segments és
étroits: 1 mm devient une hauteur
ccourante pour le premier segment de
compression; on rencontre méme
‘moins : Jusqu’ 0,7 mm sur les moteurs
F1. La hauteur des levres des seg-
ments racleurs s'est aussi considéra-
blement réduite.
200}
z
Es
g 50.16 NS man?
é Pane cay
109} —__ Teme cae ee
ods vo as a0 as
auteur de sepment gn)
Fig. a8:
Influence de la hauteur du segment de
‘compression sur la puissance perdue par
{rottement, pour une pression de surface
Cconstante: avec la diminution de la hauteur
‘du segment, Jusqu’a 0,4 mm, le trottement
‘se réduit pour augmenter ensuite ; cela
provient du fet que jusqu’é environ’ mm
{e hauteur, c'est la diminution dela surface
de contact qui est prépondérante, alors
(qu'onsuite ost laréduction de I'épaisseur
du film hue qui prend de plus en plus
Sinuence.
Les segments minces apportent un
‘autre avantage -les pistons, aux gorges
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- 2011 TC449Document106 pages2011 TC449Loic TrocmeNo ratings yet
- Manuel de Réparation RC390 2015Document251 pagesManuel de Réparation RC390 2015Loic TrocmeNo ratings yet
- KX450F 4Document118 pagesKX450F 4Loic TrocmeNo ratings yet
- 11 Kx450e 0525Document18 pages11 Kx450e 0525Loic TrocmeNo ratings yet
- 2005 Rear Shock Repair ManualDocument25 pages2005 Rear Shock Repair ManualLoic TrocmeNo ratings yet
- 2011 Te 449-511Document115 pages2011 Te 449-511Loic TrocmeNo ratings yet
- 2009 Montesa Parts ListDocument103 pages2009 Montesa Parts ListLoic TrocmeNo ratings yet
- MY11 Range ENDocument11 pagesMY11 Range ENLoic TrocmeNo ratings yet
- 2012 Technischedaten FR 03Document1 page2012 Technischedaten FR 03Loic TrocmeNo ratings yet
- Install Manual REV3.3 EngDocument12 pagesInstall Manual REV3.3 EngLoic TrocmeNo ratings yet
- Manual eDocument23 pagesManual eLoic TrocmeNo ratings yet
- GP1 EVO PROGRAMMING Procedures Rev3.3 - EngDocument17 pagesGP1 EVO PROGRAMMING Procedures Rev3.3 - EngLoic TrocmeNo ratings yet
- Maya User Manual REV3.3 EngDocument41 pagesMaya User Manual REV3.3 EngLoic TrocmeNo ratings yet
- Gasgas TXT 2012 Es4Document10 pagesGasgas TXT 2012 Es4Loic TrocmeNo ratings yet
- Manuale Utente Software Maya REV3.3 - ItaDocument41 pagesManuale Utente Software Maya REV3.3 - ItaLoic TrocmeNo ratings yet
- Dorsoduro 750 ABS F-E 2008Document175 pagesDorsoduro 750 ABS F-E 2008Loic TrocmeNo ratings yet
- GP1 EVO Procedure Di PROGRAMMAZIONE Rev3.3 - ItaDocument17 pagesGP1 EVO Procedure Di PROGRAMMAZIONE Rev3.3 - ItaLoic TrocmeNo ratings yet
- Husquarna TC250 2012Document1 pageHusquarna TC250 2012Loic TrocmeNo ratings yet
- GP1 Evo TechDocument5 pagesGP1 Evo TechLoic TrocmeNo ratings yet
- Husquarna TC250 11 OEM Vs Husquarna TC250 11 GET GP1-EVODocument1 pageHusquarna TC250 11 OEM Vs Husquarna TC250 11 GET GP1-EVOLoic TrocmeNo ratings yet
- La Preparation Des Moteurs Etai - 161 - A - 208Document48 pagesLa Preparation Des Moteurs Etai - 161 - A - 208Loic TrocmeNo ratings yet
- SXV RXV DepDocument2 pagesSXV RXV DepLoic TrocmeNo ratings yet
- La Preparation Des Moteurs Etai - 121 - A - 160Document40 pagesLa Preparation Des Moteurs Etai - 121 - A - 160Loic TrocmeNo ratings yet
- SAP16N: Absolute Maximum Ratings Electrical CharacteristicsDocument1 pageSAP16N: Absolute Maximum Ratings Electrical CharacteristicsLoic TrocmeNo ratings yet
- It SXV450 550Document1 pageIt SXV450 550Loic TrocmeNo ratings yet
- Service Manual: Little Mark Iii Combo Head IiDocument10 pagesService Manual: Little Mark Iii Combo Head IiLoic TrocmeNo ratings yet
- Study On The Characteristics of A High Capacity NiDocument20 pagesStudy On The Characteristics of A High Capacity NiLoic TrocmeNo ratings yet
- Elka TX20 (Hohner Kingstar 20)Document1 pageElka TX20 (Hohner Kingstar 20)Loic TrocmeNo ratings yet