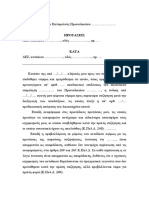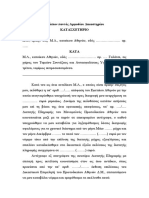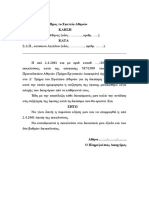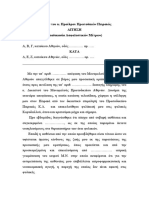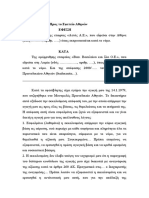Professional Documents
Culture Documents
(Le Sens Commun) Alexandre Matheron - Individu Et Communaute Chez Spinoza-Les Editions de Minuit (1988) PDF
(Le Sens Commun) Alexandre Matheron - Individu Et Communaute Chez Spinoza-Les Editions de Minuit (1988) PDF
Uploaded by
codrin_90_ro0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views329 pagesOriginal Title
(Le sens commun) Alexandre Matheron - Individu et communaute chez Spinoza-Les Editions de Minuit (1988).pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views329 pages(Le Sens Commun) Alexandre Matheron - Individu Et Communaute Chez Spinoza-Les Editions de Minuit (1988) PDF
(Le Sens Commun) Alexandre Matheron - Individu Et Communaute Chez Spinoza-Les Editions de Minuit (1988) PDF
Uploaded by
codrin_90_roCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 329
alexandre matheron
individu
et communauté
ouvrages d'slexandre matheron chez spinoza-
{Le Christ et le salut des ignorant chez Spinoza, Auber Montaigne, NOUVELLE EDITION
coll. Analyse et raison, 1971,
Anthropologie et politique au 17 sidcle. (Etudes sur Spinoza), Vrin-
reprise, 1986.
8/3799/F 3/ Mae
Fon
LES EDITIONS DE MINUIT
PREMIERE PARTIE : pe tA SUBSTANCE A L’INDIVI-
DUALITE HUMAINE : CONATUS ET DROIT NATURE.
cusprrre PREMIER : De la substance 4 Vindividualité
en général ..... oo
cuaprrne u: La séparation : individualité élémen-
taire et univers concurrentiel .... 7
cuaPrrre ut: L'unification externe : individualité
complexe et univers organisé ......
cuaprrne tv : Vers unification interne : individua-
lité consciente et univers intériorisé
SECONDE PARTIE : 1a SEPARATION : INDIVIDUALITIE
ALIGNEE ET ETAT DE NATURE ..00-0eeeeeeeeee
cnxprone v: Fondements et déploiement de la vie
passionnelle ....
. I. —Fondements de la vie _passionnelle
4 individuelle (groupe A) .-
© Les données du probléme .....
© Genése de alignation < mondaine >:
désiz, joie et tristesse, amour et haine.
i © Genése de Valiénation idéologique : Ia
eroyance aux ¢ rectores naturae >
4 I, — Déploiement de Ia vie passionnelle indi
viduelle (groupe A.) +--+
25
37
19
aL
83
90
302
113,
643,
SPINOZA
© La dérivation par transfert : les six lois
de Vassociation; Dieu et Pargent; asso-
ciation par contiguité fortuile et toute-
puissance du conditionnement; associa
tion par ressemblance et genése de la
< métaphysique » traditionndle ......
© La dérivation par transfert (suite) : le
cycle de lespoir et de la crain a
et avatars de la superstition ....
© La dérivation par identification .
IIL. — Fondements de Ia vie passionnelle inter-
humaine (groupe B,) me
© Relations interhumaines directes : im
tation affective et émulation ; pitié et
auméne; ambition de gloire comme fon-
dement ‘de Ia sociabilité; de lambition
de gloire & Yambition de domination;
envie et propriété foncitre ......
© Relation homme-Diew < =
© Relations intethumaines médiatisées par
Ja divinité anthropomorphe : charité et
fanatisme ...... ae
© Conclusion : amour et baine interhu-
mains; sociabilité et insociabiite .
IV. — Déploiement de 1a vie passionnslle inter-
humaine (groupe B) 2.2.0...
© La dérivation par exigence de récipro-
cité : la jalousie et les contradictions de
de Vallégeance 60.0... ceeeeeeee
© La dérivation par réciprocité des exi-
genees : guerre et commerce
© Les dérivations du groupe Ay .-.
© Conclusion des groupes A,, Ay B, et By
Vauto-régulation passionnelle ...
V. — Retentissement de Yadmiration sur la
vie passionnelle (groupes A’, By, AY, et
By ude a
Conclusion : état de nature et monde médiéyal,
644,
1s
126
43
150
151
179
184
189
aun
221
TABLE DES MATIERES
CHAPETRE ve: L'imputssanee relative de la raison
© La connaissance vraie du bien et du
= earns Baines
© Raison et passions (groupes C, D, E, F
2G) cee : :
© Le probleme .....
cuaprmne vit : Fondements de Ia vie raisonnable
I, — Fondements de Ia vie raisonnable indi-
viduelle (groupe Ay) ...0...e.eceeeeee
© Leégoisme biologique ..............
© Lutilitarisme rationnel
intellectualisme
Il, — Fondements de la vie raisonnable inter-
humaine (groupe B,) 3
© Lgo-altruisme biologique
© Llutilitarisme rationnel
© Lintelleetualisme ...... ps
Conclusion : nécessité de la médiation politique.
‘TROISIEME PARTIE : i'uNICATION EXTERNE :
SOCIETE POLITIQUE ET ALIENATION DIRIGEE ...,
CHAPITRE vit; De l'état de nature & 1a société poli-
tique . waeweaie ares
© Précisions sur Je droit naturel
© Précisions sur V’état de nature ...
© Le contrat social . d
© Structure de Etat en général...
a separation: société politique aliénée
ridualité déchirée ... "
1. — L'Histoire, ou les passions du corps social
© La Démocratie primitive .
© L’Aristocratie aseendante
© WAristocratie déclinante .......
@ La Monarchie
© Variantes .
223,
223
229
238
241
243,
243,
247
250
258
259
266
274
278
285
287
290
300
307
330
SPINOZA
II. — Impuissance de la collectivits ...
MUL. — Fondements de equi collectif
® Les principes ....
© Regimes politiques et passions.
© La problématique politique ..........
cuarrme x : L'unification purement externe
impasse théoeratique et barbarie bien orga-
nisée 5‘ 7
cuaerene x1 : Vers uni interne ; Etat libéral
et individualité eivilisée .......
I. ~ Réalisation de Péquilibre collectit + ta
Monarchie libérale
Il — Puissance de 1a collectivité : ST sistoor
tie centralisée 3
UL — De YaAristoc
ie tédérale & ln Démo-
cratie : vers Etat parfait ........
Conclusion ; Etat libéral et Raison .
QUATRIEME PARTIE
INDIVIDUALITE
SAGES eee ee,
LIUNIFICATION INTERNE. :
IEREE BY CONMUNAUTE DES.
‘cuarrmne x11; Déploiement de Ia vie raisonnable ..
L. — Déploiement de ta vie raisonnable indi-
viduelle (groupe A)... eee.
11. — Déploiement de la vie rs
humaine (groupe B,) .
cuaptrne xi: Puissance de la
© La réduetion des passions (groupe C) .
© Promiére étape (groupes F, D et E) .
© Seconde étape (groupe G) .......
cuar
tw, t0v 5 Fendoments ct déploioment deta
vie élernelle fine
1. — Fondement de Ia vie éternelle individuelle
(groupe A.) ps8 aa
618,
424
407
497
434
136
467
480
494
505
515
517
ory
581
343,
BAT
563
564
871
583,
CEE
TABLE DES MATIERES
I, — Fondement de Ia vie éternelle inter-
humaine (groupe B)) .......
TL. — Déploiement de la vie éternelle indivi-
duelle (groupe A,)
IV. — Déploiement de la vie étemnelle inter-
humaine (groupe B,) . a
Conelusion
ANNEXE, a earray ih
© Figure 1. — Structure du Livre U1 de
YEthique . Hraanst
© Figure 2. — Structure des 18 premiéres
propositions “du Livre IV ef des, 30
premiéres propositions du Livre V de
PEthique _
© Figure 3. — Structure des propositions
18-78 du Livre IV de VEthigue ..
© Figures 4, 4 bis et 4 ter. — Structure de
YEtat spinoziste :
© Figure 5. — Structure des propositions
14-42 du Livre V de VEthique ..
Note bibliographique
Index .
Table des matiéres
591
602
622,
629
eu
617
© 1988 by Les Eorrtons De Misurr
17, rue Bernard-Palissy — 15006 Paris
ISBN 2-7073-0391-7
Avertissement (1987)
Nous n’avons rien changé A notre texte de 1969 :ils’agit d’une
réimpression, non d’une nouvelle édition. Peut-tre est-ce la de la
présomption, mais ce livre, ale rere dix-huit ans aprés, nous sem-
ble, quant & l’essentiel de son contenu, avoir été plutdt confirmé
u’infirmé par les recherches ultérieures. Les améliorations qu'il
conviendrait de lui apporter consisteraient done, plutét qu’en des
corrections proprement dites, en des analyses complémentaires qui,
intégrées au texte lui-méme, en doubleraient presque la longuewr.
‘Nous avons déja donné ailleurs certaines d’entre elles, fragmentai-
rement, sous forme d’articles et de communications diverses ; si
tout va bien, il devrait en sortir un jour un autre livre'. Contentons-
nous ici d'en indiquer briévement les grandes lignes.
C'est évidemment la premiére partie qui aurait le plus besoin
d’étre précisée et développée : nous avions concue, en fait, comme
une sorte d’introduction, Son sujet étant le méme que celui des deux
volumes du Spinoza de Martial Gueroult, la comparaison est écra-
sante, Comme nous 'indiquons au paragraphe IMI de notre Note
bibliographique, nous n’avions pu, & l’époque, avoir connaissance
de cet ouvrage ; mais M. Gueroult, avant sa publication, nous en
avait beaucoup parlé dans les quelques entretiens qu'il avait bien
voulu nous accorder. Pour commencer & tenir fa promesse donnée
dans ce méme paragraphe, disons simplement que ce que nous
devons & Gueroult, ce sont avant tout — mais IA est I’essentiel —
des exigences méthodologiques : nous avons tenté de les mettre en
‘euvre avec plus ou moins de bonheur, mais elles n’ont jamais cessé
de nous inspirer ; en un sens, tout ce que notre livre peut avoir de
ppositif en est le fruit. Quant aux applications particuliéres, en revan-
" En attendant, onze de ces articles ont été rassemblés tels quels dans
notre livre Anthropologie et Politique au 17¢sidcle (Etudes sur Spinoza),
Vrinteprise, Paris 1986,
SPINOZA
che, sauf pour ce qui concerne ta distinction capitale entre « lidée
‘que nous sommes » et « les idées que nous avons » — que nous
toyons avoir correctement utilisée au chapitre IV —, I’influence
de Gueroult n'est malheureusement guére perceptible dans le con:
tenu méme de nos quatre premiers chapitres. Mais, d’une certaine
fason, & quelque chose malheur est bon : trop de lumigre, et trop
Vite, et risqué de nous aveugler.
‘Auchapitre I, par exemple, on pourrait s’étonner de ne pas trou-
ver la moindre trace de la conception gueroultienne des « substan-
ces & un attribut » et de leur rdle dans la construction génétique
du concept de Dieu. Gueroult avait pourtant bien di nous en par-
ler, mais, apparemment, nous n’en evions rien enregistré. De fait,
ilnous a fallu un certain temps pour ’assimiler par la suite, et plus
de temps encore pour vraiment la « sursumer ». Or, si nous en
avions retenu quelque chose sur le moment, nous aur
blement 6 amené & renoncer & notre propre interprétation —
esquissée dés les premidres pages — des rapports entre la substance,
ses modes et ses attributs. Et nous avrions eu tort. Car cette inter
prétation, aujourd'hui encore et toute réflexion faite, nous semble
‘exacte. Elle est, avouons-e, trésinsuffisamment justifige en ce cha
pitre I : nous l’appuyons uniquement sur des textes du Traite de
la Réforme de 'Enterdement, ce qui ct assez paradoxal, Mais nous
Pensons maintenant étre en mesure de la fonder dans 'Ethique elle-
‘méme : il suffit pour cela d’aller jusqu’an bout de ce qu'impliquent,
dans le livre I, les axiomes informels sur lesquels reposent les deux
scolies de la proposition 8, la proposition 9 prise d la lettre, et les
deux derniéres démonstrations de la proposition 11 avee son sco-
lie. De cette fagon, comme nous lavioas pressenti, la proposition 16
devient quasiment intuitive, alors que Gueroult y voyait tout un
monde de difficultés. Ce qui ne coniredit en tien, mais renforce
‘méme, sinon la lettre de Pinterprétation gueroultienne, du moins
ce qui nous parait en étre l'apport principal. Nous nous explique-
ons plus longuement sur ce point un jour ou l'autre",
_En ce méme chapitre 1, ainsi qu'au chapitre 1, ce que nous avons
dit des modes infinis immeédiats et médiats nous parait aujourd'hui
un peu flou. On y remarque bien, lors de notre bref commentaire
de la proposition 28 du livre I, une lézére trace de l'interprétation
* Nous avons commencé & nous en expliguer dans une communication
‘encore inédite : Essence, existence et puissance dans le livre Ide I'Etht-
‘que : les fondements de la proposition 16 (& paraitre dans les Actes diy
colloque Spinoza de Jérusalem de 1987).
1
AVERTISSEMENT
de Gueroult ; mais les autres passages consacrés au méme sujet,
sans entrer en contradiction formelle avec elle, ne s"y rattachent
pas nettement. Nous adhérons maintenant, sur ce point, au prin-
cipe directeur de cette interprétation, méme si nous lui donnons
des développements que Gueroult n'edt peut-tre pas acceptés?,
‘Au chapitre Il, et surtout au chapitre III, le modéle que nous
proposons pour ia théorie spinoviste de Iindividualité physique
(odile emprunté a la problématique du choe des corps cf. notre
« formule F ») est assez différent de celui que propose Gueroult
(pendule de Huyghens). Cette différence — qui, si nous Pavions
cenregistrée sur le moment, eft produit, elle aussi, un effet pure-
‘ment dissuasif — nous semble aujourd'hui instructive. Le modéle
de Gueroultdécrttrés évidemment un type possible, parm autres,
individu au sens spinoziste ; mais le ndtre aussi, croyons-nous ;
tls nous paraissent& présent, P'un comme autre, trop précis pour
rendre compte de l'individualité en généraf telle que la congoit Spi-
noza, Plus exactement, il nous semble que le nbtre correspond a
ppeu prés & ce que pensait Spinoza Iui-méme lorsqu’il écrivait le
Court Traité :ils'agissait bien, alors, d’un rapport au sens mathé-
‘matique (« par exemple | & 3 ») entre le mouvement et le tepos.
Mais dans 'Ethique, il n'est plus question que dune relation expri-
‘able en termes de mouvement et de repos — ce qui, dans V’Eten-
Cf. Anthropologie et Politique.... pp. 716.
+ Des compléments leur sont apportés tout au long d’ Anthropologie et
Politique.
int
SPINOZA
toutefois une lacune un peu génante au chapitre VIII : nous main-
tenons intégralement ce que nous y avons dit de I’évolution de Spi-
noza entre le T.T.P. et le T-P. (est cela, curieusement, qui a le
plus scandalisé), mais nous n’étions pas 4 mém:
rendre vraiment compte des raisons decette évolution ; aprés beau-
coup d’hésitations, nous pensons maintenant les avoir & peu prés
‘comprises, mais nous ny sommes pas arrivé seul’. Dissipons aussi
un malentendu persistant : ce que nous avons dit de I« arbre sé
rotique » concerne uniquement (outre la structure de I’Etat spino-
iste) la disposition matérielle des propositions des trois derniers
livres de I’Ethique, non leur contenu : nous n’avons pas voulu faire
de Spinoza un kabbaliste ; pour prendre un exemple analogue, dire
que les dissertations de nos étudiants ont une structure trinitaire
ne signifie pas que leurs auteurs croient eux-mémes la Trinité,
bien que la Trinité soit effectivement & Vorigine de cette structure.
‘Mentionnons également, pour permettre de mesurer la part de sub-
jectivité qui entrait peut-étre dans ceriaines de nos extrapolations
(transformation de I’Aristocratie fédérale en Démocratie au cha-
pitre XI, achévement de la connaissance du 3° genre au chapi-
tre XIV), ce que nous disait il ya cing ans un de nos amis : « Ton
Spinoza de 1969 était plus optimiste que ton Spinoza de 1982 ».
Peut-étre ’« air du temps » le voulait-il, mais cela ne signifie pas
nécessairement que nous ayons eu tort en 1969 |
En ce qui concerne notre Note bibliographique, il n'y a rien &
changer aux paragraphes I et II, puisque ce dernier mentionnait
‘uniquement les ouvrages cités par nous dans notre livre. Nous nous
sommes expliqué plus haut sur fe parsgraphe III. Pour compléter
le paragraphe IV, signalons qu’il existe aujourd’hui deux grandes
bibliographies générales consacrées & Spinoza : celle de Jean Pré-
posiet (Bibliographie spinoziste, Annales Littéraires de "Univer
ité de Besancon, Les Belles Lettres, Paris 1973) et, lui faisant suite,
celle de Theo van der Werf, Heine Siebrand et Coen Westerveen
(A, Sipnoza Bibliography 1971-1983, Mededelingen vanwege het
Sipnozahuis 46, Leiden, Brill, 1984). Signalons aussi que, depuis
1979, la revue Archives de Philosophie publie chaque année, dans
son cahier n° 4 doctobre-décembre, un Bulletin de Bibliographie
spinoziste.
* Nous avons commencé a nous expliquer sur ce point, tout en répon-
dant aux objections qui nous avaient 6 adressées, dans une communica-
tion encore inédite : Le probleme de ’évolution de Spinoza du T.T.P. au
TP. (A paraitze dans les Actes du colloque Spinoza de Chicago de 1986).
Vv
|AVERTISSEMENT
Enfin, compte tenu du mépris écrasant avec lequel ce livre fut
accueilli par la majorité de nos collégues universitaires francais,
nous voudrions ici exprimer notre gratitude & tous ceux qui, d'une
fagon ou dune autre, osérent aller a contre-courant : qu’ils aient
simplement consenti a discuter avec nous sur un pied d°égalité, qu’ils
aient reconnu — parfois méme publiquement — notre apport sur
tel ou tel point a la connaissance du spinozisme, qu’ils aient utilisé
intelligemment nos résultats dans des travaux originaux et impor-
tants, tous nous ont donné, & des degrés divers, impression récon-
fortante d’avoir au moins servi A quelque chose.
premiere partie
de la substance
a Vindividualité humaine:
«conatus» et droit naturel
chapitre 1
de la substance a Vindividualité en général
« Chaque chose, selon sa puissance d’étre (quantum in
se est), s‘efforce de persévérer dans son étre '. » Tel
est Munique point de départ de toute Ia théorie des pas-
sions, de toute la Politique et de toute la Morale de Spinoza.
Mais ce point de départ est lui-méme Paboutissement des
deux premiers livres de FEthique. Pourquoi chaque chose,
par nature, produit-elle des effets qui tendent a la conse
‘yer? Crest ce qui se déduit de Ia métaphysique du livre I*.
Pourquoi cette activité productrice se heurtetelle & des
obstacles qui Iu font apparaitre comme un effort? C'est ce
qu’indiquent, implicitement il est vrai, les treize premiéres
proposition du livre II. Pourquoi eet effort s'exerce-t-il,
selon les individus, avec plus ou moins de puissance? Crest
ce dont rendent comptent les axiomes, définitions et lemmes
qui suivent la proposition 13 du livre Hl. Comment cette
puissance se manifeste-t-elle au niveau de homme? Crest ce
que montrent les propositions 14-49 du livre 11. Nos
quatre premiers chapitres seront consacrés respectivement
A chacun de ces quatre points : sans vouloir étudier les
livres T et II pour eux-mémes, nous en dégagerons ce qui
peut éclairer In doctrine du conatus
Cette doctrine repose évidemment sur deux prineipes
fondamentaux. Le premier reste implicite: il y a des
choses, et des choses individuelles; Vindividualité, loin
@étre une illusion due a notre ignorance du Tout, posséde
tune réalité irréductible. Le second, sous une forme ou sous
tune autre, est te leit-motiv de PEthique? : tout est intelli-
1 Eth, TIL, prop. 6.
toute Iaxiomatique
°
SPINOZA
gible, de part en part et sans aucun résidu. En combinant
ees deux principes, nous pouvons done affirmer qu'il y a
des essences individuelles. Et cette troisiéme vérité, & son
tour, se présente sous deux aspects. D'une part, puisque
Tordre du connattre se modéle sur celui de Pétre, chaque
individu peut se concevoir indépendamment des autres et
faire Vobjet d'une définition distincte}. D'autre part. puis-
que Fordre de l'étre se modéle sur celui du connattre, un
individu n’est rien d'autre que Ia transposition ontologique
de sa propro définition : les choses singuliéres, telles
qu’elles sont hors de notre entendement, ne contiennent ni
plus ni moins que ce qui est compris dans leur concept 4
A partir de Ii, le conatus se justifie en deux temps. Le
premier, purement négatif, ne souléve aucune diffcalté
particuliére. Rien, dit Spinoza, ne s'anéantit jamais soi-
meme. Car, de la définition d'une chose, nous ne pottvons
déduire que des conséquences qui s'accordent avec cette
défnition; tant que nous considérons Ia chose isolément,
nous ne trouvons rien qui soit en contradiction avec son
essence’. Et puisque la chose, hors de nous, est eractement
conforme & sa propre définition, nous sommes certains,
@ priori, qurelle ne recéle aucune eontradiction interne sts.
ceptible de la détruire; si, malgré tout, elle disparait, cela
ne peut venir que d'une cause extérieure®, Mais non pas
de wimporte quelle cause : une chose de nature A ne
Peut étre détruite par une chose de nature B que dans la
Mesure oit ces deux natures A et B sont logiquement incom.
patibles, c’est-edire dans la mesure oii elles ne penvent
appartenir ensemble & un méme sujet?; ear. si un méme
sujet ponvait étre A la fois A et B, et si B détruisait A, ce
sujet se détruirait Ini-méme de Vintérieur’. Das lors que
nous admettons Videntité de intelligible et du récl, ves
propositions 4 et 5 du livre IME sont évidentes.
juatenus vero [res}inter se discrepant, eatenus unaquae-
am ab altis distinctam in nosiva Mente format»,
(Lettre 32; G, t, TV, pp. 17041 ;"P, p. 1238.) Dans le manuscrit
original, au ‘liet de «' ideam ab alts distinctam », nous trou
vons : « sine religuis ideam distinctem » (bid. ; cf, t W,
Pe 05).
4 CE. Eth. 1, axiome 6. Principe traditionnel, mais que Spinoza
prend dans toute sa rigueur,
5 Eth. IT, prop, 4, démonstration,
© Eth. UM, prop. 4,
7 Bth WH, prop. 5,
* Id, démonstration,
10
DE LA SUBSTANCE A LIINDIVIDUALITE.
Mais ce qui Pest moins, c'est le passage A la. propos!
une chose ne peut se détruire elle-méme,
it-il, positivement, qu'elle fasse effort pour se conser
ver? De ce que sa nature n'est pas compatible avee celle
des causes extérieures qui sont capables de Ja détruire,
stensuit-, positivement, qu'elle résiste & ces causes exté-
rieures? Oui, mais & une condition : il faut que la chose
fen question agisse. Si sa nature est de produire certains
cffets, il est certain que cos effets s’accorderont avec sa
nature et, par conséquent, tendront a la préserver ; sa non-
‘auto-destruction deviendra auto-conservation. Sf sa nature
est d'exercer certaines actions, il est certain que ses actions
opposeront & tout ee qui exelut sa nature : Ta contradic~
tion logique, alors, deviendra conflit physique. Mais toutes
choses sont-elles actives? Cest ce que Von ne saurait démon-
trer sans faire appel & la métaphysique du livre T*.
ste metayhysique fst ellemtme que le déelopne:
on et Taporotondissement de nos deux principes. Etant
Mts qu'l'ya dor dts et que coueel sont intel
files, mods stl, pour secon Ia cnezption sp
noziste de l'Etre, de nous demander : qu’est-ce, exactement,
te insti un nid?
e ‘rait éforme de VEntendement? nous ren-
sce ss ol Cones iatcieloten Fx
ie econgu eat on former ane dfn gendtons®
esprit ne comprenant vraiment ce qu'il construit, la vraie
seteiton Surg chee Wott en eaplctes Te processus de
Convttaton og sem teu. Tae eas proche eh
procédant ainsi, nous connaitrons la chose de Pintérieur,
Gomes noua Tatu ale neuemim dass, 5
"rates infin» atmo plus settement dans fl ou a
ests eapectssapertels ee de iy ous pouttons
‘Sauine totes cies Wonty ses props ul ddcoulent
de sa seule nature, Ainsi la sphére, pour prendre un
cenptglomtlsgue; pects se dtc Sonne Te wolume
+ Mais non yont VBthique, dont it nous fat, paredosalement,
cero elt dant tn avinage nom Dobe
TRE, § 92 (G, t. 1, p. 345 K, p. 77: P, pp. 1904).
"TRE, § 95 (G, t IL, p. 35; K, p. 79; P, pp. 192).
TRE, § 95 (G, t Up. 343 K, p. 9; P, p. 191).
TRE, § 96 (cf. supra, note 11).
nu
‘SPINOZA,
engendré par la rotation d'un demi-cercle autour de son
diamatre™. Sans doute n’est-ce 1a qu'une analogie : les
étres mathématiques ne sont que des « étres de raison > %,
et Ia fagon toujours plus ou moins conventionnelle dont
nous les définissons “ n’a pas, en réalité, grande impor- |
tance". Mais, lorsqu’il s’agit d'un étre physique réel. il
est indispensable de le définir génétiquement ; fante de
quoi nous en serions réduits 4 eonstater ses propriétés
sans pouvoir en rendre compte. Comprendre une chose,
est savoir comment Ia produire.
Transposons cela ontologiquement, puisque Pétre et Ta
pensée s'accordent par hypothése. La définition génétique,
pour étre vraie, doit étre Fexpression de la chose méme.
Tout individu, par conséquent, doit réellement se présen-
ter sous deux aspects complémentaires et réciproaues ® +
lune activité produetrice (analogiquement, Je demi-cercle
tonrnant) et le résultat de cette activité (le volume engen-
aré par le demi-cercle tournant). Le résultat n'est pas
autre chose que Vactivité elle-méme : il est simplement Ia
structure qu’elle se donne en se déployant ; en ce sens, il
est en elle comme i est concn par elle. La sphére ne pos-
séde aucune réalité en dehors du mouvement dn demi-
cercle : aussit6t que celui-ci cose de tourner, elle dispa-
ait, L’activité, antrement dit, est cause immanente de sa
propre structure. Ces deux asperts ne sont done isolables
que par abstraction : tout individu est auto-producteur,
particllement ou totalement selon que son dynamisme
interne a besoin ou non de certaines conditions extérienres
pour s'exercer; et, du fait de cette auto-produetivité, il
peut-étre considéré, & analyse, soit comme « naturant »,
soit comme « naturé >.
Allons plus loin. Le demi-cerele, en toute rigueur, n'est
pas vraiment Ia racine premiére de la sphére ; comme il
doit, & son tour, se définir génétiquement, nous retrouvons
en Ini la dualité naturantnaturé : d'une part, Te segment
sree pCR Te Ena ean
TRE, $108 Vil ht Tw me em 6D
Femelge ous
ee ae ee
Lege, fees exten du Die de §
ire A la théorie de Ja definition génétique. Et en effet,
chronologiquement, celleci est pasiéricure A cellela,
2
noma,
de Tet
DE LA SUBSTANCE A L'INDIVIDUALITE,
de droite dont une extrémité est fixe et autre: mobile, et,
d'autre part, 1a figure engendrée par la rotation de ce
segment®. Puis le segment de droite, & nouveau, se
définit de Ia méme facon : son aspect naturant, c'est la
translation @’un point, c'est-a-dire la combinaison de
mouvement et de repos qui, parce qu'elle est la plus
simple possible, se concoit pat les seules notions de mot
vement et de repos en général”; son aspect naturi
c'est la ligne déerite par cette translation. Enfin, le mou-
vement ef Ie repos sont les deux déterminations immé-
diates que VEtendue se donne a elle-méme: puisqu’ils
se concoivent par I'Etendue, la théorie ‘de la définition
exige quils soient produits par elle, méme s'il nous est
diffe de nous représenter cette production et d’en
expliquer verbalement le mécanisme; sinon, il y aurait
dans V’étre quelque chose d'inintelligible. Et’ nous attei
gnons, cette fois, le Naturant absolu, celui qui est unique-
ment naturant et en auetne fagon naturé ; car I’Etendue,
dans la mesure oi elle se comprend par sa seule essence
et non plus par autre chose, est A elle-méme sa propre
cause prochaine®: non pas réceptacle inerte*, mais
pure Activité spatialisante” qui se produit elle-méme en
produisant les structures quelle se donne. Or, cette an:
lyse, mous pouvons la faire & propos de n’importe quoi
si nous étions partis d'une réalité spirituelle, nous aurions
trouvé une Activité d’un autre type, pensante et non plus
spatialisante, mais toujours un Naturant absolu.
Cette productivité pure, pour employer le vocabulaire
traditionnel, c'est la Substance ; les structures qu'elle se
donne en se déployant, ce sont ses modes ; ce qui cons!
tue son essence, c’est-i-dire 1a maniere dont elle produit
ses propres structures (en extension et partes extra partes
dans le cas d'un corps, en pensée et parles intra partes
dans le cas dune idée ou d'un esprit), cest VAttribut.
* TRE, § % (cf. supra, note 11).
"ERE, § 108, Il (G, t HL, p. 395 K, p. 89: P, p. 196).
= Cf. Principia, IL, prop. 15, scolie (G, t. I, p. 203; P, p. 271).
encore partens ete BF GWE A Pe. Te
“TRE, § 97, 1(G, tI, p. 353 K, p. 813 P, p. 192).
8 Of, Lettre 60 (6, € IV, p. 271; Py ps BL).
% CE. Lettre 81 (G, IV, p. 382 P, p. 1355).
2 « espace spatialisant et non pas espace spatialisé », dit
Lachidzeey (ope elt, poz.
18
‘SPINOZA
Compte tenu de Ia conception spinoziste de Ia aéfinition
génétique, les définitions 3, 4 et 5 du livre If no peuvent
gutre avoir d'autre sens.
Ainsi commence Ethique. Puis les 15 premiéres pro-
positions, envisageant Ia Substance indépendamment de
ses modes, la raménent & Puaité au moyen de deux
syllogismes :
1, Ine peut y avoir deux on plusieurs substances
de méme atlribut®, car, selon le principe de cor-
respondance entre I'intellect et la chose, deux ou
plusieurs réalités dont ies concepts ne se distin-
guent en rien sont absolument identiques® ;
2. Toute substance dont nous avons une idée claire
et distinete existe nécessairement par soi. Sinon,
puisque elle ne peut pas étre produite par autre
‘chose, son existenco serait absolument impos-
sible en droit ; et, selon le principe de correspon-
dance, nous ne pourrions pas en avoir une idée
wraie®;
3, Toute substance, & supposer méme qu'un seul
attribut tui appartienne, est _nécessairement infi-
nie® ; car, étant unique en son gente, elle rest
limitée par aucune autre substance de méme
nature® ; rien ne fait done obstacle & son inépui-
sable productivité Mais pourquoi chaque sub-
stance n’aurait-elle qu'un attribut ? On peut fort
bien concevoir une activité pure qui s'exercerait,
non pas d'une seule facon, mais de plusieurs
facons a la fois : plus une substance a de réalité
ou détre, pls nous devons Ini accorder d'attri-
buts; & Ja limite, rien ne nous empéche de lui
en accorder une infinité. Chacun de ses attributs,
3 Bth. 1, prop. 5.
® Id, démonstration.
2 Eth 1, prop. 7.
2 Eth. E pron 6 et ply gu se démontrent euxmeémes
soit ar les propositions 2 et 3, Soi directement par Yaxtom
tila detnition de Is Sebstance, = “eetement Par Yesiome 4
B Fi. 1, prop. 8 scolie 2, qui complete eureusoment In
démonstration de Ia’ proposition
8 Eth. I, prop. 8.
% Id, démonstration,
% Eth. I, prop. 9.
u
DE LA SUBSTANCE A L'INDIVIDUALITE,
alors, au méme titre que nos hypothétiques
substances & un seul attribut, devrait se concevoir
par soi et étre infini en son genre. Ainsi for-
mons-nous Tidée claire et distinete de Dieu :
substance absolument infinie, c’est-i-dire consis-
tant en une infinité dattributs dont chacun
exprime une essence éternelle et infinie® ;
4, Dieu, par conséquent, existe nécessairement par
5. Dans ces conditions, puisque Diew existe et pos-
séde déjA tous les attributs possibles, aucune
substance ne peut exister en dehors de 1ui®. Tl
est Punique Naturant de la totalité du réel®:
tont est on lui et se eoncoit par luis,
Nous artivons alors & la proposition 16, qui, comme I'a
bien yu Tschirnaus®, est la plus importante de tout le
livre 1. Une fois ramené & Tunité ce Naturant que la
régression analytique nous avait fait découvrir au coeur
de chaque individu, nous allons pouvoir refaire le che-
min en sens inverse et assister & la genése des individus
ens-mémes : « De Ia nécessité de la nature divine doi
vent suivre une infinité de choses en une infinité de
modes, c'est-A-dire tout ce qui peut tomber sous un enten-
dement infini. » Proposition « évidente », dit Spinoza, si
Yon admet que, de la définition d'une chose, Mentende-
ment déduit plusieurs propriétés qui découlent réellement
de essence de la chose méme, et si Yon admet, d’autre
part, que le nombre de ces propriétés est proportionnel
Ala richesse de cette essence ®. A vrai dire, tant que Pon
ignore la conception spinoziste de V'intelligibilité, cette
« évidence » n'est gudre perceptible : s'il est vrai qu'une
% Eth, I, prop. 10.
» Eth, J, définition 6,
4 Eth, J, prop. 11. Telle est du moins la premitre démons-
tguion ae) Hetienes de Dion, elle gui ppigue aa, cas de
Dieu ce qul a été démontré do is. Substance en général, Les
fois suivantes (et surtout Ia. derniere, celle du seolie de ta
Proposition Il) partent directement de Made de Diev.
» Eth, I, prop. 14
© 14, coroll. 1.
© Eth, I, prop. 15.
© Cf, Lettre 82 (G, t. IV, p. 334; P, p. 1357.
© Eth. 1, prop. 16, démonstration.
SPINOZA
chose dont Vessence est infinie doit posséder une infinité
de propriétés, s’ensuit-il qu'elle produise une infinité
deffets ? Spinoza ne joue-til pas sur une équivoque, ass
milant Tespéce « propriété > & Vespéce « effet » sous
prétexte que l'une et Vautre appartiennent au genre
‘« conséquence >? Mais, & In lumiére de Ia théorie de la
définition et de sa transposition ontologique, tout s’éclaire.
Puisque « étre concu par > signifie « étre engendré par >,
ce qui est principe q'intelligibilité doit étre en méme
temps cause efficiente*: il appartient & essence de la
Substance de produire, chacune des propriétés qui se
Géduisent de cette essence correspond A Ia production
d'un effet déterminé, et ces effets sont d’autant plus
nombreux que Vessence est elle-méme plus riche. La
Substance, en tant qu’elle agit sous l'un quelconque de
ses Altributs infinis, se donne done nécessairement & elle-
méme une infinits de structures : toutes celles qu'un
intellect omniscient peut concevoir. Et, comme elle
consiste en une infinité d’Attributs, elle se donne chacune
de ces structures d'une infinité de facons : selon tous les
types dactivité qu'un intellect omniscient peut conce-
Voir. Ainsi obtenons-nous In résiproque de ce qui pré-
eéde : nous savions, jusqu’d présent, que tout le réel se
congoit par Dieu; nous apprenons maintenant que tout
le concevable se ‘réalise. Etre intelligible, cest pouvoir
étre produit par la Substance ; o tout ce que celle-ci peut
produire, elle le produit par définition ; seul, par consé-
quent, ce qui est logiquement contradictoire ne pourra
jamais voir Ie jour. Toutes les essences individuelles ten-
dent et prétendent & s'actualiser, toutes ont pour s'actua-
Hiser une certaine force, toutes ont. droit & Vactualité ; et
cette tendance, ou cette force, ou ce droit, c’est Diew Iui-
méme. Dieu est la projection ontologique de la proposi-
tion : « Tous les individus possibles doivent exister. »
4 Dok te corallaire de ta proposition 16
© Sauf, bien entendu, les propriétés analytiques, qui ne font
esi ete, les roils anaes, gue font
iEnce” necessare, iniaite, tate, immutabllt, eles Cesk de
cellesty seulement que Paile Soitors dans ot réponse & Techion
haus (Lettre 837 'G, t. IV, p, 335; Pp. 1358), semblant ainsi
squiver te Aebat, Mais il’ écise ii Keponta plus tard sat
farauere ds omelets, clscelge su a ante de
infinig diverité dea choses 4 partir de Diew bid; : état
earactérisé par la contradiction qui les affecte entre la
nécessité d'étre et Ia difficulté détre.
Cette contradiction n'est évidemment pas insoluble.
Mais sa solution requiert Ia mise en ceuvre d'un nouveau
type de causalité, Ce qui lui manque pour exister, essence
singuliére va le recevoir de l'exlérienr ; encore de Dieu,
dien entendu, mais, cette fois, indircetement : de Dieu,
non plus en tant qu'il se manifeste en elle comme son
naturant interne, mais en tant qu'il se manifeste dans
toutes les autres essences singuliéres. Une chose finie D,
5 Eth. 1, prop. 25.
# Eth 1, prop. 24 et coroliaire.
18
DE LA SUBSTANCE A L/INDIVIDUALITE
tout en étant nécessairement déterminge & exister par
Dieu, ne peut Vétre ni par la « nature absolue » de Dieu,
ni par Dieu-en-tant-qu’affecté-d’une-modification infinie ;
elle Ie sera done par Dieu-en-tant-qu'il-est-déja-affecté-
une-autre-modification-finie, ou, ce qui revient au méme,
par une autre chose finie C®:'pour que le demi-cerele
tourne, il faut qu'une cause externe le fase tourner. La
question, toutefois, n'est que déplacée : par quoi C est-
‘lle déterminée & exereer précisément action C qui sou-
tient D dans existence ? Par Dieu, sans aucun doute®.
Et par quoi est-elle déterminée a exister ? Toujours par
Diew. Mais, & nouveau, et pour la méme raison, par Dieu-
en-tant-qu’affecté-d’un-autre-mode-fini, done par une troi-
sitine chose finie B. Puis celle-ci, & son tour, est déterminée
A exister et & exercer l'action b qui produit C par Dien-en-
-se-manifeste-a-travers-tne-chose-finie-A-exercant-
une-action a, etc. & Pinfini*, Ainsi une essence singuliére
queleonque sera-t-elle amenée & s'actualiser par la conjone-
tion de sa propre vis existendi et de celle de toutes les
autres essences singuliéres ; cest-a-dire, comme il était
requis, par la puissance infinie de Diew : qu’est-ce que la
lotalité de ces essences individuelles (. ABCD...), sinon le
Mode infini immédiat ? Et qu’est-ce que la totalité de leurs
effets (..abcd...), sinon "ensemble des événements aux-
quels donnent ‘Tiew les lois éternelles du Mode infini
médiat en se combinant les unes avec les autres de toutes
les facons possibles? Une double conclusion s'impose
done. En premier lieu, les individus singuliers ne peuvent
exister quien communauté, & titre de parties d'un Univers
infini au sein duquel tout agit sur tout de proche en pro-
che: seule cette interaction universelle par laquelle ils
se ménagent mutuellement un contexte favorable peut
permetire A chacun d’enire cux, en Iui apportant du
Gehors Tinfinité de déterminations qu'il ne possédalt pas
par nature, de combler le vide logique qui 'empéchait de
svactualiser. Mais, en second lieu, cette coopération a sa
contrepartie négative. Car un mode fini B existe condi-
tionnellement, et non plus inconditionnellement : il s'2c-
tualise si et seulement si un autre mode fini A s'actualise ;
en Vabsence de A, il reste & état de virtualité dans le
» Eth. I, prop. 28, démonstration.
© Eth. 1, prop. 26.
© Eth, 1, prop. 28,
‘SPINOZA
Naturant. Les choses singuliéres, dans la mesure oit elles
peuvent @re concues comme inexistantes, ne sont done
pas nécessairement éternelles : si l’Altribut dont elles sont |
es modes ne peut pas les produire toutes & la fois (pour:
Vinstant, & vrai dire, nous n’en savons encore rien), elles
auront une durée limitée, chacune disparaissant’ pour
céder Ia place i d'autres lorsque son environnement
Vexelura, Mécanisme wn peu analogue & celui du pacte’
social, qui garantit aux citoyens la jouissance de leur droit
naturel tout en en limitant l'exereice. Tel est ce que l'on |
pourrait appeler le © contrat existentiel » des essences.
La Nature entiére, dés lors, est soumise & un détermi-
nisme inflexible, Rien n'est contingent : Dieu existe et
agit nécessairement, ses modes sont produits nécessaire-
ment, les actions de ces modes sont nécessaires®. Mais
cette nécessité n’implique-t-elle pas I’élimination de cer-
taines virtualités qui quraient pu s'actualiser ? Non, sans.
aucun doute: dépourvue de tout caractire sélectif, ne
sacrifiant ni ne privilégiant aucun possible, elle est, si Yon
peut dire, démocratique au plus haut point. Comment ce
que Diew ne réalise pas serait-il concevable, méme pour
un intellect omniscient? L’Entendement infini, tout comme
n'importe quel entendement fini, ne doit rien comprendre
autre que les Altributs divins et les conséquences qui
en découlent®; mode de Ja Pensée, il appartient & la
nature naturée ‘et non pas & la nature naturante # ; I
@étre antérienr & la produetion des choses, il ne fait qu
Vexprimer idéalement. Et comment Dieu aurait-il pu déci-
der, par une libre volition, de réaliser un autre monde?
La Volonté infinie n'est pas plus libre qu'une volonté
finie ; elle est l’Entendement Iui-méme en tant qu’il est
nécessairement déterminé & affirmer ce qu'il déduit ®
Dieu ne pourrait pas produire autres choses que celles
quill produit®, car il faudrait pour cela que sa nature fat
différente ; aucume essence individuelle vraiment pos-
© Eth, 1, prop. 29.
8 Eth, T, prop. 30.
Eth. T, prop. 31.
6 Eth, I, prop. 32.
“ CF, Eth, I, prop, 49 et corollaire,
© Eth. I, prop. 33
“14, démonstration,
20
DE LA SUBSTANCE 4 LINDIVIDUALITE
sible n'est done exclue : toutes, dans le Mode infini immé-
, exercent effectivement leur droit & Tactualit
comme tous les sujets d'un Etat stable exercent effect
vemnent leurs droits civils. Dieu ne pourrait pas non plus
produire Ies mémes choses dans un autre ordre®: il
faudrait pour cela qu'il pat les déterminer & exereer
autres actions qué celles par lesquelles, dans notre monde
réel, elles se font mutuelloment exister ; les choses, alors,
seraient autres qu’elles ne sont, et Dieu, & nouveau, change-
rait de nature ®, Un seul ordre est done possible : celui
que définissent les lois du Mode infini médiat, et qui,
parce qu'il se déduit de la sommation de toutes les
essences individuelles (comme les lois, dans un Etat stable,
sont Ia résultante de tous les désirs et de tous les pouvoirs
individuels), est Ie seul qui permeite & toutes ces. essen-
ees sans exception de franchir le cap de Texistence.
Moyennant quoi, puisque la puissance de Dieu se confond
favee son essence, tout ee que nous concevons étre au
pouvoir de Diew arrive nécessairement un jour ow V'au-
tre®,
Nous savons maintenant ce qu’est I'Etre. Les modes,
sans la Substance, n’ont aucune réalité. Mais la Substance,
considérée indépendamment des modes, est encore une
abstraction : il serait contradictoire @hypostasier Vacti-
vité en Ia séparant de ses structures. Seule existe concréte-
ment la Totalité auto-productrice, naturante et naturée
4 Ja fois, qui s'articule en une infinité de totalités singu-
lidres dont chacune, selon la richesse de son essence, par-
ficipe de V'unique Naturant universel. Dieu n'est pas
extérieur & Vindividu infini; il n'est pas non plus exté-
rieur aux individus finis, méme s'il déborde infiniment
chacun dentre eux pris & part : il est ce qui, en eux, les
fait étre et les fait comprendre. Deus quatenus : le pan-
théisme fonde Vindividualisme métaphysique™™*.
Dans ces conditions, le second temps de la justification
du conatus devient tout aussi compréhensible que le pre-
mier, Il est clair, & présent, que toute réalité naturelle
© Eth, 1, prop. 33,
Id, aémonstration.
% Eth, 1, prop. 34.
® Eth. T, prop. 35.
21
SPINOZA
exerce une action causale®. Un individu n'est rien d'autre
que activité divine en tant qu'elle se donne ello-méme
une structure déterminée. Mais activité productrice, en
tant qu'elle se donne telle structure, produit nécessaire-
ment quelque chose dans le cadre de cette structure.
Lorsqu’une essence individuelle existe en acte, ses consé
quences Togiques ,deviennent donc ses effets réels. Et,
comme ses conséquences ne sauitaient Ia contredire, ses
effets ont pour résultat de In maintenir dans existence”.
Bien plus : puisque Pessence de le chose est logiquement
incompatible avec celle des choses qui peuvent la détruire,
ses effets réels sont réellement incompatibles avec coux
gui naissent de ces choses ; elle oppose & ces choses ®,
physiquement et non plus seulement conceptuellement.
La question est done résolue : Vindividu s'efforce de per-
sévérer dans son étre®. Et son effort pour se conserver,
Join de Tui étre surajouté, ne se distingue pas de son
essence actuelle”: son essence, da seul fait qu'elle était
concevable, tendait nécessairement & s'actualiser depui
toujours ; dés lors qu'elle s’actualise, elie tend donc, de
la méme’facon, & se réactualiser & chaque instant le
conatus d'une chose est Je prolongement, dans In durée,
de sa vis existendi éternelle, Tout individu, qu’il soit fini
ou infini, apparait ainsi comme la résultante de ses pro
pres effets: comme une totalité fermée sur soi, qui se
produit et ‘se reproduit elle-méme en permanence. Au
niveau de Pindividu infini, qui n'a pas d'environnement
extérieur, cette auto-reproduction ne rencontre aucun
obstacle : le Mode infini immédiai produit éternellement
le Mode infini médiat, qui reproduit éternellement Ie
‘Mode infini immédiat *; e’est 1A la vie méme de Univers.
bis Comme Je dit Appuhn (Spinoze, ch. wv, p. 66). Il n'y a
done aucune contradiction, contrairement ‘ce que pense
-L. Couchoud (Benoit de’ Spinoza, ch. vit, p. 184) entre la
théorie de la Substance et celle de’ lindividualté,
1 Bth, 1, prop. 36.
1% Eth. THT, prop. 6, démonstration.
Id.
% Eth. TH, prop. 6.
7 Beh. IU, prop. 7.
% Cest pourquoi il n'y a que deux Modes infinis. Sinon, il
nly aurait aucune raison pour que leur procession ne continue
as indéfiniment. Sur ce point, nous ne ‘vraiment
Suivre HF. Haliett dans’ ses ‘considérations vertigineuses (cf.
Benedict de Spinoza, ch. 111, pp. 3440)
22
DE TA SUBSTANCE A L'rxprvipuatiTé
Dans le eas d'un individu fini, par contre, des obstacles
peuvent et doivent surgir : une chose singuliére n'existe
que si Tes autres choses. singuligres lui procurent un
Contexte favorable, si son conatus est soutenu par tous
Jes autres conatus ; ef un moment arrive toujours, oi
a. coopération se transforme en antagonisme. Mais Vin-
dividu fini Tui-méme, dans la mesure oi il agit, cest-k-
dire of ce quil fait se déduit de sa seule mature, tend
hse conserver pour une durée ilimitée ®. Aucune’ expé-
rience Winfirmera jamais cette vérité fondamentale : si
hous croyons rencontrer un étre qui ne cherche pas &
persévérer dans son étre, cela signifie simplement qu'il
he s'agit pas d'un véritable individu.
Ce conatus fonde le Droit Naturet® ; transposition, dans
ja durée, du droit étetnel des essences & exister. Quoi
@étonnant a cela ? La source de toute valeur, pour Spinoza
comme pour n'importe Iequel de ses contemporains, c'est
Dieu. La cause unique de toutes choses, par définition, a
tous les droits #. Mais Dieu, selon Spinoza, se confond avec
Yauto-productivité interne ‘de chaque réalité individuelle,
ave Paspect naturant du Tout et des totalités partielles
qui le composent. Tout ce que fait un individu est done
ipso facto validé®. Et cela, non pas simplement parce
qu'il n'y a pas de normes transcendantes (ce qui ne nous
donnerait qu'un nibilisme moral), mais parce que, posi-
tivement, Ia norme est immanente. Chaque étre a autant
de droit’ qu'll a de puissance pour persévérer dans son
@tre®, car cette puissanee mesure trés exactement son
degré de participation au divin. Droit absolu pour VIndi-
vidu infini4, droit relatif ct limité pour les individus
finis®; non seulement pour "homme, mais pour tous les
@ires naturels sans exception : les gros poisons mangent
les petits, et est normal ™. Deus quatenus : le panthéisme
justifie Pindividualisme éthique.
% Boh, TIL, prop. 8.
© TP, ch. 1, §3.
a
aid.
sia,
“TP, ch. 1, § 4
8 14.
“73
ch. xvr (G, t. ID, p. 1895 P, p. 680).
23
SPINOZA
Mais pourquoi l'exercice de notre droit naturel nc
Inels, au lieu de coexister harmonieusement et pour
toujours, se font-ils concurrence les uns aux autres ?
allons le voir, vient de 'Etendue. i
sites mite spec ye 2 :
gerne get La te
24
chapitre 2
Ja séparation : individualité élémentaire
et univers concurrentiel
Quel usage les modes finis vont-ils faire de leur droit
natitrel? ‘Tout dépend, ici, de PAttribut qu'ils manifestent.
Chaque chose est produite par Dieu d'une infinité de
fagons dont deux seulement nous sont connues, et c'est
ceite dualité qu'il nous faut maintenant examiner. Sans
doute, de Ja Pensée & l'Etendue, la structure formelle d'un
individu donné reste-telle identique & elle-méme ; mais
le type d'aetivité selon lequel elle se déploie n’en change
pas moins du tout au tout. D’ot une distorsion dont les
conséquences sont capitales
L’Etendue est un Attribut de Dien, puisque tout objet
physique se concoit par elle alors qu’elle-méme se con-
goit par soi. Principe d'intelligibilits des choses maté-
Fielles, elle doit en étre la cause efficiente et immanente ;
infinie en son genre, elle doit engendrer toutes celles qu'un
intellect omniscient peut concevoir. Elle est, si Yon veut,
Activité divine en tant que celle-ci se donne & elle-méme
tune infinité de structures en les étalant dans trois dimen-
sions’, partes extra partes, sous forme de corps extérieurs
es uns aux autres et impénétrables les uns aux autres.
Mais comment produit-elle tous ces corps? En produi-
sant le Mouvement-Repos, qui est son mode infini immé-
1 Beh, UL, prop. 2,
2 Spinoza, dans les Principia (If, définition 1; G, tT, p. 181:
Bp a)” dn Teen par 1s seule teeimensionlie, ot
foil pas par « Tacte de setendre », C'est normal, pulsquil expose
fe'phint Ge ‘vas de Descartes, Ei cela sullt” pour. edifer Une
Fuge ‘au ‘nivent doi egaalsangs du steond gery? la
{ridimenstonalitg est co gui, de TEtendue, transparsit dans ses
Thodes f titre ‘de. propriets’ commune,
SPINOZA
diat’, Spinoza, & vrai dire, n'est jamais parvenu a élucider
entigrement la question’, Mais le principe méme de la
réponse qu'il entendait Ini donner nous semble clair. Ce
qui fait psychologiquement diffienlté, c’est_ que nous
sommes habitués 4 confondre V'Etendue, & la suite de
Descartes, avec I'Elendue défi modifiée par le Repos? ;
dans ces conditions, nous ne comprenons videmment pas
comment celle moles quiescens peut se mettre d'elle-méme
en mouveinent : si elle est en repos, elle y restera éternel-
Jement, et jamais aucun corps particulier n'en. surgira®.
Mais, en réalité, V'Elendue est logiquement antérienre au
Repos comme elle est logiquement antérieare au Mouve-
ment: ces deux déterminations se concoivent par elle au
méme titre et, par conséquent, doivent étre produites par
elle aw méme titre, Si elle ne se donnait que du repos
et pas de mouvemeni, rien n’en scrtirait, sinon la mono-
tonie d'un bloc indiftérencié ; si ells ne se donnait que du
mouvement et pas de repos, rien n’en sortirait non plus,
sinon une pure fluidité sans articulations internes? L'in-
finie diversité des choses exige done, pour voir le jour,
une proportion optimum de Mouvement et de Repos en
dech et au-dela de laquelle tout le possible ne s'
pas. Mouvement et Repos forment un couple indissoluble
qui se déduit de la < nature atsolue » de I'Etendue,
compte tena du fait que celleci, par définition, tend
nécessairement & produire tous les eorps coneevables.
Ainsi modifige par son mode infini immédiat, TEtendue
se fragmente en une infinité de corpora simplicissima®
qui constituent les éléments de base du monde physique.
Spinoza ne précise guére Ia nature de ces corpuscules, et
nous ne tenterons pas de le faire A sa place. I nous dit
simplement quills « ne se distinguent entre eux que par
Je mouvement et le repos, la vitesse et Ia lentenr »°. Ce
qui est normal, puisqu’ils sont simples, c’est-A-dire indif-
férenciés intérieurement : si deux corpora simplicissima
wenkttts 6 (G, t IV, , 278 P, p. 119). Sur Tunité du Mou
Yepent et dy Repos, ck. ahi, A'Study of the « Ethics » of
4 Lettre 83 (G, t. IV, p. 334; P, p. 1357).
5 Lettre 81 (G, t IV, p. 332; P, p. 1355).
61a.
7 CLL., Appendice, UL, § 14 (G, tI, p. 120 ; P, p. 150).
* Cf. Eth, Il, Lemme 7 (aprés la proposition 13), scolie,
oI,
26
VINDIVIDUALITE ELEMENTAME
accolés I'un & autre sont au repos, ou s‘ils se meuvent &
Ja méme vitesse, ils formeront ensemble un seul et méme
corpus simplicissimum continu et homogéne ; pour qu'ils
possédent une individualité distinete, il faut, ou bien que
Pan d'entre eux se déplace alors que autre reste imino-
bile, on bien quiils se meuvent A des vitesses différentes.
Leur essence singuliére, semble-tl, se réduit done & Ieur
vilesse relative ; ce sont des individus qui se définissent
entiérement par leur rapport externe & autrui: des in
yidus qui ne sont encore qu’événements purs. Bien plus :
cette individualité élémentaire, ils ne la gardent qu'un
instant, ou presque. Car, étant impénétrables, ils ne peu-
vent se mouvoir sans se déplacer mutuellerent ® ; et cela
de facon telle que la place Inissée libre par l'un d’entre
eux soit aussitdt occupée par d'antres; d'ot, comme
chez Descartes ®, un entrecroisement de mouvements tour-
billonnaires® qui, en modifiant constamment Ia vitesse
des corps simples qu’ils entratnent ¥, obligent ces corps &
stunir et a se fragmenter sans arrét.
Au niveau des. parties, par conséquent, il n'est plus
question d’éternilé. Nous savions déja que les modes fir
d'un Attribut queleonque pounaient étre assujettis &
avant et & T'aprés ; nous savons, A présent, que ceux de
VEtendue y sont nécessairement assujettis. La matitre
prend toutes les formes qu'elle peut prendre, mais suc-
cessivement® et non pas simultanément : étant donnée
telle configuration de Univers, on peut toujours en conce-
voir une infinité dautres, qui doivent, elles aussi, se réali-
et elles ne se réalisent qu’au prix d’un remaniement
perpétuel de leurs éléments constitutifs. 1’Btendue, dans
la mesure méme oi elle produit ses modes partes extra
» Principia, U, prop. 7 (G, t. I, p. 1965 P. p. 264).
1 Principia, IL, prop. 8 (G, t. I, pp. 1967; B, p. 265).
% Ce qui est « inutile, pour ne pas. dire absurde » dans ta
Physigue cartesienne, oe sont ler prinoipes (Lette 81 G, t IV,
p. 2324 P,_p. 1333): cestidire, avant tout, Vintroduction dui
Fnowvement Gane Fétendue sous Yaction causale transitive d'un
Diew extérieur a Ia Nature, Pour le reste, Spinoza nous dit
simplement que la 6 Tegle cartésienne du choc est fausse
(etre 32; & t. IV, p. Tits P, p. 1237). Lorsque Vexposé des
Principia est logiquetnent compatible avec TEthique (et tel est
‘bien fe cas fel), nous pouvons done admettre, sauf indication
contraire, quil Correspond & la pensée de Spinoza.
8 Principia, II, prop. 8, corollaire (G, t. I, p. 198 ; Py p- 266).
¥ Principia, 1, prop. S11 (G, t. T, pp. 198200; P, pp. 2668).
% Principia, TUL, Introduction, it fine (G, t. I, p. 228 ; P, p. 296).
27
sPINozA
partes, ne peut pas les produire tous 4 Ia fois : elle n’actua-
lise leurs essences dans Te Mouvement-Repos qu’a tour
de réle. Dis lors quill y a spatialité, il y a durée ; existence
qui, Ioin de résulter inconditionnellement de Ia seule
nature de Dieu, dépend de certaines conditions de lieu et,
par lisinéme, de certaines conditions de temps ; existence
hic ef nunc, et qui est rune parce qu'elle est hic
Faisons maintenant un pas de plus, et passons des indi-
yidus iémentaires aux conséquences de leur nature.
Puisque le corpus simplicissimum a une essence, il s'ef-
force de la réaetualiser & chaque instant. Puisque son
essence se définit par sa vitesse, il tend & conserver cette
vitesse #; et cela, de Ia fagon la plus simple possible logi-
quement”, c'est-i-dire en ponrstivant son chemin en
ligne droite, Son conatus a done pour seule loi Puniver-
sel principe d'inertie. Certes, il en ira tout autrement dans
le cas des individus complexes : en régle générale, persé=
vérer dans son éire nest pas Ia méme chose que persé-
vérer dans son état#>*; mais, précisément, Vétre du
corps simple se réduit & son état. Or ce conatus élémen-
taire est nécessairement conflictuel : le eorpuscule, pour
continuer son mouvement en ligne droite, doit repousser
Jes corpuscules voisins qui len empéchent; et ceux-ci, &
Jeur tour, le repoussent, Dés lors, la séparation est
consommée : chaque corps simple, comme s'il était_un
empire dans un empire, s'affirme your ui-méme en. s'op-
posant & son milicu ; c'est Ia guerre de tous contre tous.
Et cest aussi, & bréve échéance, Vinévitable défaite de
chacun : les tourbillons rendant impossible tout mouve-
ment reetiligne prolongé, le corpus simplicissimum est
constamment détourné dé son cours, et, par l-méme,
presque toujours anéant}. Sans doute peut-il_conserver
son essence tout en changeant de direction, s'il garde la
méme vitesse; mais, en fait, c'est trés difficilement réali-
sable: la plupart du temps, le choe modifie la fois ces
deux facteurs. Ainsi Ia conjonction des conatus a-t-elle
pour résultat le destruction permanente de tous par tous.
4 Principia, W, prop. 18 et coral. (G, :
7), CE Btn i eames Copies ls pron, BF Ceol"
Principia, H, prop. 15, seolie (G, t. 1, p. 203; P, p. 271.
® Principia, W, prop. 15 (G, t. 1, 202 P, p. 27).
\8bis CE. Delbos, Le spinocisme, pp. 11823.
» Principia, 1, coroll, démorstration (6, ;
pe Pesiia prop. 8, cor, démorstration (6,1, p. 198;
28
DINDIVIDUALITE ELEMENTATRE
Mais cette guerre universelle n’est pas un chaos, bien
au contraire : eile est soumise & un déterminisme rigou-
reux, Car l'individu physique total, Tui aussi, a son
essence, caractérisée par la proportion qui s'instaure entre
Te Mouvement et le Repos I'échelle de T'Univers. Il a
done, lui aussi, son conatus, dont les conatus finis ne sont
jamais que des aspects particuliers et transitoires. Et,
etle fois, rien ne saurait Ini faire obstacle : n’ayant pas
Ge contexte dont il puisse recevoir ou & qui il puisse
communiquer quoi que ce soit, il garde nécessairement 1a
méme quantité de mouvement, la méme quantité de
repos, el, par conséquent, la méme proportion de mou-
‘ement et de repos ®. D’ott la lot fondamentale de la Phy-
sique : lorsqu'une partic quelconque du Tout en meut
tine autre, elle perd autant de mouvement que autre en
acquiert 8, De cette loi, combinée au principe d’inertie,
‘découle tout le systéme des lois universelles de la Nature;
pour les cas les plus simples, nous en déduisons assez
Facilement les sept regles eartésiennes du choc%, mais ce
nest 14 qu'un commencement : autant de situations pos-
sibles, autant de rapports concevables entre les conatus
corporels, autant de régles de communication du mouve-
ment. Telle est Iéternelle Facies Totius Universi®, qui
définit Vordre selon lequel les modes de I'Etendue se déter-
minent mutuellement a exister et & disparaitre au cours
du tomps® ; consequence éternelle da Mouvoment-Repos,
elle a pour résultat Péternelie conservation de ce méme
mouverent-Repos. Ainsi la Totalité matérielle se produit-
tlle et se reproduit-elle par 1a médiation d'une infinité de
conflils entre ses particules élémentaires : de la discorde
universelie nait Ja concorde universelle, qui régit elle-
méme ensemble des manifestations de la discorde.
2» Principia, I, prop. 13 (G, tT, p. 200; P, p. 266).
aid
2 ..omnia enim corpora ab ais cireumeinguntur, et ab
inviceni’ determinant aa existenduam st operandum certa ac
‘Sisrminata retione, servata semper tm omnibus. simul, HOC est,
stcrmin oa'cadern rations mrolus ad quletem » (Lettre 325
6 iu gp Eas Pp. 128).
‘Principia, 1, prop. 20-(G, tT, p. 208 P, p. 276.
Principia, IL prop. 2431 (G, t. 1, wp. 21119; P, pp, 27988).
seule a ePtige, BG Spina eed Pbescartes
‘régle, selon Spinoza,’a été mal déduite par
(c£, supra, note 12).
3 Lettre 64 (G, t. IV, p. 278; P, p. 1319).
% Cf. Eth. If, prop. 6.
SPINOZA
Vieille idée, toujours fascinante, que Spinoza rationalise
sans Vaffadir.
Bien entendu, cette description demeure abstraite. En
réalité, la Nature physique ne se réduit pas 4 une juxta-
position de corpora simplicissima qui tourbillonnent et se
combattent. Mais i] s'agit d'ume abstraction bien fondée,
A partir de laquelle, si nous étions omniscients, nous pour-
rions reconstiluer généliquement les structures concrétes
du réel; celles-ci la dépassent sans Pabolir. C'est la ce
que Yon pourrait appeler I’ « état de nature » de Univers,
par analogie avec l'état de nature de PHumanité, qui, Int
aussi, est une abstraction Ia fois dépassée el conservée
dans la société politique. Nous verrons bientt comment
Jes corps simples, en s’unissant, forment ensemble des
totalités plus complexes. Mais, quel que soit leur degré de
complexité et d’unité, les modes de 'Etendue ne se délic
vreront jamais entigrement de leur tare originelle : lo
monde matériel est un monde concurrentiel, il est le liew
de toute division et de toute opposition ; si tout n’était que
matiére, comme chez Hobbes, les individus resteraient
toujours plus ou moins séparés les uns des autres. Non
qu'il faille voir dans 'Etendue, a la maniére néo-plato-
nicienne, une quelconque dégradation de l'essence divine :
parfaite en son genre, elle exprime In puissance de Dieu
au méme titre que 1a Pensée, Mais c'est bien elle qui est
4 Ia souree du drame humain : drame de la séparation,
dont la racine ontologique, comme Vaffirmait déja tout
un courant de la Kabbale”, doit étre cherehée en Dieu
lni-méme.
2 Comme nous Vapprend M. Scholem, certains passages du
Zohar atfirment que « Ios causes fondamentales du mal sont
Hes, & Hane coy manifestations ow Sephcoty de, Dieu > (les
grands courants du mysticiome ji, p, 283) Vattribut Gu Juge-
Ment Sévtre, caractcrisé comme pouvcir de division et excl.
sion, Le mythe ‘de la « Brisure des Vases». cher Tsaxe, Luria
iia, yp. 2828) wpe et ilsize cette ldée Ia racine. de
toute séparation est en Dieu, qui doit se séparer davec Luimeme
Pour
© Eth, U, prop. 9.
Ce que la proposition 11 du livre TI dit de Tame humaine
aut pour toute idée de chose singuliére existant en acte. CE le
scolie de la proposition 13: « omula, quemvis diversis. gradibus,
animata tamen sunt,»
at
CINDIVIDUALITE ELEMENTAIRE,
dune chose singuliére existant en acte, quel va étre son
Elle ne peut exprimer que ce qui se passe actuel-
femeat, dane Te mode ft dont lie afinne Fexntence
Mais, dans le corpus simplicissimum, il ne se passe & peu
pres rien. Par nature, un tel corps n'a aucune différencia-
tion interne: il se réduit & Ia monotonie vide da mouve-
ment rectiligne uniforme. Quant aux événements qui Ta
arsivent de Textérieur et te font changer de dicection ils
le détruisent presque aussitét. Son ame ne pensera done
Hen, ou quasituent en, Nous aurons Li une sorte de psy
chisme préconscient, aveugle et sourd, un pew analogie
peutétre & la mens momentanea de Leibniz.
re lone, dlans la Pensée, Je retentissement du drame
oaths ceed
sans subir a moindre altération son propre niveau,
fmiette par ailleurs en une infinité de mentessimpli-
eissimae qui. ineonscientes, delles-mémes et duu monde,
obstingment ‘attachées & existence d'un objet qu’elles
ignorent, se combattent les unes les autres, sans meme se
connaitre, dans la auit noire de I'instinct de conservation.
a siparation, pourtant, nest pos complite. Lime da
corpus Siplenimum rest jas autre chose que idee
srt at gaan sang ce core ets! eal
TEE Wt cmt oak for Takia te
a ee ae eset etuee Je sou iat me,
fans le savoln, s'efforce done de le penser tel qui est en
2a ea eres ie ples bud mine au ven dee
individualités les plus frustes, la vie de V'Univers spiri-
inate te linnce sition ala one
Atel scree ot wc ie pense clare Tite
tend & regagner sa place dans Vidée infinie de Dieu ; par
ey oe ears
tte autys hime come Tse wai
+ Sartell enmuniqe te nt aes ees
Fe aac te pls baa wa ds Tan
ides was | EI coe pa ane bmmensenepieton
2 Biman,
© Eth. 11, prop. 12 (cf, note précédente).
SPINOZA,
En ce qui concerne les mentes simplicissimae, cette dou-
ble aspiration est évidemment vouée a Iéchec. Mais que
les corps s'organisent de facon & former ensemble des
fotalités complexes, que les Ames se différencient inté-
rieurement, et peut-tire aura-t-olle quelques chances de
se réaliser’ dans certains cas privilégics.
chapitre 3
Vunification externe : individualité complexe
et univers organisé
La Pensée, parce qu’elle est pensée de UEtendue, doit
se séparer d'avec elle-méme pour penser son objet dans
ce qu'il a de spécifique. Mais le parallélisme joue dans
les deux sens : TEtendue, parce qu'elle est Etendue pour
a Pensée, doit s'organiser intérieurement de fagon & pou-
voir étre congue par son sujet. Est intelligible toute struc-
ture unitaire susceptible de donner lieu & une définition
Gistinete. Or, jusqwa présent, nous n'avons envisagé que
deux sortes' de structures physiques: d'une part, les
corpora simplicissima, dont Ja pauvreté confine au néant ;
autre part, PUnivers total, dont Ia richesse est inépui-
sable. Mais, entre ces deux termes extrémes, \'Entende-
ment infini peut concevoir une infinité d'essences qui se
higrarchisent selon une infinité de degrés de perfection.
II faut done que ces essences s'actualisent. Comment cela?
Spinoza n’en sait rien : V'ordre des causes et des effets Tui
échappe. Mais une chose est cerlaine @ priori : les lois de
la Facies Tolius Universi, puisque elles découlent de la
proportion optimum de Mouvement et de Repos qui per-
met & tout Ie possible dle voir le jour, sont assez amples,
par définition, pour produire tous les individus qui peu-
vent figurer & quelque degré que ce soit de Véchelle de
Petre’. Aussi les corpora simplicissima, par le seul jeu
du déterminisme universel, doivent-ils s‘unir pour donner
naissance & des individus composés, qui doivent eux-
mémes s'unir pour donner naissance & des individus
encore plus composés, efc, A Vinfini, Crest 1 ce que Yon
pourrait appeler le confrat physique : résultante néces-
1 « wei [& Dieu] non defuit materia ad omnia, ex summo
niminiia ad infimum perjectionis gradurt, creanda z vel magis
Proprie loquendo, ..ipsius maturae leges adeo amplae fucrunt,
Lie Ruffcerent ad orinta, quae ab alqua infinito intelectu
possum, producenda. »' (Eth, 1, Appendice ; G, t. I, p. 8&3 P,
pp. 40940-)
37
a et
SPINOZA
saire des rapports de foree qui caractérisent I" « état de
nature » de !'Univers, comine le contrat social est la réstl
tante nécessaire des rapports de force qui earactérisent
Vétat de nature de VHumanité. Reste a savoir en qui
consiste exactement Vindividualité de chacune de ces tota-
lités complexes, et ‘comment penser leur gradation.
‘Tout individu se définit génétiquement par sa cause
prochaine. Mais celle-ci comporte deux éléments, qui sont
lun peu analogues au « genre et A la « différence > de
Ja définition traditionnelle. Dans le cas de la définition du
cercle, par exemple, il v a, dune part, Ie segment de droite
A partir daquel cette ‘figure s’édifiera ; et il y a, dautre
part, la combinaison particuliére de’ mouvement et de
Fepos qui s'applique ce segment de droite, et qwexprime
Ja formule: ¢ Dont une extrémité est fixe et Pautre
mobile. » La définition de Pindividu physique corportera
done, elle aussi, deux éléments: Tun matériel, Vautre
formel,
Lalément matériel d'un individu donné 1, ce sont les
corps Cy, Cy, Cy -. Cy, dont cet individu est composé. Ces
corps ne sont pas queleonques : il y en a un certain nom-
bre, soit n, qui ne peut augmenter ni diminuer sans que
1 lutméme soit détruit; chacun @eux a une cerlaine
nature’, qui ne peut changer sans que Tindividu dispa-
raisse. Le mot « nature », ici, ne désigne évidemment pas
ce qu'il y a de commun & tous les corps sans exception
(étendue, mouvement et repos), puisque les corps compo-
sants peuvent étre de nature différente* Mais il ne dési-
gne pas non plus Vessence singuliére du corps composant,
puisque celui-ei peut éire remplacé par un autre corps de
méme nature’. Sans doute se tapporte-t-il & quelque chose
@intermédiaire : au fait, par exemple, que C, accomplit
tun mouvement déterminé de type T (translation, rotation,
oscillation, ou toute autre forme de déplacement), C, un
mouvement déterminé de type T, ete. Peut-étre Cy. s'il
est Iui-méme complexe, sera-t-il également sujet A d'au-
tres mouvements T’,, T, ele; mais ces autres mouve-
2 Aliquot (DéSsiton aps ix proposon 18). Cf
dane if feomne daa i one Sebati, >
ve eiusdem nature dene ce mene lemme 4
{GE poste {apres te popi
5 ae
38
totidem »,
LINDIVIDALITE COMPEESE,
ments n'interviennent pas dans la définition de T: si G,
disparait pour faire place & un autre corps qui accomplit
‘T, sans accomplir 1’, et T",, individu sera conservé ‘. En
ce sens, deux corps ont méme nature lorsque leurs essen-
ces singuliéres, bien que différentes, se ressemblent assez
pour leur permettre de jouer le méme réle et doccuper 1a
méme place dans la méme fotalité 1.
L’élément formel, lui, est la structure qui donne au
composé son unité et son unieité : son unité, par opposi-
tion A un simple agréyat ; son unicité, par opposition aux
‘autres individus qui pourraient se former & partir des
mémes éléments. Comme il n'y a dans !'Etendue que du
‘mouvement et di repos, une telle structure ne peut consis-
ter qwen une certaine relation qui s‘instaure entre ces
deux termes, Mais cette relation s'exprime elle-méme de
deux fagons: en une formule simple F, et en une for-
mule développée F’.
ae Stone Fae gre pes danse ation do
Vindiyidualité telie que nous 1a donne le livre Tl de
VEthique ; mais elle est évoquée implieitement dans Te
Iemme 5 qui suit cette définition, ainsi que dans la pro-
position 39 du livre IV ; et, de toute facon, le Court Traité
ét Ia lettre 32 Ménoncent en clair. L’individu I se definit
par une proportion déterminée de mouvement et de
repos?; © Par exemple, dit Spinoza, 14 3% » Puisque
«Lemme 4 apres 1a proposition 13.
1 « Proportie van bewesinge en sile. » (CT, Tl, preface, note,
a Brora bawerngs eit,» (CM, rte, pate
hee Son" aile. s (ET, appendice, Be Fame mamaine, § 183
G21). i201 P, pL 180} ; 2 eadem ratione moras ad qitetem >
Getire 927 GU Ty, p. 1735 P, p. 1236); © mots et quietis
Setlonen (Ete Wein apy a props, 13) «nos
Tele edtio'» (Eth WV, prop, 39) Gog geux derniers textes,
£ Sef aise Sone quivogucs ils se referent au rapport de
clement et de repos que les corps composants ont entre eit
eure Insidem #);.ch pourrait dooe penser quils ne concernent
Scaife "appar: “ntse mouvement et repos © Yeshelle de Tindk
Pee Rergeat alors allasion ‘la Tonmule Fr, et-non pas &
pale F Mais st celle se ult de Tes deur
4a drutaons ne seschuent nuliement + la formute Fy de toute
nei rend en consideration que Telat ce mouvement ct
Pepos des. comps: composants les ‘urs par rapport us autres.
eaube’ cos dour textes sont ia transctiplion exacte de expres:
Som hollandaise du Court Traté, rien ne prouve que,in pensée
Sie ae eee eta ateaue on ne uve crear,
Zo erait si : ‘on ;
Sass fe Court Truite auctne altsion fla formule 1
* CH, IL, Préface, note, § 12 (G, t. I, p. 525 P, p. 100).
39
spIvoza
deux termes seulement sont en présence, il ne peut s'agir
que du rapport entre la quantité totale de mouvement ef
Ja quantité totale de repos dont cet individu est affecté,
c'est-A-dire entre Ja somme des quantités de mouvement
et Ja somme des quantités de repos de ses parties. Sim,
est la masse (ou, pour employer le langage de Spinoza,
Ja ¢ grandeur ») de C, et v, la vitesse relative de son mou-
vement T;, sim, est Ia masse de Cet », la vitesse relative
de son mouvement 'T,, ete. (le systime de référence étant
lig & 1, et non pas aux corps extérieurs par rapport aux-
quels I peut se déplacer), et si Yon admet que Ia quan
de repos est fonction de la masse’, cette formule F
pourrait done s’écrire, par exemple :
MMi + OWN... + Mave
PEM eee. +My
Ja constante K correspondant, soit & Pétat du systéme A
chaque instant, soit du moins a I'état moyen autour
duquel s’effectuent ses variations et vers lequel il revient
sans cesse. Tant que cette relation est vérifiée, Vindividu
subsiste, quelles que soient par ailleurs les’ variations
qu'il puisse subir. L'une des parties peut perdre de son
mouvement, pourvu que les autres en gagnent et que K
soit conservé : lorsque nous courons, nos muscles s’échauf-
fent pendant que notre cerveau s’engourdit ; lorsque nous
sommes ivres, c'est l'inverse ®. I peat transmettre du mou-
vement aux corps extérieurs, pourva qu'il en recoive d'un
autre été et que le rapport global se maintienne. La
_? Le question, & va dive, est délicate in,
jamals précise ge gull entendalt par ure ume de topos: Mais
ou satvons,“dime. part, que. le quan. de-mouveraent est
gale & mv, Nous savons, dautre part, que toute vitesse, eh tant
Selle est en méme temps lentenr, implique une participation
Siimultanee ‘au mouvement ct au fepes "Plus Es" core se
ipewent levtement pls is" partclre dul repos.» (Pritis
roe, 2 covalae 1). Ik manent wit pe is
perticipent du" mouvement. Sten appaie 7 la quantité de sepos
@'un comps, on aura done, sembletil : v= kK, dlohir = km.
‘A quantité de mouvement égale, les corps qu ont une ma
plus grande et tne wtesse plus petite partieipent plus da reses
&t moins du mouwvertent, car « ile offrent plus de feeistance Sux
ors de plus’ grande vifesse qui les Tencontrent et qui ont Une
force molndre'queuxemémes,"et lls sont ausst molns ‘separes
de cour qui leur sont immédiatement sontigus » (Ibid).
CT, I, chapitre xx, § 12 (G, t. I, pp. 923; P, pp. 1304).
40
LINDIVIDUALITE COMPLEXE
masse de I peut augmenter ou diminuer, pourva que les
mouvements de ses parties angmentent ou diminuent dans
Ia proportion youlue™. Mais, dés que la formule F cesse
inréversiblement de viloir, est 1a mort .. On pourrait
se demander, il est vrai, si ce point de vue du Court Traité
tt de la Lettre 32 est encore celui de PEthique : ce dernier
ouvrage, plus prudemment, ne parle plus d'un rapport
entre mouvement et repos, mais d'un rapport de mouve-
ment et de repos entre les parties de Vindividu ; ce qui
peut signifier bien des choses. Mais peu imporle pour
hnotre propos : qu'il nous suffise de savoir que les compo-
sants sont Jiés entre eux par une relation constante expri-
mable en termes de mouvement et de repos, quelle qu'elle
puisse étre.
Cette formule F est Péquivalent, au niveau de Vindivida
fini, de ce qu'est la proportion constante de Mouvement
et de Repos au niveau de VIndividu total. Tout un systéme
de lois en découle done, comme les lois de la Facies Totius
Universi découlent de la loi de conservation du rapport
Mouvement-Repos i Téchelle de la Nature: autant de
situations possibles & Tintérieur de I, autant de régles
Qe communication du mouvement. Mais il n'y a plus, ici,
tune infinité de situations possibles : non seulement les
parties sont en nombre fini, mais chacune d’elles doit
aecomplir tel mouvement particulier, dont In disparition
entrainerait celle de Vindividu lui-méme. Compte tenu de
cette limitation, par conséquent, un corps composant ne
peut transmettre son mouvement & un autre corps compo-
sant que d'une seule facon ; sinon, ow bien Tun de ces
corps perd sa ¢ nature », ou bien F cesse d’étre vérifige :
dans Tran et Pautre cas, I meurt. D’oi Ia formule déve-
Ioppée F*, qu’évoque la seconde moitié de la définition de
Vindividualité, et qui exprime ensemble des rapports
constants selon lesquels les parties de I se communiquent
mutuetlement leurs mouvements". Cette formule pourrait
indiquer, par exemple, que C, doit donner & C; une frac-
tion ky de son mouvement T;, & C; une fraction ke de ce
méme mouvement, ...que C, doit donner C; une fraction
Ky de son mouvement 'T,, * C, une fraction ky de ce méme
mouvement, ... que C, doit donner & C, ume fraction ky,
4 Eth. I, lemme § aprés 1a proposition 13,
2 GF, II, Préface, note § 14(G, t. Il, p. 525 P, p. 100).
8 Eth, TT, Définition aprés 1a proposition 13.
a
_
SPINOZA
de son mouvement Ty ele; Ky Kyo Kyu élant, bien
entendu, des invariants. Certaines de ces “eonstantes peu-
vent étre nutles : s'il en est ainsi de Kp, C; sera en repos
par rapport C, (s'il Tui est contigu). Elles peuvent méme
tre toutes nulles ; Ies parties de J. alors, seront pressées
les unes contre les autres sans pouvoir changer de place:
cas particulier. auquel correspond la premiére moitié de
la définition de lindividualité ", Tout dépend, ici, de la
formule F et de la « nature + des corps composants : si
nous connaissions Tune et T'antre, nous pourrions en
déduire F’, Inversement, la connaissance de F” et de Pélé-
ment matériel nous permettrait de retrouver F.
Une telle définition nous autorise & considérer comme
des individus toutes sortes de choses trés différentes : un
corpus simplicissimum (cas particulier ou ), un tour=
billon cartésien, le systéme solaire, la Terre, un. cycléne,
tune pierre, un organise biologiqte, etc. Elle s'applique
également & Univers total : F, 3 ce niveau, est le Mouve-
ment-Repos et F? la Facies Totits Universi. Elle vaut
aussi, entre autres, pour les sociéiés politiques : F, dans
ce eas, désigne Ia forme de In souseraineté (prédominance
du repos sur le mouvement en ‘Théocratie, prédominance
du mouvement dans les Etats libéraux) of F” le systéme
institutionnel qui en découle, Certes, jusqu’a nouvel ordre,
nous sommes bien incapables de comprendre de cette
facon quelque individu que ce soit. Mais du moins possé-
dons-nous la régle qui doit nous permettre de définir géné-
tiquement n'importe quel mode de VEtendue. Et cette
ragle, rien ne nous empéche de Ia faire jouer a plusieurs
niveaux @abstraction. La définition de Vindividualité en
général correspond au niveau le plus élevé: elle nous
apprend simplement qu'il y @ un élément matériel, une
formule F et une formule F’. En précisant un peu’ plus,
nous obtenons Yallure générale des formules F et F* pour
tel ou tel type de réalité: pour Phomme, ou pour I'Etat
aristocratique, par exemple ; mais nous ne pouvons encore
les déterminer quantitativement, En droit, pourtant, il
doit étre possible de préciser toujours davantage,
moment oit nous atteindrons Vessexce de tel indi
gulier : les formules F et F” de Yoomme Spinoza, ou de
Etat aristocratique hollandais. Alors, en ce qui concerne
Vessence en question, 1a connaissance du troisieme genre
sera achevée.
4 wid.
a2
AINDIVIDUALITE COMPLESE.
En attendant, nous savons au moins une chose. Tout
individa physique est un systéme de mouvements et de
repos qui, abstraction faite des perturbations d'origine
externe, fonetionne en cycle fermé : un systéme dont le
fonctionmement a pour résultat la reproduction de ce
méme systéme. Lorsque tous les corps Cy Cy .. C, se sont
communiqué leurs mouvements selon les rapports Ky
Kk ils se trouvent finalement dans une situation qui
ies Gétermine & se re-communiquer leurs mouvements
selon les mémes rapports; c’est pour cela, et pour cela
seulement, qu'ils forment ensemble un individa véritable,
et non pas un agrégat bs, On voit ainsi comment Ia
structure singuliére T peut étre concue indépendamment
des autres structures singuliéres, méme si elle ne peut
svactualiser sans leur concours. Si le systéme de rapports
qui Ia définit consistait en un enchainement linéaire, de
type A, B, C.., nous ne réussirions & la comprendre qu’en.
la rattachant, de proche en proche, & Ia série infinie des
causes; mais il s'agit d'un enchainement circulaire, de
type A, B, ..A. Il est bien vrai qu'un individu fini ne
saurait exister sans que le milieu extérieur s'y préte : il
faut que ce milieu agisse sur ses parties pour les dispo-
ser A se transmettre leurs mouvements selon les for-
mutes F et F', Mais, du fait méme quiil constitue une
totalité fermée sur soi, son essence, elle, n'implique aucune
séférence & Venvironnement. Et Von voit, du méme coup,
comment la doctrine du conatus s‘applique aux, modes
de VEtendue : le conatus n'est rien d’autre que essence
actuelle de individu, puisque cette essence est telle que,
lorsqu’elle existe hie ‘et nunc, elle produit des mouve-
ments qui ont pour effet de la maintenir dans 'existence
et 'y maintiendraient indéfiniment si aucune cause exté-
rieure ne venait s'y opposer.
Mais il y a es causes extérieures. Un corps singulier T
n’existe que dans la mesure ot son environnement Ie sou-
Mis CE. sur ce point S. Hampshire, Spinoza, ch. 1 p. 71. Cf.
aussi la formule Alain : « Le corps nist ries de pls que Yen.
femble' des mouvements par Tesques Ilse conserve », Spinozs,
PB
15 Dou expression « a
tion aprés Ta proposition 13).
\ Evh, MIL, prop. 7.
ita cofroentur » (Eth, UL, Défink-
“3
SPINOZA
tient. Or cet environnement change sans cesse : de favo-
rable, il devient défavorable ; aprés avoir permig au
conatus de I de se déployer, il finit toujours par lui faire
obstacle un jour ou autre. Cela signifie-t-il que le moin-
dre changement dans organisation du milieu suffise &
anéantir individu? Non, bien entendu. Pourvu que la
structure reste intaete, ses éléments peuvent fort bien
atre sujets & un ‘certain nombre de variations. Celles-ci
sont de quatre sortes. Régénération, en premier View : si I
perd sa partie C, par exemple, et si C, est aussitdt rem-
placé par un autre corps de méme nature, capable d'accom-
plir exactement le méme mouvement ‘I, 1 subsisiera tel
quel”. Croissance et décroissance, en second liew : si les
parties de T deviennent plus grandes ou plus petites, mais
de fagon & conserver le méme rapport de mouvement et
de repos qu’auparavant, I restera ce qu'il est; sa masse
totale augmentera ou diminuera, mais, comme sa quantité
de mouvement augmentera ou diminuera dans la méme
proportion, sa formule F sera toujours vérifiée. Variations
internes, en troisiéme lien : les parties Cy, Cy .. Cy pet
vent étre déterminges & changer la direction, ou ‘méme
(® partir d'un certain degré de complexité) Ta vitesse*,
de leurs mouvements T, T, .. 7,3 pourva qu’elles puis-
sent continuer leurs mouvements’et se les communiquer
selon la formule F*, T conservera son essence. Variations
externes, enfin: que I se déplacs globalement ou qu'il
este en repos par rapport aux corps extérienrs, qu'il se
déplace dans telle direction on dans telle autre, il demeu-
rera inchangé si ce qui se passe en Ini reste conforme &
sa formule F'2. L'individu, sans cesser d’étre lui-méme,
peut done passer par plusieurs stats, c'est-A-dire étre
affecté de plusieurs facons®. Arpelons done affections
ces multiples états d'une méme essence ®.
‘A Vanalyse, toutefois, cette notion daffection se dédou-
2 Buh TL, lemme 4 aprds Ja proposition 13,
™ ih. TE, lemme § apres In proposition 13,
Bik. TL, lemme 6 apres Ia proposition
2» Eth. TL, lemme 7 aprés In propostion 13, scoie.
2 Eth, TI, lemme 7 apres Ia proposition 1
2 Ibid, sealie.
3 « ..per affectionem humanae essentiae umcumque ejus-
a ial tn eres ee aon et
ms ds sentiments, dehaiton iy exflicaton ; 6, I,'p. 190s
Pp. 588) e ore
44
LINDIVIDUALITE COMPLEXE.
ble. ly a, d'une patt, les affections que Vindividu regoit
du dehors : Ie miliew environnant, en agissant sur ‘Cy
peut le mettre dans des états P, P', P'i; em agissant
sur C,, il peut le mettre dans des étals Py P'y P”y etc.
Ces états ne s‘expliquent pas par la seule nature de I,
mais par la conjonction de cette nature et de celle de
Todjet qui Vaifecte*. En ce sens, ils sont passifs ®.
Mais il y a d’autre part, les affections par lesquelles
Yindividu réagit & ces diverses excitations. Lorsque Cy
est mis dans un état P,, il doit, par hypothtse, commu-
niquer son mouvement 'T; & C, selon le rapport Kp; ce
qui a pour effet de meltre C dans un état a; Puis C, en
communiquant son mouvement & C, selon le rapport Kr
met C; dans un état a, etc. Au cours de ce processus, ou
2 son terme, des échanges se produisent peut-étre entre I
et le monde oxtérieur : une certaine quantité de mouve-
ment est perdue par 1, compensant ainsi l'augmentation
due & P; ou bien, au contraire, une certaine quantité de
mouvement est acquise par I, compensant ainsi la perte
due 4 P,; de toute facon, ces échanges ont pour résultat
#lobal de conserver en I ia proportion de mouvement et
de repos que définit la formule F. Appelons A, cet enchal-
hement a, — a; ... @, -— d, et M, la modification qu'il fait
subir au milieu externe, De méme, appelons A; V'enchaine-
ment by — by... b, — b que déclenche C; lorsqu’il est mis
dans état P, et'M, Ia modification qui en résulte pour
les choses siluées hors de.1; A’ lenchainement a’; —
a's .. @’y — ay que déclenche C lorsqu’il subit affection
P}, ef Mt Ia transformation correspondante de Venviron-
nement, ele. Chacune de ces réponses Ay Ay = A’y A’2,
considérée en elle-méme, abstraction faite de Vaffection
passive qui loccasionne, se congoit par la seule nature de
T: connaissant Vessence de I, on peut en déduire que « si
a, alors ay, alors a ... », done que I est capable d'exécuter
Vensemble de mouvements A,, ete. Et tout ce qui, dans
Jes transformations M, Ms = My M’y . vient de Ay
Ay Aly A’gon tout cela s'explique également par la seule
nalure de I! connaissant essence de 1, on peut en déduire
¥ Evh. IL, axiome 1 qui suit le lemme 3 aprés la proposition 13.
% Eth, Ul, définition 2.
2 Cf, action de frapper : « Verberandi actio, quatenus, ph
sice ‘consideratur, et ad Hoc tantum attendimaus, quod homo
bracchium tollit, ‘manum elandit, totumque bracchium vi deor-
‘sum mover, virlus est, quae ex Corporis humani fabricd conct-
pitur. » Eth, IV, prop. 58, scolie.
45
SPINOZA
‘que cet individu est capable d'affecter les objets extérieurs
de telle ow telle fagon déterminée. Ces réponses sont done
des actions, au sens spinoziste du terme”: I est cause
entiére, ou adéquate, de leur mécanisme interne. Modalités
du conatus de I, elles sont un peu a F et & F" ce que les
corps finis sont au Mouvement-Repos et & la Facies Totius
Universi.
Liindividu, dans ces conditions, ne supportera une varia-
tion passive que s'il est # méme de Ini riposter par une
action compensatrice, Si I est apte & action Ay qui cor-
rige Ia perturbation P,, celle-ci ne le détruira pas ; mais
P; sera mortelle si le processus qu'elle déclenche a pour
résultat d'instaurer entre C,, Cy . Cy un rapport de mou-
vernent et de repos qui ne vérifle plus Ta formule F. Plus
nombreuses sont les actions que I peut exéeuter, par
conséquent, plus nombreuses sont les modifications qu'il
peut subir’: puissance d’agir et puissance de patir vont
de pair%. Or cette capacité d’adaptation mesure trés
exactement les chances de survie de Vindividu; plus
celui-ei a de circuits auto-régulateurs, moins les varia-
tions de environnement Ie mettent en danger, plus il a
de force pour persévérer dans son étre. Nous pouvons
done poser Ia double égalité suivante : efficacité du
conatus = < puissance d'agir >” = « aptitude a affecter
les corps extérieurs et étre affecté par eux de plusieurs
facons »™, ou « aptitude & étre disposé de plusieurs
fagons >, ou ¢ aptitude & beaucoup de choses >".
‘Mais il y a adaptation et adaptation. Car, si les actions
de I, prises en elle-mémes, se comprennent par sa seule
2 ct, Bik. I, aésnition 2.
% GE, Eth I, prop. 13, sclie : « Quo Corpus atiquod reliqis
aptit E EieP cis duet Oo satan
«potenti, sive conatus » (Eth. HT, prop. 7, démonstra
tion) poten “seu “Comat in suo” Ease perseverand >
(itu pele SH demonstration; = agendl portion. hoe et
tga or Ptajas cmatas » CR ro. done
we 1d, quod Corpus humanm ita disprit, ut pluribus modis
possi afl vel od idem aptune teed corpora externa
Fan iis Ibn Cues
prop $8)" ok Spingra‘sonctut que Ia. joie est
tcng, pulsque, par elle, I's agendl potontia » du coms Sot 9a
mentée-ov favonise (Eth, ive oe desnonstration), ka pale
Eaace dale cot dons tiem identgue’Asette, double. aptitude
Snr pase ln proneiion 3 Daytime, dang demontrton
Seba" proposition ss du livre 1V."Sinoradéclace. que la joie
Sroesse eat mtuvaise « guaterns mpedit uo mnus ‘homo
46
LUNDIVIDUALITE COMPLEXE,
nature, il n’en va pas toujours ainsi de leur déclenche-
ment hie ef nune. Sachant ce qu’est 1, nous savons, par
exemple, quil peut aceomplir A; quand Yaccom-
plit-il effectivement ? Par quoi est-il déterminé a Vexé
cuter & tel moment plutt qu’é tel autre ? Deux cas, ici,
peuvent se présenter.
Le plus souvent, 1 est déterminé & accomplir A) par
tune affection passive : P,, par exemple. Son comporte-
ment, alors, c'est-a-dire Vensemble formé par Vexcitation
ot Ia réponse, est un comportement passif : puisque I n'est
pas la cause entidre de P,, il n’est pas non plus la cause
entire de ce qu'il fait sous Pinfluence de cette derniére ® ;
a conduite P,A, s’explique, non par les seules lois que
définit la formule F°, mais par la conjonetion de ces lois
et dun déterminisme extérieur. Allons plus loin: si, a
Vinstant suivant, I subit une nouvelle affection passive
Py, il lui répondra par Paction A’,; et, comme P's n'est
pas la suite nécessaire de Py. Ay’ me sera pas non plus la
suite nécessaire de A,. Peut-étre, alors, Ia transformation
Mf, annulera-L-elle la transformation M, ; en tout eas, elles
ne se prolongeront pas Tune Vautre: loin de former
ensemble une méme «uvre, elles se juxtaposeront comme
deux ébauches sans lendemain. Ainsi l'individu se pliera-t-
i aux exigences de son milieu: il s’adaptera, mais de
facon désordonnée et chaotique, selon le hasard des ren-
contres ; il survivra, mais au jour le jour.
En droit, pourtant, une autre forme d’auto-régulation
est possible. Toute action, en effet, est en méme temps
tune affection (ou un ensemble d’aifections) et doit, par
conséquent, déclencher une autre action. L’action A, du
seul fait que 1 Pexécute, met I dans un état oi ill ne se
z
ad agendum sit optus » ; et cette démonstration renvoie ® la
ition 43 du méme livre, dont la démonstration emplole
Fepreason = uo minus corps ptm sl uh prt. mods
afficiatur >. i
Meee e=. Corpus pluribus modis disponi potest. »
Gein Th prog 1) Le demonstration. ce Ta Propsition 11 da
live III identite:cotte aptitude a la puissance dagir.
Bee ad plurima opium » (2th, V, prop, 39), La, démonstree
tion ‘de"gett® proposition emploie «ad plurima agenda apturs >
ECirenvoie a 1a, proposition 48 du livre 1V. (ct. supra, note 30).
‘SFC oan exemple, ia, demonstration de 1a proposition 25 a
livre IV" « Qualenius homo ad agendam determinatur ex #0,
upd iuadacquates hhabet ideas, eatenus patitur, hoo, est, aliquid
fitt, quod per solar cjus essentiam non potest percipl. >
“ir Sagit bien due ection, mais le déclenchement ici et
maintenant de cette action est une passion.
a7
SPINOZA,
trouvait pas auparavant ; elle peut aussi le modifier
indirectement, en produisant dans le monde extérieur la
transformation M, qui, 4 son tour, retentit sur 1; dans
Pun et Pautre cas, cette variation détermine I & accomplir,
r exemple, action Ay Puis celle-ci, directement ou par
Yintermédiaire de la modifieation M; qu'elle apporte &
Fenvironnement, détermine 1 & accomplir Vaction A, ete.
Si rien ne venait entraver le processus, toute passivité
disparaitrait ; le comportement de lindividu, tout au long
de son existence, s'expliquerait par les seules lois de sa
nature : connaissant la formule F", on en déduirait que T
doit enchainer ses actions dans un ordre rigoureux, qui
serait a F” ce que la série infinie des causes et des effets
est & la Facies Totius Universi. Soit, par exemple :
Ay IM] <> As (hd
Ag—> (Mg) > Ai —> (Ml > A>
De celte fagon, nous obtiendrions ce que Von pourrai
appeler Péquation corporelle de V'individu : elle nous ind
querait, de proche en proche, état de mouvement et de
repos de chacune des parties de I en fonction de l'état de
mouvement et de repos des parties immédiatement. conti-
gués ; ce qui nous permettrait de prévoir 'évolution du
systéme au cours du temps. Si ceite équation se trouvait
toujours vérifiée, le genre d'adaptation ainsi réalisé serait
évidemment bien supérieur. Chaque action, suite logique
de la précédente, préparerait logiquement les suivantes, si
lointaines que puissent étre celles-ci ; Vactivité de 1, qui
ne dépendrait en rien des avatars ‘de environnement,
serait systématique et cohérente : sans déviations ni per-
turbations, sans + essais > ni « erreurs », elle apparaitrait
comme la réalisation méthodique d'un seul et méme pro-
jet fondamental. Et les transformations My My ..M’y
M... traduiraient hors de I cette ordonnance : au Tien de
vannuler les unes les autres ou de se juxtaposer les unes
aux autres, elles s'enchaineraient si bien qu'elles se
commanderaient mutuellement ; M;, tendue possible par
M,, eréerait les conditions de M,, ete., et le monde exté-
jeur, peu & pen, s’organiserait selon les exigences de I.
Liindividu, alors, fonctionnerait & plein rendement, pro-
Guisant le maximum deffels avee le minimum de dépenses.
Il fonetionnerait, si Yon veut, & son niveau d'actualisation
optimum.
En réalité, bien entendu, il en est trés rarement ainsi,
A peine A; s'ébauche-telle qu'une cause extérieure =
vient aussitét linfléchir ; I, alors, ne se trouve plug dans
48
LIINDIVIDUALITE COMPLEXE,
Vétat A, mais, par exemple, dans Pétat P, : affection pas-
sive, qui s'explique par la conjonetion de A, et de x. D’ot,
au lieu de action A, action Ay, Puis, celle-ci, & son tour,
fest infléchie par une cause extérieure y, qui la transforme
fen une affection passive P',; doi, an lieu de Vaction Ay
action Ay, ele. Ce qui nous donne un enchainement irré-
gulier du type suivant :
A
JOP Oh em
ay)
>:
Un individu fini n'est done jamais entiérement conforme
& son équation corporelle : il ne Ia vérifie qu’en certains
points nodaux, ceux-li mémes oi ses parties se commu-
Riquent mutuellement leurs mouvernents (les points oft
C, agit sur Cy oi Cy agit sur Cy ete.) ; pour le reste, il
sen écarte plus ou moins. Mais il y a, pour chaque essence
singuliére, un niveau d’actualisation optimum : celui qui
serait Ie sien si toutes les modalités de son déploiement
dans la durée s'expliquaient par sa seule formule F". Dans
Je cas du corpus simplicissimum, nous savons en quot
consiste cette voie royale : c'est le mouvement rectiligne,
parce qu'il est le plus simple possible. Dans le cas des
‘corps composés, nous ignorons ce qu'elle peut étre ; mais
rien ne nous empéche, en droit, de la découvrir : il suffi-
rait de connaitre F, et d'en déduire ce que doit faire T
pour que tout se passe, en lui, de la fagon logiquement 1a
plus simple. Or ce niveau optimum est celui auquel, toutes
choses égales d'ailleurs, individu tend & fonctionner :
s'il n'y réussil pas, est dans la seule mesure oit les causes
extérieures Yen empéchent, olt son conalus est déformé
et mulilé par l'environnement. Plus I s’en rapproche, plus
Ie déclenchement de ses actions se déduit de sa structure
interne, moins les autres corps contribuent & déterminer
son comportement effectif %, mieux il actualise et réactua-
lise son essence; plus il s’en rapprockhe, plus il agit, moins
i pitit; plus il s'en rapproche, par conséquent, plus il a
de force pour persévérer dans son étre. Aussi pouvons-nous
poser Ia double égalité suivante : efficacité du conatus =
Principia, 1; prop. 15, seolie (G, t 1, p. 203; P, p. 21).
3 « ..quo unis corporis actiones magis ab igso solo pendent,
et quo iainus alia corpora cam coder in dgendo cOncurrut. >
Eth. pop. 13 scale)
49
SPINOZA
Duissance d'agir = aptitude de Tindividu @ faire ce qui
découle des seules lois de sa nature *,
La puissance @agir d’un individu, an premier abord,
semble done étre fonction de deux facteurs: d'une part,
Ie plus ou moins grand nombre de variations que cet indi-
vidu peut supporter ; autre part, la plus ou moins
grande autonomie de sa conduite, Mais s'agit-il vraiment
de deux variables indépendantes? Peut-on concevoir un
individu qui, tout en étant apte a trés peu de choses, soit
‘en méme temps eapable d’agit selon ses seules lois? Non,
sans aucun doute. Supposons, en effet, que I ne puisse
subir qwune seule affection passive A la fois; dans ce
cas, Vordre de ses actions sera rigidement déterminé par
les hasards de Ia conjoncture : action A; succédera la
conduite P,A,, puis la conduite P’,4’,... et ren ne viendra
briser cet enchainement. Tel est le sort du corpus simpli-
cissimum qui, malgré son aveugle obstination, n'arrivera
jamais & se déplacer en ligne droite. Mais, si { peut subir
un grand nombre de modifications simultances ®, les choses
‘se passeront tout autrement. Dans la partie Cy. par exem-
ple, le segment a, de Paction A, sera transformé en une
affection passive P, par la cause extérieure x); au méme
moment, dans la partie C,, le segment a, de cette méme
action A, sera transformé en une alfection passive Py par
Ia cause extérieure x, ete. Or, si ces affections passives
sont trés nombreuses, peutétre se neutraliseront-elles
mutuellement : it n'est pas fatal qu’elles soient toutes
crientée dans le méme sens. Alors émergera leur dénomi-
nateur commun : action A, elle-méme, qui, & travers ces
multiples déviations contradictoires, s'accomplira jusqu’an
bout et déclenchera, malgré tout, Taction A, Puis celle-ci,
4 son tour, selon le méme mécanisme compensatoire,
réussira & déclencher action Ay etc. Finalement, la voie
royale sera suivie. Les deux facteurs sont done liés : plus
un individu est aple & étre modifé de plusieurs fagons &
Ja fois, plus il est apte & faire ce qui se déduit des seules
Em, WV, ‘99, démonstration
Er Spincea dé
ane agendi potentisnn (Ibid.
livre Vet sa" demonstration.
1a DioJe mot simul dans Vexpression gue nous citons dans
gue Ia tristesse diminue
E aussi 18. proposition 20 du
60
LIINDIVIDUALITE COMPLEXE
fois de sa mature; variabilité et indépendance vont de
pair. Il reste vrai que, pour les modes finis, 1a puissance
Gagir augmente avec la puissance de patir; mais il est
vrai aussi que, plus s'acerott cette double puissance, plus
Pagir tend & Pemporter sur le patir.
Mais pourquoi certains étres ont-ils une plus grande
marge de variabilité que certains autres? Cela vient, pour
une bonne part tout au moins, de leur degré de composi-
tion. Si T est composé de trois corps simples, il ne pourra
tre affecté que de trois facons & la fois; si chacune de
ses trois parties est elle-méme composée de trois corps
simpies, il pourra étre affecté de neuf facons a la fois, ete.
Comment se présente done cet emboitement des individus?
Le corpus simplicissimum, en un sens, vérifie déja Ia
définition de Vindividualité. Le nombre de ses parties est
égal a J. La « nature » de cet élément unique coincide
my
avec la formule F, qui exprime simplement le rapport —,
m
c’est-A-dire Ia vitesse du corpuscule. La formule F°, elle,
‘se confond avec le principe d'inertie appliqué au cas par-
ticulier de ce corpuscule. Quant aux variations possibles,
celles sont évidemment fort peu nombrenses : croissance
fon décroissance, puisque 1a masse n'intervient pas dans
Ja définition du corps simple; quelques variations exter-
nes, puisque le corps simple peut changer de direction s'il
garde la méme vitesse ; mais la marge est tris étroite, car
Tes cas de changement de direction sans accélération ni
ralentissement sont, malgré tout, exceptionnels. Par
contre, absence de parties multiples ne permet ni régé-
nération ni variations internes.
Dans le corps complexe de degré 1, composé de corpora
simplicissima, ia « nature > des éléments se définit par
leur vitesse relative : c'est en cela, et en cela seulement,
quiils se distinguent les uns des autres. La formule F peut
oxptimer m'importe quelle proportion eoncevable de mou-
% La corrélation est manifeste dans 1a démonstration de Ia
proposition 59 du livre TV, Aprés avoir dit que la tristesse est
Tnatvaise en tant quelle diminue, cette puissance dagir qui
‘onsiste a pouvoir falze ce qui se déduit des seules lois de notre
nature (cf. note 36), Spinoza renvoie & la proposition 41, dont la
Cemonstration renvole eliememe & ta double aptitude que défi-
fit Ia proposition 38 (ef. supra, note 30).
Bt
SPINOZA
vement et de repos ; ce qui nous donne une infinité d’indi-
vidus, que nous pouvons répartir grossiérement en trois
classes ! corps durs si le repos Pemporte de beaucoup sur
Ie mouvement, corps fluides si le mouvement l'emporte
de beaucoup sur Ie repos, corps mous entre les deux®
La marge de variabilité, tout en étant plus grands que
celle du corpus simplicissimum, reste encore assez étroite.
Lindividu de degré 1 peut toujours croitre ou décroitre ®.
Il peut, en outre, perdre I'une de ses parties, si celle-ci
se trouve remplacée par une aulre de méme nature,
Cest-i-dire de méme vitesse; mais, en toute rigueur, ce
ne sera pas vraiment une attire partie, puisque la vitesse
du corps simple se confond avec son essence individuelle +
ce sera la méme, en quelque sorte ressuscitée. Quelques
Variations inlernes deviennent possibles, qui sont les
variations externes des éléments : les corps composants
peuvent changer la direction de lears mouvements si cela
n'invalide pas la formule F°®; mais non pas encore leur
vitesse, car ils perdraient alors leur « nature ». Enfin, un
plus grand nombre de variations externes sont accep-
tables : en se déplacant globalement par rapport au monde
extérieur, Tindividu peut changer, non seulement de
direction, mais aussi de vitesse % puisque celle-ci n’ap-
partient plus & son essence; aceélération et ralentisse-
ment, toutefois, dang la mesure oi ils risquent de modi-
fier les vitesses relatives des parties, ne doivent pas
dépasser certaines limites
Dans Ie corps complexe de degré 2, composé de corps
complexes de degré 1, Ja « nature » des éléments ne se
confond plus avec leur essence individuelle : que telle
partie devienne un peu plus dure ou un peu plus fluide,
cola n'affecte pas nécessairement le type de mouvernent
quelle accomplit. La formule F, & nouveau, peut exprimer
n'importe quelle proportion de mouvement et de repos ;
ce qui, & nouveau, nous donne une infinité d'individus.
Quant’ & Ja marge de variabilité, elle doit évidemment
s'élargir. Un corps composant peut étre remplaeé par un
autre, dont la proportion interne de mouvement et de
» Eth, 11, axiome 3 apres Ia propesition 13.
© Eth, I, lemme 5 apres la propesition 13.
4 Eth, IT, lemme 4 apres la propcsition 13,
© Exh. M1, lemme 6 apres Ia propesition 13.
© Eth, I, lemme 7 aprés la propcsition 13.
repos est différente, pourvu que cette différence laisse
intacte Ia formule F. L’individu supporte également un
plus grand nombre de variations internes ; ses parties,
puisque elles sont elles-mémes de degré 1, peuvent chan-
get, non seulement de direction, mais aussi de vitesse;
i suffit que la formule F” reste valable. Par la-méme, un
plus grand nombre de variations externes sont possible:
peu importe, cette fois, si elles modifient 1a vitesse rela-
tive des éléments; il faut seulement que F" demeure.
Cette récurrence nous donne done le moyen de conce-
voir une infinité de degrés de complexité. D’une fagon
générale, un corps de degré n est composé d'un certain
nombre de corps de degré nx — 7, dont la ¢ nature >, qui
ne s'identifie pas obligatoirement & leur essence, se définit
par leur aptitude a exercer telle fonetion déterminge au
sein du tout, Tant que n reste fini, ily a toujours une
infinité de formules F possibles.:, nous retrouvons, &
chaque niveau, toutes les proportions concevables de mou-
vement et de repos ; seules changent, d’un niveau Pautre,
les formules F*, qui deviennent de plus en plus riches &
mesure que ’on s'éléve dans échelle des étres. Enfin, le
nombre de variations externes qu’tin individu fini peut sup-
porter est & Ja fois supérieur et proportionnel aa nombre
de variations internes qu'il peut subir, et celui-ci dépend
du nombre de variations externes dont peuvent s’accom-
moder ses composants : si, par exemple, un individu de
degré n—1 est apte & p variations internes et & kp varia-
tions externes (k étant plus grand que 1), Vindividu de
degré n sera apte & kp variations internes et & Kp varia~
tions externes, celai de degré n-+1 & Kép variations inter-
nes et & Alp variations externes, ete,, & infini.
‘A la limite, P'Univers total apparait ainsi comme Vindi-
vidu supréme, celui dont le degré de eomplexité est infini ®,
II n'est évidemment pas composé de corps complexes de
degré cof, ce qui n’aurait aucun sens: par rapport &
Vinfini, tous les degrés finis sont équivalents. Ses parties,
ce sont done fous les corps sans exception, quel que soit
leur degré de composition; et leur nature est simplement
@étre des corps, c'est-dire des combinaisons de mouve-
ment et de repos dans I'Etendue. Sa formule F, alors,
exprime la proportion de Mouvement et de Repos qui
4 Eth, HL, scolie du lemme 7 aprés la proposition 13.
© Ibid,
“ Wid.
SPINOZA
demeure éternellement constante a "échelle de la Nature ®:
Sa formule F* correspond au systéme éternel des lois de
communication du mouvement qui se déduisent de cette
proportion, compte tenu de toutes Jes situations possibles;
et, comme il y a une infinité de situations possibles, il y
‘a aussi_ume infinité de lois : la richesse de Vimmuable
Facies Totius Universi ® est infinie. Cet Individu total,
nayant pas de contexte, ne eroit ni ne déeroit, ne se régé-
nére pas, et ne peut subir aucune variation externe ; par
contre, il est sujet & une infinité de variations internes ®
Vexposant de k, ici, est infini. Et toutes ces variations,
bien entendu, se déduisent de sa seule nature, puisque
rien nlagit sur lui du dehors : il est uniquement actif,
sans aucune trace de passivité: son ¢ équation corpo-
relle > est vérifige @ chaque instant et en tous points ®.
Cet emboitement des individus & V'infini nous permet
@unifier sous un méme concept tout ce que Von entend
habituellement par ¢ loi >: lois de la Nature physique,
lois biologiques qui caractérisent tel ou tel organisme dit
féreneié, lois juridiques qui régissent cette forme parti-
culire ‘@individualité qu’est Ia société politique, lois,
« morales > propres & Vindividu humain et & la commu-
nauté humaine dans son ensemble, ete. Une loi, au pre-
mier abord, se présente comme un universel abstrait :
comme une maniére d’agir commune a tous les individus,
fou a plusieurs individus de méme espéce*; la simple
Raison en resle la. Mais ce point de vue, bien que légitime,
n’en demeure pas moins superficiel : pour Ia connaissance
du troisiéme genre, il n’y a de loi quindividuelle. Certes,
4 « ..servatd semper in omnibus [corporibus] simul, hoe est,
in t010"universo eddem ratione motus ad guietem. »
(Cotre 325°, GIN, pp. 1837 ©, p. 12)
Cf, Jetre 64 (G, t. IV, p. 278; P, p. 1319).
@ Ibid, et Eth, I, soolie du lemme 7 aprés Ja proposition 13.
ct, asa? i etre SEO sissbaae i
“Et quoniam natura universi non est, ut matura sanguinis,
timitata sed absotute tatinita, ideo" ab fie. tnfinttae ‘polenta
ature, jus pares. infnis odio ‘moderantar, et “nfintas
Varlationes pote coguntur, »
(Geni, pe t7s B, p 1235)
% Dob Vexpression « ab fae infinitce potentiae natura » dans
le texte que cite a aote précédente.
Ne Legis nomen absolute sumptum significa id, secundum
quod wuimquodgue indvvidvaem, vel crmnia’ vel aliquot ejusdem
Spectet wena, cademque.certa ac’ determinata ratione agunt. »
(PEP, ch. Ws Gt Mit, p. 51: B, pT)
64
VINDIVIDUALITE COMPLEXE
ii est bien vrai que, dans individu les parties Cy Co
vw Cy ont des propriéiés communes : pour quielles pul
Sent former ensemble un méme tout, pour que leurs cona~
tus puissent se conjuguer dans la production d'un méme
résultat, il faut que leurs natures respectives s'accordent
Togiquement les tines aux autres. TI est bien vrai, égale-
ment que, chaque fois qu'une partie de nature C, commu-
nique son mouvement & une partie de nature C,, elle le
Ini communique selon le rapport Kp; et que, par consé-
quent, chaque fois que C, se trouve dans Tétat a, i doit
mettre C; dans Pélat ay ete. Un ver intelligent qui vivrait
dans le sang humain ne dépasserait pas cette vision des
choses : observant la facon dont les particules se transmet~
tent leurs mouvements, il en dégagerait tant bien que mal
quelques relations constantes®. Mais ce qu'il ne saurait
pas, est que ces relations constantes découlent elles~
mémes de 1a nature globale du tout, En réalité, chaque
individu a sa loi fondamentale : sa formule F, qui, jointe
Ae son élément matériel, définit son essence singuliére; et
@est de cette définition que se déduisent les lois par-
tielles (caractérisées par les constantes Ky Ky ete.) qui,
secondairement et pour qui n’en posséde pas la clef, peu-
vent apparaitre comme des universaux. Les rapports
stables ne sont que les conséquenees de V'appartenance de
ears supports A une seule et méme structure : ce qui est
© Cf. Hexemple du sang et de ses parties : .
‘< Cam motus particularum Iymphac, chyli, etc, invicem pro
ratione magnitudins, et figurae ita sé accommodant, ut plane
Inter se ‘consentiant, umumque fluidum simul omnes constituent,
Gates tanta chs, pp fey pares sarge const
ferantur. =
‘(hettre 32 5 G, t. 1, p. 171; P, p. 1235)
5 « Fingamus jam, si placet vermiculum in sanguine vivere
qui ‘visu ad discernendas particulas sanguinis, iymphae, etc.,
Qateret, et ratione ad observandum, quomodo unaquaeque’ parti.
tala ce alterius dccursu, vel resilit, vel partem sul motus
Communica, etc. » bid.)
3 « nec scire poset, quomodo partes omnes ab universali
natura” sanguints ‘moderantur, et ‘invicem, prowt sniversalis
atura Sariguinis exigit, se accommodare ‘coguntur, ut ceria
atione inter se consentiant, » (Ibid.)
B« Lex, quae a necessitate, naturae dependet, ifla est, quae
es ipsa veh Futura. sive definitione necessario sequitur. »
alae av 6, «Mit. 313 8p. 122) Spinor, ‘aussiot
anita, semble Wire Gus les’ lois juriaignes, qi, dependent. de la
Bionié Humaine, copstiteent un cas & part’ Mais i precise un
dou plas loin quid men est tien, puisque 1a volonté humaine, en
Rginitne, est ellomeme une forme particulisre de névessité
55
SPINOZA
universel abstrait au niveau des parties est_universel
coneret au nivean du tout. Les ¢ lois de Ia Nature », celles
qui régissent tous les corps sans exception, ne font elles-
memes que manifester Tessence singulitre de Vindiidu
total.
Mais la réciproque est aussi vraie. Si Vappartenance de
plusieurs individus de degré x & un méme individu de
degré n -} 1 leur confére des propriétés communes, inver-
sement, lorsque plusieurs individus de degré n ont des
propriétés commanes (non seulement celles qui caracté~
Tisent tous les modes de V’Etendue, mais d’autres encore,
plus particuligres), ils peuvent s'unir en un méme indi-
vidu de degré n -- 7: ils forment ensemble une totalité
coneréte, soit déja réelle, soit du moins virtuelle. Or
toutes les virtualités ne finissent-elles pas par se réaliser?
Du seul fait, par exemple, qu’il y a similitude de nature
entre les hommes, 1a communauté humaine ne tend-elle
pas & exister? Et, par conséquent, ne doit-elle pas néces-
sairement exister un jour ou Vautre?
Quoi qu'il en soit, une loi générale n'est valable qu’
Vintérieur de la totalité singuliére qu'elle exprime, et dans
Ia soule mesure oit cette totalité domine effectivement ses
éléments. Si T est détruit, les lois exprimées par Ia formule
F* cessent aussitot de s'appliquer. Méme si I n'est pas
détruit, elles ne commandent jamsis entiérement ce qui
se passe en Ini: elles entrent en concurrence avec un
autre déterminisme, qui agit sur I de Textérieur, et qui,
en infléchissant leur cours, fait souvent obstacle A leur
actualisation hic ef nunc; aussi ne permettent-elles pas,
a elles seules, de prédire A coup sir le comportement de
1. Seules sont inviolables les lois de Ia Nature totale,
naturelle (bid; G, t, TH, p. 58, liencs 685 P, pp. 7223), En
Peal, is Toto’ jutidiques ont des “consequences” nécessaires,
Soit (dans Jes" Etats. ten. agencés) dela. seule. nature de ia
Societe politique quelles repissent, seit (dans es” Brats mal
Fait) ‘ae cette nature et-de certaines causes extérteures. Si Ton
Templagait. partes par cives (ou subditt) et sanguints par civ
Tall a phiase cites dans la note © sappliquerait parfaitement
Stew cas.
% Cest ce qui se passe dans Je cas dx sang :
« Verum Guia” flrtmac alice causae dantur, quae. foges
naturae ‘sanguinis teria’ modo moderantur, et. vicissim illae a
Sanguine: Wine ft, i ait motus, altaegue variationes tn sanguine
Srantur, quae’ consequuntur non a sola ratione. moius ejus
Gartium’ ad invicem, sed a ratione motus, sanguints, et causarian
Externaran sire! ad tnvicern. »
(Lettre 22 ;°G, t.1V, p. 172 P, p. 1236)
66
SDIVIDUALITE COMPLEXE,
dont rien, par définition, ne peut perturber le fonctionne-
ment. Celles des modes finis (des étres vivants, de homme,
de Ia société, etc.), prises en elles-mémes, ne sont jamais
que des régularités tendancielles. Et les chances qu’elles
ont de s'imposer sont fonction du degré de complexité de
Ja structure dont elles so déduisent : toutes choses égales
G'ailleurs, plus ce degré est élevé, plus la marge de va
bilité est grande, plus les individus parviennent a se confor-
mer it leur équation corporelle. Du corpus simplicissimum,
qui ne réussit jamais & suivre sa propre Joi, & MIndividu
infini qui y réussit toujours, la gradation est continue,
Nous comprenons, & présent, ce que signifie expression
quantum in se est®. Toutes choses n'ont pas Ia méme force
pour persévérer dans leur étre. Les individus se hiérar-
chisent selon Teur puissance d’agir; ou, ce qui revient
‘ou métne, selon leur degré de perfection : ces deux notions
Séquivalent, puisque perfection est synonyme de réalité,
et réalité d'activité®. :
La puissance d'agir naturelle d'un individu, ce point
est maintenant clair, dépend en tout premier lieu de son
degré de composition.
Mais elle dépend aussi, en second lieu, de son degré
intégration. Car, si un individu peut étre sujet 2 bean-
coup de variations, encore faut-il que ces variations se
pussent vraiment en ui, qu’elles Jui arrivent vraiment
& iui. Or il n’en est pas toujours ainsi, La formule F,
nons Favons vu, ne concerne pas nécessairement tous les
mouvements des corps composants. Si la partie C de T
a plusieurs mouvements Tj, Ty T's .w» si la partic C, a
plusieurs mouvements T 1"; Ty ete, F peut fort bien
Se rapporter aux seuls mouvemnents ‘T. Mais elle peut aussi
se rapporter a la fois aux mouvements T et T’: I alors,
est plus intégré. Si elle se rapporte & la fois aux mouye~
ments T, T* et T”, Lest encore plus intégré, ete. Or, dans
Te premier cas, les changements de direction ou de vitesse
des mouvements T’ et T* ne sont pas des affections de I:
jis intéressent les éléments, mais non pas Ie tout ®. Quand
bien méme celui-ci serait extrémement complexe, si la
plupart des événements qui se déroulent dans ses parties
2 Eth. 1H, prop. 6.
3 Cf. Eth. V, prop. 40 et démonstration.
Cf. Eth If, prop. 24, démonstration.
67
SPINOZA
ne constituent pas des modifications de son essence, il ne
pourra peut-étre pas, en fant que tout, étre disposé de beau-
coup de facons. Dans le deuxiéme cas, au contraire, il le
pourra bien davantage, et plus encore dans le troisiéme
cas. Toutes choses égales dailleurs, par conséquent, 1 sera
@autant plus parfait que son intégration sera plus pous-
sée: pour un méme degré de complexits, plus nombreux
seront les mouvements concernés par F, plus riche sera
le contenu de F’, plus I sera apte A beaucoup d’actions.
ILy a ainsi des individus tras intégrés et peu complexes.
Par exemple, une pierre : & peu pres tout ce qui se passe
en elle concerne sa structure, mais il ne s'y passe A peu
prés rien; son essence est done tres pauvre. Inversement,
ity a des individus trés complexes et peu intégrés. Par
exemple, une société politique : il s'y passe beaucoup de
choses, ses possibilités de variation interne lui assurent
de trés grandes chances de survie; mais la plupart de
ces variations (vie privée, amitiés et antipathies person-
nelles, etc. : toutes choses indifférentes aux yeux de la loi)
me concernent en atcune fagon sa structure; et cest
pourquoi son essence est beaucoup moins parfaite que
celle de Yhomme, bien qu'elle ait un degré de composition
de plus, Par contre, il y a des individus a Ia fois trés inté-
grés et trés complexes : les hommes, en particulier, dont
essence, pour cette raison, est extrémement riche. Enfin,
Findividu total est A Ia fois totalement intégré (tien de
‘ce qui se passe dans 'Univers n’échappe aux « lois de la
Nature >) et infiniment complexe ; sa perfection est done
infinie.
En. troistéme lien, toutefois, !élément formel entre
certainement pour une bonne part dans Ia puissance d’agir
de Findividu. A chaque niveau de complexité et d'intégra-
tion, une infinité de formules F sont possibles. Mais sans
douie n’ont-clles pas toutes le méme rendement : les corps
‘it Te repos lemporte de beaucoup sur le mouvement sont
‘és résistants, mais pon variables; cettx oft le mouvement
Pemporte de beaucoup sur le repos sont trés souples, mais
bien fragiles. 1 doit done y avoir, & chaque niveau, une
formule F optimum (celle, peut-éire, de 1'Univers total)
qui définit Vindividu le plas parfait, Tous les hommes, par
exemple, ne sont pas également favorisés par Ia nature :
plus leur essence singuliére se approche de cette propor-
tion privilégiée, plus ils sont aptes & un grand nombre de
choses; et nous verrons ce que cela implique.
68
LINDIVIDUALIT. COMPLEXE:
Tels sont done les trois eritéres qui permettent de mesu-
rer la perfection naturelle d'une essence. Mais ce n'est
pas tout. Cette perfection naturelle ne définit qu'un cer-
tain nombre de virtualités : la limite maximum qui, dans
le meilleur des cas, pent étre atteinte. Sauf pour individu
infini, rien ne garantit que ces virtualités s'actualiseront
ffectivement. Liadjectif « aple > a deux sens : il concerne,
tantét les aptitudes innées, celles que n'exelut pas la
constitution biologique de Vindividu, tantot Paptitude &
mettre en ceuvre ici et maintenant telle ou telle de ces
aptitudes ®, Or cette aptitude conjoneturelle peut varier
au cours du temps: par suite de circonstances défavo-
Tables, un onganisme assez complexe peut devenir, sans
étre détruit, momentanément incapable d'accomplir telle
‘ou telle action qui fait pourtant partie de son équipement;
par suite de circonstances plus clémentes, il peut en rede-
Xenir capable. Tl y a des affections qui augmentent ow
diminuent notre puissance d’agir, méme s'il y en a C’autres
qui ne la renforcent ni ne l'affaiblissent *.
Spinoza, pour appuyer ce postulat 1 du livre Ul, se
fonde uniquement sur les lemmes 5 et 7 qui suivent la
proposition 13 du livre II, Iaissant de cdté les lemmes 4 et
6. Et cela se comprend fort bien, car les premiers permet-
tent de saisir d’emblée ce qu'il veut dire, alors que les
seconds peuvent toujours préter A discussion. 11 est immé-
diatement évident que la croissance nous donne les moyens
de mener & bien certaines actions qui, auparavant, étaient
inexécutables : action Ay par exemple, qui, lorsque nous
Gtions trop petits, ne parvenait pas A produire dans le
monde extérieur Ia modification M, (ni, par conséquent,
4 se dérouler elle-méme jusqu’au bout), y réussit & partir
du moment of nous atteignons une cerlaine taille, car elle
met en cuvre une quantité plus grande de mouvement;
inversement, In déerépitude rend inefficaces certaines
actions qui, jusqu’alors, s'accomplissaient avec suecés.
Par contre, il est immédiatement évident qu'une variation
cexterne, si elle ne retentit pas sur ce qui se passe en nous,
augmente ni ne diminue nos pouvoirs.
© ta proposition 14 du tive If, par exemple, Temple au
premige cre La proposition $6 du livre IV Templofe att second
Bene Ee Sclie dein proposition 39 du fire V Temples succec
Seige Gang ea dean seat? dabord Ie, premfer (6, 1
SSBB ne 10, pais Le second (Iba, goes 2
Bik, TH, postlat 3s
‘et 28).
spixoza
Mais cette vérité ne concerne pas uniquement ces deux
sortes de variations. Elle vaut aussi pour la régénération
i y a de bons et de mauvais aliments. Et elle vaut aussi
pour les variations internes. Si, au moment oit nous
sommes déterminés A I'action A, celle-ci se trouve inflé-
chie dans notre organe C; par une cause extérieure x; qui
Ia transforme en une affection passive P,, cette affection
P, nous éloignera de notre niveau d’actualisation opti-
mum : Cy par exemple, aura plus de mouvement que ne
Jui on assignait notre équation corporelle (chaleur exces-
sive); ou, att contraire, pas assez de mouvement (froid) ®;
ou bien encore, son mouvement T, empruntera un eireuit
trop eompliqué ou trop direct poar se communiquer &
Cy etc. De toute facon, en nous tendant provisoirement
inaptes & A, P, diminuera notre puissance d’agir. Par
la-méme, elle contrariera notre conatus®: alors que nous
tendions fonctionner de la fagon la plus simple possible
fen nous conformant & nos seules Icis, son apparition fera
obstacle & notre effort; nous Iui résisterons done, aussi
Tongtemps du moins que nous resterons déterminés & Ay:
et ce conflit aura pour résultat Faction A,, qui rétablirait
Véquilibre si elle n’était clle-méme infléchie par Venvi-
ronnement. Par contre, si une autre cause extéricure x’,
prend la place de x, et compense affection P, par une
affection P', de sens contraire, nous redeviendrons capa-
bles, ou moins ineapables, daccomplir Vaction Ay; cela
ne s‘expliquera pas, il est vrai, par notre seule nature,
mais du moins nous rapprocherons-nous effeetivement de
notre niveau optimum : notre puissance d’agir augmen-
tera. Par li-méme, P', favorisera notre conatus®: elle
nous aidera, comme nous y tencions naturellement, a
nous conformer & notre équation corporelle; du seul fait
que nous serons plus déterminés & A, qu’auparavant, par
conséquent, nous nous efforeerons de rester dans le méme
Ammo, be Fone mais, 138 66, 1 BOs
P, p. 130).
7 a singe
minuere, mi juvare quaugere t Taire, obstacle A notre puissance
c'est en augmenter Iefficacité. Le couple augere-minuere, sans
aucun changement de sens, est employé, tantét seul (Eth, TI,
postulat 1), tant6t accompagné du le juvare-coércere (Eth.
it lation poms iit sth
ce ih a op een
© Cf, note 63.
LINDIVIDUALITE COMPLEXE
état — tel le jet d'eau, qui, du seul fait de son propre
jaillissement, tend a maintenir ouverte Ja fissure par
laquelle il passe. Enfin, si une troisitme cause x”, produit
en C; une affection P”, qui infléchit A, dans un autre sens,
mais ni plus ni moins que les précédentes, notre puis-
sance d'agir ne s’accroitra ni ne décrottra, et nous ne
répondrons ni positivement ni négativement & cette varia-
tion nouvelle.
Mais ces fluctuations ne sont possibles que chez les
aires dont la marge de variabilité naturelle est assez large.
Plus tne essence est riche, plus nombreuses sont les
conséquences qui s’en déduisent, plus elle peut se per-
mettre d’en actualiser plus ou moins; plus une essence
est riche, plus grande est la distance entre son niveau
@actualisation optimum et le seuil minimum en decd
Guquel la moindre affection défavorable compromettrait
‘son existence dans Ia durée. Seuls les individus naturel-
Tement trés parfails se perfectionnent au cours du temps.
Non pas les plus parfaits, bien entendu ; la puissance
dagir de TIndividu total ne change pas. Mais, dans Ventre~
deux, il y a "homme.
Cf, Eth. 11, prop. 37, démonstration.
chapitre 4
vers V’unification interne:
individualité consciente et univers intériorisé
Aprés ce détour, organisation des modes de la Pensée
devient plus claire De méme que les corps se hiérarchisent
selon leur puissance dagir, de méme, conformément au
parallélisme, les ames doivent se hiérarchiser selon leur
puissance de penser : toutes choses sont animées, mais &
des degrés divers’, Or, nous I'avons vu, la puissance d’agir
dun corps se présente sous deux aspects : variabilité et
autonomie. La puissance de penser d'une ame doit done
stanalyser selon deux composantes analogues. D'une part,
plus un corps est capable dagir et de patir de plusieurs
facons & la fois, plus Pame de ce corps est capable de
percevoir un grand nombre de choses & Ja fois? D’autre
part, plus les actions d’un corps dépendent de ce corps
seul, moins les corps extérieurs concourent leur déclen-
chement, plus lame de ce corps est apte & former des
idées qui se comprennent par sa seule nature : c'est-d-dire
des idées adéquates, ou complttes, qui contiennent en
elles-mémes tout ce qui est nécessaire a leur entiére intel-
lection, Mais, nous lavons vu aussi, ces deux aspects de
Ja puissance d’agir ne sont pas indépendants I'un de Yau~
tre: plus un corps est apte & beaucoup de variations, plus
i y a de chances pour que sa conduite s'explique par le
seul jeu des lois qui le caractérisent en propre. Les ames,
1 « Omnia, quamvis diversis gradibus, enimata tamen sunt. »
(Gut He prop. 1, soolie | G, © HL, p99; P, B. 423)
Pe ..quo Corpus atiguod reliquis aptius stad plura_ simul
age te ute Zo" ets Mens. reiguis eplior ost ad
plarasrnulpeveipienduy. »
(bid. ; G, t. If, p. 973 P, p. 424.)
3 « ef quo wnlus corporis actiones magis ab ipso solo
dent, i°quio minus alia Corpora cum eoders in conser
Font, 60 Gus mens aptior ext ad distcte inteligendum. » (Ibid)
63
SPIXOzA
par conséquent, doivent se trouver dans la méme situa-
tion : plus large est leur champ de conscience, plus grandes
sont leurs chances d'accéder & la connaissance claire et
distincte. Et cette probabilité eroissante, & partir d'un
seuil déterminé, deviendra réalité : Jes Ames des corps dont
e degré de perfection est assez élevé pourront, en partic
su moins, intérioriser Univers en en reconstruisant men-
talement Pordonnance; grice & quoi elles communieront
en une seule et méme vérité. L'unification externe des
modes de 'Etendue rend possible, du edté de la Pensée,
une unification interne,
Etre conscient d'une chose, ou la percevoir, c'est avoir
Vidée de cette chose’. Mais Ame, qui est une idée, ne
peut « avoir » d'autres idées que si elle les contient en
elle, Une idée n'est done consciente que dans Ia mesure
oit elle est intérieurement différencife : si Vidée d’un objet
X contient les idées des événements A, B et C qui arrivent
aX, elle aura conscience de A, B et C; et cela d’autant
plus que les idées de A, B et C se distingueront plus nette-
ment les unes des autres. Mais V'idée de X me sera pas
nécessairement consciente de X en tant que tel, sinon par
Yintermédiaire des idées de A, Bet C!; « etre une idée »
ne signifie pas encore « avoir cette idée ». Elle ne perce-
ra que ce qui se passe dans X, s'il ey passe quelque
Or quel objet l'ame exprime-t-elle? D'une part, nous
Je savons déja, elle est Tidée dun corps existant en
acte?. D’autre part, Spinoza nous Vapprend maintenant,
elle est aussi idée de soi. Il y a, en Dieu, une idée de tous
les modes de tous les Altributs, y compris des modes de
la Pensée'; il y a done, en Dieu, une idée de Pesprit
humain®, Et cette idée de ’ame, étant unie & I’'ame comme
celle-ci est unie & son objet, forme avec elle une seule et
méme chose ®, Mais il s'agit, cette fois, d'une seule et
4 Cf,, par exemple, Eth. I, prop. 12,
5 Cf. Eth. II, prop. 19.
CE, Buh If, prop. 12.
1 Eth. WL, prop. 13.
4 Eth, Il, prop. 20, demonstration,
9 Eth. IL, prop. 20.
© Eth. M1, prop. 21.
4
LINDIVIDUALITE CONSCIENTE,
méme chose sans restriction, puisque Mune et Vautre sont
comprises sous le méme Attribut'™ : Tidée de lidée n’est
rien dautre que I'idée en tant que celle-ci se réfléchit elle
méme. L’ame n'a done conscience que de ce qui arrive &
‘son corps, et de ce qui lui arrive 4 elle-méme en tant qu’elle
pergoit les événements dont ce dernier est le thédire : des
affections de son corps et, réflexivement, des idées de ces
affections 2.
Mais il peut se passer, dans un corps, plus ou moins de
choses, selon le nombre et 'ampleur des variations non~
destructrices qu'il est capable de supporter. Et celles-ci,
rappelons-le, dépendent de son degré de complexité et d'in-
tsgration, ainsi que du rendement de sa formule F ; cest-’-
dire, finalement, de Ia richesse de son essence. C’est done
de cela aussi que dépend le degré de conscience de son
esprit. A un corps simple, ou & un corps complexe mais
peu intégré, ou 4 un corps bien intégré mais peu complexe,
Correspond une fime inconsciente ou quasi-inconsciente +
‘méme si des modifications Tui adviennent (en fait, il y en
‘2 toujours), elles sont trop faibles, trop peu nombreuses
et trop pew distinctes les unes des autres pour étre per-
{ques netlement. Par contre, un corps & Ia fois trés complexe
et trés intégré est sujet & beaucoup de modifications
‘simultanées; certaines d'entre elles, alors, peuvent se déta-
cher fortement sur la toile de fond constituée par les
fautres affections et par ce qui, dans le corps, demeure
immuable; Tame d'un tel corps est done consciente, en
méme temps que consciente de soi, et cela d’autant plus
que son contenu est plus varié. Quand, préci
conscience apparait-elle? Spinoza n’en sait rien
simplement que la pierre n'est pas consclente®, alors que
les animaux le sont; le cas intermédiaire des plantes est
passé sous silence. Mais ce qui est certain, c'est que la
chaine est continue.
Or, dans cette hiérarchie, nous occupons un rang élové.
Car le corps humain est un individu tres complexe,
composé d'un trés grand nombre d’individus tres
13.44 ; P, p. 1308). Cf. infra,
tire, »
SPINOZA,
complexes; il est sujet, par Reméme, & un tds grand
nombre de variations internes * et régénératrices *; il est
capable, par conséquent, de mouvoir et de disposer les
corps extérienrs d'un trés grand nombre de fagons#.
L'ime humaine, dans ces conditions, est apte a percevoir
beaucoup de choses®. Quoi exactement? Voila qui se
congoit sans peine, Pulsque une affection passive découle
la fois de la nature de notre corps et de celle du corps
extérieur qui nous affecte®, son idée enveloppe & la fois
ces deux natures. Notre Ame, dés lors, doit pereevoir,
non seulement son propre corps, mais tout ce qui, direc
tement ou indirectement, agit sur Iui®. Sans doute ces
perceptions ne nous livrent-elles pas nécessairement la
table structure des choses : elles nous indiquent
plutét l'état de notre corps que les propriétés réelles des
objets environnants, Mais du moins nous font-elles
ressentir existence hie et nunc de ces objets : aussi loug-
temps que le corps humain subit ue affection qui, enve-
loppe la nature de tel ou tel corps extérieur, esprit
humain considére ce dernier comme présent*, Appelons
images ce gente d’affections corporelles, et imagination
la conscience qu’en prend notre ame,
Mais il y a plus. Le corps humain n'est pas seulement
trés composé, il est aussi trés diversifé ; certaines de ses
parties sont dures, d'autres sont fluides, d’autres sont
molles®; sa formule F, qui wimplique ni prédominance
excessive du mouvement sur le repos ni prédominance
excessive du repos sur Ie mouvement, se rapproche sans
doute de 1a proportion optimum. D’oit une conséquence
importante : lorsqu’une partie fluide est déterminée par
lun corps extérieur & heurter souvent une partie molle,
Eth II, postulat 1 aprés la proposition 13.
% Eth. If, postulat 3 aprés Ia proposition 13,
1 Eth. II, postulat 4 aprés la proposition 13.
% Eth, U1, postulat 6 aprés la proposition 13.
» Eth, Il, prop. 14.
% Eth. If, prop, 16, démonstration,
4 Eth. M1, prop. 16.
2 [bid., coroll, 1.
® Ibid, coroll. 2.
% Eth, U, prop. 17.
% Ib, scolie.
% Eth, Il, postulat 2 aprés la proposition 13.
LIINDIVIDUALITE CONSCTENTE
elle en change Ia surface, imprimant en nous Ia trace de
‘ec corps extérieur; et les modifications imposées & un
corps mou sont relativement durables. Ainsi pouvons-nous
imaginer les choses en Ieur absence: alors, mais alors
seulement, elles nous apparaissent comme des choses, qui
Subsistent indépendamment de nous sans s’évanouir
lorsque nous en détournons notre regard; la notion
objet se constitue, Certes, ces traces peuvent étre
brouillées par d'autres traces. Mais Vassociation par
contiguité tes ressuscite : si nous avons percu ensemble
deux objets A et B, et si, par la suite, nous percevons de
nouveau A, notre corps se retrouvera dans In situation qui
Gait la sienne au moment oit nous avions pergu cet objet
pour la premiére fois; il sera done affecté simultané-
ment de ces deux modifications ®, et nous imaginerons &
nouvean B, ‘Tele est la mémoire ®, qui met & notre dispo-
sition un capital d'idées, sinon illimité, du moins prati-
quement inépuisable.
La puissance de penser de notre esprit est done tres
geande : notre champ perceptif, contrairement 2 celui
fies ¢ Ames » plus rudimentaires, déborde largement
instant présent ; loin de toujours rester polarisés sur
Vimmédiat, nous avons Je pouvoir de retenir les impres-
sions passées et d'imaginer 'avenir en fonction de notre
expérience. Encore faut-il, bien entendu, que le monde
estéricur s'y préte: si notre milieu était uniforme et
invariable, ou s'il nous infligeait chaque instant une
affection assez violente pour que toutes les autres, par
rapport a elle, me constituent plus qu'un arriére-fond
indistinct, notre ame, réduite au monoidéisme, retombe-
rait dans tne somnolence & laquelle sa nature ne 1a pré-
disposait pourtant pas. Mais lessentiel est que nous ne
sommes pas voués A la torpeur: notre degré de cons
cionee et d’auto-conscience, déja trés élevé au départ, peut
encore s’accroitre dans une mesure considérable.
7 Eth, 11, postulat 5 aprés Ia proposition 13.
% Eth, Ul, prop. 17, cotoll.
Eth, I, prop. 18, démonstration,
» Ibid,
4 Eth, I, prop. 18.
2 Ibid., soalie.
or
SPINOZA.
Malheureusement, ce qui explique l'apparition de Ia
conscience rend compte, en méme temps, du caractére ina-
déquat de cette conscience.
Liime est Pidée du corps existant en acte. Mais elle n'a
pas Vidée du corps existant en acte: cette idée, c'est
Dieu qui Ya; et il Pa dans la seule mesure oft il a aussi
es idées des causes extérieures qui font exister notre
corps, puis des causes de ces causes, ete» & linfini
L’ame, en tant que telle, ne connait done pas le corps *,
Pourtant, elle le connait par un autre biais: grace aux
événements qui lui artivent. Puisque elle a les idées des
affections du corps, et puisque ces idées enveloppent la
nature du corps, elle pergoit le corps en percevant ces
affections *: tel est le seul moyen qui Ini soit donné de
prendre conscience de son objet *. Pour la méme raison,
elle ne se pergoit elle-méme qu’en percevant. réflexivement
les idées des affections du corps: tel est le seul moyen
qui Ini soit donné daccéder & la conscience de sol. Mais
s'agit-il 14 d'une connaissance claire ct distinete ? Non,
sans aucun doute. Car une affection corporelle, considé-
rée isolément, n’enveloppe pas la nature du corps dans
son intégralité : outre cette modification particuliére, nous
pouvons aussi étre affectés d'un trés grand nombre d’au-
tres fagons*. L’idée de cette affection n’exprime done
qu’en partie la nature du corps humain lui-méme : elle
ne nous le fait pas connaitre adéquatement®. Pour la
méme raison, Pidée de cette idée ne nous fait pas connai-
tre adéquatement notre propre esprit *.
Gela signifie-t-il que toute connaissance vraie de notre
corps et de notre esprit soit impossible ? En droit, pas
nécessairement. Car une affection n'est jamais seule
nous en percevons un trés grand nombre, et nous nous
souvenons de celles que nous avons pergues auparavant.
Si, par conséquent, les événements qui se déroulent en
nous s'expliquaient par notre seule nalure, nous pour-
3 Eth. II, prop, 19, démonstration.
% Ibid,
% Ibid,
% Eth, I, prop. 19.
3 Eth, WL, prop. 23,
% Eth Ti, prop. 27, démonstration.
& Eth, UL, prop. 27.
© Eth, IL, prop. 23.
68
LINDIVIDUALITE CONSCIENTE,
tions, en les tolalisani, comprendre cette méme nature.
Si notre corps fonetionnait 4 son niveau d’actualisation
optimum, si tout co qu'il faisait vérifiait l’équation théo-
rique qui se déduit de sa formule F’, Vordonnance de ses
affections serait expression adéquate de son essence :
celle-ci transparaitrait dans sa maniére d'exister hic et
nunc ; dans le corps existant en acte, I'essence du corps
se délacherait nettement, comme une figure se détache
sur un fond. Par li-méme, I'ame, idée du corps existant
fea acte, aurait explicitement l'idée de Vessence du corps :
nous saurions vraiment co que nous sommes, car nous
agirions selon ce que nous sommes vraiment. Mais il n’en
est pas ainsi, du moins an départ : notre corps, en réalité,
existe que déformé par les causes extérieures qui le sou-
tiennent, si bien déformé qu'il en devient méconnaissable;
Yenchainement désordonné de ses affections ne nous per-
met pas de reconstituer sa loi interne. Sa structure est 14,
fen permanence ; mais elle n’émerge pas, camouflée qu'elle
est sous Tafilux des déterminations qui lui viennent de
Yenvironnement. L'idée vraic de sa structure n'émerge
donc pas dans notre esprit : elle est la, elle aussi, mais &
notre inst, brouillée par une imagination chaotique qui
Ja recouvre en chacun de ses points.
Mais ne pourrions-nous pas la dégager indirectement ?
Les idées des alfections du corps, outre la nature du
corps, enveloppent la nature des corps extérieurs qui
nous affectent et celle des parties par ol nous sommes
affectés #, Si elles nous faisaient connaitre adéquatement
‘ces corps extérieurs et ces parties, ne nous serait-il pas
possible, en analysant le résidu qui subsisterait, de décou-
Yrir ce que nous sommes ? Certes. Mais, précisément, elles
ne le font pas, D'une part, elle n'enveloppent nullement
ja connaissance adéquate des corps extérieurs® : elles ne
nous les font percevoir que trés partiellement, dans Ja
seule mesure oi ils agissent sur nous par tel ou tel de
Jeurs mouvements ®; Pour le reste, ils nous échappent.
Liidée compléte d'un objet situé hors de nous n’est en
aucune facon dans notre esprit : elle est en Dieu en tant
quil a Tidée d'une autre chose singuliére existant en
dete“. Et, d'autre part, nous mavons pas non plus la
4 Eth, U1, prop. 28, démonstration.
© Eth. I, prop. 25.
© Tbid,, démonstration.
« Ibid,
6
srIsozs
connaissance adéquate des parties de notre corps:
celles-ci ne nous affectent que dans la mesure ot elles se
communiquent mutuellement ceux d'entre leurs mouve-
ments qui interviennent dans nos formules F et F"; mais
elles peuvent, en dehors de cela, exéeuter beaucoup d'au~
tres mouvements, qui ne coneernert en rien notre struc
ture ; leurs idées complites, elles non plus, ne sont donc
pas intérieures & Vesprit humain ; seul un ‘individu tota-
Jement intégré pourrait en avoir d’emblée une entiére
intellection, L'idée de une queleonque de ces affections,
par conséquent, ne nous livre pas le secret de son origine
prise en elle-méme, elle ne contieat rien qui nous per~
mette de déterminer ce qu’elle nous doit et ce qu’elte d
8 environnement
eut-elle, du moins, nous faite comprendre le méca-
aia St teeny, tas te comprente eM
tout a fait impossible : comment comprendrions-nous ce
dont nous ignorons les causes? Les idées de limagin:
tion, conclusions séparées de leurs prémisses , ne posse
@ent_pas en elles-mémes lour raison d’étre ; celle-ci, on
partie au moins, est ailleurs : dans d’antres idées, qui
n'appartiennent ‘pas A notre esprit. Idées mutilées et
incompletes, elles sont nécessairement confuses ®. Et il en
va de méme, bien entendu, des idées de leurs idées *
Lorsque nous percevons les choses selon Tordre
commun de la Nature, nous ne comnaissons done adéqua-
tement ni notre esprit, mi notre corps, ni les corps qui
nous entourent® Manipulés par les causes extérieures
selon le hasard des rencontres, nous me comprenons ni
ce que nous sommes ni ce que nous faisons : notre esprit
est passif, au méme titre que notre corps, puisqu'll n'est
pas la cause entiére des pensées qui surgissent en 1ui 3.
Situation, en un sens, indépassable : comment éviter
@'étre modifiés par un Univers qui nous englobe®?... Bt
Eth, UL, prop. 24.
* Ibid, démonstration.
© Eth. I, prop. 28, démonstration.
“ Bid,
© Eth. UL, prop. 28.
® Ibid, scalie,
4 Eth. IL, prop. 29, corcllaire.
® Eth, I, prop. 1.
8 CE. Eth, 1V, prop. 4.
70
UINDIVIDUALITIE CONSCTENTE:
pourtant, il y a bien quelgue chose d'adéquat dans cha-
une de nos idées confuses : quelque chose qui, du fait
Ge leur multiplicité méme, doit apparaltre assez fréquem-
ment au grand jour et nous ouvrir le chemin du vrai.
Car il y a, dans chacune de nos modifications corpo-
relles, quelque chose qui se concoit par notre seule nature.
Tous les corps ont des propriétés communes : tous, sont
des modes de 'Biendue; tous participent & la fois du
mouvement et du repos, & des degrés divers selon leur
vitesse ow leur Ienteur, enveloppant ainsi In nature du
Mode infini immédiat : tous sont agencés de facon & se
conformer & la Joi fondamentale de la communication du
mouvement, enveloppant ainsi la nature du Mode infini
médiat. Cettes, ces propriétés communes n’appartiennent
4 Pessence d’aucun corps en particulier ; mais du moins
sont-elles également dans le tout et dans les parties de
chaque chose, qu'il s‘agisse de I'Individu total, des indi-
vidus complexes de quelque degré que ce soit ou des
corpora simplicissima. Ftant tout entigres présentes dans
notre corps et dans nfimporte laquelle de ses affections,
elles ne peuvent donc étre coneues qu'adéquatement
Si elles sont concues, bien entendu. Et pour qu’elles le
soient, encore faut-il que certaines conditions soient
réunies. Car, si elles sont impliquées dans chacune de nos
affections, elles ne s’y manifestent jamais & état pur:
ous ne sommes pas affectés par W'étendue en tant que
telle, ni par le monvernent et le repos en tant que tels,
mais par des combinaisons particuliéres de mouvement et
de repos, qui, elles, ne se comprennent pas par nos seules
lois ; adéquat, dans nos perceptions, est mélé & Vinadé-
qual, et c'est A nous de Ven dégager. Mais comment notce
esprit Yen dégagerait-il si notre corps Iui-méme ne s’y
prétait? Si nous n'imaginions qu'une seule chose 4 la
fois, cette opération serait exelue : rien ne nous inciterait
a séparer, par exemple, V'étendue de Ia couleur. Si nous
nimaginions que peu. de choses & la fois, ou des choses
trés peu distinctes les unes des autres, ce serait également
impossible. L’animal, en un sens, posséde les notions
S Eth, 1, lemme II apres 1a proposition 13.
% Eth. 1, prop. 37.
% Id.
51 Eth, Il, prop. 38.
n
‘SPINOZA,
communes ; mais il ne les posséde qu'implicitement, sans
pouvoir les extraire de leur conterte. Chez ’homme, au
contraire, Vimplicite devient expticite. Car le corps humain,
lui, est capable de retenir simultanément un trés grand
nombre d'impressions nettes ; par li-méme, dans le champ
de ses images, une structure figure — fond apparait : de
Ja multiplicité de ces affections bien contrastées, le déno-
minateur commun émerge. Non pas toujours, certes : si
notre milieu est trop pauvre, ou s'il est assez déséquilibré
pour produire en nous une affection qui éclipse toutes les
autres, cette ségrégation ne s'opérera pas. Mais du moins
les propriétés communes des chores passent-elles assez
souvent au premier plan dans notre corps. Notre esprit,
alors, Jes congoit séparément : percevant les dissemblan-
‘ces et les oppositions, il percoit, du méme coup, les véri-
tables invariants qui s’en détechent®. Les notions
communes, on le voit, sont exactement le contraire des
universaux illusoires : coux-ci ne $2 forment qu'en raison
de notre impuissance & imaginer distinctement un trop
grand nombre de choses & la fois; colles-IA ne se for-
ment que dans la mesure oi nous avons conscience des
différences individuelles ; elles manifestent notre puis-
sance de penser, non ses limites. Pourquoi cette eapacité
‘est-elle le privilége de Phomme, alors que les animaux supé=
rieurs en sont privés? Spinoza ne saurait le dire : les
connaissances biologiques Iui font défaut. Mais il pose,
comme allant de soi, que "homme est le seul étre fini &
avoir un corps suffisamment complexe et suffisamment
intégré pour que Jes notions communes puissent transpa-
aitre dans son ame. Aussi ces notions sont-elles commu-
nes 4 tous les hommes ®, et & eux seuls.
Mais, en plus des notions communes, il y a aussi d’au-
tres idées qui doivent étre adéquates dans notre esprit
Pour qu’une propriété fasse l'objet d'un concept clair, il
suffit qu'elle soit commune & notre corps et & certains
corps extérieurs, quelle se retrouve & la fois dans le tout
et dans les parties de chacun de ces corps extérieurs, et
4 « quotes, inteme, ex co scillee, quod res plures simul
contenipilt, asturmifater £4 ‘cninto® Snort,
Fenttas? et “oppaghanias inisligendin,” fun rar eave, et
lite confer»
(Eth. TL, prop. 29, scolie.)
» Eth. 1, prop. 4, scale 1.
© Eth, II, prop. 38, coroll.
2
LINDIVIDUALITE CONSCIENTE.
que ces corps extérieurs nous affectent habituellement *.
Or ily a des propriéiés qui, sans étre communes & tous
les corps sans exception, satisfont pourtant aux deux pre
mitres de ces conditions ; et il y a des corps qui, possé-
Gant ces propriétés, satisfont la troisiéme. Supposons
que les corps d'une certaine ospéce X soient naturelle-
ment sujets & un cerlain mouvement global A (translation,
rotation, etc.). Supposons que notre corps, Iui aussi, soit
capable @accomplir Ie méme mouvement A; que A fasse
partie des actions auxquelles notre constitution biologique
nous Tend aptes. Dans ce cas, la propriété A sera tout
entigre présente aussi bien dans notre corps qu’en chacun
de ces corps X et en n'importe laquelle de leurs parties :
elle se concevra, indifféremment, par notre seule mature
aussi bien que par leur seule nature ®. Supposons main-
tenant que l'un quelconque de ces corps X, soit X;, nous
affecte d'une certaine fagon. Que X; agisse sur nous dans
sa totalité ou par Pune seulement de ses parties, et quelle
que soit cette partie, notre affection, par hypothése, enve-
loppera Ia propriété A; la conscience que nous aurons de
cette affection enveloppera done une idée de A ; et, puisque
‘A sera entiérement présente en nous, cette idée que nous
fen aurons ne pourra étre qu’adéquate®. Enfin, si X agit
ensuite sur nous par plusieurs autres de ses’ parties, si
@autres corps X (Xp Xy Xp ete.) nous alfectent A leur
tour, si nous retenons bien ces diverses impressions, Pidée
adéquate de A, parce qu'elle figurera dans une multitude
de conlextes dont elle constituera Vinvariant, se détachera
nettement dans notre fme: nous formerons de A un
‘eoncept clair et distinct. Ainsi, lorsque notre champ per-
ceptif est équilibré et riche, des expériences bien conduites
peuvent-elles nous permettre d’augmenter notre stock
didées vraies : Je monde extérieur, interrogé comme il
convient, nous révéle & nous-mémes en nous offrant un
reflet de nous-mémes.
A des degeés divers, cependant. Tout dépend de nos
aptitudes : si nous pouvons accomplir une action A, nous
pourrons, le cas échéant, concevoir clairemment les mouve~
ments globaux de type A qui se produisent hors de nous ;
si nous pouvons accomplir une autre action B, nous pour-
© Eth, TL, prop. 39.
© [bid, démonstration.
© Wid.
SPINOZS
rons aussi concevoir les mouvements globaux de ty
"titans et bod Sot Gs sue ocr pair oo
coup de choses: il forme assez facilement Vidée claire
de la ligne droite ou du cerele, par exemple, parce qu'il
peut effectuer Ini-méme des translations et des rotations.
Te Sccnin Rorsmes sot pn ae pean a eas
mult cl un seal of meses here pone opie ee
papas tein ful pa penionee oie inves
4 un grand nombre d’actions, plus nombreuses sont les
opel qua mate corps pono ene te
tres corps, plus nos affections (et les conduites qu’elles
déclenchent) s’expliquent par notre seule nature, plus
hous sommes aptcs Sconce un gun nombre de ees
Mdcqustement nce ae foe, Scab ot anne
a
Au départ, ces idées claires se présentent en orc
disperse fans notre esprit! Idée de Pétendue idee deta
igs droite ie du moutomont, abe i oe, Ste tot
se cere spleens foupaos tats one ame
percept demeue cous af nckes nou ne Seine
‘ons pas dans Ia torpeur, rien ne nous empéche, en droit,
de faire fructifier ce capital initial. De nos idées adé&
quates se déduisent d'autres idées qui, eTles aussi, sont
Uicsesutenneat. wheqoctan ss Post pont es ae ek
Soarccal en eoubeant sluseats “ootepte hose
Sontrulans dauter consupts "Bios pan aos des ane
nous possédions 4 Porigine, nous pouvons fort bien les
smneaind Rastis Gatien Tass fies Singer see
possédions par ailleurs. Le cerele, d’abord concu statique-
ment comme le lieu des points équidistants d'un méme
Gentte ne concolt enstta endgame pee rolaion
fan toguat do drole 1s cegniet do tie, ton ter
se congoit génétiquement par Ia translation d'un point #,
qui elle-méme se concoit par la seule notion commune du
mouvement ®, qui elle-méme se coneoit par 1a seule notion
« Hine sequitur, quod Mens eo aptior est ad plura adaequate
pereipienduin, quod efus corpus plura Iubet cum alils corpord
Seton Et on Sera A Ns Conportis
‘© Conventionnellement, nous employoas une minuscule lorsque
nous parlons de Vetenduepropriete commune, et une. majuscu
Torsque nous peclons de PEtenducAttbut. ” ve
‘Eth. UL, prop. 40
CE FRE, §§ 956 (K, p. 9; G, 1, I, p. 35; P, pp, 1912),
Ck TRE, § 108, 1M (kp. 9; 6, 1» 39; 9.180,
“4
LINDIVIDUALITE CONSCIEN'TE
commune de I'étendue®. A la limite, toutes nos idées adé
quates formeront un systéme unique, dont unique point
de départ sera constitué par cette derniére.
Quol est équivalent corporel de cette déduction ration-
nelle? Spinoza nous Vindique, mais setllement au début du
livre V: dans la mesure oit notre esprit a Te pouvoir de
déduire ses idées les unes des autres, notre corps, lui
aussi, a le pouvoir @enchainer ses affections on un ordre
intelligible. Et cela se comprend fort bien. Les images
corporelles, d'une fagon générale, s'associent toujours
selon la loi de contiguité. Mais il y a contiguité et conti-
guité ; si nos associations, le plus souvent, sont empiri-
Gues, elles peuvent aussi étre logiques ; tout dépend de
ee qui, dans mos images, leur sert de fill conducteur.
image d’un cerele rouge, si aspect « rouge > est au pre~
mier plan, peut évoquer Pimage du sang, qui évoque elle-
iméme des images de guerre. Mais, si c'est 'aspect « cer-
cle » qui se trouve au premier plan, la méme image peut
Sassocier 4 celle de la rotation d'un segment de droites
puis cette derniére, si son aspect gométrique reste Ega-
Tement au premier plan, peut s'associer, & son tour, &
celle de la transtation d'un point, etc. Or c'est bien cela
‘qui doit se passer ici. Ce qui correspond, dans notre corps,
une idée claire et distincte, ce n'est pas une image par
ticuliére ; c'est un certain aspect d’une ou plusieurs de
nos images, celui-la méme qui se concoit par notre seule
nature physique. Lorsque nos idées adéquates émergent
dans notre esprit, ce sont ces aspects-1a qui émergent dans
notre corps. Lorsque mos idées adéquates s’enchainent les
fines aux autres, par conséquent, ce sont ces aspects-l&
qui doivent s'enchainer les uns” aux autres, entrainant
avee eux les autres aspects qui leur sont Tiés empirique-
ment. Chaque image, prise & part, est évidemment passive :
le cercle reste rouge, ou noir sur blanc, et ces couleurs
Sexpliquent par la conjonction de notre nature et de celle
Ge corps inadéquatement percus. Mais ce ne sont pas les
couleurs qui commandent association: ordre dans
Tequel ces images se combinent et se succédent (segment
de droite 4 rotation —> cercle), abstraction faite du
contenu matériel de ses éléments, se comprend, lui, par
® Ibid., Spinoza, ici, appelle Vétendue « quantité >.
1 Qu « conforme a Ventendement » (« ad intellectum »).
Cf. Eth. V, prop. 10, démonstration.
7B
srIsoza
Ia seule nature de notre corps, comme Yordre de ta dédue-
tion se comprend par Ia seule nature de notre esprit.
Allons plus loin. Toute image déclenche une action. Or,
lorsque nos images s’enchainent de facon intelligible, les
actions qui en résultent doivent s‘enchainer, elles aussi,
en un ordre logique rigoureux: elles forment, toutes
ensemble, une opérition technique eohérente, done parfai-
tement efficace; une opération par laquelle, au lien de
nous adapter au monde selon le hasard des rencontres,
nous transformons méthodiquemen: notre milien en I'adap-
tant & nos besoins. Crest 1a une conduite active, puisque
Je systéme d'images qui la provoque peut lui-méme élre
considéré comme une actions: nous en sommes la
cause adéquate. Sans doute ce systéme dactions m’abou-
tira-til pas nécessairement 4 une transformation réelle
de notre environnement extérieur. Mais du moins ébau-
cherons-nous le processus, Lorsque nous construisons le
concept de cerele, notre corps esquisse, ne seraitce que
de fagon imperceptible, 1a série des gestes par lesquels
nous pourrions, le eas éhéant, fabriquer un objet circu-
laire : ceux-la méme qu’exprime idéalement Ia définition
génétique de cet objet. Et ces gestes, si le besoin s’en fait
sentir, se prolongeront en une fabrieation technique réelle.
En définitive, done, toute déduction rationnelle a pour
corrélat physique un comportement technique esquissé ou
effectif, par lequel, virtuellement ou réellement, nous
devenons maitres et’ possesseurs d’ane partie de la Nature.
Et notre pouvoir de déduire, c'esi-i-dire de reconstruire
mentalement certains objets, s‘étend exactement jusqu’oi
s'étend le pouvoir qu’a notre corps de construire ces mémes
objets en combinant dans tel ou tel ordre es actions aux-
quelles il est apte. Nous connaissons clairement ce que
notre corps « sait > faire®.
‘Au point ott nous en sommes, cette connaissance est
abstraite. Le point de départ de la Raison, ce sont les
De méme que toute action, considérée en elloméme, est
active, mais que ordre, de nos’ actions peut etre passif, de
méme toute image, considérée en elle meme, est passive, mais
Yordre de nos images peut étre actif. Lordre de nos actions
est actif lorsque Yordre des images qui déclenchent ces actions
est lubiéme actif; dans le cas contraire, cestadire le plus
souvent, il est passif ; mais la premitre éventualité nest mille:
ment exelue en droit.
7 M, Zac, commentant le § 31 du Traité de la Réforme de
VEntendement, développe une idée anclogue (L'idée de vie dans
a philosophie’ de Spinoza, pp. 110-1).
76
VINDIVIDUALITE CONSCIENTE,
notions communes : Vétendue mvest pas encore congue
comme un Attribut de Dieu, mais seulement comme la tri-
dimensionalité qui caraetérise tous les corps sans excep-
tion; son aspect naturant reste dans Yombre. Le point
Warrivée, ce sont encore des propriétés générales, méme
ssi elles Ie sont de moins en moins : la Raison ne connalt
les étres concrets qu’en leur appliquant, de Vextérieur, les
vérités universelles qu'elle a déduites. Parallélement, les
systémes d'images et d'actions qui lui correspondent ne
sont encore que des schémes de production abstraits. Mais
Westil pas possible de conerétiser toujours davantage ?
Ne pourrions-nous pas, au terme d'une déduction parfaite,
aiteindre notre essence singuliére? Ne pourrions-nous
pas enchainer nos images en un systéme dont la structure
Teproduirait exactement celle de notre corps individuel, et
dont découlerait un systéme d'actions qui, en nous main-
tenant & notre niveau d’actualisation optimum, se confor=
merait exactement & notre équation- corporelle ? Si, mais
& une condition : il faut d'abord que nous sachions que
hous avons une essence singuliére. Or, cela, la simple Rai-
son ne nous Tapprend pas: pour Je savoir, il nous faut
comprendre que toutes choses, en tant qu’elles ge dédui-
sent de Dieu, sont intelligibles de part en part. Et nous
ne le comprendrons qu'a partir du moment oi nous for-
merons une idée claire et distinete de Dieu. Cette idée,
Tavons-nous déja? Oui, en un sens : elle est enveloppée
dans nvimporte laquelle de nos idées, puisque tout se
concoit par Dieu. Mais, jusqu’d nouvel ordre, nous ne
Yavons qwimplicitement. Réussirons-nous a Ia faire passer
‘am premier pian de notre esprit? Si oui, nous pourron:
nous engager dans la connaissance du troisiéme genre® :
& partir des Atiributs de Dieu concus comme tels, nous
nous acheminerons vers la pleine intellection de notre moi
corporel et spirituel. Mais c'est difficile, ear Dieu, contrai-
rentent aux propriétés communes des corps, n'est pas
objet imagination ®. Pour le moment, 1a question reste
en suspens.
% Cf, Eth. I, prop. 40, scolie 2.
1 Eth, 13, prop. 4547.
1 Eth, 1, prop. 47, sco.
% Ibid.
1
SPINOZA.
Tel est done homme : organise hautement diffé-
rencié, mais dont les conduites sont encore beaucoup
plus passives qu’aectives; ame déja trés consciente, mais
dans laquelle un petit ilot de représentations claires et
istinetes émerge peine d'un océan d'idées confuses.
Son effort pour persévérer dans son étre va done s'orien-
ter dans deux directions contradictoires, selon que
Vinspirera la Raison ou la passion; et la seconde de ces
deux tendances, au départ du moins, seta nettement pré-
pondérante. Mais, quoi qu’il fasse, if a le droit de le faire >
passionnés ou raisonnables, stupides ou intelligents, tous
ses décrets ei tous ses actes sont des manifestations de
son conatus individuel; par li-méme, ils se justifient sans
la moindre restriction; ils sont proprement’ divins.
Reste & savoir ce que nous allons faire de ce droit
naturel. Comment notre conatus, a Pétat de nature, va-t-il
nous engager dans toule une série d'alignations indivi
duelles qui introduiront Ia discorde dans nos rapporis
avee autrui? Tel sera Pobjet de notre seconde partie, qui
commentera le livre [11 et Ie début du livre TV. Comment
Je jeu méme de Vétat de nature va-til engendrer la
société civile, qui, ume fois née, céorientera nos aliéna-
tions? Tel sera Fobjet de notre troisiéme partie, qui exa-
minera la Politique de Spinoza. Comment, une fois mode-
és par le conditionnement politique, allons-nous pouv
nous libérer individuellement et aous unir a nos sem-
blables en une communauté fondée sur Paccord des enten-
dements? Tel sera Pobjet de notre quatriéme partie, qui
étudiera Ia fin du livre IV et Ie livre V.
seconde partie
la séparation : individualité aliénée
et état de nature
SPINOZA
‘Tel est done l'homme: organisme hautement diffé-
rencié, mais dont les conduites sont encore beaucoup
plus passives qu’actives; me déja trés consciente, mais
dans laquelle un petit ilot de représentations claires ot
distinctes émerge a peine d'un océan d'idées confuses.
Son effort. pour persévérer dans son étre va done s‘orien-
ter dans deux. directions contradictoires, selon que
Vinspirera ta Raison ou fa passion; et Ia seconde de ces
deux tendances, au départ du moins, sera nettement pré-
pondérante. Mais, quoi qu'il fasse, i! a le droit de le faire :
passionnés ou raisonnables, stupides ou intelligents, tous
ses décrets et tous ses actes sont des manifestations de
son conatus individuel: par li-méme, ils se justifient sans
ia moindre restriction; ils sont proprement divins.
Reste & savoir ce que nous allons faire de ce droit
naturel. Comment notre conatus, a état de nature, vact-il
nous engager dans toute une série d’aliénations indivi-
duelles qui introduiront la discorde dans nos rapports
avec autrui? Tel sera Yobjet de notre seconde partie, qui
commentera le livre III et le début du livre IV. Comment
Je jeu méme de Vétat de nature va-t-il engendrer la
société civile, qui, une fois née, xorientera nos aliéna-
tions? Tel sera l'objet de noire troisiéme partie, qui exa-
minera Ia Politique de Spinoza. Comment, une fois mode-
és par le conditionnement politique, allons-nous pouvoir
nous libérer individuellement et nous unir & nos sem-
lables en une communauté fondée sur Paccord des enten-
dements? Tel sera Pobjet de notre quatriéme partie, qui
étudiera a fin du livre IV et le livre V.
seconde partie
la séparation : individualité ali¢née
et état de nature
chapitre 5
fondement et déploiement
de la vie passionnelle
Le livre II de TEthique, et le livre IV jusqu'an scolie 2
de la proposition 37, nous permettent de voir ce que
devient le conatus humain lorsqu’il est & Uétat de nature.
Cet état présente deux caractéres. D'une part, il est celui
des hommes réels : des hommes tels qu’ils sont, dominés
par leurs idées inadéquates, mais avec un embryon de
Raison et les exigences qui en découlent. D'autre part, il
est Pétat des hommes réels fels qu’ils agiraient s'ils étaient
Tivrés & la spontanéité anarchique de leurs désirs, si aucun
conditionnement politique ne venait orienter le cours de
eurs passions. Un tel état, du fait méme que Yon ne
saurait longtemps y vivre,.ne correspond & aucune expé-
Tience. Mais ce n'est pas une simple fiction: c'est une
société infra-politique, qui, sans avoir une existence
séparée, n’en constitue pas moins la matiére premiére de
Ja société politique qui en est la continuation directe.
Cest donc une abstraction a la fois dépassée et conservée
dans la réalité concréte.
Cet état de nature recéle une triple contradiction, doi
viendra, préeisément, son dépassement.
Tout dabord, contradiction interne & ta vie passionnetle
(livre I1f, 2 partir de la proposition 9), L'individa humais
pour Vessentiel, est passif. Son asservissement aux causes
extérieures, d'une part, Valiéne, et, d'autre part, engage
favee les autres individus dans une communauté conilie-
tuelle. Tel. sera objet du présent chapitre
Contradiction, ensuite, entre ta raison et les passions
(livre IV jusqu’an scolie de Ia proposition 18). La raison,
en elfet, est déja li: tout homme posséde les notions
communes et peut en déduire au moins quelques consé-
quences, Mais son développement est entravé par la vie
passionnelle, Tel sera Vobjet du chapitre VI
81
SeINOZA,
Contradiction interne, enfin, aux exigences de ta Raison
elle-méme (livte IV, du seolie de Ia proposition 18 au
scolie 2 de la proposition 37). Car la Raison, pour se
développer et s'épanouir, réclame des conditions qui,
dans Tétat de Nature, sont rigoureusement irréalisables.
Irréalisables, non seulement en fait, mais en droit. Tel
sera objet du chapitre VI
A partir de ces trois contradictions (mais surtout de Ia
premigre), nots pourrons comprendre le passage néces-
saire de l'état de nature a In société politique.
Le livre IIT, comme dailleurs les deux livres suivants,
a une structure que nous appellerons quasi-séfirotique. La
théorie des passions, en effet, y est exposée scton un ordre
qui, par ses caractéres formels (comme le montre la
figure 1 que nous reproduisons en appendice), peut étre
considéré comme une variation libre sur Ie thtme de
Yarbre séfirotique des kabbslistes.
‘Au sommet se trouvent les propositions 4-8, consacrées
ila théorie générale du conatus qui faisait Vobjet de notre
premiere partie, Puis, 4 partir de 1a, nous avons deux
colonnes paralléles : Tune traite de ia vie individuelle,
Yautre des relations interhumsines. Chacune de ces deux
colonnes comprend elle-méme deux groupes : fondement
et déploiement. Ce qui nous donne, en tout, quatre
groupe
1 — Groupe Ay: fondements de la vie personnelle (pro-
position 9 — scolie de la proposition 18); c'est-a-
dire désir, joie et tristesse, amour et haine.
2 — Groupe Ay: déploiement de la vie personnelle (scolie
de la proposition 18 — scolie de la proposition 26 ;
ajoutons-y, nous verrons pourquoi, la proposition
50); Cest--dire dérivation de Yamour et de la haine
en fonetion des cireonstances.
3 — Groupe B,: fondements des relations interhumaines
(proposition 27 — scolie de la proposition 32) ;
Cest-a-dire imitation des sentiments, désir d’univer-
salité quien découle, et, & partir de Id, genése de
Yamour et de la haine interhamains.
4— Groupe B,: déploiement des relations _interhu-
maines (propositions 33-49) ; cest-a-dire dérivation
de Yamour et de la haine interhumains en fonetion
des eirconstances.
82
LA VIE PASSIONNELLE
Entre ces deux branches, une colonne médiane
comprend, outre les propositions 4-8, la proposition 28, qui
sert de plaque tournante, et la proposition 51, vers
laquelle tout converge et qui joue le role de conclusion
générale. é
Chacun des quatre groupes, de plus, forme Iui-méme un.
petit arbre quasi-séfirotique a V'intérieur du grand. Et cer-
taines de leurs branches ont également une structure peu
diftérente.
Lo livre IIL, cependant, ne s'achéve pas ici. A lensem-
tile A, Az B, Bz succéde un groupe de propositions (62-57)
qui forme, 4 lui seul, un petit arbre quasi-séfirotique indé-
pendant. Get arbre, symétrique et inverse du précédent,
en est en quelque sorte Ie complément. Spinoza y décrit
les effets de admiration sur les passions déja étudiées.
‘Aussi comprend-il quatre groupes (A’y B'p A’, et BY), qui
correspondent respectivement & ceux du grand arbre et
pourraient, par une rotation autour d'un axe horizontal,
se rabatire sur chacun @eux.
D’oit les cing parties de notre exposé, pour Ia compré-
hension duquel nous invitons notre lecteur a se reporter
constamment & Ia figure 1.
1, — Fondements de ta vie passionnelte individuelle
Groupe A:)
du conatus toute 1a game des
passions humaines, Spinoza doit néeessairement assumer
lune problématique qui, au xvn"' siécle, va de soi. Tous les
philosophes de la vie morale, en effet, travaillent & cette
époque sur un matériel identique : chez tous, & quelques
variantes prés, In liste des passions est la méme, et Vori-
ginalité ne peut consister pour eux que dang Ta fagon dont
iis en combinent les éléments. Mais cette combinaison
elleméme a des régles; 1a plupart des auteurs, en parti-
culier, s'accordent pour considérer comme primitifs trois
couples de sentiments fondamentaux : amour et haine,
désir et aversion, joie et tristesse (ou plaisir et douleur),
‘Le rapprochement, de Ja liste spinoziste des passions et de
la liste cartésienne nest donc ni plus ni moins signifcatif que
niimporte quel autre. La comparaison avec Hobbes aboutit au
meme résultat,
83
SPINOZA,
dont tous les autres seraient plus ou moins dérivés?. La
question qui se pose, dés lors, et qui détermine les grands
clivages, est de savoir auquel de ces trois couples revient
Ja priorité. D’oi trois types logiquement possibles, et effec-
tivement réalisés, de théories des passions.
Un tel débat n’est nullement gra‘uit. Ce qui est en jeu,
dertiére cette querelle de préséance, c'est toute une
conception de homme et, en un sens, toute une concep-
tion du monde. On pourrait méme se demander si le contlit
théorique, ici, n’exprime pas & sa maniére une réalité tres
jintensément vécue au xvir siécle : le passage lent et diffi-
ile de Vhomme médiéval & Phomme moderne. Spinoza,
fen tout cas, le prend trés au sérieux. Cos trois types de
doctrines qui s‘affrontent, il les hiérarchise selon le degré
@alignation qu’ils lui ‘semblent comporter, réservant
Pessentiel de ses coups & celui qu'il associe @ la vision
médiévale du monde, expédiant par prétérition celui qui
Jui parait constituer une position intermédiaire, et pre-
nant parti pour le plus moderne moyennant une importante
rectification.
Le degré maximum d’alignation est représenté par les
anthropologies et les morales les plus traditionnelles, dont
Vinspiration est explicitement finaliste. Selon celles-ci,
Vhomme est naturellement orienté vers un Bien objectif
et transcendant, et cest Vattrait exereé par ce Bien qui le
met en mouvement et rend compte de toute sa conduite.
Dans la théorie des passions, sous la forme classique
qu'elle a prise avec saint Thomas <’Aquin, cela se traduit
par le privilége accordé & amour. ¢ Racine premiére de
toutes les passions »%, écrit le plus éminent commenta-
teur de saint Thomas, l'amour < consiste & se complaire
dans le bien >4; il est Y" ¢ expérience pour ainsi dire
immédiate d'une affinité naturelle et comme d'une complé-
mentarité du vivant et de l'objet qu’il rencontre... A peine
stest-elle produite, cette passion suscite un mouvement de
Vappétit pour s'emparer réellement, et non plus intention-
nellement, de Vobjet qui Iai convient. Ce mouvement est
Je désix, né de amour, S'il arrive A ses fins, le terme de
2Ce sont les passions du concupiscitfe thomiste, Le dualisme
concypicibesuatebt, vidieulisé, par Descartes, nest plus unt
ment admis, De toute
wercellement fason, Yiraseible "presuppose Ie
9B, Gilsom, Le Thomtisme (Vrin, 1942), p. 374
"Ty p. 316.
at
LA VIE PASSIONNELLE
ce mouvement est le repos dans la possession de l'objet
aimé. Ce repos est la joie, satisfaction du désir » 5,
Les morales de ce type sont les plus courantes, ear elles
reposent, en définitive, sur une illusion spontanée, univer-
sellement répandue, quelles ne font que rationaliser :
Villusion de Vobjectivité des valeurs; celle qui nous fait
croire, d'une part, que "homme tend par nature vers
quelque chose d’autre que son moi individuel, ef, d'autre
part, que certains objets et certains étres sont destinés
par nature & combler cette aspiration. C'est cette illusion
‘que Spinoza critique avec le plas de vigueur, non seule-
‘ment dans la célébre formule du scolie de la proposition 9
du livre It de PEthique*, mais aussi dans YAppendice du
livre T et dang la Préface du livre IV; car en elle se révele
Yorigine méme de tous nos malheurs.
Un degré moyen d’aliénation est représenté par les
anthropologies et les morales d'inspiration hédoniste, qui,
longtemps éclipsées au Moyen-Age of elles servaient sur-
tout de repoussoir, connaissent maintenant une vie nou-
velle avec, en particulier, le néo-épicurisme de Gassendi.
Celles-ci, évidemment, privilégient Ja joie, ou Je plaisir,
de Yattrait duquel elles s’efforcent de faire dériver toutes
Jes aspirations humaines. Le modéle de cette réduction est
fourni par Vexposé classique du De Finibus? indéfiniment
paraphrasé par tous les Epicuriens du monde.
Spinoza ne critique jamais explicitement cette position.
Par rapport & la précédente, elle constitue certainement,
a ses yeux, un progrés dans Je sens de Ja lucidité, Elle a
une ulilité’négative et polémique, dans la mesure oi elle
contribue & dénoncer la pseudo-objectivité des valeurs :
les soi-disant biens objectifs ne sont rien d’autre que des
instruments de plaisir, amour n'est rien d'autre que la
joie accompagnée de Pidée d'une cause extérieure; toute
‘énonciation de ce genre peut étre considérée comme une
propédeutique a la désaliénation véritabl
Sans nul doute, cependant, Vhédonisme demeure une
alignation, Car le plaisir, ce n'est pas moi; méme si ce
West pas autre chose que moi, méme si c'est un événe-
5 Id, p. 318,
«« “nihil nos, conarl, velle, appetere neque cupere, quia id
bponuni"esse “udicarmus sed, contra, mos’ proplered aliquid
bonum esse judicare, quia td ‘conaniur, volumts, appetimus,
atque cupinus. »
1 Cf, Clodron, De Finibus, 1, 3436, 4254,
85
sPixoza
ment qui m’arrive, cet événement ne se confond pas avec
mon individuals.’ L’attachement au plaisir, dés lors, s'il
est moins nocif que Vattachement a un objet externe
(comme Spinoza le dit expressément au § 5 du Traité de
la Réforme de Entendement)*, n’en constitue pas moins
un commencement de perversion. Et, du reste, Phédonisme
nest jamais qu'une position instable : du plaisir, nous
sommes presque infailliblement reavoyés, soit & Vobjet
qui nous Te procure, ee qui nous reméne a Vextraversion
finaliste, soit au dynamisme interne qu’il manifeste, ce
qui nous améne & Ta découverte du moi.
Le degré le plus haut de lucidit:, en effel, est repré-
senté par les anthropologies et les morales du type
« égoisme uniyersel »; c'est-i-dire, avant tout, par Hobbes.
Celui-ci incarne, sous sa forme la plus parfaite, ce que
Yon a appelé « Vindividualisme possessif »’. Le mobile
fondamental de Yhomme, chez lui, r’est plus Ia recherche
du plaisir, mais affirmation et Pexpansion du moi indi-
viduel : amour-propre, qui, avee le calcul de Vavenir,
devient yolonté de puissance. La priorité, ici, revient
done au désir : désir orienté, non pas vers in réatisation
d'une valeur transcendante, non pas méme vers Pobten-
tion de la joie considérée ‘comme une fin en soi, mais
vers le mnaintien de Pindividu dans existence et V'acerois-
sement de son pouvoir sur le monde; désir qui, Hobbes le
dit expressément, est un conatus (endeavour) d’autocon-
servation, Tout, hors de nous el en nous, n’est que
moyen pour cet égoisme calculateur. Et Famour, et le plai-
sir lui-méme, n'en sont que des aspects ou des modalités
secondaires.
Spinoza se range dans le méme camp, prenant ainsi
parti dans In grande querelle de 'amour-propre qui anime
tout le xvi" sidcle. Mais, ses prémisses métaphysiques et
ses exigences éthiques élant autres, son point de we ne
coincide pas purement et simplement avec celui de
was Mati tne oem moda, sat
de ly i
fated aime eta eee reece
(G, t. IL, p. 6; P, pp. 159-60.)
Gen tae de Fay de 8 phen he
ce RE es: 7 ret
* Cf, infra, pp. 1523.
"ttn ew
86
LA VIP PASSIONNFLLE
Hobbes. Sa théorie du désir approfondit et dépasse & la
fois, & ses yeux du moins, celle du philosophe anglais.
‘La théorie hobbienne des passions fondamentales, en
effet, repose tout entiére sur Ia distinction entre mouve-
ment vilal et mouvement animal. Le mouvement vital,
défini par la circulation du sang et tous les processus qui
Sty ratlachent (vie végélative), est un mouvement en cycle
fermé qui, se reproduisant Ini-méme en. permanence, n'a
pas dautre fin que Iui-méme. Les mouvements animaux
(ie de relation), au contraire, toujours dirigés vers Vexté~
Hieur, servent dauxiliaires au mouvement vital; ils sélec-
tionnent les objets qui le favorisent et éliminent ceux qui
Tentravent. Et ce que Hobbes appelle le conatus n’est rien
autre que Pesquisse infinitésimale de l'un ou Vautre de
ces mouvements animaux: désir s'il préfigure Vappro-
priation d'un objet biologiquement utile, aversion s'il pré-
figure la fuite devant un objet nuisible™
‘De lA résultent deux conséquences. D'une part, les trois
couples de passions fondamentales n'en font plus, en
réalits, quun seul. En effet, si l'amour et Ia joie doivent
se distinguer du désir, ce ne peut étre que modalement,
hon réellement, L'amour n’est plus, comme dans la concep
tion classique, une appréhension du Bien antérieure
tont désir; le plaisir n'est plus un état de repos consécutif
ala satisfaction du désir; 'on est déja mouvement, Pautre
est encore. Tis ne peuvent done se définir, dans le meil-
leur des cas, que comme le désir Iui-méme modifié d'une
cerlaine facon. Mais si la modification en question inter-
Vient déja dans la définition du désir, toute distinction,
Inéme modale, s’évanouit. Or est bien ce qui se produit
ici. Puisque le désir est toujours intentionnel par nature,
i devient psychologiquement identique & I'amour; seule
Yen sépare une différence purement extrinséque : absence
dans un cas, Ia présence dans Vautre, de Vobjet vers
Jequel ils tendent. De méme, puisque le désir est effort
pour gusciter ou conserver tne excitation favorable, et
Faversion effort pour repousser une excitation défavorable,
leur contenu épuise entigrement celui du plaisir et de la
douleur, qui n’en sont plus que l'apparence subjective ™.
Impossible, dés lors, de concevoir plaisir et amour comme
deg aliénations du’ désir; celui-ci ne saurait jamais se
” Pid.
8 Ibid, p- 24.
¥ bid, p. 3.
87
SPINOZA,
méconnaltre Iui-méme en s'investissant sur le monde.
Toute passion apparalt comme un caleul conseient, sinon
toujours organisé. Lillusion d'obje:
si bien dénoneée qu’elle en devient inexplicable.
D’autre part, Vinstauration d’un rapport de type encore
finaliste (car c'est bien de cela qu'il s'agit) entre désir et
mouvement vital rend le stade du pur égoisme biologique
définitivement indépassable, Notre tendance & persévérer
dans T’étro, en effet, ne s‘identifie pas A I'étre dans lequel
nous tendons & persévérer; elle n'est que moyen a son
service, mouvement desting & sauvegarder un autre mou
vement. Et cet étre & sauvegarder, c'est tout simplement
Vexistence biologique brute, sans autre spécification. Tout
comportement humain, dés lors, quelle que soit la
complexité des médiations qu'il fail intervenir, se raméne,
en definitive, & une simple dérivation de Pinstinet de
conservation; jusque dans les nuances les plus subtiles du
sentiment de Vhonneur, jusque dans les aspects les plus
sitet de 1a spéculation intellectuslle, Uhomme ne cher-
che jamais qu'une chose: vivre le plus longtemps possi-
dle EL Ia erainte de la mort violente, griee i laquelle
nous nous constituons en société civile”” n'est, au fond,
que la prise de conscience de ce projet fondamental. Aussi
Texistence politique dans un Etat absolutiste, qui seule
peut satisfaire cet immense besoin de sécurité, constitue-t-
elle Vultime salut.
Tel ne saurait étre, bien entendt, le point de vue de
Spinoza. Nul dualisme, chez Iui, entre la tendance et une
fin arbitrairement. restreinte qui la commanderait de
Vextérieur. Sans doute le désir peut-l étre encore assim
A instinct de conservation, mais celui-ci est beaucoup
plus riche qu'il ne le semble au premier abord. Ce qui est
A conserver, ici, ce n'est pas le mouvement vital abstrai-
tement séparé de ensemble ott il s'intdgre : c'est, dans sa
tolalité, le systéme de mouvements et de repos dont la
formule définit notre individualité. Nous voulons vivre,
certes, el, en un sens, seulement vivre; mais la vie ne se
réduit pas a la simple circulation da sang ni aux autres
fonctions biologiques élémentaires. Vivre, cest. vivre
4 « This Motion, which is called Appetite. seemeth to be @
corroboration of Vital! motion, and a celp thereunto, » (Ibid.)
% CE, infra, pp. 1523.
1 Ibid, ch. x1, p. 50; ch. xmr, p. 66,
™ CE TP, ch. v, § 5 (G, t. ILL, p. 296 ; P, p. 1006),
88
TA VIE PASSIONNELLE
selon mon essence individuelle; car, lorsque je perds
Saieer"fe meurs, méme si mon sang circule toujours.
Persévérer dans T'éire, pour tout etre, c'est persévérer
dang son étre (« in suo esse >) ®, Ot, nous Ie savons déja.
ce systéme total de mouvements et de repos qui constitue
nolre étre se reproduit Iuiméme en permanence par son
propre fonctionnement, comme c’était le cas chez Hobbes
pour le seul mouvement vital; et celle auto-reproduction,
hous le savons aussi, c'est précisément le conalus spino-
aisle, qui, Join d’étre surajouté & notre essence individuelle,
Se confond avee elle aussi longtemps qu’elle existe en
facte2. Mais ce systéme, et par conséquent ce conatus,
puisque en nous jl englobe tout, englobe aussi tous nos
Uésirs particuliers dans la mesure of ils viennent de nous;
eoux-ei se raménent done a des aspects fragmentaires et
fh des conséquences partielles d'un désir plus fondamental
qui nest pas autre chase que nous-méme. Plus de subor~
Uination, dés lors, du désir considéré comme simple moyen
a une forme particuliée et particiliérement pauvre de
mouvement qui seule posséderait le privilege d’auto-fer-
meture : mon désir est désir de soi, et ce désir de soi,
Cest moi, dans toute ma richesse et toute ma complexité.
‘Ainsi se trouve garantie la possibilité d’un dépassement
ullérieur du pur égoisme biologique, par simple appro-
fondissement ‘de celui-ci: possibilité qui se réalisera
Tersque le désit parviendra & la connaissance adéquate
de soi. L’instinet de conservation, sous sa forme ordinaire,
fest un égoisme encore inconscient de son propre contenu;
Ta détormination de ce contenu ne nous sera donnée qu’aa
niveau de la connaissance du trolsitme genre, qui seule
‘dévoilera notre essence singuliére. :
nage Akos 2s tn a aon Seale,
Spinoza va pouvoir, contrairement & Hobbes, la distinguer
modatement de celle de joie et de celle d'amour. Une fois
identifié & essence actuelle de Vindividu, le désir peut
se concevoir indépendamment de toute référence & un
objet externe, indépendamment méme de toute référence
fu eargetére favorable on défavorable des excitations qui
lui adviennent; une fois éliminée cette dernitre référence,
il p’a méme plus de contraire : la notion d’aversion perd
fout sens. Mais, cela dit, des excitations ne Iui en advien-
» Eth. IV, prop. 39, scolic,
Eth, UW, prop. 9.
2 Eth. TH, prop. 7.
3y
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Klhteysh Martyra Se Politikh Dikh IIDocument1 pageKlhteysh Martyra Se Politikh Dikh IInbozekidisNo ratings yet
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Protaseis Enagontos Kata THN Met Apodeixh SyzythshDocument3 pagesProtaseis Enagontos Kata THN Met Apodeixh SyzythshnbozekidisNo ratings yet
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Aithsh Gia TH Dosh Bebaiotikou OrkouDocument3 pagesAithsh Gia TH Dosh Bebaiotikou OrkounbozekidisNo ratings yet
- PROTASEISDocument2 pagesPROTASEISnbozekidisNo ratings yet
- Prostheth ParemvashDocument2 pagesProstheth ParemvashnbozekidisNo ratings yet
- Viaih Diakoph Epanalhpsh DikhsDocument2 pagesViaih Diakoph Epanalhpsh DikhsnbozekidisNo ratings yet
- KLHSH Gnostopoihsh Martyron (Enorkh Bebaiosh)Document2 pagesKLHSH Gnostopoihsh Martyron (Enorkh Bebaiosh)nbozekidisNo ratings yet
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Klhteysh Martyra Se Politikh Dikh IDocument2 pagesKlhteysh Martyra Se Politikh Dikh InbozekidisNo ratings yet
- KLHSH Logo AnarmodiothtasDocument2 pagesKLHSH Logo AnarmodiothtasnbozekidisNo ratings yet
- PROSEPIKLHSHDocument2 pagesPROSEPIKLHSHnbozekidisNo ratings yet
- Aithsh Gia TH Diorthosh ApofaseosDocument2 pagesAithsh Gia TH Diorthosh ApofaseosnbozekidisNo ratings yet
- Syntax HDocument3 pagesSyntax HnbozekidisNo ratings yet
- KLHSH Meta Apo MataioshDocument1 pageKLHSH Meta Apo MataioshnbozekidisNo ratings yet
- Paragelia Epidoshs Agoghs PolymelousDocument1 pageParagelia Epidoshs Agoghs PolymelousnbozekidisNo ratings yet
- Symvibastikh Epilysh H Metavolhs TopouDocument1 pageSymvibastikh Epilysh H Metavolhs TopounbozekidisNo ratings yet
- Paraithsh Apo Dikografo AgoghsDocument1 pageParaithsh Apo Dikografo AgoghsnbozekidisNo ratings yet
- Anagastikh KatasxeshDocument2 pagesAnagastikh KatasxeshnbozekidisNo ratings yet
- Protaseis Prosthkh AntikroushDocument5 pagesProtaseis Prosthkh AntikroushnbozekidisNo ratings yet
- Aithsh Gia Eggrafh Agoghs Sta Biblia DiekdikhseonDocument2 pagesAithsh Gia Eggrafh Agoghs Sta Biblia DiekdikhseonnbozekidisNo ratings yet
- Edolh Dikhgorou Prosopikh KrathshDocument1 pageEdolh Dikhgorou Prosopikh KrathshnbozekidisNo ratings yet
- Dhlosh SHZHTHSHSDocument2 pagesDhlosh SHZHTHSHSnbozekidisNo ratings yet
- Enorkh BebaioshDocument2 pagesEnorkh BebaioshnbozekidisNo ratings yet
- Gnostopihsh Viaihs Diakophs Ths DikhsDocument2 pagesGnostopihsh Viaihs Diakophs Ths DikhsnbozekidisNo ratings yet
- Aithsh Paratashs Prothesmias Exetaseos MartyronDocument2 pagesAithsh Paratashs Prothesmias Exetaseos MartyronnbozekidisNo ratings yet
- Efesh IDocument6 pagesEfesh InbozekidisNo ratings yet
- Aithsh Eleutheroseos ProsopokratoumenouDocument2 pagesAithsh Eleutheroseos ProsopokratoumenounbozekidisNo ratings yet
- Aithsh Gia TH Sydmhsh ProthesmiasDocument2 pagesAithsh Gia TH Sydmhsh ProthesmiasnbozekidisNo ratings yet
- Monomerh Dhlosh ApotyxiasDocument1 pageMonomerh Dhlosh ApotyxiasnbozekidisNo ratings yet
- KLHSH Gia Parastash Se Enorkh BebaioshDocument1 pageKLHSH Gia Parastash Se Enorkh BebaioshnbozekidisNo ratings yet
- Efesh IiDocument2 pagesEfesh IinbozekidisNo ratings yet