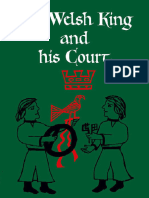Professional Documents
Culture Documents
Strus - L Apocryphe Grec de La Passion de S. Étienne
Strus - L Apocryphe Grec de La Passion de S. Étienne
Uploaded by
Basil Lourié0 ratings0% found this document useful (0 votes)
14 views20 pagesOriginal Title
Strus _ L Apocryphe Grec de la Passion de S. Étienne
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
14 views20 pagesStrus - L Apocryphe Grec de La Passion de S. Étienne
Strus - L Apocryphe Grec de La Passion de S. Étienne
Uploaded by
Basil LouriéCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 20
pteneids Line 112930 185
L/ORIGINE DE L'APOCRYPHE GREC
DE LA PASSION DE S. ETIENNE, _
A propos dun texte de deux manuserits récemment publics
tht nvr oar ut e asin Sne Sean rtm co
oni ecg. Duobes texbus manips re
separ dei inven ee ings hsforc-rtica expcaones pact de
inven nun ne nobus ext vent
récit de la Passion du protomartyr Etienne, tel qu'il nous a as
sur la lapidation méme et sur |'enterrement du protomartyr. Cc sien
Fe i hr Sars
1 ae Se ee gle
eee ta wan
in Dans le discours du prétre Grégoite, dité par N. MARR, Le synaxaire _séorgien, dan
sa nnn
ri artnet A
ram tr si ene
oer tipatriepaeres ae oe
sabe eee Sette a
LLAPOCRYPHE GREC DE LA PASSION DE 5. ETIENNE 19
rative, quel texie est plus ancien par rapport & autre. A cette étude, qui
‘inspire de la méthode de Mhistoire de la rédaction, serviront aussi les
renvois aux versions slavonnes et géorgienne. Une fois établi le texte
plus ancien nous tenterons, a l'aide de la critique historique, den déga-
ger la date d’origine.
‘Nous espérons pouvoir ainsi éclairir davantage la question épineuse de
la datation du récit de la Passion. Les opinions sur cette question varient
d'un auteur l'autre, sans trouver aucun appui surles donnés solides.
our en donner quelques exemples, citons les articles des encyclo-
pédies et des dictionnaires. L’opinion de FM. Abel, qui résulte de son
Etude cohérente et documentée’, débouche sur des conclusions, qui doi-
vent étre corrigées & la Iumire de nouveaux donnés. Sans rapporter des
arguments de poids, Abel place l'origine du récit de la Passion au Ve
sitcle, peut-&tre en Fgypte®. C’est cette opinion d’ Abel que les auteurs
cont repris dans les articles dédiés & s. Ftienne dans les encyclopédies,
‘comme par exemple ceux de S. Duplacy’ et de SJ. Hartdegen*. Plus
prudent est G.D. Gordini, se limitant & laffirmetion qu'il « est difficile
@ établir ot la Passio a été éerite et & quelle éfoque on peut dater son
origine »*.
‘A part le texte de la Passion, conservé dans Ie synaxaire géorgien en
Arménie, qui est une refonte complete de la Iégende, les textes grec, sla-
‘von et géorgien de I'apocryphe concordent en ce qui concemne les lignes
générales du récit. La version géorgienne abrege ou omet certaines par-
ties, mais n'ajoute pas de nouveaux éléments. Les textes grecs et les
‘versions slavonnes s"accordent en plusieurs détilles, ce qui fait suppo-
ser que ces quatre textes proviennent d'une Vorlage commune. Les dif-
{érences, dont nous parlerons plus bas, sont a attribuer facilement aux
auteurs des synaxaires
Sade et présentée dans Varicle FM. ABEL, «Beane», dans Dictionnaire de la
‘Bible Saplémene, vl Il, Pri 1930, col 132-1146
“ Leepinion exprimde dans Varicle FM. ABEL. « Etienne», col 1135 et dans étude
ingite du mime auteur, La légende apocryphe de Saint Etiense propos de quelques txies
Béorgiens (pre manuscfpo), érusalern 1931,
5'S' DuPtacy, « Elene », dans G. JACQUEMENT (ed), Catolcame hier, ajourd ha,
demain, vol. IV, Puss 1956, col. S73: sil existe un récit apocryphe du martyre, dont
orignal grec (Gert peu een Egypte a IV-Ve est pends»
SJ, HARTDEGEN,« Stephen, St», dass New Carlie Encyclopedia, New Yotk, vo.
ZAI, 1967, col 694: «This apoeryphon originated cutsde of Palestine, most probably afer
the above mentioned universally Teeived testimony of Lucan the priest (415). IF the
‘Slavonic version mentions the martyrdom of Gamaliel and companions with Stephen the
Georgian MSS does not. The former obviously invented it te explain the discovery oftheir
‘ois with tha of Stephen th protomaty
SGD. Goroin, « Stlano protomatre, Santo, dans F. CARAFFA (ed), Bblionheca
‘Sonctoram, vo. XI, Roms 1968, ol. 1380 L'autur se demandes origin du réit ne sot
pis placer an V-Vie site
2» ‘ANDRZED STRUS
1, LE CONTENU DU RECIT DE LA PASSION
[Nous rapportons fe contenu apres 1a recension conservée dans 16
smanysert de I Escorial (Esc); une la forme identique, sauf un seul point,
Mavjouve aussi dans le manuscrit 387 de la Bibliotheque Vaticane (Var)-
‘E toute recension, que nous nommons A, appartiennent aussi les textes
jen version slavonne de Zamosc (Zn), d'une autre recension slavonne
{fe Lvov (Ln) et de la version géorgicnne du mont d'Athos. Toutefois ta
eésence de Pilate est décrite dans ces textes de fagons diferentes: 1
Prttion stavonne Lv contient trois particulars concemant Pilate et sa
Tamille, le texte Esc et la version géorgienne rapportent seulement
Tuudience devant le tribunal de Pilate, la version slavonne Zi et le texte
Var ne contiennent aucune référence a Pilate, Nous complétons done le
vee Bse avec les éléments du récit plus développé, celui de Ia version
slavonne Lv.
1.1. La trame narrative du récit
in prologue, semblable A celui de s. Luc au début de son oeuvre,
eee cs gu juste Te waa de aster et garntisnt
Presinilité des venements qu'il va raconter. On peut en déduire que
Teateur a conmu une tradition orale, un vénérable mémoire (avinng
aqudhe) qui a été transmis & ses contemporains.
reo) aul ac wetmmence avec a ate pci de deux ans aus
sont écoulés depuis la passion, la résurrection et I'ascension du Christ:
Penal les habitants de érusalem se poursuivent les controverses au sujet
ram daiseance, de 1a mort et de la résurrection de Jésus, amenant &
oe ers des dosteuts &’Ethiopie, de Thébaid, d’Alexandsie, de Mau-
iianie d' Asie, de Babylonic, sans parler de ceux de la ville sainte. §-
‘hanie, onts sur une pace élevée, prononce un diseours en faveur de
Tanuieeance virginale, des miracles, de In descente du Christ aux enfers
tiie sa résurrection. Le discours se termine par une impressionnante
Sesciption des prodiges apocalyptiques du jugement de I'univers Jos de
fescPhde venue du Seigneur. Au lieu de décrire le jugement, Etienne
apport la scene dela session du Chris a droite du PEre, Conspué par
Trenstance, Ie saint diacre est conduit devant Pilate qui, du haut des
‘egrés du parvis extérieur probablement, prend Ia défense du prévenu &t
weeSche aux juts leur emportement Suit une comparution devant les
Trains prétes. Caipbe fait batre Eienne de verge, tandis que le saint
Jfpcre prie pour ses bourreaux. Les témoins oculaires voient les anges
cervir le valeureux combattant, tandis que Pilate se fait baptiser avec sa
femme et ses enfants
LAPOCRYFIE GREC DE LA PASSION DE S. TENE a
__ La deuxitme partic commence par une discussion qui s’engage entre
TBtenne et ses contradicteurs qui, at bout de trois jours et de trois nuit, ne
peuvent résister a la sagesse du diare. De guere lasse, les prétres man-
dent par lettres Saul de Tarse, alors en train de perquisitionner chez les
chrétiens de Césarée. Celui-c, Gant accouru, fait comparatre devant lui,
Sur les degrés du Temple, son cousin Etienne, augue il adresse de véhé-
ments reproches. Dans sa réplique le prévenu annonce & Saul sa conver-
sion prochaine, ce qui met ce demier dans une tell fureur qu'il frappe son
parent a coups de baton. Mais un rabbi du nom Gamalielintervient en
faveur d’Etienne et donne un souflet & Saul, son ancien disciple. Le rabbi
trahit des sentiments si profondément chrétiens que les anciens crient au
blasphime et demandent la mort d’Etienne et de Gamaliel. Saul met les
deux personnages en prison, mas le lendemain on soumet aux supplices
seulement le diate. Toutefos Etienne sort triomphant de divers supplices
ave le seco de ang de Dw podige ui cas de nombres ae
sions au Christ. La remarque qu'Etienne état «le prophate et le maftre
Auprés de tout le peuple » termine la deuxitme partic
Le jour suivant on porte Etienne hors de la ville pou le faire moutir
Mais le saint diacre, debout sur un rocher choisiprés du Mont des Oli-
viers, prononce un second discours sur Ia naissance virginale de Jésus
(Christ, en reprochant aux auditeurs leur dureté de coeur. Aprés une
harangue que Gamaliel s’fforce en vain d'adcuei, Etienne est conduit
garrotté dans la prison chez le magistrat Alexandre de la « e&lebre ville
de Tibériade ». Pendant la nuit, une voix d'en haut, accompagnée d'une
Sblouissante clanté, encourage le martyr, car "heute du demier combat
approche. Le matin la foule se rend & a prison od ily a, 8 coté d’Etien-
nev une quantité de files, ente autres Abibos, Nicodeme et Gamaiel,
fet aussi Pilate avec sa femme et ses enfants, A la vue de ces adhésions,
Saul demande la lapidation de peur que puisse s'acroire le nombre des
conversions, et tout le peuple s'écrie: « Qu'il soit lapidé! » Les bour-
eaux hésitent. Saul, furibond, enléve aux servants leurs habits qu'il
{depose sur son sidge et commande a ses gens de mettre la main sur
Etienne suivant le rite légal. « Saul, Sau, dit le condamné, ce que tu me
fais aujourd'hui, tu auras demain a le souffrir ce la part des mémes juifs
et alors tu te souviendras de moi.» De plus en plus courroucé, Saul
dlnne le signal de 'exécution et la gréle de pierre se ft si dense qu'elle
obscurcissait la lumiére du soleil.
‘Alors Nicodéme, Abibos et Gamalicl se précpitent pour faire &
{Etienne un rempart de leur corp. Ils succombent sous les pierre et par-
ticipent au triomphe céleste du protomartyr. Le saint martyr end son
dime & Diew vers 10 heures en priant pour ses ennemis. Tout le peuple,
en voyant leurs ames portées au ciel par les anges, mene un grand deuil
pendant trois jours et trois nuits. La conclusion du récit concernant la
a ANDRZED STRUS
sépulture débouche sur des détails tellement dispersés que chaque mana-
sett offre une version différente. Nous y revenons toute 3 l'heure.
Le récit dans sa totalité manque d'unité logique. Etienne est trois
fois arréé (deux fois par la foule et une fois par Saul), trois fois mis en
prison, deux fois condamné & mort. En plus, on le porte pour étreenuci-
fie sans l'avoir auparavant condamné & mort! Malgré les arrestations et
ies supplices le valeureux diacre prononce son deuxiéme discours libre-
tment, Gamaliel est mis en prison avec Etienne, mais & la suite il se com
porte en homme libre. Pilate se trouve aussi dans la prison avec sa ferame
Er ses enfants. Ces incohérences semblent prouver le caractére composé
du récit. Les deux césures de caractére doxologique confirment cette
opinion en se donnant comme certains indices de la division du récit.
1.2. La structure du récit
En tenant compte des indices formels et du contenu, nous pouvons
dresser le schéma suivant de sa structure:
STRUCTURE
INTRODUCTION
1. Premiére passion d’Etienne
1. Le discouts d'Etienne (Il, 1-42)
2. L’arrestation (IL, 1-4)
3. Le tribunal de Pilate ~ sans condamnation (II, 5-11)
4. La flagellation d'Etienne (ll, 12-17)
5. La révélation des anges (II, 17-18)
6.La conversion de Pilate et de sa famille (L¥)
I Dewxiéme passion d’Etienne
1 La discussion d'Eienne avec la foule (IV, 1-11)
2. Le jugement de Saul - sans condamnation (V, 1-25)
3. La flagellation d’Etienne par Saul (VI, 1-2)
4. La défense par Gamaliel (VI, 2-14)
‘5, Lamise en Prison d’Etionne et de Gamaliel (V1, 15-17)
6. La crucifixion et autres supplices 4’Etienne (VI, 18-26)
7. Larévélation d'un ange (VI, 27-28)
8. La conversion de la foule (V1, 28-30)
nt Troisidme passion eta mor d’Etienne
Ie discoure tiene pres du Mont des Otvirs (VIL,
2. Varestaton (VIL, 1-11)
3. La prison d’Etienne et la vision nocturne avec I'annonce de sa
‘mort (VI, 11-17)
4. Le condamnation Etienne pale Sain (IX, 1-4)
30)
LUAPOCRYPIE GREC DE LA PASSION DE 5. ETIENNE 2B
‘5. La condamnation d’Eienne par Saul (IX, 5-14)
6. La lapidation et la mort du diacre et de ses ois amis (IX, 15-28)
7. La révélation des anges et des Ames des ustes (X, 1-3)
8.La conversion de tout le peuple et le deuil d’Etienne (X, 4-5)
CONCLUSION (doxotogie)
Les trois parties du récit sont développées autour de I’axe structurale
le discours du diacre — les supplices — la révélation des anges (d'un
‘ange) - la conversion. Dans la deuxitme parte inteviennent deux per-
sonnages avec les réles différents: Saul de Tarse comme juge responsable
des tortures du saint diacre, Gamaliel comme défenseur d'Etienne. Les
deux personnages téapparaissent aussi dans la troisitme patie, ol
Gamaliel défend encore une fois Ftienne et meurt pour lui, tandis que
Saul prononce un discours contre Etienne et le condamne & mort (malgré
au'auparavant une analogue sentence de condamnation ait &é émise par
te Sanhédrin), et e'est Ini qui donne 'orde dele lapider®.
La comparation d'Abibos et de Nicodéme, qu'on rencontre & V'im-
proviste dans la prison avec Etienne, Gamaliel et Pilate avec sa famille,
stun épisode isos et reste en marge du réit
1.3. Le changement de Ia structure dans la recension & et dans les,
récits « non pilatiens »
Le texte de la Biblioth¢que Ambrosienne (Amb) differe dans plu-
sieurs points des textes de la recension A de fagon qu'il faille V’attribuer
une autre recension, que nous désignons recension B. Ce texte, qui
appartient au groupe des textes « pilatiens », contient les suivants chan-
‘gements par rapport la recension A:
=: manque de prologue
1,5: manque de la vision des anges servant le saint diacre
i, 5: on met en prison seulement Ftienne (sans Gamalie})
—IL,6: la mention de la crucifixion d'Etienne est omise
=I, 1: on insére une importante section dans le discours Etienne
—Il,2: la iscours de défense de Gamaliel est abréxé
I, 6: le texte omet la lapidation des trois amis d"Etienne
1,7: manque de la vision des Ames des justes et le récit du deuil sur
Etienne est altéré
[Nous allons montrer plus bas que tous ces changements sont faits &
dessein et relevent d'une tendance intentionnelle inspirée par des buts
théologiques.
"Le wexte Amb atribue ast Saul le commencement dela lpidaion en Ii fasant
{ter a premite pierre (IX, 18) Ce dal est absent ds ates apoeryphes de la Passion
4 ANDRZEY STRUS
ar les récits « non pilatiens » nous entendons les textes qui omet-
tent complétement les mentions de Pilate et de sa famille; il sont deux:
Te texte grec Vat et la version slavonne Zm. Dans ces textes l'arrestation
d'Etienne en I, 3 est suivi directement par I'ordre des grands prétres de
flageller le diacre, en I, 5 manque la mention du baptéme de la famille
de Pilate, et en TIT, 4 on omet le détal sur la présence de la famille de
Pilate en prison avec Etienne. Les deux textes de la recension A, & savoir
le texte grec Esc et la version géorgienne, omettent la mention de Pilate
en 1, 5 et IM, 4, mais conservent la comparution devant le tribunal de
Pilate (1,3). A
2. ETUDE COMPARATIVE DES THEMES NARRATIFS
DANS LES RECENSIONS A ET B
‘Ayant constaté que Ie texte grec Vat et les versions slavonnes et celle
asorpienne appuient de concert la recension A, représentée parle texte
sijous voutons coniontr elu-e ave la recension B represents par
fe texte Amb Les divergences ene les deux réits se concentrent sur la
présence et le réle de Pilate et de Gamaliel. Les thémes concernant Saul,
Etionne et ses adversares sont peu prés identiques et ne sont pas signti-
Calif pour différencier les deux recensions. Par conte, la présence de
Pilate et de Gamal est capital, parce que chacun6'eux justi le choix
dela stne de a sépulturerapportce dans la conclusion du eit
2.1. Le role de Pilate
Le thime «pilatien » est développé avee plus de détails dans 1a
recension B, mais un texte de la recension A, celui de la version
Slavonne Ly, le contient aussi.
Le néit de ces deus textes atibue au gouverneur romain le méme
role quit a eu dans le Nouveau Testament: il doit condamner Etienne
rete par les jufs. La scene du tribunal de Pilate apparaitausi, en plus
de aversion slave de Lvov, dans le texte grec Ese et dans la version
forgienne, mais elle est absente du texte gree Var et dela version sla
Sonne Zin, les deux textes, qui omettent toutes les mentions de Pilate. TL
faut constater, conte les apparences, que accusation 4’Btienne devant
Pilate nest pas une imitation da jagement de Jésus dans les Evangiles
Te pouverneur est debout sur les dogés, ét Bv éveaduav (Ese I,
Ta recension B rapport ls note du baptéme, mais omet Ia phrase «nous vimes Tes
anges de Diu servic Eaienne m,tandis gue dats larcensin A la situation est complexe: le
texte Eve content la phrase ais ne dt len da baptéme de Pilate, a version Lv rapport un
tau élément
L-APOCRYTHE GREC DE LA PASSION DE S. ETENNE 2
4-5), expression qu’on trouve dans la défense de Paul debout sur les
degrés de Ia forteresse Antonia (Ac 21, 40), mais qui ne revient pas dans
le proces de Jésus; il défend Ftienne en exprimant le regret d’avoir con-
damné autrefois Jésus et en reprochant aux juifs leur folie. I termine par
Tappet aux juifs d’abandonner leur ignorance Un élément commun
pour tous IeS textes, la demande de Pilate « pourquoi grincez-vous les
dents? », fait écho 3 Ta remarque du récit de Ac, 54. La scéne de Pilate
se termine en Esc avec la constatation « ils ont pris Etienne et I'ont porté
en dehors du temple », ce qui semble suggérer que le tribunal aurait eu
Jiew dans le temple, Le texte Amb, qui précise 2t éclare les lieux ambi-
guts, le raconte de facon plus logigue: «ils ont pris Etienne du tribunal
de Pilate (dx® Buccs 108 ThAGzO0) et I'ont porté en dehors du temple »
(UL, 11). Une telle précision rend justice & Vhistoire et prétend & la eré-
dibilicé du récit primitif. Peut-on lui accorder 'a crédibilité en dépit du
texte gree Esc et des versions slavonnes Lv et Zm, qui cependant pour-
rait trouver un appui dans Ac 21, 30-312
Deux autres bréves mentions de Pilate sont conservées seulement
dans Amb (recension B) et dans la version slavonne Ly (recension A).
Quoique les deux textes semblent avoir pris ces détails d'une source
commune, ils ne dépendent pas I'un de l'autre. Amb dit immeédiatement
apres la pritre intercession d’tienne pour ses bourreaux: « Les grands
prétres ordonnérent de garder Etienne dans a prison. Le lendemain, Pilate,
ayant pris sa femme Procla, se firent baptisé en glorifiant Dieu », Rapov
{6 Thast0s TpdxAav thy yovetwa ao} éBaricdgoaw BobsCovTes Tov Ody
(Amb IIL, 18-19). La version slave remplace la mention des grands prétres
avec l'expression « Nous avons vu les anges de Dieu servir Etienne >",
et poursuit « Le matin Pilate envoya chercher sa femme et ses deux
enfants, et tous se firent baptiser et Iouerent Diet »
Enfin les deux textes, Amb et la version slavonne Ly, font voir Pilate
ddans la prison, avec Abibos, Nicodéme et Gamaliel, comme compa-
gnons d’Etienne. Ici aussi, une Iégere différence confirme que les deux
textes, quoique provenants d'une source commune, ont subi des chan-
"tented a eensionB jot 3 yes eta nydwepok Dans version
storgcone Pe parle du viage Beane «smblabe a seat Fun angen expression
Emprmge 4Ac6, 13
"Ses tos tees sont ne formato dew opis o nae de syne on
se demane ea aon de amine eer aes ister Lex dn vero savas
penne texte rv Esc? Outen cert ts dew versions dependents on
fete pls ancien pa es voles fens? La veson gegen spp une conection
St ometant a menton ds temple part encoouo = Alo, ow severe ue de
assemble past cen we pant cr N. Math Le snare pe.
Le mene uoignage i naar ee eave danse tte i cee Edad
sobs bong eb 60 Savers Dep (17-10) legulpouant ep pat
de boptene ce Pe
26 ANDRZES STRUS
‘gements, Le texte Amb dit: « avec Etienne étaient en prison [..] Pilate
fivee sa femme et ses fils », xoi 6 Tiddtas pert tc yovarsds wai sibv
Semvoy cor, tandis que Ie texte slave prévise: « le gouverneur Pilate
avec sa femme et ses deux enfants ». Le texte slave rapporte avec cohé-
rence la mention des deux enfants de Pilate, ce que le texte gree ne
semble pas connaitre.
Deux questions se posent & la conclusion de ce bref apergu compa-
ati, Tout d'abord, lequel des deux textes est le plus proche de la Vor-
lage? Ensuite, les themes « platiens » sontils un ajout postérieur®, ou
bien au contraire, fontils partie de la version originelle de la légende?
2.1.1. Les themes « pilatiens » dans les textes dé’ recensions A er B
Pour répondre & la premitre question, nous voudrions rappeler
<’ahord que le début de la scene de la flagellation du diare dans Te texte
sib Nontient une insertion importante qui dssipe 'équivogue eoncer-
nant le lieu du tribunal de Pilate, dnd Bruatos tod Mddreov. Cette inser-
flan manque dans les textes de la recension A qui mentionnent seule-
went Tenlovement e'Etienne en dehors du temple, comme si le
fouvemeur avait son tribunal au temple! Cependant il ne faut pas ou-
Bier que la seéne a son précédant dans Ac 21, 27-40 od la foule
Unplre de Paul dans le temple et 'Apbtee, sauvé par les soldats 10-
rene prononce sa défense sur les degrés de la forteresse Antonia. La
sateiblance est frappante et elle pouvaitjutifier expression génér-
que gui suagere soit Paresation denne soit Ie tebunal de Pilate dans
Resctos de temple. D'autre pare, la précision du texte Amb évelle le
oupgon d'étre une correction de la lectio dificilior du récit primis
onservée cependant dans la recension A
‘es divergences dans les autres sc&nes concemant Pate peuventils
conficmer la majeure fidlité de cete recension? Ici, il s'agit de a con-
GRanttion entre les deux textes, la version slavonne (recension A) et le
teats gree Amb (gecension B). La version Ly rapporte deux détails qui
‘manquent du texte Amb, & savoir la mention des deux enfants de Pilate et
Tr ulge de gouvemcur dans Pépisode de sa présence avec Etienne en pri-
Em Par contre, Amb appelle la femme de Pilate par son nom Procla,
‘anus que la version slavonne garde I'anonymat 2 cet gard. Il s'agit
Aina MR, JAMES, The Apocrphal New Testoment, Oxford 1926: « The exte-
‘agance ofthe Slavonic text sich tha Ope canact but tink i as been improved by he
[AEN and if Pilate could be gratuitously iseted ~ as I think be has been ~ by one
‘ition others may equally well have been at work» (p. $68). M, BERGER exprime
Tropa crtgue vies dec ugsment,« Un indi italo-gec dela Passion legendaire de
Sunt Bien », dans M. MAGCARRONE, e alii, La Chisa greca im Walia dllVIt al XVI
say hut del Convegno Strico Iterevcesiale (Bar 30.04 ~ 4.05 1969), vl, Padov
1973, p 1388,
COREC DE LA PASSION DE § ErENNE 2
4 ajouts ou d’omissions? Il est difficile d’y r€pondre avec certitude. Le
titre de gouvemneur, ieudy, revient avec constance pour Pilate et ses
suecesseurs dans 1 Evangile de Matthieu et dans les écrits de Luc'*, La
littérature apocryphe, née autour de la personne de Pilate au Ile sitcle
aprés J.-C.", emploie ce titre dans les écrits qui peuvent étre anciens,
meieaal inno = la plupart des apocryphes « pilatiens »", Com-
me Ia version slavonne V'emploie une seule fois dans les tions
Ge Plat, etle grec Arb mele donne point, I tte lt méme ne nows
semble pas étre significatif pour notre question. Quant au nom de la
femme de Pilate et & ses deux fils, le nom de Procla est absent de
lBvangile de Matthiew®, mais on le connait par les témoignages patist
ques® et des apocryphes tels que la Paradosis Pilati, le Martyrium Pilati
gt la Letire de Pilate @ Hérode. Ona pe de nouvelle sr Is enfants
le Pilate. Deux apocryphes, outre les nétres, en parlent: on les men
tionne, mais sans préciser leur nombre, dans I'spocryphe géorgien de la
Passion d’Etienne™ et dans le Martyrium Pilati qui, par contre, en parle
A plusieurs reprises et précise leur nombre, toat comme la version Ly.
Ces détails, plutdt peu connus, sont trop originaux pour étre classés
‘comme des ajouts provenants de la fantaisie d'un copiste ou d'un moine
soucieux des synaxaires. Nous sommes enclins a les attribuer au texte
originel, a la Vorlage de nos textes, qui était bien informée sur les
WMT) 115,227 28, Me 3128 WA 3924
26,99 Maries go nt pa a8 22877
"ann eine tr Pe oni ter esd
span st cpa gh ia
cats pcr ae re Pl, Ps
besia Orientals XLV, a. 204, 1993, 615-687. Etant dormé cependant que l'apocryphe
mie de Pari Ne cl ton, cif Tent Ce
Moneta 1985.59, mone ncn hoo so FS By,
Breve pte eae lcm ie ce
SURV. « Neve Paws Aoki » dans Vigae Chrono 3297) 5.
PSEC oo bn Pine es ei er a Ps
Auton de func ie egret ede
re B Raton en asc dan see Ae SOs
ter Eres rf Ma 186 p50 ton a ped i
Tobe nogage aan ie Marg et ees gsc set oe ton
chy han ape So eae
‘ol da de sper ne eta FH
the vip eine Nate Nace BH ssn Ane lode 03
‘sae oon Maryede Pape
Baar
se Ha in Maca XV: 1 Maes. 26,1
sermon Soins oan Dea
EE Mo pci Be Mae dP
‘ugh a pp ims ml tae
M. VAN ESBROECK, « Jean II de Jérusalem », p. 101ss. mis Ga SoA
28 anozes STHUS
enfants de Pilate et qui avait soin de ne pas oublier son titre d’office.
Nous avons done des petites retouches opérées plut6t sur le texte Amb
‘quia éliminé la mention des deux enfants de Pilate, présente déja dans le
texte grec sous-gisant a la traduction slave, On peut aussi conjecturer
{que la comparution, une fois, du titre gouverneur remonte au rédacteur
‘du méme texte®.
L'analyse de la structure du récit fournit un autre argument en
faveur de la majeure fidéité de la version Lv. Comme nous avons relevé
plus haut, chacune des trois parties de la Passion se termine parla vision
bes anges (d'un ange) et par la conversion de quelqu’un. La conclusion
de la premiére Passion d’ Etienne contient, dans la version Ly et dans le
texte grec Esc, apparition des anges qui servent Etienne, et, dans la
version slavonne seule, la conversion de Pilate avec sa famille. Ces deux
€léments ont da sans doute faire partie du récit d’origine. Or, soit Esc
qu’Amb alterent la structure, ear le premier supprime la conversion de
Pilate, et le deuxitme omet Ia vision des anges par les témoins. Le gree
‘Amb comparé avec la version slavonne Ly résulte défectueux, car retou-
‘ché par une intervention qui a éliminé la vision des anges, un élément
{important du récit primitif, Nous croyons pouvoir en donner la raison.
Comme Amb a omis V'introduction de la Passion od auteur déclare
vouloir transmettre le matériel regu des témoins oculaites, il s’est trouvé
par conséquent contraint d’ometire ici l'expression qui, vient de ces
témoins. Nous conclurons donc que les recensions A et B ont repris le
récit concernant Pilate et sa famille de fagon différente et que ce théme
est mieux conservé dans la version slavonne Ly au désavantage du gree
‘Amb qui a subi de petites retouches.
2.1.2. Les thames « pilatiens » et la Vorlage de la recension A
‘La deuxitme question est plus difficile. Les thtmes « platens » se
retrouvent dans deux textes appartenants aux recensions A et B. Le texte
de Ia recension A est celui de la version slavonne Ly que nous avons
{qualifié comme représentant la forme plus ancienne de celle rapporté
par le texte grec Amb. Les autres textes de la recension A contiennent
tune seule mention de Pilate, la comparution d’Etienne devant son tribu-
Gomme ce texte gre Gat Ia Vorlage dela version slave etd grec Es, nous suppo~
ons quil avait le mot Sryoote dans Ia phrase inyodusantIépisode de la flagliation|
{TBtcdne, qu'un copiste da texte Ese avait perds. Av contaie, le am propre Pros devait
manque js dans a Vorlage. car sy était la Uaducton slave Vaart conserv8, On doit se
emangers ce nom prope fat pas iar pa le rdacteur dela recension B.
spar conte il sere ici une information qi va bien avec sa tendance générale de ren-
rea naration pus logigue, Au eu de la pirate «nous vimes alors les anges de Dic servir
‘Beane nil met «les grands petes ont live Etienne pou qu'il ft gardé dans ta prison»
{atl 17) ce qui impor dan Ia logique du ei le lagelé est mis dans la prison.
LLAPOCRYFHE GREC DE LA PASSION bE $. ETENNE »
nal (le texte grec Esc et la version géorgienne),ou bien ignorent comple
tement la figure du gouverneur (le texte grec Vat et la version slavonne
Zm). Presque tous les thémes « pilatiens »® étant communs aux deux
recensions, il en résulte que leur Vorlage les avait déja connus. Si on les
jugeait comme résultats des interventions postérieutes, 1a Vorlage des
deux recensions serait & considérer tandive et on devrait supposet
Yrexistence d’un autre texte, encore plus ancier, duquel dépendraient les
textes dans lesquels manguent de ces thémes (le grec Vat et la version
slavonne Zm). Et que dire des deux textes qui connaissent seulement la
seéne du tribunal devant Pilate? Sont-ils encore plus anciens ou bien
plus récents? Peut-on les considérer comme représentants dune période
wermédiaire entre les textes non « pilatiens» et ceux « pilatiens »?
Heureusement nous avons deux textes grecs,I'an avec Ia scdne du tribu-
nal devant Pilate (Esc) et l'autre ob elle manque totalement (Vat), nous
ppermettant d’opérer la critique de la rédaction.
Dans les deux textes le premier discours d'Etienne se termine par
une harangue de la foule avec l'exclamation « qu'on I'éte de la terre >
Ensuite Esc introduit la scéne du tribunal aver la construction syntaxi-
que usuelle, un verbe en participe et un autre en temps fini: <éwe
BraBadAdpevor wv Egavov: fhmov abtdv mpd MaGrov Mérovees (UL,
3)°. Une expression analogique termine Mérisode, sb:e hopveeg zby
Rekpavoy fhnqov caniy Eo cod igpod, et introduit In flagellation
@'Etienne, wai ovjoavees abov Sundyovt0 (Ill, 12-13). Le texte gree
Var, qui manque de la sctne de Plate, passe directement la flagellation
avec la phrase: tore Aapves viv Enéqanov- ovjcavees adtiv énuoati:
Srepéov20%. La construction est maladroite, au liew du Schéma usuel du
patticipe + le verbe fini, nous y avons les deux participes non
coordonnés et une forme verbale finie. Voila la synopse de trois textes:
Amb: ‘Reais oy dt as ao
00 ipod mak onfouvrs ey Stole Sanizoweo mp
ead ang Moves (TL, 11-13) anne
at rent Om sme Fd ome pe
ta
sont aot ng a se cen
trate atria te cnndetr cio © yee
Sor Cpe as ofa pn phos seen
“xaire et s'inspire au discours d'Etienne dans Ac 6, 13-14.
epee yr
reagents ec oats eae ies Gop
Se ee tae a a
can tee a oe ea wre
Tiana
A |ANDRZEI STRUS
Bsc: Tore Aaovtes sbv Exégaver iter adebv Eo 100 fepad> xa
ochouraeg abby beus,ovt Rp ns Moves I, 12:13)
Var Tite hapiveeg cv Teigmov oxjoavees abtoy Snuodig
Biqudzovi0 xpd Odi ROvs Rove
La construction si mal faite s'explique par le fait que l'auteur du
texte Vat a omis I'épisode du tribunal devant Pilate qu'il avait dans sa
Vorlage, et par conséquent il s'est trouvé obligé de recoudre le début de
Ia nouvelle section dont l'expression «ils ont pris Etienne et l'ont porté
en dehors du temple » se référat 81 épisode précédent. Ila donc retran-
thé la deuxitme partic de la phrase intiale eta collé la partie restante &
la phrase suivante sans recourir & la conjonction xai. Une parcille opé
ration sest visible aussi dans la version slavonne Zim qui omet toute réf
rence & Pilate, La mutilation du texte y est faite sur le texte slave et Ie
résultat est encore plus grossier. En effet, aprés avoir rapporté les excla-
mations de la foule, le récit poursuit: «Ils le placBrent devant et discute-
rent entre eux m, sans préciser que dabord ils s'emparérent d’Etienne®.
La deuxitme mention de Pilate, celle de sa conversion avec sa
famille, se place aussi dans le contexte du récit primitif, car le schéma
de la structure gardée dans les trois passions d’Etienne lexige. On ne
peut pas dire la méme chose & propos de la scéne de la présence de
Pilate et de sa famille dans la prison avec Etienne. A la rigueur on pour-
rait considérer cet épisode comme un emprunt aux récits apocryphes du
‘Martyrium Pilati dont imagination abonde en épisodes de persécution
ddu gouverneur par les juifs, par le roi Hérode et par l'empereur lui
rméme. Mais ii le sort de Pilate s'arréte sur cet épisode banale: iL ne sera
pas Fobjet de persécution, il ne participera pas au martyre d
L'unique raison plausible de sa présence ici, nous semble
solidarité de Pilate chrétien, & coté des autres chrétiens,tels Gamaliel,
Nicodéme, Abibos et une « foule innombrable » de croyants, avec Ie
héros du récit, le premicr martyr Etienne. Dans cette scene il y a une
‘confrontation des deux déploiements, d'un coté les persécutcurs avec le
Sanhédrin et Saul en tite, et de l'autre Etienne avec une foule de
croyants, les rabbis chrétiens et le gouverneur romain chrétien. Les rabbis
prendront part au martyre du diacre, la foule ménera la lamentation des
Saints martyrs quel est le re de Pilate? A notre avis, c’est le rble qu'on
trouve dans la conclusion de la légende dans la version slavonne Lv, &
‘savoir celui de chef chrétien responsable de la sépulture des martyrs. La
Nous suivons a traduction allemandsfsite pa I. Franko ob tout a sSqucnce est la
suivante: « a eto sich ein grotes Gescre, wie das Gebravs eines grofen Strmes, und
(ds Volk Fie. "Er mige vergt werden von der Erde! Er moge verilgt werden, denn er
proc goteslistrliche Wore!” Und stellen ihn vorn und sprathen unereinander >, eft 1
Rano « Beitrige aus dem Kichenslavischen »,p 160,
LEAPOCRYPHE GREC DE LA PASSION OE 5. ETIENNE 3
présence de Pilate et de sa famille dans la prison fonctionne au plan nar-
ratif comme l’annonce du service que le gouvemeur va rendre atix saints
dans leur sépulture.
La critique littéraire des textes que nous avons & disposition nous
permet de constater que le jugement devant Filate et la conversion du
gouverneur romain sont les éléments constituifs de la Vorlage des tex-
tes A. Quant aux deux autres themes, nous crovons qu’ils sont ligs entre
ceux au plan narratif, mais nous ne saurions pas dire sls appartiennent
au texte primitif ou s'ils en sont postérieurs. Il ne nous reste que & éta-
blir quel est le rapport de la narration sur les funérailles d’Etienne et de
see compagnons faites par Plate ave I Vorlage grime de la cen
sion
2.1.3 Les narrations de la sépulture d’Etienne
Les témoignages textuels de la seéne finale de la Passion sont ts
‘complexes et rendent extrémement difficile tout essais d’étude compa-
rative. La recension B offre un récit retravaill. Le personnage princi-
pale y est Gamalie, introduit apres la « grande lamentation » pour prendre
soin du corps du saint et pour le porter dans sa propristé, appelée de son
nom, 3 une distance de la vile d’environ 20 miles.
Les textes de Ia recension A fournissent cing variantes de la sépul-
ture
Les grees Ese et Vat parlent de concert de lamentation de tout le
peuple, de la vision des ames des quatre martyrs et du deuil fait d’Etien-
ne pendant trois jours et trois nuits. Ensuite les récits des deux textes se
séparent: Esc rapporte la pritre du saint diacre de cacher leurs corps
dans sa propriété « Arosima »®, Ie Vat parle de apparition des saints
martyrs par trois fois aux hommes pieux et de la croissance de Elise
aprés leur mor.
Les deux versions slavonnes sont d’accord en ce qui,concerne la la-
mentation, la vision des ames des martyrs et le deuil d'Etienne pendant
trois jours ~ tout comme dans les textes grecs. Mais aprés les deux récits
se divisent: le texte Zm poursuit avec la mention de la fabrication de
trois caisses en argent et d'une caisse en or peur les corps des saints et
de Ia pritre d'Etienne de cacher leur corps dans sa propriété « Arosima »
(comme dans Esc), tandis que le récit « pilatien » Lv d&veloppe un
theme tout fait nouveau. Le personage principal y est Pilate qui prend
>? Le texte grec a ie expression év dans son sépulee, et lui promet qu'un des ses descendants
Aavera un jour les 0s des saints « avec l'aide d'une révélation ». Cette
prophétie ex eventa, qui justifie invention des religues dans un Tiew
fenoré par les chrétiens pendant une certaine période et éloigné de la
place de la lapidation et des funérailles, constitue 1a motivation princ-
pale du récit de la sépulture d’Btienne, Les funérailles faites par Pilate et
ivtout le transfert des reliques de son sépulere & un autre caché, éait
AnScossaire, parce que la tombe des saints martyrs état ignorée par les
Chrétiens juifs et, d’apriés I'annonce du saint diacre, leur invention échut
fn partage & un des « descendants du gouverneur », done &.un crétien
romain ou byzantin*.
‘Nous croyons pouvoir ainsi identifier la partic finale du révit de la
Passion dans la Vorlage de la recension A. Apres la bréve description du
Geuil e de 1a lamentation "Etienne il y avait le récit dédi¢ 2 Pilate
‘Comme responsable des funérailles, avec le message qu'il regoit dans 1a
‘évélation de 5. Etienne et avec la conclusion concernant sa mort ainsi
(que celle de sa femme. L’auteur du texte gree Esc, qui a omis déja aupa-
sant les deux mentions de Pilate et qui alaisé tomber ici Ia référence
a sépalture des saints, a éliminé tout le matériel concernant Pilate. Le
traducteur de la version slavonne Zm, ou bien I'auteur de son original
free, qui a ignoré Pilate dans son récit de la Passion, a coupé aussi tout
equi concemait le gowvemeur, mais a remanié la description des funé-
males en remplagant Ia personne de Pilate par le sujet collecti™.
La version Ly clot la scene de la sSpulture et de I'apparition
re & Pilate par T'incise sur la triple apparition des saints martyrs aux
Ti Gene ropposition owve toute une problématiqu du rapport de c= réit avec inven
tion des seliques des sunt decrte dans [a Tete du pte Lacien, ef. E, VANDENLINDEN,
“etevelato § Stephan » dans Revue des Gudesbyzanines$ (946) 178-217. Nos voulons
‘ete a ce problme une ede & part. Pour Uinstant signlons Ypinion de I. FRANKO,
sesrartoe ase de Kichensavischen >, qo prpesait défi en 1906 de voir en Lacien un
SWeehen gu se vant etre on descendant dela famille de Pate (. 167), et de pace la
(Mlle Invendion des rliqes &Bsenne dans I premire moitié du IVe siecle (. 170.
STEERzge gue le Poe Abel. qu connaissit la plication de Frank, oa pas ragi cee
hypothe.
'S Dvapts le témolgnage de I Franko, qui a taduit etext slave en allemand, aunt
dela version de Zatpose taht une constants tendanced’expurger son texte: « Besos fr
ad ans et dau leicht bepeiich, da der Verfertger dieser Rezension daauf austin,
aoe aneckenaBige und manchal auch unzweckmaBige Steichungen dem Sticke eines fr
sre does Ose moglichtinofTensiven Klang zu geben », cf. 1. FRANKO, « Bite aus
tm Kircenslavischen», . 166.
LEAFOCRYPHE GREC DE LA PASSION DE. ETIENNE 35
hommes « peux et fides», nese qui suit directement information
sur la mort de Pilate et des femme. Ce changement de perspective nar
tive nous parait étrange. On serait tenté de cire avec I, Franko que
{est une interpolation une main tardive, mais le texte gree Var qu
content la méme information n'autorse pas une tele opinion. Ce texte
int a mot eng sve cl Es np dee ele mS
apparition d'Ecenne& Pilate, mais conct la Passion avec la notice de
apparition des quatre martyrs. La conclusion en Vat cadre bien dans le
contexte et se présente comme une continuation logique de la narration
ence qui conceme la grammaie etl syntax, Vola la phrase initiate de
la conclusion, précédée par quelques expressions prises du récit de la
sépulture, commun avec le texte Esc:
lov wis denélovs éveringinas ci meivora ani .. xo th
i éeedingiras ti obey. wai ag
Seine deurooarag cs rwina ey en. Eoinoy we woREEY
bro x56 ag nt sv Etgevoy spe ups wal sete nas
018 &pot 205 Xprarot jdprupes Gponaay én seis eo¥e okeoe.
T1n’y aien de plus naturel que de considérer tout le texte sur Pilate
comme une interpolation postérieure insérée entre les expressions:
-speis iyiépag nat pets vowtas et of && depot toi Xprorod uépr
restée inchangée dans la version slavonne Lv. La version plus ancienne
de la Passion n'a done pas connu ’épisode de la sépulture des saints
arty, ni le transfert des reliques des saints dans la propriété d’Ftienne
ni annonce de invention de leurs corps par un descendant de Pilate
Au contraire, elle contenait le détail de la triple apparition des saints
martyrs aux hommes pieux et du développement de I'Eglise du Christ
apres leur mort. Que apparition des martyrs pa: trois fois faisait patie
Dans la mccecins oe
wl est que is transformation de Vatice en prom personnel et pr conséquen a
‘ometion dela ponctuation dans Er soit 'ccuvs dun coping doce we
‘SOB: PP. 1000N, Grammaire de bres bilque, Rome 1965.4 Iida
mots wesion géogiene ft metre en prison seulement Eicane car cl acon aus! la
Spier ci sin dace faite par OamaleL Ce changement n'y depend pus dy ce
Seyret da waducteur quia fait pluses remariements dans a wadacon, Pas Gece a
‘eo versions savonnessscordnt ave le gre Et et confer cet one conan nae
oe ANDRZES STRUS
‘commentaire en donne le sens historique et eschatologique, tandis que
dans la B il en est privé, le discours du grand rabbi y étant retranché. Esc
met dans la bouche de Gamaliel un midrask qui explique 1a vision
Etienne. Le rabbi commente la vision du diacre de la fagon suivante:
Fienne non pas seulement a vu le Fils de I'Homme & la droite de Diew,
‘ais il a aussi entendu Ia conversation entre Jésus et son Pere. D’aprés
fe midrash, Jésus, debout en train de regarder indigné ce qui se passe
pour Etienne, s’adresse& son Pere: « Regarde, Pére#, comment les juifs
Stemportent sur moi et ne cessent pas de persécuter ceux qui confessent
ton nom ». Le Pere lui répond: « Sige a ma droite, jusqu'a ce que j'aic
fait de tes ennemis un escabeau pour tes pieds ». Le midrash explique
ainsi pourquoi dans la vision d’Etienne, dont parlent déja Ac 7, 56, Jésus
Teste debout, tandis que, conformément 2 la théologie attestée dans les
Evangiles et dans la Lettre aux Hébreue® il doit étre assis 3 Ia droite du
Pore. Le commentaire de Gamaliel précise que Jésus sera assis 3 la
droite de Dieu, quand le Pére aura soumis tous ses ennemis sous ses
pieds. Par conséquent, la glorification de Jésus & la droite du Pere est
Considérée comme consequence du jugement de Diew sur tous ses
Cnnemis, Or, Etienne annonce dans son premier discours que Jésus sis
gera, avec Diew Pantocrator et I'Esprit de I’Aliance, lors du jugement
Eosmique sur tous les hommes, xadioracar wipios Geis 6 rartoxpdrop
eal 6 EvBoos axbtod vidg 6 wipros hpdv “Inoois Xpuatig wait 1 xvetpe tii
Buadians Her'exdt0d (Esc I, 38-40). Ici, Gamaliel constate Varrivé de ce
moment: Etienne a entendu le Pre qui invitat Jésus a s'asseoir & sa
Groite ce qui veut dire que le jugement sur ses ennemis commence & se
téaliser. Dans une telle perspective du jugement de Dieu, décrit dans le
premier discours du diacre avec ses dimensions apocalyptigues et vu
Tnaintenant comme en train de se réaliser dans le martyre d'Etienne, on
econnait 'expression de Iattente du jugement imminent. L’auteur qui a
nis ce midrash dans la bouche de Gamaliel, entend le jugement comme
tun événement apocalyptique ~ tout en suivant la conception judaique ~
el croit qu'il va se réaliser encore dans la génération coniemporaine
Etienne. Nous a’hésiterons pas a y voir I’cho de 'ancienne eschato-
logie judéo-chrétienne telle qu'elle se trouve. par exemple, dans les let-
tres de Pierre et de Jude.
Le tents Vara Ta voi, Pee.
© Me 16,19; Mr 26,64 pars Heb 13
$6] Pan A7, 2 P3 I-14: Jude 17-19, Nous avons interpret ales ce wit doctrinal
comme tein de ancieanté du rit de Ia ecenson A, eft. A. STRUS, « Cristian di or-
ne iudaica unesperien sepia? Dali archeologici ed aporii dans A. STRUS (ed.
in Gludaismo e Crstianesino: Qumran ~ Giudeocristian = ler, Ogg, Domani 17), LAS,
Roma 1995, pp 108-110
LLAPOCRYPHE GREC DE LA PASSION DE S. ETIENNE 9
Ce caractére théologique du bref discours de Gamaliel ne se trouve
pas dans le texte Amb od sculement la premire partie de la phrase est
conservée. Le discours n'est pas ici originl, il est tranché a dessein. Le
«but du récit dans la recension B en explique la raison: selon la pers-
pective eschatologique de la recension B Jésus est déja assis & la droite
du Pere. invitation du Dieu Pantocrator a Jésus « sibge & ma droite.»
¥ apparat, comme dans les réits de la recensicn A, dans la perspective
Tuture, a Ja fin du jugement apocalyptique décrit dans le premier dis-
cours d'Etienne, Mais I'auteur de la recension B perd de vue cette pers-
pectve et consire la session de Jésus & la drcite du Pére comme déja
arrivée, & partir du premier discours du dincre. Ainsi, quand Etienne
parle de la glorification de Jésus dans son deuxiéme discours, il cite les
paroles du Symbole des Apétres «il est monté au ciel et il sige Ala
droite du Pere >, les paroles qui manguent dans ks texts de la recension
A. Pareillement Etienne voit, selon ce réit, les cieux ouverts ef le Fils
de Homme « assis la droite de Dieu », contairement au témoignage
de Ac 7, 55-56 ot tous Tes récis de Ia recetsion AM. Cela explique
pourquoi fe texte Amb interrompt le discours du Gamaliel apres les
paroles « [Etienne] a contemplé les cieux ouvert et le Fils de Dieu assis,
la droite de son Pre »*, Tel changement, motivé par 'intention théo-
Togique de Tanteur de ta recension B, constitue un indice incontestable
du remaniement postérieur du text primi.
‘La comparution suivante de Gamalicl, a liev dans la prison d'Etien-
ne en compagnie de Nicodéme et d'Abibos. Les deux recensions rappor-
tent identiquement ce detail”, mais les deux nouveaux personnages
apparassent de fagon inatende. Nicodéme et Abibos entrent dans le
récit pour la premiére fois mais, contrairement 4 "usage habituel, ils ne
Sont pas introduits avec une formule approprie. Le récit ignore leur
fonction et leur le dans cette histoire etn'essaye pas d’explquer pour-
ils se trouvent dans la prison. On a l’impression que I’ auteur et les
Til int roe ven logge sp ile ad ete A
(opt cove dao tens Ss eson srs pa Met qa tok
‘tn astute sans de Fo, tedden iow ERAS
taper oo Teams Hts» Apc Mas, 18. p 03.4
se unkowao aemen eve ech Ran Ge 1 PR
“Beige p16) eacuge et lorena a con Pat
isemleul ite soe dei
"ore chngment te rlgqa: Bee vole Fl deme si
ama fms gu Btne le sd Dit hs Ua deen Ae
here datas ie Fs de Dieu cote ang de A, SL ee Ser,
fen sey enue Ae puted aon Eee)
Scent rane ele daca de Gani "ype
Tein ppc cu Poni ul cot os Elect ste dae
son cae de ui pos
40 ‘anos stRUS
lecteurs de la Passion les connaissaient bien et n'avaient pas besoin de
Jes introduire. La logique du récit boite aussi par rapport la figure de
Gamaliel. 11 défendait tout a Mheure, en tant que maftre des « Fils,
Csraél », le saint diate; i n°état pas areté ni mis en prison avec
Fienne; maintenant il s'y trouve comme un malfateur. Cette coupure
dans Ia trame narrative indique & notre avs le caractre hétérogene de
’épisode: rien n'empéche qu'on le qualifie comme une insertion posté-
rieure, range au réeit primitif. Elle a &é faite pour justfir Ia mise en
scene suivante des trois personnages, au moment de la lapidation du
saint diacre .
Nous voici la demiére rencontre avec Gamaliel, quarid se déchaine
1a fureur de la foule contre Etienne. Exe conelut la scéne de la lapidation
du diacte par la remarque: « Mais Abibos, Nicodéme et Gamaliel,
eentourant Htienne, regurent les coups de pirres, et ils ont rendu leurs
Ames au Christ en paix », nepthoBdvtes toy Etégavoy, dine’éEavto ths tiv
Aidov Bodidas, of xai tas yuxis Gnéboxav 1 Xprow év cipfivn (IX,
234). La mort décrit de fagon si prosaique, on dirait au hasard, des trois
amis qui voulaient protéger Etienne, manque complétement dans la re-
cension B. On les a vus, est vrai dans la prison avec Etienne, mais en-
suite ils ne réapparaissent plus. C'est Etienne seul qui rend en paix son
‘ime au Christ.
‘Nous avons done dans les deux recension des différentes scdnes
finales de la Passion: la lapidation des quatre saints, ou bien la lapida-
tion de s. Etienne seul. Quelle recension prétend éie plus proche du
texte origine!? Iya un indice incontestable en faveur de la recension A,
2 savoir Ia pritre intercession d'Etienne. Le saint implore dans cette
pritre, rapportée de maniére identique dans tous les textes des recen-
ions A et B, de ne pas imputer ce péché « a ceux qui nous ont apidé »,
T0Ig AdoPodoaaw Apis (Esc IX, 26), wig AdoBorotaw hpas (Amb IX,
25). Le pluriel du complement d’objet en Amb n'a pas de sens si ne se
refer pas la lapidation des quatre saints. L’auteur de la recension B
{qu a éliminé Abibos, Nicodeme ot Gamalcl de la scéne de la lapidation,
1a pas eu le souci de corriger le pluriel du pronom personnel, lissant
ainst le témoignage de son remaniement du texte.
analyse du theme de Gamaliel dans la Passion confime les con-
clusions faites & propos du theme de Pilate. Les différences entre les
Les versions slaves connaissent seulement
‘version ggrgieaneomet cet soe
St Ea version géorgienne, quia besoin d'un Gamal vivant pour li confir I séputore
‘de s Evenne, ignore la lapidation de es compagnoas, Son auteur avert incobéence dans
In pied Elienne et la change a fagon «Jésus Cris, regois mon me et ae tens pas
Compte de ce péché q's ont commis envers tet envers moh, ton esslave », N. MARR, Le
sgnaire, p. 69.
mor es deux, Niodéme et Gamal: la
LUAPOCRYFHE GREC DE LA PASSION DES, ETIENNE 4
deux recensions ressortent en la majeure partic du travail rédactionnel
que auteur de la recension B avait fait sur le texte primitif. La forme
primitive du récit est micux attestée dans la recension A, surtout dans le
texte Ly qui garde les thénies plus anciens de I'apocryphe. La Passion
4 Etienne connassait, dans sa forme primitive, a conversion de Pilate et
de sa famille, latitude courageuse de Gamaliel pour défendre la doc-
‘rine d’ Etienne, la mort des trois autres compagnons dEtienne et I'appa-
rition des saints martyrs aux hommes pieux. A une époque plus tardive
de nouveaux détails ont été inséés, tels la sépulture faite par Pilate, le
transfert ainsi que la dissimulation des corps des saints demandés & Dieu
par Etienne. Encore plus tard, le récit de invention des reliques a da
contribuer & lélimination de toutes les références au gouvemeur, y
‘compris de la spulture des saints martyrs faite par I
3. LE MILIEU D’ORIGINE ET LE DEVELOPPEMENT
DE L’APOCRYPHE DE LA PASSION
Placer un texte apocryphe dans une période historique déterminge
ressemble a la traversée d'une forét privée de sentiers. Si nous voulons
affronter cet aspect, nous devons nous appuyer sur quelques références &
ta passion de s. Etienne dans la litérature patisique.
3.1. Le contexte historique de la transformation
de l’épisode des funérailles
Un premier approche historique conceme Ia phase finale des trans-
formations du réit. C'est dans cete phase quon a remplacé, comme
nous avons dja vu, Ia personne de Pilate par Garaliel dans le ect des
fanérailles. Cete opération a conduit au changement des trois éléments
fondamentanx du récit:I'elimination dela figure de Pilate chetien, celle
de Ia lapidation des trois compagnons d'Etienre, celle du transfer des
reliques Etienne et de ses compagnons dans un lieu cach, Pa conte,
la nouvelle description dela séputure a claiféV’énigme de la locale,
tion de la tombe du sant. D'aprés la recension Bila lassé in Exopy-
4a? pendant une nuit et un jour et c'est probablement dans la nuit su
vante que Gamalelaurait demandé aux chrtiens d'enlever le corps et
de enseveir dans sa propritééloignée 20 miles dela vile®, infor
Le nom fc iter, Nou avons eu wos pts co:
nce cf A STRUS, «La pson py mas atu ne aon pre agi st I
Plus probable. ® s
On oie dans cnet infomation ples pins bcs. Tout abd on peut
Pine mane comment corps pou reste por ee es de 2 hae san
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- Dimitru Stăniloae - The Experience of God (Orthodox Dogmatic Theology, Vol. 1)Document299 pagesDimitru Stăniloae - The Experience of God (Orthodox Dogmatic Theology, Vol. 1)Basil Lourié100% (1)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Polemis - Theophanes of Nicaea. His Life and Works (WBS-20)Document220 pagesPolemis - Theophanes of Nicaea. His Life and Works (WBS-20)Basil LouriéNo ratings yet
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Christ Came Forth From India Georgian Astrological Texts 2020Document485 pagesChrist Came Forth From India Georgian Astrological Texts 2020Basil Lourié100% (1)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Dimitru Stăniloae - The Fulfillment of Creation (Orthodox Dogmatic Theology, Vol. 6)Document247 pagesDimitru Stăniloae - The Fulfillment of Creation (Orthodox Dogmatic Theology, Vol. 6)Basil Lourié100% (2)
- Cyrus Ioannes Fernandez Marcos 1975 Thaumata SofronioDocument90 pagesCyrus Ioannes Fernandez Marcos 1975 Thaumata SofronioBasil LouriéNo ratings yet
- Novaes Taxonomy of Mediaeval Approaches To The Liar 2008Document36 pagesNovaes Taxonomy of Mediaeval Approaches To The Liar 2008Basil LouriéNo ratings yet
- Uncovering Ancient Footprints - Armenian Inscriptions and The Pilgrimage Routes of The Sinai - Michael E. StoneDocument184 pagesUncovering Ancient Footprints - Armenian Inscriptions and The Pilgrimage Routes of The Sinai - Michael E. StoneBasil LouriéNo ratings yet
- Studia Patristica-104, 2021 (1 - Historica)Document193 pagesStudia Patristica-104, 2021 (1 - Historica)Basil Lourié100% (1)
- The Welsh King and His Court - Charles-Edwards, Thomas.,Owen, Morfydd E.,Russell, Paul, University of WalesDocument614 pagesThe Welsh King and His Court - Charles-Edwards, Thomas.,Owen, Morfydd E.,Russell, Paul, University of WalesBasil LouriéNo ratings yet
- Θεόδωρος Μετοχίτης - Ἠθικὸς ἢ περὶ παιδείας (Πολέμης, 1995) (ΚΒΛ-1)Document295 pagesΘεόδωρος Μετοχίτης - Ἠθικὸς ἢ περὶ παιδείας (Πολέμης, 1995) (ΚΒΛ-1)Basil LouriéNo ratings yet
- Agachi, Staniloae PalamismDocument103 pagesAgachi, Staniloae PalamismBasil LouriéNo ratings yet
- Theodorus Metochites - Orationes (Eds. Polemis, Kaltsogianni) (BT, 2019)Document796 pagesTheodorus Metochites - Orationes (Eds. Polemis, Kaltsogianni) (BT, 2019)Basil LouriéNo ratings yet
- Tchekhanotits DevtubaniDocument9 pagesTchekhanotits DevtubaniBasil LouriéNo ratings yet
- Heinz Fahnrich. Geschichte Georgiens. Brill Academic Publishing, 2010Document589 pagesHeinz Fahnrich. Geschichte Georgiens. Brill Academic Publishing, 2010Basil LouriéNo ratings yet
- Bouvier - Bovon 2007, Invention Des Reliques D'etienne, Le Saint Premier MartyrDocument27 pagesBouvier - Bovon 2007, Invention Des Reliques D'etienne, Le Saint Premier MartyrBasil LouriéNo ratings yet
- Paul Werth. Georgian Autocephaly and The Ethnic Fragmentation of Orthodoxy. Acta Slavica Iaponica, Iss. 23 2006, Pp. 74 - 100Document28 pagesPaul Werth. Georgian Autocephaly and The Ethnic Fragmentation of Orthodoxy. Acta Slavica Iaponica, Iss. 23 2006, Pp. 74 - 100Basil LouriéNo ratings yet
- Strus Calendrical Aspect of A Recently Discovered Christian ApocryphonDocument17 pagesStrus Calendrical Aspect of A Recently Discovered Christian ApocryphonBasil LouriéNo ratings yet
- Norelli Avant Le Canonique Et Apocryphe 1994Document21 pagesNorelli Avant Le Canonique Et Apocryphe 1994Basil LouriéNo ratings yet
- Hirschfeld Monastery Chariton Excavations 2000Document48 pagesHirschfeld Monastery Chariton Excavations 2000Basil LouriéNo ratings yet
- Strus La Passione Santo StefanoDocument41 pagesStrus La Passione Santo StefanoBasil LouriéNo ratings yet
- Strus Haggada StephaneDocument16 pagesStrus Haggada StephaneBasil LouriéNo ratings yet
- Bovon Bouvier Étienne Première Martyr BHG 1649d Without QuotationsDocument22 pagesBovon Bouvier Étienne Première Martyr BHG 1649d Without QuotationsBasil LouriéNo ratings yet
- Suciu - 2019a - A Coptic Text Attributed To John of Jerusalem On StephanusDocument8 pagesSuciu - 2019a - A Coptic Text Attributed To John of Jerusalem On StephanusBasil LouriéNo ratings yet
- Clark Claims On The Bones of St. Stephen 1982Document17 pagesClark Claims On The Bones of St. Stephen 1982Basil LouriéNo ratings yet
- Marius Victorinus - Commenta in Ciceronis Rhetorica (BT)Document291 pagesMarius Victorinus - Commenta in Ciceronis Rhetorica (BT)Basil LouriéNo ratings yet
- Michael Psellus - Orationes Funebres - 1 (BT, Polemis) PDFDocument285 pagesMichael Psellus - Orationes Funebres - 1 (BT, Polemis) PDFBasil LouriéNo ratings yet