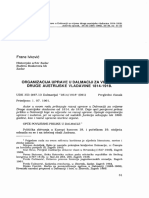Professional Documents
Culture Documents
Rapport de Soutenance A. Srdic
Rapport de Soutenance A. Srdic
Uploaded by
srdjasrdja0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views16 pagesOriginal Title
RAPPORT DE SOUTENANCE A. SRDIC
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
9 views16 pagesRapport de Soutenance A. Srdic
Rapport de Soutenance A. Srdic
Uploaded by
srdjasrdjaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 16
Rapport de These de Mme Andja SRDIC-SREBRO
Les représentations des femmes dans le cinéma serbe : identités individuelles et
imaginaires collectifs. Une étude anthropologique.
Le Jury, composé de Pascale Melani (Professeure a l'Université Bordeaux Montaigne,
Directrice de thése), Slobodan Naumovic (Professeur 8 l'Université de Belgrade, rapporteur),
Gwenaélle Le Gras (MCF a 'université Bordeaux Montaigne), Dejan Dimitrijevic (Professeur &
Vuniversité Lumi@re Lyon 2), Aleksandar Prstojevic (Professeur @ I'iNaLCO) et Catherine Géry
(Professeure a 'INaLCO, rapporteure et Présidente du Jury) s‘est réuni & l'Université de Bordeaux
Montaigne (partiellement par visio-conférence) le 17 septembre 2021 pour la soutenance de la
These de Mme Andja Srdic-Srebro.
Au cours d'une intervention synthétique et tres claire de 25 minutes, Andja Srdic-Srebro
expose sa stratégie de recherche et ses choix théoriques et thématiques, qui révélent un
positionnement assumé dans le champ qui est celui de sa these.
La parole est donnée a la directrice de recherche, Pascale Melani, qui commence par féliciter
Andja Srdic-Srebro pour l'aboutissement, au terme d'un long processus de maturation, de cette
these sur Les représentations des femmes dans le cinéma serbe : identités individuelles et imaginaires
collectifs. Une étude anthropologique.
Elle rappelle I'historique de ce travail. Une premiére these, engagée sous la direction d'un
autre professeur et sur un autre sujet, a dd étre abandonnée en raison du départ de cette collegue
de Vuniversité. Andja Srdic-Srebro a été contrainte de changer de discipline et de recommencer un
travail doctoral, en choisissant cette fois de se consacrer au cinéma serbe,
En tant que russisante, Pascale Melani confesse n’avoir pas toujours été d'une grande aide.
Elle ajoute que la candidate s'est heurtée a un certain nombre de difficultés logistiques et pratiques
bien réelles. Andja Srdic-Srebro n’est pas de langue maternelle frangaise et, bien que vivant en
France depuis de longues années, la rédaction en frangais d'une these qui s'appuie essentiellement
sur des sources serbes et anglo-saxonnes lui a coaté beaucoup defforts. Non seulement elle @
iravaillé a distance des lieux de conservation et de documentation sur la cinématographie serbe,
mais la pandémie de covid-19, qui s'est abattue sur le monde au cours des deux derniéres années de
la these, a porté une sorte de coup de gréce 8 un travail qui aurait da étre achevé avant. Pascale
Melani saisit occasion pour féliciter la candidate de n’avoir pas renoncé et davoir rendu un texte
dont la rédaction en franais est d’une grande qualité.
En tant que directrice de recherche et aussi en tant que slaviste non spécialiste de 'univers
yougosiave et balkanique, Pascale Melani souligne ensuite ce qui, & son avis, constitue les points
forts et la spécificité de cette these.
Cest un travail d'une ampleur et d'une originalité incontestables. il aborde une
cinématographie considérée comme marginale, trés peu exportée en dehors des frontiéres de l'ex-
Yougoslavie, pratiquement inconnue du grand public en France & l'exception de quelques cinéastes
phares. Les films analysés, dans leur grande majorité, sont rarement montrés sur les écrans francais,
le plus souvent lors de manifestations a audience confidentielle, un certain nombre d’entre eux n’ont
jamais été projetés en France et n’existent pas en version frangaise ni méme anglaise. Pascale Melani
considére done que le premier mérite de la these d’Andja Srdic-Srebro est d'offrir une plongée dans
une cinématographie peu visitée et de proposer une sorte de parcours initiatique a travers son
histoire et son évolution.
Le second point fort de ce travail, toujours selon Pascale Melani, est la qualité de son
approche théorique et méthodologique. La candidate a su tirer parti de sa formation initiale en
anthropologie, de la réflexion qu’elle méne depuis de longues années sur les questions de
représentation et de conceptualisation du corps humain. Elle a mobilise un cogpsro-ta,toxtes de
(ae):
_——
référence particuligrement riche, principalement en anthropologie et en études de genre, afin de
définir une méthodologie d’analyse qui lui est personnelle dans le paysage universitaire francais. Elle
‘a souhaité prendre en compte le contexte socioculturel des films, l histoire de la production des films
en Yougoslavie et Serbie, mais aussi son propre statut de femme et sa propre relation a sa culture
dorigine. Elle souligne sa position de chercheuse a la fois immergée dans la culture décrite, et
extérieure parce que vivant en France. Enfin, son travail d'analyse des films recourt 8 des outils
analytiques soigneusement réfléchis qui sont exposés p. 65 (les tropes, le genre, les roles sociaux,
organisation familiale et sociale, 'intimité culturelle, etc.)
Bien évidemment, poursuit Pascale Melani, le contexte universitaire francais dans lequel le
travail doctoral a été produit a déterminé la présence d'un certain nombre d’éléments explicatifs
destinés a contextualiser les films des points de vue historique et social. En effet, méme les slavisants
ne sont pas forcément au fait des spécificités qui étaient celles de la société yougoslave. Ceux qui ne
sont pas spécialistes du domaine balkanique peuvent a juste titre étre étonnés par ce contraste entre
un archaisme patriarcal et Fouverture sur la modernité occidentale qui traversait la société titiste. Ils
ignorent le plus souvent les répercussions sociales que la rupture entre Tito et Staline a eues sur le
quotidien des femmes en Yougoslavie. Enfin, Phistoire du cinéma serbe/yougoslave, que ce soit dans
ses aspects artistiques, institutionnels ou économiques, est pour I'essentiel terra incognita. la done
fallu en retracer rapidement son évolution générale. De cela découle la spécificité du plan de la
thése, qui a été pensé d'un point de vue « pédagogique » : il présente successivement une breve
histoire de la Yougoslavie d’aprés-guerre, I'évolution du statut de la femme au fil des décennies et
enfin les spécificités de organisation de lindustrie cinématographique dans ce pays. De ce point de
‘vue, selon Pascale Melani, la these témoigne de la solidité de I'érudition d'Andja Srdic-Srebro, de ses
aptitudes d'enseignante et de ses qualités de « passeuse » entre plusieurs cultures.
La quatriéme partie, qui constitue le cceur de la these, analyse successivement les types
féminins que la candidate a choisi de mettre en exergue en appliquant les principes théoriques
Gnoncés plus haut. Elle combine les approches thématique et diachronique afin de faire ressortir les
caractéres principaux de ces types et leur évolution dans le cinéma serbe. La rédaction de cette
partie s'est étalée sur une durée trés longue, avec les avantages et les inconvénients que cela induit.
Selon sa directrice de these, cela a permis & Andja Srdic-Srebro de déployer ses qualités
dobservation et danalyse dans des miniatures qui sont remarquablement maries et fouillées. Il est
vrai aussi que I’étalement du travail dans le temps produit une sorte de relachement de la structure
d'ensemble, qui s‘est un peu distendue. Pascale Melani estime néanmoins que ce chapelet de micro-
études indépendantes, qu'il est possible de lire séparément, constitue un tableau qui reste cohérent,
Elle formule ensuite quelques remarques.
Ce travail assume, selon elle, une certaine dose d’empirisme et de subjectivité. Son caractére
inédit et pionnicr, le manque de disponibilité des films, mais aussi les spécificités de l'histoire
yougoslave, marquée par la discontinuité, ont conduit la candidate 8 produire des définitions ad hoc,
comme celle proposée du cinéma serbe, par exemple, et a constituer un corpus de films jugés
pertinents par rapport au sujet. Certains choix étaient contraints, ~ mais d'autres, apparemment,
étaient volontaires, comme ceux qui ont présidé a la sélection initiale des films. A ce propos, Pascale
Melani regrette un peu I’omniprésence du regard masculin sur les femmes et, bien que la candidate
ait clairement exposé les raisons de l'absence de voix féminines dans ce concert cinématographique,
elle se demande s'il n’était pas possible de mettre davantage en lumiére le travail des réalisatrices
(ou des scénaristes) féminines. Elle considére qu'une piste pour le développement ultérieur de cette
recherche serait probablement de chercher 4 repérer I'émergence, dans le cinéma serbe
contemporain, de réalisatrices qui commencent & ébranler le monopole masculin et les stéréotypes,
culturels qui sont si bien décrits dans ce travail.
Une autre remarque de Pascale Melani concerne la place de V'individu créateur dans
I'élaboration des types décrits. Andja Srdic-Srebro analyse les films de fiction d'un point de vue
anthropologique, comme des «artefacts culturels », comme des « projections d'IMAGES du
comportement humain et social » pour en dégager une sorte de savoir sur la cule et la société
serbes, Dans sa conclusion (p. 411), elle écrit que le plan n’est pas chronologiquer ue ae
AC} .
‘analysées ne sont pas forcément liges un courant cinématographique ou un moment précis de
histoire yougoslave ou serbe. En méme temps, elle souligne que ces types sont plus ou moins
visibles selon les époques, donnant @ penser que les représentations naftraient d’un rapport
dialectique entre des « invariants », des formes stables présentes dans limaginaire collectif, pas
forcément figées, mais évoluant lentement, et des facteurs « conjoncturels », historiques, une sorte
de réaction a lair du temps. Au sein de ce rapport, la place de individu, de V’artiste créateur, de son
histoire personnelle, n’est pas précisée. Mais, ajoute Pascale Melani, cette question fera peut-étre
Fobjet d’un débat dans la suite de la soutenance.
En conclusion, Pascale Melani souhaite redire le plaisir qu'elle a eu a diriger cette these, & en
lire les analyses toujours pertinentes, souvent passionnantes, et elle réitére toutes ses félicitations &
Andja Srdic-Srebro pour cette étude qui permet de poser une base solide pour des recherches
ultérieures sur Fhistoire du cinéma serbe et yougoslave.
Slobodan Naumovic, premier rapporteur de la thése, prend ensuite la parole. Tout d'abord, il
affirme se sentir honoré d'avoir été invité & participer au jury de soutenance de cette these
importante et ambiticuse. II ajoute qu'il doit aussi exprimer sa gratitude pour des raisons
personnelles : la lecture (et la révision dans quelques cas) de cette thase lui a permis de revivre une
part importante de sa vie et de se souvenir des nombreux films avec l'aide desquels sa génération a
pu survivre durant des années sombres. Puis il précise quill a structuré sa présentation en deux
parties, Dans la premiere partie, M. Naumovié a choisi de présenter les points essentiels de son
rapport préliminaire en vue de la soutenance de la thése de doctorat, tandis qu'il a dédié la seconde
partie @ quelques questions qui doivent étre entendues comme des suggestions en vue de
publications futures.
La these que Mme Andja Srdié Srebro a réalisée sous la direction de Madame Pascale Melani
porte sur les représentations cinématographiques des femmes dans le cinéma serbe de 1945 a 1990,
et en particulier sur les questions d'identité et d'altérité féminines. Dans |'introduction de sa these
Mme Srdié Srebro part d'une idée ¢’Emilie de Brigard selon laquelle tous les films peuvent étre
considérés comme ethnographiques, faisant d'eux des révélateurs des modéles culturels, Lauteure
‘explique que les films de fiction figurent dans le quotidien d'une part, comme des artefacts
contenant un ensemble de représentations socioculturelles et, d’autre part, comme des produits qui
refletent l'imaginaire collectif, les savoirs et les modéles culturels typiques d'une époque ou d'un
milieu culturel, Une fois réalisées, les images cinématographiques deviennent des « documents » qui
« témoignent » a leur maniére d’une réalité socioculturelle donnée. Mme Srdié Srebro démontre que
Cest au moment ol les images cinématographiques deviennent l'objet du regard que ces images
prennent toute leur importance de médiateur. C'est précisément lors de cette rencontre avec le
spectatour qu’elles transférent des messages sous la forme d'une représentation ~ sur la réalité, les
personnages et les phénomenes sociaux qu’elles sont censées représenter.
Dans la premiere partie de sa thése, Mme Srdié Srebro aborde Ia question féminine dans la
société yougoslave et serbe dans la période de 1945 & 2000. étant donné que les représentations
cinématographiques des femmes établissent des interactions mutuelles avec les constructions
socioculturelles du féminin, la candidate a considéré pertinent de mettre en lumiére les différentes
facettes de ce contexte relevant de ses diverses dimensions : historique, sociale, politique et
culturelle. De cette maniére, 'auteure a pu éclairer la fagon dont les facteurs historiques, politiques
et économiques, ainsi que I'influence des médias, de la religion, du savoir médical ou de la culture de
masse ont forgé des images des femmes. Cet éclairage I'a aidée & mieux saisir et & mieux répondre &
une question qui s'est posée lors de I'analyse ultérieure du corpus cinématographique de référence
‘comment ces images ont-elles 8, & leur tour, réutilisées, reproduites, manipulées ou déconstruites
en tant que métaphores de la société durant plus d'un demi-siécle (1945-2000) de l'histoire
yougoslave et serbe ? Dans la deuxiéme partie, Madame Srdié Srebro explore les problemes liés & la
systématisation des cinémas serbes et yougoslaves. Premiérement, 'auteure essaie d'éclairer la
notion du cinéma national ainsi que doffrir un critére pour distinguer le cinéma serke,dy,cinéma
yougoslave. En ce qui concerne 'apercu de Ihistoire du cinéma serbe et yougoslavgadé 1996 "2900,
4 4
Ae
Vauteure offre un critére de systématisation qui combine une approche centrée sur la périodisation
avec une tentative typologique qui vise 8 distinguer des « écoles » cinématographiques. Ce qui en
résulte est une systématisation qui distingue six périodes/écoles: avant la Deuxiéme Guerre
mondiale, « cinéma komunisto », « Vague rouge », film intimiste et « Vague noire », « Ecole de
Prague », et finalement la phase ou s'achéve la « culture cinématographique multinationale »
Lauteure conclut la deuxiéme partie par un court apercu du réle des femmes dans l'histoire du
cinéma serbe et yougoslave - en particulier les roles des réalisatrices, des monteuses et des actrices,
notamment des « stars », dans le développent de 'industrie cinématographique serbe et yougoslave.
Dans la troisiéme partie de sa thése, Mme Andja Srdié Srebro examine le regard du cinéma sur les
femmes au prisme de lanthropologie. Il s'agit, d'abord, d'un apercu réflexif des facteurs qui
faconnent son propre regard en tant que chercheuse - son appartenance & la culture d’ou émanent
les films constituant le corpus d’analyse, puis sa formation théorique en anthropologie, et,
finalement, sa position en tant que femme qui étudie les représentations cinématographiques des
femmes. II faut ajouter un facteur qui complique I'équation : Nauteure présente ses analyses de sa
propre culture un public culturellement différent. La quatriéme partie offre une riche analyse
diachronique des représentations des femmes dans le cinéma serbe. En combinant les différents
utils analytiques et les approches méthodologiques, I'auteure a essayé de faire ressortir les themes,
motifs, représentations et stéréotypes employés dans le traitement cinématographique des femmes
durant plus d’un demi-sigcle. Mme Andja Srdié Srebro a par la suite tenté d’établir, & partir de
observation approfondie d'une panoplie de personages trés variés, une typologie des
représentations du féminin dans le cinéma qui fait l'objet de son étude. La typologie proposée
combine une logique diachronique avec une approche thématique. L'auteure a constrult six types
féminins: 1) Partisane ~ d'abord combattante, femme ensuite; 2) Mere - «la matrice du corps
social »; 3) Femme aux pouvoirs surnaturels; 4) Fluidité du genre : héros et héroines transgenres; 5)
Femme étrangére : visages de l'autre; 6) Femme(s) contemporaine(s) : la (permanente) quéte
d'émancipation. M Naumovié conclue cette partie de sa présentation en constatant que les
chercheurs auront beaucoup a profiter de cette mosaique riche et complexe offert par la these de
Mme Srdié Srebro.
M. Naumovié ouvre la deuxiéme partie de sa contribution en notant que, nonobstant les
qualités deja décrites, il y a quelques regrets & exprimer et des points de détail a discuter avec la
candidate. Il commence par attirer l'attention sur un nombre de failles faciles & corriger, par exemple
quelques erreurs dans les notices bibliographiques. Puis, il évoque le probleme posé par la
ériodisation de la cinématographie serbe et yougoslave offerte dans la thése. Pourquoi le point de
départ de l'analyse est-lfixé 8 année 1947, tandis que le début de la production cinématographique
en Serbie peut étre datée au moins de 1911, sinon de 1896? Est-ce-que le critére retenu était de
suivre les différents aspects de continuité idéologique communiste/socialiste percevables plus ou
moins clairement dans la production cinématographique en cette période? Et si oui, pourquoi ne pas
mettre ce critere en évidence ouvertement, en commencant parle titre de la these? M. Naumovié
continue en questionnant les critéres de Mme Srdié Srebro pour distinguer le cinéma serbe du
cinéma yougoslave.
Selon M, Naumovié, la troisiéme partie de l'étude est marquée par un académisme par
moments trop rigoureux. Les reconstructions historiques et les catégorisations disciplinaires
complexes qui sont élaborées (Vanalyse des spécificités de réflexion dans les champs de
|'anthropologie visuelle en France ou en Serbie, par exemple), aussi que leurs explications souvent
assez détaillées, restent, malgré l'effort sincére de l'auteure, au niveau de « décorations »
théoriques, sans avoir d'utilité véritable dens les analyses qui suivent. Les problémes les plus graves
sont perceptibles, selon M Naumovié, dans la typologie proposée des représentations du féminin
dans le cinéma yougoslave et serbe. En mélangeant différents critéres, l'auteure a mis en cause le
fondement logique de sa typologie. Pour ne donner qu'un seul exemple, la sixiéme categorie
femmes) contemporaine(s) - englobe la presque totalité des catégories antérieurement présentées,
M, Naumovig finit la deuxiéme partie de sa contribution en soulignant que ces prj iereraat pas
conduit 'auteure & commettre des fautes de raisonnement et quills peuvent tous étre corrigés plus
ou moins facilement.
En conclusion, M Naumovié constate qu'll s‘agit d’un travail ample, ambitieux et d'une
grande importance. Nous sommes, souligne til, en présence d'une réflexion conjuguant avec succés
différentes disciplines — études slaves, anthropologie visuelle, filmologie, études de genre, histoire
politique ~ ce qui & présent ne peut étre qu’un grand compliment. II s'agit d'une étude d'une
originalité incontestable. Selon lui, la thése de Mme Srdié Srebro thématise des problémes clefs
concernant la logique de la production de l'image filmique des femmes en Yougoslavie et en Serbie,
qui n'ont pas été abordés dans d'autres ouvrages. U’auteure a montré une connaissance
exceptionnelle des faits historiques, démographiques, politiques et culturels concernant le systéme
socialiste et postsocialiste yougoslave et serbe, ainsi que de la production cinématographique locale,
tout en éclairant avec doigté un contexte culture! encore fortement patriarcal. Cette réflexion
exprime aussi un engagement interprétatif et critique trés particulier, provoqué par la double
appartenance de I'auteure - en tant qu’anthropologue, elle s'attaque aux visions filmiques produites
par sa culture propre, qui en méme temps décrivent les expériences de vie de son genre - sans que
cela nuise & la rigueur du raisonnement. Finalement, cette étude a un potentiel fort intéressant et est
susceptible d'influencer la réflexion critique, notamment féministe, sur la production artistique et
culturelle en Serbie contemporaine.
La parole est ensuite donnée & Gwenaélle Le Gras, qui tient tout d’abord a féliciter
chaleureusement limpétrante pour le chemin parcouru et se réjouit de voir cette these arriver &
soutenance dans des conditions, notamment logistiques, qui n’ont pas toujours été simples pendant
la pandémie. Cette thése sur les représentations des femmes dans le cinéma serbe constitue un
travail conséquent et original dans sa volonté de redessiner le paysage cinématographique serbe,
dans sa diversité, & travers le prisme de ses représentations féminines,
Dans l'ensemble, la thése, composée de 496 pages, constitue un travail propre et rigoureux
dans lequel il n’y a pratiquement ni faute d’orthographe ni coquille. Elles sont rares tout du moins.
Comme le frangais n'est pas la langue maternelle de Mme Srdic Srebro et que la langue de objet de
V'étude est différente, effort de traduction a tout moment est considérable et mérite d’étre souligné
et apprécié & sa juste valeur. La rédaction témoigne d'un effort remarquable pour corriger les,
maladresses d’expression et les coquilles. La these s'avére tres agréable a lire.
Vajout diilustrations apporte un peu de chair aux représentations analysées et les annexes,
filmographies trés détaillées et index des films et des noms s‘avérent particuliérement utiles pour la
fluidité de la lecture et le maniement de la thése, pas seulement parce que c'est I'usage dans les
théses portant sur des films, mais aussi parce que c’est un moyen ici de donner une visibilité & des
ceuvres qui en manquent en général. La bibliographie est dense, a l'image des nombreuses
références thoriques et historiques mobilisées au fil de I’étude.
Le corpus des films étudiés s'étend de 1947 & 1999, comporte 38 titres et prend en compte
les genres cinématographiques pour rendre compte des tendances les plus populaires (p.25), ce qui
est extrémement précieux. U'approche mobilisée par la these est une approche transversale & deux
titres. D’une part parce qu'elle s‘intéresse au cinéma serbe/yougoslave dans sa diversité historique et
politique : « Un Etat, deux alphabets, trois religions, quatre langues, cing nations, six républiques »
(p.67). D’autre part parce que la thése ambitionne de solliciter une multitude d'approches
théoriques : approches anthropologiques, historiques, sémiologiques, théories féministes du cinéma,
sociologie, analyse textuelle des films.
Comme le souligne fort justement I'introduction, le cinéma serbe et yougoslave est méconnu
et constitue un angle mort des travaux sur le cinéma en France, qui plus est dans sa dimension
socioculturelle, alors que 'approche dominante en France est une approche formelle favorisant
Vanalyse interne des couvres. La qualité de contextualisation de la thése n’en est que plus
remarquable ct elle constitue un ensemble important pour la visibilité de ce -
la progression du plan, composé de quatre grandes parties (deux patties historiques et
contextuelles, une partie théorique et une partie d'analyse du corpus), est convaincante et permet,
méme pour quelqu’un qui connait peu le cinéma serbe, d’aborder le corpus avec un cadre référentiel
solide. La premiére et la deuxiéme partie, «la question féminine dans la société serbe et yougoslave
(1945-2000) » et « le(s) cinéma(s} serbe et yougosiave », posent efficacement le contexte de la thése
et opérent un dialogue, une résonnance nourrie avec la derniére partie. La premiere partie offre des
points de comparaison avec avancée des droits des femmes et du féminisme dans dautres pays qui
mettent bien en relief la situation des femmes serbes et yougosiaves. Uimportance du poids des
influences culturelles extérieures sur les modes de vie, les mentalités et importance des images est
bien mise en évidence, y compris dans ses ambivalences. Dans la partie deux, les reperes
chronologiques avec la distinction de six périodes s’averent particuliérement utiles pour comprendre
de maniére synthétique les strates qui donnent forme a cette cinématographie dont la définition est
Epineuse. Est-ce que le cinéma yougosiave est uniquement un cinéma plurinational ? est-l plus
transnational ou supranational (terme appliqué au cinéma partisan p. 82) ? P.70, une méthodologie
rationnelle de définition du cinéma serbe est avancée, malgré le fait qu’elle ne peut jamais étre
parfaitement exhaustive surtout 2 l'heure actuelle ou le cinéma transnational et postnational se fait
présent dans toutes les cinématographies mondiales. Mais la thése souligne fort justement a quel
point Belgrade ressort comme le centre névralgique de cette industrie, ce qui est un élément de
cohérence nationale important.
Gwénaélle Le Gras a trouvé passionnant de voir les similitudes de influence de Occupation
entre ce cinéma et le cinéma frangais, avec notamment la création dune école supérieure de cinéma
(en France en 1943) et entrée de IEtat dans Vorganisation de la production et de la diffusion, méme
si bien évidemment les raisons politiques sont sensiblement différentes. (p.76). analyse est souvent
tres nuancée sur la complexité de histoire de ce cinéma, notamment p.84 sur le statut ambivalent
dos films de la vague noire, trés inspirés par le cinéma US, fustigés par le régime titiste qui profite de
leur succes & Vinternational comme vitrine avantageuse du régime qui lui-méme profite également
en retour aux cinéastes pendant un temps
La troisiéme partie, «le regard du cinéma sur les femmes au prisme de I'anthropologie »,
apporte un travail de synthése impressionnant sur différentes théories, notamment les théories
féministes du cinéma (Mulvey, Doane, Kaplan, Modleski, Clover, Neale, Dyer, Williams}. La candidate
met en avant, a juste titre, importance du travail d'Hortense Powdermaker en anthropologic
visuelle notamment, méme s'il aurait été bon de préciser quelle porte un regard assez adornien sur
le cinéma hollywoodien qui biaise un peu sa position de chercheuse, contrairement aux travaux
d'Edgar Morin sur le cinéma quelques années aprés. Sur les théories féministes du cinéma, Maja
Bogojevic est une référence importante de la thése. Néanmoins elle simplifie parfois un peu trop les
choses. P.128 « Maja Bogojevié précise 8 ce propos que les théories sur la représentation des
femmes dans les médias se divisent principalement en deux grands groupes. Le premier s'appuie sur
les postulats de Laura Mulvey, considérant que toutes les représentations médiatiques de la femme
sont a priori négatives, car elles incarnent l'économie politique du syst@me patriarcal et capitalise. »
«Le deuxiéme groupe des théories envisage, au dépit de ces représentations négatives, fa possibilté
pour les femmes d’incorporer leur subjectivité et leurs propres compétences culturelles dans le
processus de la consommation du média et insiste sur les analyses historiquement contextualisées »
La these aurait pu restituer la plus grande complexité de la position de Mulvey qui appartient elle-
mame aux deux groupes en étant revenue sur son texte pour prendre en compte le cas des
spectatrices, sans forcément aller aussi loin que quelqu’un comme Tania Modleski qui a fait
notamment une excellente lecture dialectique des films d’Hitchcock. Méme remarque pour la lecture
que donne ensuite Steven Caton des approches féministes {p.73) : « sa foiblesse principale réside
dans la tendance & négliger les influences du contexte socioculturel des discours dominants et de
leur relation avec la production artistique. » Si les travaux des années 70 sont trés inspirés de
psychanalyse, beaucoup de ces travaux n’en excluent pas pour autant le contexte socioculturel, dans
Ia lignée des cultural studies (Doane, Kaplan, Modleski, Clover, Neale, Dyer). Au final, cette partie 9
une trés bonne cohérence interne, et la maitrise de cette grande richesse apse rove
(AL) .
est impressionnante, mais cette partie semble un peu isolée au sein de la progression du plan, dans
le sens ou, dans la quatriéme partie, le dialogue se fait sur bien des points, méme avec les théories
féministes du cinéma sur la question du regard notamment, mais ce dialogue est plus discret qu’avec
les parties 1 et 2, sans doute parce que lanalyse de la mise en scéne n’est pas l'objet ici, mais cela
bride un peu certains aspects des analyses.
La quatrigme partie, « image des femmes et du féminin dans le cinéma serbe : quels liens
avec la « réalité » socioculturelle ? », offre une analyse typologique tout & fait convaincante qui
permet de découvrir en détail ce cinéma méconnu, dans des analyses souvent trés minutieuses. La
candidate se situe par rapport & son sujet (p.137 notamment), sans entrer dans I'ego-histoire, ce qui
enforce la cohérence de la démarche. Uanalyse des femmes aux pouvoirs surnaturels est
particuliérement intéressante et convoquer la notion de carnavalesque de Bakhtine s'avére tres
fructueuse. Toute la période de la Vague noire est passionnante sur les questions de quéte
identitaire qui se joue dans Vinversion des réles conventionnels et des identifications, avec peut-étre
idée que pour ces réalisateurs jouer sur la fluidité des genres parle en définitive du flou du
sentiment ’identité nationale. Mme Srdic Srebro fait un usage bienvenu des concepts de Butler dans
la partie sur les personnages trans ou de ceux de Francoise Héritier dans la partie sur la femme
étrangére, Héritier étant particuligrement bien adaptée au sujet et & la démarche de cette thése. On
aurait pu aussi s‘attendre a une mobilisation des outils théoriques sur les stéréotypes, comme ceux
de Ruth Amossy.
Gwénaille Le Gras souhaite poser quatre questions pour prolonger la discussion et le plaisir
qu’elle acu a lire cette these.
La premiére question concerne la méthodologie adoptée pour établir le corpus. Outre le
choix des films les plus connus pour dégager la substantifique moelle de I'identité de ce cinéma tel
quill est pergu par le plus grand nombre, quels ont été les critéres pour déterminer les cinéastes
reconnus au niveau national et international et quelle a été la méthadologie quantitative pour arriver
2 ces typologies et & cet échantillonnage de 38 films? La seconde question porte sur l'emploi
fréquent dans la these de « la femme » au singulier, alors que le titre de la these prend soin d'utiliser
le pluriel pour éviter sa dimension essentialisante. La troisiéme question est lige au concept de
« micromatriarcat auto-sacrificiel » présenté p.43 puis appliqué ensuite dans la partie 4. II s’agit d’un
concept avancant lidée que les femmes, dans les années 90, en s‘investissant aussi bien dans la
sphere publique que dans la sphere privée sont a la fois sujet et objet de leur propre sacrifice dont
elles tirent satisfaction psychologique et reconnaissance sociale, Pour autant, les mére auto:
sacrificielles des films étudiés le sont dans la fiction, mais in fine est-ce vraiment de l'auto-sacrifice ?
Ce sont des personnages, écrits et mis en scéne par des hommes, non ? Ces hommes nous font croire
un auto-sacrifice [a ou s‘agit d’une négociation : accorder de l'agentivité aux personnages féminins,
mais au service du patriarcat, de lidéologie. Ce sont des personnages pulssants, transformés en
symbole, en effigie et la seule alternative est une des trois figures d’altérité, Un film comme Slavica,
dont le titre se confond entre le prénom de I'héroine et le bateau en est un bon exemple.
Enfin, la derniére question concerne I'usage du mot « refiet » dans la thése. Par exemple p.60
« D’autre cété, ces mémes médias ont été, et sont encore, les miroirs de la soclété, car ils refletent
les diverses réalités socioculturelles, non seulement les représentations existantes de la femme mais
aussi les fantasmes de la féminité et les imaginaires collectifs de féminin et au féminin. ». Si nous
parlons de représentations, iI ne s’agit pas de reflets mais de points de vue qui opérent des choix
conscients ou non pour construire ces représentations. Ce qui n’empéche pas de considérer les films
comme témoins de leur époque ou révélateurs de modéles culturels comme la thése le précise en
évoquant Jean Rouch, les « maniéres de voir » de Marc-Hentri Piault ou & la « version construite de la
vérité » de James Clifford. De fait, l'usage du mot « reflet » entre souvent en contradiction avec les
outils mobilsés, et semble relever plus de la maladresse. P.105 « L'avantage d’une telle approche
réside dans le fait que les films de fiction reflétent les modéles culturels et, par voie de consequence,
ils peuvent nous éclairer sur les comportements humains et sociaux réels, qu'ils soient similaires ou
différents de ceux qui sont représentés dans les films. » Les films ne reflétent pas les modéles
culturels, ils les construisent et en sont imprégnés, les reconduisent. ae ets ne
Ge
viendrait pas du fait que la thése ne prend pas en compte la mise en scéne de ces films, c'est & dire
précisément la construction des images ?
‘Andja Srdic-Srebro répond de facon satisfaisante aux questions de Gwénaélle Le Gras, et la
parole est donnée & Dejan Dimitrijevic, qui félicite d’emblée la candidate pour la qualité de son
travail, sur le fond et la forme. Il affirme que le travail de Andja Srdic Srebro est abondant, riche et
érudit. Il est également trés bien écrit. La lecture est non seulement agréable, elle est aussi tres
instructive. Madame Srdic Srebro a recuellli un matériau trés riche et important sur le cinéma serbe
‘et yougoslave, et Dejan Dimitrijevic affirme avoir beaucoup appris en lisant cette these. I souligne
également la qualité des explications relatives & la construction de l'objet d’étude, méme si le
découpage peut étre discuté. Les clarifications qui portent sur les raisons qui ont déterminé le choix
de 'intitulé « cinéma serbe » au lieu du « cinéma yougoslave » confirment par une voie nouvelle que
les identifications serbe et yougoslave ont trés largement été confondues durant la période
diexistence de la Yougoslavie.
Pour Dejan Dimitrijevic, nous avons incontestablement affaire & un travail novateur qui sera
dune inestimable utilité pour les recherches futures sur le cinéma serbe et yougoslave. Deux
éléments capitaux sont a distinguer et & valoriser & leur juste importance. D’abord l'importance du
corpus en nombre impressionnant de films visionnés, ensuite la longue période considérée : de
Vfaprés Seconde Guerre mondiale jusqu’a année 2000. Cette limite de I'sn 2000 est abstraitement
symbolique plutdt que réellement significative. Dejan Dimitrijevic considére quelle n’est finalement
pas convaincante car le renversement de Slobodan Milosevic ne s'est finalement pas imposé
historiquement comme lévénement qui ouvre réellement une nouvelle ére pour la Serbie. Les
analyses des films, quant 8 elles, sont toujours pertinentes et intellectuellement stimulantes. Ces
analyses projettent une lumiére instructive sur les films du corpus. Le lecteur est mis dans les
meilleures dispositions pour suivre les transformations de la représentation des femmes dans le
cinéma serbe et ce principalement par un procédé de construction linéaire du récit et d'un
rétrécissement de la focal sur les facteurs que l'auteure a sélectionné comme essentiels :idéologie
communiste, dans sa variante titiste, et larriére-plan « traditionnel » de la vie sociale locale, sur
laquelle cette idéologie venait en partie se plaquer et qu'elle venait en partie contrarier avec
Vobjectif de la modifier radicalement. Cependant, a cet endroit, deux remarques s'imposent. L'une
qui se rapporte a I’échelle globale, et l'autre celle du local.
1. Lévolution de image des femmes dans le cinéma serbe et yougoslave n'est pas
seulement le fait de la confrontation de Iidéologie communiste et de la dimension « traditionnelle »
ou « patriarcale » de la société serbe - et yougoslave dans son ensemble. Les modifications de la
figure féminine sont un phénomene global, observable dans le cinéma européen et mondial, et il
aurait été utile de mettre en place un dispositif de recherche comparatif pour faire émerger les
spécificités serbes et yougoslaves. Sans cela, il est tres difficile de distinguer le particulier serbe ou
yougoslave des tendances structurelles globales de I'évolution des modes de vie qui ont impacté les
conditions d’existence réelles des femmes dans la vie sociale, et par voie de conséquence leur
représentation dans le cinéma, De plus, ajoute Dejan Dimitrjevic, la période sélectionnée par
Vauteure est également traversée par différents mouvements revendiquant l'égalité (voire
V’égalitarisme) et \'émancipation a I’échelle planétaire, ce qui renforce la dimension globale des
cadres dans lesquels se sont déroulées les différentes séquences historiques que Madame Andja
Srdic-Srebro a sélectionnées pour son étude. La Partisane communiste, qui est souvent montrée
comme légale des Partisans dans les films yougoslaves sur la Guerre de libération, et les
dénonciations des contradictions et de W'embourgeoisement du processus révolutionnaire par les
réalisateurs de la « Vague Noire » des années 1960/1970 sont parties prenantes de phénoménes
globaux. Les luttes politiques égalitaristes et émancipatrices de la seconde moitié des années 1960
ont, dans leur version Occidentale, explicitement ajouté la dimension corporelle et sexuelle aux
perspectives d'émancipation, ce dont témoignent les films de la Vague Noire. gs0¥*Abry,
(AG) ,
2. Vutilisation de la notion de « tradition » est aussi abondante qu’imprécise. Dejan Dimitrijevic
regrette que l'auteure ne s'explique jamais sur ce quelle entend par société ou culture
«traditionnelle ». Le terme « traditionnel » est parfois utilisé comme synonyme de « populaire »,
parfois comme celui de « religieux », ou encore de « pré-moderne », mais dans tous les cas son usage
rest précédé d’aucune discussion ni problématisation. Pour ne prendre que l'exemple de \'instinet
maternel, qui est présenté comme un élément archétypique de la « tradition patriarcale », il est
étonnant qu’une étude qui s‘inscrit dans le périmetre des sciences sociales, et & plus forte raison
dans celui de ranthropologie (comme 'indique le sous-titre de la these), ne restitue aucun élément
du débat scientifique sur ce théme. Entre son appréhension culturaliste, qui classe I'instinct maternel
dans la catégorie des normes socialement et historiquement construites, et le retour contemporain
du biologique dans les recherches anthropologiques, qui donne @ V'instinct maternel une réalité
naturelle, les enjeux sont pourtant intenses (voir par exemple, Marc H. Bornstein, Diane L. Putnick,
Paola Rigo, Gianluca Esposito, James E, Swain, Joan T. D. Suwalsky, Xueyun Su, Xiaoxia Du, Kaihua
Zhang, Linda R. Cote, Nicola De Pisapia, and Paola Venuti, PNAS, 114 (45), Edited by Charles Gross,
Princeton University, Princeton, NJ https://doi.org/10.1073/pnas.1712022114)
Dejan Dimitrijevic poursuit néanmoins en relativisant ses critiques. Nonobstant les failles, qui
sont principalement relatives 4 la contextualisation historique et a la problématisation
anthropologique, ce qui serait surtout handicapant si la these s‘inscrivait dans le champ académique
de l'anthropologie sociale et culturelle, le manuscrit est globalement de trés bonne qualité, avec des
séquences particuliérement réussies. II ne souhaite en restituer qu’une, pour ne pas étre trop long et
parce que beaucoup ont déja été soulignées par ses collegues.
Dans les analyses que Madame Srdic Srebro fait des films sélectionnés, nous retrouvons une
tension entre la volonté du sujet individuel ou collectif et la structure (qui est le plus souvent
désignée du nom approximatif de « culture » ou « tradition »). C'est par exemple, ordre ancien que
veulent abolir les communistes et le réel social avec lequel ils doivent néanmoins composer. Mais,
cette tension est particuliérement bien rendue dans le chapitre « IV. Fluidités du genre : héros et
héroines transgenres » (pp. 253 sq.), avec deux beaux exemples extraits du film W. R. ou les Mystéres
de Forgonisme, de Dusan Makavejev, qui alimentent la réflexion sur la rupture et la permanence. Le
premier exemple est celui oli la muse transgenre d’Andy Warhol, Jackie Curtis, relate sa premiére
expérience sexuelle avec un homme aprés « sa transition en femme ». Elle explique que homme
avec lequel elle avait des relations sexuelles avant sa transformation « était incapable de bander »
aprés, préférant les relations sexuelles avec des hommes. Jackie Curtis exprime son
incompréhension, car dit-elle :«.. j’tais la méme personne. Littéralement la méme personne ». (p.
261) L’autre exemple significatif est celui de Milena qui s'identifie du slogan « Mort au fascisme des
hommes ! Liberté au Peuple des fermmes » mais qui « tombe amoureuse d'un homme dont le profil
ne correspond pas du tout 4 ses idéaux: un modele d'homme «stalinien de ta révolution
sovidtique ». Au travers de ces deux cas, Madame Srdic Srebro montre parfaitement les noeuds qui se
tissent dans des tensions parfois extrémes entre « convictions personnelles » et « expériences
réelles ».
Pour finir, Dejan Dimitrijevic tient a préciser que les quelques regrets qu'il a exposés témoignent
plus de Vintérét pris la lecture de la thése qu’elles n’en constituent des critiques négatives. Il estime
que la qualité de la recherche saute aux yeux, qu'elle fera date dans le domaine des études du
cinéma serbe et yougoslave, et pour toutes ces raisons il réitere ses félicitations & Andja Srdic Srebro.
Alexandre Prstojevic prend la parole. Il souligne le plaisir qu'il a eu a lire cette these,
correctement écrite et bien structurée, présentée de surcroit sous une forme particuligrement
soignée (['absence de coquilles, la mise en page agréable, une riche iconographie).
Il rappelle son empan chronologique qui couvre une trés longue période dans I'histoire de la
Serbie, coincidant en réalité, avec le régne du parti communiste du « Maréchal » Tito. Il est donc
question d'un travail de grande envergure, couvrant quelque cinquante ans d'une cinématographie
nationale marquée par une évolution et une diversification thématique (nctamergce demniére
(At)
période) trés importantes. Le professeur Prstojevic félicite la candidate de la qualité et de la
représentativité de son corpus qui comprend tous les films marquants de la période.
Cette réflexion sur la « représentation des femmes dans le cinéma serbe », est aussi un voyage
dans le temps. C’est le retour dans un pays qui n’est plus, car histoire serbe la plus contemporaine
ne peut étre dissociée de celle de la Yougoslavie communiste. Mme Srdic reconstitue de mantere
indirecte et tout allusive, 4 travers une lecture cinématographique dun imaginaire local, les maniéres
de penser, de sentir et de faire que furent celles des « ex-Yougoslaves ». II n'y a pas de doute que
cette entreprise repose ~ dailleurs Mme Srdic ne sen cache pas: elle en fait méme un argument
méthodologique ~ sur un élément trés personnel : sur la mémoire intime de ce « monde d'hier »
pour lequel elle semble éprouver une forte sympathie.
Le professeur Prstojevie précise qu'l n'est ni anthropologue ni spécialiste du cinéma. De ce fait, il
soubaite limiter sa réflexion & la maniére dont un cadre culturel et historique concret ~ cest-&-dire
certaines références communes ~ a été restitué et interprété dans le travail de la candidate. II fait
remarquer que le manuscrit de Mme Srdic dont il tient & souligner derechef la richesse et la qualité,
ne tient pas compte du contexte dans lequel s'est développé le cinéma serbe. Toutes les analyses
proposées dans cette étude le sont de maniére pour ainsi dire « désincarnée » comme si le cinéma
serbe aprés la Seconde Guerre mondiale ne représentait aucune différence substantielle avec celui
de Europe occidentale,
Or, la cinématographie serbe dans la seconde moitié du xx" sidcle n’est pas celle de la France ou
de la Suisse. C’est la cinématographie d’un pays communiste. Elle se développe dans un contexte
‘épressif dans lequel il n'y a pratiquement aucune liberté de parole ou d'action. Dans fimmédiat
aprés-guerre des dizaines de millers de personnes sont exécutées, emprisonnées ou contraintes &
Vex, les biens de la « bourgeoisie » sont saisis par l'état, la liberté politique est inexistante, la
critique méme la plus modérée du régime est punie de lourdes peines de prison. Le « dégel » qui
survient dans les années 1970 ~ en réalité, il s‘agit d'une amélioration de la situation économique,
plus que d'un aggiornamento idéologique ~ ne modifie pas radicalement les conditions de vie des
Yougoslaves. Cest dans la derniére décennie seulement — les années 1980 ~ qu'une certaine liberté
de parole sera accordée aux artistes, mais Ié aussi, 8 condition qu'ls restent en deca de la ligne rouge
implicitement tracée par le comité central.
De ce point de vue, deux moments ilustrent ce manque dattention portée a I'Histoire. Au tout
début de son étude, la candidate présente la Seconde Guerre mondiale de maniére qui rappelle
Gtrangement les manuels scolaires communistes puisque le principal mouvement de résistance
commandé par le Général Mihailovic, reconnu par le gouvernement en exil a Londres et soutenu par
les Alliés, n’est jamais évoqué. Pour la candidate, dans les Balkans occidentaux, il n'y avait que les
partisans de Tito, pour se mettre sur le chemin de l'armée de occupation |
De mame, lorsqu’elle évoque la vie en ex-Yougoslavie dans immédiat aprés-guerre, la candidate
cite un extrait de la constitution de 1946 qui « garantissait » au citoyens yougoslaves la « liberté de
conscience et la liberté de religion » en oubliant de préciser que cette constitution ~ en tout cas
Varticle 25 qu’elle cite ~ était pure fiction et que toute pratique religieuse, notamment celle de la foi
orthodoxe (Serbie, Macédoine, Monténégro, une partie de la Bosnie et de la Croatie) était réprimée
avec la plus grande vigueur, que les fiddles étaient soumis a la surveillance policiére et aux
chicaneries administratives permanentes, quill était impensable qu’un chrétien déclaré puisse aspirer
8 une position professionnelle avantageuse, que tout un systéme de contraintes et de méfiance
entourait celui qui osait assister a la messe le condamnant & une solitude certaine, etc., etc. De cette
répression il ne reste rien dans le manuscrit de la candidate. A la place, c'est un pays de cocagne qui
se profile oi il faisait bon vivre et ou, grdce au bienveillant travail du Pert, les femmes ont retrouvé
leur iberté tant désirée.
| ne faut pas s’étonner alors si le chapitre consacré aux « films de partisans », qui aurait pu
donner lieu une analyse fine de la manire dont un systame répressif construit son imaginaire,
oblitére complétement le contexte historique pour mettre en valeur une vision positive de la femme
lngrée, de Ia femme combattante, 2 gale de Thome, porteuse des valews dy gamgunisme
triomphant. Mme Srdic ne précise 4 aucun moment le fait que ces films sont, en rage des filmes de
(Ae).
propagande d'un régime totalitaire, que leur fonction principale est de déformer la réalité historique
(celle de la guerre) et de maquiller la situation tragique dans laquelle se trouve le pays dans les
années quarante et cinquante (les procés montés, les emprisonnements, les exécutions, etc.). Dans
cette terrible machine de propagande la candidate ne trouve digne d'intérét ~ c’est-a-dire d'analyse
= que la représentation fictionnelle des progres, par ailleurs fort douteux et somme toute
secondaires, d’un « féminisme » révolutionnaire.
De importance et de la nécessité de la contextualisation historique dans l'étude du cinéma
serbe témoigne la partie de la thase consacrée aux années 1980. La candidate y propose des analyses
fines des couvres et des courants majeurs de cette période qui pour des raisons évoquées plus haut
souffrent moins de la pression politique. Bien que toujours surveillée, la production de époque peut
se développer de maniére nettement plus libre et prendre des distances avec le politique, parfois
méme émettre quelques critiques voilées du pouvoir. De ce fait, elle s‘offre plus facilement 8 une
analyse « immanente ». Les pages consacrées 8 Dusan Makavejev le prouvent quiillustrent de la plus
belle maniére la qualité du regard de Mme Srdic. Elles constituent indubitablement un bel apport &
étude du cinéma serbe. De méme, le chapitre sur la « fluidité du genre » mérite attention. Trés bien
construit, reposant sur des analyses pertinentes et proposant un angle de vue original sur une
production relativement peu « exploitée » sur le plan théorique, ce chapitre est peut-étre l'un des
mieux réussis dans ce riche travail qu’est « Les représentations des femmes dans le cinéma serbe :
identités individuelles et imaginaires collectifs ».
la critique de approche «immanente » qui tend a décontextualiser historiquement la
production cinématographique serbe, ne diminue d’aucune maniére les qualités de cette these, Au
contraire, elle a pour but de permettre a la candidate d’améliorer encore son manuscrit en vue d'une
éventuelle publication
«Les représentations des femmes dans le cinéma serbe» est une étude riche, fort bien
structurée, au propos clair et précis. Elle sinscrit dans le courant récent des études du genre ce qui lui
garantit une certaine « actualité » académique et la rend utile aussi bien aux spécialistes francais que
serbes.
Catherine Géry, deuxiéme rapporteur et présidente du Jury, prend la parole et salue une
thése d’un beau volume, bien présentée et tres bien rédigée ; tout est fait par Andja Srdic-Srebro
pour faciliter a lecture de cette étude aux bases théoriques clairement exposées, et dont les qualités
conceptuelles et pédagogiques sont évidentes. Vapproche méthodologique, entre « lecture
textuelle » et « auto-ethnographie », est convaincante. Enfin, et ce nest pas son moindre mérite,
cette thése vient combler une absence dans la slavistique francaise, puisque le cinéma serbe, et de
facon plus générale, yougoslave, n’a que peu attiré I'attention des chercheurs & ce jour. Catherine
Géry remercie d’ailleurs Andja Sdric Srebro de avoir initiée A une cinématographie qui lui était
presque inconnue, a l'exception de 4 ou 5 films.
La thése d’Andja Srdic-Srebro est organisée en quatre parties, qui laissent apparaitre deux
mouvements nettement différenciés: le premier définit le cadre historique, théorique et
méthodologique de cette étude (trois 1éres parties) : sont passés en revue un choix d’éléments du
contexte historico-culturel (la condition des femmes en Serbie, la construction du féminin a travers
les pratiques sociales ou religicuses, I’histoire et la definition du cinéma serbe), les assises théoriques
(essentiellement fondée sur les principes de 'anthropologie visuelle et, de fagon plus annexe, sur les
Gtudes féministes et les études de genre) et la démarche pluridisciplinaire de la candidate. Le
deuxigme mouvement consiste en une analyse diachronique et thématique des représentations des
femmes dans le cinéma serbe visant 4 établir une typologie (4° partie). Cette typologie envisage
plusieurs hypostases du féminin, regroupées en six grandes catégories : la partisane, la mére, la
sorciére, 'héroine queer, I'étrangere, la nouvelle femme yougoslave.
A intérieur de ce deuxigme mouvement, les analyses des films sont bien menées et souvent
de lecture captivante, méme pour qui n’a pas eu acces & toutes les oeuvres du corpus. Madéles et
stéréotypes de comportement genrés dans leurs dimensions sociales, me pormbalgee font
(ae):
Vobjet d'études précises et fouillées(on se demande toutefois ce qu'il en est des identités
individuelles annoncées dans le titre, qui semblent disparaitre de la réflexion de la thése). On
distinguera un bon chapitre Ill sur les «femmes aux pouvoirs surnaturels » qui réussit
harmonieusement la synthése de I'analyse des représentations et de I'approche folkloristique et
anthropologique, et un chapitre IV trés intéressant sur « la fluidité du genre » avec le phénoméne,
largement méconnu hors des frontidres de l’ancienne Yougoslavie, de queeruption (pour reprendre
le mot-valise d’Olga Dmitrijevic) dans le cinéma de la « Vague noire », Dans cette 4° partie, le lecteur
apprend avec amusement que sorciéres et personages queers, ces nouvelles icénes de notre monde
contemporain, font depuis assez longtemps ‘objet de représentations dans le cinéma yougoslave.
La filmographie en annexe (p. 421 4 445), qui propose le synopsis et des « notes et
remarques » pour chacun des 38 films qui forment le corpus, est utile et bienvenue, ainsi que la
filmographie complete des 71 réalisateurs d’ex Yougoslavie (p. 447 a 451) et I'index des ceuvres et
des auteurs mentionnés dans la thése.
La thése d’Andja Srdic-Srebro appelle cependant une série de questions, dont la premiere
touche aux désavantages d'une structure qu'on pourrait qualifier de « différentielle » en ce qu'elle
fait le choix d’une séparation radicale entre le cadre théorique, les éléments de contexte et ce qui
constitue le noyau de la thése: l'analyse des représentations des femmes dans les films. Les
différentes parties sont en conséquence trés déséquilibrées : une trentaine de pages successivement
pour la premiére et la seconde partie, un peu plus de 50 pages pour la 3° partie et... 240 pages pour
la 4° partie. Ce défaut de structure semble procéder d’un souci pédagogique et méthodologique sans
doute trop accentué qui fait qu'on attend plus de 150 pages pour « entrer dans le vif du sujet » ~ et
ici, les qualités de la thése se retournent en faiblesses, d’autant plus que certains des prolégoménes
‘ou des outils exposés dans les trois premiéres parties (ou premier mouvement) ne semblent pas
avoir toujours innervé ou construit la réflexion dans la quatriéme par Pourtant, le chapitre sur la
«mere, matrice du corps social », montre que la candidate sait fondre la réflexion théorique et
historique dans la problématique qui est la sienne.
Pour ce qui est du corpus, on ne peut que regretter une sélection fondée sur des critéres
consistant 4 ne prendre en compte que « des films réalisés par des cinéastes reconnus aux niveaux
national et international » (p. 25), ce qui souléve deux problémes ; 1} Celui des critéres de cette
reconnaissance nationale et internationale: par exemple, quelles sont les conditions de co-
production et de diffusion des films « serbes » ou plus globalement yougoslaves a |’étranger ? Les
critéres de reconnaissance institutionnelle ne sont-ils pas forcément genrés sur une grande partie de
la période couverte par la thése ? 2) Une telle approche a pour effet de laisser completement de cété
les (rares) films réalisés par des femmes. On aurait aimé savoir quelles sont les possibilités d’accés
des femmes a la réalisation de films en Yougoslavie/Serbie et quelle est leur place dans l'industrie du
cinéma ? Ces questions sont en partie mais trop rapidement abordées p. 90 4 94 dans la partie
«Apercu de [histoire du cinéma serbe et yougoslave » et en conclusion de ce dernier ; mais seuls
deux paragraphes sont consacrés aux réalisatrices et monteuses, le reste traitant des actrices. |I faut
en fait se référer a I’annexe II pour faire la constatation suivante (reprise dans la conclusion) : sur les
71 réalisateurs répertoriés, seuls 3 sont des femmes, et aucune n’entre dans le corpus... Catherine
Géry note que la thése occulte également les éléments institutionnels constitutifs de «la
cinématographie serbe ». Les réalisateurs et leur parcours ne sont pas présentés, les conditions de
production et de diffusion des films ou les politiques socioéconomiques, dont on sait qu’elles
déterminent en partie les systémes de représentation des ceuvres cinématographiques, ne sont pas
analysées. Pas plus que ne sont exposés le systéme de censure (toujours trés complexe pour les
cinématographies des régimes communistes) ou, a quelques exceptions prés, la réception critique
des films (articles de presse, prix, etc.) et tout ce qui permettrait d’apprécier la marche de manoeuvre
dont disposaient les réalisateurs et les scénaristes, ainsi que le cadre trés contraignant dans lequel ils
évoluaient.
Une étude précise des institutions cinématographiques aurait sans doute permis de répondre
@ certaines interrogations évoquées ci-dessus, comme elle aurait permis de repondre plus
précisément & la question qui se trouve au coeur de la thase (et qui ne peut se rgs8itdre'Haga seule
f
Cx
approche « classique » par les représentations), telle qu’elle est formulée page 28 : « le cinéma serbe
reflete-t-il les enjeux socio-culturels autour de la notion du féminin, et si oui ~ comment ? ». En effet,
la représentation des femmes au cinéma est indéfectiblement liée & leur statut social, professionnel
ou culturel dans le syst8me qui les regarde.
La question du regard, essenticlle dans ce type de travail sur les représentations, est donc
&troitement liée a celle du choix des films analysés. Andja Srdic-Srebro est consclente de
importance du regard au cinéma (comme le prouve la partie intitulée « une image misogyne ? »), un
art pour lequel la question fondamentale est : qui regarde quoi, et avec quel regard ? (ou, pour
reprendre Judith Butler citée p. 253, « qui imagine qui et dans quel but ? »). Le titre de la 3° partie de
la these est par ailleurs trés révélateur: «le regard du cinéma sur les femmes au prisme de
Vanthropologie » ; on comprend tout de suite qu'il s‘agira d’un regard masculin sur le féminin. Ainsi,
un certains nombres de films du corpus proposent des représentations du féminin qui sont le résultat
d'une projection fantasmatique masculine ; la femme-vampire du film de Kadijevic Papillon, mais
aussi toute la galerie de femmes idéalisées, démonisées ou sacrifiées dans les films analysés ~ c'est
pour cela quiil aurait été nécessaire de confronter ceux-ci 8 des représentations de femmes dans des
films réalisés par des femmes, ne serait-ce que pour évaluer dans quelle mesure les stéréotypes
masculins ont été intériorisés par ces derniéres.
Cest [a que l'anthropologie et ses phénomenes de transfert rencontrent les études de genre,
et il aurait été judicieux de croiser plus systématiquement les deux approches, en s'appuyant par
exemple sur les travaux de Laura Mulvey 8 qui Andja Sdric Srebro consacre quelques pages dans sa
partie d’exposition théorique, mais sans les faire vraiment fructifier au moment de l'analyse des films
= a exception du moment, qui constitue sans doute un des sommets de la thése, de I'altérité que
constitue le féminin pour les cinéastes du corpus. On peut faire le méme constat pour le concept de
« micro-matriarcat sacrificiel » de Marina Hugson qui aurait gagné a étre intégré a l'analyse des films
et 3 en organiser la réflexion, plut6t qu'en étre dissocié a Vintérieur d'un « premier mouvement » qui
n’échappe pas aux écueils du reader's digest. Cette notion de « micro-matriarcat sacrificiel » est
extrémement intéressante et fonctionne trés bien dans le monde slave, oui le sactifice de soi est sur
échelle des vertus la qualité la plus haute et la plus partagée par les femmes dans la culture écrite
orthodoxe (on en retrouve des traces dans toute la littérature russe du XIX° siécle, par exemple). I
aurait été pertinent de lier ce concept de au poids de la tradition orthodoxe plutdt que de les
juxtaposer. Catherine Géry fait la méme remarque pour le cinéma « komunisto », qui propage des
images de sacrifice féminin (ici, le sacrifice & la cause collective). La conclusion, tras réussie, de la
these met d’ailleurs en avant ces deux notions fondamentales : sacrifice et altérité, qui auraient
peut-étre pu structurer plus fermement le cheminement scientifique en évitant les dissociations que
Catherine Géry a relevées.
Une derniére interrogation concerne I’épineuse problématique d'un « cinéma national » (en
occurrence, serbe) en contexte multinational (en occurrence, yougoslave). Ic, les critéres retenus
pour définir un « cinéma serbe » indissociable de la construction d'un imaginaire national méritent
d'atre discutés. Catherine Géry estime que la notion de « cinéma national », traitée dans la deuxiéme
partie de la these, aurait due étre abordée en tant que construction et comme imaginaire (voir @ ce
sujet Benedict Anderson, Anne-Marie Thiesse ou Jean-Michel Frodon), Comme Ia bien relevé Jean-
Michel Frodon dans introduction de son ouvrage La Projection nationale, le cinéma national releve
de la projection fantasmatique : « ll y a une analogie entre la nation et le cinéma, qui existent et ne
peuvent exister que par un méme mécanisme : la projection », Dans sa recherche d'un cinéma
rational serbe «2 tout prix », Andja Sdric Srebro n’évite pas le pidge de « limaginaire national »
analysé par Benedict Anderson dans son ouvrage de référence Imagined Communities. Reflections on
the Origin and. Spread of Nationalism. Aussi, les quatre criteres qu'elle retient pour définir un cinéma
serbe (p, 70) réduisent singuliérement la définition d'un cinéma national, surtout le 4°: un film est
considéré comme serbe « s'l traite des thémes relevant dfe lj/actualité ou dfe I|histoire de la culture
serbe ». Sil'on adopte les quatre critéres de la définition, il ne s'agit plus de cinéma national, mals de
cinéma nationaliste. Pour Catherine Géry, une cinématographie nationale (plutot qu’un cinéma
national) est une cinématographie possédant ses propres organes de eo ge les ou
Cr
comités cinématographiques), de financement, de formation (écoles d’acteurs et de réalisateurs), de
diffusion (circuits de distribution, réseau de salles) et de réception (revues spécialisées).
Les questionnements, voire les critiques suscités par la lecture de ce travail au croisement de
plusieurs prismes et disciplines n’enlevent cependant rien son originalité et la richesse des
analyses ; ces critiques découlent essentiellement de la simulation intellectuelle provoquée par la
lecture d'une these que Catherine Géry a pris beaucoup de plaisir & lire et qui lui a délivré de
précieuses informations.
La candidate a tout au long de la soutenance fourni des réponses circonstanciées &
ensemble des questions qui lui ont été posées ou aux critiques émises par les divers membres du
jury, qui lui accorde, au terme d’une courte délibération, le titre de Docteure en Etudes slaves.
+ Weg Tevic
C. Ceey 6. LE GANS Bal
ie
14
b ao
AR ea
8 # Université
® * BORDEAUX Ecole doctorale Montaigne Humanités
MONTAIGNE
sw /
Ane
Délégation de signature
Je, soussigné, Monsieur Dejan DIMITRUEVIC.
Qualité : Professeur a 'Université Lumiére Lyon 2.
1 - Déclare assister en visioconférence & la soutenance de
Madame Andja SRDIC ...
Titre des de la Thése : Les représentations des femmes dans le cinéma serbe : identités individuelles et imaginaires
collectifs. Une étude anthropologique
Ayant eu lieu le 17 Septembre 2021...
EN VISIOCONFERENCE 200M
de 14h00 a 18h30
2- Autorise
‘Madame Catherine GERY.....
Qualité: Président du jury de thése
{signer seul et en mon nom les documents administratifs iés
Cette délégation est délivrée a titre exceptionnel et dérogatoire, suite 8 mon impossibilité d’assister en présentiel &
cette soutenance, en raison de la crise sanitaire Covid-19,
Date 17/09/2021.
Signature
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universtare F-23607 PESSAC Cedex
tel 433(0)957 1244 4a
‘wba montagne fe
# Université \
BORDEAUX Ecole doctorale Montaigne Humanités
MONTAIGNE
oa /
Délégation de signature
Je, soussigné, Monsieur Slobodan NAUMOVIC.
Qualité : Professeur a I'Université de Belgrade.
1 - Déclare assister en visioconférence & la soutenance de
‘Madame Andja SROIC.
Titre des de la These : Les représentations des femmes dans le cinéma serbe :identités individuelles et imaginaires
collectifs. Une étude anthropologique
Ayant eu lieu le 17 Septembre 2021 de 14h00 8 18h30
EN VISIOCONFERENCE ZOOM,
2- Autorise
Madame Catherine GERY
Qualité : Président du jury de these
A signer seul et en mon nom les documents administratifs liés
Cette délégation est délivrée a titre exceptionnel et dérogatoire, suite 3 mon impossibilité d’assister en présentiel a
cette soutenance, en raison de la crise sanitaire Covid-19.
Date 17/03/2021;
sinature/
Université Bordeaux Montaigne
21433 (0)557 1248.8
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)
- Buljina Stvaranje Muslimanske NacijeDocument108 pagesBuljina Stvaranje Muslimanske NacijesrdjasrdjaNo ratings yet
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)
- (Europea - Ethnomusicologies and Modernities) Dafni Tragaki - Empire of Song - Europe and Nation in The Eurovision Song Contest-Scarecrow Press (2013)Document337 pages(Europea - Ethnomusicologies and Modernities) Dafni Tragaki - Empire of Song - Europe and Nation in The Eurovision Song Contest-Scarecrow Press (2013)srdjasrdjaNo ratings yet
- Lista Naucnih Casopisa Domacih Izdavaca Za 2021 25012022Document68 pagesLista Naucnih Casopisa Domacih Izdavaca Za 2021 25012022srdjasrdjaNo ratings yet
- Da Li Macke Jedu Lice JB A Volim Da Gledam I Gledam Sa Erkom I SinomDocument22 pagesDa Li Macke Jedu Lice JB A Volim Da Gledam I Gledam Sa Erkom I SinomsrdjasrdjaNo ratings yet
- O Identitetu - 33. Miraš MARTINOVIĆDocument7 pagesO Identitetu - 33. Miraš MARTINOVIĆsrdjasrdjaNo ratings yet
- Kujovic IslamDocument7 pagesKujovic IslamsrdjasrdjaNo ratings yet
- Crna Gora 1878-1918. - 02 - Dragan K. VukčevićDocument7 pagesCrna Gora 1878-1918. - 02 - Dragan K. VukčevićsrdjasrdjaNo ratings yet
- Etnogeneza - Hrvatska EnciklopedijaDocument4 pagesEtnogeneza - Hrvatska EnciklopedijasrdjasrdjaNo ratings yet
- Vidak Vujacic Porodica U Crnoj GoriDocument12 pagesVidak Vujacic Porodica U Crnoj GorisrdjasrdjaNo ratings yet
- Етничко култоролошки атлас Црне Горе Секуловић ШарановићDocument14 pagesЕтничко култоролошки атлас Црне Горе Секуловић ШарановићsrdjasrdjaNo ratings yet
- Keeping Up Appearances How The Soviet State Failed To Control Popular Attitudes Toward The United States of America 1945-1959Document289 pagesKeeping Up Appearances How The Soviet State Failed To Control Popular Attitudes Toward The United States of America 1945-1959srdjasrdja0% (1)
- The Image of Josip Broz Tito in Post-YugoslaviaDocument19 pagesThe Image of Josip Broz Tito in Post-YugoslaviasrdjasrdjaNo ratings yet
- AdministrativnaDocument21 pagesAdministrativnasrdjasrdjaNo ratings yet
- Vojvodina U Borbi FINAL-1Document40 pagesVojvodina U Borbi FINAL-1srdjasrdjaNo ratings yet
- ArkzinDocument50 pagesArkzinsrdjasrdjaNo ratings yet
- Disidenti Druge JugoslavijeDocument20 pagesDisidenti Druge JugoslavijesrdjasrdjaNo ratings yet
- Dejan DjokicDocument19 pagesDejan DjokicsrdjasrdjaNo ratings yet