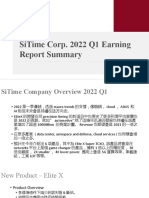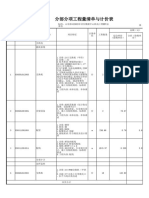Professional Documents
Culture Documents
Wimax
Wimax
Uploaded by
Suley PatersonOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Wimax
Wimax
Uploaded by
Suley PatersonCopyright:
Available Formats
Page 1 sur 37
DOSSIER
NOUVELLES TECHNOLOGIES
RESEAUX
Ludovic De RGAUD
Nicolas DOCQ
Maxime HABABOU
2003/2004 R5
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 2 sur 37
TABLE DES MATIERES
I. Introduction 3
II. Prsentation gnrale 4
1. Principe et equipements pour la BLR4
2. Les Frequences disponibles 6
3. L`ART et l`attribution des licences6
III. Etude technique de la norme 1
1. La norme 802.1610
a) La couche physique 11
2. La norme 802.16a/b 22
a) Groupe 802.16a 22
b) Groupe 802.16b 23
IJ. Perspectives pour 82.1 24
1. 802.16 : un concept large bande 24
a) La technologie du large bande 24
b) La mise en place du large bande 25
c) Evolution de la large bande 26
d) penetration de la technologie hertzienne au sein du large bande 26
2. Comparaison BLR / autres oIIres hauts debits 27
a) ComparatiI technologique du debit 27
b) Tableau recapitulatiI des oIIres haut debit 29
3. Comparaison 802.16 / 802.1130
4. Previsions de developpement 33
a) De nombreux projets 33
b) La puce Wimax d'Intel 33
J. Conclusion 35
JI. Webographie 3
JII. Clossaire 37
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 3 sur 37
I I. . I IN NT TR RO OD DU UC CT TI IO ON N
L'objectif de ce dossier est de prsenter la norme EEE 802.16.
Elle reprsente une des deux normes applicables la BLR (Boucle Locale Radio)
haut dbit avec la norme 802.11.
Dans un premier temps, nous prsenterons le principe de fonctionnement et
l'mergence de la Boucle Locale Radio en France.
Nous tudierons ensuite les aspects techniques de la norme 802.16 et ses drives.
Enfin, nous raliserons une tude comparative de cette norme avec les autres offres
actuelles, afin d'en dgager les avantages et les inconvnients et d'anticiper les
volutions possibles de cette norme.
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 4 sur 37
I II I. . P PR RE ES SE EN NT TA AT TI IO ON N G GE EN NE ER RA AL LE E
1. Principe et quipements pour Ia BLR
Historiquement, les zones isoles ou trop loignes gographiquement des
mtropoles ne pouvaient tre couvertes par l'nternet haut dbit, pour des raisons de
cots lis au dploiement des cbles. De fait, l'installation d'une antenne,
metteur/rcepteur d'ondes radio, pouvait pallier ce manque. Dans le cadre de la
libralisation du march des tlcommunications (effective au 1er janvier 2001), le
dgroupage de la boucle locale filaire a pris un certain retard notamment du fait de la
mauvaise volont de France Telecom. Certains oprateurs, comme Belgacom,
FirstMark et Fortel, ont pris le parti d'investir dans le dploiement d'antennes sur les
toits d'immeubles et de ne pas attendre que France Tlcom libre des emplacements
dans ses centres au plus prs de l'abonn pour permettre aux oprateurs alternatifs
de s'y brancher et d'exploiter le rseau filaire existant.
Ainsi est ne la boucle locale radio, moins onreuse (pas besoin de creuser des
tranches comme pour le cble) et indpendante de l'oprateur historique national
auquel il n'est pas besoin de verser une licence d'exploitation.
La boucIe IocaIe dsigne les infrastructures de transmission d'un rseau de
tlcommunications ouvert au public reliant directement les clients aux quipements
de commutation auxquels ils sont rattachs. Elle reprsente un segment important du
rseau d'un oprateur, travers lequel celui-ci peut accder directement ses clients
et matriser les services offerts.
Les technologies radio dans la boucle locale constituent aujourd'hui une solution de
substitution aux moyens filaires pour le raccordement direct de clients et la fourniture
de services de tlcommunications fixes.
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 5 sur 37
Composition d'une architecture BLR :
Le premier lment de l'architecture BLR est la station de base. Les stations de base
correspondent aux antennes places sur les toits d'immeubles et tous les
quipements qui y sont relis, chargs d'mettre et de recevoir les paquets de
donnes sous forme d'ondes radio. La station de base est relie au centre de
l'oprateur, et prend en charge les transmissions avec les abonns.
Au niveau de la station de base (en fait quatre stations aux quatre coins de l'immeuble
qui couvrent chacune un faisceau d'ondes sur un angle de 90 degrs), l'antenne est le
maillon final qui met et reoit les ondes radio. Avant celle-ci est situe une passerelle
qui transforme le protocole rseau fixe employ pour la transmission (par exemple
ATM sous forme de paquets de donnes) en un quivalent propritaire sous forme
d'ondes radio. Bien videmment, il faut aussi que l'oprateur puisse gnrer en amont
ce flux ATM partir de la fibre trs haut dbit, et il lui faut pour cela un commutateur
adquat.
Chez le client, une petite antenne doit tre place sur le toit de l'immeuble ou au
minimum sur un balcon expos dans la bonne direction. Celle-ci est relie par un
cble un botier priphrique de l'ordinateur, qui joue le rle de modem
(MOdulateur/DEModulateur de frquences).
De son ct l'oprateur doit disposer d'antennes parpilles sur le territoire, sachant
qu'elles doivent tre au maximum 15 kilomtres du client final. Cette technologie
autorise au final un dbit allant jusqu' 132 Mbits/seconde.
Parmi les quipementiers concerns, on retrouve souvent Alcatel, mais galement
Thales datys, l'ancienne division telecoms de Dassault AT dont le nom est dsormais
Thales e-Transactions SA.
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 6 sur 37
2. Les Frquences disponibIes
La validation des frquences utilises et la distribution de celles-ci aux diffrents
oprateurs appartient l'ART (Autorit de rgulation des tlcommunications).
La rgulation consiste en l'application, par l'autorit comptente, de l'ensemble des
dispositions juridiques, conomiques et techniques qui permettent aux activits de
tlcommunications de s'exercer effectivement.
En France, la loi a confi cette mission au ministre charg des tlcommunications et
une institution indpendante : l'Autorit de rgulation des tlcommunications, mise
en place le 5 janvier 1997.
Le nombre d'oprateurs pouvant exploiter la boucle locale radio est forcment limit.
Tout comme les emplacements pour brancher les fils sur les commutateurs de France
Tlcom sont en nombre limit, les frquences qui peuvent tre attribues le sont
galement. Si deux oprateurs tentaient d'mettre sur la mme frquence, les flux
risqueraient d'tre superposs et des incohrences empcheraient un envoi ou une
rception correcte des donnes ou de la voix. Or, le 23 Avril 1998, aprs que la phase
d'exprimentation de la BLR ait t termin, l'ART n'a retenu que deux bandes de
frquences juges exploitables : autour de 3,5 GHz et de 27,5 29,5 GHz. Le
problme tant que cette dernire plage apparat en conflit avec des transmissions
satellitaires, l'arme a bien voulu concder une partie qu'elle n'exploitait pas des
frquences autour de 26 MHz. Le 23 Avril 1999, l'ART propose d'ouvrir la bande de
frquence du 26 GHz la boucle locale radio.
Les frquences identifies pour les rseaux de boucle locale radio se trouvent donc
dans les bandes de frquences 3,5 GHz et 26 GHz pour la mtropole et 3,5 GHz pour
les DOM.
3. L'ART et I'attribution des Iicences
L'Autorit de Rgulation des Tlcommunications a considr la Boucle locale radio
comme une technologie susceptible la fois de dvelopper la concurrence sur le
march local et de contribuer l'amnagement du territoire. La dmarche suivie par
l'ART a t progressive :
Lancement d'une consultation publique en 1997 avec une multitudes de questions
sur la technologie de la BLR aux diffrents oprateurs (les enjeux, le march, la
technologie, les conditions d'octroi des licences), avec rdaction d'un rapport de
synthse ;
Mise en ouvre de 27 exprimentations, afin de dterminer notamment les
frquences exploitables pour la BLR ;
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 7 sur 37
Appel candidatures lanc le 30 novembre 1999 : cet appel candidature visait
retenir 2 oprateurs mtropolitains (niveau national) dans les bandes 3,5 et 26
GHZ, 2 oprateurs dans chacune des 22 rgions mtropolitaines (bande 26 GHZ)
et 2 oprateurs dans chacun des quatre Dpartements d'outre-mer (bande 3,5
GHZ).
Le 16 fvrier 2000, 28 socits dposent 218 dossiers de candidatures pour 54
licences en jeu. Outre les critres classiques dans ce genre de procdure (capacit
technique, capacit financire du candidat), l'ART a mis l'accent sur des critres
spcifiques pour attribuer les licences :
Capacit stimuler la concurrence dans la boucle locale ;
Ampleur et rapidit du dploiement ;
Cohrence du projet ;
Optimisation de l'usage du spectre ;
Contribution l'emploi en France et en Europe ;
Contribution la protection de l'environnement.
L'attribution des frquences (suite au choix des candidats retenus et la signature
des arrts d'autorisation par le Ministre) a t publie le 28 juillet 2000.
Huit oprateurs ont t initialement retenus. Six d'entre eux ont maintenu leur offre et
sont chargs de dvelopper cette technologie et les services associs.
Les oprateurs prsents sur le march de la boucle locale radio sont donc au nombre
de six :
Deux oprateurs mtropolitains et d'ampleur nationale :
9 Telecom Entreprise (groupe LD Com) ;
Altitude Telecom.
Un oprateur mtropolitain et rgional :
Broadnet France (filiale d'Altitude Telecom).
Trois oprateurs dans les DOM :
Cegetel La Runion ;
Mdiaserv ;
XTS Network.
Le nombre d'oprateurs prsents tant aujourd'hui encore assez faible, beaucoup de
bandes de frquences ne sont pas encore attribues. D'ailleurs, le 12 mars 2003, afin
de statuer sur les conditions d'utilisation et les modalits d'attribution des frquences
radiolectriques, une consultation publique a t lance. Cette consultation a permis
d'tablir que le degr de raret dans la bande 3,5 GHz ne justifie pas la r-attribution
par appel candidatures des frquences disponibles. L'Autorit est donc dsormais
en mesure de rpondre au fur et mesure aux demandes de frquences de cette
bande.
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 8 sur 37
Pour rcapituler, voici sous forme de tableau les frquences BLR attribues par l'ART
et disponibles en France :
En mtropoIe
3,5 GHz 26 GHz
Bande 1 Bande 2 Bande 3 Bande 4 Bande 5 Bande 6 Bande
aIIoue
Rgions
15 MHz
duplex
15 MHz
duplex
112 MHz
duplex
112 MHz
duplex
112 MHz
duplex
112 MHz
duplex
Alsace DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
DisponibIe DisponibIe DisponibIe
Aquitaine DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
DisponibIe DisponibIe DisponibIe
Auvergne DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
DisponibIe DisponibIe DisponibIe
Basse-
Normandie
DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
Altitude
Tlcom
DisponibIe DisponibIe
Bourgogne DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
DisponibIe DisponibIe DisponibIe
Bretagne DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
DisponibIe DisponibIe DisponibIe
Centre DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
DisponibIe DisponibIe DisponibIe
Champagne-
Ardenne
DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
DisponibIe DisponibIe DisponibIe
Corse DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
DisponibIe DisponibIe DisponibIe
Franche-
Comt
DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
DisponibIe DisponibIe DisponibIe
Haute-
Normandie
DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
Altitude
Tlcom
DisponibIe DisponibIe
le-de-
France
DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
Broadnet
France
DisponibIe DisponibIe
Languedoc-
Roussillon
DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
DisponibIe DisponibIe DisponibIe
Limousin DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
DisponibIe DisponibIe DisponibIe
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 9 sur 37
Lorraine DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
DisponibIe DisponibIe DisponibIe
Midi-
Pyrnes
DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
DisponibIe DisponibIe DisponibIe
Nord-Pas-
de-Calais
DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
DisponibIe DisponibIe DisponibIe
Pays de la
Loire
DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
DisponibIe DisponibIe DisponibIe
Picardie DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
DisponibIe DisponibIe DisponibIe
Poitou-
Charentes
DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
DisponibIe DisponibIe DisponibIe
Provence
Alpes Cte
d'Azur
DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
DisponibIe DisponibIe DisponibIe
Rhne-Alpes DisponibIe
Altitude
Tlcom
9 Telecom
Entreprise
DisponibIe DisponibIe DisponibIe
En mtropole, la quantit de frquences alloue un oprateur dans la bande 3,5
GHz est de 15 MHz duplex.
Elle est de 112 MHz duplex dans la bande 26 GHz.
Dans Ies DOM
3,5 GHz
Bande 1 Bande 2 Bande aIIoue
Rgions
42 MHz duplex 42 MHz duplex
Guadeloupe XTS Network Carabes Mdiaserv
Guyane XTS Network Carabes DisponibIe
Martinique XTS Network Carabes Mdiaserv
Runion XTS Network Ocan ndien Cegetel La Runion
Dans les dpartements d'outre-mer, la quantit de frquence alloue un oprateur
dans la bande 3,5 GHz est de 42 MHz duplex.
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 10 sur 37
I II II I. . E ET TU UD DE E T TE EC CH HN NI IQ QU UE E D DE E L LA A N NO OR RM ME E
La norme 802.16 comporte plusieurs groupes d'tude :
Le groupe 802.16 pour les frquences > 10 GHz. Couche MAC commune
(16,16a,16b) ;
Le groupe 802.16a pour les frquences < 11 GHz ;
Le groupe 802.16b pour les frquences < 11 GHz, sans licences (UN, 5-6 Ghz,
USA) ;
Le groupe 802.16.2 qui met des recommandations pour la coexistence des
systmes 802.16.
1. La norme 802.16
Voici un aperu des diffrentes couches du modle OS constituant la norme 802.16.
Celles-ci vont tre dtailles par la suite.
Illustration 1 - Les couches physique et MAC
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 11 sur 37
a) La couche physique
Le 802.16 utilise la bande des 10 66 GHz. Dans la conception des spcifications
physiques de la bande des 10-66 Ghz, une propagation par vue directe tait
considre comme une ncessit pratique. Avec cette condition respecte, la
modulation par simple porteuse a t facilement choisie ; l'interface radio tant
dsigne "WirelessMAN-SC. De nombreux dfis de design subsistent malgr tout. En
raison de l'architecture point-multipoint, le BS transmet un signal TDM (Time Divison
Multiplex - multiplexage par division temporelle), avec une attribution d'un intervalle de
temps (slot time) pour chacun. L'accs la voie montante est ralis par TDMA
(Time-Division-Multiple-Access).
A la suite des discussions autour de l'extension de la norme concernant le duplex, la
conception d'un burst a t choisie pour permettre en mme temps :
Le TDD (Time-Division-Duplexing), dans lequel les liens montants et descendants
partage un canal mais ne transmettent pas simultanment ;
Le FDD (Frequency-Division-Duplexing), dans lequel les liens montants et
descendants fonctionnent sur diffrents canaux, parfois simultanment.
La conception de ce burst a permis de supporter de la mme faon le TDD et le FDD.
Le support du half-duplex a t ajout pour les abonns qui utilisent le FDD, ce qui
permet d'avoir des quipements moins coteux lorsqu'il ne transmettent pas et ne
reoivent pas en mme temps, ce qui s'est fait au dpend d'une lgre complexit. Le
FDD et le TDD supportent tous deux une adaptation du profil de burst dans lequel les
options de codage et de modulation peuvent tre assignes dynamiquement aux
rafales de burst. Cette adaptation dynamique est fonction des conditions d'mission-
rception radio.
DtaiIs de Ia couche physique
La spcification technique dfinie pour la bande 10-66 Ghz utilise des burst par
modulation d'une simple porteuse. Les burst sont modulaires, les paramtres de
transmissions incluant les schmas de modulation et de codage pouvant tre
ajusts individuellement pour chaque station d'abonn (SS Subscriver Station) avec
pour base du trame par trame. Des canaux de largeur de bande de 20Mhz, 25MHz
(allocation de bande typiquement US) ou 28MHz (allocation de bande typiquement
europenne) sont dfinies (en suivant une racine carre de Nyquist suivie d'une
impulsion forme d'un cosinus avec un facteur de rolloff de 0.25). Une fonction
alatoire est applique pour l'talement temporel et pour assurer les transitions de bits
afin de pouvoir rcuprer l'horloge.
Le mcanisme de correction d'erreur FEC (Forward Error Correction) utilis est Reed-
Solomon GF(256), avec des tailles de blocs variables et une capacit de correction
d'erreur. Le FEC est coupl une convolution de code pour transmettre de manire
robuste les donnes critiques, tel que les trames de contrle et d'accs initial. Les
options FEC sont couples la modulation QPSK (Quadrature Phase Shift Keying),
QAM-16 tats et QAM-64 tats afin de former des profiles de burst de robustesse
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 12 sur 37
modulable et efficace. Si le dernier bloc FEC n'est pas rempli, ce bloc peut tre
raccourci. Raccourcir la fois le lien montant et le lien descendant est contrl par le
BS et est implicitement communiqu dans la carte du lien montant (UL-MAP) et
descendant (DL-MAP).
Le systme utilise une trame de 0.5, 1, ou 2 ms. Cette trame est divise en plusieurs
slot physique afin d'allouer la largeur de bande et l'identification des transitions
physiques. A mesure que le dbit augmente, le temps d'mission diminue. Un slot
physique est dfini pour tre un symbole du codage QAM-4. Dans la version modifie
de la couche Physique du TDD, la sous-trame de lien montant est envoye aprs la
sous-trame de lien descendant sur la mme frquence porteuse. Dans la version
modifie FDD, les sous-trames des liens montants et descendants sont envoys dans
le mme intervalle de temps mais sont transportes sur des frquences spares. La
sous-trame de lien descendant est expose dans la figure suivante :
La sous-trame de lien descendant commence par une trame avec un champ de
contrle de section DL-MAP , qui est le plan de la trame descendante actuelle,
tandis que le champ UL-MAP est laiss vide pour un mme usage ultrieur. Le
plan de la trame de lien descendant spcifie quand des transitions sur la couche
physique surviennent (la modulation et le FEC changent). La sous-trame de lien
descendant contient gnralement une portion de code TDM immdiatement aprs la
trame de contrle de section. Les donnes venant du lien descendant sont transmises
chaque SS qui utilisent une ngociation du profil de burst.
Les donnes sont transmises par ordre de robustesse dcroissante pour permettre au
SS de recevoir leurs donnes, avant que ne se prsente un profile de burst qui
causera la perte de synchronisation entre la SS et le lien descendant.
Dans les systmes FDD, la portion de code TDM doit tre suivie par un segment
TDMA qui inclut un prambule supplmentaire au dbut de chaque nouveau profil de
burst. Cette fonctionnalit permet un meilleur support du half-duplex par les SS. Si
l'mission se fait en half-duplex avec les SS, la synchronisation entre la SS et le lien
Illustration 2 - Structure de la sous-trame de lien descendant
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 13 sur 37
descendant risque d'tre perdu. Le prambule TDMA permet de racqurir la
synchronisation.
En raison des demandes de bande passante dynamique - de nombreux services
pouvant tre actifs - le mlange et la dure des profils de burst ainsi que la prsence
ou l'absence de la portion TDMA varient dynamiquement d'une trame l'autre.
Puisque le SS destinataire peut tre implicitement indiqu dans l'en-tte MAC plutt
que dans la DL-MAP , les SS coutent toutes les portions de la sous-trame de lien
descendant qu'ils sont capables de recevoir. Pour les SS fonctionnant en full-duplex,
cela signifie recevoir tous les profils de burst d'une robustesse gale ou suprieure
celle qu'ils avaient ngocis avec le BS.
Une sous-trame de lien montant typique de la couche Physique, dans la bande des
10-66 Ghz est montre ci-dessous :
Contrairement au lien descendant, la carte UL-MAP garantit une bande passante
chaque SS. Les SS transmettent leurs donnes via l'allocation qui leur a t
assigne, en utilisant le profil de burst spcifi par le UUC (Uplink nterval Usage
Code) spcifi dans l'entre de la UL-MAP . Cette entre indique la bande
passante garantit pour cette SS.
La sous-trame de lien montant contient aussi un message de contention pour l'accs
initial au systme et pour les requtes de bande passante transmises en multicast et
broadcast. Pour l'accs au systme, les opportunits d'accs sont choisies de
manire accorder un temps supplmentaire pour les SS qui n'ont pas rsolut assez
tt le transmit time advance (en fait, qui n'ont pas envoy en avance leurs trames)
afin de pallier au dcalage temporel de la transmission avec le BS.
Entre les couches physique et MAC existent une sous-couche de convergence de
transmission : TC (Transmission Convergence). Cette couche permet de transformer
Illustration 3 - Structure de sous-trame de lien montant
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 14 sur 37
des PDU MAC (Protocol Data Unit) de longueur variable en un bloc FEC de taille fixe
(avec potentiellement un court bloc la fin) pour chaque burst. La couche TC a un
PDU conu pour convenir aux blocs FEC ayant dj t remplit. l dmarre avec un
pointeur indiquant o est le prochain en-tte MAC PDU n'ayant pas de bloc FEC. Le
schma ci-dessous explique le fonctionnement de ce mcanisme :
Le format des PDU de convergence de transmission (TC) permet de re-synchroniser
avec le prochain PDU dans le cas o une erreur irrcuprable surviendrait sur le bloc
FEC (correction d'erreur) prcdent. Sans la couche de TC, lorsqu'une BS ou une SS
recevrait un burst, le contenu entier pourrait tre perdu si une erreur irrcuprable
survenait sur un bit.
DtaiIs de Ia couche MAC
La couche MAC est spare en trois sous-couches :
La couche MAC inclus un service spcifique de convergence (Service-Specific
Convergence) des couches suprieures du modle OS avec les sous-couches
MAC (Cf. llustration 1) ;
En dessous se trouve une sous-couche formant le noyau de la couche MAC,
nomme couche commune , qui contient les fonctions cls de la couche MAC ;
Enfin, il existe une sous-couche nomme sous-couche de protection (privacy
sublayer).
Service-Specific Convergence SubIayers
Le standard EE 802.16 dfinis deux service spcifique de convergence de sous-
couche pour faire la correspondance des services partir et depuis les connexions
MAC. Les deux services de convergence sont :
La sous-couche de convergence ATM qui est dfinies pour les services ATM ;
La sous-couche de convergence de paquets qui est dfinies pour faire la
correspondance des services par paquets tels que pv4, pv6, Ethernet ou les
VLAN (Virtual LAN).
La premire tche de cette sous-couche est de transmettre les SDU (Service Data
Unit) la bonne connexion MAC, de prserver ou d'activer la QoS (Quality of Service),
et d'activer l'allocation de bande passante. L'opration de correspondance prend des
formes diffrentes suivant le type de service. En plus de ces fonctions basiques, cette
sous-couche de convergence peut aussi mettre en oeuvre des fonctions plus
Illustration 4 - Format d'un PDU de TC
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 15 sur 37
sophistiques tel que l'amlioration de la charge utile via la suppression des en-ttes
puis leurs reconstructions, pour amliorer l'efficacit du lien hertzien.
Common Part SubIayer
Introduction et architecture gnrale
En gnral, l'architecture MAC du 802.16 est conue pour supporter une architecture
point-multipoint avec un BS central grant simultanment de multiples secteurs
indpendants. Sur le lien descendant, les donnes vers les SS sont multiplexe en
TDMA.
La couche MAC 802.16 est oriente connexion. Tous les services, ce qui inclus les
services non connects, sont associs une connexion. Ce mcanisme de connexion
nous permet de fournir un mcanisme de demande de bande passante, d'associer la
QoS et les paramtres de trafic, de transporter et router les donnes la sous-couche
de convergence approprie, et enfin, d'effectuer toute autre action dfinie dans le
contrat entre l'oprateur et le client. Les connexions sont rfrences par un identifiant
de connexion sur 16 bits (CD), et peuvent demands continuellement la mme bande
passante garantie, ou bien vouloir de la bande passante la demande (adaptation de
la bande passante au trafic). Les deux mthodes sont possibles.
Chaque SS une adresse MAC standard sur 48 bits, mais cette adresse MAC est
surtout utilise comme un identifiant d'quipement, puisque l'adresse principalement
utilise durant les oprations sont les CD(identifiant de connexion). A l'entre sur le
rseau, il est assign au SS trois connexions de management dans chaque sens de
communication.
Ces trois connexions refltent les trois niveaux de QoS utiliss par les diffrents
niveaux de management.
La premire des trois connexion est la connexion basique, qui est utilise pour le
transfert de court message de contrle, tels que :
Message la couche MAC de criticit du temps ;
Message de contrle du lien radio (RLC Radio Link Control).
La premire connexion de management est utilise pour transfrer pendant un
temps plus long, des messages plus tolrant sur les dlais tel que ceux utilis pour
l'authentification ou configurer la connexion.
La seconde connexion de management est utilise pour le transfert de messages
de management bass sur des standards, tels que :
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ;
TFTP (Trivial File Transfer Protocol) ;
SNMP (Simple Network Management Protocol).
En plus de ces connexions de management, des connexions sont alloues sur le SS
pour les services souscrits au contrat. Les connexions de transport sont
unidirectionnelles, pour faciliter la QoS et les paramtres du trafic, aussi bien en lien
montant qu'en lien descendant. Typiquement, les connexions sont assignes aux
services par paires.
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 16 sur 37
La couche MAC rserve des connexions additionnelles pour d'autres tches. Ainsi,
une connexion est rserve pour l'accs la contention (mcanisme d'vitement
d'engorgement). Une autre connexion est rserve pour la transmission en diffusion
(broadcast) sur le lien descendant (donc du BS vers le SS) aussi bien que pour
signaler le besoin de bande passante des SS via l'mission de broadcast de
contention d'un futur engorgement, si le besoin n'est pas satisfait. D'autres connexions
enfin sont rserves au multicast. l doit tre demand aux SS de s'abonner un
groupe multicast, en utilisant les connexions multicast ddies.
Format des PDU
Le MAC PDU est l'unit charge d'changer des donnes entre les couches MAC du
BS et de ses SS. Un PDU consiste en un en-tte MAC de taille fixe, avec une charge
utile de taille variable, et un CRC optionnel. (Cyclic Redundancy Code). Deux formats
d'en-tte existent, distinguer par le champ HT :
L'en-tte gnrique, dfinit ci-aprs :
L'en-tte de demande de bande passante.
Except pour la demande de bande passante par un PDU - qui ne contient alors pas
de charge utile les PDU contiennent aussi bien les messages de management MAC
que les donnes de convergence des sous-couches. Nous allons voir les en-ttes des
donnes de convergence des sous-couches.
Trois types de sous-en-tte doivent tre prsent :
Le sous-en-tte de management des droits est utilis par un SS pour transporter la
demande de bande passante voulue auprs de son BS ;
Le sous-en-tte de fragmentation contient des informations qui indique la prsence
et l'organisation de chacun des fragments des SDU (les SDU tant alors la donne
utile) ;
Le sous-en-tte de regroupement est utilis pour signaler qu'il contient un
regroupement de nombreux SDU dans un unique PDU.
Les sous-en-ttes de management et de fragmentation doivent tre insrs dans un
MAC PDU qui doit tre juste aprs l'en-tte gnrique si le champ Type l'exige. Le
Illustration 5 - Format d'un en-tte PDU gnrique
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 17 sur 37
sous-en-tte de regroupement doit tre insr avant chaque MAC SDU si le champ
Type l'indique.
Transmission des PDU
La couche MAC du 802.16 supporte de nombreux protocoles de plus haut niveau, tel
que ATM ou P. Les sous-trames de convergence correspondants aux SDU entrants
sont formates en accord avec les trames PDU - une fragmentation ou une
encapsulation tant - possible, avant d'tre envoy vers une ou plusieurs connexions,
en accord avec le protocole MAC. Aprs avoir travers le lien hertzien, les SDU
originaux sont reconstruits partir des PDU reus, ce qui fait que les modifications de
formats ralis par le protocole de la couche MAC sont transparentes pour l'entit
rceptrice.
Le 802.16 prend donc les avantages d'incorporer la fois des processus d'agrgation
de donnes et de fragmentation. De plus, le processus d'allocation de bande passante
permet de maximiser l'efficacit des deux processus prcdent. La fragmentation est
le processus par lequel les SDU sont diviss en un ou plusieurs fragments SDU.
L'agrgation est le processus par lequel de nombreux SDU sont regroups dans une
unique trame PDU. Les deux processus peuvent tre initis ou par une BS pour une
connexion de lien descendant ou par une SS pour une connexion de lien montant.
Le 802.16 permet d'utiliser simultanment la fragmentation et l'agrgation pour une
utilisation optimale de la bande passante.
Le support physique et la structure de trame
La couche MAC 802.16 supporte la fois le TDD et le FDD. En FDD, une liaison
descendante continue ou par burst est supporte. Un lien descendant utilisant un flux
continu permet l'usage de certaines techniques d'amlioration de la robustesse, tel
que l'entrelacement de trames. Un lien descendant fonctionnant par burst (aussi bien
en FDD qu'en TDD) permet l'utilisation de meilleures techniques d'amlioration de la
robustesse et des capacits, tel que le profil de burst adaptatif correspondant au
niveau de l'abonn ou l'utilisation d'antenne plus volue.
La couche MAC construit la sous-trame de lien descendant en commenant avec une
trame de contrle de section contenant les messages DL-MAP et UL-MAP .
Ceux-ci indiquent les transitions de la couche physique du lien descendant aussi bien
que les allocations de bande passante. ls indiquent aussi les profils de burst du lien
montant.
Le message DL-MAP s'applique toujours la trame en cours et est au moins de la
longueur de deux blocs FEC. La premire transition physique est dfini dans le
premier bloc FEC, ceci afin de permettre un traitement adquat du temps. A la fois
dans les systmes TDD et FDD, le message UL-MAP fourni l'allocation temporelle
qui permettra d'envoyer des donnes la prochaine trame descendante. l peut aussi
commencer utiliser son allocation temporelle, tout en tenant compte du temps de
traitement et du dlai d'aller-retour. Le temps minimum entre la rception et
l'application du message UL-MAP dans un systme FDD est vu figure suivante :
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 18 sur 37
Contrle du lien radio
La technologie de la couche physique 802.16 demande galement un contrle avanc
du lien radio (RLC), particulirement pour dtecter les changements de la couche
physique d'un profil de burst un autre. Le RLC doit vrifier ce changement ventuel,
en plus des tches habituellement dvolues, telles que contrle d'nergie et porte
des ondes.
Le RLC entre en oeuvre lorsque la BS commence mettre priodiquement en
broadcast le profil du burst choisi pour le lien montant et le lien descendant. Le profil
de burst qui sera utilis sur un canal est dtermin en fonction de nombreux facteurs :
La pluie dans la rgion ;
Les capacits de l'quipement.
Chacun des profil de burst pour le lien descendant est marqu avec un DUC
(Downlink nterval Usage Code code utilis pour l'intervalle entre les burst du lien
descendant). Ceux du lien montant sont marqus avec un UUC (Uplink nterval
Usage Code code utilis pour l'intervalle entre les burst du lien montant). Voir
l'illustration 3 pour voir l'utilisation du UUC dans la trame.
Initialisation et ngociation des possibilits de la SS
Jusqu'au moment o elle aura appris quels paramtres utiliser pour les premires
transmissions, la SS va regarder les paramtres d'initialisation potentiels en scannant
les messages UL-MAP prsents dans chaque trame. La SS utilise un algorithme
de repliement exponentiel tronqu pour dterminer quel intervalle de temps initial
utiliser afin d'envoyer une requte. La SS va envoyer un burst de connexion en
utilisant un minimum d'nergie. Puis elle va augmenter graduellement la puissance de
transmission jusqu' recevoir enfin un message d'initialisation.
Illustration 6 Minimum FDD map relevance
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 19 sur 37
Lorsque la BS reoit ce message d'initialisation, elle renvoie un message rponse
d'initialisation la SS, en lui indiquant l'avance temporelle utiliser ainsi que la
puissance d'mission ncessaire. Pour dterminer ces valeurs, la BS se base sur le
temps d'arrive (calcul du delta t entre mission et rception) et la puissance mesure
du signal reu. Cette rponse fournie aussi la SS les CD (les identifiants de
connexions) de management basique et primaire. Une fois que l'avance temporelle
pour la transmission du SS a t correctement calcule, la procdure d'initialisation
d'ajustement de la puissance d'mission peut tre ralis plus finement, en utilisant
les canaux de transmissions annexe.
A partir de ce point, toutes les transmissions sont effectues en utilisant le profil de
burst le plus robuste et le plus efficace. Pour viter de perdre de la capacit par la
suite, la SS rapporte sa BS ses capacits physiques, incluant la modulation et le
schma de codage support, si le systme fonctionne en FDD, et si elle fonctionne en
half ou full duplex. La BS, dans sa rponse, peut refuser l'utilisation de n'importe
laquelle des possibilits rapportes par la SS.
Authentification et Enregistrement de la SS
Chaque SS contient un certificat digital X.509 install par le fabricant la sortie
d'usine, et un certificat du fabricant. Ces certificats - qui tablissent un lien entre
l'adresse MAC sur 48 bits de la SS et la cl publique RSA sont envoys la BS par
la SS dans les requtes d'autorisation (Authorization Request) et d'authentification. Le
rseau est ainsi capable de vrifier l'identit des SS en regardant les certificats. La BS
peut donc dterminer le niveau d'autorisation de la SS. Si la SS est autorise se
joindre au rseau, la BS va alors rpondre cette requte avec une demande
d'autorisation (Authorization Reply) contenant un cl d'autorisation crypte (AK
Authorization Key). Cette AK est ralise partir de la cl publique de la SS et sera
utilise pour scuriser d'autres transactions.
Une fois l'autorisation effectue avec succs, la SS va s'enregistrer auprs du rseau.
Cela va alors tablir une seconde connexion de management avec la SS afin de
dterminer les oprations MAC faisable ainsi que l'installation de connexions. La
version du protocole P utilis sur cette seconde connexion de management est aussi
dtermin pendant l'enregistrement.
Connectivit IP
Aprs s'tre enregistr, la SS rcupre une adresse P via DHCP et tablie l'heure
courante et la date via le protocole nternet de temps (nternet Time Protocol). Le
serveur DHCP fournit aussi la SS l'adresse d'un serveur TFTP auprs duquel la
station peut rcuprer un fichier de configuration. Ce fichier fourni une interface
standard pour accder aux informations de configuration spcifique au constructeur.
Configuration des connexions
Le 802.16 utilise le concept des flux de service pour dfinir le transport unidirectionnel
des paquets, que ce soit en trafic montant ou descendant. Les flux de service sont
caractriss par un jeu de paramtre QoS tels que le temps de latence et de
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 20 sur 37
dcalage. Afin d'utiliser de la manire la plus efficace la bande passante et la
mmoire, 802.16 a adopt un modle d'activation en deux phases. Une ressource est
tout d'abord assigne un flux de service autoris particulier, mais ne sera finalement
envoye que lorsque le flux de service aura t activ. Chaque service admis ou
activ sera affect une connexion MAC avec un CD unique.
En gnral, les flux de services en 802.16 sont prdfinis. La configuration des flux de
service est ralise par la BS pendant l'initialisation de la SS. Cependant, les flux de
service peuvent tre tablis dynamiquement par la BS ou la SS. La SS n'initie un flux
de service que dans le cas ou un signal de connexion dynamique lui est transmis
dynamiquement, comme par exemple une connexion virtuelle provenant d'un rseau
ATM (SVC Switched Virtual Connection).
L'tablissement d'un flux de service est ralis par un mcanisme d'acquittement en
trois parties :
Requte pour l'tablissement d'un nouveau flux de service ;
Rponse pour l'tablissement du nouveau flux de service ;
Acquittement de la rponse.
En plus de l'tablissement dynamique des services, le 802.16 supporte aussi la
rengociation dynamique des flux de service. Comme pour les flux d'tablissement de
service dynamique, les rengociations se font par le biais d'un mcanisme
d'acquittement en trois parties.
La sous-couche de protection des donnes (privacy subIayer)
Le protocole de protection des donnes 802.16 est bas sur le protocole Privacy
Key Management (PKM) provenant des spcifications du DOCSS BP+. Le
protocole PKM a t enrichit pour convenir la couche MAC 802.16 et pour prendre
en compte les mthodes de cryptage les plus rcentes et les plus puissantes, tel que
l'AES (Advanced Encryption Standard).
Security Associations
PKM est construit autour du concept d'associations de scurit (SA Security
Associations). Le SA est un ensemble de mthode de cryptage et ses cls matrielles
associes (Cf Authentification et Enregistrement de la SS), permettant de contenir les
informations concernant les algorithme de cryptage utiliser, quelle cl utiliser...
Fonctionnement :
Chaque SS tablit au moins une SA pendant l'initialisation. Chaque connexion
l'exception de la connexion de management basique et primaire est affect une
SA, aussi bien au moment de la connexion que dynamiquement pendant une
opration.
Mthode de cryptographie
Actuellement le protocole PKM utilise des certificats digitaux associs un cryptage
RSA par cl publique pour les changes de cls lors de l'authentification et
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 21 sur 37
autorisation des SS. Pour crypter le trafic, on utilise le DES (Data Encryption
Standard) qui utilise une cl de 56 bits.
Les messages du protocole PKM sont eux-mmes authentifis par le protocole HMAC
(Hashed Message Authentication Code) avec en plus SHA-1.
Pour conclure, les messages des fonctions MAC vitales comme l'initialisation de
connexions sont authentifie par le protocole PKM.
ConcIusion
Le 802.16 a t dvelopp pour offrir un accs large bande sans fil dans de nombreux
cas de figure. Le standard certifie une inter-oprabilite des quipements, mais en
laissant une certaine marge aux diffrents constructeurs. Ainsi, les standards sont
crits, mais l'implantation de certains algorithmes est laisse la discrtion des
constructeurs. Ainsi, les performances peuvent diffrer d'un quipement l'autre. Par
exemple, le profil de burst adaptable permet un contrle trs fin du trafic, et permet de
gagner ou non en performance. Les constructeurs intelligents sauront optimiser cet
algorithme afin d'amliorer leur matriel.
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 22 sur 37
2. La norme 802.16a/b
Une dcision importante a t prise au cours d'une runion de normalisation : le mode
A (transmission en mode continu) a t supprim, seul subsiste le mode B de
transmission par bursts. Elle a t prise afin de simplifier le standard et de le rendre
plus cohrent. En effet, pour 802.16, la dfinition de l'interoprabilit est large,
l'implmentation d'un seul mode parmi ceux qui sont standardiss est suffisante. Deux
quipements respectant le standard n'implmentent donc pas ncessairement le
mme mode, ce qui pose des problmes d'interoprabilit, mais simplifie les
dveloppements.
a) Groupe 802.16a
La projet EE 802.16a utilise la bande des 2 11 Ghz. La conception de la couche
physique des 2 11 Ghz a t guide par le besoin d'une utilisation avec des
obstacles potentiels sur le chemin des ondes radios (en anglais : NLOS Non Line Of
Sight). En prvision d'une application rsidentielle du 802.16a, il a t envisag que
les toits de maisons seraient trop bas pour avoir une vue dgage vers l'antenne de la
BS, notamment cause d'arbres. Donc, il a fallu prvoir la possibilit d'une
propagation par de multiples chemins. En outre, le montage d'antenne extrieur est
coteux en raison des cots du matriel et de l'installation.
Les spcifications du draft 3 pour le 802.16a pour l'interface radio sont :
WirelessMAN-OFDM : utilise le mutliplexage orthogonal par division de frquence
avec 256 points. L'accs se fait l'aide de TDMA. Cette interface radio est
candidate pour les bandes sans licences ncessaires.
WirelessMAN-OFDMA : utilise les frquences orthogonales avec multiples
divisions frquentielles avec 2048 points. Dans ce systme, les accs multiples
sont fournis en adressant un sous-ensemble des porteuses multiples des
rcepteurs individuels.
En raison des contraintes de propagations, l'utilisation de systme d'antennes
avances sera support.
Deux formes d'ondes sont retenues: OFDM et mono-porteuse. La forme d'onde
OFDM comporte elle-mme 2 modes, OFDM (256 porteuses) TDMA, et OFDMA
(2048 porteuses).
Les points communs entre ces formes d'onde sont :
Un traitement par bloc avec utilisation de la FFT pour galisation dans le domaine
frquentiel ;
nsertion d'intervalles de garde : 1/8 du temps symbole ;
Prambules ;
Modulation adaptative 4/16/64 QAM ;
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 23 sur 37
Codage concatn CV(7,1/2) RS, mais les options choisies diffrent un peu pour
l'instant ;
Turbo codes en bloc: codes produits, avec pour codes constituants des codes de
Hamming et codes de Hamming tendus ;
Codage correcteur classique RS+Conv, ou optionnellement TPC ;
Codage espace temps Alamouti optionnel ;
Antennes adaptatives, formation de faisceaux adaptative, en option.
Les spcificits d'OFDM/OFDMA sont :
Nombre de porteuses variable, taille de l'intervalle de garde (prfixe cyclique)
variable ;
Pour les FFT de taille 64 512: OFDM inspir de EEE802.11a ;
Pour les FFT de taille 512 2048: OFDMA inspir de DVB-T et DVB-RCT.
Les spcificits de la mono-porteuse (Single Carrier) sont :
Egalisation dans le domaine frquentiel (FDE), par FFT. Schma en bloc avec
intervalle de garde modul par une squence unique (plus ou moins rpte) ;
Possibilit de filtre de retour pour l'galisation (DFE).
b) Groupe 802.16b
La motivation du march de l'industrie est plus faible que pour le 802.16a, mais le
march vis est exclusivement nord-amricain.
Ce groupe a pris comme base EEE802.11a/Hiperlan2 pour la couche physique, qui
est une forme d'onde OFDM. L'OFDMA est en option. Les turbo codes convolutifs et
les turbo codes produits sont en option, avec une certaine rivalit entre leurs
promoteurs respectifs. Le document de base pour le travail a t accept. l servira de
base la rdaction du document commun avec 802.16a.
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 24 sur 37
I IV V. . P PE ER RS SP PE EC CT TI IV VE ES S P PO OU UR R 8 80 02 2. .1 16 6
Grce l'explosion de l'ADSL, le haut-dbit est devenu une ralit pour un nombre
croissant d'internautes franais. Pourtant si ce dispositif semble rgner en matre sur
les connexions la BLR avec les normes 802.11 et 802.16 pourrait trs vite s'octroyer
une place de choix au sein de l'internet large bande.
1. 802.16 : un concept Iarge bande
a) La technologie du large bande
On associe souvent le large bande un dbit ou un ensemble de services donns,
mais, en ralit, l'expression "large bande" correspond un concept volutif. Les
dbits d'accs l'nternet augmentent rgulirement. On ne peut donc parler vraiment
que de l'tat "actuel" du large bande, et procder des extrapolations thoriques sur
la base de l'volution prvue ou observe, que l'avenir pourra confirmer ou infirmer.
On dsigne gnralement par "large bande" des connexions nternet rcentes
sensiblement plus rapides que les techniques de commutation actuelles, mais le
terme ne correspond pas un dbit ou un service prcis. La Recommandation .113
du Secteur de la normalisation de l'UT(Union nternationale des Tlcommunications)
dfinit le large bande comme une capacit de transmission suprieure au dbit
primaire du RNS, 1,5 ou 2,0 Mbit/s.
La norme 802.16 autorisant des dbits pouvant aller jusqu' 75 Mbits/s est donc bien
une connexion large bande.
Le principal intrt du large bande rside dans la multiplication des possibilits qu'il
offre aussi bien pour les applications que pour les services. La disponibilit du large
bande dpend essentiellement des rseaux en place, qui eux-mmes sont de type
variable, en fonction des infrastructures hrites.
Les pays dvelopps et les zones urbaines disposent dj de systmes filaires
paires torsades ou cbles coaxiaux. Dans les pays en dveloppement et les zones
rurales, d'autres technologies plus rcentes, reposant sur les systmes hertziens, tels
que le WiMax, seront parfois plus pratiques et plus conomiques.
Les connexions filaires reprsentent la grande majorit (plus de 98%) des connexions
actuellement disponibles, mais les technologies hertziennes (WiFi) progressent
rapidement grce notamment un prix attractif et une mise en ouvre relativement
simple.
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 25 sur 37
En ce qui concerne les connexions fixes, les lignes d'abonn numriques (DSL) et les
cblomodems sont les plus populaires .Jusqu'en 2000, la majorit des utilisateurs du
large bande utilisaient des cblomodems, qui sont encore la forme d'accs la plus
populaire en Amrique du Nord. Mais, dans le monde, les lignes ADSL reprsentent
dsormais plus de la moiti des connexions (et sont particulirement populaires en
Asie et en Europe de l'Ouest).
Lorsque les connexions filaires fixes ne sont pas largement disponibles ou ne sont
gure pratiques utiliser, on observe la popularit croissante d'un certain nombre de
technologies hertziennes, telles que le Wi-Fi.
b) La mise en place du large bande
Le large bande apparat de plus en plus comme un vritable agent catalyseur du
succs conomique dans l'conomie de l'information. De plus en plus, le succs aux
communauts qui ne seraient pas les premires desservies si l'on s'en remettait
simplement au jeu des forces du march.
Un grand nombre d'entreprises diffrentes sont prsentes sur le march du large
bande, mais, dans la majorit des Etats Membres de l'UT, le fournisseur en position
dominante est en fait l'oprateur de systmes fixes tabli, mme s'il n'est pas le
premier agent chronologiquement.
En France, seuls deux entreprises sont prsente sur le march du large bande
hertzien : Altitude Tlcom et 9 Telecom Entreprise.
A la fin 2002, 82 sur 200 pays du monde offraient dj des services large bande
commercialiss. Depuis 2000, le nombre des utilisateurs du large bande dans le
monde s'est accru de 500%, le total dpasse aujourd'hui 60 millions (figure 1).
Comme on peut s'y attendre, les taux de pntration sont troitement corrls avec le
produit national brut (PNB) par habitant, encore que la Core fasse manifestement
exception cette tendance.
Alors que le large bande arrive sur le march dans une priode de convergence et
d'volution technique, les modles d'offre peuvent varier considrablement. Certains
utilisateurs finals tablissent eux-mmes leurs connexions par fibres optiques avec
leurs fournisseurs de services nternet. En gnral, ces initiatives ont pour objet
d'viter les cots levs associs aux services volus grand dbit proposs par les
fournisseurs de large bande tablis. La norme 802.16 avec des prix comptitifs se
positionne ainsi en concurrent des offres large bande dj existantes.
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 26 sur 37
c) Evolution de la large bande
figure 1
d) pntration de la technologie hertzienne au sein du large bande
figure 2
Le large bande est l'avenir de l'nternet. Or d'aprs ce schma nous voyons que les
technologies hertziennes (autres) prennent de plus en plus d'importance au sein du
large bande, ce qui semble prometteur.
Mais la norme 802.16 n'est pas la seule sur le march. La principale norme
aujourd'hui utilise est la norme 802.11 aussi appele WiFi.
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 27 sur 37
En France, l'Ethernet sans fil entame la conqute de la boucle locale. L'oprateur
rouennais Altitude Telecom annonce cent cinquante entreprises raccordes par cette
technologie.
Les limites de dbit et de distance sont repousses. Dj, le 802.11b, en l'tat, est
utilisable en tlcoms. Par exemple, l'intgrateur ADW network (Lyon) vient
d'interconnecter, en ville, les btiments de la mairie du Puy-en-Velay (43) avec des
ponts Proxim 11 Mbit/s sur 300 m.
802.16 fournit des liens de 5 km avec ligne de vue, dans la bande des 10 66 GHz.
La largeur des canaux retenue pour l'Europe (28 MHz) autorise un dbit de 132
Mbit/s.
Comparons alors la BLR avec les autres offres du march.
2. Comparaison BLR / autres offres hauts dbits
a) Comparatif technologique du dbit
BLR ADSL CbIe
Dbits ascendants De 128 Kbits/s
130 Mbits/s
De 16 Kbits/s
640 Kbits/s
De 128 /s
Dbits descendants De 128 Kbits/s
130 Mbits/s
De 1,5 Kbits/s
9 Mbits/s
De 512 Kbits/s
figure 3
Dbit ascendants : du provider vers l'abonn.
Dbits descendants : de l'abonn vers le prestataire.
D'aprs la figure 3 nous voyons bien que la BLR offre un dbit plus intressant que le
cble ou l'ADSL que se soit dans le sens ascendant ou dans le sens descendant..
l parat donc plus avantageux de choisir la BLR.
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 28 sur 37
figure 4
Sur cette image nous observons que seul la fibre optique propose des dbits aussi
levs que ceux de la BLR mais les technologies proposes ne sont pas les mmes
et installer un rseau de fibre optique ncessite des investissements plus importants
que pour la BLR.
Ainsi si le rseau de fibre optique n'existe pas il semble plus intressant d'opter pour
la BLR.
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 29 sur 37
b) Tableau rcapitulatif des offres haut dbit
figure 5
Ce tableau nous montre que seul la norme 802.11 offre des dbits similaires ceux
de la norme 802.16.
Etudions donc les caractristiques de ces deux normes pour pouvoir les comparer.
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 30 sur 37
3. Comparaison 802.16 / 802.11
figure 6
PAN :Personal Area Network concerne les rseaux sans fils d'une faible porte : de l'ordre de
quelques dizaines mtres
LAN :Local Area Network est un rseau permettant de couvrir l'quivalent d'un rseau local
d'entreprise, soit une porte d'environ une centaine de mtres.
MAN :Metropolitan Area Network concerne les rseaux d'une porte de l'ordre de quelques
kilomtres.
WAN : Wireless Wide Area Network concerne les rseaux d'une porte de l'ordre de quelques
dizaines de kilomtres.
Cette image montre que les normes 802.11 et 802.16 n'ont pas t prvues pour les
mmes usages.
Nous allons donc nous pencher sur leurs diffrences.
802.11 802.16a
Scurit : WPA + WEP Triple-DES (128-bit) and RSA
(1024-bit)
Optimis pour l'intrieur environ 100
mtres.
Optimis pour l'extrieur plus de 50
kilomtres..
ne garantit pas la transmission de la
parole et de la vido.
crit pour supporter la voie et la vido
QoS propose si la priorit est active. QoS tout le temps.
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 31 sur 37
figure 7
Les deux tableaux prcdents nous montrent bien que les normes 802.16 et 802.11
n'ont pas t prvues pour les mmes usages bien que par extension la norme
802.11 essaye d'avoir des dbits plus importants sur de plus longues distances.
Comparons les frquences de ces deux normes :
figure 8
WiMax
WiFi
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 32 sur 37
Nous voyons que les frquences ne se superposent pas.
D'aprs ces informations ces deux normes se compltent et cela peut se modliser de
la manire suivante :
figure 9
Cette image dmontre qu'il n'y a pas priori de concurrence directe entre les normes
802.11 et 802.16 mais qu'elles sont complmentaires.
Nous allons donc essayer d'tudier les prvisions de dveloppement de la norme
802.16.
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 33 sur 37
4. Prvisions de dveIoppement
a) De nombreux projets
L'amendement 802.16a, publi en janvier 2003, tend le standard la bande des 2
11 GHz. Si le dbit est moins important, les distances sont suprieures, et on
s'affranchit de la ligne de vue. Ce qui convient en zone rsidentielle et pour les PME.
En France Altitude Telecom a retenu ce type de solution avec l'offre prstandard de
Wi-LAN.
Les acteurs du 802.16a multiplient les annonces. ntel y travaille avec Alvarion et
Aperto. Redline Communications a prsent son commutateur AN-100 ; et Wavesat
Wireless, son Asic. Airspan Networks lance ses quipements AS4030 et AS3030.
L'AS4030 dlivre, au choix, un dbit de 45 Mbit/s, quatre lignes E1, ou une
combinaison de services P et E1 en point multipoint 3,5 et 5,8 GHz. l fonctionne,
avec ou sans ligne de vue, en OFDM [1] sur 50 km. L'AS3030 est la version point
point de l'AS4030.
Paralllement, un autre ajout, le 802.16e, qui acceptera les terminaux mobiles, devrait
tre valid l't 2004. Mais, mme s'il va permettre des dplacements 100 km/h,
cette norme prendra surtout en charge la mobilit rduite ou le maintien des sessions
entre les bornes. Nortel Networks a dfini un prototype 20 Mbit/s qui utilise une
interface arienne OFDM et la technologie Mimo (Multiple input multiple output). Celle-
ci multiplie les performances de systmes OFDM, qu'il s'agisse de rseaux locaux ou
tendus, en employant plusieurs antennes au niveau de l'metteur et du rcepteur.
b) La puce Wimax d'ntel
ntel va lancer au deuxime semestre 2004 une puce appele WiMax qui sera
destine au rseau sans fil, elle sera base sur le standard 802.16a. Cette puce va
permettre d'atteindre des dbits de 70 Mbits/s sur une distance de 50 Km. Le WiMAX
(Worldwide nteroperability for Microwave Access), association d'acteurs des
tlcommunications et de l'informatique, mettant en avant les standards 802.16 et le
802.20 pourrait connatre un succs important selon le cabinet d'tude AB. D'aprs le
rapport nomm "WiMAX / 802.16 and 802.20 New Standards Revitalizing Broadband
Wireless Access", les quipements compatibles avec ces standards reprsenteraient
un march en 2008 de 1,5 milliards de dollars. La majorit de ces quipements
n'apparaitront sur le march qu'en 2006. Ces deux standards de rseaux sans fils
sont les volutions des standards 802.11 baptis WiFi. ls bnficient des bons
auspices de Nokia et d'ntel qui souhaitent mettre en avant ce standard.
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 34 sur 37
Les deux figures suivantes proviennent de l'TU et tablissent les prvisions de
dveloppement de la norme 802.16.
figure 10
figure 11
Le rseau sans fil fait de plus en plus parler de lui, avec les dbits annoncs on
pourrait penser que dans un avenir proche seule l'alimentation lectrique ncessitera
une liaison physique.
Ainsi la norme 802.16 semble avoir de beaux jours devant elle.
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 35 sur 37
V V. . C CO ON NC CL LU US SI IO ON N
La norme 802.16 s'appuie sur la boucle locale radio. L'ART s'efforce de dvelopper
cette technologie qui permet de concurrencer les offres dj existantes, notamment
dans les zones peu desservies, ou celle pour lesquelles lutter contre France Telecom
-pour le dgroupage est difficile.
Le 802.16 a vu son attrait relanc par le dveloppement de la norme 802.16a d la
cration du forum WiMAX, dont ntel est un des moteurs principaux.
En comparant les diffrentes offres par rapport au 802.16 et au 802.16a, nous avons
constat la forte comptitivit de cette norme.
Avec la finalisation de la norme 802.16e, qui permettra la mobilit pdestre des
terminaux, l'avenir du Wireless MAN 802.16 parat prometteur.
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 36 sur 37
V VI I. . W WE EB BO OG GR RA AP PH HI IE E
Site officiel de l'EEE permettant l'accs aux documents de normalisation :
http://standards.ieee.org/getieee802/
Compte rendu de runion de normalisation 802.16 :
http://www.sacet.com/articles/CR_ORLANDO.pdf
Groupe de travail suivi 802.16a :
http://www.sacet.com/articles/CR_Hilton_Head.pdf
Forum WiMAX :
http://www.wimaxforum.org/home
La Boucle Locale Radio en 7 questions :
http://solutions.journaldunet.com/0111/011102_faqblr.shtml
Les utilisations de la BLR :
http://www.telecom.gouv.fr/telecom/reg_blr3.htm
La BLR en France :
http://www.art-telecom.fr/dossiers/blr/som_blr.htm
Critiques sur la BLR :
http://www.monde-solidaire.org/article.php3?id_article=39
Consultation publique sur la BLR :
http://www.art-telecom.fr/publications/blr/blrsom.htm
Quelques chiffres intressants :
http://www.zdnet.fr/techupdate/reseaux_telecoms/0,39020969,2094247,00.htm
Dossier NT Rseaux Ingnieurs2000
Page 37 sur 37
V VI II I. . G GL LO OS SS SA AI IR RE E
Burst : envoi rapide d'un flot de trame fini.
BS : Base Station, est la station de base, savoir l'emplacement de l'oprateur.
CID : Connection dentifier est l'identifiant d'une connexion sur la couche MAC, sur 16
bits.
DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol.
FDD : Frequency-Division-Duplexing.
QoS : Quality of Service.
PDU : Protocol Data Unit de la couche MAC.
RLC : Radio Data Control mcanisme de contrle du lien radio
SS : Subscriber Station, est la station cliente.
TDD : Time-Division-Duplexing.
TDM : Time Division Multiplex.
TDMA : Time-Division-Multiple-Access.
UIT : Union nternationale des Tlcommunications.
You might also like
- 5 中国联通LTE无线网络优化指导书 干扰优化指导手册Document36 pages5 中国联通LTE无线网络优化指导书 干扰优化指导手册gameOverNo ratings yet
- 单波400G长距离光传输技术白皮书 中兴通讯Document49 pages单波400G长距离光传输技术白皮书 中兴通讯ll1148733194No ratings yet
- T Rec G.984.2 200303 S!!PDF CDocument36 pagesT Rec G.984.2 200303 S!!PDF CpaigeNo ratings yet
- 5gnet 0814bDocument111 pages5gnet 0814b張敬昊No ratings yet
- 5G同步组网架构及关键技术白皮书(IMT2020推进组)Document18 pages5G同步组网架构及关键技术白皮书(IMT2020推进组)shwunwangNo ratings yet
- 基於opc Ua Tsn技術的工業通訊解決方案Document17 pages基於opc Ua Tsn技術的工業通訊解決方案YT LiuNo ratings yet
- 1012 - 1 TD-LTE eNodeB设备基础 (V2.0)Document44 pages1012 - 1 TD-LTE eNodeB设备基础 (V2.0)Chang JackNo ratings yet
- 计算机网络 (第五版) 习题答案 谢希仁Document83 pages计算机网络 (第五版) 习题答案 谢希仁黄灿安No ratings yet
- Taiwan Telecommunication MonthlyDocument5 pagesTaiwan Telecommunication MonthlyIan HsiehNo ratings yet
- CISSP培训 2电信及网络安全Document107 pagesCISSP培训 2电信及网络安全kotz123No ratings yet
- PCA82C250 CAN 收发器应用指南-周立功Document18 pagesPCA82C250 CAN 收发器应用指南-周立功Kaede MatsushmaNo ratings yet
- 【p】5g毫米波专用芯片、器件与工艺白皮书Document28 pages【p】5g毫米波专用芯片、器件与工艺白皮书张沛泽No ratings yet
- L2 考试试题Document45 pagesL2 考试试题vici archerNo ratings yet
- (中文) 现场总线与HART协议的关系及应用 PDFDocument2 pages(中文) 现场总线与HART协议的关系及应用 PDFvirgil guimanNo ratings yet
- HC-21 User's ManualDocument48 pagesHC-21 User's ManualOlavo JuniorNo ratings yet
- 模拟会话 202003Document64 pages模拟会话 202003Xin LinNo ratings yet
- 【l】毫米波应用场景、系统与标准白皮书终板Document58 pages【l】毫米波应用场景、系统与标准白皮书终板张沛泽No ratings yet
- GBT 51216-2017 移动通信基站工程节能技术标准Document50 pagesGBT 51216-2017 移动通信基站工程节能技术标准leo.qianfeng.jiaoNo ratings yet
- 3 7 LTE V2XC V2X技术报告 PDFDocument30 pages3 7 LTE V2XC V2X技术报告 PDF董庆庆No ratings yet
- 400G技术发展及应用部署考虑Document3 pages400G技术发展及应用部署考虑ll1148733194No ratings yet
- 2.6 Ghz狟腔5g Nr葡裔夔薯煦昴Document7 pages2.6 Ghz狟腔5g Nr葡裔夔薯煦昴mountainchNo ratings yet
- 第一章 TD-LTE概述Document10 pages第一章 TD-LTE概述grakiterNo ratings yet
- 第09章Document37 pages第09章张浩象No ratings yet
- 1 网络体系结构Document67 pages1 网络体系结构xiongjunhao2004No ratings yet
- 1 1诺基亚2G基站基础知识介绍1 (NOKIADocument71 pages1 1诺基亚2G基站基础知识介绍1 (NOKIAJinzhe WangNo ratings yet
- Key Technologies in Open Optical Transmission Systems CNDocument15 pagesKey Technologies in Open Optical Transmission Systems CNkentmultanNo ratings yet
- AIoT智能边缘计算网关技术规范Document21 pagesAIoT智能边缘计算网关技术规范liu yiNo ratings yet
- M900 SE - 用户手册 - v1.0Document27 pagesM900 SE - 用户手册 - v1.0nc252jbxkfNo ratings yet
- 【n】5g毫米波系统测量方法专用设备与测试规范 白皮书v1.0Document54 pages【n】5g毫米波系统测量方法专用设备与测试规范 白皮书v1.0张沛泽No ratings yet
- Signaling System No.7 - SS7Document40 pagesSignaling System No.7 - SS7Mofasser Ahmed (Tamal)100% (3)
- 【q】5g毫米波封装技术白皮书v10Document30 pages【q】5g毫米波封装技术白皮书v10张沛泽No ratings yet
- 国际海事卫星Document14 pages国际海事卫星Kehao ZhangNo ratings yet
- 第1章 现代互联网技术概述Document96 pages第1章 现代互联网技术概述flach062No ratings yet
- SCANET用户手册CN2016.07 1Document107 pagesSCANET用户手册CN2016.07 1Alvaro Jesus Ledo PelaezNo ratings yet
- can sc15 2编制说明Document7 pagescan sc15 2编制说明Chaos XiaNo ratings yet
- 中兴高达公司总体介绍Document61 pages中兴高达公司总体介绍kentmultanNo ratings yet
- Quectel 天线设计指导 V3.3Document29 pagesQuectel 天线设计指导 V3.3dong wangNo ratings yet
- 2020年重要產業技術 5G通訊Document14 pages2020年重要產業技術 5G通訊Angel ChiangNo ratings yet
- CAN Bus 现场总线基础方案 工具 周立功Document28 pagesCAN Bus 现场总线基础方案 工具 周立功Kaede MatsushmaNo ratings yet
- 低轨通信卫星Document29 pages低轨通信卫星kentmultanNo ratings yet
- SiTime CorpDocument18 pagesSiTime CorpjamesNo ratings yet
- AS32 DTU 100 Datasheet CN v5.0Document11 pagesAS32 DTU 100 Datasheet CN v5.0Thông NguyễnNo ratings yet
- 实时以太网Powerlink技术的研究 贾鸿莉Document2 pages实时以太网Powerlink技术的研究 贾鸿莉slickzz5262No ratings yet
- 智能化工程小机电Document22 pages智能化工程小机电ychen5374No ratings yet
- CAN Network (Reneses)Document49 pagesCAN Network (Reneses)delfitechNo ratings yet
- 100G OTN解决方案Document44 pages100G OTN解决方案Zhai ZhaiNo ratings yet
- Traffic Offloading Technology in LTE Network Using MECDocument10 pagesTraffic Offloading Technology in LTE Network Using MECJarbas BorgesNo ratings yet
- FlexRay 介绍Document11 pagesFlexRay 介绍Ryan WangNo ratings yet
- 现场总线PROFINETDocument228 pages现场总线PROFINETback1949No ratings yet
- X00010004 第4章 广域网基本原理Document20 pagesX00010004 第4章 广域网基本原理necibe2276No ratings yet
- ERICSSON基站英文缩写查询Document33 pagesERICSSON基站英文缩写查询Jinzhe WangNo ratings yet
- Rru ZteDocument6 pagesRru ZtexpyanghgNo ratings yet
- 04 GSM System OverviewDocument80 pages04 GSM System Overviewsmss01No ratings yet
- 电信云白皮书(2019年)19年7月Document57 pages电信云白皮书(2019年)19年7月firstwang0123No ratings yet
- 面向工业互联网的5G-U与时间敏感网络融合架构与技术 蔡岳平Document12 pages面向工业互联网的5G-U与时间敏感网络融合架构与技术 蔡岳平Blanca HillNo ratings yet
- 11 05-张骞允 中英对照 5G网络安全研究现状及进展Document70 pages11 05-张骞允 中英对照 5G网络安全研究现状及进展gnst.ntcNo ratings yet
- 5G VoNR语音关键技术分析Document5 pages5G VoNR语音关键技术分析wooskyhkNo ratings yet
- 1.4GHz数字集群专网在海警的应用研究 刘锦超Document2 pages1.4GHz数字集群专网在海警的应用研究 刘锦超Ma QianNo ratings yet