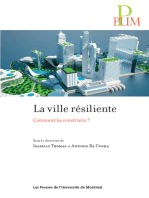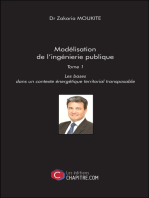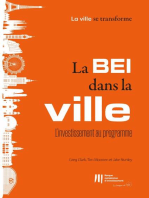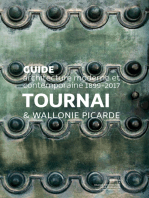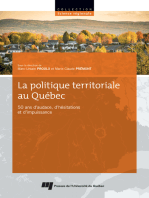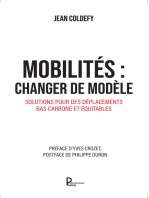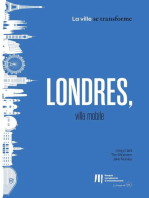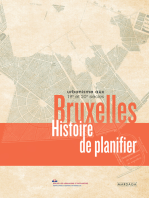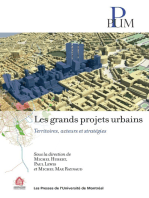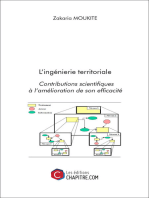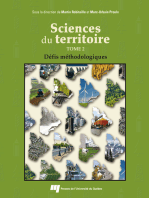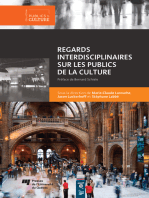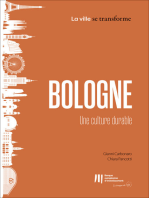Professional Documents
Culture Documents
Transport Urbain Et Circulation
Transport Urbain Et Circulation
Uploaded by
Marwa rhOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Transport Urbain Et Circulation
Transport Urbain Et Circulation
Uploaded by
Marwa rhCopyright:
Available Formats
Institut Supérieur des Technologies de l’Urbanisme, de l’Environnement et du
Bâtiment
Classe – Filière : 2ème TSUA
Module : Transports urbains et Circulation
Notes de cours
Par : Sami Yassine Turki
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
Table des matières
ISTEUB – TSUA –2ème année 2
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
Préambule
1. Consistance du cours
Le cours de transports urbains et circulation est assuré pour les étudiants de
deuxième année de la spécialité technicien supérieur en urbanisme et
aménagement.
S’agissant de l’unique module traitant de la question des transports urbains et de la
circulation dispensé aux étudiants, le cours comportera tout d’abord une introduction
à l’historique des transports urbains ainsi qu’aux enjeux, méthodes et techniques de
leur planification. Les documents de planification et d’organisation des transports
urbains seront également étudiés.
La deuxième partie du cours sera consacrée à la question de la circulation urbaine.
L’accent sera mis sur les méthodes d’analyse de celle-ci en distinguant les différents
modes de déplacement ainsi que sur les moyens d’organisation de la circulation.
Des exemples extraits de cas réels étudiés en Tunisie et à l’étranger seront exposés
et analysés.
2. Objectifs du cours
A l’issue du cours, les étudiants devront être en mesure de :
- intégrer, lors des études de planification urbaine, une réflexion sur la question des
transports urbains et notamment sur l’articulation entre programmation urbaine et
déplacements générés.
- participer à des équipes d’étude de planification des transports urbains
essentiellement en ce qui concerne les aspects relatifs à la collecte, à
l’exploitation et à l’analyse des données sur l’offre et la demande.
- effectuer des analyses et développer des réflexions et des solutions concernant
l’organisation de la circulation routière au niveau de territoires limités ou de points
particuliers du réseau routier (carrefours).
3. Bibliographie sommaire
CERTU, Plans de déplacements urbains- guide, Paris, CERTU, 1996,
263p
CETUR, Les études de prévision de trafic en milieu urbain- guide
technique, 1990,79 p
CETUR, Guide général des voiries urbaines, 1998, 197 p
ISTEUB – TSUA –2ème année 3
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
CHOAY (Françoise) et MERLIN (Pierre), Dictionnaire de l’urbanisme et de
l’aménagement, Paris, PUF, 1996, 863 p.
District de Tunis- Enquête-ménage 1994
DUPYU, (Gabriel). L’urbanisme des réseaux : théorie et méthodes Paris, A.
collin,1992, 198p
MARSHAL, J. L’établissement d’un plan de transport. L.H.C.N. Liège, 1992.
MERLIN, (Pierre) Méthodes quantitatives et espace urbain, Paris, MASSON,
1973, 192 p.
MERLIN, (Pierre), La planification des transports urbains, enjeux et
méthodes, Paris, Masson, 1984, 220 p.
MERLIN, (Pierre) Les transports en commun, quel choix pour nos
villes ? Dossier dirigé pour Urbanisme N° 258 Novembre 1992
MERLIN, (Pierre), Les transports urbains, Paris, PUF, 1992, 128 p.
QUINET (Emile) (sous la direction de) La demande de transport, de la
modélisation des trafics à l’appréhension des besoins, presses de l’ENPC, Paris,
1982
République Tunisienne, Ministère des Transports, Direction Générale des
Transports Terrestres, Organisation et coordination des transports urbains et
régionaux de voyageurs en Tunisie- diagnostic, octobre 1998, 230 p.
République Tunisienne, Ministère des Transports, Actualisation du PDRT du
Grand Tunis, 1996.
ISTEUB – TSUA –2ème année 4
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
Chapitre 1 : Historique et caractéristiques des transports
urbains
1. Les déplacements dans la ville
1.1. La fonction des transports dans la ville
La ville est un espace de vie et un assemblage de fonctions. Les théoriciens
fonctionnalistes ont défini quatre fonctions essentielles des villes en tant que besoins
universels de l’Homme :
L’habitat
La production
La culture du corps et de l’esprit
La circulation
La ville de nos jours n’existe qu’en tant que lieu de rassemblement des hommes et
de leurs activités, comme cadre de leurs échanges et de leurs communications. La
fonction des transports y est donc très importante même si elle n’est pas une fin
en soi.
Il y a lieu de remarquer, par ailleurs, que les transports urbains ont eu plusieurs rôles
dans la ville selon l’époque considérée : si au départ, les transports ont façonné la
forme des villes et guidé leur croissance et leur évolution, ils constituent aujourd’hui
un de leurs problèmes majeurs.
1.2. Naissance et évolution des problèmes de transport urbain
Les grandes villes du monde ont connu, à partir de la deuxième moitié du XIXème
siècle, une grande croissance. Outre le développement démographique de toute la
planète, cette croissance est due au fait que la population urbaine croît à un rythme
plus rapide que celui de la population totale.
Les causes de cette forte croissance et son déroulement dans le temps sont
différents selon la chronologie, l’histoire et selon le degré de développement du pays
ou de la ville concernés.
Cette croissance urbaine et démographique conjuguée avec les développements
économiques a entraîné une augmentation de la demande de transport. La
naissance des véhicules roulants tendait à satisfaire cette demande. Mais, durant la
deuxième moitié du XXème siècle, le nombre de ces véhicules n’a cessé d’augmenter
entraînant un grand besoin d’infrastructures (la demande est devenue supérieure à
l’offre) pour garantir une circulation fluide et sans danger.
Le constat actuel est qu’on assiste à la confirmation de grandes métropoles pluri-
millionnaires concentrant un grand nombre d’habitants dans un espace relativement
réduit. Cette concentration ne s’est pas déroulée sans effets sur le fonctionnement
de la ville et sur le mode de vie de ses habitants ; en effet, les grandes métropoles
vivent aujourd’hui plusieurs problèmes et crises dont celle du transport représente un
ISTEUB – TSUA –2ème année 5
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
élément de grande envergure par ses effets directs et indirects sur la vie économique
et sociale de toute la métropole.
Dans la plupart des métropoles du monde, congestion de la circulation, pertes de
temps importantes, inefficience des moyens de transport en commun, effets
environnementaux indésirables font partie du lot quotidien des usagers et des
gestionnaires des métropoles.
Notons que cette crise générale des transports urbains est le fait de plusieurs
facteurs qui interagissent avec celui du transport : facteurs urbanistiques, facteurs
socio-économiques, choix de politique de transport, insuffisance des transports
collectifs urbains... .
Remarquons, à cet égard, que la situation de crise qui a étranglé les villes va en
s'aggravant avec la production massive de l'automobile et la possibilité d'achat
croissante des ménages.
La nature de cette crise est différente selon le degré de développement du pays
considéré. Ainsi, les points forts de cette crise ne sont pas les mêmes dans les
villes du Nord et celles du Sud.
Crise de transport dans les villes du Nord
La crise de transport dans les villes du Nord est caractérisée par :
Un déséquilibre croissant entre zones d’habitat (généralement la périphérie et la
banlieue) et zones d’emploi (de plus en plus tertiaire, et de plus en plus au centre
ville). Les effets de ce déséquilibre se ressentent surtout au moment des
déplacements pendulaires qui s’accompagnent d’une congestion sans égal au centre
ville et sur les voies assurant la desserte des banlieues.
Une grande croissance du nombre de voitures particulières. Cette croissance va
favoriser la saturation des réseaux routiers et surtout les axes radiaux.
Une congestion du centre ville quasi généralisée dans l’espace en raison de la
concentration des activités tertiaires dans cet espace central relativement réduit.
Une incapacité des réseaux routiers existants à contenir cette mobilité croissante.
Cette incapacité est due au fait que ces réseaux sont, en partie, « hérités » et ne
sont donc pas aptes à recevoir une demande de transport plus importante. En plus,
la rareté de l’espace au centre ville, la nécessité de préserver les monuments
historiques, la situation foncière complexe et les différentes autres contraintes
économiques et environnementales rendent impossible l’adaptation du réseau routier
du centre ville à la demande réelle de transport.
Une grande difficulté des moyens de transport en commun à contenir la demande
de transport selon les deux aspects quantitatif et qualitatif :
Le réseau d’autobus, bien qu’il jouisse d’une souplesse similaire à celle de
l’automobile, lui permettant d’être adapté à la desserte des zones peu denses,
se trouve au centre ville « coincé » dans la congestion routière, ce qui diminue
sensiblement sa vitesse commerciale, et par suite, son rendement et son
attractivité.
ISTEUB – TSUA –2ème année 6
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
Le réseau de chemin de fer, quant à lui, ne permet pas, généralement, une
grande souplesse au centre ville. Son rôle essentiel étant la liaison banlieue-
centre ville, ses usagers se trouvent souvent obligés d’effectuer des
déplacements secondaires pour rejoindre leurs lieux de travail. Ce qui diminue
le rendement de ce moyen de transport et le rend moins attractif.
Le réseau de métro léger (tramway) représente une bonne alternative quand
la demande n’est pas très importante. Le métro lourd, par contre, reste le seul
moyen susceptible de répondre à une importante demande. Mais ses coûts de
construction très élevés rendent très difficile sa prolifération. D’autre part, les
différentes correspondances que les usagers doivent faire à l’intérieur même
du réseau ou avec d’autres réseaux augmentent le temps des trajets et
diminue le confort de ces usagers.
Des répercussions environnementales importantes : d’une part, les différents gaz
émis par les pots d’échappement des engins contribuent à la pollution de l’air et
d’autre part, les bruits et les nuisances sonores sont devenues des caractéristiques
des métropoles. Toutes ces nuisances contribuent à la dégradation de la qualité de
vie, à l’apparition de diverses maladies et à la dépréciation immobilière des bâtiments
qui se trouvent sur les axes de circulation.
Crise des transports dans des villes du Sud
La crise des transports a touché les villes de Sud à l’instar de celles du Nord. Il
existe, cependant, des différences dues à la nature de ces villes, à leur histoire, à la
fragilité économique des Etats concernés et à leur démographie.
La congestion du centre ville et l’allongement des temps de déplacement en voiture
particulière ou en transport collectif est un phénomène très répandu dans les
métropoles du Sud.
Sur un autre plan, les difficultés économiques au niveau des métropoles du Sud se
ressentent à deux échelles :
un niveau de vie médiocre des habitants, ce qui rend l’acquisition par ceux-ci de
moyens de transport autonomes un phénomène moins fréquent que dans les villes
du Nord. Ceci va rendre les déplacements difficiles surtout avec la prolifération de
l’habitat périphérique, des bidonvilles et le déséquilibre entre centre et périphéries.
Cette difficulté touche aussi l’utilisation des moyens de transport en commun dont les
tarifs restent inaccessibles pour une partie de la population.
une incapacité des Etats à satisfaire la totalité de la demande de transport. Les
moyens de l’Etat ne lui permettent pas d’entreprendre de grands investissements
que ce soit routiers ou en faveur des transports en commun. Ces Etats ont, aussi,
des difficultés à subventionner les déplacements des couches défavorisées sur les
réseaux de transport Etatiques.
Outre les difficultés d’investir en matière de transport en commun, la gestion et la
maintenance des réseaux existants sont fort difficiles.
1.3. La Mobilité
La mobilité urbaine est mesurée par le nombre moyen de déplacements effectués
par personne (généralement supérieure à 5 ans) et par jour. Dans une grande
ISTEUB – TSUA –2ème année 7
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
majorité des villes en développement, elle est inférieure ou proche d’un déplacement
mécanisé par personne de plus de 14 ans et par jour. Autrement dit, plus de la moitié
de la population ne se déplace pas ou se déplace à pied. Elle se situe à des niveaux
bien plus élevés (deux ou trois déplacements) dans les villes des pays développés
mais il existe des exceptions notables1.
Dans le Grand Tunis, l’enquête déplacements auprès des ménages réalisée en 1994
a révélé que la mobilité moyenne est de 1.76 déplacement par personne et par jour
(0.89 déplacement à pied et 0.87 déplacement mécanisé)
La mobilité au sein de chaque ville elle-même est inégale. Elle varie selon le niveau
de revenu, la motorisation (elle augmente avec l’évolution du revenu et du taux de
motorisation), la catégorie socioprofessionnelle, le lieu de résidence
(centre/périphérie) et les normes sociales (âge, sexe), traduisant les conditions
d’insertion dans la vie urbaine : dans le Grand Tunis, la mobilité varie de 1.41 dans
le Nord-Ouest à 2.08 dans le centre. De même, elle est de 2.55 pour les actifs ayant
un emploi et de seulement 0.99 pour les chômeurs et 1.28 pour les retraités.
Dans la plupart des sociétés, les hommes se déplacent plus que les femmes. Ce
constat est du au fait que ce sont généralement les femmes qui effectuent les
activités ménagères à domicile. Cet écart varie selon le pays en question (en fonction
des normes sociales). Mais il va en s’atténuant avec les nouvelles générations
scolarisées.
L’étude de l’évolution de la mobilité2 dans certaines villes européennes montre que
les personnes se déplacent autant (mobilité évolue très peu) mais sur des distances
encore plus importantes. La durée des déplacements est ainsi quasi-constante. Le
gain en teps est ainsi transformé en gain d’accessibilité, les individus élargissent
1.4. Les types de déplacements
On peut différencier les déplacements selon plusieurs critères dont notamment le
motif, l’origine et la destination et l’horaire.
Les motifs
On distingue deux grandes familles de motifs : les migrations alternantes d’un côté et
les déplacements professionnels, d’achat et de loisirs d’un autre côté.
Les migrations alternantes :
Ce sont les déplacements du domicile au lieu de travail. Ceux-ci résultent avant
tout, de la disparité entre la répartition géographique des emplois et des
logements, les premiers étant plus concentrés que les seconds.
Généralement, la disparité géographique qui existe entre l’habitat et l’emploi oppose
le centre à la périphérie. Dans le centre, souvent peu peuplé parce que les bureaux
ont chassé les résidents, on compte plusieurs emplois par personne active résidente
(plus de cent pour un dans la City à Londres ). Au contraire à la périphérie, à
l’exception de quelques secteurs industriels, les « banlieues dortoirs » n’offrent que
1
Certaines villes du Sud connaissent une mobilité élevée en raison de l’importance des deux roues : c’est le cas
de Ouagadougou en Afrique ou de nombreuses villes asiatiques, comme Hanoi au Viêt-nam (64% des
déplacements pour travail et écoles, près de 6% visites et loisirs).
2
On ne dispose pas de sources suffisantes pour caractériser la situation en Tunisie
ISTEUB – TSUA –2ème année 8
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
de rares emplois, liés à la présence d’une population résidente (commerces et
services quotidiens, écoles, artisanats, etc.), pour une population active importante. Il
en résulte que le courant essentiel des migrations alternantes s’effectue vers le
centre le matin, vers la périphérie le soir. Ce phénomène est également observé,
mais dans des proportions différentes, dans les zones de centralité périphériques
(quartiers d’affaires, zones d’emplois…)
Les migrations alternantes ne représentent que le quart du volume des
déplacements d’un jour de semaine dans les villes américaines, où la mobilité est
très élevée et le tiers dans les villes européennes.
Mais une attention particulière doit être portée à ce motif à cause d’une raison
importante : les migrations alternantes représentent la plus grande part – parfois
les trois quarts – des déplacements en heure de pointe. Or, c’est de ces heures
les plus chargées que le problème des transports urbains se pose avec le plus
d’importance. et même si les dernières enquêtes de déplacement effectuées dans
certaines villes européennes montrent que le poids des migrations alternantes est
entrain de diminuer, l’importance de ce motif demeure inchangée et doit continuer à
nécessiter un traitement spécifique.
Les déplacements professionnels, d’achat et de loisirs :
Les déplacements professionnels représentent un peu plus de 10% au total des
déplacements (exemple pris en France dans les années 1980-90). Liés à l’activité de
la ville, ils ont lieu surtout dans le centre. Leur horaire est assez étalé. Ces
déplacements sont assurés généralement par l’automobile : au moins ¾ des
déplacements professionnels.
Les déplacements d’achats (avec les déplacements pour affaires personnelles,
formalités, banques et assurances, services juridiques) sont encore très concentrés
dans les centres des villes. Ils sont assurés par les automobiles en majorité mais en
fonction de la taille de la ville et selon la nature des achats. Les centres commerciaux
en périphérie représentent parfois des parts non négligeables des déplacements
pour motif achat.
Les déplacements de loisirs ont des objets divers (activités culturelles et sociales,
distractions, visites, promenades, jeux ou sport) et leur répartition géographique est
plus diffuse que pour les autres déplacements.
Les origines et les destinations
On peut classer les déplacements selon leurs origines et leurs destinations. On
distingue ainsi les déplacements centre/centre, centre/périphérie,
périphérie/périphérie, centre/banlieue…
On peut également classer les déplacements, par rapport à un espace délimité, en
déplacements internes, déplacements d’échange et déplacements de transit.
Un déplacement interne a son origine et sa destination à l’intérieur de l’espace
considéré (fig. 1.). Ces déplacements sont généralement liés à l’activité et à la
résidence relative à l’espace en question : il faut donc les encourager.
ISTEUB – TSUA –2ème année 9
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
Un déplacement d’échange a son origine ou sa destination à l’extérieur de
l’espace considéré (fig.2.). Ce type de déplacement est également nécessaire mais
à condition de bien le véhiculer loin des espaces de résidence et d’activités.
Un déplacement de transit a son origine et sa destination à l’extérieur de
l’espace considéré (fig.3.). Il s’agit d’un trafic gênant et inutile (pour l’espace en
question) et il faut donc qu’il ne traverse pas celui-ci.
D
dd
Fig. 1. déplacement interne
O
O
D
D
dd
dd
Fig.2. déplacements d’échange
D
dd
Fig.3. déplacement de transit
Le fait qu’il y ait différents types de trafics qui nécessitent des traitements différents
impose que l’on doit différencier les réseaux routiers ; on parle alors de
hiérarchisation du réseau routier. C’est une opération qui détermine les voiries les
ISTEUB – TSUA –2ème année 10
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
plus importantes et qui servent aux déplacements d’échange avec les zones
environnantes, les voiries servant pour l’échange entre les quartiers et les voiries
internes aux quartiers.
Différentes dénominations sont utilisées : voiries primaire/secondaire/tertiaire, voirie
artérielles/ de liaison…
Les horaires des déplacements.
On peut classer les déplacements selon l’horaire. La distinction principale est la
suivante : déplacements en heure de pointe (matin ou soir) et déplacements en
heure creuse.
Si la pointe dépasse une heure, on parle de période de pointe.
Généralement, les études de planification et d’organisation des transports
urbains font les analyses par rapport à l’heure de pointe matin.
Nombre de déplacements
0h 6h 12h 18h 24h horaire
Heure de
pointe
Période de
pointe
Fig.4. distribution moyenne des déplacements dans une journée.
2. Les modes de déplacement
2.1. Historique des moyens de transport
Le transport individuel
Les premiers moyens de transport étaient individuels : d’abord les chevaux, ensuite
les carrosses. Un moyen nouveau s’est développé au XIXème siècle : c’est la
bicyclette grâce surtout à l’invention du pneu par Dunlop en 1888. La bicyclette,
après avoir été un moyen de loisirs, s’est développée dans certaines banlieues
industrielles.
ISTEUB – TSUA –2ème année 11
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
Les véhicules motorisés à deux roues ont ensuite succédé au vélo qui est (re)devenu
aujourd’hui principalement un objet de loisirs.
La première voiture a été construite en 1883. Mais elle resta longtemps le privilège
d’une minorité. Le parc des véhicules va ensuite se développer ainsi que les
infrastructures routières.
Le transport collectif
Les transports collectifs terrestres sont apparus avec la révolution industrielle (XIXème
siècle).
Au début du XIXème siècle, les omnibus tirés par des chevaux sont apparus ensuite
les tramways tirés par des chevaux. Le premier tramway dans le monde est celui de
New York inauguré en 1832. La traction mécanique a été introduite aux tramways en
1876.
La fin du XIXème siècle a été marquée par l’apparition des trolleybus et le début du
XXème siècle par celui des bus. Les autobus se sont développés au détriment des
tramways, à cause notamment de la gêne qu'occasionnaient ces derniers aux autres
usagers de la route.
Le chemin de fer métropolitain (appelé Métro) est apparu en 1863 à Londres.
L’historique des chemins de fer de banlieue est différent : les premières lignes de
chemin de fer reliaient les villes entre elles (début du XIXème siècle). Des gares de
banlieues furent construites ensuite. Des services spéciaux ont ensuite été créés
donnant naissance aux chemins de fer de banlieue.
Conclusion : tous les moyens de transport existant aujourd’hui datent de plus
d’un siècle.
2.2. Caractéristiques des moyens de transport
Les moyens de transport individuel
On s’intéressera dans cette section aux routes et espaces de stationnement. Les
caractéristiques des véhicules sont plus connues.
Pour les routes, la construction d’un kilomètre de 2X2 voies avec terre plein central
(TPC) coûte à peu près 1 million de dinars en périphérie. Ce prix augmente
sensiblement si on s’approche du centre-ville.
La capacité d’une voie de circulation est de 1800 voitures par heure.
Pour le stationnement des voitures, la surface nécessaire est de 20-25 m2 par place.
Le coût de la construction de ces places dépend de la localisation (centre/périphérie)
et du niveau (au sol/en sous-sol/en parking à étages).
Tableau 1 : Prix moyen de la construction d’une place de stationnement3
Niveau
Au sol En étage
3
Ordre de grandeur
ISTEUB – TSUA –2ème année 12
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
Localisation En périphérie 1 000 DT 8 000 DT
En centre ville 20 000 DT 12 000 DT
Les moyens de transport collectif
Les coûts des infrastructures de transport sont très élevés4. Ils sont encore plus
élevés si on est dans le centre ville. Le matériel roulant est également coûteux5.
La capacité horaire des modes de transport collectif dépend de la capacité du
matériel roulant et de la fréquence maximale de véhicules/heure (déterminés par des
considérations de sécurité).
Tableau 2 : capacité des moyens de transport collectif
Moyen Fréquence Capacité d’un Capacité horaire
maximale véhicule maximale
RER 30 2 000 60 000
Métro 40 600 24 000
Tramway 30 168X2 10 000
Autobus 60 80 4 800
Remarques :
La mise en place d’infrastructures lourdes de transport collectif ne peut être
rentable que sur des axes lourds de transport (couloirs où il y a un nombre très
important de déplacements).
Le coût de l’investissement est en relation étroite avec la capacité : ainsi, on
ne doit programmer que les moyens de transport qui répondent exactement à la
demande.
Les transports collectifs (et surtout ceux en site propre) sont les seuls à
pouvoir répondre à une demande très importante.
Chaque mode de déplacement a sa propre place dans la ville.
Les transports collectifs sont moins polluants, moins consommateurs
d’espace et plus sûrs.
Pour le fonctionnement des transports collectifs, le coût du personnel est très
important (peut atteindre 60 %).
4
à titre d’exemples, la ligne de Métro léger (tramway) qui va desservir El Mourouj va coûter quelques 51
millions de dinars, celle de Manouba 23. Le tronc commun du centre ville (Avenue Med V- TGM) coûtera 21
millions de dinars. L’électrification de la ligne Tunis-Borj Cédria coûtera 180 millions de dinars (dont 125
millions pour l’acquisition de nouveaux matériels)
5
un autobus de 77 places coûte 200 milles dinars et un tramway de 168 places deux millions de dinars.
ISTEUB – TSUA –2ème année 13
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
3. Historique des transports urbains à Tunis
3.1. L’époque d’avant l’indépendance
Avant le protectorat
C’est l’année 1872 qui marque l’histoire du transport urbain dans le Grand Tunis
puisque la première ligne de transport en commun, la ligne TGM qui dessert Tunis-
La Goulette- La Marsa pour la banlieue nord, ligne de 28 Km d’aller retour a été
inaugurée par Mohamed Sadok Bey. Notons que cette date précède l’instauration du
protectorat Français.
C’est ensuite au tour de Hammam- Lif banlieue sud à 20 Km de la capitale d’être
desservie par le chemin de fer en 1876.
Pendant le protectorat
En 1885 la société anonyme de tramways de Tunis fondée par un belge6 met en
évidence cinq lignes de tramway hippomobile7.
La mise en place de la ligne ferroviaire Bab Saâdoun –Manouba a été opérée en
1900. Cinq ans après, la ligne TGM a été transformée à la Compagnie des
Tramways de Tunis (CTT) qui a connu alors deux grands changements :
l’électrification de la voie qui remplace le chemin de fer à vapeur,
l’inauguration du premier tracé direct à travers le lac de Tunis, cette ligne portera
désormais le nom de TGM Tunis -Goulette –Marsa .
En 1913 la ligne ferroviaire Tunis –Djebel Djelloud a été créée et en 1929 les
premiers autobus apparaissent8.
En 1946 la CTT exploite par trolleybus, la desserte Port De France- Mont Fleury, la
ligne autobus Place Pasteur – Mutuelle Ville et la ligne sept du tramway Port De
France – Avenue Carnot avec prolongement jusqu’à Mutuelle Ville.
Enfin en 1950, la ligne autobus desservant La Cagna est créée.
3.2. L’époque d’après l’indépendance
Après l’indépendance et plus précisément en 1958 les secteurs électricité et
transport en commun de Tunis et banlieue appartenaient désormais à l’Etat Tunisien.
En 1960 le tramway disparaît définitivement, en 1963 la société nationale de
transport est née et sera connue sous le sigle SNT, elle est chargée du transport des
voyageurs routiers et marchandises.
6
Joseph Closon
7
Ces lignes sont les suivantes : 1ère ligne Bab Jedid-Bab Bhar par Bab Jezira, 2ème ligne Bab Bhar-
ème ème
Bab Suika par Bab Carthagène, 3 ligne Bab Jedid –Bab Suika par La Kasbah, 4 ligne Bab Bhar
ème
–La Marine (devenue à l’heure actuelle Avenue Habib Bourguiba) et 5 ligne Bab Bhar-Bab El
Kadrah.
8
Un an après, les lignes autobus, Rue De Rome-France Ville-Mutuelle Ville et Place De la Gare -
Mont Fleury ont été mises en service.
ISTEUB – TSUA –2ème année 14
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
En 1964 la société de transport marchandise (STM) a été créée et la SNT n’exploite
plus que le réseau de transport urbain dans la ville de Tunis et banlieue et le réseau
de transport interurbain.
En 1981, la SNT a été scindée en trois sociétés distinctes : la SNT qui s’occupe du
transport routier urbain et suburbain, la Société du Métro Léger de Tunis SMLT
chargée d’exploiter la ligne TGM et le futur réseau métro léger et la Société Nationale
de Transport Rural et Interurbain SNTRI.
La ligne 1 du métro léger Tunis-Ben Arous a été mise en service en 1985, un an
après c’est la mise en place de la correspondance bus-métro à El Ouardia.
En 1989 la SNT, la SMLT et la SNCFT avaient engagé ensemble une étude de
restructuration de leurs réseaux d’où la mise en service de la ligne 2 du métro léger
Tunis-Ariana.
L’année 1990 a connu la mise en service de la ligne 3 du métro léger jusqu’à Ibn
Khaldoun et de la ligne 4 jusqu’à Bardo.
En 1992, le prolongement de la ligne 3 du métro léger jusqu’à El Intilaka donne
naissance à la ligne 5 du métro léger.
En 1997, la ligne 4 a été prolongée jusqu’à Denden.
En 2001, le processus de fusion de la SNT et de la SMLT est enclenché (donnant la
société de transport de Tunis STT, avec comme nom commercial TRANSTU) .
Le 8 Janvier 2003, annonce lors d’un comité interministériel de la création de la STT.
au cours du second semestre de cette même année, les travaux de réalisation de la
ligne 6 du métro desservant El Mourouj ont démarré.
Pour les prochaines années, il est prévu de réaliser un transport de masse avec une
classe de trafic de l’ordre de 20.000 voyageurs/heure dans le sens le plus chargé
pour répondre à la demande potentielle sur 3 secteurs bien identifiés : Manouba-
RN7-M’nihla ; Ezzouhour-Zahrouni ;Bir Kassaa-Fouchana-Séjoumi9.
La vitesse commerciale est de l’ordre de 30 à35 Km/heure permettant d’amener les
usagers situés sur la troisième couronne(éloigné de 15 Km en moyenne par rapport
au centre) en 30 minutes au maximum.
Le tracé des axes futurs de ce mode devrait permettre de relier le cœur des
nouvelles grandes urbanisations au centre de Tunis.
4. Enjeux de la planification des transports urbains
Planifier les transports urbains n'est pas uniquement une question "technique" ou
« économique ». La planification des transports urbains fait ressortir différents enjeux
:
4.1. Enjeux humains
Il s’agit, en premier lieu, d’assurer une accessibilité satisfaisante pour l’ensemble
des usagers. Cette accessibilité doit prendre en considération l’existence - malgré la
9
En plus de l’électrification de la ligne de Borj Cédria.
ISTEUB – TSUA –2ème année 15
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
motorisation croissante des ménages - d’une population captive des transports
collectifs (c’est à dire qui ne peut se déplacer qu’en utilisant les transports collectifs).
Dans les pays en voie de développement, cette assurance d’une de l’accessibilité
représente l’objectif primordial à atteindre. Par contre, dans les pays développés, les
études et réalisations dépassent l’accessibilité pour toucher la qualité de service des
différents investissements et notamment la vitesse et le confort des usagers.
4.2. Enjeux techniques
Ces enjeux concernent essentiellement les pays en voie de développement. La
maîtrise technique constitue parfois un obstacle devant l’expansion des réseaux de
transport et de leur adaptabilité à la demande des populations.
4.3. Enjeux économiques et politiques
« Il faut souvent une génération pour qu’une idée mûrisse et devienne un projet
précis »10. Il faut ensuite plusieurs années pour effectuer les différentes études, pour
réunir les financements nécessaires et pour réaliser le projet en question.
Par ailleurs, les choix importants en matière de politique de déplacement à l'intérieur
des villes se confrontent toujours à des intérêts économiques et politiques divers.
4.4. Enjeux environnementaux
Les atteintes des transports à l’environnement sont loin d’être négligeables: bruit,
pollution, effets visuels dues aux infrastructures de transport et à leurs équipements
annexes coûtent très chers aux personnes et aux collectivités.
4.5. Enjeux énergétiques
La part importante du secteur des transports dans la consommation totale d’énergie
dans une ville mérite que l’on associe politique de transport et maîtrise énergétique.
4.6. Enjeux spatiaux
La consommation de l’espace par les infrastructures et les moyens de transport
constitue un élément de valorisation et de comparaison des différentes politiques de
planification des transports. A titre d’exemple, un déplacement en automobile
consomme 10 à 20 fois plus d’espace qu’un déplacement effectué par un moyen de
transport en commun.
4.7. Enjeux urbains11
« Les transports constituent le moyen le plus efficace pour modeler l’espace »12 en
effet, les densités urbaines et les valeurs foncières sont fonction des moyens et
infrastructures de transport existants : Ainsi, les transports en commun favorisent -
ils la densification de l’urbanisation autour des stations tandis que l’automobile
favorise une urbanisation peu dense mais sur des surfaces beaucoup plus étendues.
10
MERLIN, P l’urbanisme, 1994
11
voir détails au chapitre suivant
12
MERLIN, P l’urbanisme, 1994
ISTEUB – TSUA –2ème année 16
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
Chapitre II. Transport et organisation de l’espace
1. Transport urbain et urbanisme
Les transports urbains ne sont pas seulement une conséquence de l’évolution des
villes, donc des besoins en déplacements. Ils contribuent à la définition de la forme,
de la croissance et de l’évolution des villes.
Les transports collectifs favorisent une urbanisation dense autours des arrêts dans
un rayon de marche à pied ainsi qu’une évolution importante des valeurs foncières.
Ils sont cohérents avec une politique d’habitat collectif autour des stations.
Les réseaux routiers (voitures particulières) favorisent l’ouverture de vastes espaces
à l’urbanisation, donc font baisser les prix fonciers (mais les prix sont plus ou moins
élevés à l’approche des voies les plus importantes). Ils sont cohérents avec un
habitat individuel (faible densité).
Le choix d’un système dominant de transport, des axes desservis, des points d’arrêt,
de la tarification ont des conséquences décisives sur les formes urbaines. C’est
pourquoi l’urbaniste doit contribuer à l’étude de la planification et de l’organisation
des transports urbains : le transport constitue le moyen le plus efficace pour modeler
l’espace.
Le plan de transport d’une agglomération doit être conçu parallèlement à son plan
d’urbanisme. Les choix de transport sont les meilleurs moyens d’atteindre les
objectifs d’urbanisme. De même, le choix en matière d’urbanisme peut favoriser une
politique de transport urbain (par exemple : l’habitat dense favorise les transports
collectifs).
2. Système de transport et aménagement du territoire
2.1. L’échelle de l’ensemble du territoire
L’objectif principal d’une politique d’aménagement du territoire est la lutte contre les
déséquilibres démographiques et économiques.
Le système de transport proposé par les schémas d’aménagement du territoire peut
avoir différents impacts :
- Améliorer l’accessibilité des régions (et par suite des villes) mal desservies ce qui
permet une meilleure rentabilité des activités économiques et par suite leur
dynamisation.
- Homogénéiser le réseau urbain en favorisant la liaison des petites villes aux villes
moyennes au lieu de les lier toutes à la grande métropole.
2.2. L’échelle de la région
La définition d’un réseau de transport à l’échelle d’une région permet d’atteindre les
objectifs de la politique d’aménagement de la région et notamment le développement
des grandes et petites villes ainsi que la relation entre la grande agglomération et les
agglomérations périphériques.
ISTEUB – TSUA –2ème année 17
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
Chapitre III. Méthodes de planification des transports urbains
1. La planification des transports urbains
Une politique de transports est l’ensemble des orientations fixées par les pouvoirs
publics, après études de planification et consultation des habitants, fixant :
- le rôle assigné aux différents moyens de transport,
- les grands investissements à réaliser,
- leur financement et celui de leur fonctionnement,
- la tarification,
- les moyens d’inciter les usagers dans le sens des objectifs fixés.
La planification des transports est l’« établissement de programmes, spatiaux et
économiques, déterminant la demande prévisible à horizon temporel étudié, les
investissements à réaliser pour la satisfaire, leur échelonnement dans le temps et
leurs conséquences prévisibles, en particulier sur le développement urbain et la
localisation des activités et des équipements ».
Le schéma suivant explicite la démarche à suivre pour planifier les transports
urbains :
ISTEUB – TSUA –2ème année 18
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
Enquêtes Demande Offre Statistiques
Recensements Actuelle actuelle Enquêtes
Confrontation
Méthodes de
prévision
Prévisions Demande Offre future Etudes
démographiques, future (infrastructures économiques
économiques, supplémentaires (rentabilité,
urbanistiques nécessaires) priorité)
Itérations Programme
d'investissements
Fig. 5. Démarche de planification des transports urbains
La planification des transports urbains se fait généralement à moyen et long terme
(maximum 15-20 ans) contrairement à l’organisation de la circulation qui se fait à
court terme et parfois à moyen terme (maximum 8-10 ans).
Deux autres différences entre ces deux approches des transports urbains sont à
relever :
- La planification des transports urbains s’intéresse à la définition des
infrastructures additionnelles à réaliser alors l’organisation de la circulation se
limite à l’optimisation des infrastructures existantes.
- En Tunisie, la planification des transports urbains est du ressort de l’Etat alors
que l’organisation de la circulation est à la charge des collectivités locales.
D’une manière plus générale, il est à noter que la multitude des acteurs en matière
de transport urbain, la lourdeur de l’investissement ainsi que la difficulté du contrôle
rendent difficile la maîtrise des transports urbains. En Tunisie, un autre élément rend
encore plus difficile cette maîtrise : c’est l’absence de textes instaurant et définissant
ISTEUB – TSUA –2ème année 19
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
les documents de planification des transports et d’organisation des déplacements ou
la circulation.
2. Caractérisation de la demande
Pour caractériser la demande en matière de déplacements urbains, le meilleur
moyen est la réalisation d’une enquête déplacement auprès des ménages.
La démarche classique de cette enquête est la suivante :
Subdivision de la ville en zones de transport
Le territoire de la ville est subdivisé en un ensemble de zones de transport (une ville
comme le Grand Tunis doit être subdivisée en 50-100 zones). Chaque zone doit
avoir des caractéristiques homogènes.
Choix d’un échantillon de ménages
On doit connaître préalablement dans chaque zone le nombre de ménages. On
établit également le taux d’échantillonnage.
On choisit ensuite les ménages (ou plutôt les logements) qui feront l’objet de
l’enquête de sorte à respecter le taux d’échantillonnage.
Réalisation de l’enquête
Les ménages en question doivent être avertis du contenu et de la date de l’enquête.
Cette enquête doit se dérouler dans un mois représentatif de toute l’année (de
préférence le mois d’avril) dans une journée qui suit une journée représentative de
toute la semaine (généralement mardi et jeudi, donc l’enquête se déroulera de
préférence le mercredi et le vendredi).
On effectue l’enquête pour chaque membre du ménage (généralement supérieur à 5
ans) séparément.
Outre les informations générales (âge, sexe, fonction…), les informations à collecter
sont les suivantes : chaque personne doit indiquer tous les déplacements
effectivement réalisés la veille en indiquant pour chaque déplacement :
- le motif,
- l’origine et la destination
- l’horaire,
- la durée,
- le mode utilisé.
Exploitation des données
Les différentes données collectées sont saisies et exploitées pour déterminer des
résultats tels que la mobilité moyenne selon la zone, le taux de motorisation, la
répartition modale, matrice origine/destination…
ISTEUB – TSUA –2ème année 20
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
3. Caractérisation de l’offre
3.1. Offre en matière de transport individuel
Pour caractériser l’offre en matière de transport individuel, on doit disposer des
éléments suivants :
- Une implantation du réseau routier (exceptées les voies utilisées pour les
déplacements internes). Cette implantation (de préférence sous forme
numérique) doit distinguer les tronçons de routes et les intersections.
- Pour chaque tronçon, on doit indiquer la longueur, le nombre de voies, la capacité
et certaines caractéristiques physiques (pente, présence de terre plein central…)
ou réglementaires (présence de sens unique, restriction de circulation, vitesse
maximale…).
- Pour chaque intersection on doit indiquer le niveau par rapport au sol (carrefour
au sol ou carrefour dénivelé, de type échangeur par exemple) et le mode de
résolution des conflits (carrefour à feux, giratoire…).
- Une caractérisation du parc de voitures (nombre, répartition du taux de
motorisation, âge moyen des voitures…).
3.2. Offre en matière de transport collectif
Pour caractériser l’offre en matière de transport collectif, on doit disposer des
éléments suivants :
- Une implantation du réseau de transport collectif (en distinguant les
infrastructures des lignes). Cette implantation (de préférence sous forme
numérique) doit distinguer les tronçons des infrastructures en site propre (bus,
métro, tramway, train…) et les intersections.
- Pour chaque tronçon, on doit indiquer la longueur et le nombre de voies (pour les
réseaux en site propre) ainsi que le type de voie (normale (1,435 m,
métrique(1m)…).
- Pour chaque station on doit indiquer : nombre de voies, nombre de quais de
voyageurs, capacité des quais, confort…
- Pour chaque intersection on doit indiquer le mode de résolution des conflits
(passage à niveau, tunnel…).
- Une caractérisation du matériel roulant (nombre, capacité (debout et assis),
vitesse maximale, confort…).
4. La méthode de planification à quatre étapes
4.1. Consistance
La méthode de planification des transports urbains dite à quatre étapes est la plus
employée (appelée d'ailleurs méthode classique) et n'a pas encore trouvé de
méthode alternative et ce malgré les critiques qui ont été formulées à son encontre.
Cette méthode est souvent structurée en quatre étapes successives :
ISTEUB – TSUA –2ème année 21
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
La génération de déplacements : il s’agit de déterminer, à partir d’un découpage
de la zone d’étude en sous zones, l’émission (nombre de déplacements émis) et
l’attraction (nombre de déplacements reçus) de ces sous zones
La distribution : cette étape concerne la détermination des origines et des
destinations des déplacements. Les modèles de distribution géographique
reposent sur une adaptation du citadin aux possibilités qui lui sont offertes. Ils
expriment le choix réciproque du lieu de travail et du lieu de résidence.
La répartition modale : cette phase s’intéresse à la part de chaque mode de
déplacement (donc au choix effectué par l’usager)
L’affectation sur les différents itinéraires possibles.
Cette méthode est très utilisée pour les études de calibrage des
infrastructures. Ils permettent d’établir des prévisions de déplacements en
voiture particulière ou en transport en commun à moyen et à long terme afin de
déterminer l’ensemble des actions sur l’infrastructure à réaliser pour satisfaire
l’ensemble de la demande. C’est le cas, par exemple, du plan directeur régional
des transports du Grand Tunis (PDRT-1996) qui utilise le modèle EMME/2 pour
caractériser l’offre et la demande future.
4.2. Les modèles utilisés
Différents modèles ont été développés pour supporter les différentes étapes de la
méthode. Dans ce qui suit, seront présentés quelques-uns les plus utilisés :
Génération des déplacements
Les modèles utilisés essayent de déterminer le niveau de mobilité globale (en
nombre de déplacements par jour, par ménage ou par personne). Des formules de
régression linéaire liant la mobilité à certains paramètres sont souvent utilisées.
Exemple : formule de Schuldiner (Etats Unis)
M = 2,18 + 3,40A + 0,25H + 0,119S - 0,0343F
M : nombre de déplacements par jour et par ménage
A : nombre d'automobiles par ménage
H : taille du ménage
S : indice de rang social
F : indice d'attachement au foyer
ISTEUB – TSUA –2ème année 22
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
Distribution des déplacements
Modèle de Fratar (facteurs de croissance) :
à partir de flux existants connus par enquête t0ij (nombre de déplacements entre les
zones i et j) on va faire des corrections par des facteurs de croissance pour
déterminer les flux à la date de prévision t1ij
on peut utiliser un facteur de croissance de la population pour les secteurs de
résidence :
Fi = P1i/P0i et un facteur de croissance des emplois pour les secteurs de travail : Fj =
E1j/E0j
On peut établir plusieurs modèles :
Fi F j'
t t
1
ij
0
ij
2
t t Fi F j'
1
ij
0
ij
Cette méthode a pour avantage de se baser sur des flux réels, donc évite de
grandes divergences sur des prévisions à moyen terme. Par contre, elle ne prend
pas en considération les évolutions des structures des agglomérations, des réseaux
de transport et des comportements entre les dates 0 et 1.
Modèle gravitaire :
Ce modèle prévoit les flux futurs sans tenir compte des flux actuels :
t ij .A i .E j .f (Dij )
La fonction Dij est appelée fonction de résistance au déplacement. Deux
formulations simples sont employées :
La fonction puissance :
.f (Dij )
1
Dij
La fonction exponentielle :
ISTEUB – TSUA –2ème année 23
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
.f (Dij ) e
' D ij
L'utilisation de ces modèles à court ou moyen terme peut aboutir à des erreurs
graves. Ils peuvent être utilisés à long terme à condition de prendre en considération
les évolutions des structures des agglomérations, des réseaux de transport et des
comportements.
Répartition par itinéraire
Exemple du Modèle de Claffey13 :
P CL 2 L1 t 2 t1 a 2 a 1 V2 V1
z
1 z
log
Z est la probabilité d'utiliser l'itinéraire 1
P est le péage de l'itinéraire 2
L1 et L2 la longueur des itinéraires 1 et 2
C le coût par unité de longueur
t1 et t2 le temps de trajet selon l’itinéraire
la valeur du temps
a le coût de sécurité par itinéraire
V la somme des variations de vitesse par itinéraire
l'inconfort attaché aux variations de vitesse
A l’issue de cette étape, et connaissant l’offre actuelle et la demande future sur
chaque tronçon de route ou de ligne de transport collectif, on peut confronter ces
deux éléments et déterminer l’offre additionnelle nécessaire.
13
Ce modèle est utilisé pour les déplacements interurbains. Pour le trafic purement urbain, on peut utiliser
différents modèles tel que l’affectation par "tout ou rien" à l'itinéraire le plus rapide.
ISTEUB – TSUA –2ème année 24
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
Chapitre IV. Outils de planification et d’organisation des transports
Le chapitre précédent a donné les définitions de la planification et de l’organisation
des transports urbains. Il a également présenté les différences majeures entre ces
deux types d’approche des transports urbains.
Cependant, les études de planification ou d'organisation des déplacements peuvent
avoir plusieurs formes selon la nature de l'étude (planification, organisation,
restructuration…), l'échelle territoriale (quartier, commune, grande ville…) et l'autorité
responsable de l'application de la programmation de l'étude (Etat, collectivités
locales, entreprises de transport…).
Toutefois, il est à signaler qu'il n'existe pas, jusqu'aujourd'hui de définitions claires
des documents de planification et d'organisation des déplacements en Tunisie.
1. Les plans directeurs et les documents de planification des infrastructures
La planification des transports urbains se fait généralement à l’échelle de l’ensemble
d’une agglomération, à moyen et long terme (avec quelquefois des actions à court
terme) et peut prendre plusieurs formes : on trouve en Tunisie par exemple les Plans
Directeurs Régionaux de Transport (PDRT), en France les Dossiers de Voirie
d’Agglomération (DVA)…
La méthode et la consistance des études permettant d’aboutir à ces documents sont
explicités dans le chapitre précédent.
2. Les plans de circulation
Le plan de circulation est un plan à court et à moyen terme (10 ans au maximum)
prévoyant des aménagements légers (carrefours, sens uniques, feux tricolores…)
permettant d’accroître l’efficacité de la voirie existante. Il peut comporter des
propositions concernant les piétons (voies piétonnes) les cycles (pistes cyclables), le
stationnement (réglementation, tarif), les transports en commun routiers (pistes
réservées, tarif, restructuration des réseaux…).
Le plan de circulation se fait généralement à l’échelle d’une commune.
Les principaux objectifs du plan de circulation sont :
- favoriser le déplacement des piétons et des moyens de transport en commun,
- améliorer les conditions de circulation et de fluidité du trafic,
- organiser et améliorer l’espace en coordonnant les fonctions diverses qu’il
assure : cheminement des piétons, circulation des transports en commun, circulation
des voitures, stationnement, circulation des deux roues…
- réduire les accidents urbains et en particulier ceux qui surviennent aux piétons.
Les plans de circulation cherchent à optimiser l’utilisation des infrastructures
existantes en utilisant deux types de moyens :
Des moyens réglementaires d’organisation de la circulation.
ISTEUB – TSUA –2ème année 25
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
- séparation des différents modes de transport (voies réservées aux bus, piétons,
deux roues…)
- organisation des courants de circulation (sens uniques, itinéraires poids lourds…)
- organisation du stationnement.
Des moyens techniques d’équipement des voiries
- aménagement des carrefours,
- signalisation des circulations et jalonnement des itinéraires,
- régulation des trafics par feux,
- éclairage public,
- aménagement de passages piétons,
- aménagement d’aires de stationnement.
Remarque : les aménagements sont minimes et se situent dans le cadre des
infrastructures existantes.
3. Les plans de déplacements urbains
Les PDU sont nés en France suite au constat d’insuffisance des plans de circulation
pour maîtriser les déplacements urbains.
Les PDU définissent les principes généraux de l’organisation des transports, de la
circulation, et du stationnement pour permettre une utilisation plus rationnelle de la
voiture et assurer la bonne insertion des piétons, des véhicules à deux roues et des
transports en commun (de préférence en sites propres pour une meilleure efficacité.
Ainsi, les orientations voulues par les PDU sont :
- la diminution du trafic automobile,
- le développement des moyens de déplacement économiques et les moins
polluants,
- l’aménagement et l’exploitation du réseau de voirie afin de rendre plus efficace
son usage en l’affectant aux divers modes de transport,
- l’organisation du stationnement et du transport et livraison de marchandise,
- l’organisation du transport du personnel des entreprises et des collectivités.
Le PDU est conçu pour les objectifs suivants :
- se déplacer sans nuire à la santé,
- favoriser l’intermodalité pour une meilleure cohérence des transports dans
l’agglomération,
- coordonner la politique urbaine et la politique de déplacement,
- retrouver dans la cité le plaisir du vélo et de la marche à pied,
ISTEUB – TSUA –2ème année 26
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
- offrir des transports en commun performants et complémentaires,
- proposer un stationnement adapté aux attentes et effectuer les livraisons en tout
respect,
- contribuer aux changements de comportements et d’habitudes.
La démarche du PDU se situe dans le moyen terme (10 ans). Le périmètre d’action
doit, pour des raisons opérationnelles, le périmètre des transports urbain
(l’agglomération).
Le PDU doit être réalisé par l’autorité compétente pour l’organisation des transports
après avis des collectivités locales.
Exemples de mesures prises par les PDU
- l'encouragement de la pratique du vélo par la mise en place de stationnements
pratiques et sûrs.
- l’encouragement de l’utilisation des transports collectifs, par exemple par la prise
en charge de l’abonnement,
- la réduction du stationnement, par exemple par la pratique du « cash out » qui
consiste à offrir une indemnité aux salariés acceptant de ne plus utiliser leurs places
de stationnement.
4. Gestion des réseaux de transport collectif urbain
Les sociétés de transport peuvent être de différents types (privées, publiques,
régies…). Mais l’Etat intervient de différentes manières dans la planification et la
gestion des réseaux de transport collectif que ce soit par le financement des
infrastructures, les subventions pour certaines catégories, la définition des politiques
générales en matière de transport (part du secteur privé…)...
Selon le pays considéré, la collectivité locale intervient dans la gestion des réseaux
de transport collectif.
Il est recommandé de mettre en place une « autorité organisatrice » des transports
urbains afin de mettre en conformité les actions des différents intervenants.
En Tunisie, il n’y a pas d’autorité organisatrice des transports urbains proprement
dite. Les réseaux de transport collectifs sont gérés par des entreprises relevant de
l’Etat. Certaines lignes de bus sont concédées à des sociétés privées avec un cahier
des charges à respecter.
La gestion des réseaux de transport collectif vise souvent à atteindre deux objectifs
non toujours convergents :
- améliorer la rentabilité de l’activité de l’entreprise
- améliorer la qualité de service : vitesse commerciale, zones desservies,
fréquence, confort, information aux usagers…
Les problèmes types rencontrés sont les suivants :
ISTEUB – TSUA –2ème année 27
Transports urbains et Circulation S. Y. TURKI
- rentabiliser et optimiser l’usage du parc (parc insuffisant en heure de pointe,
dépassant la demande en heure creuse, lignes peu rentables dans le sens des
retours…),
- optimiser l’utilisation du personnel,
- améliorer la vitesse commerciale, surtout des bus, dans le centre ville. Les bus se
trouvent coincés avec la circulation des voitures,
- trouver l’espace nécessaire pour stationnement des véhicules (gares et dépôts),
- disposer d’informations à jour sur la demande.
ISTEUB – TSUA –2ème année 28
You might also like
- Manual Hawo HD 650 DLDocument15 pagesManual Hawo HD 650 DLAmparo CarrilloNo ratings yet
- Mobilités internationales et intervention interculturelle: Théories, expériences et pratiquesFrom EverandMobilités internationales et intervention interculturelle: Théories, expériences et pratiquesRating: 1 out of 5 stars1/5 (1)
- Relleno Hidráulico PDFDocument32 pagesRelleno Hidráulico PDFL Joseline Avila Condori100% (1)
- Les Voies de Communication et les Moyens de Transport : Défis et Solutions pour un Avenir DurableFrom EverandLes Voies de Communication et les Moyens de Transport : Défis et Solutions pour un Avenir DurableNo ratings yet
- Perspectives critiques et analyse territoriale: Applications urbaines et régionalesFrom EverandPerspectives critiques et analyse territoriale: Applications urbaines et régionalesNo ratings yet
- Renouveler l'aménagement et l'urbanismeFrom EverandRenouveler l'aménagement et l'urbanismeNo ratings yet
- Architectures et villes de l'Asie contemporaine: Héritages et projetsFrom EverandArchitectures et villes de l'Asie contemporaine: Héritages et projetsNo ratings yet
- Lire et comprendre les environnements bâtis au Québec: La morphologie au service d'une démarche d'aménagement durableFrom EverandLire et comprendre les environnements bâtis au Québec: La morphologie au service d'une démarche d'aménagement durableNo ratings yet
- Économie des transports: Voyager à travers l'économie de la mobilité, un guide sur l'économie des transportsFrom EverandÉconomie des transports: Voyager à travers l'économie de la mobilité, un guide sur l'économie des transportsNo ratings yet
- À la croisée des nouvelles routes de la soie: Coopérations et frictionsFrom EverandÀ la croisée des nouvelles routes de la soie: Coopérations et frictionsNo ratings yet
- Gouvernance et planification collaborative: Cinq métropoles canadiennesFrom EverandGouvernance et planification collaborative: Cinq métropoles canadiennesNo ratings yet
- L' ADMINISTRATION DES TERRITOIRES ET LES INSTRUMENTS DE L'ACTION PUBLIQUEFrom EverandL' ADMINISTRATION DES TERRITOIRES ET LES INSTRUMENTS DE L'ACTION PUBLIQUENo ratings yet
- Le LONG DE LA MAIN COSMOPOLITE: Promouvoir, vivre et marcher le boulevard Saint-Laurent à MontréalFrom EverandLe LONG DE LA MAIN COSMOPOLITE: Promouvoir, vivre et marcher le boulevard Saint-Laurent à MontréalNo ratings yet
- Mosaïques du paysage: Pensées et propositions pour la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur le paysageFrom EverandMosaïques du paysage: Pensées et propositions pour la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur le paysageNo ratings yet
- Tournai et Wallonie picarde: Guide d’architecture moderne et contemporaine 1863-2016From EverandTournai et Wallonie picarde: Guide d’architecture moderne et contemporaine 1863-2016No ratings yet
- Montréal et Toronto. Villes intérieures: Villes intérieuresFrom EverandMontréal et Toronto. Villes intérieures: Villes intérieuresNo ratings yet
- La politique territoriale au Québec: 50 ans d'audace, d'hésitations et d'impuissanceFrom EverandLa politique territoriale au Québec: 50 ans d'audace, d'hésitations et d'impuissanceNo ratings yet
- La LA TRACE ET LE RHIZOME - LES MISES EN SCÈNE DU PATRIMOINE CULTURELFrom EverandLa LA TRACE ET LE RHIZOME - LES MISES EN SCÈNE DU PATRIMOINE CULTURELNo ratings yet
- Mobilités : changer de modèle: Solutions pour des déplacements bas carbone et équitablesFrom EverandMobilités : changer de modèle: Solutions pour des déplacements bas carbone et équitablesNo ratings yet
- Bruxelles, Histoire de planifier: Urbanisme aux 19e et 20e sièclesFrom EverandBruxelles, Histoire de planifier: Urbanisme aux 19e et 20e sièclesNo ratings yet
- Décharactérisation Et Dégradation Du Paysage UrbainFrom EverandDécharactérisation Et Dégradation Du Paysage UrbainNo ratings yet
- Les grands projets urbains: Territoires, acteurs et stratégiesFrom EverandLes grands projets urbains: Territoires, acteurs et stratégiesNo ratings yet
- Des ponts interculturels à la rivière Romaine?: Développement nordique et territorialités innuesFrom EverandDes ponts interculturels à la rivière Romaine?: Développement nordique et territorialités innuesNo ratings yet
- La bonne étoile du Lyon Turin: Quand l'Europe nous guide vers la transition écologiqueFrom EverandLa bonne étoile du Lyon Turin: Quand l'Europe nous guide vers la transition écologiqueNo ratings yet
- Non-publics de la culture: Six institutions culturelles de la Mauricie à l'étudeFrom EverandNon-publics de la culture: Six institutions culturelles de la Mauricie à l'étudeNo ratings yet
- L'ingénierie territoriale : Contributions scientifiques à l'amélioration de son efficacité.From EverandL'ingénierie territoriale : Contributions scientifiques à l'amélioration de son efficacité.No ratings yet
- Culture et revitalisation urbaine : le cas du Cinéma Beaubien à MontréalFrom EverandCulture et revitalisation urbaine : le cas du Cinéma Beaubien à MontréalNo ratings yet
- Montréal en évolution: Quatre siècles d’architecture et d’aménagementFrom EverandMontréal en évolution: Quatre siècles d’architecture et d’aménagementNo ratings yet
- Traverser Toronto: Récits urbains et culture matérielle de la traduction théâtraleFrom EverandTraverser Toronto: Récits urbains et culture matérielle de la traduction théâtraleNo ratings yet
- Relations publiques et journalisme à l'ère numérique: Dynamiques de collaboration, de conflit et de consentementFrom EverandRelations publiques et journalisme à l'ère numérique: Dynamiques de collaboration, de conflit et de consentementNo ratings yet
- Aménager des espaces favorables au loisir, au sport et au tourisme: Perspectives théoriques, pragmatiques et réglementairesFrom EverandAménager des espaces favorables au loisir, au sport et au tourisme: Perspectives théoriques, pragmatiques et réglementairesNo ratings yet
- Gérer la communication numérique communale: Guide pratique 2.0 à destination des communesFrom EverandGérer la communication numérique communale: Guide pratique 2.0 à destination des communesNo ratings yet
- Regards interdisciplinaires sur les publics de la cultureFrom EverandRegards interdisciplinaires sur les publics de la cultureNo ratings yet
- Les VILLES NON OCCIDENTALES: Comprendre les enjeux de la diversité urbaineFrom EverandLes VILLES NON OCCIDENTALES: Comprendre les enjeux de la diversité urbaineNo ratings yet
- Itinérance et cohabitation urbaine: Regards, enjeux et stratégies d'actionFrom EverandItinérance et cohabitation urbaine: Regards, enjeux et stratégies d'actionNo ratings yet
- Arrimage Vehicules Roues ChenillesDocument6 pagesArrimage Vehicules Roues ChenillesTarek SetifienNo ratings yet
- نفسية السائقDocument10 pagesنفسية السائقTarek SetifienNo ratings yet
- Bilan Du Programme D'appui Ue-MtDocument41 pagesBilan Du Programme D'appui Ue-MtTarek SetifienNo ratings yet
- النقل الجماعي بحلول فردية المصير المجهولDocument1 pageالنقل الجماعي بحلول فردية المصير المجهولTarek SetifienNo ratings yet
- أطروحة بوجلال تخطيط النقل ودوره في تسويق المدينةDocument298 pagesأطروحة بوجلال تخطيط النقل ودوره في تسويق المدينةTarek SetifienNo ratings yet
- Analyse PerformanceDocument9 pagesAnalyse PerformanceTarek SetifienNo ratings yet
- A 2022024Document40 pagesA 2022024Tarek SetifienNo ratings yet
- Best Solution To Plan and Solve The Problem of TransportationDocument18 pagesBest Solution To Plan and Solve The Problem of TransportationTarek SetifienNo ratings yet
- CODATU Training Programme1Document4 pagesCODATU Training Programme1Tarek SetifienNo ratings yet
- A2019070 PDFDocument28 pagesA2019070 PDFTarek SetifienNo ratings yet
- Edition 2017 04 24Document23 pagesEdition 2017 04 24Tarek SetifienNo ratings yet
- Cahier de References Pour La ConceptionDocument128 pagesCahier de References Pour La ConceptionTarek SetifienNo ratings yet
- إقتصاديات و إدارة النقل الداخليDocument354 pagesإقتصاديات و إدارة النقل الداخليTarek Setifien100% (1)
- Malformations Fœtales Liées Aux InfectionsDocument25 pagesMalformations Fœtales Liées Aux InfectionsTarek SetifienNo ratings yet
- TuberculoseDocument305 pagesTuberculoseTarek Setifien0% (1)
- infections - ب chlamydiaDocument13 pagesinfections - ب chlamydiaTarek SetifienNo ratings yet
- Infections Respiratoires Aigues BassesDocument36 pagesInfections Respiratoires Aigues BassesTarek SetifienNo ratings yet
- Aviso Oficial Del 15-03-2007 Utilizacion de Vehiculos Minivan y VanDocument1 pageAviso Oficial Del 15-03-2007 Utilizacion de Vehiculos Minivan y VanMariela MartinezNo ratings yet
- Investigacion Operativa FinalDocument31 pagesInvestigacion Operativa FinalNoelia Morales caquiNo ratings yet
- North Tyneside NTC PSCM - PSCM WebDocument27 pagesNorth Tyneside NTC PSCM - PSCM WebparkingeconomicsNo ratings yet
- Indg199 Workplace Transport Safety (HSE)Document22 pagesIndg199 Workplace Transport Safety (HSE)kanakarao1No ratings yet
- Bases Conceptuales de La Logística Sanitaria en CatástrofeDocument25 pagesBases Conceptuales de La Logística Sanitaria en CatástrofeJuan Antonio GarcíaNo ratings yet
- The Airbag System For 2-Wheeler VehicleDocument5 pagesThe Airbag System For 2-Wheeler Vehiclekiran kumar gNo ratings yet
- Catálogo MotoresDocument253 pagesCatálogo MotoresNaando Musiic100% (2)
- DPWH Road & Gutter Details PDFDocument10 pagesDPWH Road & Gutter Details PDFRandy Cerna100% (1)
- 02 6261 ELV Datasheet For ElevatorsDocument4 pages02 6261 ELV Datasheet For ElevatorsKaniska Bhattacharya100% (1)
- My Trip: Emirates (EK) 2168Document2 pagesMy Trip: Emirates (EK) 2168roselin sahayamNo ratings yet
- Emerging Role of Bike (Motorcycle) Taxis in Urban Mobility: Discussion PaperDocument28 pagesEmerging Role of Bike (Motorcycle) Taxis in Urban Mobility: Discussion PaperSankalp GahlotNo ratings yet
- Dimensiones Minimas de Puertas y Escaleras, Solicitudes-Vazquez Colin Frida Abigail 3iv12Document11 pagesDimensiones Minimas de Puertas y Escaleras, Solicitudes-Vazquez Colin Frida Abigail 3iv12Isabella LopezNo ratings yet
- Performance Report: Komatsu 1500-7Document14 pagesPerformance Report: Komatsu 1500-7DAnielNo ratings yet
- Minibuseta Serie NPR Reward EIV Buses y Camiones ChevroletDocument1 pageMinibuseta Serie NPR Reward EIV Buses y Camiones ChevroletAlgides Mosta PiazzaNo ratings yet
- Types of Electric VehiclesDocument17 pagesTypes of Electric VehiclesjokerNo ratings yet
- Mapa Funcional Del Sector Mantenimiento AutomotrizDocument4 pagesMapa Funcional Del Sector Mantenimiento AutomotrizJorge Cuadros BlasNo ratings yet
- Free Energy Generation Using FlywheelDocument12 pagesFree Energy Generation Using FlywheelOshan IndrajithNo ratings yet
- Resolucion 1000 Salidas EscolaresDocument21 pagesResolucion 1000 Salidas Escolarescristianmercadoortiz50% (4)
- CRLV SaveiroDocument1 pageCRLV Saveirowellington silvaNo ratings yet
- Arduino Based Automated Braking Control System To Enhance Road SafetyDocument22 pagesArduino Based Automated Braking Control System To Enhance Road SafetyShreya ModiNo ratings yet
- Incoterms-2020 Postera4 LogisberDocument1 pageIncoterms-2020 Postera4 LogisberCristian CapchaNo ratings yet
- Principios Del Transporte.Document4 pagesPrincipios Del Transporte.Jorge Guadamud Garcia100% (1)
- 2008 Audi S4/S4 Avant Quick Reference GuideDocument6 pages2008 Audi S4/S4 Avant Quick Reference GuideAlnazer HaythamNo ratings yet
- Ramp and OperationsDocument126 pagesRamp and OperationsKhushboo VermaNo ratings yet
- 01 Pip Electrificacion Sol RadianteDocument103 pages01 Pip Electrificacion Sol Radiantepamel.rr20No ratings yet
- Serv NYC ProjectDocument9 pagesServ NYC ProjectAnshu BaidyaNo ratings yet
- DistribuidoresDocument43 pagesDistribuidoresJoeny ValeraNo ratings yet
- Sk16pr-A11: Ikh16 Ikh16 Ikh16 Ikh16 Ikh16 Ikh16Document1 pageSk16pr-A11: Ikh16 Ikh16 Ikh16 Ikh16 Ikh16 Ikh16Maxi ElmallianNo ratings yet