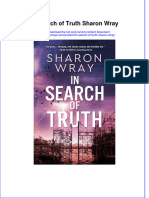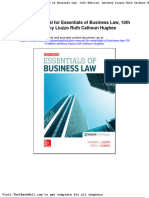Professional Documents
Culture Documents
Foundations of Microeconomics 7Th Edition Bade Solutions Manual Full Chapter PDF
Uploaded by
gabrielthuym96jOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Foundations of Microeconomics 7Th Edition Bade Solutions Manual Full Chapter PDF
Uploaded by
gabrielthuym96jCopyright:
Available Formats
Foundations of Microeconomics 7th
Edition Bade Solutions Manual
Visit to download the full and correct content document: https://testbankdeal.com/dow
nload/foundations-of-microeconomics-7th-edition-bade-solutions-manual/
Chapter
Externalities
CHAPTER OUTLINE
10
I. Explain why negative externalities lead to inefficient overproduction and
how property rights, pollution charges, and taxes can achieve a more
efficient outcome.
A. Externalities in Our Daily Lives
1. Negative Production Externalities
2. Positive Production Externalities
3. Negative Consumption Externalities
4. Positive Consumption Externalities
B. Private Costs and Social Costs
1. Valuing an External Cost
2. External Cost and Output
C. Production and Pollution: How Much?
D. Establish Property Rights
1. Use an Abatement Technology
2. Produce Less and Pollute Less
3. The Coase Theorem
4. Application of the Coase Theorem
5. Efficient Market Equilibrium With Property Rights
E. Mandate Clean Technology
F. Tax or Cap and Price Pollution
1. Taxes
2. Cap-and-Trade
2. Explain why positive externalities lead to inefficient underproduction and
how public provision, subsidies, and vouchers can achieve a more efficient
outcome.
A. Private Benefits and Social Benefits
B. Government Actions in the Face of External Benefits
1. Public Provision
2. Private Subsidies
3. Vouchers
© 2015 Pearson Education, Inc.
154 Part 4 . MARKET FAILURE AND PUBLIC POLICY
◼ What’s New in this Edition?
Chapter 10 features a heavily revised and reorganized sec-
tion on negative externalities, most notably the analysis of
attempts to address inefficiency. Coverage of the Coase the-
orem has been shortened and abatement technology, clean
technology mandates, Pigovian taxes, and cap-and-trade
coverage are more heavily emphasized and expanded.
◼ Where We Are
We use the demand and supply curves to show how exter-
nalities affect the efficient use of resources. We see that ex-
ternal costs result in overproduction and that external bene-
fits result in underproduction. By developing the marginal
social cost curve and marginal social benefit curve, we in-
corporate these external costs and external benefits into the
basic demand-supply graph. Finally, we investigate how the
government intervenes in the market to promote efficient
use of resources.
◼ Where We’ve Been
We’ve explored the interactions of supply and demand that
bring about the efficient use of resources by equating mar-
ginal benefit to marginal cost. We use the concept of efficien-
cy in this chapter to discuss the deadweight loss from exter-
nalities and possible solutions for these inefficiencies.
◼ Where We’re Going
After this chapter, we conclude studying how the govern-
ment influences markets by examining public goods and
common resources.
© 2015 Pearson Education, Inc.
Chapter 10 . Externalities 155
IN THE CLASSROOM
◼ Class Time Needed
You can complete this chapter in one and a half sessions to two class sessions.
This chapter is particularly suitable to the use of current event examples. You can
take one class period to cover the mechanics of the marginal social cost curve,
marginal social benefit curve, and government intervention. Then you can spend
part of the next class period discussing real world examples.
An estimate of the time per checkpoint is:
• 10.1 Negative Externalities: Pollution—60 minutes
• 10.2 Positive Externalities: Education—50 minutes
© 2015 Pearson Education, Inc.
156 Part 4 . MARKET FAILURE AND PUBLIC POLICY
CHAPTER LECTURE
◼ 10.1 Negative Externalities: Pollution
Externalities in Our Daily Lives
• An externality is a cost or benefit that arises from production and falls on someone other
than the producer, or a cost or benefit that arises from consumption and falls on someone
other than the consumer. A negative externality imposes an external cost and a positive
externality creates an external benefit.
❑ Land Mine: To help avoid potential vocabulary confusion, relate the word
“externality” to the more familiar phrases “side effect” or “spillover effect.”
Lecture Launcher: Students quite often are surprised that economists have a lot to say about pol-
lution. Many students think that pollution is a topic handled only by scientists, technicians,
and engineers working in the field. You can point out to your students that in truth econo-
mists have had a lot of influence in the nation’s pollution policies. So, if a student is consider-
ing a career in a pollution related field, he or she might also want to consider economics as a
potential major.
• There are four types of externalities:
• Negative Production Externalities: noise from aircraft and trucks, polluted rivers
and lakes, the destruction of native animal habitat, air pollution in major cities from
auto exhaust.
• Positive Production Externalities: honey and fruit production, in which fruit pro-
duction gets an external benefit from locating bee hives next to a fruit orchard, where
the bees pollinate the trees to boost fruit output and honey production gets an exter-
nal benefit from the orchard trees that generate the pollen necessary for honey pro-
duction.
• Negative Consumption Externalities: smoking in a confined space and posing a
health risk to others, or having noisy parties or loud car stereos that disturb others.
• Positive Consumption Externalities, flu vaccination because everyone who comes
into contact with the person benefits because they are less likely to catch the flu.
Private Costs and Social Costs
• A private cost of production is a cost that is borne by the producer. Marginal private cost
(MC) is the cost of producing an additional unit of a good or service that is borne by the
producer of that good or service.
• An external cost is a cost of producing a good or service that is not borne by the producer
but is born by other people. A marginal external cost is the cost of producing an addi-
tional unit of a good or service that falls on people other than the producer.
• Marginal social cost (MSC) is the marginal cost incurred by the entire society—by the
producer and by everyone else on whom the cost falls—and is the sum of marginal
© 2015 Pearson Education, Inc.
Chapter 10 . Externalities 157
private cost and marginal external cost:
MSC = MC + Marginal external cost.
❑ Land Mine: Have the students consider what is included in the idea of
marginal external costs. Be sure that they understand that external costs are
the costs of either cleaning up the damage caused by the polluting activity
or the extra costs of having to take actions to avoid the damage in the first
place. Emphasize that both actions require payment by people other than
the producer or consumer, which is why the costs are considered external.
This chapter tests students’ graphing abilities with the addition of the marginal social cost curve
and the marginal social benefit curve. Using colored chalk, colored markers on the overhead, or
colored lines on your PowerPoint slides is very helpful in distinguishing these different lines.
Draw the supply (MC) curve for a good, say electricity, that when produced creates pollution.
Remind students that this curve represents the costs paid by the producers to produce one more
unit of the good. Pick a point on the curve and say “To increase the production of electricity one
more unit, the graph shows that the producer must incur a cost of $100 (or whatever price and
quantity you have chosen). If I tell you that the utility is polluting the environment, do we as a
society face a higher cost?” Most students will answer “yes” and you can plot a point higher on
the graph at the same quantity. Do the same analysis for other production points and you now
have a new supply curve, the marginal social cost (MSC) curve. Remind students that the dis-
tance between the curves is the added cost of the pollutants, which is the marginal external cost.
• The figure shows the marginal private
cost curve (MC) and the marginal so-
cial cost curve (MSC) for a good with
an external cost. The vertical distance
between the two curves is the mar-
ginal external cost.
• Because the marginal social cost
includes the marginal external
cost, the marginal social cost ex-
ceeds the marginal private cost
(MSC > MC) for all quantities.
• The efficient quantity of output
occurs where the marginal social
cost equals marginal benefit, that
is, where MSC = MB. In the figure,
the efficient quantity is Q1.
• An unregulated market, however,
produces where the MC = MB
© 2015 Pearson Education, Inc.
158 Part 4 . MARKET FAILURE AND PUBLIC POLICY
(which is equivalent to producing where S = D). In the figure, the unregulated mar-
ket is at Q0. At this level of output, MSC exceeds MB so there is, as illustrated, a
deadweight loss.
Production and Pollution: How Much?
• When an industry is unregulated, the amount of pollution it creates depends upon the
market equilibrium price and quantity of the good produced. But the market outcome is
one of inefficient overproduction (see the deadweight loss in the figure above). In the
pursuit of self-interest, firms produce too much, and pollute too much. Therefore, reduc-
ing the amount of pollution and eliminating the deadweight loss brings potential gains.
Establishing property rights, mandating clean technologies, taxes, or cap-and-trade are
methods available to fix the inefficiency.
Establish Property Rights
• Property rights are legally established titles to the ownership, use, and disposal of fac-
tors of production and goods and services that are enforceable in the courts. Establishing
property rights where they do not currently exist can confront producers with the costs
of their actions and provide them with an incentive to allocate resources efficiently.
• An abatement technology is a production technology that reduces or prevents pollu-
tion.
• A firm can choose to cut production to reduce pollution if the abatement technology
is not cost-effective. Firms will choose the least-cost alternative method of reducing
pollution.
• The Coase theorem is the proposition that if property rights exist and the costs of en-
forcing them are low, then the market outcome is efficient and it doesn’t matter who has
the property rights. The outcome will be efficient whether the property right is given to
the creators of the externality (the polluters) or to the victims.
• If the polluters value the benefits from the activity generating the pollution more
highly than the victims value being free from the pollution, (that is, the cost of reduc-
ing the pollution exceeds the benefit from the reduction) then the efficient outcome is
for the pollution to continue. If polluters are assigned the right to pollute, the victims
are not able to pay enough to convince the polluters to stop. If the victims are as-
signed the property right to be free from pollution, then the polluters are able to pay
the victims sufficient compensation to continue polluting. Either way, the pollution
continues.
• If the victims value the benefits from being free from pollution more highly than the
polluters value the benefits of the pollution, (that is, the benefit from reducing pollu-
tion exceeds the cost of the reduction) then the efficient outcome is for the pollution
to stop. If the polluters are assigned the right to pollute, then the victims are willing
to pay the polluters sufficient compensation to stop the pollution. If the victims are
assigned the right to be free from pollution, then the polluters are not able to pay the
victims enough to allow them to continue polluting. Either way, the pollution stops.
© 2015 Pearson Education, Inc.
Chapter 10 . Externalities 159
• If the cost of reaching an agreement between property owners is too high, so that an
agreement cannot be reached to produce the efficient outcome, government action is
needed.
Mandate Clean Technology
• The government can mandate clean technology be used and regulate the types and amounts
of pollutants emitted. The Environmental Protection Agency has the authority to issue
regulations that limit emissions and achieve air quality standards in the United States.
However, government agencies are typically not effective at finding the least- cost meth-
od for reducing pollution. Profit maximizing firms might be more effective at reducing
pollution at the lowest cost.
Tax or Cap and Price Pollution
• The government can use taxes as an incentive for producers to reduce the pollution they
create. Taxes used in this way are called Pigovian taxes. By taxing an amount equal to the
marginal external cost, the MSC curve becomes the same as the market supply curve.
This moves the market to the efficient quantity and the government collects revenue
from the charge or tax. In the figure above, the appropriate tax equals the length of the
double headed arrow.
• The government can use cap-and-trade to place a cap or ceiling on emissions at the esti-
mated efficient quantity and assign or sell emission rights to individual producers who
are then free to trade permits with each other. The market in permits determines the
price of a permit and firms with a low marginal abatement cost will sell permits and
make big cuts in pollution, while firms with a high marginal abatement cost will buy
permits and make smaller (or no) cuts in pollution. By confronting producers with a price
of pollution, trade in pollution permits can achieve the same efficient outcome as a
Pigovian tax.
◼ 10.2 Positive Externalities: Education
Private Benefits and Social Benefits
• A private benefit is a benefit that the consumer of a good or service receives. Marginal pri-
vate benefit (MB) is the benefit from an additional unit of a good or service that the con-
sumer of that good or service receives.
• An external benefit from a good or service is a benefit that someone other than the con-
sumer receives. A marginal external benefit is the benefit from an additional unit of a
good or service that people other than the consumer enjoy.
• Marginal social benefit (MSB) is the marginal benefit enjoyed by the entire society—by
the consumer and by everyone else who enjoys a benefit—and is the sum of marginal
private benefit and marginal external benefit:
MSB = MB + Marginal external benefit.
© 2015 Pearson Education, Inc.
160 Part 4 . MARKET FAILURE AND PUBLIC POLICY
This chapter tests students’ graphing abilities with the addition of the marginal social benefit
curve. Using colored chalk, colored markers on the overhead, or colored lines on your Power-
Point slides is very helpful in distinguishing between MB and MSB lines.
Draw the demand (marginal benefit) curve for a good, say education, that when consumed cre-
ates external benefits. Remind students that this curve represents the benefit received by con-
sumers from one more unit of education. Pick a point on the curve and say “If a student increases
their consumption of education by one more unit, the graph shows that the student will receive a
private benefit equal to $500 (or whatever price and quantity you have chosen). If I tell you that
the education is also benefitting that student’s coworkers, neighbors, and friends, do we as a so-
ciety face a higher benefit?” Most students will answer “yes” and you can plot a point higher on
the graph at the same quantity. Do the same analysis for other consumption points and you now
have a new benefit curve, the marginal social benefit (MSB) curve.
• The figure shows the marginal pri-
vate benefit curve (MB) and the mar-
ginal social benefit curve (MSB) for a
good with an external benefit. The
vertical distance between the two
curves equals the marginal external
benefit. For instance, the length of the
arrow in the figure equals the mar-
ginal external benefit at the quantity
Q1.
• Because marginal social benefit
includes marginal external bene-
fit, the marginal social benefit ex-
ceeds the marginal private bene-
fit (MSB > MB) for all quantities.
• The efficient quantity of output
occurs where the marginal social
benefit equals marginal cost, that
is, where MSB = MC. In the figure, the efficient quantity is Q1.
• An unregulated market produces where the MC = MB (which is equivalent to pro-
ducing where S = D). In the figure, the unregulated market equilibrium is Q0. At this
level of output, MSB exceeds MC so there is, as illustrated in the figure, a deadweight
loss.
Government Actions in the Face of External Benefits
• Public provision, which is when a public authority that receives its revenue from the
government produces the good or service. (Public schools, colleges, and universities
are examples.) In this case, the government can direct the authority to produce the ef-
ficient quantity.
© 2015 Pearson Education, Inc.
Chapter 10 . Externalities 161
• A subsidy, payment that the government makes to a producer to cover part of the
cost of production, can be used. If the government pays the producer a subsidy equal
to the marginal external benefit, then the quantity produced by the private firm in-
creases to that at which the marginal cost equals the marginal social benefit and an
efficient allocation of resources occurs. In the figure, the correct subsidy is equal to
the length of the double headed arrow.
• A voucher, which is a token that the government provides to households to buy
specified goods or services, can be used. Households receiving a voucher effectively
have a greater income to be used for the specific good or service, which increases
their demand and increases the quantity consumed.
• Both public provision and private subsidies may fail to ultimately provide an effi-
cient outcome due to bureaucratic cost padding and overprovision. Advocates of
vouchers argue that giving financial resources to the consumer rather than the pro-
ducer will produce a more efficient outcome as consumers may monitor performance
more effectively than the government will.
To clarify the effects of the government’s options of using public provision, private subsidies, and
vouchers to deal with external benefits, draw all three options as headings across the board at
one time. Under each heading, start with identical demand and supply curves that result in un-
derproduction. Add the MSB curve in each case. Start with the voucher case first because it is the
simplest and show how the voucher increases demand so that it becomes the same as the MSB
curve. You can then show how a subsidy shifts the supply curve creating the same outcome.
Compare the value of the subsidy with the value of the voucher …it’s the same. Then draw the
public provision case showing how the taxpayer pays the marginal external cost (the same
amount in the two other cases) and produces the efficient amount. Review how each option pro-
duces the same outcome for the same “price” in theory and that it’s just the process to the effi-
cient outcome that differs. After this is established, explore the argument that, in practice, vouch-
ers may actually be more effective at producing the efficient outcome.
© 2015 Pearson Education, Inc.
162 Part 4 . MARKET FAILURE AND PUBLIC POLICY
USING EYE ON THE U.S. ECONOMY
◼ U.S. Air Pollution Trends
This Eye focuses on the three main types of pollution: air, water and land. The
story notes that most types of air pollution have decreased over the past 30 years.
These results show that the cost of reducing some contaminants (lead and sulfur
dioxide) is lower than other contaminants (nitrogen dioxide and ozone). If the
costs were equally low, we would see all types of pollution decrease by similar
percentages. You can ask students when or how they think the most common
types of pollutants will effectively be reduced. Their answers should contain in-
tuition about comparing the opportunity cost of reduction versus pollution and
the ability to assign property rights.
◼ Education Quality: Charter Schools and Vouchers
This Eye introduces students to charter schools, which recently vaulted in notori-
ety after the award-winning 2010 documentary Waiting for Superman, which
chronicles the success of some of the superior charter schools in the U.S. in con-
trast to the more traditional public schools. While not all charter schools produce
high quality education, there is increasing evidence that charter schools can be a
viable option for improving educational quality. How do charter schools pro-
mote competition in the public education system? Is this competition equally
possible in all areas – urban, suburban, and rural? What are the advantages of
having each school design its own educational policy, standards, and curricu-
lum? What are the disadvantages of having each school design its own educa-
tional policy, standards, and curriculum? Ask your students to select and defend
a stance: if they had a choice for themselves between a traditional public school,
a charter school, a private school with a subsidy, or a private school with a
voucher and they knew nothing else about the institution, which would they
choose and why? If they had to choose for the entire country, which system
would be best? Or should it be a combination? Why?
USING EYE ON CLIMATE CHANGE
◼ How Can We Limit Climate Change?
This Eye focuses on the most widely publicized environmental issue (climate
change) and the debates surrounding the dangers of carbon emissions and poli-
cies used to reduce those emissions. Once your students understand that climate
change is essentially a situation of pollution (CO2 emissions) and that climate
change is an externality, ask them their suggested solutions to this issue. Be sure
to keep them focused on how economists approach the problem by developing
© 2015 Pearson Education, Inc.
Chapter 10 . Externalities 163
policies so that the marginal social cost equals the marginal benefit – but estimat-
ing costs and benefits is the source of much debate. One point you might want to
address in the class is the fact that the costs of climate change —and hence the
benefits from preventing it—largely occur in the future and so must be discount-
ed to make them equivalent to today’s costs of preventing climate change. There
is no need to be formal about this issue. You can merely point out that money
today is more valuable than money to be received in the future because money
today can be saved and can reap interest, an option not available with money to
be received in the future.
In order to personalize the issue, ask students how much they are willing to pay
for cleaner air, land, and water. For example, electricity deregulation is supposed
to allow you to choose among various utility providers. Some providers will
claim “clean” production of electricity, while others will offer electricity at the
lowest price. Ask your students which provider they would pick. How many of
those choosing the “green” provider are willing to pay higher prices? How much
higher? Ask your students how many of them buy the “green” paper towels and
napkins in the grocery store. They are usually higher priced and lower quality.
How many of them are willing to give up their cars for public transportation?
These choices represent the opportunity cost of reducing pollution. To compli-
cate the debate, point out that even if scientists, economists, and policymakers
would agree on CO2 emissions’ negative effects and targeted environmental poli-
cy were adopted in the United States, it still might have only a negligible impact
on climate change. As long as developing countries’ governments subsidize the
pollution, actions in the United States will account for a decreasing portion of the
world’s total.
USING EYE ON YOUR LIFE
◼ Externalities in Your Life
This Eye has two interesting examples of government responses to externalities
that occur in virtually every student’s life: the tax imposed on gasoline, which in
part exists because of the external cost from gasoline use, and the subsidies
granted college students, which in part exist because of the external benefit from
education. But it is really important for your students to realize that not all taxes
and not all subsidies exist as a result of externalities. It is easy to think of prod-
ucts that are taxed but have no external costs: cell phone service, and hair styling
are immediate examples. It is similarly easy to think of products that are subsi-
dized and have no external benefits: wheat, tobacco (!), and the 936 subsidies
given to manufacturers who operate in Puerto Rico. Make sure that your stu-
dents realize that taxes and subsidies are generally the result of the political equi-
librium and not reflective of external costs and external benefits.
© 2015 Pearson Education, Inc.
164 Part 4 . MARKET FAILURE AND PUBLIC POLICY
ADDITIONAL EXERCISES FOR ASSIGNMENT
◼ Questions
◼ Checkpoint 10.1 Negative Externalities: Pollution
1. Figure 10.1 illustrates the unregulated mar-
ket for pesticide. When the factories pro-
duce pesticide, they also create waste,
which they dump into a lake on the out-
skirts of the town. The marginal external
cost of the dumped waste is equal to the
marginal private cost of producing the pes-
ticide, so the marginal social cost of produc-
ing the pesticide is double the marginal
private cost. Suppose that the government
issues marketable pollution permits that are
just sufficient to enable the factories to pro-
duce the efficient output of pesticide. The
permits are divided equally between the
townspeople and the factories.
1a. What is the efficient amount of pesticide?
1b. What is the price of a marketable permit?
1c. Who buys permits and who sells permits?
1d. How would the outcome differ if all the permits were allocated to the factories?
1e. How would the outcome differ if all the permits were allocated to the
townspeople?
2. Figure 10.2 shows the marginal cost and
marginal benefit curves facing a small sce-
nic seaside village that has a water-
polluting paper mill next to it.
2a. If property rights are not assigned and the
market is unregulated, how much paper is
produced and what is the price?
2b. If the transactions costs are low and proper-
ty rights to the water are assigned, how
much paper is produced? Does it matter
whether the town or the factory is assigned
the property rights?
2c. If the city wants to tax the factory to achieve
the efficient amount of pollution, what
must the tax be and what is the city’s total
tax revenue from the tax?
© 2015 Pearson Education, Inc.
Chapter 10 . Externalities 165
◼ Checkpoint 10.2 Positive Externalities: Education
3. Obtaining a college education has a mar-
ginal external benefit. Figure 10.3 shows
the market for college education.
3a. What is the efficient number of students?
3b. If the government decides to provide pub-
lic colleges, what must the tuition equal to
attain efficiency? How much of the cost of
a student’s tuition will be funded by taxes
and how much will be paid for by the stu-
dent?
◼ Answers
◼ Checkpoint 10.1 Negative Externalities: Pollution
1a. The efficient quantity is 20 tons a week be-
cause this quantity is where the marginal
benefit curve intersects the marginal social
cost curve, as shown in Figure 10.4.
1b. The price of the permit is $50, the marginal
external cost when 20 tons a week are pro-
duced.
1c. The factory buys the permits and the town
sells the permits.
1d. If the factory received all the permits, the
factory would not sell any permits. The fac-
tory would use the permits to produce the
efficient quantity of pesticide.
1e. If the townspeople received all the permits,
the factory would buy the permits for $50 a
ton.
© 2015 Pearson Education, Inc.
166 Part 4 . MARKET FAILURE AND PUBLIC POLICY
2a. With no property rights and no government intervention, the quantity of
paper is determined by the demand and supply curves and is 60 tons of
paper at a price of $150 a ton.
2b. If property rights to the water are assigned, the efficient amount of paper is
produced, which is 40 tons. The Coase theorem points out that it does not
matter to whom the property rights are assigned.
2c. To attain efficiency, the tax must equal the marginal external cost at the ef-
ficient quantity, which is $100 a ton. With this tax, 40 tons of paper is pro-
duced, so the city collects ($100 a ton) (40 tons), which equals $4,000 a
week in tax revenue.
◼ Checkpoint 10.2 Positive Externalities: Education
3a. The efficient number of students is 12 million because that is the quantity at
which the marginal social benefit, MSB, equals the marginal cost, MC.
3b. To have 12 million students enroll, the demand curve shows that the tuition
must be $2,000 a student. The marginal cost when 12,000 students enroll is
$6,000, so with each student paying $2,000, taxpayers must pay $4,000 a
student.
© 2015 Pearson Education, Inc.
Another random document with
no related content on Scribd:
tant d’hommes habilement masqués, ou cachés dans les coulisses
du théâtre politique; vol qui, fait dans la rue, à la lueur d’un
réverbère, enverrait au bagne un malheureux, mais que sanctionne
l’or des moulures et des candélabres. Diard accaparait et revendait
les sucres, il vendait des places, il eut la gloire d’inventer l’homme
de paille pour les emplois lucratifs qu’il était nécessaire de garder
pendant un certain temps, avant d’en avoir d’autres. Puis, il méditait
les primes, il étudiait le défaut des lois, il faisait une contrebande
légale. Pour peindre d’un seul mot ce haut négoce, il demanda tant
pour cent sur l’achat des quinze voix législatives qui, dans l’espace
d’une nuit, passèrent des bancs de la Gauche aux bancs de la
Droite. Ces actions ne sont plus ni des crimes ni des vols, c’est faire
du gouvernement, commanditer l’industrie, être une tête financière.
Diard fut assis par l’opinion publique sur le banc d’infamie, où
siégeait déjà plus d’un homme habile. Là, se trouve l’aristocratie du
mal. C’est la chambre haute des scélérats de bon ton. Diard ne fut
donc pas un joueur vulgaire que le drame représente ignoble et
finissant par mendier. Ce joueur n’existe plus dans le monde à une
certaine hauteur topographique. Aujourd’hui, ces hardis coquins
meurent brillamment attelés au vice et sous le harnais de la fortune.
Ils vont se brûler la cervelle en carrosse et emportent tout ce dont on
leur a fait crédit. Du moins, Diard eut le talent de ne pas acheter ses
remords au rabais, et se fit un de ces hommes privilégiés. Ayant
appris tous les ressorts du gouvernement, tous les secrets et les
passions des gens en place, il sut se maintenir à son rang dans la
fournaise ardente où il s’était jeté. Madame Diard ignorait la vie
infernale que menait son mari. Satisfaite de l’abandon dans lequel il
la laissait, elle ne s’en étonna pas d’abord, parce que toutes ses
heures furent bien remplies. Elle avait consacré son argent à
l’éducation de ses enfants, à payer un très-habile précepteur et tous
les maîtres nécessaires pour un enseignement complet; elle voulait
faire d’eux des hommes, leur donner une raison droite, sans déflorer
leur imagination; n’ayant plus de sensations que par eux, elle ne
souffrait donc plus de sa vie décolorée, ils étaient, pour elle, ce que
sont les enfants, pendant longtemps, pour beaucoup de mères, une
sorte de prolongement de leur existence. Diard n’était plus qu’un
accident; et depuis que Diard avait cessé d’être le père, le chef de la
famille, Juana ne tenait plus à lui que par les liens de parade
socialement imposés aux époux. Néanmoins, elle élevait ses enfants
dans le plus haut respect du pouvoir paternel, quelque imaginaire
qu’il était pour eux; mais elle fut très-heureusement secondée par la
continuelle absence de son mari. S’il était resté au logis, Diard aurait
détruit les efforts de Juana. Ses enfants avaient déjà trop de tact et
de finesse pour ne pas juger leur père. Juger son père, est un
parricide moral. Cependant, à la longue, l’indifférence de Juana pour
son mari s’effaça. Ce sentiment primitif se changea même en
terreur. Elle comprit un jour que la conduite d’un père peut peser
longtemps sur l’avenir de ses enfants, et sa tendresse maternelle lui
donna parfois des révélations incomplètes de la vérité. De jour en
jour, l’appréhension de ce malheur inconnu, mais inévitable, dans
laquelle elle avait constamment vécu, devenait et plus vive et plus
ardente. Aussi, pendant les rares instants durant lesquels Juana
voyait Diard, jetait-elle sur sa face creusée, blême de nuits passées,
ridée par les émotions, un regard perçant dont la clarté faisait
presque tressaillir Diard. Alors, la gaieté de commande affichée par
son mari l’effrayait encore plus que les sombres expressions de son
inquiétude quand, par hasard, il oubliait son rôle de joie. Il craignait
sa femme comme le criminel craint le bourreau. Juana voyait en lui
la honte de ses enfants; et Diard redoutait en elle la vengeance
calme, une sorte de justice au front serein, le bras toujours levé,
toujours armé.
Après quinze ans de mariage, Diard se trouva un jour sans
ressources. Il devait cent mille écus et possédait à peine cent mille
francs. Son hôtel, son seul bien visible, était grevé d’une somme
d’hypothèques qui en dépassait la valeur. Encore quelques jours, et
le prestige dont l’avait revêtu l’opulence allait s’évanouir. Après ces
jours de grâce, pas une main ne lui serait tendue, pas une bourse ne
lui serait ouverte. Puis, à moins de quelque événement favorable, il
irait tomber dans le bourbier du mépris, plus bas peut-être qu’il ne
devait y être, précisément parce qu’il s’en était tenu à une hauteur
indue. Il apprit heureusement que, durant la saison des Eaux, il se
trouverait à celle des Pyrénées plusieurs étrangers de distinction,
des diplomates, tous jouant un jeu d’enfer, et sans doute munis de
grosses sommes. Il résolut aussitôt de partir pour les Pyrénées.
Mais il ne voulut pas laisser à Paris sa femme, à laquelle quelques
créanciers pourraient révéler l’affreux mystère de sa situation, et il
l’emmena avec ses deux enfants, en leur refusant même le
précepteur. Il ne prit avec lui qu’un valet, et permit à peine à Juana
de garder une femme de chambre. Son ton était devenu bref,
impérieux, il semblait avoir retrouvé de l’énergie. Ce voyage
soudain, dont la cause échappait à sa pénétration, glaça Juana d’un
secret effroi. Son mari fit gaiement la route; et, forcément réunis
dans leur berline, le père se montra chaque jour plus attentif pour les
enfants et plus aimable pour la mère. Néanmoins, chaque jour
apportait à Juana de sinistres pressentiments, les pressentiments
des mères, qui tremblent sans raison apparente, mais qui se
trompent rarement quand elles tremblent ainsi. Pour elles, le voile de
l’avenir semble être plus léger.
A Bordeaux, Diard loua, dans une rue tranquille, une petite
maison tranquille, très-proprement meublée, et y logea sa femme.
Cette maison était située par hasard à un des coins de la rue, et
avait un grand jardin. Ne tenant donc que par un de ses flancs à la
maison voisine, elle se trouvait en vue et accessible de trois côtés.
Diard en paya le loyer, et ne laissa à Juana que l’argent strictement
nécessaire pour sa dépense pendant trois mois; à peine lui donna-t-
il cinquante louis. Madame Diard ne se permit aucune observation
sur cette lésinerie inaccoutumée. Quand son mari lui dit qu’il allait
aux Eaux et qu’elle devait rester à Bordeaux, Juana forma le plan
d’apprendre plus complétement à ses enfants l’espagnol, l’italien, et
de leur faire lire les principaux chefs-d’œuvre de ces deux langues.
Elle allait donc mener une vie retirée, simple et naturellement
économique. Pour s’épargner les ennuis de la vie matérielle, elle
s’arrangea, le lendemain du départ de Diard, avec un traiteur pour
sa nourriture. Sa femme de chambre suffit à son service, et elle se
trouva sans argent, mais pourvue de tout jusqu’au retour de son
mari. Ses plaisirs devaient consister à faire quelques promenades
avec ses enfants. Elle avait alors trente-trois ans. Sa beauté,
largement développée, éclatait dans tout son lustre. Aussi, quand
elle se montra, ne fut-il question dans Bordeaux que de la belle
Espagnole. A la première lettre d’amour qu’elle reçut, Juana ne se
promena plus que dans son jardin. Diard fit d’abord fortune aux
Eaux; il gagna trois cent mille francs en deux mois, et ne songea
point à envoyer de l’argent à sa femme, il voulait en garder
beaucoup pour jouer encore plus gros jeu. A la fin du dernier mois,
vint aux Eaux le marquis de Montefiore, déjà précédé par la célébrité
de sa fortune, de sa belle figure, de son heureux mariage avec une
illustre Anglaise, et plus encore par son goût pour le jeu. Diard, son
ancien compagnon, voulut l’y attendre, dans l’intention d’en joindre
les dépouilles à celles de tous les autres. Un joueur armé de quatre
cent mille francs environ est toujours dans une position d’où il
domine la vie, et Diard, confiant en sa veine, renoua connaissance
avec Montefiore; celui-ci le reçut froidement, mais ils jouèrent, et
Diard perdit tout ce qu’il possédait.
—Mon cher Montefiore, dit l’ancien quartier-maître après avoir
fait le tour du salon, quand il eut achevé de se ruiner, je vous dois
cent mille francs; mais mon argent est à Bordeaux, où j’ai laissé ma
femme.
Diard avait bien les cent billets de banque dans sa poche; mais
avec l’aplomb et le coup d’œil rapide d’un homme accoutumé à faire
ressource de tout, il espérait encore dans les indéfinissables
caprices du jeu. Montefiore avait manifesté l’intention de voir
Bordeaux. En s’acquittant, Diard n’avait plus d’argent, et ne pouvait
plus prendre sa revanche. Une revanche comble quelquefois toutes
les pertes précédentes. Néanmoins, ces brûlantes espérances
dépendaient de la réponse du marquis.
—Attends, mon cher, dit Montefiore, nous irons ensemble à
Bordeaux. En conscience, je suis assez riche aujourd’hui pour ne
pas vouloir prendre l’argent d’un ancien camarade.
Trois jours après, Diard et l’Italien étaient à Bordeaux. L’un offrit
revanche à l’autre. Or, pendant une soirée, où Diard commença par
payer ses cent mille francs, il en perdit deux cent mille autres sur sa
parole. Le Provençal était gai comme un homme habitué à prendre
des bains d’or. Onze heures venaient de sonner, le ciel était
superbe, Montefiore devait éprouver autant que Diard le besoin de
respirer sous le ciel et de faire une promenade pour se remettre de
leurs émotions, celui-ci lui proposa donc de venir prendre son argent
et une tasse de thé chez lui.
—Mais madame Diard, dit Montefiore.
—Bah! fit le Provençal.
Ils descendirent; mais avant de prendre son chapeau, Diard entra
dans la salle à manger de la maison où il était, et demanda un verre
d’eau; pendant qu’on le lui apprêtait, il se promena de long en large,
et put, sans être aperçu, saisir un de ces couteaux d’acier très-petits,
pointus et à manche de nacre, qui servent à couper les fruits au
dessert, et qui n’avaient pas encore été rangés.
—Où demeures-tu? lui demanda Montefiore dans la cour. Il faut
que j’envoie ma voiture à ta porte.
Diard indiqua parfaitement bien sa maison.
—Tu comprends, lui dit Montefiore à voix basse en lui prenant le
bras, que tant que je serai avec toi je n’aurai rien à craindre; mais si
je revenais seul, et qu’un vaurien me suivît, je serais très-bon à tuer.
—Qu’as-tu donc sur toi?
—Oh! presque rien, répondit le défiant Italien. Je n’ai que mes
gains. Cependant ils feraient encore une jolie fortune à un gueux qui,
certes, aurait un bon brevet d’honnête homme pour le reste de ses
jours.
Diard conduisit l’Italien par une rue déserte où il avait remarqué
une maison dont la porte se trouvait au bout d’une espèce d’avenue
garnie d’arbres, et bordée de hautes murailles très-sombres. En
arrivant à cet endroit, il eut l’audace de prier militairement Montefiore
d’aller en avant. Montefiore comprit Diard et voulut lui tenir
compagnie. Alors, aussitôt qu’ils eurent tous deux mis le pied dans
cette avenue, Diard, avec une agilité de tigre, renversa le marquis
par un croc-en-jambe donné à l’articulation intérieure des genoux, lui
mit hardiment le pied sur la gorge, et lui enfonça le couteau à
plusieurs reprises dans le cœur, où la lame se cassa. Puis il fouilla
Montefiore, lui prit portefeuille, argent, tout. Quoique Diard y allât
avec une rage lucide, avec une prestesse de filou; quoiqu’il eût très-
habilement surpris l’Italien, Montefiore avait eu le temps de crier:—A
l’assassin! à l’assassin! d’une voix claire et perçante qui dut remuer
les entrailles des gens endormis. Ses derniers soupirs furent des cris
horribles. Diard ne savait pas que, au moment où ils entrèrent dans
l’avenue, un flot de gens sortis des théâtres où le spectacle était fini
se trouvèrent en haut de la rue, et entendirent le râle du mourant,
quoique le Provençal tâchât d’étouffer la voix en appuyant plus
fortement le pied sur la gorge de Montefiore, et en fît graduellement
cesser les cris. Ces gens se mirent donc à courir en se dirigeant
vers l’avenue, dont les hautes murailles, répercutant les cris, leur
indiquèrent l’endroit précis où se commettait le crime. Leurs pas
retentirent dans la cervelle de Diard. Mais ne perdant pas encore la
tête, l’assassin quitta l’avenue et sortit dans la rue, en marchant très-
doucement, comme un curieux qui aurait reconnu l’inutilité des
secours. Il se retourna même pour bien juger de la distance qui
pouvait le séparer des survenants, il les vit se précipitant dans
l’allée, à l’exception de l’un d’eux, qui, par une précaution toute
naturelle, se mit à observer Diard.
—C’est lui! c’est lui! crièrent les gens entrés dans l’allée,
lorsqu’ils aperçurent Montefiore étendu, la porte de l’hôtel fermée, et
qu’ils eurent tout fouillé sans rencontrer l’assassin.
Aussitôt que cette clameur eut retenti, Diard, se sentant de
l’avance, trouva l’énergie du lion et les bonds du cerf, il se mit à
courir ou mieux à voler. A l’autre bout de la rue, il vit ou crut voir une
masse de monde, et alors il se jeta dans une rue transversale. Mais
déjà toutes les croisées s’ouvraient, et à chaque croisée surgissaient
des figures; à chaque porte partaient et des cris et des lueurs. Et
Diard de se sauver, allant devant lui, courant au milieu des lumières
et du tumulte; mais ses jambes étaient si activement agiles, qu’il
devançait le tumulte, sans néanmoins pouvoir se soustraire aux
yeux qui embrassaient encore plus rapidement l’étendue qu’il ne
l’envahissait par sa course. Habitants, soldats, gendarmes, tout dans
le quartier fut sur pied en un clin d’œil. Des officieux éveillèrent les
commissaires, d’autres gardèrent le corps. La rumeur allait en
s’envolant et vers le fugitif qui l’entraînait avec lui comme une
flamme d’incendie, et vers le centre de la ville où étaient les
magistrats. Diard avait toutes les sensations d’un rêve à entendre
ainsi une ville entière hurlant, courant, frissonnant. Cependant il
conservait encore ses idées et sa présence d’esprit, il s’essuyait les
mains le long des murs. Enfin, il atteignit le mur du jardin de sa
maison. Croyant avoir dépisté les poursuites, il se trouvait dans un
endroit parfaitement silencieux, où néanmoins parvenait encore le
lointain murmure de la ville, semblable au mugissement de la mer. Il
puisa de l’eau dans un ruisseau et la but. Voyant un tas de pavés de
rebut, il y cacha son trésor, en obéissant à une de ces vagues
pensées qui arrivent aux criminels, au moment où, n’ayant plus la
faculté de juger de l’ensemble de leurs actions, ils sont pressés
d’établir leur innocence sur quelque manque de preuves. Cela fait, il
tâcha de prendre une contenance placide, essaya de sourire, et
frappa doucement à la porte de sa maison, en espérant n’avoir été
vu de personne. Il leva les yeux, et aperçut, à travers les persiennes,
la lumière des bougies qui éclairaient la chambre de sa femme.
Alors, au milieu de son trouble, les images de la douce vie de Juana,
assise entre ses fils, vinrent lui heurter le crâne comme s’il y eût reçu
un coup de marteau. La femme de chambre ouvrit la porte, que
Diard referma vivement d’un coup de pied. En ce moment, il respira;
mais alors, il s’aperçut qu’il était en sueur, il resta dans l’ombre et
renvoya la servante près de Juana. Il s’essuya le visage avec son
mouchoir, mit ses vêtements en ordre comme un fat qui déplisse son
habit avant d’entrer chez une jolie femme; puis il vint à la lueur de la
lune pour examiner ses mains et se tâter le visage; il eut un
mouvement de joie en voyant qu’il n’avait aucune tache de sang,
l’épanchement s’était sans doute fait dans le corps même de la
victime. Mais cette toilette de criminel prit du temps. Il monta chez
Juana, dans un maintien calme, posé, comme peut l’être celui d’un
homme qui revient se coucher après être allé au spectacle. En
gravissant les marches de l’escalier, il put réfléchir à sa position, et
la résuma en deux mots: sortir et gagner le port. Ces idées il ne les
pensa pas, il les trouvait écrites en lettres de feu dans l’ombre. Une
fois au port, se cacher pendant le jour, revenir chercher le trésor à la
nuit; puis se mettre, comme un rat, à fond de cale d’un bâtiment, et
partir sans que personne ne se doutât qu’il fût dans ce vaisseau.
Pour tout cela, de l’or avant toute chose! Et il n’avait rien. La femme
de chambre vint l’éclairer.
—Félicie, lui dit-il, n’entendez-vous pas du bruit dans la rue, des
cris; allez en savoir la cause, vous me la direz...
Vêtue de ses blancs ajustements de nuit, sa femme était assise à
une table, et faisait lire Francisque et Juan dans un Cervantes
espagnol, où tous deux suivaient le texte pendant qu’elle le leur
prononçait à haute voix. Ils s’arrêtèrent tous trois et regardèrent
Diard qui restait debout, les mains dans ses poches, étonné peut-
être de se trouver dans le calme de cette scène, si douce de lueur,
embellie par les figures de cette femme et de ces deux enfants.
C’était un tableau vivant de la Vierge entre son fils et saint Jean.
—Juana, j’ai quelque chose à te dire.
—Qu’y a-t-il? demanda-t-elle en devinant sous la pâleur jaune de
son mari le malheur qu’elle avait attendu chaque jour.
—Ce n’est rien, mais je voudrais te parler... à toi... seule.
Et il regarda fixement ses deux fils.
—Mes chers petits, allez dans votre chambre et couchez-vous,
dit Juana. Dites vos prières sans moi.
Les deux fils sortirent en silence et avec l’incurieuse obéissance
des enfants bien élevés.
—Ma chère Juana, reprit Diard d’une voix caressante, je t’ai
laissé bien peu d’argent, et j’en suis désolé maintenant. Écoute,
depuis que je t’ai ôté les soucis de ta maison en te donnant une
pension, n’aurais-tu pas fait, comme toutes les femmes, quelques
petites économies?
—Non, répondit Juana, je n’ai rien. Vous n’aviez pas compté les
frais de l’éducation de vos enfants. Je ne vous le reproche point,
mon ami, et ne vous rappelle cette omission que pour vous expliquer
mon manque d’argent. Tout celui que vous m’avez donné m’a servi
pour payer les maîtres, et...
—Assez, s’écria Diard brusquement. Sacré tonnerre! le temps
est précieux. N’avez-vous pas des bijoux?
—Vous savez bien que je n’en ai jamais porté.
—Il n’y a donc pas un sou ici, cria Diard avec frénésie.
—Pourquoi criez-vous, dit-elle.
—Juana, reprit-il, je viens de tuer un homme.
Juana sauta vers la chambre de ses enfants, et en revint après
avoir fermé toutes les portes.
—Que vos fils n’entendent rien, dit-elle. Mais avec qui donc avez-
vous pu vous battre?
—Avec Montefiore, répondit-il.
—Ah! dit-elle, en laissant échapper un soupir, c’est le seul
homme que vous eussiez le droit de tuer...
—Beaucoup de raisons voulaient qu’il mourût de ma main. Mais
ne perdons pas de temps. De l’argent, de l’argent, de l’argent, au
nom de Dieu! Je puis être poursuivi. Nous ne nous sommes pas
battus, je l’ai... tué.
—Tué! s’écria-t-elle. Et comment...
—Mais, comme on tue; il m’avait volé toute ma fortune au jeu,
moi, je la lui ai reprise. Vous devriez, Juana, pendant que tout est
tranquille, puisque nous n’avons pas d’argent, aller chercher le mien
sous ce tas de pierres que vous savez, ce tas qui est au bout de la
rue.
—Allons, dit Juana, vous l’avez volé.
—Qu’est-ce que cela vous fait? Ne faut-il pas que je m’en aille?
Avez-vous de l’argent? Ils sont sur mes traces!
—Qui?
—Les juges!
Juana sortit et revint brusquement.
—Tenez, dit-elle, en lui tendant à distance un bijou, voilà la croix
de dona Lagounia. Il y a quatre rubis de grande valeur, m’a-t-on dit.
Allez, partez, partez... partez donc!
—Félicie ne revient point, dit-il avec stupeur. Serait-elle donc
arrêtée?
Juana laissa la croix au bord de la table, et s’élança vers les
fenêtres qui donnaient sur la rue. Là, elle vit, à la lueur de la lune,
des soldats qui se plaçaient, dans le plus grand silence, le long des
murs. Elle revint en affectant d’être calme, et dit à son mari:—Vous
n’avez pas une minute à perdre, il faut fuir par le jardin. Voici la clef
de la petite porte.
Par un reste de prudence, elle alla cependant jeter un coup d’œil
sur le jardin. Dans l’ombre, sous les arbres, elle aperçut alors
quelques lueurs produites par le bord argenté des chapeaux de
gendarmes. Elle entendit même la rumeur vague de la foule, attirée
par la curiosité, mais qu’une sentinelle contenait aux différents bouts
des rues par lesquelles elle affluait. En effet, Diard avait été vu par
les gens qui s’étaient mis à leurs fenêtres. Bientôt, sur leurs
indications, sur celles de sa servante que l’on avait effrayée, puis
arrêtée, les troupes et le peuple avaient barré les deux rues, à
l’angle desquelles était située la maison. Une douzaine de
gendarmes revenus du théâtre l’ayant cernée, d’autres grimpaient
par dessus les murs du jardin et le fouillaient, autorisés par la
flagrance du crime.
—Monsieur, dit Juana, vous ne pouvez plus sortir. Toute la ville
est là.
Diard courut aux fenêtres avec la folle activité d’un oiseau
enfermé qui se heurte à toutes les clartés. Il alla et vint à chaque
issue. Juana resta debout, pensive.
—Où puis-je me cacher? dit-il.
Il regardait la cheminée, et Juana contemplait les deux chaises
vides. Depuis un moment, pour elle, ses enfants étaient là. En cet
instant la porte de la rue s’ouvrit, et un bruit de pas nombreux retentit
dans la cour.
—Juana, ma chère Juana, donnez-moi donc, par grâce, un bon
conseil.
—Je vais vous en donner un, dit-elle, et vous sauver.
—Ah! tu seras mon bon ange.
Juana revint, tendit à Diard un de ses pistolets, et détourna la
tête. Diard ne prit pas le pistolet. Juana entendit le bruit de la cour,
où l’on déposait le corps du marquis pour le confronter avec
l’assassin, elle se retourna, vit Diard pâle et blême. Cet homme se
sentait défaillir et voulait s’asseoir.
—Vos enfants vous en supplient, lui dit-elle, en lui mettant l’arme
sur les mains.
—Mais, ma bonne Juana, ma petite Juana, tu crois donc que...
Juana? Cela est-il bien pressé... Je voudrais t’embrasser.
Les gendarmes montaient les marches de l’escalier. Juana reprit
alors le pistolet, ajusta Diard, le maintint malgré ses cris en le
saisissant à la gorge, lui fit sauter la cervelle, et jeta l’arme par terre.
En ce moment la porte s’ouvrit brusquement. Le procureur du roi,
suivi d’un juge, d’un médecin, d’un greffier, les gendarmes, enfin
toute la Justice humaine apparut.
—Que voulez-vous? dit-elle.
—Est-ce là monsieur Diard? répondit le procureur du roi, en
montrant le corps courbé en deux.
—Oui, monsieur.
—Votre robe est pleine de sang, madame.
—Ne comprenez-vous pas pourquoi? dit Juana.
Elle alla s’asseoir à la petite table où elle prit le volume de
Cervantes, et resta pâle, dans une agitation nerveuse tout intérieure
qu’elle tâcha de contenir.
—Sortez, dit le magistrat aux gendarmes.
Puis il fit un signe au juge d’instruction et au médecin, qui
demeurèrent.
—Madame, en cette occasion, nous n’avons qu’à vous féliciter
de la mort de votre mari. Du moins, s’il a été égaré par la passion, il
sera mort en militaire, et rend inutile l’action de la justice. Mais quel
que soit notre désir de ne pas vous troubler en un semblable
moment, la loi nous oblige de constater toute mort violente.
Permettez-nous de faire notre devoir.
—Puis-je aller changer de robe? demanda-t-elle en posant le
volume.
—Oui, madame; mais vous la rapporterez ici. Le docteur en aura
sans doute besoin...
—Il serait trop pénible à madame de me voir et de m’entendre
opérer, dit le médecin qui comprit les soupçons du magistrat.
Messieurs, permettez-lui de demeurer dans la chambre voisine.
Les magistrats approuvèrent le charitable médecin, et alors
Félicie alla servir sa maîtresse. Le juge et le procureur du roi se
mirent à causer à voix basse. Les magistrats sont bien malheureux
d’être obligés de tout soupçonner, de tout concevoir. A force de
supposer des intentions mauvaises et de les comprendre toutes
pour arriver à des vérités cachées sous les actions les plus
contradictoires, il est impossible que l’exercice de leur épouvantable
sacerdoce ne dessèche pas à la longue la source des émotions
généreuses qu’ils sont contraints de mettre en doute. Si les sens du
chirurgien qui va fouillant les mystères du corps finissent par se
blaser, que devient la conscience du juge obligé de fouiller
incessamment les replis de l’âme? Premiers martyrs de leur mission,
les magistrats marchent toujours en deuil de leurs illusions perdues,
et le crime ne pèse pas moins sur eux que sur les criminels. Un
vieillard assis sur un tribunal est sublime, mais un juge jeune ne fait-
il pas frémir? Or, ce juge d’instruction était jeune, et il fut obligé de
dire au procureur du roi:—Croyez-vous que la femme soit complice
du mari? Faut-il instruire contre elle? Êtes-vous d’avis de
l’interroger?
Le procureur du roi répondit en faisant un geste d’épaules fort
insouciant.
—Montefiore et Diard, ajouta-t-il, étaient deux mauvais sujets
connus. La femme de chambre ne savait rien du crime. Restons-en
là.
Le médecin opérait, visitait Diard, et dictait son procès-verbal au
greffier. Tout à coup il s’élança dans la chambre de Juana.
—Madame...
Juana, ayant déjà quitté sa robe ensanglantée, vint au-devant du
docteur.
—C’est vous, lui dit-il, en se penchant à l’oreille de l’Espagnole,
qui avez tué votre mari.
—Oui, monsieur.
... Et, de cet ensemble de faits... continua le médecin en dictant,
il résulte pour nous que le nommé Diard s’est volontairement et lui-
même donné la mort.
—Avez-vous fini? demanda-t-il au greffier après une pause.
—Oui, dit le scribe.
Le médecin signa, Juana lui jeta un regard, en réprimant avec
peine des larmes qui lui humectèrent passagèrement les yeux.
—Messieurs, dit-elle au procureur du roi, je suis étrangère,
Espagnole. J’ignore les lois, je ne connais personne à Bordeaux, je
réclame de vous un bon office. Faites-moi donner un passe-port
pour l’Espagne...
—Un instant, s’écria le juge d’instruction. Madame, qu’est
devenue la somme volée au marquis de Montefiore?
—Monsieur Diard, répondit-elle, m’a parlé vaguement d’un tas de
pierres sous lequel il l’aurait cachée.
—Où?
—Dans la rue.
Les deux magistrats se regardèrent. Juana laissa échapper un
geste sublime et appela le médecin.
—Monsieur, lui dit-elle à l’oreille, serais-je donc soupçonnée de
quelque infamie? moi! Le tas de pierres doit être au bout de mon
jardin. Allez-y vous-même, je vous en prie. Voyez, visitez, trouvez
cet argent.
Le médecin sortit en emmenant le juge d’instruction, et ils
retrouvèrent le portefeuille de Montefiore.
Le surlendemain, Juana vendit sa croix d’or pour subvenir aux
frais de son voyage. En se rendant avec ses deux enfants à la
diligence qui allait la conduire aux frontières de l’Espagne, elle
s’entendit appeler dans la rue, sa mère mourante était conduite à
l’hôpital; et, par la fente des rideaux du brancard sur lequel on la
portait, elle avait aperçu sa fille. Juana fit entrer le brancard sous
une porte cochère. Là, eut lieu la dernière entrevue entre la mère et
la fille. Quoique toutes deux s’entretinssent à voix basse, Juan
entendit ces mots d’adieu:
—Mourez en paix, ma mère, j’ai souffert pour vous toutes!
Paris, novembre 1832.
ADIEU.
AU PRINCE FRÉDÉRIC SCHWARZENBERG.
—Allons, député du centre, en avant! Il s’agit d’aller au pas
accéléré si nous voulons être à table en même temps que les autres.
Haut le pied! Saute, marquis! là donc! bien. Vous franchissez les
sillons comme un véritable cerf!
Ces paroles étaient prononcées par un chasseur paisiblement
assis sur une lisière de la forêt de l’Isle-Adam, et qui achevait de
fumer un cigare de la Havane en attendant son compagnon, sans
doute égaré depuis longtemps dans les halliers de la forêt. A ses
côtés, quatre chiens haletants regardaient comme lui le personnage
auquel il s’adressait. Pour comprendre combien étaient railleuses
ces allocutions répétées par intervalles, il faut dire que le chasseur
était un gros homme court dont le ventre proéminent accusait un
embonpoint véritablement ministériel. Aussi arpentait-il avec peine
les sillons d’un vaste champ récemment moissonné, dont les
chaumes gênaient considérablement sa marche; puis, pour surcroît
de douleur, les rayons du soleil qui frappaient obliquement sa figure
y amassaient de grosses gouttes de sueur. Préoccupé par le soin de
garder son équilibre, il se penchait tantôt en avant, tantôt en arrière,
en imitant ainsi les soubresauts d’une voiture fortement cahotée. Ce
jour était un de ceux qui, pendant le mois de septembre, achèvent
de mûrir les raisins par des feux équatoriaux. Le temps annonçait un
orage. Quoique plusieurs grands espaces d’azur séparassent
encore vers l’horizon de gros nuages noirs, on voyait des nuées
blondes s’avancer avec une effrayante rapidité, en étendant, de
l’ouest à l’est, un léger rideau grisâtre. Le vent, n’agissant que dans
la haute région de l’air, l’atmosphère comprimait vers les bas-fonds
les brûlantes vapeurs de la terre. Entouré de hautes futaies qui le
privaient d’air, le vallon que franchissait le chasseur avait la
température d’une fournaise. Ardente et silencieuse, la forêt semblait
avoir soif. Les oiseaux, les insectes étaient muets, et les cimes des
arbres s’inclinaient à peine. Les personnes auxquelles il reste
quelque souvenir de l’été de 1819, doivent donc compatir aux maux
du pauvre ministériel, qui suait sang et eau pour rejoindre son
compagnon moqueur. Tout en fumant son cigare, celui-ci avait
calculé, par la position du soleil, qu’il pouvait être environ cinq
heures du soir.
—Où diable sommes-nous? dit le gros chasseur en s’essuyant le
front et s’appuyant contre un arbre du champ, presque en face de
son compagnon; car il ne se sentit plus la force de sauter le large
fossé qui l’en séparait.
—Et c’est à moi que tu le demandes, répondit en riant le
chasseur couché dans les hautes herbes jaunes qui couronnaient le
talus. Il jeta le bout de son cigare dans le fossé, en s’écriant:—Je
jure par saint Hubert qu’on ne me reprendra plus à m’aventurer dans
un pays inconnu avec un magistrat, fût-il comme toi, mon cher
d’Albon, un vieux camarade de collége!
—Mais, Philippe, vous ne comprenez donc plus le français? Vous
avez sans doute laissé votre esprit en Sibérie, répliqua le gros
homme en lançant un regard douloureusement comique sur un
poteau qui se trouvait à cent pas de là.
—J’entends! répondit Philippe qui saisit son fusil, se leva tout à
coup, s’élança d’un seul bond dans le champ, et courut vers le
poteau.—Par ici, d’Albon, par ici! demi-tour à gauche, cria-t-il à son
compagnon en lui indiquant par un geste une large voie pavée.
Chemin de Baillet à l’Ile-Adam! reprit-il, ainsi nous trouverons dans
cette direction celui de Cassan, qui doit s’embrancher sur celui de
l’Ile-Adam.
—C’est juste, mon colonel, dit monsieur d’Albon en remettant sur
sa tête une casquette avec laquelle il venait de s’éventer.
—En avant donc, mon respectable conseiller, répondit le colonel
Philippe en sifflant les chiens qui semblaient déjà lui mieux obéir
qu’au magistrat auquel ils appartenaient.
—Savez-vous, monsieur le marquis, reprit le militaire goguenard,
que nous avons encore plus de deux lieues à faire? Le village que
nous apercevons là-bas doit être Baillet.
—Grand Dieu! s’écria le marquis d’Albon, allez à Cassan, si cela
peut vous être agréable, mais vous irez tout seul. Je préfère attendre
ici, malgré l’orage, un cheval que vous m’enverrez du château. Vous
vous êtes moqué de moi, Sucy. Nous devions faire une jolie petite
partie de chasse, ne pas nous éloigner de Cassan, fureter sur les
terres que je connais. Bah! au lieu de nous amuser, vous m’avez fait
courir comme un lévrier depuis quatre heures du matin, et nous
n’avons eu pour tout déjeuner que deux tasses de lait! Ah! si vous
avez jamais un procès à la Cour, je vous le ferai perdre, eussiez-
vous cent fois raison.
Le chasseur découragé s’assit sur une des bornes qui étaient au
pied du poteau, se débarrassa de son fusil, de sa carnassière vide,
et poussa un long soupir.
—France! voilà tes députés, s’écria en riant le colonel de Sucy.
Ah! mon pauvre d’Albon, si vous aviez été comme moi six ans au
fond de la Sibérie...
Il n’acheva pas et leva les yeux au ciel, comme si ses malheurs
étaient un secret entre Dieu et lui.
—Allons! marchez! ajouta-t-il. Si vous restez assis, vous êtes
perdu.
—Que voulez-vous, Philippe? c’est une si vieille habitude chez
un magistrat! D’honneur, je suis excédé! Encore si j’avais tué un
lièvre!
Les deux chasseurs présentaient un contraste assez rare. Le
ministériel était âgé de quarante-deux ans et ne paraissait pas en
avoir plus de trente, tandis que le militaire, âgé de trente ans,
semblait en avoir au moins quarante. Tous deux étaient décorés de
la rosette rouge, attribut des officiers de la Légion d’honneur.
Quelques mèches de cheveux, mélangées de noir et de blanc
comme l’aile d’une pie, s’échappaient de dessous la casquette du
colonel; de belles boucles blondes ornaient les tempes du magistrat.
L’un était d’une haute taille, sec, maigre, nerveux, et les rides de sa
figure blanche trahissaient des passions terribles ou d’affreux
malheurs; l’autre avait un visage brillant de santé, jovial et digne d’un
épicurien. Tous deux étaient fortement hâlés par le soleil, et leurs
longues guêtres de cuir fauve portaient les marques de tous les
fossés, de tous les marais qu’ils avaient traversés.
—Allons, s’écria monsieur de Sucy, en avant! Après une petite
heure de marche nous serons à Cassan, devant une bonne table.
—Il faut que vous n’ayez jamais aimé, répondit le conseiller d’un
air piteusement comique, vous êtes aussi impitoyable que l’article
304 du Code pénal!
Philippe de Sucy tressaillit violemment; son large front se plissa;
sa figure devint aussi sombre que l’était le ciel en ce moment.
Quoiqu’un souvenir d’une affreuse amertume crispât tous ses traits,
il ne pleura pas. Semblable aux hommes puissants, il savait refouler
ses émotions au fond de son cœur, et trouvait peut-être, comme
beaucoup de caractères purs, une sorte d’impudeur à dévoiler ses
peines quand aucune parole humaine n’en peut rendre la
profondeur, et qu’on redoute la moquerie des gens qui ne veulent
pas les comprendre. Monsieur d’Albon avait une de ces âmes
délicates qui devinent les douleurs et ressentent vivement la
commotion qu’elles ont involontairement produite par quelque
maladresse. Il respecta le silence de son ami, se leva, oublia sa
fatigue, et le suivit silencieusement, tout chagrin d’avoir touché une
plaie qui probablement n’était pas cicatrisée.
—Un jour, mon ami, lui dit Philippe en lui serrant la main et en le
remerciant de son muet repentir par un regard déchirant, un jour je
te raconterai ma vie. Aujourd’hui, je ne saurais.
Ils continuèrent à marcher en silence. Quand la douleur du
colonel parut dissipée, le conseiller retrouva sa fatigue; et avec
l’instinct ou plutôt avec le vouloir d’un homme harassé, son œil
sonda toutes les profondeurs de la forêt; il interrogea les cimes des
arbres, examina les avenues, en espérant y découvrir quelque gîte
où il pût demander l’hospitalité. En arrivant à un carrefour, il crut
apercevoir une légère fumée qui s’élevait entre les arbres. Il s’arrêta,
regarda fort attentivement, et reconnut, au milieu d’un massif
immense, les branches vertes et sombres de quelques pins.
—Une maison! une maison! s’écria-t-il avec le plaisir qu’aurait eu
un marin à crier: Terre! terre!
Puis il s’élança vivement à travers un hallier assez épais, et le
colonel, qui était tombé dans une profonde rêverie, l’y suivit
machinalement.
—J’aime mieux trouver ici une omelette, du pain de ménage et
une chaise, que d’aller chercher à Cassan des divans, des truffes et
du vin de Bordeaux.
Ces paroles étaient une exclamation d’enthousiasme arrachée
au conseiller par l’aspect d’un mur dont la couleur blanchâtre
tranchait, dans le lointain, sur la masse brune des troncs noueux de
la forêt.
—Ah! ah! ceci m’a l’air d’être quelque ancien prieuré, s’écria
derechef le marquis d’Albon en arrivant à une grille antique et noire,
d’où il put voir, au milieu d’un parc assez vaste, un bâtiment construit
dans le style employé jadis pour les monuments monastiques.—
Comme ces coquins de moines savaient choisir un emplacement!
Cette nouvelle exclamation était l’expression de l’étonnement
que causait au magistrat le poétique ermitage qui s’offrait à ses
regards. La maison était située à mi-côte, sur le revers de la
montagne, dont le sommet est occupé par le village de Nerville. Les
grands chênes séculaires de la forêt, qui décrivait un cercle
immense autour de cette habitation, en faisaient une véritable
solitude. Le corps de logis jadis destiné aux moines avait son
exposition au midi. Le parc paraissait avoir une quarantaine
d’arpents. Auprès de la maison, régnait une verte prairie,
heureusement découpée par plusieurs ruisseaux clairs, par des
nappes d’eau gracieusement posées, et sans aucun artifice
apparent. Çà et là s’élevaient des arbres verts aux formes élégantes,
aux feuillages variés. Puis, des grottes habilement ménagées, des
terrasses massives avec leurs escaliers dégradés et leurs rampes
rouillées imprimaient une physionomie particulière à cette sauvage
Thébaïde. L’art y avait élégamment uni ses constructions aux plus
pittoresques effets de la nature. Les passions humaines semblaient
devoir mourir aux pieds de ces grands arbres qui défendaient
l’approche de cet asile aux bruits du monde, comme ils y
tempéraient les feux du soleil.
—Quel désordre! se dit monsieur d’Albon après avoir joui de la
sombre expression que les ruines donnaient à ce paysage, qui
paraissait frappé de malédiction. C’était comme un lieu funeste
abandonné par les hommes. Le lierre avait étendu partout ses nerfs
tortueux et ses riches manteaux. Des mousses brunes, verdâtres,
jaunes ou rouges répandaient leurs teintes romantiques sur les
arbres, sur les bancs, sur les toits, sur les pierres. Les fenêtres
vermoulues étaient usées par la pluie, creusées par le temps; les
balcons étaient brisés, les terrasses démolies. Quelques persiennes
ne tenaient plus que par un de leurs gonds. Les portes disjointes
paraissaient ne pas devoir résister à un assaillant. Chargées des
touffes luisantes du guy, les branches des arbres fruitiers négligés
s’étendaient au loin sans donner de récolte. De hautes herbes
croissaient dans les allées. Ces débris jetaient dans le tableau des
effets d’une poésie ravissante, et des idées rêveuses dans l’âme du
spectateur. Un poëte serait resté là plongé dans une longue
mélancolie, en admirant ce désordre plein d’harmonies, cette
destruction qui n’était pas sans grâce. En ce moment, quelques
rayons de soleil se firent jour à travers les crevasses des nuages,
illuminèrent par des jets de mille couleurs cette scène à demi
sauvage. Les tuiles brunes resplendirent, les mousses brillèrent, des
ombres fantastiques s’agitèrent sur les prés, sous les arbres; des
couleurs mortes se réveillèrent, des oppositions piquantes se
combattirent, les feuillages se découpèrent dans la clarté. Tout à
coup, la lumière disparut. Ce paysage qui semblait avoir parlé, se
tut, et redevint sombre, ou plutôt doux comme la plus douce teinte
d’un crépuscule d’automne.
You might also like
- Foundations of Microeconomics 6Th Edition Bade Test Bank Full Chapter PDFDocument67 pagesFoundations of Microeconomics 6Th Edition Bade Test Bank Full Chapter PDFgabrielthuym96j100% (11)
- Foundations of Mems 2Nd Edition Chang Liu Solutions Manual Full Chapter PDFDocument32 pagesFoundations of Mems 2Nd Edition Chang Liu Solutions Manual Full Chapter PDFgabrielthuym96j100% (10)
- Foundations of Marketing 8Th Edition Pride Solutions Manual Full Chapter PDFDocument48 pagesFoundations of Marketing 8Th Edition Pride Solutions Manual Full Chapter PDFgabrielthuym96j100% (10)
- Foundations of Maternal Newborn and Womens Health Nursing 7Th Edition Murray Test Bank Full Chapter PDFDocument41 pagesFoundations of Maternal Newborn and Womens Health Nursing 7Th Edition Murray Test Bank Full Chapter PDFgabrielthuym96j100% (11)
- Foundations of Marketing 5Th Edition Pride Test Bank Full Chapter PDFDocument56 pagesFoundations of Marketing 5Th Edition Pride Test Bank Full Chapter PDFwilliamvanrqg100% (9)
- Foundations of Marketing 6Th Edition Pride Solutions Manual Full Chapter PDFDocument58 pagesFoundations of Marketing 6Th Edition Pride Solutions Manual Full Chapter PDFwilliamvanrqg100% (9)
- Global 2Nd Edition Mike Peng Solutions Manual Full Chapter PDFDocument32 pagesGlobal 2Nd Edition Mike Peng Solutions Manual Full Chapter PDFmary.ratliff248100% (14)
- Foundations of Macroeconomics 8Th Edition Bade Solutions Manual Full Chapter PDFDocument36 pagesFoundations of Macroeconomics 8Th Edition Bade Solutions Manual Full Chapter PDFwilliamvanrqg100% (11)
- Foundations of Marketing 6Th Edition Pride Test Bank Full Chapter PDFDocument68 pagesFoundations of Marketing 6Th Edition Pride Test Bank Full Chapter PDFwilliamvanrqg100% (13)
- Framework For Marketing Management Global 6Th Edition Kotler Solutions Manual Full Chapter PDFDocument33 pagesFramework For Marketing Management Global 6Th Edition Kotler Solutions Manual Full Chapter PDFWilliamThomasbpsg100% (9)
- Global Business Today 10Th Edition Hill Test Bank Full Chapter PDFDocument36 pagesGlobal Business Today 10Th Edition Hill Test Bank Full Chapter PDFjean.mcguire430100% (14)
- Download The Institutionalisation Of Evaluation In The Americas Reinhard Stockmann full chapterDocument67 pagesDownload The Institutionalisation Of Evaluation In The Americas Reinhard Stockmann full chapterjoann.lamb584100% (12)
- Foundations of Macroeconomics 7Th Edition Bade Solutions Manual Full Chapter PDFDocument33 pagesFoundations of Macroeconomics 7Th Edition Bade Solutions Manual Full Chapter PDFwilliamvanrqg100% (10)
- Principles of Finance 6Th Edition Besley Test Bank Full Chapter PDFDocument36 pagesPrinciples of Finance 6Th Edition Besley Test Bank Full Chapter PDFvernon.yang315100% (15)
- Download Missing The Target Why Stock Market Short Termism Is Not The Problem Mark J Roe full chapterDocument67 pagesDownload Missing The Target Why Stock Market Short Termism Is Not The Problem Mark J Roe full chaptermargaret.mendez801100% (10)
- Foundations of Macroeconomics 8Th Edition Bade Test Bank Full Chapter PDFDocument67 pagesFoundations of Macroeconomics 8Th Edition Bade Test Bank Full Chapter PDFwilliamvanrqg100% (11)
- Download Fashion Marketing In Emerging Economies Volume Ii South American Asian And African Perspectives Palgrave Studies Of Marketing In Emerging Economies 1St Ed 2023 Edition Frederica Brooksworth full chapterDocument51 pagesDownload Fashion Marketing In Emerging Economies Volume Ii South American Asian And African Perspectives Palgrave Studies Of Marketing In Emerging Economies 1St Ed 2023 Edition Frederica Brooksworth full chapterantonia.connor789100% (12)
- Solution Manual For Managerial Economics 4Th Edition Froeb Mccann Ward Shor 1305259335 978130525933 Full Chapter PDFDocument25 pagesSolution Manual For Managerial Economics 4Th Edition Froeb Mccann Ward Shor 1305259335 978130525933 Full Chapter PDFlisa.ellis353100% (13)
- Foundations of Macroeconomics 6Th Edition Bade Test Bank Full Chapter PDFDocument67 pagesFoundations of Macroeconomics 6Th Edition Bade Test Bank Full Chapter PDFwilliamvanrqg100% (11)
- Download A Concise Public Speaking Handbook 6Th Edition Steven A Beebe full chapterDocument67 pagesDownload A Concise Public Speaking Handbook 6Th Edition Steven A Beebe full chapteralfred.jessie484100% (5)
- Global Business Today 10Th Edition Hill Solutions Manual Full Chapter PDFDocument36 pagesGlobal Business Today 10Th Edition Hill Solutions Manual Full Chapter PDFjean.mcguire430100% (14)
- Essentials of Contemporary Management 9Th Edition Full ChapterDocument41 pagesEssentials of Contemporary Management 9Th Edition Full Chapterwilliam.millard192100% (27)
- Fraud Examination 3Rd Edition Albrecht Solutions Manual Full Chapter PDFDocument41 pagesFraud Examination 3Rd Edition Albrecht Solutions Manual Full Chapter PDFDawnCalderonkxne100% (10)
- Download Herders Philosophy Michael N Forster full chapterDocument67 pagesDownload Herders Philosophy Michael N Forster full chapterstephanie.hannon764100% (13)
- Solution Manual For Managerial Decision Modeling With Spreadsheets 3Rd Edition Balakrishnan Render Stair 0136115837 9780136115830 Full Chapter PDFDocument24 pagesSolution Manual For Managerial Decision Modeling With Spreadsheets 3Rd Edition Balakrishnan Render Stair 0136115837 9780136115830 Full Chapter PDFlisa.ellis353100% (10)
- Franchising 4Th Edition Judd Test Bank Full Chapter PDFDocument22 pagesFranchising 4Th Edition Judd Test Bank Full Chapter PDFariadnemarthaauva100% (9)
- Principles of Finance 6Th Edition Besley Solutions Manual Full Chapter PDFDocument36 pagesPrinciples of Finance 6Th Edition Besley Solutions Manual Full Chapter PDFvernon.yang315100% (12)
- Download Inclusive Banking In India Re Imagining The Bank Business Model 1St Ed 2021 Edition Lalitagauri Kulkarni full chapterDocument67 pagesDownload Inclusive Banking In India Re Imagining The Bank Business Model 1St Ed 2021 Edition Lalitagauri Kulkarni full chapterthomas.leggett699100% (4)
- Solution Manual For Managerial Accounting Tools For Business Decision Making 7Th Edition Weygandt Kimmel Kieso 978111833433 Full Chapter PDFDocument36 pagesSolution Manual For Managerial Accounting Tools For Business Decision Making 7Th Edition Weygandt Kimmel Kieso 978111833433 Full Chapter PDFlisa.ellis353100% (12)
- Download Weird Ir Deviant Cases In International Relations David Bell Mislan all chapterDocument67 pagesDownload Weird Ir Deviant Cases In International Relations David Bell Mislan all chapterjanice.faupel319100% (11)
- Download The Ai Revolution In Medicine Gpt 4 And Beyond Peter Lee full chapterDocument67 pagesDownload The Ai Revolution In Medicine Gpt 4 And Beyond Peter Lee full chapterrobert.lee850100% (6)
- Management 16E 16Th Edition Stephen P Robbins download pdf chapterDocument51 pagesManagement 16E 16Th Edition Stephen P Robbins download pdf chaptermichael.haynes469100% (10)
- Download Contemporary World History 7Th Edition William J Duiker full chapterDocument67 pagesDownload Contemporary World History 7Th Edition William J Duiker full chaptermarilyn.lapage696100% (3)
- Download Fundamentals Of Corporate Finance 3Rd Edition David Hillier full chapterDocument67 pagesDownload Fundamentals Of Corporate Finance 3Rd Edition David Hillier full chapterray.strubbe795100% (7)
- Experience Human Development 12Th Edition Papalia Test Bank Full Chapter PDFDocument43 pagesExperience Human Development 12Th Edition Papalia Test Bank Full Chapter PDFglendalaeliaqm5lr9100% (12)
- Basic Geriatric Nursing 8Th Edition Patricia A Williams full chapterDocument51 pagesBasic Geriatric Nursing 8Th Edition Patricia A Williams full chapterbenita.grimm191100% (2)
- Download The Peoples Dance The Power And Politics Of Guangchang Wu 1St Ed Edition Rose Martin full chapterDocument67 pagesDownload The Peoples Dance The Power And Politics Of Guangchang Wu 1St Ed Edition Rose Martin full chapterrosemarie.mooney373100% (6)
- Download Physical Geography 11Th Edition Petersen all chapterDocument67 pagesDownload Physical Geography 11Th Edition Petersen all chapterkevin.roberts692100% (4)
- Download Contemporaneous Event Studies In Corporate Finance Methods Critiques And Robust Alternative Approaches 1St Ed Edition Jau Lian Jeng full chapterDocument68 pagesDownload Contemporaneous Event Studies In Corporate Finance Methods Critiques And Robust Alternative Approaches 1St Ed Edition Jau Lian Jeng full chaptersharon.dunnagan654100% (5)
- Download Talking Sociology Dipankar Gupta In Conversation With Ramin Jahanbegloo Ramin Jahanbegloo full chapterDocument67 pagesDownload Talking Sociology Dipankar Gupta In Conversation With Ramin Jahanbegloo Ramin Jahanbegloo full chapterrandy.bohannon602100% (7)
- Download Probability And Statistical Inference 3Rd Edition Magdalena Niewiadomska Bugaj all chapterDocument67 pagesDownload Probability And Statistical Inference 3Rd Edition Magdalena Niewiadomska Bugaj all chapterduane.henry420100% (4)
- Download Total Burn Care 5Th Edition David N Herndon all chapterDocument67 pagesDownload Total Burn Care 5Th Edition David N Herndon all chapterrichard.thomas647100% (7)
- Download The Authority Of Female Speech In Indian Goddess Traditions Devi And Womansplaining 1St Ed Edition Anway Mukhopadhyay full chapterDocument68 pagesDownload The Authority Of Female Speech In Indian Goddess Traditions Devi And Womansplaining 1St Ed Edition Anway Mukhopadhyay full chaptersean.schwipps177100% (3)
- Endoscopic Surgery Of The Orbit 1St Edition Raj Sindwani full chapterDocument51 pagesEndoscopic Surgery Of The Orbit 1St Edition Raj Sindwani full chapterrandolph.mason687100% (3)
- Teacher Leadership For Social Justice Building A Curriculum For Liberation Revised First Ed Edition Full ChapterDocument41 pagesTeacher Leadership For Social Justice Building A Curriculum For Liberation Revised First Ed Edition Full Chapterjamie.nettles908100% (29)
- Making Meritocracy Lessons From China And India From Antiquity To The Present Tarun Khanna download pdf chapterDocument51 pagesMaking Meritocracy Lessons From China And India From Antiquity To The Present Tarun Khanna download pdf chapterrobert.doughtie960100% (10)
- Ethics and Business Decision MakingDocument36 pagesEthics and Business Decision Makingdora.perkins798100% (11)
- In Search Of Truth Sharon Wray full chapterDocument51 pagesIn Search Of Truth Sharon Wray full chapterdianne.garcia634100% (3)
- Download Electrocardiography In Ischemic Heart Disease Clinical And Imaging Correlations And Prognostic Implications Second Edition Bayes De Luna full chapterDocument68 pagesDownload Electrocardiography In Ischemic Heart Disease Clinical And Imaging Correlations And Prognostic Implications Second Edition Bayes De Luna full chaptermyrtle.leverenz833100% (7)
- Framework For Human Resource Management 7Th Edition Gary Dessler Solutions Manual Full Chapter PDFDocument39 pagesFramework For Human Resource Management 7Th Edition Gary Dessler Solutions Manual Full Chapter PDFWilliamThomasbpsg100% (11)
- Learning And Development Effectiveness In Organisations An Integrated Systems Informed Model Of Effectiveness 1St Ed Edition Thomas N Garavan full chapterDocument52 pagesLearning And Development Effectiveness In Organisations An Integrated Systems Informed Model Of Effectiveness 1St Ed Edition Thomas N Garavan full chapterlula.zimmer403100% (7)
- Download Contemporary Research In Accounting And Finance Case Studies From The Mena Region Abdelghani Echchabi full chapterDocument77 pagesDownload Contemporary Research In Accounting And Finance Case Studies From The Mena Region Abdelghani Echchabi full chaptermarilyn.lapage696100% (4)
- Human Resource Management Essential Perspectives 7Th Edition Mathis Solutions Manual Full Chapter PDFDocument43 pagesHuman Resource Management Essential Perspectives 7Th Edition Mathis Solutions Manual Full Chapter PDFannjohnsonpdieokmsaf100% (6)
- Download Advances In The Practice Of Public Investment Management 1St Ed Edition Narayan Bulusu full chapterDocument67 pagesDownload Advances In The Practice Of Public Investment Management 1St Ed Edition Narayan Bulusu full chapterteresa.vanhorn907100% (4)
- Download Eating Disorders And Child Sexual Abuse 1St Edition Lisa Hodge full chapterDocument67 pagesDownload Eating Disorders And Child Sexual Abuse 1St Edition Lisa Hodge full chaptereve.sampson314100% (6)
- Test Bank For Methods in Behavioral Research 12Th Edition Cozby Bates 0077861892 9780077861896 Full Chapter PDFDocument36 pagesTest Bank For Methods in Behavioral Research 12Th Edition Cozby Bates 0077861892 9780077861896 Full Chapter PDFpauline.ganley829100% (12)
- Download Mission Race And Empire The Episcopal Church In Global Context Jennifer C Snow full chapterDocument67 pagesDownload Mission Race And Empire The Episcopal Church In Global Context Jennifer C Snow full chaptermargaret.mendez801100% (12)
- Download Financial Accounting I Revised Fourth Edition Mohammed Hanif full chapterDocument55 pagesDownload Financial Accounting I Revised Fourth Edition Mohammed Hanif full chaptercarol.germann781100% (13)
- Download Democracy Inside Participatory Innovation In Unlikely Places Albert W Dzur full chapterDocument67 pagesDownload Democracy Inside Participatory Innovation In Unlikely Places Albert W Dzur full chapterrodney.walker793100% (14)
- Essential Foundations of Economics 8th Edition Bade Solutions ManualDocument17 pagesEssential Foundations of Economics 8th Edition Bade Solutions Manualtannagemesodermh4ge100% (19)
- Solution Manual For Financial Accounting 16th Edition Carl Warren Christine Jonick Jennifer SchneiderDocument45 pagesSolution Manual For Financial Accounting 16th Edition Carl Warren Christine Jonick Jennifer Schneidergabrielthuym96j96% (28)
- Solution Manual For Ethical Obligations and Decision Making in Accounting Text and Cases 4th EditionDocument30 pagesSolution Manual For Ethical Obligations and Decision Making in Accounting Text and Cases 4th Editiongabrielthuym96j100% (16)
- Solution Manual For Essentials of Business Law 10th Edition Anthony Liuzzo Ruth Calhoun Hughes Full DownloadDocument11 pagesSolution Manual For Essentials of Business Law 10th Edition Anthony Liuzzo Ruth Calhoun Hughes Full Downloadtracyherrerabqgyjwormf100% (34)
- Solution Manual For Essentials of Meteorology An Invitation To The Atmosphere 7th EditionDocument9 pagesSolution Manual For Essentials of Meteorology An Invitation To The Atmosphere 7th Editiongabrielthuym96j100% (20)
- Planning and Optimal Control Policy Gradient MethodsDocument34 pagesPlanning and Optimal Control Policy Gradient MethodscosmicduckNo ratings yet
- CAMBRIDGE IGCSE (0478-0984) 3.3 Secondary StorageDocument10 pagesCAMBRIDGE IGCSE (0478-0984) 3.3 Secondary Storageangle5858zhaoNo ratings yet
- ABB TZIDC CatalogueDocument32 pagesABB TZIDC CataloguesizmaruNo ratings yet
- Assignmnet, Textile PhysicsDocument6 pagesAssignmnet, Textile PhysicsAbu Mukarram AZADNo ratings yet
- SYNPOL D Service Manual E V20!09!05Document60 pagesSYNPOL D Service Manual E V20!09!05auto etrustNo ratings yet
- (9781783475537 - The Neuroscience of Organizational Behavior) IntroductionDocument4 pages(9781783475537 - The Neuroscience of Organizational Behavior) IntroductionMiguelNo ratings yet
- Riva, Anna - Secrets of Magical Seals A Modern Grimoire of Amulets, Charms, Symbols and TalismansDocument35 pagesRiva, Anna - Secrets of Magical Seals A Modern Grimoire of Amulets, Charms, Symbols and Talismansbondogoof83% (12)
- Wooldridge ExampleDocument4 pagesWooldridge Examplejomarta01No ratings yet
- Pipeline and Piping RepairDocument18 pagesPipeline and Piping RepairkhoerulNo ratings yet
- The Role of Studying Abroad in Attitudes Towards Immigration A European Context Yakup Öz, Enes GökDocument21 pagesThe Role of Studying Abroad in Attitudes Towards Immigration A European Context Yakup Öz, Enes GökSTAR ScholarsNo ratings yet
- Nitrogen Blanketing For Storage and TransportationDocument5 pagesNitrogen Blanketing For Storage and TransportationHoang-Vu BuiNo ratings yet
- Histogram: Nonparametric Kernel Density EstimationDocument19 pagesHistogram: Nonparametric Kernel Density Estimationsabeeh iqbalNo ratings yet
- 3 - Green Synthesis of A Fluorescent Natural Product PDFDocument3 pages3 - Green Synthesis of A Fluorescent Natural Product PDFjavier roo ror100% (1)
- The Effect of Talent Retention and Employee Engagement On The Performance of Study Employees at Automotive Companies in South SulawesiDocument4 pagesThe Effect of Talent Retention and Employee Engagement On The Performance of Study Employees at Automotive Companies in South SulawesiInternational Journal of Innovative Science and Research TechnologyNo ratings yet
- English written preparation for Dhaka University admission test (DUDocument7 pagesEnglish written preparation for Dhaka University admission test (DUShanian Ahmed100% (3)
- (Haus & Melcher) Electromagnetic Fields and EnergyDocument863 pages(Haus & Melcher) Electromagnetic Fields and EnergyFlavio AbreuNo ratings yet
- Berrcom JXB-178 Non-Contact Infrared Digital Thermometer Quick Start GuideDocument1 pageBerrcom JXB-178 Non-Contact Infrared Digital Thermometer Quick Start GuidehhhhNo ratings yet
- Exercise No. 1 The Compound MicroscopeDocument16 pagesExercise No. 1 The Compound MicroscopeAndRenNo ratings yet
- Sample Narrative Report and Documentation 2024 InsetDocument3 pagesSample Narrative Report and Documentation 2024 InsetWILSON CASTRONo ratings yet
- 10.design 3D Steel Frame ViewDocument21 pages10.design 3D Steel Frame ViewPanha PorNo ratings yet
- EN 1340:2003/AC: European Standard Norme Européenne Europäische NormDocument14 pagesEN 1340:2003/AC: European Standard Norme Européenne Europäische NormAsmir Softic100% (1)
- Automotive Lighting System SimulatorDocument14 pagesAutomotive Lighting System SimulatorAllan LariosaNo ratings yet
- AP Greenfield Electronics Cluster EIA ReportDocument283 pagesAP Greenfield Electronics Cluster EIA ReportNUTHI SIVA SANTHANNo ratings yet
- Activities guide and evaluation rubric - Unit 3 - Task 4 - Oral Production - Voices in Motion (1)Document7 pagesActivities guide and evaluation rubric - Unit 3 - Task 4 - Oral Production - Voices in Motion (1)Darleison VergelNo ratings yet
- TPL5010 Nano-Power System Timer With Watchdog Function: 1 Features 3 DescriptionDocument27 pagesTPL5010 Nano-Power System Timer With Watchdog Function: 1 Features 3 Descriptionelfak.2000No ratings yet
- Service Manual Selenia Dimensions V1.8 Rev 3Document418 pagesService Manual Selenia Dimensions V1.8 Rev 3IMEEDCO SRL100% (1)
- The Construction of Self-Made Freaks: Interviews with the Vampire WomanDocument68 pagesThe Construction of Self-Made Freaks: Interviews with the Vampire WomanAdriano LeoneNo ratings yet
- Carlo Gavazzi Small CatDocument226 pagesCarlo Gavazzi Small CatkcraussNo ratings yet
- Determine Crop Water Needs from Soil SamplesDocument7 pagesDetermine Crop Water Needs from Soil SamplesFaris AhmadNo ratings yet
- Keywords: Waste, Environment, Makassar, TPA AntangDocument5 pagesKeywords: Waste, Environment, Makassar, TPA AntangWahidin Alamnuari RachmanNo ratings yet