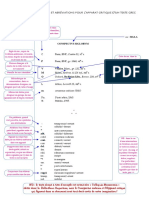Professional Documents
Culture Documents
Injonctif Et Subjonctif Dans Les Gāthās de L'avesta
Injonctif Et Subjonctif Dans Les Gāthās de L'avesta
Uploaded by
Georgios Tsamouras0 ratings0% found this document useful (0 votes)
17 views16 pagesOriginal Title
injonctif et subjonctif dans les Gāthās de l'Avesta
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
17 views16 pagesInjonctif Et Subjonctif Dans Les Gāthās de L'avesta
Injonctif Et Subjonctif Dans Les Gāthās de L'avesta
Uploaded by
Georgios TsamourasCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 16
JERZY KURYLOWICZ.
Injonctif et subjonctif
dans les Gathas de I'Avesta.
I. Injonctif.
Les formes définies par Bartholomae (Grundriss der iran.
Phil. 1., 1., p. 56, § 103 note) comme celles du prétérit,
jouent dans les Gathas de |’Avesta des réles trés variés.
Pour éviter I’Gquivoque on se servira dans cet article du terme
injonctif ce qui veut dire tout simplement que la forme en
question consiste en un théme présent/aoriste + désinence se~
condaire. On dira, par contre, que |'injonctif a la valeur d’un
passé ou d’un futur ou d’un présent (dans le sens le plus large
du mot) ou enfin une valeur modale (ordre, désir).
Car c’est toujours d’une de ces quatre maniéres qu'il nous
faut rendre l'injonctif en traduisant les Gathas. La traduction
de Bartholomae, critiquée et corrigée dans les détails, mais
solide dans son ensemble, nous montre qu’aucune de ces
quatre valeurs de l’injonctif n’est exceptionnelle.
Dés 1885 (KZ XXVII, p. 173) M. Thurneysen a avancé
Yidée que Vinjonctif représentait la couche la plus ancienne
du systéme verbal indoeuropéen. Il aurait été originairement
purement attributif, c’est-a-dire il attribuait 4 une per-
sonne une action ou un état, comme on lui attribue une qualité;
aucune notion de temps ne s’y mélait. Peu a peu cette masse
amorphe aurait dégagé, par différentiation, des formes de présent
(i), d’impératif (p. e. -u), de passé (augment). L’aoriste gno-
mique grec représente (abstraction faite de la question d’aspect)
ce qui reste aprés ces pertes successives: Il'ancienne valeur
attributive n’ayant rien de commun avec une expression de
temps quelconque.
INJONCTIF ET SUBJONCTIF DANS L'AVESTA 165
En face de cette théorie plausible, quoique non susceptible
d'une démonstration précise, "hypothése de MM, Streitberg et
Hirt (IF XII, p. 212 ss.) manque de vraisemblance. Les dif-
férentes valeurs de Vinjonctif se seraient développées, d’aprés
eux, dans les thémes aoristiques seulement et de la facon
suivante: “indicatif d’un théme perfectif” > “futur” > “modalité”.
Cette hypothése, disons-nous, a peu de probabilité, d’abord parce
que nous ne savons pas si l’opposition de présent et d’aoriste
telle qu’elle suppose est assez ancienne pour entrer en ligne
de compte, ensuite puisqu’un théme perfectif qui prenait la
valeur de futur justement en vertu de sa perfectivité, n'aurait
pas pris en méme temps la valeur d’un passé. Et ce passé.
doit étre, lui aussi, ancien, puisqu’il se présente sous une forme
identique & celle du futur (c’est-a-dire sans augment) en
gathique et en védique. Enfin la modalité (désir, ordre) est
mieux attestée que le futur dont elle se serait développée
Ainsi p. e. en védique ce chainon intermédiaire, le futur,
manque.
Les valeurs variées de l'injonctif gathique résultent du
contexte et c'est seulement le contexte qui rend possible
la fixation de la valeur d’un injonctif. Une forme dadat Pe.
se traduit en latin, suivant les cas, “creabat”, “creet”, “creabit”,
“creat”. Elle équivaut, en somme, & une phrase nominale
composée d’un pronom personel -+ un nom d’agent oit la forme
de la copule se définit par l’entourage. “ille-creans” ou »creator”.
Le temps n’est exprimé que la ow c’est stricte-
ment nécessaire. C’est ce que nous montre une comparaison
des phrases nominales avec les phrases contenant un injonctif.
1° Valeur de passé
A. Phrase nominale.
Y. 34, 13 mizdam mazda yehya ta datram “la récompense,
© Mazda, que tu as fixé (cuius tu constitutor)”.
La promesse de Ja récompense fait partie de la révélation
qui est le point de départ de I’activité de Zoroastre. Une dé-
termination de temps n’était donc point nécessaire.
51, 12 noit ta im x3ndus vaepyo kavind parats zamo “l’amant
du Kavi ne V’a pas contenté au seuil de I’hiver”.
166 JERZY KURYLOWICZ
La valeur temporelle de passé résulte de la phrase sub-
ordonnée oit I’on a: hyat ahmi uriraost ato “quand il lui a re-
fusé son hospitalité” (ururaost azata (dja-) conformément 4 la régle.
46, 1 kata twa mazda xinaosai ahura: mais x$naosai ne vaut que 2
syllabes, car wa compte pour deux syllabes, comme a Y 46,3; 46, 9.")
7) On pourrait naturellement admettre que le second hémistiche (mazda
xSnaosai ahura) est correct et le premier seulement fautif (kala twa).
INJONCTIF ET SUBJONCTIF DANS L'AVESTA 173
49, 12 ya va staolai mazda frinai ahura (frinai 2 syllabes).
On attendrait 3 syllabes (<*) prind-ai).
En somme on a 40 exemples favorables en face d’un seul
exemple contraire. La régle peut donc passer pour prouvée.
* Quant aux désinences on ne trouve & la 2-éme pers. de
Yactif que les désinences primaires -hi, Na (dahi 53, 9; otéayaa
46, 15; azada 50, 7). De méme la 1-ére pers. du sing. ne con-
nait que la désinence primaire -a (14 exemples; et aussi, avec
adjonction d’une particule: -ani; 9 exemples). L’unique exemple
de la 3-éme pers. du duel (jamaete 44, 15) présente une dési-
nence primaire. On trouve deux exemples de la 1-ére pers. du
pluriel, dont I’un avec la désinence primaire -mahi (joamahi 31,
2), autre avec la désinence secondaire -ma (44, 13 (ni3jna-
3ama). — Ne présentent une alternance bien attestée entre dé-
sinences primaires et désinences secondaires que les 3-&mes
personnes de l’actif. On trouve dans les Gathas:
Dés. primaires Dés. secondaires
Actif 3-éme pers. sing. 21 51
a » plur. 3 12
Le manque de désinences secondaires pour la 2-éme pers.
sing. n’est qu’un accident. L’Avesta récent nous présente
aphé = ind. asas, lat. eris; paya, cf. ind. jays (Grundriss 1, 1,
p. 59). On a donc le droit de conclure que 18 ot les deux
classes de désinences se distinguent par la
présence et l'absence de “i”, c’est-a-dire. 8 le 2-8me,
3-éme pers. sing. et & la 3-8me pers. du pluriel®), le sub-
jonctif peut présenter et les désinences pri-
maires et les désinences secondaires. On ne
saurait décider si l’alternance naiama — joamahi (cf. plus
dessus) est due au fait que Vindoiranien a introduit l’-7 aussi
a Ia 1-ére pers. du pluriel en créant ainsi une alfernance sem-
blable & -t/-ti etc.; ou si joamahi, forme unique dans tout
VAvesta (les autres subjonctif n'ont que -ma) est tout simple~
®) La premiére personne du sing. ne connait Valternance -m/-mi
& Vindicatif que pour une partie de verbes, &@ savoir pour les verbes
athématiques. Dans la classe thémathique c’est ~@ qui est la désinence
primaire regulitre en gathique et en indoeuropéen (6).
174 JERZY KURYLOWICZ
ment une forme d’indicatif. Cette derniére possibilité nous
semble plus probable.
Jusqu’ici il n’a été question que des désinences actives.
On a vu qu'on y rencontre une forte majorité de désinences
secondaires. Au moyen les choses se passent tout autrement.
Désinences primaires:
21 exemples de 1-ére pers. sing. (dont 2 cas
avec -né, paralléle au -ni de l’actif)
1 exemple de 2° pers. sing.
10 exemples, 3° ,, »
8 i 7 or ne eplure
Désinences secondaires:
2 exemples de 1° pers. sing.
2 » » Fy on
Ce qui frappe d’abord c’est le manque total de désinences
secondaires pour la 3-éme pers. du pluriel et le rapport de dé-
sinences primairés aux désinences secondaires dans les 3-émes
pers. (sing. et plur.). Il est 18:2 au moyen et 24:63 4 I'actif.
Il y a mieux encore. De ces deux exemples (darasata
30, 1; mainyata 45, 11) darasata est tout a fait hypothétique:
il pourrait représenter un participe passif futur (féminin), Gr. |,
1, p. 110, ou méme un aoriste radical thémathique (injonctif).")
Il ne reste donc qu’un exemple différent pour tout I’Avesta;
car dans |’Avesta récent on ne trouve que Jes désinences pri-
maires au moyen du subjonctif. Et la proportion établie ci-
dessus (18:2 en face de 24:63) nous autorise d’affirmer qu’au
moyen le subjonctif ne connait que les désinences primaires.
mainyala qui est inattaquable au point de vue de la tradition
(il est attesté par tous les manuscrits exceptés Je Ks Pts ot
mainyanta est une faute évidente, car le sujet est (ahmat)ya; la
faute s’explique facilement par le mainyanta de la ligne précé-
dente), est donc vraisemblablement une innovation.
Pour définir la différence de valeur entre les deux classes de
désinences au subjonctif, si différence il y a, nous n’avons
®) Dans le Grundriss, Bartholomae considérait encore comme sub-
jonctifs mazdawho.dam (Gr.1, 1, p. 165; mais Dict., col. 1181 il le considére
comme aor, thém.), et dawha (Gr. J, 1, p. 63; mais Dict., col. 744: nom d'action).
INJONCTIF ET SUBJONCTIF DANS L'AVESTA 175
donc que les 3-émes pers. (sing. et plur.) de l’actif qui puissent
fournir des renseignements. Car la et seulement 1a il y a alter -
nance de désinences primaires avec les désinences secondaires.
Il semble que les matériaux fournis par les Gathas per~
mettent de tracer assez nettement cette différence. II résulte de
examen de ces matériaux (ils sont donnés complets) que les
désinences primaires du subjonctif expriment la réalité (future
ou méme présente) tandis que les désinences secondaires dé-
signent l’éventualité et la modalité (impératif futur).
A. Subjonctif & désinences primaires.
Il a la valeur de futur simple:
I. Dans les phrases affirmatives simples:
30, 14 at aipt tai§ avhaiti usta; 31, 22 hod toi mazda ahura
vazisto avhaiti asti3; 43, 6 acibyo rata songhaiti armaitis; 45,7 yehya
sav i8anti radavho yoi...; 51, 1 vohi x3afram... vidiSemnais... ada
antara. Earaiti; 53, 7 at va vayoi avhaiti apamam vaéo; cf. aussi avec
bava-, perfectif de ah-, 30, 10 aa zt ava drujo bavaiti skand6 spa-
ees
IL Dans les phrases interrogatives qui ne sont pas intro-
duites par une particule ou un pronom interrogatif (qui ne se
dinstinguent donc que par le ton de la phrase affirmative):
44, 6 aiam Syaotanais dabqzaiti armaitis? 47, 5 hanara fwah-
mal zaosat dragoa baxSaiti?
III. Dans les phrases relatives qui n’ont pas de couleur modale:
31, 5 ya... awhaiti; 31, 14 ta Gwa parasd ahura ya zt aili
jenghaitita; 33, 10 ya zi awhara yasta hanti yasta mazda bavaintt
(bav- servant de futur 8 ah- comme plus haut); 45, 7 yoi zi joa
avharata bvantiéa; 54, 13 ta dragvato maradaite daena arazaos hai-
Yim yehya@ urea xraodaiti; 53, 9 tat mazda tava xatlram ya ara-
Zajyoi dahi drigaove vahyo.
Les deux derniers exemples expriment des dogmes concer-
nant la récompense et la punition. C’est une réalité future,
il n’y a aucune nuance modale.
IV. Dans les phrases temporelles (a fond dogmatique):
30, 8 atéa@ yada aesgm kaend jimaiti aénawhqmat mazda taibyo
xSailram vohit manasha voividaitt; 48, 1 yezt adai§ drujam venghaiti;
48, 2 para hyat ma ya mang paratla jimaiti.
176 JERZY KURYLOWICZ
Le subjonctif 4 désinences primaires a la valeur de présent:
V. dans les phrases relatives généralisées si la phrase prin-
cipale contient un présent:
33, 2 at ya akam dragoaité vatavha va af va manawha zastoibya
va varasaili vavhau va oidaité aslim — toi varai radanti ahurahya
zao3é mazda.
Bartholomae considére radonti comme indicatif prés. Peut
&tre Zoifaite lui méme est-il aussi un indicatif, cf. le pré-
térit éoidat, 46, 9 (thématique). On ne voit pas pourquoi
Bartholomae pose un kaei athématique. varasaitt est équivalent
4 radanli et a éoitaité, c’est-a-dire il a le sens d’un ind. prés.
51, 6 ya vahyo vavhaus dazdé yaséa hoi varai radat... at ahmai akat
aSy0 ya hoi noit vidaitt. — dazdé est pr ésent, radat (inj.) remplace
un présent, vidaiti a donc le sens d’un présent; 51, 8 ho zi mgtra
Syato ya vidusé mravaiti. Cf. aussi le prétérit thém. mravat (45, 2).
B. Subjonctif 4 désinences secondaires.
Les désinences secondaires se rencontrent la ot Je subjonctif
exprime soit une action €ventuelle soit un désir dont l’accom-
plissement n’est possible que dans l'avenir.
Le subjonctif 4 désinences secondaires se rencontre:
I. Dans les phrases interrogatives introduites par une particule
ou un pronom interrogatif:
29, 9 kada yava hed awhat; 44, 12 éyavhat; 44, 19 ka tom
ahya maéni§ avhat paouruye; 46, 3 katibyo wai voha jimat manaeha;
48, 2 kat aiava mazda venghat dragoantam; 48, 11 kada mazda aka
mat aGrmaitis jimat; 49, 7 ka airyama ka xvaétu3 datais avhat;
48, 11 kang @ vavhaus jimat mananha Zistis.
De méme dans les phrases interrogatives indirectes:
28, 11 fro. ma si8a... yaiS 2 avhuk paouruyo bavat; 31, 14 parasa...
yaa ta avhan hankoraté hyat; 31, 16 parasa avat... yada hoo
avhat ya.syao%anaséa; 34, 12 fravacéa ya vidayat adi3 raingm.
Il. Dans les phrases modales:
a) d. 1. ph. finales:
30, 4 yataéa avhat apemam avhus atisto dragoaite (peut-étre
oraison indirecte); 44, 1 yata na a vohii jimat manavha; 53, 4 ya
fadrai vidat;
b) d. lL. ph. consécutives:
INJONCTIF ET SUBJONCTIF DANS L'AVESTA 177
30, 7 aeigm toi @ avhat yatla ayavha adanais paouruyd.
c) d. 1. ph. conditionnelles:
43, 4 hyat moi vavhaus haza jimat manavho.
Ill. Dans les phrases qui dépendent de phrases modales:
a) ph. dép. d'une interrogation:
29, 9 kada yava hv6 avhat ya hoi dadat zastavat avo.
b) ph. dép. d’un ordre ou d’un désir:
30, 9 até hoi vaem hyama yoi im faraiam karanaon; 43, 12
uziraidyai para hyat moi G.jimat saraoio; 46, 8 paityaoget 1a
ahmai jasdit doaesawha tanvam a ya im hujyatois payat; 51, 14 gavoi
Groi3 Gsanda xvaik syaoianai§ sanghaista ya sangho apamam
drajo demane Gdat.
c) ph. dép. d’une phrase finale:
30, 9 hyat hailré mana bavat yatlra dsti§ awhat maeila.
d) ph. dép. d’une phrase a éventuel:
31, 6 ahmai avhat... avat x3airam hyat hoi vaxkat; 43, 12
para hyat moi G.jim@t saraogo... ya vi... dayat,
e) Sont finales les phrases suivantes dépendantes d’inter-
rogations :
29, 7 kasté vohii manavha yo t dayét aaava maratacibyo;
44, 2 kaila awhous vahistahya paourvim kate siidyai ya im pai-
ti8at; 49, 7 ka... awhat ya vorazanai vanuhim dat frasastim.
IV, Aprés la négation:
31, 9 vastrat va Gite yo va noit avhat vastryo; 31, 5 ya noit
va avhat avhaiti va (opposition !).
V. Dans les phrases relatives généralisées qui ont une nuance
conditionnelle et se rapportent au futur:
31, 20 ya dyal asavanam divamnam hoi aparam xsyo; 33, 3
ya asauné vahisto... ai hod awhat aSahya vawhauséa vastré manawho;
45, 5 yoi mdi ahmai soraosam dan éayasé@ upajiman haurvata
amaratata; 46, 4 yastam x3athat mazda moi%at jyateus va hvo tang
fro.ga_pattmang hutistoi garat; 46, 6 at yastom noit nd isomno
ayatdrujo hve damgn haitya gat; 46, 10 ya va moi na@ gona va
mazda ahuré dayat avhouS-ya ta voista vahi8ta... fro tais vispais
invato frafra pearatiim; 48, 4 ya dat (injonctif) vasyo ‘mazda
asyaséa... Swahmi xrata apamam nand avhat; 31, 6 ahmai avhat
vahistam yo moi vidva vaokat hailltm.
12
178 JERZY KURYLOWICZ
L’action de la phrase relative étant éventuelle celle de
la phrase principale l’est aussi; dans les deux le subjonctif
& désinences secondaires est donc de régle.
Cf. aussi 30, 5 varatd. . atam mainyus spaniito... yaééa xinaoson
ahuram; 31,1 ta va ureata sanghamafit... aeibyé vahista yoi zarazda
avhan mazdai;
et a cété d’un parfait:
32,11 yoi cikoitaras... yoi vahistat aSaond mazda rarasygn manawho.
VI. Dans les phrases simples le subjonctif 4 désinences
secondaires exprime un ordre ou un désir (a réalisation future);
41, 4 kava avhat; 32, 2 ha na avhat; 43, 1 vasa x’aygs mazda
dayat ahuré; 50, 11 data awhau$ aradat voha manavha.
Dans ces quatre derniers exemples Bartholomae traduit le sub-
jonctif par un désir (ou ordre). Dans les autres exemples ot un
subjonctif & désinence secondaire se présente soit dans une phrase
simple soit dans une phrase relative pure, Bartholomae le traduit
par un futur ou un présent. D’aprés tout ce qui précéde nous
croyons pouvoir affirmer qu’il faut le traduire partout de la méme
maniére (ordre, désir), & moins qu'il n’exprime une éventualité.
31, 20 tam va ahum dragvanté syaoianais xvais dana naeiat “qu’a
cette vie-la vous conduise votre conscience”! Bartholomae
traduit: “vous conduira”. — 47, 1 toute la strophe avec le subj.
dgn “que nous accordent”! Bartholomae: “accorderont”.. —
48, 1 at toi savais vahmam vaxsat chur “qu’il éléve ton adorateur”!
Bartholomae: “élévera”. — 53, 7 aféa va mizdam aphat ahya
magahya “que vous revienne la récompense de cette alliance”!
Bartholomae: “vous reviendra”. — 53, 5 aa va anyo ainim
vivanghala tat zi hoi hu’enam avhat — “que ceci lui procure la
récompense” (quant a zi accompagnant une commande, cf.
Dictionnaire, col. 1695). Bartholomae: “lui procurera”. — 49, 11
0 damane haitlya avhan astayd “quils soient (a la fin) hétes
dans la maison de la Drug.” Bartholomae: “ils seront”. — 48, 6
at aliyai aa mazda ureara vaxiat “que Mazda laisse pousser
(dorénavant) les plantes pour lui (le boeuf). Bartholomae: “il
laisse pousser”. .
A ces exemples il faut peut-étre joindre les suivants:
29, 4 ata na avhat yatla hvd vasot “que nous advienne ce
qu'il voudra”. Bartholomae: “adviendra”. — 46, 11 yang xva
INJONCTIF ET SUBJONCTIF DANS L'AVESTA 179
urea xvaeéa xraodat'’) daéna hyat aibi.gaman yailra éinvats parotus
“quils aient peur de leur propre conscience”. Bartholomae:
“auront peur”, — 48, 12 at toi avhan saogyanto dakyungm yoi
xinam vohii mansha hatante “que ceux-la deviennent les sauveurs
des pays...” Bartholomae: “sont”. — 50, 5 ardi. zi xima... zastaista
ya na xvailre dayat “qui puissent (un jour) nous transporter au
paradis“. Bartholomae: “qui nous transportent”.
Il y a enfin 6 exemples qui sont nettement contraires:
a) Désinences secondaires au lieu de désinences primaires:
31, 4 yada aiam zavim avhan mazdaséa ahuranho; 44,19 vidoa
avgm ya im arhat apama.
b) Désinences primaires au lieu de désinences secondaires:
44, 19 yastat mizdam hananteé noit daitt ka tam ahya maénis
avhal paouruye; 45, 3 yoi im va noit ida m@giram varaganti-aéibyo
avhaus avdi avhat apamam; 46, 19 ya modi aSal hata varasaiti...ahmai
mizdam hananté parahim...gava azi; 50, 3 atéa ahmai mazda aka
avhaili..ya nd as6iS aojavha varadayaeta.
Il resterait 4 rechercher si la répartition que nous venons
de préciser est de date ancienne. Une analyse détaillée du
Rigveda pourrait seule fournir une réponse satisfaisante. Si cette
derniére est négative, il restera néanmoins vrai, que la réparti-
tion est clairement esquissée dans les Gathas, et on pourra
admettre qu’elle est secondaire et provoquée par l’opposition du
présent (désinences primaires; réalité) et de l'injonctif (désinen-
ces secondaires; modalité entre autres).
©) Opposition avec xraodaiti (futur; 51, 13). Cf plus haut.
12*
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Hoffmann-Das Kategoriensystem Des Indogermanischen VerbumsDocument13 pagesHoffmann-Das Kategoriensystem Des Indogermanischen VerbumsGeorgios TsamourasNo ratings yet
- 20230127150704949Document1 page20230127150704949Georgios TsamourasNo ratings yet
- 20230421153312972Document21 pages20230421153312972Georgios TsamourasNo ratings yet
- Perfect STHĀDocument2 pagesPerfect STHĀGeorgios TsamourasNo ratings yet
- Retrospektivität Im Rigveda: Aorist Und PerfektDocument32 pagesRetrospektivität Im Rigveda: Aorist Und PerfektGeorgios TsamourasNo ratings yet
- The Augment in Homer (Continued)Document18 pagesThe Augment in Homer (Continued)Georgios TsamourasNo ratings yet
- Greek and Latin From An Indo-EDocument7 pagesGreek and Latin From An Indo-EGeorgios TsamourasNo ratings yet
- Mycénien Et Grec D'homèreDocument11 pagesMycénien Et Grec D'homèreGeorgios TsamourasNo ratings yet
- 44518873070002321Document19 pages44518873070002321Georgios TsamourasNo ratings yet
- Mélanges de Linguistique Offerts À M. Ferdinand de Saussure: Source Gallica - BNF.FR / Bibliothèque Nationale de FranceDocument335 pagesMélanges de Linguistique Offerts À M. Ferdinand de Saussure: Source Gallica - BNF.FR / Bibliothèque Nationale de FranceGeorgios TsamourasNo ratings yet
- 20230331152006690Document7 pages20230331152006690Georgios TsamourasNo ratings yet
- 20230327160013471Document8 pages20230327160013471Georgios TsamourasNo ratings yet
- 20200424221353Z VishnouismeDocument15 pages20200424221353Z VishnouismeGeorgios TsamourasNo ratings yet
- The Unaugmented Verb-Forms of The Rig - and Atharva-VedasDocument37 pagesThe Unaugmented Verb-Forms of The Rig - and Atharva-VedasGeorgios TsamourasNo ratings yet
- Inscriptions Osques Ornées D'images de MonnaiesDocument15 pagesInscriptions Osques Ornées D'images de MonnaiesGeorgios TsamourasNo ratings yet
- Ya - Presents STHĀDocument3 pagesYa - Presents STHĀGeorgios TsamourasNo ratings yet
- P1clas01 CDocument17 pagesP1clas01 CGeorgios TsamourasNo ratings yet
- 20200318131936Z Gonda BeginningDocument20 pages20200318131936Z Gonda BeginningGeorgios TsamourasNo ratings yet
- 20200318121119Z VedismeDocument23 pages20200318121119Z VedismeGeorgios TsamourasNo ratings yet
- 20200401225754Z Naissance BouddhismeDocument13 pages20200401225754Z Naissance BouddhismeGeorgios TsamourasNo ratings yet
- 20200430191222Z ShivaismeDocument10 pages20200430191222Z ShivaismeGeorgios TsamourasNo ratings yet
- auteurs-BAC1-Dém. Corona-Début Du Texte - CopieDocument2 pagesauteurs-BAC1-Dém. Corona-Début Du Texte - CopieGeorgios TsamourasNo ratings yet
- Altiranischeswr00bartgoog PDFDocument1,041 pagesAltiranischeswr00bartgoog PDFGeorgios TsamourasNo ratings yet
- Hodel 2 GuidelinesDocument11 pagesHodel 2 GuidelinesGeorgios TsamourasNo ratings yet
- Francois G., Grammaire Latine. Trad. Exemples (1976) - OCR - CopieDocument52 pagesFrancois G., Grammaire Latine. Trad. Exemples (1976) - OCR - CopieGeorgios TsamourasNo ratings yet
- Apparat Critique-Sigles Et Quelques Abréviations - CopieDocument1 pageApparat Critique-Sigles Et Quelques Abréviations - CopieGeorgios TsamourasNo ratings yet
- Power Point MémoireDocument12 pagesPower Point MémoireGeorgios TsamourasNo ratings yet
- Traduction CorrigéeDocument7 pagesTraduction CorrigéeGeorgios TsamourasNo ratings yet
- Apparat Critique-Présentation Et StructureDocument1 pageApparat Critique-Présentation Et StructureGeorgios TsamourasNo ratings yet
- GrEpiAbbr 2version Janvier2022Document26 pagesGrEpiAbbr 2version Janvier2022Georgios TsamourasNo ratings yet